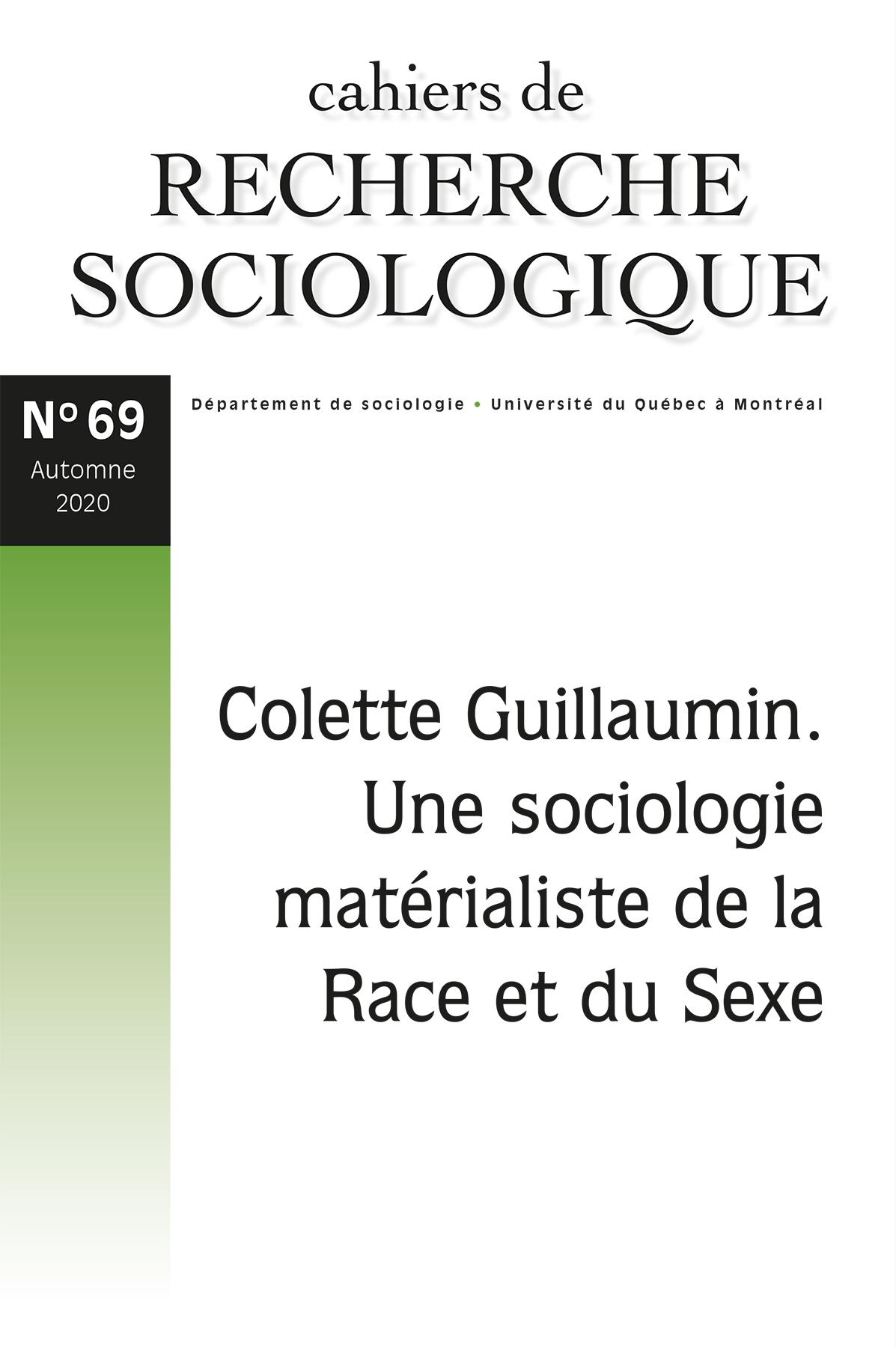Ici, nous exposerons d’abord notre lecture du contexte dans lequel intervient ce numéro ainsi que sa problématique. Dans un second temps, nous reviendrons sur le matérialisme de Colette Guillaumin pour préciser ce qu’il implique sur les plans théoriques et méthodologiques au regard des débats d’actualité concernant les relations qu’entretiennent les différents rapports de pouvoir et les manières de les théoriser. Enfin, en guise d’ouverture, nous dégagerons des pistes prospectives de recherches à partir de ce que nous tenons pour des contributions majeures de Colette Guillaumin, non seulement à la sociologie de la domination mais à « la sociologie de la sociologie ». Les textes rassemblés dans ce numéro interviennent 50 ans après la parution de L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel (1972), alors que les racismes ne s’épuisent pas et que la mise en concurrence des luttes (de classe, de sexe et de race) (Benveniste, Falquet et Quiminal, 2017) a notamment pour effet de réactiver le paradigme de la lutte principale avec ses ennemis secondaires ; une « hiérarchie non prouvée ». C’est néanmoins dans ce contexte, et dans un élan critique notamment féministe sur la question de la race et du rapport colonial, que l’on semble redécouvrir Colette Guillaumin et son travail pionnier sur le racisme (Bertheleu et Rétif, ce numéro). Si ce dernier a incontestablement nourri sa réflexion sur le sexisme, il est lui-même ancré dans les rapports sociaux de sexe (Juteau, ce numéro [1995]). Véritable « tournant dans l’histoire des idées » (Juteau, 1998), L’idéologie raciste marque cependant « l’histoire d’un tournant qui ne s’opérera pas ; celui de l’étude des rapports sociaux de race en France. Il faudra trente ans pour que réémerge ce livre… » (Naudier et Soriano, 2010, p. 193) dans la société même où Guillaumin l’aura produit. Au moment de sa parution, il inaugure une rupture majeure avec la définition raciste du racisme (Guillaumin, 1992, p. 92) qui le comprend pour l’essentiel comme une « conduite hostile », moralement réprouvable, vis-à-vis d’un groupe déjà désigné et perçu comme absolument autre et particularisé dans l’univers social. Tandis que l’idéologie raciste est ainsi communément appréhendée comme une doctrine qui hiérarchise « des races » comprises comme des unités déjà-là, Guillaumin démontre que c’est justement la croyance en l’existence de catégories naturelles, closes sur elles-mêmes et dotées d’un déterminisme interne, qui constitue l’idéologie raciste. Spécifique au racisme tel que nous le connaissons en Occident, cette idéologie prend forme avec le développement des sciences modernes, au moment même où la prolétarisation et la colonisation « présentent un caractère systématique » (Guillaumin, 2002, [1972], p. 46). Loin de constituer un phénomène autonome, elle est la forme mentale du rapport spécifique d’appropriation du travail qui caractérise « l’esclavage des XVIIIe et XIXe siècles dans les États de la première accumulation industrielle » (1978b, p. 13). Dans et par ce rapport, les corps sont appropriés et marqués, réduits à l’état de choses ou d’outils, et ce dans les faits comme dans la pensée. Ainsi, « …la marque suivait l’esclavage et ne précédait nullement le groupe des esclaves; le système esclavagiste était déjà constitué lorsqu’on s’est avisé d’inventer les races » 2002, [1977], p. 337, Italiques dans l’original). Cette déconstruction de la notion de race dans sa forme moderne, qui procède de l’examen minutieux de son avènement et d’une inversion du rapport entre race et racisme (la race suit le rapport social ; il la précède en fait et la produit, contrairement à l’entendement populaire et scientifique d’alors) informe le raisonnement de Colette Guillaumin sur le sexe. Tous deux impliquent l’Idée de Nature (Guillaumin, 1978b), laquelle exprime un …
Parties annexes
Bibliographie
- Abreu, M., Falquet, J., Fougeyrollas-Schwebel, D. et Noûs, C. (2020). Penser avec Colette Guillaumin aujourd’hui. Cahiers du Genre, 68.
- Amiraux, V. et Sallée, N. (2017). Colette Guillaumin (1934-2017). Sociologie et sociétés, 49(1), 153-154.
- Bilge, S. (2010). De l’analogie à l’articulation ; théoriser la différenciation sociale et l’inégalité complexe. L’Homme & la Société, 176-177, 43-64.
- Cognet, M., Dhume, F. et Rabaud, A. (2017). Comprendre et théoriser le racisme. Apports de Véronique De Rudder et controverses. Journal des anthropologues, 3(150-151), 43-62.
- Bentouhami, H. et Guénif-Souilamas, N. (2017). Avec Colette Guillaumin ; penser les rapports de sexe, race, classe. Les paradoxes de l’analogie. Cahiers du Genre, 63(2), 205-219.
- Benveniste, A., Falquet, J. et Quiminal, C. (2017). En femmage à Véronique De Rudder, Nicole-Claude Mathieu et Colette Guillaumin, précurseures de la dénaturalisation de la race et du sexe. Journal des anthropologues, (150-151), 25-42.
- Delphy, C. (2013). L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, Paris ; Syllepse
- Delphy, C. (2003). Pour une théorie générale de l’exploitation (I) ; en finir avec la théorie de la plus-value. Mouvements, 26, 69-78.
- Dorlin, E. (2005). « De l’usage épistémologique et politique des catégories de « sexe » et de « race » dans les études sur le genre », Cahiers du genre, 39, 83-105.
- Falquet, J. (2016). Entretien avec Jules Falquet ; Matérialisme féministe, crise du travail salarié et imbrication des rapports sociaux, Cahiers du GRM [en ligne], 10|2016 http;//journals.openedition.org/grm/839
- Feldman, J. (1980), La sexualité du Petit Larousse ou le Jeu du dictionnaire, Paris ; Éditions Tierces.
- Galerand, E. et Kergoat, D. (2014). Consubstantialité vs intersectionnalité ? À propos de l’imbrication des rapports sociaux. Nouvelles pratiques sociales, 26(2), 44-61.
- Galerand, E. (2015). Quelle conceptualisation de l’exploitation pour quelle critique intersectionnelle ? Recherches féministes, 28(2), 179-197.
- Guillaumin, C. ([1998] 2017). La confrontation des féministes en particulier au racisme en général ; Remarques sur les relations du féminisme à ses sociétés, Sociologie et sociétés, 49(1), 155-162.
- Guillaumin, C. (1992). Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris ; Éditions Côté-Femmes.
- Guillaumin, C. (1981). Femmes et théories de la société ; remarques sur les effets thériques de la colère des opprimées. Sociologie et sociétés, 13(2), 19-32.
- Guillaumin, C. (1978a). Pratique du pouvoir et idée de nature (1), L’appropriation des femmes. Questions féministes, (2) « Les corps appropriés » [rééd. in (2016). Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature. Donnemarie-Dontilly ; Éd. iXe].
- Guillaumin, C. (1978b). Pratique du pouvoir et idée de nature (2), Le discours de la nature. Questions féministes, (3) « Natur-elle-ment » [rééd. in (2016). Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature. Donnemarie-Dontilly, Éd. iXe].
- Guillaumin, C. (1977). Race et nature ; système de marques, idée de groupe naturel et rapports sociaux, Pluriel, 11, 39-55.
- Guillaumin, C. (1972). L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel. Paris ; Mouton.
- Guillaumin, C. ([1972] 2002). L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel. Paris ; Gallimard.
- Hall, S. (1980). Race, articulation and societies structured in dominance. Dans UNESCO (dir.), Sociological Theories ; Race and colonialism. Paris ; UNESCO, 305-345.
- Juteau, D. (1981). Visions partielles, visions partiales ; visions des minoritaires en sociologies. Sociologie et sociétés, 13(2), 33-48.
- Juteau, D. et Laurin-Frenette, N. (1988). L’évolution des formes de l’appropriation des femmes ; des religieuses aux « mères porteuses », Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie, 25(2), 183-207.
- Juteau, D. (1995). Introduction. (Re)constructing the categories of « race » and « sex » ; The work of a precursor. Dans C. Guillaumin, Racism, Sexism, Power, and Ideology. Critical studies in racism and migration (p. 1-28). London ; Routledge.
- Juteau, D. (2017a). La sociologue Colette Guillaumin est morte, Le Monde, 18 mai.
- Juteau, D. (2017b). Sur la pensée de Colette Guillaumin ; Entretien avec Danielle Juteau, réalisé par Valérie Amiraux et Nicolas Sallée. Sociologie et sociétés, 49(1), printemps, 163-175.
- Juteau, D. (2016). Un paradigme féministe matérialiste de l’intersectionnalité. Cahiers du Genre, hs 4(3), 129-149.
- Juteau, D. (2010). « Nous » les femmes ; sur l’indissociable homogénéité et hétérogénéité de la catégorie. L’Homme & la société, (176-177), 65-81.
- Juteau, D. ([1999] 2015). L’ethnicité et ses frontières. Montréal ; Presses de l’Université de Montréal.
- Le Doeuff, M. (1998). Le sexe du savoir. Paris ; Aubier.
- Mathieu, N.-C. (1973). Homme-culture et femme nature ? L’Homme. 13(3), 101-113.
- Mathieu, N.-C. (1971). Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe. Épistémologie sociologique, 11, 19-39.
- Michard, C. (2019). Humain/Femelle de l’humain. Effet idéologique du rapport de sexage et notion de sexe en français. Montréal ; Éditions sans fin.
- Michard, C. (1996). Genre et sexe en linguistique ; les analyses du masculin générique. Mots. Les langages du politique, 49, 29-47.
- Naudier, D. et Soriano, É. (2010). Colette Guillaumin. La race, le sexe et les vertus de l’analogie. Cahiers du Genre, 48(1), 193-214.
- Pietrantonio, L. (2018). Dévoiler le sujet social normé de tout rapport de pouvoir et (re)penser l’émancipation. Université féministe d’été – conférence d’ouverture, mai.
- Pietrantonio, L., Bouthillier, G. (2015). Comprendre l’hétérogénéité sociale pour faire valoir la diversité. Recherches féministes, 28(2), 163-178.
- Pietrantonio, L. (2005). Égalité et norme. Pour une analyse du majoritaire social. Mots. Les langages du politique, 78, 10-10.
- Pietrantonio, L. (2002).Who is « We » ? An Exploratory Study of the Notion of « the Majority » and Cultural Policy. Canadian Ethnic Studies, 34(3), 142-156.
- Simon, P.-J. (2006). Pour une sociologie des relations interethniques et des minorités. Rennes ; Presses Universitaires de Rennes.
- Tabet, P. (1979). Les mains, les outils, les armes. L’Homme, 19(3-4), 5-61.
- Wirth, L. (1945). « The Problem of Minority Groups ». Dans R. Linton (dir.). The Science of Men in the World in Crisis. New York ; Morningside Heights-Columbia University Press.
- Wittig, M. (1992). The Straight Mind and Other Essays. Boston ; Beacon Press.