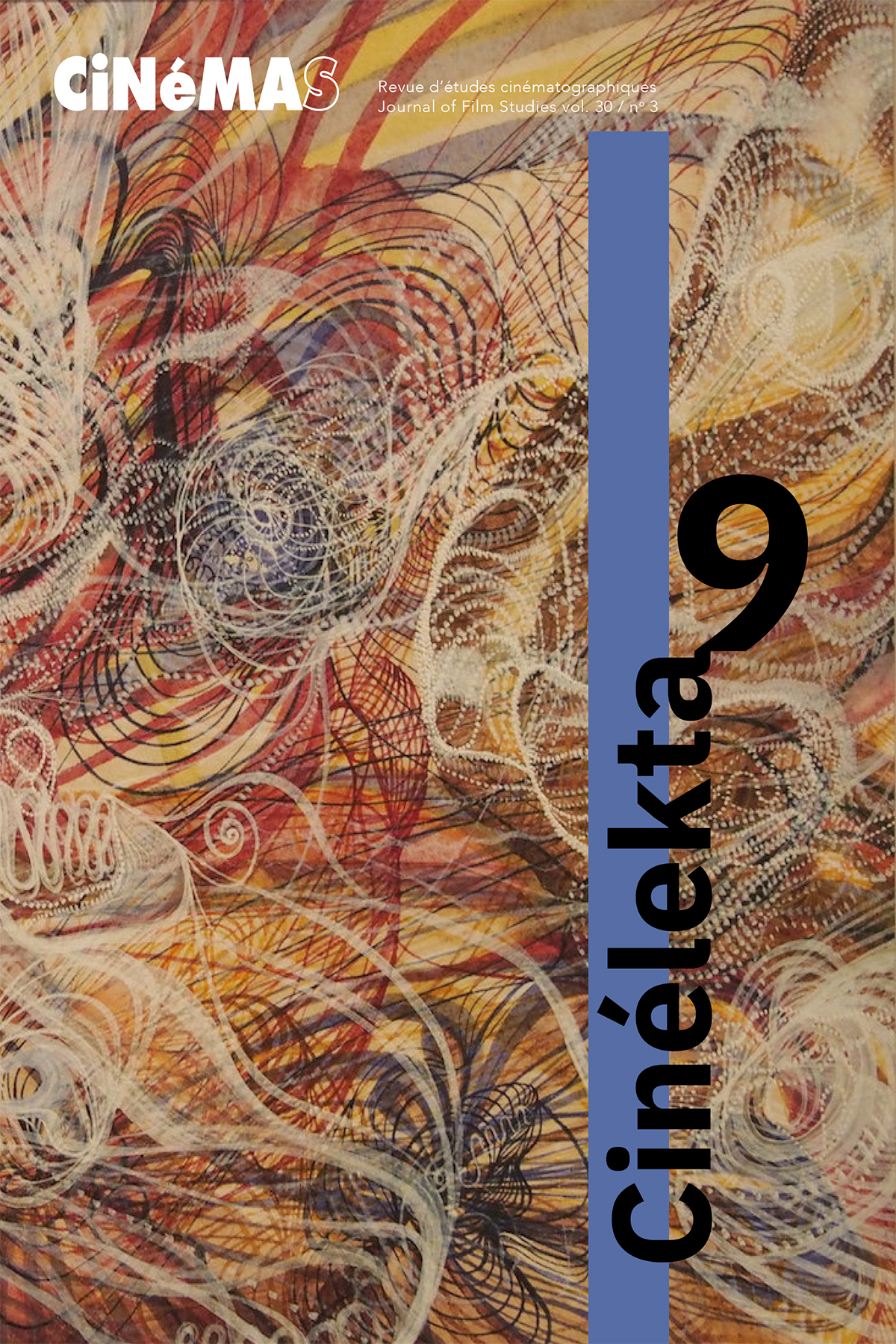Résumés
Résumé
En dépit d’un regain d’intérêt pour la science-fiction depuis les années 2000, le nombre de longs-métrages du genre reste limité au Brésil. Cependant, la production de courts-métrages de science-fiction y est abondante, et plus récemment, on a vu quelques longs-métrages brésiliens affiliés au genre avoir un grand impact sur l’opinion publique et la critique. Ainsi, la science-fiction brésilienne peut être qualifiée de « baromètre » des tensions sociales et politiques dans le pays, avec sa longue histoire d’arbitraire, d’exclusion et de conflit permanent entre conservatisme et modernité, soit des aspects qui ont toujours façonné les contradictions internes de la société brésilienne. Cet article propose une brève histoire critique du cinéma brésilien de science-fiction vis-à-vis les tensions politiques au Brésil, de la moitié du xxe siècle jusqu’au temps présent.
Abstract
Despite the renewed interest in science fiction since the 2000s, the number of feature films in the genre remains limited in Brazil. Yet an abundant number of short science fiction films are produced there, and more recently we have seen a few Brazilian feature films affiliated with the genre have great impact on public and critical opinion. Brazilian science fiction can thus be described as a “barometer” of social and political tensions in the country, with its long history of arbitrary and exclusionary practices and of constant conflict between conservatism and modernity, aspects which have always shaped the internal contradictions of Brazilian society. This article offers a brief critical history of Brazilian science fiction film in the context of the country’s political tensions from the mid-twentieth century to the present day.
Corps de l’article
Le Brésil, « terre d’avenir » selon Stefan Zweig et pays qui a prêté son nom à la fameuse dystopie de Terry Gilliam (1985), n’est pas pour autant un pôle de production reconnu de la science-fiction. Même au sein de la sphère latino-américaine, l’Argentine et le Mexique viennent plus aisément à l’esprit. Si le cinéma brésilien de science-fiction ressemble à une planète silencieuse, les raisons peuvent en être multiples (Suppia 2013, 319-47). En effet, selon Mary Elizabeth Ginway, « la science-fiction [brésilienne] souffre […] de l’idée qu’un pays du tiers monde ne pourrait pas authentiquement produire un tel genre » (2005, 27)[1]. Elle ajoute :
La science-fiction pourrait être considérée comme « inauthentique », c’est-à-dire non représentative de la culture brésilienne. En tant que genre issu des sociétés industrialisées, il vaut peut-être mieux le considérer comme ce que Roberto Schwarz a appelé « des idées déplacées », c’est-à-dire un exemple de l’importation de modèles littéraires étrangers au Brésil.
Ginway 2005, 27
Ce diagnostic posé à l’endroit de la littérature peut être étendu au cinéma. Le concept « d’idées déplacées » de Roberto Schwarz (2000), un auteur qui, en compagnie de Darcy Ribeiro (2006 ; 2008)[2], renvoie aux contradictions affectant la société brésilienne à la fin du xixe siècle, soit la difficulté d’assimilation de modèles issus de l’étranger, à la fois appréciés et contradictoires avec l’organisation sociale, économique et politique du Brésil. La science-fiction dans le cinéma brésilien est ainsi perçue comme un « intrus extraterrestre ». Ce paradoxe s’accompagne d’une relation ambivalente avec la modernisation technique, liée dans le cas du Brésil à une homogénéisation culturelle forcée, associée à l’héritage de l’esclavage, qui crée des écarts considérables entre les classes sociales : « Il n’y a pas eu d’amélioration pour les travailleurs lorsque nous sommes entrés dans la civilisation industrielle […] régie par des sociétés multinationales » (Ribeiro 2008, 31). Il en résulte une tension persistante entre archaïsme et modernisation, qui est aussi le fait des classes dirigeantes, arc-boutées sur « leurs intérêts et privilèges, fondés sur un ordre structurel archaïque et un mode d’articulation malheureux avec l’économie mondiale » (Ribeiro 2006, 228). Francisco Alberto Skorupa s’est interrogé sur le rapport entre la vision de la science-fiction au Brésil et son niveau de modernisation technologique, en lien avec l’enseignement des sciences, mais selon lui, « le rôle joué par le développement scientifique et technologique dans la production de science-fiction est controversé » (2002, 93). Skorupa souligne qu’il existe une forte corrélation entre le développement scientifique et technologique et la production de science-fiction, en particulier depuis la révolution industrielle et l’explosion scientifique des xixe et xxe siècles, en particulier aux États-Unis, en ex-URSS, au Royaume-Uni, en France, au Japon et en Allemagne. Pourtant, cet aspect n’est pas l’unique obstacle au développement d’un cinéma de science-fiction brésilien. Ces difficultés sont certainement multifactorielles : préjugés artistiques valorisant le réalisme, manque de politiques publiques cohérentes pour le développement scientifique et technologique, absence d’une « culture de l’invention », spécificités des marchés brésiliens de l’édition et de l’audiovisuel…
Le cinéma de science-fiction brésilien a néanmoins connu une tradition spécifique, au moins depuis 1962, dans une période particulièrement faste pour le cinéma brésilien (Ramos 1987, 340) – les années 1960 ont été fondamentales pour l’internationalisation et l’essor de la valeur artistique du cinéma de science-fiction (Hardy 1995, 196). C’est donc en 1962 que sortent, au Brésil, deux films marquants, O Quinto Poder et Os Cosmonautas, représentant respectivement deux volets fondamentaux du panorama brésilien du genre : le « sérieux dramatique » et le « ludique carnavalesque[3] », ce dernier étant plus populaire que le premier. O Quinto Poder, réalisé par Alberto Pieralisi et scénarisé par Carlos Pedregal, se situe plutôt dans la veine des thrillers d’espionnage en s’appuyant sur une conjecture scientifique – l’hypothèse d’une technique de manipulation mentale à grande échelle. La comédie Os Cosmonautas, réalisée par Victor Lima et produite par Herbert Richers, résonne avec les thèmes de son époque : le rêve d’envoyer des hommes sur la Lune, le danger posé par la crise des missiles cubains, le tout, dans la continuité des chanchadas[4]. Parmi les points de repère significatifs de l’évolution du cinéma brésilien de science-fiction, citons : Brasil Ano 2000 (Walter Lima Jr., 1969), le récit d’un après Troisième Guerre mondiale qui marque une période plus politisée du genre en utilisant les codes de la science-fiction afin de détourner l’attention de la censure ; Parada 88 – O Limite de Alerta (José de Anchieta, 1978), une écodystopie montrant les habitants d’une ville victime d’un accident industriel, enfermés dans des souterrains et obligés de payer pour avoir de l’air pur, voire se faire greffer des poumons cybernétiques[5] ; et Amor Voraz (Walter Hugo Khouri, 1984), une histoire d’amour entre une femme et un visiteur extraterrestre.
Le début des années 1960 était fondamental pour la visibilité mondiale du cinéma brésilien avec l’éruption du Cinema Novo. Selon Fernão Ramos, une nouvelle ère pour le cinéma national débutait avec la Palme d’Or à Cannes décernée à O Pagador de Promessas, réalisé par Anselmo Duarte, ainsi qu’avec le succès de Barravento de Glauber Rocha à Karlovy Vary, de Couro de Gato de Joaquim Pedro de Andrade à Sestri-Levante, d’OAssalto ao Trem Pagador de Roberto Farias à Venise, et finalement d’Os Cafajestes de Ruy Guerra à Berlin – une récolte impressionnante de prix pour ces films, tous sortis en 1962. « 1962 a définitivement été l’année de l’affirmation du cinéma brésilien » (Ramos 1987, 340).
Vers la fin des années 1960, après le coup civil-militaire en 1964 et la création de l’Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), un modèle plutôt étatisé de production cinématographique s’est installé. L’avant-gardisme du Cinema Novo a perdu sa puissance initiale, cherchant à établir une communication plus soutenue avec le public. Ainsi, pendant la fin des années 1960, et tout au long des années 1970, l’iconographie de science-fiction est régulièrement intervenue dans les films plus expérimentaux du Cinema Novo ou du « cinéma marginal » (par exemple, Hitler 3o Mundo de José Agripino de Paula, 1968 ; O Anunciador de Paulo Bastos Martins, 1970 ; Quem é Beta ? de Nelson Pereira dos Santos, 1973). Dans plusieurs de ces films, le concept d’allégorie émerge de façon instrumentalisée, soit comme une clé de lecture pour l’histoire du Brésil et d’un cinéma du tiers monde, soit comme une stratégie pour échapper à la censure – ou encore les deux en même temps. C’est le cas, par exemple, du film de science-fiction Brasil Ano 2000 de Walter Lima Jr., affilié au Cinema Novo et analysé en profondeur par Ismail Xavier (1993, 119-37). Selon Flávio Kothe, « allégorie signifie littéralement “dire l’autre” » (1986, 7). C’est la représentation concrète – ici, sous la forme d’un message audiovisuel – d’une idée abstraite, une forme d’imagerie narrative ou visuelle dont le sens évident ou littéral masque un ou plusieurs sens, généralement dans un but didactique. L’allégorie est souvent définie comme une métaphore élargie et soutenue (Macey 2000, 8).
Bien que des auteurs comme Seo-Young Chu (2010, 75-80) ne reconnaissent aucune utilité au rôle de l’allégorie dans les études de science-fiction, encore moins une définition de la science-fiction qui assimile le genre à une forme d’allégorie, dans le cas brésilien, en revanche, la notion d’allégorie peut avoir une fonction clé, surtout pendant les années 1968-69 et tout au long des années 1970 : « Articulée à la conscience de la crise du pays, de la langue capable de “le dire”, du cinéma capable d’être politique, dans la seconde moitié des années 1960, l’usage des allégories » (Xavier 1993, 10) se consolide.
Le cinéma brésilien de science-fiction des années 1980, et même après, intègre la science-fiction dans un cadre parodique, que ce soit avec les comédies de la troupe Os Trapalhões[6], la pornochanchada[7], ou les films carnavalesques d’Ivan Cardoso mêlant érotisme, satire et hommage aux séries B — le « Terrir ». Dans le contexte des années 1980 et 1990, très difficiles pour le cinéma brésilien – en 1990, le gouvernement néolibéral du président Fernando Collor de Mello ferme Embrafilme, l’entreprise d’État qui subventionnait le secteur –, la production cinématographique de science-fiction s’est raréfiée[8].
En dépit d’un regain d’intérêt pour ce genre depuis les années 2000, le nombre de longs-métrages de science-fiction reste limité au Brésil. Cependant, on note que, plus récemment, les quelques longs-métrages brésiliens affiliés au genre ont eu un grand impact sur l’opinion publique et la critique (par exemple, Bacurau de Juliano Dornelles et Kleber Mendonça Filho, 2019, et Divino Amor de Gabriel Mascaro, 2019). Il nous paraît néanmoins pouvoir à nouveau être qualifié de « baromètre » (Ginway 2005, 211[9]) des tensions sociales et politiques dans le pays, avec sa longue histoire d’arbitraire, d’exclusion et de conflit permanent entre le conservatisme et la modernité, des aspects qui ont toujours façonné les contradictions internes de la société brésilienne. Nous allons ici tâcher d’en identifier les aspects saillants[10].
« Déchiffrer » la société contemporaine – un cinéma dystopique
Depuis 2007, différents projets audiovisuels se sont appuyés sur la science-fiction pour poser un regard critique sur la société brésilienne. Parmi les oeuvres ayant reçu une reconnaissance internationale, il y a la série 3 %, qui après un projet pilote en 2010, a été diffusée par Netflix en 2016, devenant ainsi « la production originale non anglaise la plus regardée aux États-Unis[11] ». Il y a également Uma História de Amor e Fúria (Rio 2096, Luiz Bolognesi, 2013), récompensé par le prix du Meilleur Film au Festival d’Annecy. Ce long-métrage d’animation retrace l’histoire du Brésil pendant environ 600 ans, du point de vue d’un indigène Tupinambá, personnage immortel qui traverse les siècles à la recherche des réincarnations de sa femme bien-aimée, tout en se battant pour la défense du peuple opprimé. La science-fiction permet ainsi à des réalisateurs brésiliens de faire entendre des voix dissonantes et de dénoncer des injustices sociales. Les deux oeuvres les plus représentatives de cette tendance, par leur réception publique et leur accueil critique, pourraient bien être le court-métrage Recife Frio (Kleber Mendonça Filho, 2009) et le long-métrage Branco Sai, Preto Fica (Adirley Queirós, 2014, gagnant du prix du Festival de Brasília en 2014). Des films comme Branco Sai, Preto Fica, mais surtout Rio 2096 et le court-métrage Gambiarra : O HD de Espadas (2019)[12] de Frederico Cardoso et Gustavo Colombo, peuvent être associés à la tendance de la science-fiction brésilienne que Roberto de Sousa Causo (1996 ; 2015) appelait « Tupinipunk », un cyberpunk avec couleurs tropicales inséré dans le contexte d’un pays en voie de développement[13].
Branco Sai, Preto Fica (désormais BSPF) est une fiction spéculative qui traite de la citoyenneté et des droits civiques attaqués par l’État brésilien. Un voyage dans le temps permet de revisiter un événement réel de 1986, lorsque la police a lancé une attaque contre le Quarentão, un bal de musique noire organisé à Ceilândia[14]. Le titre du film fait référence à l’ordre d’un des policiers incriminés : « Les Blancs dehors, les Noirs dedans », ce qui signifie cibler les participants en fonction de leur couleur de peau pour s’acharner sur les Noirs au creux de la nasse policière. Le voyage temporel permet ainsi d’affronter un traumatisme collectif de la société brésilienne[15]. Venant d’un avenir plus lointain, le voyageur temporel Dimas Cravalanças (Dilmar Durães) arrive à Ceilândia dans un avenir proche et indéterminé, où vivent deux personnages : l’animateur de radio Marquim (interprété par Marquim do Tropa, chanteur d’un groupe connu sous le nom de Tropa de Elite) et Sartana (interprété par Shockito), un technicien spécialisé dans la réparation de prothèses. Ces deux personnages, dont les profils et le style de vie chevauchent en réalité ceux des acteurs qui les incarnent, ont survécu à la nuit d’agressions policières dans le Quarentão, portant sur leurs corps les stigmates de la violence : Marquim est devenu paraplégique après avoir été battu par la police et Sartana a perdu une jambe après avoir été piétiné par la cavalerie[16]. Les témoignages de Marquim do Tropa et de Shockito se présentent entremêlés de scènes de fiction dans lesquelles leurs personnages, Marquim et Sartana, élaborent un plan pour se venger. Dans cet avenir alternatif de Ceilândia, les deux survivants de l’incident du Quarentão prévoient attaquer Brasília avec une sorte de bombe sonique, un engin apocalyptique qui inclut des variétés de bruits et des musiques populaires authentiques de la banlieue de la capitale fédérale.
L’avenir proche représenté dans BSPF est très dystopique, marquant une aggravation de la ségrégation raciale et sociale : un État policier raciste exclut les communautés périphériques de Brasília, en gardant sous surveillance toute la circulation dans le Plano Piloto[17]. L’esthétique du film rappelle celle de La Jetée de Chris Marker (1962) ou de Je t’aime, je t’aime (1968) d’Alain Resnais : très peu de justifications techniques pour la machine temporelle et une recherche du passé obsessionnelle, visant ici à rassembler des preuves sur la responsabilité de l’État brésilien. Ainsi, trois moments ou « chronotopes » se chevauchent dans BSPF : (1) le passé récent, à savoir les années 1980, lorsque l’incident du Quarentão a eu lieu ; (2) le futur proche, où le voyageur temporel Dimas Cravalanças recherche les preuves et les survivants du Quarentão ; et (3) un avenir plus lointain, pratiquement hors de l’écran, où l’État brésilien est poursuivi en justice. Le passé récent est principalement évoqué ou reconstitué au moyen de séquences d’archives ou de photographies de l’incident du Quarentão en 1986, ainsi que des souvenirs rappelés par les personnages. L’avenir le plus lointain n’est évoqué que dans les scènes dans lesquelles le voyageur du temps enregistre ou établit un contact audiovisuel à distance avec son patron. À cet égard, ce film est représentatif d’une science-fiction « lo-fi », sans effets spéciaux majeurs, en jouant d’un mirage conceptuel et en s’appuyant sur la musique et le son, le chant et la voix de la banlieue noire afrodescendante (voir Suppia et Gomes 2015 ; Reis, Mena et Imanishi 2013) : Marquim enregistre le forró « Dança do jumento » de la Banda Família, un rap de Dino Black et les bruits des rues de Ceilândia, soit les sons de la banlieue.
L’idée d’un voyageur temporel qui doit recueillir les preuves d’un crime commis par l’État pour un procès ultérieur semble provocatrice pour deux raisons. D’abord, le voyageur du temps dans BSPF renvoie au paradigme identifié par Roberto de Sousa Causo : les personnages des récits brésiliens de voyage dans le temps sont généralement des observateurs passifs qui n’exercent presque aucune influence sur le cours de l’histoire (Causo 2003, 145). Les actions de Cravalanças n’ont aucun effet sur Ceilândia ni sur les personnages qui habitent ce chronotope. Il n’y a pas de contact entre le voyageur temporel et Marquim ni avec Sartana. Cravalanças ne voyage pas dans le passé pour changer l’histoire en détruisant toute « l’injustice » – une tentative qui s’est soldée par un échec total dans le court-métrage Barbosa –, mais pour recueillir des preuves en vue d’un futur procès « en cours ». Les éléments de preuve ne sont pas précisés dans le récit et l’injustice est déjà gravée dans l’histoire et sur les corps des personnages principaux. La seule option est d’attribuer la responsabilité, de trouver le coupable – ce qui est une avancée majeure dans le contexte d’une société à « mémoire courte », impitoyablement punitive envers les pauvres et historiquement miséricordieuse face à la corruption et aux abus de la part de l’élite ou de l’État. Il n’est donc pas surprenant que lorsque le voyageur temporel Cravalanças jure contre des oppresseurs virtuels alors qu’il fait semblant de tirer sur des ennemis dans un entrepôt abandonné et en ruine, il le fasse dans un espace vide.
Ensuite, le simple fait que le voyageur du temps dans BSPF ait pour mission de rassembler des éléments de preuve en vue de futures poursuites judiciaires contre l’État semble ironique en soi, étant donné les connaissances empiriques de tout spectateur brésilien contemporain sur le système judiciaire du pays, en particulier par rapport à la justice impliquant les élites nationales. Le film donne peu d’éléments sur les résultats de cette procédure judiciaire, tandis que le plan de Marquim et Sartana aboutit bien à la destruction de Brasília par une bombe sonique – représentée à travers les dessins faits à la main, une technique qui, outre ses contraintes, peut aussi être interprétée comme une métaphore des difficultés liées à la représentation de l’avenir au Brésil.
En tant qu’amalgame de documentaire et de fiction, et avec son intrigue se situant dans une zone frontalière – celle qui sépare Brasília de Ceilândia, ville natale de la classe ouvrière –, BSPF est un film frontalier hybride en matière de genre et de représentation, qu’on pourrait rattacher à la « borderlands science-fiction » proposée par Lysa Rivera (2012). En partant d’un événement historique refoulé ou « étouffé », et en touchant à un avenir conjecturé, BSPF met en tension les limites de la représentation audiovisuelle et redécouvre la voie du genre de la science-fiction en tant que « régime de discussion » du passé, du présent et de l’avenir – comme l’ont fait les cinéastes brésiliens à l’époque de la dictature civile-militaire, lorsque la science-fiction fournissait une sémantique et une syntaxe permettant d’éviter la censure et d’aiguiser les critiques du gouvernement dictatorial, dans des films tels que Brasil Ano 2000 (1969) de Walter Lima Jr., Manhã Cinzenta (1969) d’Olney São Paulo, Parada 88 – O Limite de Alerta (1978) de José de Anchieta ou Abrigo Nuclear (1981) de Robert Pires. Il entre également en résonance avec les évolutions politiques récentes – l’État dystopique devenant peu à peu réalité au Brésil –, évolutions explorées notamment par Kleber Mendonça Filho de manière réaliste dans Aquarius (2016), mais aussi dans un thriller de science-fiction, Bacurau, réalisé par Juliano Dornelles et Mendonça Filho (2019).
Bacurau a été bien accueilli à Cannes et Munich. Il a fait la couverture du numéro de septembre 2019 des Cahiers du cinéma et a déclenché des discussions passionnées sur les médias sociaux et les forums universitaires. Bacurau peut être considéré comme une puissante allégorie de la société brésilienne à l’époque actuelle – même si le projet a débuté dix ans avant sa création et que la version finale du scénario fut achevée trois ans avant la sortie du film. Bacurau est un thriller dystopique qui utilise des conventions de genre, en reprenant des idées exploitées dans The Most Dangerous Game (1932) d’Irving Pichel et Ernest B. Schoedsack, High Plains Drifter (1973) de Clint Eastwood ou même The Hunger Games (2012) de Gary Ross. De plus, dans une certaine mesure, Bacurau peut être associé aux tendances de l’amazofuturisme, du cyberagreste ou du sertãopunk apparues dans la bande dessinée, la littérature et les arts visuels brésiliens[18]. Comme le souligne Camille Bui, « [à] rebours de l’idéologie de la conquête de l’Ouest, Bacurau réoriente l’énergie vengeresse et jouissive du western en prenant pour cible l’Amérique du capitalisme dévorateur et du fascisme rampant » (2019, 8). Dans une interview avec Bui et Lepastier, Mendonça Filho a déclaré que « le film de genre nous donne une bonne excuse pour l’exagération, pour y aller à fond », tandis que Dornelles explique qu’« il permet de parler de politique en déguisant des pensées très subversives en quelque chose d’innocent » (Bui et Lepastier 2019, 10). Comme l’ont souligné Bui et Lepastier, et comme l’ont confirmé les réalisateurs eux-mêmes, Bacurau intensifie les conflits déjà suggérés par O Som ao Redor (2012) et Aquarius (2016). Il se déroule dans un avenir proche et raconte l’histoire de personnages qui habitent une ville isolée appelée Bacurau, dans la campagne du Pernambuco. Le nom du village, comme l’explique l’un des personnages du film, fait référence à un oiseau. Mendonça Filho, cependant, dit que « Bacurau » est simplement le surnom donné aux derniers bus qui passent dans la nuit à Recife (Bui et Lepastier 2019, 11).
Le film commence avec l’arrivée de Teresa (Bárbara Colen) à Bacurau pour les obsèques de sa grand-mère Carmelita (Lia de Itamaracá). Elle apporte également des vaccins et des fournitures pour aider la communauté. Dès son arrivée, d’étranges événements se produisent : Bacurau disparaît des cartes en ligne ; un camion apportant de l’eau potable est criblé de balles ; deux étrangers circulent en moto ; une famille est massacrée dans une ferme à proximité. Il devient vite évident que Bacurau est attaquée par des forces extérieures. En ce sens, le film fait écho à d’autres films latino-américains de science-fiction tels que O Quinto Poder d’Alberto Pieralisi (1962) et Invasión d’Hugo Santiago (1969). Les citoyens de Bacurau sont chassés et tués par des visiteurs étrangers – probablement des Américains –, engagés dans une sorte de safari humain dirigé par Michael (Udo Kier). Au cours de l’attaque, les villageois rompent avec les vieilles rivalités et les conflits internes pour se défendre. Acácio (Thomas Aquino), un ancien tueur connu sous le surnom de Pacote, conclut un pacte avec Lunga (Silvero Pereira), le criminel fugitif qui se cache de la police, avec ses copains, dans un barrage sec et abandonné. Des séquences violentes s’ensuivent où les villageois se défendent et se vengent. Camille Bui reconnaît dans le film deux relations spatiales principales, l’une, habitante, et l’autre, prédatrice : « Le territoire de Bacurau apparaît en cela comme un bien public, menacé de disparition par la folie privée de politiciens corrompus et de paramilitaires américains. La relation des étrangers avec cette terre, qu’ils soient le ridicule préfet de la région, les Nord-Américains ou les Brésiliens du Sud-Est, est au contraire marquée par la prédation » (2019, 8). La perception du film suit les clivages politiques du pays : les progressistes y voient un manifeste contre la domination impérialiste, les conservateurs se scandalisent de la représentation positive des voyous et des marginaux – où l’on reconnaît surtout les victimes de la violence au Brésil aujourd’hui, soit les femmes, les prostituées, les travestis, les gays et les lesbiennes. Bien que la violence extrême proposée par la fable du film puisse être discutée, Bacurau ouvre un dialogue stimulant avec quelques manifestes pour le cinéma latino-américain des années 1960 et 1970, tels que « Hacia un tercer cine » de Fernando Solanas et Octavio Getino (1997, 35-38, originalement publié en 1969) et « Uma estética da fome » de Glauber Rocha (1997, 59-61, originalement publié en 1965, aussi connu sous le titre « Estétyka da fome »), notamment avec les idées de Glauber, dans lesquelles la violence est revendiquée comme une valeur esthétique – selon Glauber, « la plus noble manifestation culturelle de la faim est la violence » (1997, 60). Bacurau est un film contemporain qui utilise une syntaxe et un vocabulaire propres à la science-fiction et, dans la croissance de sa fable, il culmine dans un spectacle de violence qui nous rappelle certaines idées de Glauber dans son manifeste. Tour à tour, le « Troisième Cinéma » de Solanas et Getino ou le « cine imperfecto » de José Garcia Espinosa (1997, 71-82) sont aussi des alternatives au cinéma colonial, impérialiste, industriel et au cinéma européen moderne, loin de la réalité des peuples latino-américains. Dans leurs spectacles de production précaire et/ou de violence, des films comme Parada 88 ou Bacurau, parmi d’autres titres, font écho à des fragments d’idéaux présents dans cette mosaïque de manifestes. Le cinéma brésilien de science-fiction est un cinéma précaire, avide d’avenir, mais qui digère très mal les paradigmes les plus commerciaux du genre, pleins de sous-textes impérialistes et d’effets spéciaux ahurissants.
De plus, la dystopie se retourne partiellement en aspiration utopique dans Bacurau, dont la petite communauté rappelle le modèle ancien du quilombo, un de ces villages fondés dans l’arrière-pays reculé du Brésil par des Africains ou des Brésiliens d’ascendance africaine qui ont réussi à échapper à l’esclavage dans les plantations situées pour la plupart sur les côtes du pays. Parmi les protagonistes, le professeur Plinio (Wilson Rabelo) est d’abord une figure positive et pacifique, qui défend les valeurs de l’éducation comme remèdes à la violence – même si, vers la fin du film, il prend lui aussi les armes contre les intrus. À cet égard, Bacurau semble être aujourd’hui à l’avant-garde d’un groupe de films d’auteur politiquement engagés qui critiquent le tournant conservateur de la politique institutionnalisée et des pratiques socioculturelles au Brésil, comme As Boas Maneiras, un film d’horreur sur un petit loup-garou, de Juliana Rojas et Marco Dutra (2017), Era uma Vez Brasília (2017), une autre dystopie futuriste d’Adirley Queirós qui suit BSPF, et A Vizinhança do Tigre (2016) d’Affonso Uchôa, entre autres. Ces films, notamment ceux de Rojas, Dutra, Queirós et Mendonça Filho, utilisent le vocabulaire et la syntaxe des films de genre – surtout de science-fiction – pour composer leurs éléments de critique sociale.
Clivages politiques
Bacurau et BSPF pourraient également servir à interroger l’articulation entre la science-fiction et l’afrofuturisme à la brésilienne. Le terme « afrofuturisme » est apparu pour la première fois en 1995, dans un entretien dirigé par le critique Mark Derey avec l’écrivain de science-fiction Samuel R. Delany, Greg Tate (le leader de Burnt Sugar) et la professeure Tricia Rose. À cette occasion, Derey a utilisé le terme pour désigner une
fiction spéculative qui traite de thèmes afro-américains et répond aux préoccupations afro-américaines dans le contexte de la technoculture du xxe siècle – et, plus généralement, la signification afro-américaine qui s’approprie des images de la technologie et un avenir augmenté par des extensions prothétiques […].
Derey 1994, 180
Après avoir donné cette définition, il ajoute que « les voix afro-américaines ont d’autres histoires à raconter sur la culture, la technologie et les choses à venir. S’il y a un afrofuturisme, il faut le chercher dans des endroits improbables, organisés en constellation de points très éloignés » (1994, 182). Si l’angle d’approche renvoie ici aux productions nord-américaines, rien n’empêche de partir de ce concept pour interpréter Bacurau et BSPF comme des oeuvres afrofuturistes, proto ou semi-afrofuturistes brésiliennes. Il s’agit de films dont les personnages principaux sont afrodescendants, appartenant à une population exclue et marginalisée au Brésil depuis les temps coloniaux. Ces personnages afrodescendants sont à la fois des protagonistes et des visionnaires, ouvrant sur des alternatives, sur d’autres futurs possibles. Le film d’Adirley Queirós est particulièrement représentatif d’un regard afrofuturiste, car il montre des personnages afrodescendants susceptibles de triompher en raison de leur culture et de leur identité communautaire. Marquim est un DJ spécialiste de la scène musicale noire. La bombe sonique qu’il met au point avec Sartana reprend des sons et des musiques de la banlieue de Brasília, de la culture afro-brésilienne qui survit malgré la marginalisation – la même culture d’origine africaine qui, depuis toujours, ravive de temps en temps le mainstream culturel brésilien, comme dans le cas de la bossa nova ou de la música popular brasileira (MPB), parmi d’autres exemples. On pourrait y ajouter des courts-métrages représentatifs de cette tendance d’un cinéma proto ou semi-afrofuturiste brésilien, comme Quintal (André Novais Oliveira, 2015), Chico (Eduardo e Marcos Carvalho, 2016), À Margem do Universo (Tiago Esmeraldo, 2017) ou República (Grace Passô, 2020). À Margem do Universo mélange l’afrofuturisme proprement dit avec quelque chose de la culture brésilienne indigène et un discours ouvertement écologiste, tourné dans le parc national de la Chapada dos Veadeiros – une région de nature exubérante, dans l’État de Goiás, au centre du Brésil. Ce court-métrage met en scène un protagoniste noir – l’astronaute Awada, joué par l’actrice Petra Sunjo, Brésilienne d’origine camerounaise – dans un récit utopique d’exploration spatiale parlé en portugais et suruwahá[19], une langue brésilienne indigène comptant moins de 150 locuteurs aujourd’hui. La notion d’afrofuturisme brésilien, dans le cadre d’une définition mondiale du phénomène, est défendue par exemple par Freitas et Messias (2018), qui prennent l’exemple du court-métrage brésilien Chico pour distinguer l’afrofuturisme de l’afropessimisme. Chico présente un Brésil profondément dystopique, en 2029, au moment où la politique autoritaire et technocratique du gouvernement fédéral décide d’autoriser l’enlèvement de mineurs afrodescendants, habitants des périphéries, afin de contenir la criminalité[20]. Selon Freitas et Messias, « l’avenir sera noir, ou il ne sera point » (2018, 423).
L’année 2020 a d’ailleurs marqué un temps important pour l’afrofuturisme brésilien, notamment lors du festival Africa in Motion d’Édimbourg, dans une séance « Afrofuturism in the Brazilian Way » où furent présentés A Mulher No Fim do Mundo (Ana do Carmo, 2019), Cartuchos de Super Nintendo en Anéis de Saturno (Leon Reis, 2018), Negrum3 (Diego Paulino, 2018), Personal Vivator (Sabrina Fidalgo, 2014) et Sem Asas (Renata Martins, 2019). Personal Vivator est très caractéristique de cette tendance. Des visiteurs extraterrestres enquêtent sur la société en se glissant dans des peaux humaines. Le protagoniste a 72 heures pour tourner un documentaire à Rio de Janeiro dans la peau d’un homme noir du nom de Rutger. D’abord intéressé par une femme blanche de la bourgeoisie, Rutger se concentre vite sur la vie d’une femme de chambre noire, Marinalva. C’est à son propos qu’il emploie l’expression « personal vivator » : un travailleur faisant vivre ses employeurs. Il découvre ensuite que Marinalva est aussi une patronne, dans la mesure où elle embauche une assistante maternelle. Tout au long du court-métrage, une série de commentaires sociaux, politiques et économiques, notamment sur le patrimoine esclavagiste et la montée en puissance économique et éducative des plus pauvres sous les administrations fédérales du Partido dos Trabalhadores ponctuent la fable de science-fiction. Un peu comme dans Recife Frio (2009), court-métrage de Kleber Mendonça Filho où le fantastique changement climatique ayant lieu dans la ville de Recife sert à critiquer le racisme, les inégalités économiques et sociales et la spéculation immobilière au Brésil, Personal Vivator utilise le vocabulaire et la syntaxe de la science-fiction pour élaborer une réflexion sur les contradictions sociales dans le pays, et ce, dans une perspective plus ouvertement afrofuturiste.
Le film le plus singulier de l’afrofuturisme brésilien récent est, à nos yeux, República, en raison de son minimalisme éloquent, de la performance de sa réalisatrice (Grace Passô) et de sa juxtaposition de la dystopie et du rêve. Dans República, une oeuvre réalisée pendant la période de quarantaine résultante de la pandémie de COVID-19, Grace Passô interprète un personnage qui élabore une situation troublante de prise en otage dans une réalité dystopique. Le court-métrage commence avec le personnage de Grace se réveillant d’un rêve. Elle reçoit un appel sur son téléphone portable, venant de quelqu’un qui l’informe que le Brésil n’existe pas vraiment, que ce n’est qu’un rêve. Puis, visiblement sous l’émotion, le personnage de Grace ouvre la fenêtre de son appartement et pousse un cri au coeur du paysage sonore de la ville. Un plan extérieur en plongée expose la situation de pauvreté et de vulnérabilité dans la rue. Du point de vue du personnage de Grace, on regarde un double d’elle-même crier dans la rue. À l’intérieur de l’appartement, le personnage de Grace appelle sa mère et lui demande d’allumer immédiatement la télévision. Elle explique à sa mère que « le Brésil est un rêve », que le pays n’existe pas, que personne n’existe vraiment, que la maison est un rêve, tout est un rêve. « Le monde, il existe, sauf le Brésil », c’est « quelqu’un qui rêve du Brésil », explique la fille. « Tout à l’heure, la personne qui rêve peut se réveiller » – et quand cela se sera produit, elle et sa mère seront libres. La dystopie est un cauchemar. Comme BSPF d’Adirley Queirós, República peut être vu comme un autre « cri » éloquent de l’histoire de l’exclusion au Brésil, amplifié dans le prisme d’un éventuel afrofuturisme cinématographique brésilien, qui est marqué par la hantise de l’exclusion, de la perte d’identité, mais aussi par des aspirations à un meilleur avenir, plus inclusif.
Une réflexion plus large sur l’afrofuturisme brésilien dans l’audiovisuel pourrait inclure l’étude de la série 3 % (2016-2020), une aventure futuriste qui est aussi une allégorie de l’histoire de l’esclavagisme, des inégalités, de l’exclusion, de la violence et de l’autoritarisme qui ont marqué un peu plus de 500 ans d’histoire au pays, tout en présentant une galerie de personnages de toutes identités : noirs, blancs, hétérosexuels, homosexuels, trans, etc. De plus, l’importance des personnages noirs ou métis et la spéculation sur un futur afrofuturiste dans 3 % sont indissociables de l’enjeu écologique ou environnemental qui imprègne toutes les saisons de cette série. De fait, l’autre champ de bataille pour le cinéma brésilien de science-fiction d’aujourd’hui est l’environnementalisme. À cet égard, on peut citer au moins deux films contemporains : Invasão Espacial (Thiago Foresti, 2019) et Missão Perséfone (Karim Aïnouz, 2020). Invasão Espacial a remporté d’importants prix au Brésil, dont le prix du Meilleur montage au 47e Festival de Gramado, et a été bien diffusé à l’échelle nationale et internationale. Là encore, à l’intersection du documentaire et de la science-fiction, Invasão Espacial aborde l’impact de l’existence de la base spatiale d’Alcântara dans l’État du Maranhão sur les terres quilombolas, c’est-à-dire sur le territoire des communautés légitimement issues des anciens quilombos. Le documentaire est conçu en utilisant les codes narratifs et visuels de la science-fiction pour présenter une invasion réelle, comme s’il s’agissait d’une invasion extraterrestre[21].
Pour autant, la science-fiction ne véhicule pas uniquement des revendications de gauche. L’attrait populaire et commercial d’un nouveau cinéma conservateur brésilien, principalement représenté par des films religieux ou spirites, est indéniable[22]. Il faut signaler sur ce point l’influence considérable du penseur français Alan Kardec, dont la doctrine spirite, le « kardécisme », est devenue l’une des religions les plus populaires à ce jour au Brésil, et ce, depuis son introduction dans la société brésilienne à la fin du xixe siècle[23]. Même si le spiritisme de Kardec se présente comme une doctrine scientifique, il est vu comme une religion ou une croyance par une partie significative de la population brésilienne. À ce spiritisme vient s’ajouter une part croissante d’adeptes de l’évangélisme protestant et du néopentecôtisme. Plusieurs grands succès cinématographiques récents au Brésil ont mis en scène des sujets religieux[24], ce qu’on voit comme un « cinéma religieux » (Vadico 2015) ou une « nouvelle vague » du cinéma spirite brésilien (Cánepa 2013 ; Cánepa et Suppia 2017). Quelques films de ce cinéma spirite brésilien récent utilisent explicitement l’iconographie, la sémantique et la syntaxe du cinéma de science-fiction à grand spectacle pour donner une apparence (pseudo) scientifique à leur système de croyances – citons, par exemple, les longs-métrages Nosso Lar (Wagner de Assis, 2010) et Area Q (Gerson Sanginitto, 2012).
Même s’il s’agit d’un film non religieux, pointant du doigt la dégradation de la laïcité de l’État, c’est en partie dans ce contexte que Divino Amor (Gabriel Mascaro, 2019) – qu’on pourrait tenir pour une version brésilienne de The Handmaid’s Tale avec sa critique de la théocratie latente du Brésil d’aujourd’hui – est sorti. Satire dystopique des aspirations spiritualistes, Divino Amor présente d’emblée son argument de science-fiction lors de la scène d’ouverture – images d’une soirée, quelque chose comme une prière collective en transe, en plein air, commentée par la voix off d’un enfant :
C’était 2027. Le Brésil avait changé. La fête la plus importante du pays n’était plus le Carnaval. C’était « la Fête de l’Amour suprême ». La rédemption du corps, le sentiment le plus pur. Le serment d’amour éternel. La grande attente du retour du Messie.
Divino Amor, 2019
Divino Amor raconte l’histoire de Joana (Dira Paes), employée d’une sorte de bureau d’état civil. Évangélique, elle se consacre aux procédures de divorce, avec pour but de dissuader les couples qui se présentent à elle, jusqu’à les orienter vers son Église, Amour Divin, où elle et son mari Danilo (Júlio Machado) pratiquent leur foi. Au nom de la famille, l’église d’Amour Divin promeut des services du soir qui mêlent des lectures bibliques décontextualisées, des activités ludiques et des séances d’autoassistance pour des orgies échangistes, le tout dans un décor rappelant celui des maisons closes des grandes villes. Joana a pour aspiration essentielle de concevoir un enfant, malgré la stérilité de son mari. Cette vision de l’évangélisme est évidemment très critique. Selon le pasteur Alexandre Gonçalves[25], le personnage de Joana représente une religion évangélique néopentecôtiste, triomphaliste, individualiste et adepte d’une théologie autoritaire, hégémonique, intolérante aux autres formes de foi. Le Brésil du futur proche de Divino Amor est une théocratie, un pays « néopentec », ou mieux encore « néonpentec », qui donne à voir l’issue de la lutte conservatrice contre la « cristophobie » prétextée récemment par Jair Bolsonaro.
Le film de Mascaro se termine sur une incertitude fantastique. Joana est finalement enceinte et son mari Danilo n’est pas le père, selon l’examen d’ADN. Le couple se sépare. On ne sait pas si l’enfant sans nom a un père, ou s’il a été engendré par le Saint-Esprit. La voix de cet enfant, qui dans la première scène a annoncé le Brésil de 2027 avec la longue attente du retour du Messie, peut, en théorie, être la voix du Messie lui-même. Que ce soit ou non le cas, la voix de l’enfant raconte un avenir où le Brésil, jeune nation, régresse encore plus dans sa maturité. Les personnages sont sous influence, pilotés et conditionnés par le seul but de produire des enfants. Le Brésil de 2027 de Divino Amor est une nation renaissante et infantile, où la vie se limite aux tâches domestiques, aux relations sexuelles au nom de la famille et au culte religieux pendant les heures de loisir, après les heures de travail dans la fonction publique ou dans diverses petites entreprises. Pour autant, le film suggère plus qu’il ne montre la puissance possible du mouvement néopentecôtiste, dont il produit une satire grinçante, mais intimiste.
Un cinéma brésilien de science-fiction ?
Cet article visait à offrir un panorama commenté du cinéma brésilien de science-fiction, en identifiant quelques « lignes de force ». Nous avons pu observer comment plusieurs courts et longs-métrages brésiliens utilisent le vocabulaire de la science-fiction, son lexique, sa syntaxe ou son iconographie pour aborder des problèmes liés à l’histoire des inégalités et de l’exclusion dans le pays, de même qu’aux héritages de la violence, de l’esclavagisme et du sous-développement. Cela signifie qu’aujourd’hui, la science-fiction est explorée par des artistes ou des cinéastes militants, en convergence avec des philosophies ou des pensées telles que le féminisme, l’afrofuturisme, l’environnementalisme, dans des films politiquement engagés qui offrent un « déchiffrement » de notre réalité absurde et aliénante, ainsi que des spéculations sur un avenir potentiellement dangereux. À ces explorations orientées vers des questions politiques, il faudrait ajouter une moisson récente de productions au budget modeste, plus ou moins ambitieuses en matière d’effets spéciaux et de complexité narrative, dont le propos n’est pas particulièrement engagé[26]. Certains courts-métrages, comme The Flying Man (2013)[27] de Marcus Alqueres ou Lunatique (2016)[28] de Gabriel Kalim Mucci, ont des effets spéciaux de qualité, mais leurs scénarios faibles, fragmentaires, rappellent le cinéma industriel (ou américain) et laissent l’impression de n’être que des tests pour d’éventuels longs-métrages. On pourrait enfin mentionner le court-métrage de Maria Leite, O Quebra Cabeças de Tarik (2015), un hapax rappelant l’école d’animation d’Europe de l’Est, offrant une adaptation libre du roman Frankenstein (1818), de Mary Shelley, avec une tonalité féministe.
La question demeure en partie irrésolue sur ce qu’il convient d’identifier comme « brésilien » dans ce cinéma de science-fiction. Nous voudrions, pour cela, convoquer Paulo Emílio Salles Gomes comme « clé de lecture » :
Nous ne sommes ni Européens ni Nord-Américains, mais dépourvus de culture d’origine, rien ne nous est étranger, comme tout. Le sentiment douloureux de nous-mêmes se développe dans la mince dialectique entre non-être et altérité. Le film brésilien participe au mécanisme et le modifie grâce à notre incompétence créatrice en matière de copie. Le phénomène cinématographique au Brésil témoigne et marque beaucoup de vicissitudes nationales.
Salles Gomes 1986, 88
Nous croyons que la science-fiction est un macro-genre universel, un genre dans le champ plus large de la fiction spéculative. Ses matières premières sont l’exotisme, l’exogène, l’inhabituel, le différent, tout ce qui met en échec les limites et les définitions. John Baxter a pu revendiquer le cinéma de science-fiction comme une manifestation culturelle essentiellement américaine :
La plupart des pays ont tenté la SF, certains ont réussi dans une certaine mesure, mais la forme reste agressivement américaine, l’expression d’une impulsion nationale qui, comme l’Occident, est trop profondément ancrée dans la peau américaine pour n’être jamais révélée par qui que ce soit d’autre qu’un enfant du pays.
Baxter 1970, 208
Néanmoins, la « nationalisation » de la science-fiction nous semble être absolument contradictoire avec la nature universalisante du genre, soit sa vocation intrinsèquement spéculative ou expérimentale. Affirmer que le cinéma de science-fiction est une matière essentiellement américaine, ainsi que le fait Baxter, revient à accepter sans discernement la division internationale de la culture la plus controversée et réactionnaire, partage qui accompagne la division internationale du travail et de la richesse. Dire qu’il n’y a pas de science-fiction dans les pays dits en développement, en tirant argument de leurs infrastructures scientifique et technologique inappropriées, est une position politique. De même, affirmer que les effets spéciaux sont la vraie essence, la raison d’être des films de science-fiction – tel que le fait Adam Roberts (2000, 152-53) –, brouille le rôle des effets spéciaux dans tout le cinéma. En ce sens, lier de manière péremptoire le cinéma de science-fiction à des effets visuels sophistiqués ou industriels, sans aucune considération ni attention portée à l’histoire mondiale du genre, signifie refuser aux cinématographies non occidentales l’accès à un mode de représentation et de discussion potentiellement universel. Pourtant, le cinéma brésilien de science-fiction acquiert peu à peu son autonomie. Ce sont des Brésiliens qui produisent de la science-fiction dans les domaines du cinéma et de la télévision, de la littérature et de la bande dessinée, du théâtre, du web et des jeux vidéo, malgré l’obscurantisme et les obstacles qui affectent le marché brésilien des biens culturels. Les travaux universitaires sur ce macro-genre se sont également accumulés au fil des ans, en démontrant que même l’université brésilienne s’est ouverte progressivement à la multiplicité de textes qui caractérisent le phénomène de la science-fiction dans le Brésil contemporain. Le futur du cinéma de science-fiction en Amérique latine et au Brésil pourrait être souriant, malgré les difficultés sociales, économiques et politiques.
Parties annexes
Remerciements
Cet article a été écrit avec la collaboration fondamentale de Simon Bréan, que je dois remercier pour nos échanges d’idées et son aide apportée à mon écriture du français.
Notes
-
[1]
Toutes les traductions du portugais vers le français et de l’anglais vers le français sont de l’auteur.
-
[2]
Utopia Brasil (2008), de Darcy Ribeiro, rassemble cinq textes inédits, ou à diffusion restreinte, des 20 dernières années de production de l’anthropologue et homme politique Darcy Ribeiro : « Brasil, Brasis » (1987), texte sur la singularité culturelle brésilienne ; « Ivy-marãen, a terra sem males, ano 2997 » (1997), une utopie futuriste ; « Brasil: terra dos índios » (1977), sur la diversité des peuples au Brésil ; « Primeira fala ao Senado » (1991) et « Exéquias a Glauber Rocha » (1981). Sont également inclus un texte de Glauber sur son ami (1978) et un entretien sans précédent, réalisé en exil (1977), avec Ferreira Gullar, Mário Pedrosa, Glauber Rocha, Zuenir Ventura et Darcy Ribeiro. Le travail a été organisé par la réalisatrice de documentaires Isa Grinspum Ferraz.
-
[3]
Ismail Xavier utilise les termes « sério-dramático » et « lúdico-carnavalesco » dans son livre Alegorias do subdesenvolvimento (1993) et d’autres ouvrages. Les catégories semblent appropriées pour le moment, en l’absence d’un terme encore plus précis. Le contraste de Xavier entre un récit « sérieux-dramatique » et un récit « ludique-carnavalesque » (1993, 227) peut également être utile pour mieux distinguer les films de science-fiction brésiliens plus « engagés » (« sérieux ») et les films plus parodiques (« ludique-carnavalesque »).
-
[4]
Les chanchadas ont été les films brésiliens dans lesquels l’humour naïf et burlesque à caractère populaire prédomine. Les chanchadas étaient monnaie courante au Brésil entre les années 1930 et 1960, et sont aujourd’hui considérés comme un genre cinématographique typiquement brésilien. Le studio le plus connu pour sa production de chanchadas a été Atlântida, à Rio.
-
[5]
Par sa mélancolie et ses décors sombres et claustrophobes, Parada 88 rappelle des films comme A Clockwork Orange (1971) de Stanley Kubrick ou A Boy and his Dog de L. Q. Jones (1975), tout en semblant préfigurer des titres comme Mad Max (1979) de George Miller, ou même Blade Runner de Ridley Scott (1982). Le film de José de Anchieta est presque entièrement plongé dans l’obscurité, dans l’hermétisme des tunnels et des bâtiments. La grande majorité des images sont nocturnes. Les seuls plans en plein air et à la lumière du jour sont ceux de la façade du bâtiment du département du contrôle de gaz et la scène finale, où le protagoniste et sa famille quittent la ville.
-
[6]
Os Trapalhões était un groupe de comédiens connaissant un grand succès à la télévision et au cinéma. Ils avaient un programme tous les dimanches soir à la plus grande chaîne télévisuelle du Brésil, Rede Globo, et ont lancé des dizaines de longs-métrages au cinéma. Voir Ortiz Ramos 2004.
-
[7]
La pornochanchada a été un genre du cinéma brésilien. Le terme, fruit de la jonction des mots « pornô » et « chanchada », a permis de classer un type de film qui a commencé à être produit à partir des années 1970 et qui, par la convergence de facteurs économiques et culturels, notamment la libération des moeurs, a produit une nouvelle tendance dans le domaine cinématographique à remettre en question ces moeurs et à explorer l’érotisme. Produit culturel typique du Brésil, la pornochanchada a connu un grand succès commercial dans le pays tout au long des années 1970, et ce, malgré le coût faible de ses productions, principalement fabriquées à Boca do Lixo, au centre-ville de São Paulo. Les pornochanchadas étaient attrayantes, rudimentaires et vulgaires, et bénéficiaient du contrôle considérable exercé sur la production culturelle et l’information pendant la dictature civile-militaire brésilienne. Des secteurs de la société plus conservateurs et moralistes ont même organisé des campagnes contre la projection des films, et des centaines d’entre eux ont subi des coupes de la part des censeurs fédéraux. Aujourd’hui, la valeur politique et même esthétique de la pornochanchada fait l’objet de débats. Voir Abreu 2012 et 2015.
-
[8]
Citons Oceano Atlantis, tourné entre 1989 et 1993, mais jamais diffusé ; le relatif échec de Cassiopéia (Clóvis Vieira, 1996), film pour enfants en animation 3D, éclipsé par le succès mondial de Toy Story.
-
[9]
Selon Ginway, la science-fiction brésilienne « fournit un baromètre pour mesurer les attitudes à l’égard de la technologie, tout en reflétant en même temps les implications sociales de la modernisation dans la société brésilienne ».
-
[10]
Ce travail dérive de notre recherche doctorale à l’Université de Campinas (Unicamp), entre 2003 et 2007, sous la supervision du professeur José Mário Ortiz Ramos. La thèse résultante de cette recherche est disponible à l’adresse : https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2007.415315.
- [11]
-
[12]
Dans une version cyberpunk de Rio, Heitor (Roberto Rodrigues) est un journaliste raté qui vit de la publication d’actualités sous la forme de GIF, mais rêve d’avoir enfin une grande histoire. Lorsqu’il trouve un mystérieux disque dur contenant des informations susceptibles de compromettre la société Intercom, Heitor entame une enquête au coeur de la pègre de Rio, mais ce « journaliste » n’est peut-être pas préparé aux directions que prendra son « histoire ». Le film est disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=71vBCE7eh00.
-
[13]
« Tupinipunk » est le terme inventé par l’écrivain et chercheur Roberto de Sousa Causo (1996) pour désigner le cyberpunk brésilien, manifesté dans des livres tels que Silicone XXI d’Alfredo Sirkis (1985), Santa Clara Poltergeist de Fausto Fawcett (2020, première publication en 1991), ou Piritas Siderais de Guilherme Kujawski (1994). Ce néologisme dérive du mot tupiniquim, relatif au peuple indigène brésilien qui appartient à la nation Tupi, connu également sous les noms de Tupinaquis, Topinaquis ou Tupinanquins. Dans une perspective coloniale qui survit jusqu’à nos jours, le terme tupiniquim peut désigner des peuples « primitifs » ou des Brésiliens moins privilégiés, comme synonyme de retard civilisationnel, de manque de « modernité », ou de « primitivisme ». Il y a une certaine ironie dans le terme « tupinipunk » de Roberto Causo, mais nous doutons qu’il soit réellement désobligeant, étant donné l’essentiel du travail de Causo sur la science-fiction brésilienne en tant que critique littéraire, historien et auteur d’histoires de science-fiction (voir Causo 1996 et 2015).
-
[14]
Banlieue de Brasília, la capitale fédérale – en fait, l’une des nombreuses cidades-satélites (« villes-satellites ») destinées à la classe ouvrière.
-
[15]
Sur ce sujet, voir aussi le court-métrage Barbosa (Jorge Furtado, 1988).
-
[16]
L’infirmité de Shockito est due à un accident sans lien avec ce qui est attribué à son personnage. La jambe mécanique qu’il porte, et qu’il est question de pirater dans le film, est bien un modèle expérimental dont il est « beta testeur ».
-
[17]
La région plus centrale et urbanisée de Brasília, conçue par l’urbaniste brésilien Lúcio Costa.
-
[18]
« Amazofuturisme » et « cyberagreste » sont des termes qui ont émergé ces derniers temps pour tenter de classer les oeuvres de fiction spéculative à thèmes régionaux, plus spécifiquement situés (ou faisant référence à des traditions et des enjeux sociaux ou culturels) dans la forêt amazonienne et dans le Nord-Est, respectivement. Voir Claudio Yuge, « Conheça a nova sci-fi brasileira com sertãopunk, cyberagreste e amazofuturismo », Canaltech, 8 février 2020, https://canaltech.com.br/entretenimento/conheca-a-nova-sci-fi-brasileira-com-sertaopunk-cyberagreste-e-amazofuturismo-159802/. Le « sertãopunk » est un mouvement culturel de fiction spéculative créé par Alan de Sá, Alec Silva et G. G. Diniz. Prenant pour référence le solarpunk, l’afrofuturisme et le réalisme magique, le mouvement imagine les futurs possibles d’un Nord-Est technologiquement et culturellement avancé. Un film qui anticipe les tendances du cyberagreste ou du sertãopunk dans la littérature et l’audiovisuel brésiliens contemporains est le court-métrage E o Mar Virou Sangue… (1995) de Paulo Weidebach (https://www.youtube.com/watch?v=zSIw8agVc4o). Ce film mêle prises de vue réelles et animation numérique, en combinant des éléments de l’esthétique du nord-est du sertão brésilien avec un futurisme dystopique à la Metropolis (1927) de Fritz Lang, basé sur un extrait du livre Haute Terres : La Guerre de Canudos (2012) d’Euclides da Cunha, un auteur qui a rapporté la Guerre de Canudos au Brésil du XIXe siècle.
-
[19]
Les Suruuarrás, également appelés Zuruahãs, sont un groupe indigène qui habite le sud de l’État brésilien d’Amazonas, plus précisément la zone indigène Zuruahã. Ils parlent une langue de la famille Arawá et, selon les dernières estimations, ce groupe compte 130 personnes.
-
[20]
À cet égard, Chico rappelle un court-métrage d’animation brésilien, Projeto Pulex (Tadao Miaqui, 1991), où le génocide des afrodescendants, engendré par la technocratie du gouvernement fédéral autoritaire, se fait par l’infestation intentionnelle de puces dans les communautés périphériques.
-
[21]
Thiago Foresti est peut-être l’un des jeunes cinéastes les plus prometteurs en ce qui concerne le cinéma de science-fiction brésilien politiquement engagé. Son dernier court-métrage, Algoritmo (2020), est un film tout aussi éloquent en matière de critique politique, et plus nettement encore ancré dans la science-fiction. C’est une anticipation dystopique dans laquelle un État policier soumet les citoyens à une surveillance constante, restreint les droits, chasse et élimine les dissidents politiques. Les jeunes sont surveillés par un algorithme qui permet d’identifier des lectures subversives, des discussions politiques et des remises en cause du système, transposant donc les excès des réseaux sociaux dans une version totalitaire.
-
[22]
Voir Cánepa et Suppia (2017) et Vadico (2015).
-
[23]
Selon les données du recensement de l’IBGE, 3,8 millions de Brésiliens se déclarent spirites en 2010 (Cánepa et Suppia 2017, 81), ce qui équivaut à environ 2 % de la population brésilienne, représentant ainsi la plus grande communauté spirite de la planète. Le recensement de l’IBGE de 2010 conclut que le nombre de catholiques diminue dans le pays, tandis que le nombre d’évangéliques, de spirites et d’athées augmente. Voir https://censo2010.ibge.gov.br/.
-
[24]
Voir par exemple Bezerra de Menezes: O Diário de um Espírito (2008) de Glauber Filho et Joe Pimentel, Nosso Lar de Wagner d’Assis (2010) et Chico Xavier (2010) de Daniel Filho.
-
[25]
Alexandre Gonçalves, « Divino Amor: filme futurista é uma crítica à hipocrisia do Brasil evangélico de Bolsonaro », The Intercept, 18 juillet 2019, https://theintercept.com/2019/07/17/divino-amor-critica-evangelico-bolsonaro/.
-
[26]
Quelques exemples : Deserto Azul (2013) d’Éder Santos, Brasil S/A (2014) de Marcelo Pedroso, A Repartição do Tempo (2016) de Santiago Dellape, À Margem do Universo (2016) de Tiago Esmeraldo, O Estranho Caso de Ezequiel (2017) de Guto Parente, Arzok (2017) d’Ian SBF, A Terra Negra dos Kawâ (2018) de Sérgio Andrade, Ultravioleta (2018) de Dhiones do Congo, Loop (2019) de Bruno Bini, et A Pedra da Serpente (2018) de Fernando Sanches.
- [27]
- [28]
Bibliographie
- Abreu, Nuno César. 2012. O olhar pornô: a representação do obsceno no cinema e no vídeo, 2e édition. Campinas : Alameda.
- Abreu, Nuno César. 2015. Boca do Lixo: cinema e classes populares, 2e édition. Campinas : Editora Unicamp.
- Baxter, John. 1970. Science Fiction in the Cinema. New York/Londres : A.S. Barnes/ A. Zwemmer.
- Bui, Camille. 2019. « Village Global ». Cahiers du Cinéma 758 : 8–9.
- Bui, Camille, et Joachim Lepastier. 2019. « Écouter le présent. Entretien avec Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. » Cahiers du Cinéma 758 : 10-14.
- Cánepa, Laura. 2013. « Notas para pensar a onda de filmes espíritas no Brasil. » Rumores 7 (13) : 46-64. https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2013.58931.
- Cánepa, Laura, et Alfredo Suppia. 2017. « O filme espírita brasileiro: entre dois mundos. » Alceu 17 (34) : 81-97. https://doi.org/10.46391/ALCEU.v17.ed34.2017.135.
- Causo, Roberto de Sousa. 1996. « Tupinipunk: cyberpunk brasileiro. » Papêra Uirandê Especial 1 : 5-11.
- Causo, Roberto de Sousa. 2003. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – 1875 a 1950. Belo Horizonte : Editora UFMG.
- Causo, Roberto de Sousa. 2015. « O estado da arte: Ficção científica Tupinipunk. » Papêra Uirandê Especial 9 : 11-12. https://periodicos.ufjf.br/index.php/zanzala/article/view/37394.
- Chu, Seo-Young. 2010. Do Metaphors Dream of Literal Sleep? A Science-Fictional Theory of Representation. Cambridge : Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674059221.
- Derey, Mark. 1994. « Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate and Tricia Rose. » Dans Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, sous la direction de Mark Derey, 179-222. Durham : Duke University Press.
- Espinosa, Julio García. 1997. « For an Imperfect Cinema. » Dans New Latin American Cinema, vol. 1, Theory, Practices and Transcontinental Articulations, sous la direction de Michael T. Martin, 71-82. Detroit : Wayne State University Press.
- Freitas, Kênia, et José Messias. 2018. « O futuro será negro ou não será: Afrofuturismo versus Afropessimismo – as distopias do presente. » Imagofagia 17 : 402-23. https://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/225.
- Ginway, M. Elizabeth. 2005. Ficção científica brasileira: Mitos culturais e nacionalidade no país do futuro. São Paulo : Devir.
- Hardy, Phil (dir). 1995. The Overlook Film Encyclopedia: Science-fiction, 3e édition. Woodstock : Overlook.
- Kothe, Flávio R. 1986. A Alegoria. São Paulo : Ática.
- Macey, David. 2000. Dictionary of Critical Theory. London : Penguin.
- Ortiz Ramos, José Mário. 2004. Cinema, televisão, publicidade: cultura popular de massa no Brasil nos anos 1970-1980. São Paulo : Annablume.
- Ramos, Fernão (dir.). 1987. História do cinema brasileiro. São Paulo : Art Editora.
- Reis, Cláudio, Maurício Campos Mena et Raquel Imanishi. 2013. Entretien avec Adirley Queirós. Negativo 1 (1) : 16-70. https://periodicos.unb.br/index.php/revnegativo/article/view/6634/5633.
- Ribeiro, Darcy. 2006. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo : Companhia das Letras.
- Ribeiro, Darcy. 2008. Utopia Brasil. São Paulo : Hedra.
- Rivera, Lysa. 2012. « Future Histories and Cyborg Labor: Reading Borderlands Science Fiction after NAFTA. » Science Fiction Studies 39 (3) : 415-36. https://doi.org/10.5621/sciefictstud.39.3.0415.
- Roberts, Adam. 2000. Science Fiction. London : Routledge.
- Rocha, Glauber. 1997. « An Esthetic of Hunger. » Dans New Latin American Cinema, vol. 1, Theory, Practices and Transcontinental Articulations, sous la direction de Michael T. Martin, 59-61. Detroit : Wayne State University Press.
- Salles Gomes, Paulo Emílio. 1986. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, 2e édition. São Paulo : Paz e Terra.
- Schwarz, Roberto. 2000. Ao vencedor as batatas: Forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro, 5e édition. São Paulo : Editora 34.
- Skorupa, Francisco Alberto. 2002. Viagem às letras do futuro: Extratos de bordo da ficção científica brasileira: 1947-1975. Curitiba : Aos Quatro Ventos.
- Solanas, Fernando, et Octavio Getino. 1997. « Towards a Third Cinema: Notes and Experiences for the Development of a Cinema of Liberation in the Third World ». Dans New Latin American Cinema, vol. 1, Theory, Practices and Transcontinental Articulations, sous la direction de Michael T. Martin, 33-58. Detroit : Wayne State University Press.
- Suppia, Alfredo. 2013. Atmosfera rarefeita: A ficção científica no cinema brasileiro. São Paulo : Devir.
- Suppia, Alfredo, et Paula Gomes. 2015. « Por um cinema infiltrado: entrevista com Adirley Queirós e Maurílio Martins a propósito de BSPF (2014). » Doc On-Line 18 : 389-413. https://doi.org/10.20287/doc.d18.dt17.
- Vadico, Luiz. 2015. O campo do filme religioso: cinema, religião e sociedade. Campinas : Paco Editorial.
- Xavier, Ismail. 1993. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São Paulo : Brasiliense.
- Zweig, Stefan. 2013. Brasil, um país do futuro. Porto Alegre : L&PM.