De nombreuses études ont bien démontré comment la colonisation a produit, et perpétue encore, une violence dont les conséquences se tracent à même le corps des femmes Autochtones, leur sensibilité et leur sensualité, à la fois psychique et corporelle (Maracle 1996; Rifkin 2011 : 174; Suzack et al. 2011; Anderson 2016; Hargreaves 2017). Comme le souligne particulièrement Alison Hargreaves dans son ouvrage Violence Against Indigenous Women, la colonisation du continent américain par les Européens et les systèmes qui seront ensuite établis sous ce couvert (la Loi sur les Indiens, les réserves, les pensionnats, etc.) sont tout autant de manifestations d’une dépossession coloniale et genrée (Hargreaves 2017 : 2) subie par les Premiers Peuples. C’est donc depuis ce contexte qu’il convient de lire l’extrait présenté en exergue où l’autrice Sto:lo Lee Maracle prend conscience, à travers une écriture qui s’accompagne d’un désir de mouvement et de sensualité, de sa féminitude. Et non seulement en prend-elle conscience, mais elle performe cette féminitude par une intervention littéraire qui inscrit le féminin dans une prise de position subjective forte et marquée, dans la matérialité du texte, par la mise en majuscule de l’énoncé comme en un cri : « I AM WOMAN ». Sa conception du féminin, de la femme qui bouge, résiste ainsi à une vision coloniale constatée par l’autrice selon laquelle « [n]ative women signifies the absence of beauty, the negation of our sexuality » (Maracle 1996 : 120), une vision qui abjecte le corps féminin, parfois en l’hypersexualisant à travers des images très souvent stéréotypées, toujours d’une grande violence symbolique. En fait, le travail littéraire de Maracle s’affirme ici au truchement d’une pensée du féminin dans ses rapports au corps en mouvement. Ce faisant, l’autrice remet en cause les formes patriarcales des violences véhiculées par la pensée et les structures coloniales (Maracle 1996; Smith 2011; Anderson 2016) et dont les pensionnats, en prescrivant la conduite des jeunes filles et en contrôlant les mouvements de leurs corps, sont devenus, pendant plus d’un siècle, une manifestation des plus concrètes. Dans de nombreux textes littéraires, fictifs ou autobiographiques, qui s’ajoutent à celui de Maracle, on trouve des témoignages précieux qui rétablissent une vérité en rendant compte, souvent à la première personne, et de manière intime, de cette expérience du corps et de sa contention par différents moyens physiques, affectifs et langagiers. Le récit autobiographique Geniesh : An Indian Girlhood (1973) de l’écrivaine Crie Jane (Willis) Pachano compte sans doute parmi les exemples les plus éloquents de cela, notamment dans le contexte du Québec où les témoignages littéraires à propos de l’histoire et de l’héritage des pensionnats sont peu nombreux. Dans ce texte, elle décrit avec force détails comment les jeunes filles devaient se conformer aux attentes des autorités coloniales à défaut de quoi leur était imposée une rhétorique de la contamination, de la sexualisation et de la honte du corps. Tantôt le mouvement du corps de l’autrice-narratrice, plus particulièrement sa manière de marcher est contrainte (Pachano [Willis] 1973 : 116), tantôt ce sont les premières menstruations qui trouvent un espace dans le discours des autorités du pensionnat de sorte à être ensuite vécues, par les jeunes filles, comme une honte vis-à-vis de leur propre corps (Pachano [Willis] 1973 : 101). Cette scène, celle des premières règles, n’est par ailleurs pas étrangère au vaste corpus de la littérature des pensionnats au féminin (Cheechoo 1993; Manuel 2019), tant elle marque à la fois un moment important dans la vie des jeunes filles et symbolise, de plus, la rupture d’avec les traditions culturelles Autochtones en lien avec cet événement significatif (Risling Baldy 2018 : 101). …
Parties annexes
Bibliographie
- ABSOLON, Kathleen E, 2011, Kaandossiwin: How We Come to Know, Fernwood Publishing.
- ACOOSE, Janice, 2016, Iskwewak Kah’ki Yaw Ni Wahkomakanak: Neither Indian Princesses nor Easy Squaws, Toronto : Canadian Scholars’ Press.
- ANDERSON, Kim, 2016, A Recognition of Being: Reconstructing Native Womanhood, Toronto : Canadian Scholars’ Press.
- BORDELEAU, Virginia Pésémapéo, 2013, L’amant du lac, Montréal : Mémoire d’encrier.
- BOULANGER, Pier-Pascale, 2009, « La sémiose du texte érotique », Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry 29 (2–3) : 99-113.
- BRADETTE, Marie-Eve, 2019, « Elles se relèvent: penser la résurgence dans la langue et la littérature Innues », @nalyses. Revue des littératures franco-canadiennes et québécoise 14 (1) : 100–125.
- CHEECHOO, Shirley, 1993, Path with No Moccasins, Toronto : Talent Group.
- DE CERTEAU, Michel, 1979. « Des outils pour écrire le corps » Traverses 14 (15) : 3–14.
- DELORIA, Philip Joseph, 2004, Indians in Unexpected Places, Lawrence : University Press of Kansas Lawrence.
- ERMINE, Willie, 2000, « Aboriginal Epistemology », dans BASTTISTE, M. et Jean BARMAN, First Nations Education in Canada: The Circle Unfolds (pp. 101-111), Vancouver : UBC Press.
- FOUCAULT, Michel, 1976, Histoire de La Sexualité, Volume 1: La Volonté de Savoir, Paris : Gallimard.
- GOEMAN, Mishuana, 2013, Mark My Words: Native Women Mapping Our Nations, Minneapolis : University of Minnesota Press.
- HARGREAVES, Allison, 2017, Violence against Indigenous Women: Literature, Activism, Resistance, Waterloo : Wilfrid Laurier University Press.
- HENZI, Sarah, 2015, « Bodies, Sovereignties, and Desire: Aboriginal Women’s Writing of Québec », Québec Studies 59 : 85–106.
- HIGHWAY, Tomson, 2008, « Why Cree Is the Sexiest of All Languages », Me Sexy. An Exploration of Native Sex and Sexuality, Vancouver : Douglas et McIntyre.
- HIGHWAY, Tomson, 2015, A Tale of Monstrous Extravagance: Imagining Multilingualism, Edmonton : University of Alberta Press.
- HUBERMAN, Isabella, 2019, Pratiques et poétiques des histoires personnelles dans les littératures Autochtones francophones au Québec. (PhD Thesis), University of Toronto.
- MANUEL, Vera, 2019, Honouring the Strength of Indian Women: Plays, Stories, Poetry, édités par Michelle Coupal, Deanna Reder, Joanne Arnott, et Emalene A. Manuel. First Voices/First Texts, Winnipeg : University of Manitoba Press.
- MARACLE, Lee, 1996, I Am Woman: A Native Perspective on Sociology and Feminism, Halifax : The Press Gang.
- MCKEGNEY, Sam, 2014, Masculindians: Conversations about Indigenous Manhood, Winnipeg : University of Manitoba Press.
- PACHANO (WILLIS), Jane, 1973, Geniesh: An Indian Girlhood, New York : New Press.
- RIFKIN, Mark, 2011, “The Erotics of Sovereignty”, Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature, New York : University of Arizona Press.
- RIFKIN, Mark, 2017, Beyond Settler Time: Temporal Sovereignty and Indigenous Self-Determination, Durham : Duke University Press.
- RISLING BALDY, Cutcha, 2018, We Are Dancing for You. Native Feminisms & The Revitalization of Women’s Coming-of-Age Ceremonies, Seattle : University of Washington Press.
- ROBINSON, Dylan, et Keavy MARTIN, 2016, « Introduction:The Body Is a Resonant Chamber », Arts of Engagement: Taking Aesthetic Action in and beyond the Truth and Reconciliation Commission of Canada, Waterloo :Wilfrid Laurier University Press.
- SIOUI, Georges, 1989, Pour une histoire amérindienne de l’Amérique, Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval.
- SMITH, Andrea, 2011, « Queer Theory and Native Studies: The Heteronormativity of Settler Colonialism », dans DRISKILL, Qwo-Li, FINLEY, Chris, GILLEY, Brian Joseph et Scott Lauria MORGENSEN (dirs.), Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature (pp. 43-65), Tuscon : University of Arizona Press.
- VIZENOR, Gerald Robert, 2009, Native Liberty: Natural Reason and Cultural Survivance, Lincoln : University of Nebraska Press.
- WALTON, Hilary, 2019, « Un lac comme personnage principal ? Une étude de la volonté et de l’esprit du lac Abitibi dans L’amant du lac de Virginia Pésémapéo Bordeleau », Voix Plurielles 16 (1) : 17–29.
- WILSON, Shawn, 2008, Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods, Halifax : Fernwood Publishing.

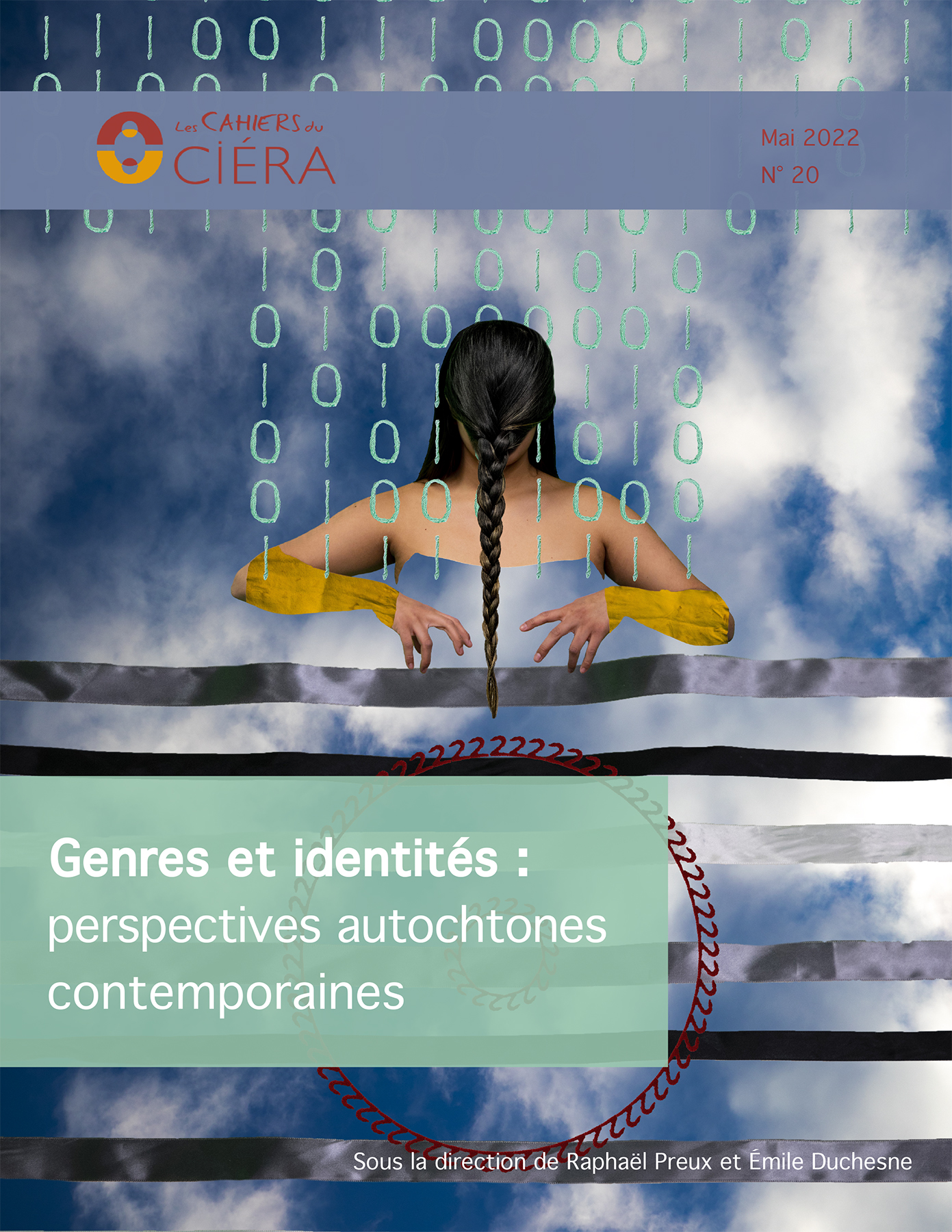

 10.7202/1014251ar
10.7202/1014251ar