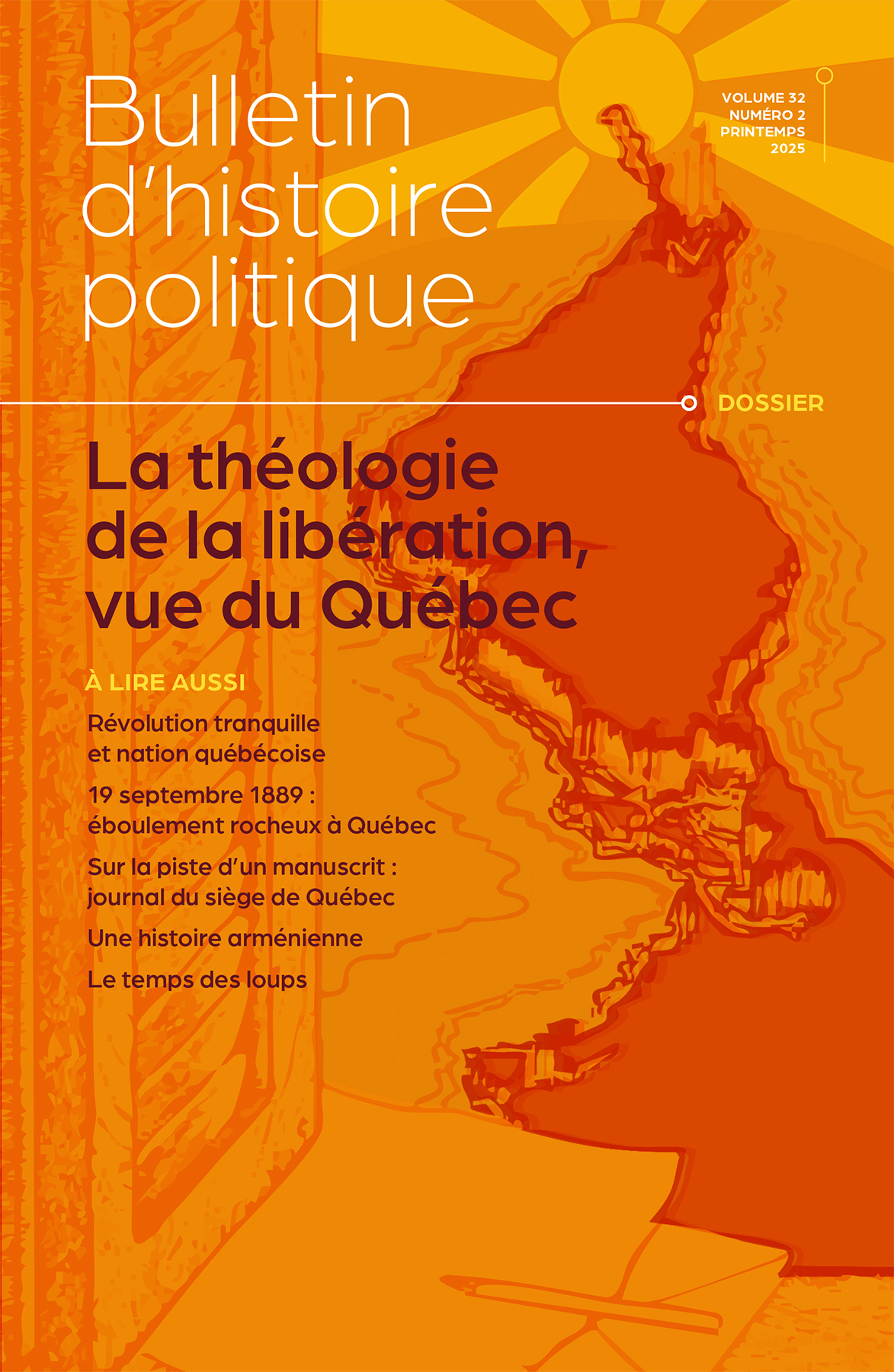Plus éclectique que l’ouvrage collectif typique, ce livre contient, en plus de l’introduction des co-directeurs, deux entretiens avec des intellectuels autochtones éminents (Marie-Andrée Gill et Kenneth Deer), deux entretiens avec des universitaires chevronnés (Gilles Bibeau et Denys Delâge), deux textes plutôt théoriques ou méthodologiques (Brian Gettler et David Bernard), un résumé historiographique (Mathieu Arsenault), un texte de recherche originale (Isabelle Bouchard), et un texte portant sur la pratique contemporaine de la reconnaissance territoriale (Sébastien Brodeur-Girard). Compte tenu de cette diversité, les commentaires suivants porteront majoritairement sur le projet englobant prôné par les co-directeurs François-Olivier Dorais et Geneviève Nootens. Malgré la présence du mot « histoires » au pluriel dans le sous-titre de l’ouvrage, il semble que les co-directeurs visent surtout à renforcer un cadre historiographique en particulier. Dans l’introduction, ils expliquent leur intention d’offrir un survol du « choc des récits historiques » provoqué par l’accrochage des « projets politiques de la nation québécoise et des peuples autochtones » (p. 9). Il est néanmoins apparent que le souci primordial demeure le projet d’une histoire nationale québécoise. Le fait que la présence autochtone fragilise ce projet apparaît comme le moteur principal de l’ouvrage. Dans l’introduction, Dorais et Nootens expliquent que « l’Autochtone instille un doute, un paradoxe dans l’intention émancipatoire du Québec » (ibid.), que les revendications des acteurs autochtones décèlent « des apories inhérentes à l’affirmation nationale et territoriale du Québec » (p. 10), et que « le devenir des Premières Nations » pose « le plus grand défi à l’historicisation de la nation québécoise telle qu’elle se dessine dans l’espace public » (p. 15). Plutôt que de les motiver à dépasser le cadre national, cette problématique pousse les co-directeurs à proposer des efforts supplémentaires pour trouver un « récit intégrateur », d’où l’origine de cet ouvrage collectif. Bien qu’ils soient conscients qu’un tel projet risque d’être irréaliste, ils insistent néanmoins sur le fait que « le projet d’une histoire nationale québécoise demeure essentiel » (p. 20). Les nationalismes canadien-français et québécois ont eu bien sûr d’énormes impacts sur les nations autochtones au Québec. Le rapport entre ces projets nationalistes et les communautés autochtones est donc un sujet propice à la recherche. Mais les co-directeurs ne proposent pas d’examiner le nationalisme comme un phénomène historique. Ils insistent plutôt sur l’importance d’une histoire nationale comme un impératif pédagogique et un cadre interprétatif pour poursuivre la possibilité de parachever le projet d’une « histoire commune ». Dorais et Nootens ne proposent aucun cadre alternatif pour aborder la discussion des relations entre allochtones et Autochtones au Québec. Même le mot « allochtone » ne figure que trois fois dans l’introduction, manifestement éclipsé par le concept organisateur de la nation. Bien que les co-directeurs soient vraisemblablement sincères dans leur désir d’entrer en dialogue avec les autohistoires autochtones, le cadre d’une histoire nationale québécoise semble néanmoins la condition sine qua non de cette discussion. L’insistance sur l’idée de faire dialoguer spécifiquement une histoire nationale québécoise avec les histoires autochtones est remise en question par le fait que même les co-directeurs reconnaissent que les historiens et les historiennes déconseillent largement l’interprétation de l’histoire autochtone dans des cadres étatiques ou nationaux depuis des décennies (p. 19). Cette insistance commence à ressembler plutôt à une obstination étant donné que la majorité des textes recueillis dans cet ouvrage cherchent soit à s’éloigner de ce cadre national, soit le rejettent explicitement. Le texte de Brian Gettler, par exemple, propose de « déconstruire le récit dominant de l’histoire nationale au Québec » et d’« éviter de tenir pour acquise l’existence du territoire national du Québec » (p. 24). Dans …
François-Olivier Dorais et Geneviève Nootens (dir.), Québécois et Autochtones : histoire commune, histoires croisées, histoires parallèles ?, Montréal, Boréal, 2023, 276 p.
…plus d’informations
Nathan Ince
Université de Sherbrooke
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès