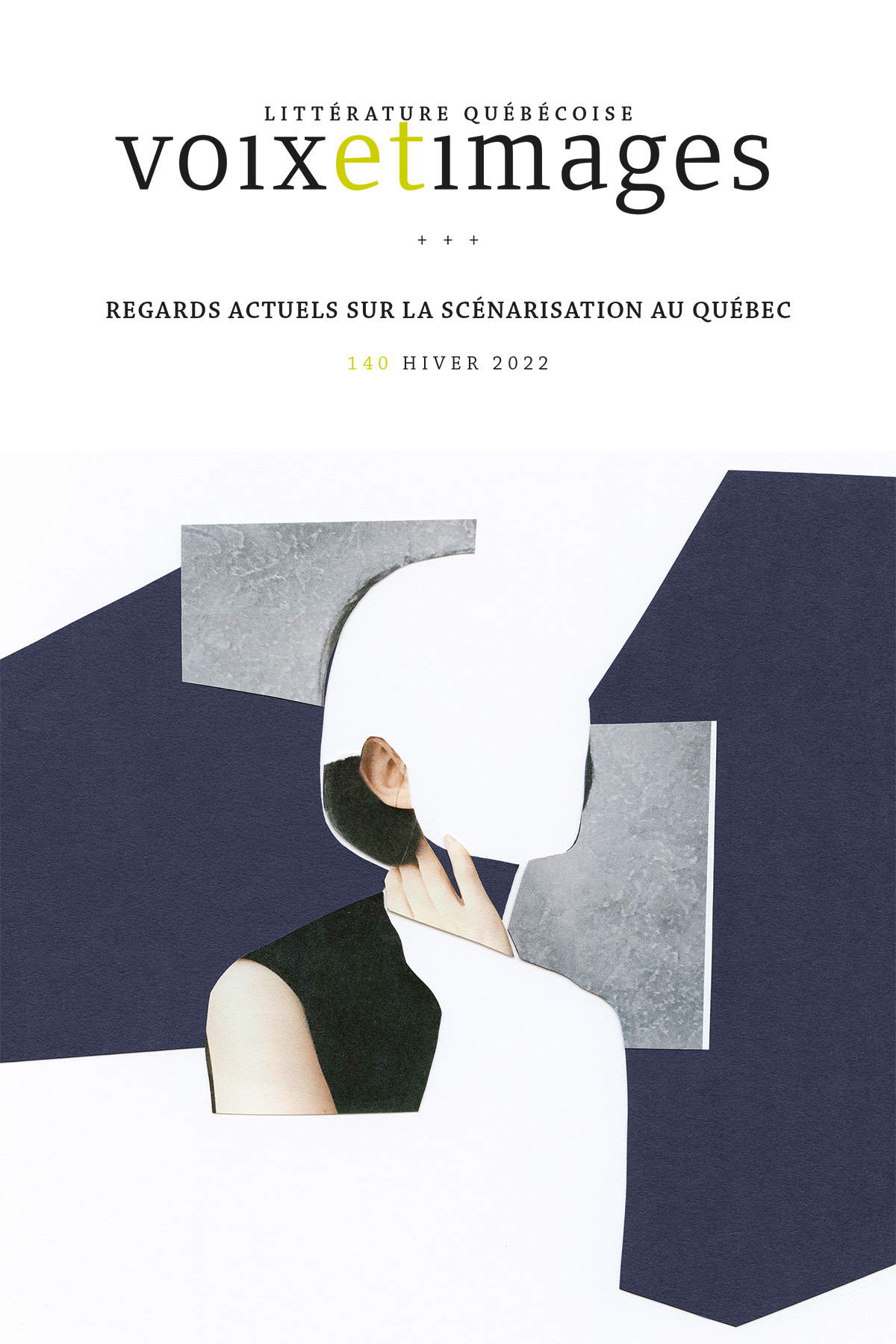Corps de l’article
Le hasard des piles de lecture et des obligations professionnelles, dont on sait qu’elles obéissent, les unes comme les autres, à des logiques presque ésotériques, a récemment mis sur mon chemin des ouvrages de Micheline Cambron et de Régine Robin, deux intellectuelles plus proches que l’on pourrait croire au premier abord. Le hasard des actualités politiques – celui-là autrement plus sordide – m’a comme soufflé à l’oreille une perspective de lecture de ces ouvrages. Je ferai ici entrer en dialogue Le roman mémoriel de Robin[1] et Une société, un récit de Cambron[2], mariage qui ne va pas de soi, question de filiations intellectuelles, de gang, dirais-je trivialement. Et pourtant.
La collection « Essais classiques du Québec » aux Presses de l’Université de Montréal, dirigée par Guy Champagne, Nicolas Lévesque et Patrick Poirier, fait paraître d’importants essais québécois souvent épuisés. Dans un pays où les aléas des structures d’édition ont souvent rendu indisponibles de costauds morceaux d’histoire intellectuelle, nous ne pouvons que saluer cette initiative. De Suzanne Lamy à Marty Laforest en passant par Claude Lévesque, c’est sans limites disciplinaires nettes que la collection bâtit son fonds. Les rééditions du Roman mémoriel et d’Une société, un récit (respectivement accompagnées de préfaces de Pierre Popovic et de Chantal Savoie), tous deux parus en 1989, participent de cette entreprise éditoriale d’envergure. Plus de trente ans après leur parution, il semble opportun de mesurer leur impact sur les études québécoises en actualisant les enjeux qu’ils soulèvent. Leur parution simultanée permet de forcer un peu le hasard et de tracer les contours d’une séquence historique qui nous mène jusqu’au présent.
Car bien au-delà de la coïncidence des dates, ce sont semblablement les notions de récit, de fiction et d’identité qui se retrouvent élucidées par le travail de Cambron et de Robin. C’est depuis mes études à l’Université de Montréal que je fréquente l’oeuvre de Robin. Au début des années 2000, on enseignait encore souvent La Québécoite (1983), et c’est avec ravissement et étonnement que j’ai découvert ses grands essais sur la mémoire et l’autobiographie, qui m’ont ensuite accompagné au fil de mes études supérieures. J’y ai trouvé une source d’inspiration théorique, mais surtout – et ce n’est pas rien ! – une posture critique, une méthode de lecture ouverte, souple, digressive. J’ai découvert le travail de Cambron, à ma grande honte, beaucoup plus tardivement, dans les parages des études sur le livre et l’imprimé.
La lecture d’Une société, un récit a donc pour moi un net effet de nouveauté, trente-trois ans après sa sortie. Si postérité savante il y a aux travaux de Cambron, c’est dans la foulée des projets collectifs comme le CRILCQ et « Penser l’histoire de la vie culturelle au Québec ». J’ai l’impression – peut-être ai-je tort – que ce ne sont pas les adeptes de la sociocritique qui lisent Cambron (peut-être le devraient-ils) ; ce sont plutôt celles et ceux qui envisagent la littérature québécoise comme un phénomène culturel s’inscrivant dans une courtepointe formée de multiples motifs d’imprimés, de spectacles, de radioromans, etc. L’objet de l’essai de Cambron est la formation (et la reproduction) d’un récit commun dans les années 1960 et 1970 au Québec. J’ai été surpris de voir l’actualité de ses conclusions, en l’occurrence la persistance de ce récit commun dans le présent. Cambron procède en analysant des oeuvres qui ont en partage d’avoir été des succès populaires : les chansons de Beau Dommage, les monologues d’Yvon Deschamps, les articles de Lysiane Gagnon sur la langue française, Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay, les poèmes de Gaston Miron, L’hiver de force de Réjean Ducharme. Afin de reconstituer ce qui est pensable et dicible durant la Révolution tranquille, Cambron propose donc un examen de ces objets hétérogènes entre « l’ordre du récit et le désordre du monde pour questionner la fiction et les modalités de sa lecture comme de son écriture » (16).
Une société, un récit est pleinement un essai de 1989, dans la mesure où Cambron dialogue explicitement avec les travaux, encore relativement récents à l’époque, de Paul Ricoeur sur le récit ; récents et pourtant un peu démodés, Gilles Marcotte lui avait semble-t-il rappelé à la blague. Cambron se positionne aussi, plus indirectement toutefois, quant aux développements de la théorie littéraire apportés par la sociocritique (Robert Escarpit) et l’analyse de discours (Marc Angenot, qui publie la même année 1889. Un état du discours social[3], n’est évidemment pas étranger à la démarche de Cambron). Elle pose des questions théoriques bien de son époque : Comment penser les rapports entre le discours littéraire et le discours social ? Quelle est la distance entre les productions culturelles et l’idéologie ? En ce sens, il me semble utile de lire en parallèle Une société, un récit et L’institution du littéraire au Québec[4] de Lucie Robert, dont la publication est exactement contemporaine ; lus côte à côte, les deux essais nous permettent de répondre à des questions connexes. Chez Robert, c’est la valeur d’usage et d’échange des textes qui est évaluée à l’aune du développement d’une institution littéraire proprement québécoise. 1989, grosse année.
Les cas d’étude de Cambron sont menés en fonction d’une grille inspirée de Ricoeur et de sa conception du récit qui articule les actes de langage en trois mouvements successifs : préfiguration, configuration et refiguration. Le récit est ici considéré comme un système ouvert qu’il s’agit d’analyser en vertu de sa fonction sociale de symbolisation. Pour le dire plus simplement : Cambron ne veut pas réduire le récit de la Révolution tranquille à une anecdote ; elle cherche à comprendre le « procès qui se joue à la fois dans le texte et hors du texte » (60), à cerner son caractère paradigmatique, à voir comment il travaille en profondeur l’ensemble du discours culturel. Quelle histoire les Québécois racontent-ils à ce moment ? « [S]i le récit commun a une fonction modélisante qui permet d’explorer le caractère d’un discours commun, c’est qu’il exprime le dicible d’une société donnée à un moment donné. » (92) Ce récit, insiste Cambron, est plus compliqué qu’il en a l’air au premier abord. S’il est commun de dire que les Canadiens français épousent le progrès et l’avenir durant cette période de l’histoire, le discours culturel paraît plus nuancé. Il semble en effet que l’intelligibilité du discours culturel est aussi définie en fonction de l’ancrage dans le passé et dans la définition d’un « nous » implicite. Cette perspective développée par Cambron est encore riche pour les études culturelles en raison de sa qualité d’ouverture : il existe des discours qui circulent, il faut savoir les écouter sans y plaquer des grilles d’interprétation téléologique.
À cet égard, le texte de Beau Dommage révèle tout à la fois un récit immobile (un « nous » englobant dans lequel le public se reconnaît aisément par le biais de références lisibles) et une mise à distance ironique et nostalgique, où coexistent plusieurs niveaux de langage. Le drame de l’enseignement du français de Lysiane Gagnon propose pour sa part une organisation enthymématique (beau mot, que j’ai appris en lisant Cambron, et qui désigne la figure de rhétorique consistant à réduire les raisonnements à des syllogismes simplistes – ici, qui renvoie à un sens commun dont toute critique serait exclue : tout le monde trouve que le français décline au Québec), mais qui comprend elle aussi des mécanismes de distanciation. Première conclusion théorique de Cambron : « De là […] provient la force heuristique du concept de récit commun : il permet de découvrir un modèle narratif hégémonique appréhendé paradigmatiquement et de saisir les forces qui agissent sur ce modèle, lui imposant une historicité, c’est-à-dire le rendant vulnérable dans le temps. » (118)
L’hégémonie, dit-elle, fonctionne comme une identification. Le public a le sentiment que l’oeuvre lui parle directement, phénomène rendu possible par le réseau de références implicites, d’évidences et de lieux communs qu’elle charrie. Les monologues d’Yvon Deschamps et les pièces de Michel Tremblay créent, par des effets perlocutoires, un sentiment de proximité pour les spectateurs. Dans Les Belles-Soeurs, par exemple, la parole apparaît comme le substitut d’une action transformatrice. « Parler, c’est éviter l’affrontement, mais aussi toute possibilité de changement. » (153) L’irruption du tragique chez Tremblay et de l’ironique chez Deschamps produit des conflits de codes, au sens d’André Belleau. Les caractéristiques formelles de ces oeuvres mettent à distance le récit hégémonique : « Dans le discours culturel québécois, entre les langages relevant du code élaboré (de la culture savante) et ceux relevant du code restreint (de la culture populaire), il y a une fissure béante : un profond malaise. » (173)
Ces conflits de codes entre « la parole de tous » et la distance qui marquent les oeuvres d’art, Cambron les voit aussi chez Miron qui « éprouve l’impossibilité de l’adéquation à une culture » (176) et dans L’hiver de force de Ducharme, où André et Nicole se rendent à l’évidence : « refuser de participer au discours commun c’est se condamner au silence, à l’“hiver de force” dans lequel le dedans et le dehors reviennent au même » (199). Après cette analyse minutieuse et sans complaisance, Cambron propose une caractérisation de ce récit hégémonique : celui-ci
constitue un système cohérent et très stable, [qui] se présente comme une sorte de définition de l’identité québécoise. La collectivité y est conçue comme un « nous » englobant, vidé de toute tension sociale ou politique, qui conçoit son destin comme une sorte de permanente reconduction excluant les ruptures de l’axe temporel que supposerait la succession passé-présent-futur. Ce « nous » défini spatialement, hors de toute extériorité (à ce titre, il désigne les Québécois rattachés à un territoire, et non les Canadiens français rattachés à une histoire messianique), rejette d’emblée toute action transformatrice, à la fois parce que les organisations éthique et épistémologique paraissent relever de l’ordre du donné et parce que la temporalité et la spatialité sans perspectives n’aménagent aucune extériorité vers laquelle puissent tendre les transformations.
204
Cela mène Cambron à réaffirmer, avec les mots de Ricoeur, que l’identité a d’abord et avant tout une fonction narrative, ce qui explique non seulement la teneur du discours, mais aussi la forme même de ce récit commun. Ce récit hégémonique a une grande stabilité, ce que confirment les oeuvres analysées ; cela n’exclut toutefois pas les procédés de mise à distance, les modifications au système qui, paradoxalement, en assurent la pérennité. Durant la Révolution tranquille, les Québécois sont subitement perplexes quant au récit dominant qui leur a servi si longtemps de socle. Il leur faudra néanmoins faire le récit de ces paradoxes, car « une culture ne meurt jamais tout à fait, tant qu’elle est retenue au langage par son Histoire, par ses histoires, par le grand récit commun qui fonde son rapport au monde » (210). Cambron montre avec éloquence que le récit commun fonctionne aussi par la force des mécanismes qui oeuvrent contre lui : le discours est toujours disjonctif, car il fait entrer en choc le récit hégémonique et les procédés de mise à distance. En conclusion, Cambron s’approprie les réflexions de Fernand Dumont, selon qui la culture est à la fois mémoire et distance, et ce sont l’inscription de la culture première dans la mémoire collective tout comme la mise à distance de la culture seconde qui lui donnent son sens. Cette « déchirure » est le propre du discours culturel québécois, conclut Cambron.
Synthèse de l’hétérogène. Mélanges offerts à Micheline Cambron, dirigé par Karine Cellard et Louise Frappier[5], montre bien comment ce premier essai de Cambron, tiré de sa thèse, est fondateur pour la suite de ses travaux sur l’histoire de la presse et sur l’enseignement de la littérature. Comme elle l’écrit dans la postface de l’ouvrage :
Enseignant la littérature dans un temps vécu, nous faisons moins don de la littérature que du lien social que la mise en circulation des discours échangés crée. D’où il faut dire et répéter que l’enseignement de la littérature est toujours politique, qu’il a à voir avec des communautés de lecture, avec la mise à distance et la mémoire d’une culture et que, cela se faisant dans le temps, notre historicité se trouve mise en jeu[6].
La temporalité et la spatialité des récits sont toujours des faits politiques, parce que la lecture les refigure en fonction des impératifs propres à chaque communauté. Ce que nous apprend Cambron, c’est à lire la lecture avec des outils et des méthodes qui laissent une grande place à l’aléatoire et à l’hétérogène, et accordent peu d’importance aux hiérarchies et aux grilles théoriques rigides. À cheval entre la philosophie, la linguistique, la sociologie et l’histoire des idées, elle a fait des études littéraires une maison désordonnée et d’une foisonnante lucidité.
Foisonnante, l’oeuvre de Régine Robin l’est aussi, sans l’ombre d’un doute. Et si les travaux de Cambron s’intéressent à la notion de récit, à la même époque, Robin, elle, porte plutôt son attention sur les mécanismes d’écriture de l’histoire et sur son caractère toujours subjectif et parfois fictif. La carrière de Robin, qui est décédée au début de l’année 2021, fut longue. Les deux livres dont je parlerai maintenant font office de bilan, Le roman mémoriel des vingt-cinq premières années de sa carrière, Les ombres de la mémoire, des intersections entre la grande histoire et sa propre histoire. Le roman mémoriel reprend en essence le rapport de synthèse de sa thèse de doctorat d’État à l’École des hautes études en sciences sociales (tradition hélas disparue !). Placé sous le signe du voyage (« Récit de voyage si l’on veut, voyage intellectuel, spirituel, existentiel, itinéraire qui ne s’arrête pas au découpage convenu des discours » [21]), Le roman mémoriel n’est pas uniquement un exercice institutionnel, cadre que Robin ne prenait pas au pied de la lettre, on le devine. Ceux et celles qui l’ont lue savent qu’elle mêlait sans cesse considérations autobiographiques et réflexions théoriques ou historiques. À ce titre, il me semble que l’une des actualités de son oeuvre réside précisément dans cette forme hybride assez prisée en ce moment, tant dans le monde anglophone (pensons à Maggie Nelson, Lisa Robertson[7]) que plus près de chez nous avec Daphné B., Charlotte Biron[8]. Mais il est une différence entre ces écrivaines adeptes d’autothéorie[9] et Robin, qui a élaboré une oeuvre avant tout savante, depuis l’université, tout en faisant bouger sans cesse les formes mêmes de diffusion de la connaissance. Ce n’est pas le même voyage, en quelque sorte.
Le roman mémoriel est donc autoréflexif en ceci qu’il propose une synthèse des travaux antérieurs de Robin, mais aussi parce qu’il propose une réflexion sur la zone poreuse qu’elle investit elle-même entre histoire et fiction. Et pour cela, elle remonte à sa thèse en histoire (La société française en 1789. Semur-en-Auxois), fait quelques détours par son enfance, par l’histoire de ses parents, par sa fréquentation des travaux d’Althusser, de Foucault et de Barthes, sa découverte de Bakhtine, son arrivée à Montréal, l’écriture de La Québécoite. Tout se mêle.
Malgré ce grand désordre, Le roman mémoriel suit un fil net : celui des raisons pour lesquelles elle est passée de l’histoire sociale à une analyse du discours, du fonctionnement du mémoriel (Ricoeur, Halbwachs) jusqu’au plurilinguisme. Ce parcours, qui suit les grandes conjectures intellectuelles des années 1960 jusqu’aux années 1980, fait office d’apologie de l’hétérogène afin de reformuler « tout le champ des représentations ayant trait au mémoriel, à l’imaginaire social » (48). La réflexion de Robin sur l’écriture de l’histoire, et sur la manière dont mémoire et histoire entrent en relation, concerne à la fois la patrimonialisation, les entremêlements des mémoires nationale, savante, collective et culturelle, ou ce qu’on pourrait globalement appeler « la gestion du passé », thème qui la taraudera jusqu’à ses magistraux Berlin chantiers et La mémoire saturée[10], parus une décennie plus tard. Mais son interrogation concerne également le rôle spécifique de la littérature dans la constitution de la mémoire. Évoquant tantôt Georges Perec, tantôt Nicole Lapierre (dont l’oeuvre constitue une sorte de soeur jumelle de celle de Robin), elle montre comment les différents procédés narratifs (le carnavalesque, le baroque, le burlesque, etc.) des fictions de l’histoire contribuent à une déconstruction des mémoires identitaires en proposant des mémoires critiques et poétiques. Le roman mémoriel est une mise en forme narrative du souvenir. Dans les débats historiens, la position de Robin est fuyante, l’a toujours été, et le restera jusqu’à la fin : il n’est d’histoire qui soit neutre, et il serait absurde de se passer – au nom d’une hiérarchie savante – du matériel mémoriel qu’est la littérature si on cherche à comprendre les représentations conflictuelles qui la forment. En cela, Robin est une brillante sociocriticienne, débusquant les chronotropes et les sociogrammes, ne s’intéressant qu’aux textes, qui ne sont ni de « bons » ni de « mauvais » récits (aux yeux de l’historien, « le flic du référent », dit Robin, narquoise). En 1989, alors qu’elle clôt un cycle de recherche sur Kafka, le yiddish, les esthétiques sociales, Robin s’intéresse à la manière dont l’écriture de l’histoire est prise dans une nouvelle conjoncture qui a trait « au multiculturalisme, aux identités ambiguës et molles, multivalentes, et au cosmopolitisme » (161). « Hétérogène langagier et mémoire ont partie liée », écrit-elle.
Les réflexions de Robin sur les différences épistémologiques entre écriture de la fiction et écriture de l’histoire, et sur les zones poreuses entre ces deux pôles, me semblent précurseures. On l’a vu, dans les trois décennies suivantes, les ouvrages de Ricoeur[11] (encore lui), d’Enzo Traverso[12], d’Ivan Jablonka[13], pour ne nommer que ceux-là[14], ont sans cesse interrogé les conséquences éthiques et politiques de la confusion grandissante entre fait et fiction[15], notamment dans l’écriture de l’histoire. Traverso a noté, avec justesse, mais non sans conservatisme, que la subjectivité trop grande de l’historien pouvait verser dans le narcissisme et miner sa crédibilité. Robin prend le parti de rendre visibles les subjectivités écrivantes, mais sans pour autant fixer les identités. Sans cesse dans son propre travail elle brouille les pistes, multipliant les alter ego, les villes visitées et habitées, les écrivains lus, les langues parlées.
Les entretiens qu’elle a accordés à Stéphane Lépine peu de temps avant son décès portent bien leur nom : Les ombres de la mémoire[16]. Soyons sensibles ici à l’aspect polysémique du titre. Tandis que Robin revient dans cet ouvrage sur son enfance et sa jeunesse, on constate à quel point la Shoah et la reconquête ultérieure de son identité juive furent fondatrices de toute sa vie intellectuelle ; l’impératif de mémoire, Zakhor – en hébreu : souviens-toi ! –, l’a suivie toute sa vie durant. Cette mémoire est ombrageuse, voire tragique, et a fortement coloré l’ensemble de son travail. Ces ombres du titre représentent aussi les membres décimés de la communauté intellectuelle de Robin, la bibliothèque imaginaire qu’elle a traînée dans son sillage : Perec, Kafka, Doubrovsky, Roth… Ce testament me force à mesurer l’apport de Robin aux études québécoises à proprement parler, et mon constat semblera trivial. C’est précisément son rejet de principe du nationalisme qui lui a permis d’élaborer un univers intellectuel cosmopolite, par moments assez peu ancré au Québec, mais qui paradoxalement me semble avoir durablement influencé les études littéraires d’ici. Et sa conception d’une mémoire marquée par la précarité, par une nécessité de se raconter, la rapproche à la fois de Dumont et de Cambron.
+
Il est quelque chose d’indirectement politique dans les essais dont j’ai parlé ici. Je dis « indirectement », car ce sont des ouvrages qui posent des questions théoriques, qui ne portent pas en eux des causes précises. Mais leurs implications politiques sont sérieuses, et concernent notre responsabilité en tant qu’analystes de la culture. Les parcours de Robin et de Cambron nous rappellent que les sciences humaines portent en elles un projet émancipateur, non pas parce qu’elles se doivent d’être essentiellement militantes ou alignées sur des axes idéologiques, mais plutôt parce que la pulsion de connaissance qu’elles manifestent devrait, en dernière instance, enrichir le débat public par un apport net en lucidité. L’hétérogénéité des objets de Cambron et de Robin, leur méthode, leur curiosité désordonnée, voire chaotique, peut aussi servir de leçon politique : les chercheurs doivent être attentifs à ce qui vient rompre les récits lisses.
Sans rabattre trop effrontément ces essais sur le présent, force est de remarquer que les questions de mémoire et d’identité continuent d’alimenter les débats publics. En fait, c’est peut-être cela qui me frappe : de 1989 à 2022, les enjeux sont souvent les mêmes. Nous sommes suspendus dans une non-résolution. J’avais eu la même impression en abordant l’affaire Larue, il y a quelques années[17]. Le livre de Cambron montre bien, dans la longue durée, comment des récits nationaux perdurent, et comment les oeuvres artistiques, le discours culturel, les reproduisent tout en insérant de la variation dans ce qui semble immuable. Le récent livre de Pierre Nepveu[18], sur lequel je reviendrai peut-être ultérieurement, une fois décanté, donne du grain à moudre sur cette question. En plein dans la mouvance de l’écriture migrante, Robin, pour sa part, dans Le roman mémoriel, s’interroge :
Ferais-je un jour partie de la littérature québécoise ? Au prix d’une désethnicisation de la notion, dans un jeu ouvert des mémoires collectives même en conflit, dans la traversée des intertextes multiples, même affrontés. C’est à ce prix que la/les littérature(s) québécoise(s) auront un sens pour que les autres s’y fassent une place, y soient acceptés, y aient un lieu de parole contribuant à l’élaboration de ce nouvel imaginaire social si nécessaire dans la société québécoise.
175
Encore une fois, il est tentant de lire le présent à l’aune des questions posées par mes aînées. J’imagine que Robin se réjouirait de voir une littérature québécoise de moins en moins captive d’un récit national ethnocentré. Mais elle serait sûrement inquiète – je le suis – de voir le gouvernement nationaliste de la CAQ tenter d’imposer le « nous » dont parlait Cambron, sans cette fois laisser de portes ouvertes à la variation. Gouvernement de la mêmeté, pourrait-on dire. Lisant la conclusion de Cambron, je ne peux m’empêcher de me dire que ses analyses des textes de Beau Dommage ou de Lysiane Gagnon, si elles appartiennent de toute évidence à une époque révolue, réussissent à mettre le doigt sur l’obsession du « nous » qui gangrène le Québec actuel. Il nous manque peut-être de spécialistes de la littérature sur la place publique pour analyser les signifiants culturels qui finissent par former des récits hégémoniques. J’en viens aussi à me demander ce qu’une lecture d’oeuvres de grande diffusion de notre époque (sans juger de leur qualité esthétique à proprement parler) nous indiquerait sur la manière dont l’identité québécoise se pense. Juste y penser me déprime un peu.
Parties annexes
Note biographique
JULIEN LEFORT-FAVREAU est professeur agrégé au Département d’études françaises de l’Université Queen’s. Ses principales publications sont : Henri Deluy, ici et ailleurs (avec Saskia Deluy), Le Temps des cerises, 2017 ; Politique de l’autobiographie. Engagements et subjectivités (avec Jean-François Hamel et Barbara Havercroft), Nota Bene, 2017 ; Pierre Guyotat politique, Lux éditeur, 2018 ; Le luxe de l’indépendance. Réflexions sur le monde du livre, Lux éditeur, 2021.
Notes
-
[1]
Régine Robin, Le roman mémoriel. De l’histoire à l’écriture du hors-lieu, nouvelle édition, préface de Pierre Popovic, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Essais classiques du Québec », 2021 [1989], 185 p.
-
[2]
Micheline Cambron, Une société, un récit. Discours culturel au Québec (1967-1976), nouvelle édition, préface de Chantal Savoie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Essais classiques du Québec », 2021 [1989], 224 p.
-
[3]
Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Longueuil, Le Préambule, coll. « L’univers des discours », 1989, 1167 p.
-
[4]
Lucie Robert, L’institution du littéraire au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « À propos », 2019 [1989], 252 p.
-
[5]
Karine Cellard et Louise Frappier (dir.), Synthèse de l’hétérogène. Mélanges offerts à Micheline Cambron, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2023, à paraître.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Maggie Nelson, The Argonauts, Minneapolis, Graywolf Press, 2015, 143 p. ; Lisa Robertson, The Baudelaire Fractal, Toronto, Coach House, 2020, 205 p.
-
[8]
Daphné B., Maquillée, Montréal, Marchand de feuilles, 2020, 220 p. ; Charlotte Biron, Jardin radio, Montréal, Le Quartanier, coll. « Série QR », 2022, 126 p.
-
[9]
Voir Lauren Fournier, Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism, Cambridge, MIT Press, 2021, 320 p.
-
[10]
Régine Robin, Berlin chantiers. Essais sur les passés fragile, Paris, Stock, coll. « Un ordre d’idées », 2001, 445 p. ; La mémoire saturée, Paris, Stock, coll. « Un ordre d’idées », 2003, 524 p.
-
[11]
Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2000, 675 p.
-
[12]
Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi : histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 2005, 136 p ; Passés singuliers. Le « je » dans l’écriture de l’histoire, Montréal, Lux éditeur, 2020, 223 p.
-
[13]
Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du xixe siècle », 2014, 339 p.
-
[14]
Voir aussi Jean-Pierre Couture, « Notre allergie aux faits sociaux », Liberté, no 331, été 2021, p. 77-78.
-
[15]
Sur cette question, voir le tranchant : Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2016, 618 p.
-
[16]
Stéphane Lépine, Les ombres de la mémoire. Entretiens avec Régine Robin, Montréal, Somme toute, coll. « D’ailleurs », 2021, 223 p.
-
[17]
Julien Lefort-Favreau, « Une mésaventure intellectuelle », Liberté, no 311, printemps 2016, p. 58-59 ; Dominique Garand, Un Québec polémique. Éthique de la discussion dans les débats publics, avec la participation de Philippe Archambault et Laurence Daigneault-Desrosiers, Montréal, Hurtubise, coll. « Cahiers du Québec. Communications/Littérature », 2014, 450 p.
-
[18]
Pierre Nepveu, Géographies du pays proche. Poète et citoyen dans un Québec pluriel, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2022, 249 p.