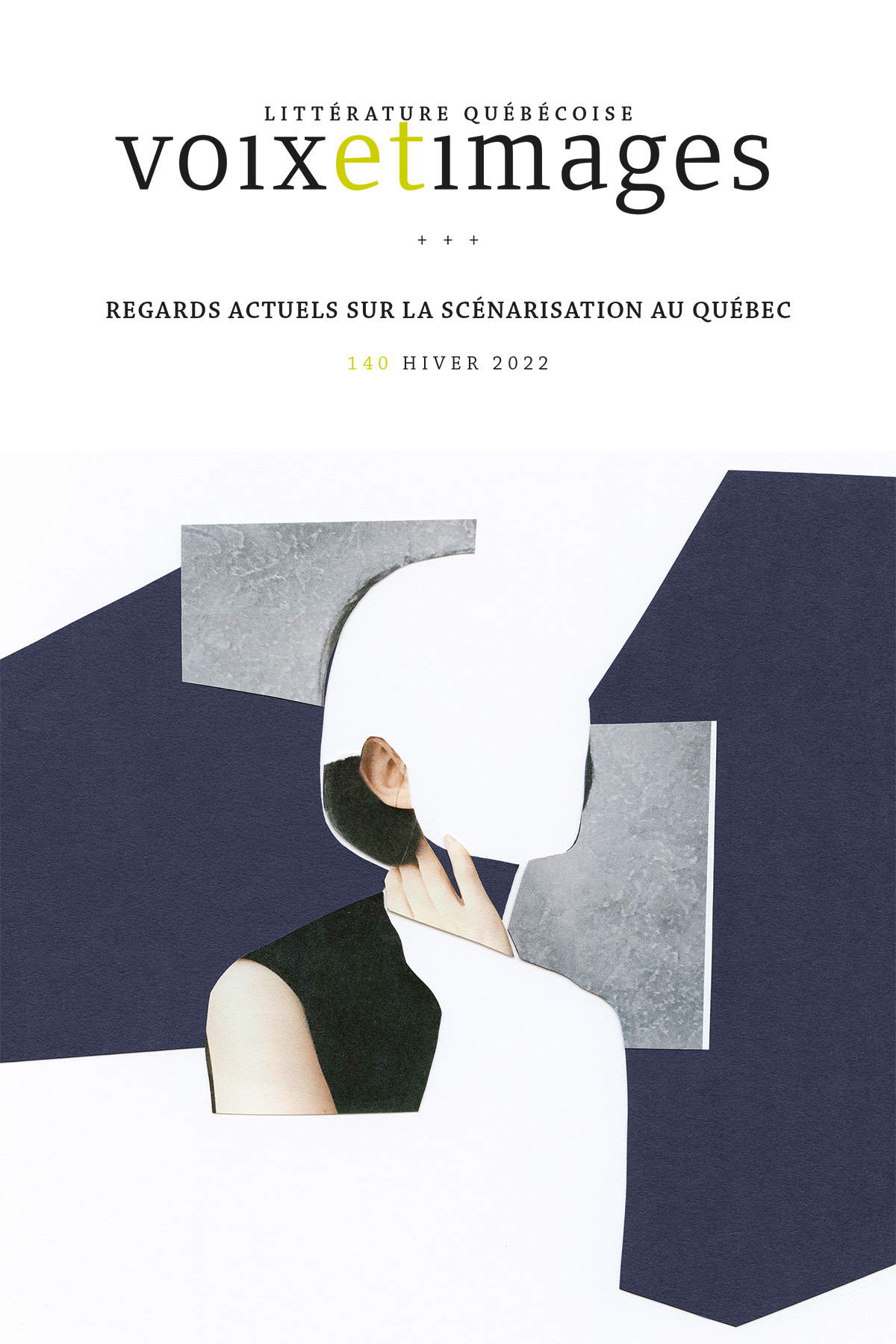Résumés
Résumé
Cet article cherche à démontrer comment l’écriture du scénario de films fictionnels réalisés par des femmes autochtones/allochtones (Québec, Nunavut) peut être considérée à la fois comme un acte de résurgence, donc de régénération socioculturelle (Betasamosake Simpson, 2011), et de survivance, c’est-à-dire d’une présence dynamique qui se manifeste entre autres à travers l’approche décolonisante de raconter des histoires (Vizenor, 2008). L’importance d’une écriture scénaristique qui redonne à la femme autochtone la place qui lui revient en tant que pédagogue, conseillère, guérisseuse, entrepreneure, mère et guerrière au sein de sa communauté et à l’extérieur est également mise de l’avant. Enfin, la dimension collective et collaborative d’un processus d’écriture qui engage de plusieurs façons des individus, familles et communautés dans des gestes de souveraineté narrative est mise en lumière, à travers la parole même des cinéastes et le partage de leurs expériences respectives.
Abstract
This article seeks to demonstrate ways in which writing screenplays for fictional films produced by Indigenous/Non-Indigenous women (Québec, Nunavut) can be considered as an act both of revival, thus of socio-cultural regeneration (Betasamosake Simpson, 2011), and of survival, that is to say of a dynamic presence that is apparent in, among other things, the decolonizing approach to recounting stories (Vizenor, 2008). The significance of writing scripts for films that restore Indigenous women to their rightful roles as educators, counsellors, healers, entrepreneurs, mothers, and advocates within the community and beyond is also emphasized. Finally, the collective and collaborative dimension of a process that engages individuals, families and communities in a number of ways in acts of narrative sovereignty is highlighted through the words, even of the film-makers themselves, and through the sharing of their respective experiences.
Resumen
Este artículo intenta demostrar cómo la redacción del guion de películas de ficción realizadas por mujeres autóctonas (Quebec, Nunavut) puede considerarse tanto un acto de resurgimiento, y por tanto de regeneración sociocultural (Betasamosake Simpson, 2011), como de supervivencia, es decir, de una presencia dinámica que se manifiesta, entre otras cosas, a través del enfoque descolonizante de la narración (Vizenor, 2008). También se plantea la importancia de una escritura de guiones que devuelva a la mujer autóctona el lugar que le corresponde como pedagoga, consejera, sanadora, empresaria, madre y guerrera dentro y fuera de su comunidad. Por último, se destaca la dimensión colectiva y colaborativa de un proceso de escritura que compromete de muchas maneras a individuos, familias y comunidades en actos de soberanía narrativa, a través de las propias palabras de los cineastas y puesta en común de sus respectivas experiencias.
Corps de l’article
En observant de près le paysage cinématographique au Québec, peuplé depuis peu par une nouvelle génération de femmes cinéastes autochtones (dignes héritières de la matriarche et documentariste abénaquise Alanis Obomsawin), force est de constater la prédominance en son sein d’une présence féminine qui donne vie – à l’écrit comme à l’écran – à des récits contemporains de dénonciation, mais surtout de célébration des cultures autochtones. À cet égard, les longs métrages de fiction de la cinéaste mohawk Sonia Bonspille-Boileau (Le Dep, 2014 ; Rustic Oracle, 2019) ou du collectif de femmes inuit Arnait Video Productions (Before Tomorrow, 2009 ; Uvanga, 2013 ; Restless River, 2019) positionnent les femmes autochtones au coeur même de leurs récits. Ces derniers sont bien souvent inspirés d’événements réels, d’histoires issues de la tradition orale et de témoignages qui ont subi diverses remédiations avant de se retrouver sous forme d’images et de sons. Il est communément admis qu’« écrire un scénario, c’est d’abord et avant tout construire une histoire qui véhiculera un ou plusieurs thèmes centraux[1] ». Cela dit, à la suite de rencontres éclairantes avec les cinéastes Sonia Bonspille-Boileau (Mohawk) et Marie-Hélène Cousineau (membre du collectif Arnait Video Productions), nous souhaitons mettre de l’avant l’idée que l’écriture du scénario constitue une étape importante dans l’élaboration de longs métrages en général, mais particulièrement pour les films autochtones, car elle permet de coucher sur papier ces mots/maux parfois racontés (tradition orale), parfois négligés, afin de donner à nouveau une voix à ceux et à celles qui ont été pendant de nombreuses décennies condamné·es au silence. Ces deux cinéastes (et nous ajouterons ici Madeline Ivalu et Susan Avingaq, d’Arnait) s’inscrivent ainsi au sein d’une abondante lignée de conteur·euses d’histoires « qui n’ont jamais été silencieux·ses face à la violence coloniale[2] » et aux conséquences qu’elle engendre. Dans cette optique, et suivant les paroles recueillies lors d’entrevues conduites avec les deux créatrices à l’automne 2021, nous chercherons à démontrer comment l’écriture du scénario de ces films peut être considérée à la fois comme un acte de résurgence, défini comme un « mouvement socioculturel qui se concentre sur la régénération dans les communautés autochtones, entre autres à travers la validation des connaissances, cultures, histoires et [de la] continuité[3] », et de survivance, entendue comme une « présence active qui dépasse la survie et qui se manifeste à travers [les] histoires[4] ». De même, nous soulignerons l’importance d’une écriture scénaristique qui redonne à la femme autochtone la place qui lui revient en tant que pédagogue, conseillère, guérisseuse, entrepreneure, mère et guerrière au sein de sa communauté et à l’extérieur. Enfin, il est impossible de négliger la dimension collective d’un processus d’écriture qui engage de plusieurs façons des individus, familles et communautés dans des gestes de souveraineté narrative, et qui implique « l’habileté à raconter [leurs] propres histoires et à définir [leur] vision du monde […] afin que disparaissent les stéréotypes et les mythes, et qu[’ils soient] libres de [se] représenter [eux]-mêmes[5] ». Le programmeur de films Ojibwé Jesse Wente mentionne à cet effet que l’expression d’une souveraineté narrative est présente à travers des histoires autochtones écrites et racontées par des Autochtones qui détiennent le contrôle créatif de ces dernières[6]. Il est inutile de préciser (mais nous le ferons tout de même) que les pages qui suivent se veulent le récit du parcours unique de deux cinéastes, de cette grande histoire d’amour qu’elles entretiennent avec leur oeuvre, et qui ne saurait être exprimée avec verve autrement qu’à travers leur parole. Aussi, en s’appuyant sur les témoignages des réalisatrices et sur le contenu des scénarios, cet article souhaite démontrer comment l’écriture de scénarios par des cinéastes autochtones s’avère un acte de résurgence et de souveraineté narrative, à travers une réécriture de l’histoire (bien souvent liée au colonialisme) racontée du point de vue autochtone. L’apport de ce texte se situe dans cette démonstration à partir de témoignages/conversations avec les cinéastes qui expliquent avec générosité leur démarche.
LE DEP (2014) ET RUSTIC ORACLE (2019) : LA SOUVERAINETÉ NARRATIVE AUTOCHTONE DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’étape de l’écriture du scénario chez les cinéastes autochtones interrogées (ou collaborant avec un collectif autochtone, dans le cas de Marie-Hélène Cousineau) se veut le point médian d’un projet (la réalisation d’un film) autour duquel gravitent des voix, des récits, des visages, des traditions, ainsi qu’une histoire fortement teintée par la colonisation. Ces éléments influencent non seulement le processus d’écriture, mais le définissent en tant qu’acte collectif où la remédiation joue un rôle non négligeable, malgré l’unicité de chaque expérience reliée à l’écriture de ces scénarios. La remédiation est définie par Bolter et Grusin comme « la représentation d’un médium dans un autre médium », en ce sens où tout nouveau médium conserve une trace de l’ancien médium sur lequel il est bien souvent calqué – par exemple, la version numérisée d’une oeuvre d’art conservera une trace (visuelle et parfois écrite) de l’oeuvre originale[7]. Dans cet ordre d’idées, établissant un lien entre les médias électroniques et le langage articulé, Marshall McLuhan explique comment les médias présentent une nature similaire, les sociétés modernes/technologiques ressemblant davantage aux sociétés orales qu’aux sociétés littéraires[8]. La remédiation peut aussi être considérée dans son sens phonétique (on y entend le mot « remède ») et étymologique (« re-guérir », considérant que « remède » signifie « guérir ») comme un remède apportant la guérison (amélioration ou gain rapporté dans le nouveau médium). Cela dit, si la guérison sous-tend nécessairement le passage d’un état à un autre, ainsi que la modification de l’être « transformé » par ce passage, la remédiation d’un médium dans un autre médium implique également une métamorphose qui a lieu dans cet entre-deux du transfert médiatique, et où les modes de transmission (par exemple de l’écrit au virtuel) se modulent à de nouvelles fréquences. Ainsi, dans une entrevue, le cinéaste anishinaabe Kevin Papatie explique comment la caméra est le bâton de parole contemporain de son peuple, alors que dans le court métrage Territoire des ondes (Patrick Boivin et Allan Flamand, 2007), les cinéastes atikamekw démontrent comment les ondes du tambour, outil ancestral de communication et de guérison, sont analogues aux ondes télévisuelles ou radiophoniques, nouveaux outils de communication avec l’extérieur.
La tradition orale autochtone se transmettait vocalement et bien souvent à l’aide d’artefacts visuels (ceintures wampums) et de formes d’écriture (pictogrammes) qui servaient d’aide-mémoire. Ainsi, comme la nature du lien entre l’auditeur·rice et le récepteur·rice sous-tend une présence physique (en direct, virtuelle ou différée, selon le cas), nous pouvons envisager la remédiation de la tradition orale vers un médium électronique tel que le cinéma comme étant davantage propice à la transmission vocale et visuelle des récits. À cet égard, plusieurs cinéastes autochtones, dont Loretta Todd, Shelley Niro et Alanis Obomsawin, reconnaissent qu’il existe un lien unissant la tradition orale et le médium filmique, et que cette relation entre les deux se traduit différemment selon la vision du ou de la cinéaste et son appropriation de la tradition orale et du médium cinématographique[9]. Lorsqu’interrogé sur cette question, le cinéaste inuit Zacharias Kunuk est d’ailleurs le premier à répondre avec conviction que la vidéo demeure pour lui un médium de prédilection lorsqu’il s’agit de filmer l’invisible et de restituer avec justesse une vision du monde inuit, qui fut longtemps centrée autour du chamanisme et d’une cohabitation avec le territoire et les esprits[10]. Qu’en est-il alors de l’écriture à travers laquelle le scénario se manifeste ? Pour l’anthropologue Rémi Savard, la traversée de l’oralité à l’écriture, d’une narration créative et sujette au mouvement rotatoire à une narration statique et permanente, peut menacer la nature dynamique et changeante du récit oral en le faisant tenir dans des catégories qui sont utilisées par les civilisations écrites :
Transporté dans le monde de l’écriture, un récit oral risque de se voir conférer une existence de plus en plus autonome, ayant finalement peu de rapport avec celle que lui réserve son contexte d’origine […]. En lui donnant une forme écrite, on fait donc plus que substituer une technique d’expression à une autre : 1) on l’immobilise par rapport à la combinatoire sémantique qui l’avait engendré et qui l’aurait modifié, 2) il s’éloigne peu à peu du contexte humain dont il tirait sa substance et qu’il transposait à sa façon[11].
Or, plusieurs auteur·rices autochtones explorent les possibilités de renégociations de la langue et de la tradition orale à travers le médium de l’écriture, en intégrant « des mots, des expressions, voire des phrases complètes de leur langue maternelle à leurs écrits de langue anglaise ou française », ce processus leur permettant de redécouvrir certaines dimensions de leur propre langue maintenant disparues[12]. Mentionnons à ce titre la poésie de Joséphine Bacon et l’expérience de la poétesse innue qui, naviguant d’une langue à l’autre, garde vivantes certaines expressions de l’innu-aimun qui appartiennent au temps du nomadisme. Dans le même ordre d’idées, l’autrice anishinaabe Leanne Betasamosake Simpson choisit d’enfreindre, avec un style d’écriture décolonisant, les règles de la langue anglaise, en jouant allègrement avec la ponctuation, en insérant dans ses textes des mots et expressions en anishinabemowin et en intégrant, pour son ouvrage Islands of Decolonial Love, un lien audio qui donne à ses lecteur·rices la possibilité d’expérimenter son écriture à travers l’oralité (chant et musique). Outre ces faits, il faut également tenir compte de ce qu’avec le scénario de film, il y a, peut-être davantage qu’avec le roman, un processus de va-et-vient continuel entre le scénario et la production du film (tournage, montage) qui fait du scénario un objet d’écriture fluide, enrichi par une oralité qui se manifeste à travers des rencontres ; rencontres avec le temps, avec la mémoire, avec des individus et avec les nombreuses possibilités du médium filmique (montage, reprise des scènes, improvisation des comédiens, etc.).
L’autochtonisation de l’écriture et de la langue par des artistes autochtones est par ailleurs présente sous différentes facettes dans le processus d’écriture de scénario tel que vécu par la cinéaste mohawk Sonia Bonspille-Boileau. Originaire de Kanehsatake et née de l’union d’une mère mohawk et d’un père québécois (allochtone), la réalisatrice est diplômée de l’Université Concordia (Montréal), où elle a fait des études en cinéma. Elle entame sa carrière, comme beaucoup de cinéastes autochtones, avec le genre documentaire, cherchant à sonder, par l’entremise de ses images et des voix autochtones captées par sa caméra, son identité autochtone (Last Call Indien, 2011) ainsi que l’histoire de son peuple et de sa communauté (The Oka Legacy, 2015). Or, c’est avec Le Dep, sorti en salles en 2014, que Sonia entame l’écriture de ce qui deviendra son premier long métrage fictionnel. Inspiré par des gens qu’elle connaît et par des situations vécues dans des communautés autochtones, le scénario est écrit en un temps record (environ trois semaines) et raconte l’histoire d’une jeune femme qui, une nuit, vit une situation traumatisante au dépanneur où elle travaille. Sachant qu’elle doit composer avec un budget ainsi qu’un temps limités, la cinéaste décide d’écrire une histoire ayant une unité de lieu et de temps (un dépanneur, pendant la nuit) et très peu de personnages (une jeune femme, son petit ami, son père et un inconnu), construisant ainsi un univers avec lequel elle est à l’aise[13]. Parce qu’elle ne se sent pas nécessairement outillée sur le plan de la structure, elle demande à travailler avec un conseiller en scénarisation. Ce dernier, le cinéaste québécois Benoît Pilon, se révèle une aide précieuse, faisant preuve de compréhension envers sa démarche et d’une grande générosité quant à ses conseils judicieux. Toujours selon la cinéaste, le scénario qu’elle a écrit est très proche du film qu’elle a tourné et monté, en ce sens que les dialogues du texte sont ceux que l’on peut entendre dans le produit final, malgré la flexibilité accordée aux comédien·nes – tou·tes autochtones, mais provenant de communautés diverses – afin que ces dernier·ères se sentent à l’aise avec les mots qu’elle leur suggère (ES). C’est en outre à travers la vision toute personnelle de la cinéaste, qui nous propose un regard de l’intérieur sur les problématiques vécues dans les communautés (violence, pauvreté, perte de pouvoir), mais surtout à travers le côté profondément humain et authentique d’une écriture jaillie de façon spontanée que l’on assiste à une « autochtonisation de l’écriture ». Cette dernière se veut le rassemblement des fragments épars d’une mémoire et de récits oraux issus de sa culture et de son identité autochtones, emmagasinés dans un coin de la conscience, et auxquels la cinéaste offre une vie nouvelle. Enfin, parce que les thématiques sont ancrées dans l’autochtonie contemporaine, l’autrice est reconnaissante de la réception positive accordée au film par un auditoire international, imputable à l’universalité des valeurs autochtones et des émotions véhiculées dans le film. L’atteinte d’une souveraineté narrative s’accomplit alors par le biais d’une écriture qui se fait voix.
L’intériorité de l’expérience vécue par la cinéaste, qui puise, pour l’écriture du scénario Le Dep, à même ses expériences et souvenirs, s’est révélée pour son second long métrage une tout autre aventure. Le scénario écrit, puis le film tourné et monté seront cette fois fort différents d’une étape à l’autre du développement. Fruit d’un processus de recherche intense et étendu plus longuement dans le temps (2015-2017), l’écriture de Rustic Oracle (2019), qui traite de la question on ne peut plus délicate des femmes autochtones disparues et assassinées au Canada, demande que soit adoptée une approche adaptée à un nouveau contexte, comme le souligne cette dernière :
En écrivant le scénario de Rustic Oracle, je savais que je traitais d’un sujet énorme dans les communautés autochtones et au Canada, donc je n’avais pas la même approche […]. Le processus a été très long ; parler à des familles, lire des livres, des articles, regarder des entrevues, écouter des balados. C’est délicat de parler à des gens, mais je sentais que je n’avais pas le choix d’aller parler à des groupes tels que Sisters in Spirit, de participer à des marches, à des vigiles, pour m’assurer que je maîtrisais mon sujet, et que je respectais le message que les familles souhaitaient que je communique.
ES
Depuis maintenant un peu plus d’une décennie, les communautés autochtones du Canada tentent d’attirer l’attention de la population et du gouvernement sur le nombre élevé de femmes autochtones assassinées et disparues. Jadis considérées par les sociétés autochtones traditionnelles et matriarcales comme étant au coeur de l’économie, de la vie familiale et de la transmission culturelle de leurs peuples, ces femmes doivent aujourd’hui négocier avec les conséquences découlant de l’assimilation et de la christianisation des Autochtones. Au-delà d’une simple question de genre, les sévices physiques et psychologiques subis par ces femmes sont directement liés à une forme de violence coloniale qui perdure à ce jour, et ce, malgré les efforts d’organismes (Sisters in Spirit, Legal Strategy Coalition on Violence Against Indigenous Women) et d’individus qui travaillent sans relâche pour cette cause. Dans un tel contexte, où les statistiques démontrent par exemple que les femmes autochtones sont sept fois plus à risque d’être victimes de violence que les femmes non autochtones, l’écriture d’un scénario qui cherche à tenir compte de ces réalités, tout en personnalisant une histoire afin de la rendre plus humaine pour les spectateurs, vient nécessairement avec son lot de défis et de victoires[14]. C’est ainsi que le premier jet du scénario, qui présente une suite d’événements à la manière d’un film d’enquête, a été mis aux poubelles, afin que puisse être véhiculé avec justesse un message d’amour et d’espoir, de résilience et de beauté, témoin d’une survivance qui s’accomplit par-delà la victimisation, le déracinement et la douleur (ES). L’importance de communiquer vers l’extérieur des représentations positives, qui sont des exemples de souveraineté narrative et audiovisuelle, est d’ailleurs réitérée par l’autrice Michelle Raheja dans son ouvrage Reservation Reelism (2010), où elle reconnaît le pouvoir que détiennent « les actes créatifs d’autoreprésentations[15] » dans les possibilités de recouvrement d’une santé intellectuelle brimée par le colonialisme.
Dans cette veine, des ateliers d’écriture avec d’autres cinéastes autochtones – dans le cadre du projet Women in the Director’s Chair – ont permis à Sonia Bonspille-Boileau d’entendre les mots qu’elle avait jusqu’alors écrits, récités par des acteur·rices professionnel·les (ES). Ce pouvoir de la voix, qui la mène « à traduire les nuances affectives les plus fines » en s’identifiant profondément, sur le plan psychique, à la volonté d’un individu de se dire et d’exister, affecte ainsi le langage sans voix qu’est l’écriture[16]. Ce sont par ailleurs les émotions associées aux voix – éteintes, tues, étouffées – des femmes autochtones disparues et assassinées qu’il est possible de ressentir dans l’interstice des mots qui hantent un scénario inspiré (entre autres) par la disparition de deux jeunes femmes provenant de la communauté du conjoint de Bonspille-Boileau, le cinéaste Jason Brennan. C’est aussi l’émotion vécue par la réalisatrice qui est couchée sur papier, alors que la femme, mère, conjointe et fille ne peut écrire plus de deux à trois heures par jour « parce que cela [lui] brisait le coeur » (ES). Le scénario raconte les périples vécus par une mère (Susan) et sa plus jeune fille (Ivy) lors de leurs recherches de l’aînée (Heather), disparue subitement de leur communauté. Or, au-delà d’une simple quête pour retrouver Heather, le long métrage dévoile, parfois clairement, parfois de manière plus subtile, les incohérences d’un système qui semble se préoccuper bien peu du sort de ces filles et femmes, la responsabilité incombant aux familles de faire entendre leurs revendications et leur besoin d’assistance, quitte à se heurter aux murs de l’incommunicabilité entre deux cultures qui cohabitent sans se connaître véritablement.
Pour les peuples autochtones, l’importance de raconter leurs histoires découle alors du pouvoir acquis à travers cette capacité de transmettre – que ce soit à l’oral, à l’écrit ou, plus récemment, à l’écran – ces « mémoires d’une injustice » léguées d’une génération à l’autre, qui sont aussi une façon de bâtir des ponts entre les cultures, à travers un processus de guérison qui passe par la création et le partage[17]. Bien souvent, ces récits sont portés par plusieurs voix (femmes, enfants, aînés) qui, sous le prétexte du film, font entendre le message des individus, familles et communautés unis dans une même lutte, dans une même célébration de la résilience. Pour Rustic Oracle (et après une modification du scénario), c’est à travers le regard et la voix d’une enfant, Ivy, qui cherche à comprendre ce qu’il est advenu de sa grande soeur adorée, que ces valeurs universelles aptes à toucher un plus vaste auditoire ont trouvé un canal de prédilection, pendant l’étape du tournage :
Au tournage, j’ai plus appris la réalisation, car je me suis rendu compte que, lorsque tu écris tes propres scénarios, tu ne dois pas perdre de vue les objectifs de chaque scène ; quels sont les moments clés de chaque scène ? C’est ce que tu dois faire ressortir. Pas seulement la mécanique de tourner la scène ; si ta scène repose sur la réaction de l’enfant dans le scénario, c’est ce qui doit arriver au tournage. J’ai compris cet élément avec Rustic, avec l’expérience. Donc mon premier montage reflétait ce côté un peu plus technique de l’histoire : en laissant dormir le scénario pendant 6 mois et en faisant autre chose, je rebaignais dans la créativité ; j’ai pu retourner à mon montage et retourner à la perspective de l’enfant. On a donc ramené les scènes selon la perspective d’Ivy. C’est là que le film a pris forme ; c’est là que j’ai retrouvé mon scénario. La perspective d’Ivy permet d’aller toucher l’auditoire de façon viscérale.
ES
Le processus d’écriture d’un scénario autochtone, du moins en ce qui concerne cette réalisatrice, n’est jamais qu’une écriture (symboliquement parlant) à une main, un fait réitéré une fois de plus à travers l’écriture et le tournage, par Sonia Bonspille-Boileau et son équipe, de la télésérie sur les pensionnats autochtones du Québec Pour toi, Flora, dont le tournage s’est terminé en novembre 2021. Tournée en grande partie dans la région de l’Outaouais (Kitigan Zibi et Maniwaki), Pour toi, Flora, qui comprend six épisodes, s’inspire plus précisément du quotidien d’enfants autochtones ayant fréquenté (malgré eux) le pensionnat Saint-Marc-de-Figuery, en Abitibi. La première diffusion de la série, sur les ondes de Radio-Canada et d’APTN (Aboriginal Peoples Television Network), sera par ailleurs offerte en anishinabemowin, avec sous-titres en français, afin que « l’ensemble du Québec puisse entendre cette langue[18] ». À l’heure où les écrits sur les pensionnats autochtones circulent de plus en plus, et où des courts et des longs métrages tels que La mallette noire (Monnet, 2014) et Rhymes for Young Ghouls (Barnaby, 2012) nous aident à comprendre l’horreur des pensionnats – abus physiques, sexuels et psychologiques – et les impacts sur les générations qui ont suivi, Pour toi, Flora est la première série à aborder de front la question de ces établissements au Québec francophone. D’entrée de jeu, il est bon de rappeler que « le principe fondateur des pensionnats était celui de la séparation et de la rupture des relations familiales et communautaires[19] », et que la réparation de ces liens demeure au coeur de la résurgence autochtone, c’est-à-dire de ces actions qui visent la restauration et la régénération à travers un investissement « dans nos façons d’être[20] ». C’est entre autres à travers le processus de collaboration de Bonspille-Boileau avec des survivants de pensionnats qu’une démarche de guérison déjà en cours a pu être poursuivie par les individus et les familles.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’écriture du scénario, la réalisatrice raconte qu’une collaboration étroite était de mise pour ce projet, car si l’autrice hésitait, en ce qui concerne Rustic Oracle, à replonger les familles dans le trauma qu’elles vivaient, préférant écrire une histoire fictive inspirée de situations réelles, la consultation avec des survivant·es (et leurs familles) allait cette fois de soi :
J’ai fait lire les six épisodes à des aînés et à des survivants de pensionnats au Québec, et un pensionnat en particulier (Saint-Marc-de-Figuery). Il y a des éléments qui viennent d’autres pensionnats, mais j’ai travaillé avec des survivants de ces pensionnats et ça a été un processus de guérison assez extraordinaire, parce que juste le fait de faire lire les scénarios à des gens, je sais que c’était très exigeant pour certaines personnes. On s’entend qu’ils ont été choisis parce qu’ils sont là aussi dans leur processus ; ce sont des gens qui ont déjà des étapes de franchies dans leur cheminement. Le processus de guérison était entamé et ils étaient rendus à un point où ils étaient capables de se replonger dans leur vécu.
ES
Ainsi, le processus d’écriture et de tournage, qui s’est échelonné au total sur trois ans, implique cette fois directement des individus, familles et communautés. Les survivants et témoins des pensionnats agirent en tant que consultants et surtout en tant que conseillers ; ces derniers devaient absolument donner leur accord quant au scénario afin que le projet aille de l’avant. Inévitablement, le rythme adopté fut beaucoup plus lent qu’avec les deux autres films, car il était impératif de se plier au temps dont les témoins avaient besoin pour lire et assimiler le scénario, et ce, malgré les échéanciers imposés par les bailleurs de fonds, qui se montrèrent par ailleurs très compréhensifs :
On a pleuré abondamment, il y a des gens qui venaient avec des commentaires, et qui avaient vécu quelque chose de très spécifique, et ils se reconnaissaient à travers mes écrits. Il y en a qui disaient : « Je n’ai pas dormi cette nuit, car je me suis rappelé tel ou tel événement » ; certains nous ont appelés en nous disant : « C’est incroyable, j’ai l’impression de lire ma vie ! » et ça, c’était énorme […]. À cause de tout ce qui est sorti dans la dernière année (découvertes de sépultures d’enfants autochtones dans d’anciens pensionnats), j’ai dû réajuster mes scénarios. Si on avait filmé pendant la pandémie (2020) comme prévu, mon histoire aurait été en retard sur là où l’on est socialement. Alors que là, j’ai pu adapter en fonction de l’histoire. Il n’y a pas eu de fouilles au Québec. Quand nous avons fait les auditions, nous nous sommes promenés dans les communautés et nous avons rencontré plusieurs survivants. Une de ces survivantes, qui habite Kitigan Zibi mais qui vient de Barrier Lake, est allée au pensionnat de Saint-Marc. Elle m’a dit : « Le jour où ils vont me demander où sont enterrés les bébés, je vais être capable de pointer exactement où, parce que, moi, je sais où ils se trouvent. »
ES
L’écriture de Pour toi, Flora est donc clairement influencée par la force des témoignages, qui sont pour les peuples autochtones « une façon de parler d’événements ou d’une série d’événements extrêmement douloureux [ou] une forme à travers laquelle on accorde à la voix d’un ou d’une témoin un espace protégé[21] ». De cet aperçu du processus d’écriture de scénario tel que vécu par Sonia Bonspille-Boileau ressort l’importance de raconter des histoires du point de vue des siens, en écrivant des récits qui placent en leur centre des personnages, lieux, valeurs et équipes de tournage autochtones, et en impliquant dans ce processus les principaux intéressés, dans la mesure du possible. Sortis non pas seulement de l’imagination de la cinéaste, mais bien d’une volonté de colmater les brèches en ce qui concerne l’histoire – lointaine et plus récente – de son peuple, les personnages et récits s’inscrivent sans l’ombre d’un doute dans une démarche artistique, mais aussi militante, puisqu’elle contribue à la décolonisation de l’histoire et à la construction de ponts interculturels, un objectif avoué de la réalisatrice.
LA TRILOGIE D’ARNAIT : ÉCRIRE DE MANIÈRE COLLABORATIVE LE PASSAGE DU TEMPS
Durant la dernière décennie, nous avons vu apparaître au Québec davantage de collaborations entre des cinéastes québécois·es et des individus/artistes/communautés autochtones. À titre d’exemple, nommons Avant les rues (2016) de Chloé Leriche, aboutissement d’un travail d’équipe avec des participants atikamekw provenant des communautés de Manawan, Opitciwan et Wemotaci. La réalisatrice, qui a travaillé avec le Wapikoni mobile pendant plusieurs années avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, c’est-à-dire réaliser un film en entier dans une langue autochtone, entretenait depuis quelque temps déjà des relations avec ces communautés avant de commencer le tournage. Elle admet que son ignorance de la langue a obligé les comédiens atikamekw à traduire eux-mêmes leurs dialogues écrits en français dans le scénario, à prendre en charge le récit (du moins en partie) en transformant la signification de certains mots et expressions afin de les faire concorder avec l’émotion telle qu’exprimée dans leur langue maternelle[22]. La volonté de Leriche de réaliser un film entièrement en atikamekw a fait en sorte qu’elle était prête à plusieurs compromis, sur le plan de l’écriture scénaristique, afin de garantir au projet une certaine authenticité à travers l’appropriation du texte par les comédien·nes (EC). De manière analogue, Myriam Verreault, dans sa démarche de scénarisation de l’ouvrage Kuessipan (2011) – rédigé en français – de l’autrice innue Naomi Fontaine, développe une relation avec cette dernière, qu’elle recrute en tant que coscénariste, avec comme objectif d’écrire l’histoire contemporaine et « vraie » des gens vivant dans la communauté de Uashat[23]. Ce besoin de relationnalité, au sens où l’emploie l’auteur Opaskwayak cri Shawn Wilson, c’est-à-dire l’interconnexion qui est essentielle et inhérente entre toutes formes de vie, est palpable à travers les démarches relationnelles de ces réalisatrices, qui démontrent une volonté de créer une oeuvre où l’on entend, à travers les mots écrits et prononcés à voix haute, et où l’on sent, à travers ce qui est filmé et monté, la vérité de l’Autre, dans ce qu’elle a de beau et parfois de moins beau à communiquer. C’est précisément la beauté de cette relationnalité qui ressort des oeuvres écrites, remédiées et réalisées par l’équipe d’Arnait Video.
À l’instant où j’écris cet article, l’histoire du collectif formé de la cinéaste québécoise Marie-Hélène Cousineau et de femmes inuit vivant sur la petite île d’Igloolik, au Nunavut, tire à sa fin, alors que les aînées et productrices Madeline Ivalu et Susan Avingaq s’installent dans une retraite bien méritée. Né il y a exactement trente ans, en 1991, Arnait Video Productions a vu le jour à Igloolik, alors qu’Isuma Video Productions, initiative de Zacharias Kunuk et Norman Cohn, fournit l’inspiration au collectif de créer un espace où « les femmes aident les femmes » et où le contenu diffusé est presque exclusivement dédié aux défis, traditions, histoires – passée et présente – et aux combats des femmes inuit. Les projets du collectif sont largement diversifiés, et incluent des courts et moyens métrages documentaires, des entrevues avec des sages-femmes, des séries télé, un film pour enfants ainsi qu’un projet pilote impliquant des femmes du Nunavut. De même, trois longs métrages de fiction, que Cousineau nomme « la trilogie d’Arnait », font partie du répertoire du collectif, et racontent les différentes couleurs et époques du colonialisme, des conséquences attribuables aux premières rencontres (Before Tomorrow, 2009) jusqu’aux défis et aux conséquences de la technologie et des pensionnats (Uvanga, 2012), en passant par la période charnière de sédentarisation des Inuit dans la décennie 1940-1950 (Restless River, 2019). Le premier volet de la trilogie, Before Tomorrow (Le jour avant le lendemain), raconte l’histoire d’une grand-mère (Ninioq) et de son petit-fils (Maniq) qui, après la décimation de leur communauté par des aiguilles contaminées données par des Blancs, doivent apprendre à survivre seul·es dans le rude climat de l’Arctique. Ce récit est une adaptation d’un roman groenlandais écrit par Bjorn Riel, lu et aimé par Marie-Hélène Cousineau, qui décide alors d’en envoyer une copie à ses comparses d’Igloolik, Madeline Ivalu et Susan Avingaq, sans savoir ce qu’elles comprendront de la version groenlandaise (les aînées ne parlent que l’inuktitut)[24]. S’ensuivent de nombreuses rencontres où les trois femmes discutent du scénario et du récit qu’elles souhaitent mettre de l’avant, dans l’inuktitut d’Igloolik (qu’au passage Cousineau ne parle pas). La réalisatrice soutient par ailleurs que c’est la familiarité avec l’histoire racontée par Bjorn, et inspirée d’un fait vécu, qui encouragea les aînées dans leur choix de participer à ce projet :
C’était une histoire vécue par leurs ancêtres (leur grand-mère ou des gens qu’ils connaissaient). Pas exactement dans les mêmes termes que dans le livre, mais c’était quelque chose qu’elles connaissaient ; ce genre de drame, de tragédie, et même les virus, l’espèce de… Ça n’était pas une pandémie, mais elles connaissaient des gens qui étaient morts de virus amenés par les colonisateurs. Elles se souvenaient des premiers Blancs qu’elles avaient vus. Ça les touchait. Donc elles ont donné leur accord. J’ai fait un traitement, une première version traduite en anglais, et là, on a travaillé avec un interprète. Elles sont venues ici (à Montréal). Ça a été long, une année de rencontres. Nous sommes passées à travers toutes les scènes, on corrigeait des éléments précis qu’elles voulaient changer. Autrement dit, le scénario du film a été écrit vraiment en collaboration.
EMH
Comme ce fut le cas pour le film de Chloé Leriche, la question du scénario et de son écriture, de même que les étapes menant au tournage, sont largement dominées par des considérations linguistiques, ainsi que par le temps qu’il faut prendre pour rencontrer les aînées (organiser des rencontres à Montréal et à Igloolik, avec la présence d’une interprète) afin de discuter et de rediscuter du scénario, d’écrire des ébauches, de consulter, de traduire, et de garder les relations bien vivantes autour d’une tasse de thé ou d’un festin improvisé. Cette implication des aînées, et particulièrement celle de Madeline Ivalu, qui adaptait quelque peu ses dialogues de manière à les rendre plus naturels, s’étend au reste de la troupe de comédien·nes, lesquel·les possédaient une assez grande latitude pour improviser leur dialogue, tant qu’étaient conservés les principaux événements du récit, afin d’en assurer la cohérence.
Cousineau a également tenu à rencontrer l’auteur du roman, Bjorn Riel, pour discuter de l’adaptation scénaristique du livre et des modifications faites à l’histoire romanesque, par exemple l’ajout d’une scène qui adoucit la mort des protagonistes, en les situant dans un espace qui les réunit avec les leurs (EMH). Outre cette scène, la dernière du film, la géographie (donc le lieu où se passe le récit) devait être modifiée, ainsi que les éléments culturels présents dans le roman, afin d’éviter toute dissonance avec les légendes racontées oralement et les pratiques traditionnelles (par exemple, la chasse au requin au Groenland devient la chasse au phoque au Nunavut). L’écriture du scénario s’articule ainsi dans un premier temps autour de la parole de la grand-mère (jouée par Madeline Ivalu, qui est aussi coréalisatrice), laquelle, à travers la narration de récits de vie et de légendes traditionnelles, apprend à son petit-fils l’art de la survie, un art qui s’acquiert non seulement en développant des habiletés physiques, mais surtout en apprenant à nourrir le coeur et l’âme. Aussi, des leçons de vie présentes dans les contes de Ninioq (la grand-mère) ressort l’idée à la fois de la force et de la fragilité des liens qui unissent la communauté, chaque individu devenant responsable de l’autre s’il veut assurer sa propre survie. Dans un second temps, ce sont les comptes rendus de Maniq qui nous rappellent l’importance de nommer à voix haute, lorsque l’enfant raconte à sa grand-mère ses exploits quotidiens de chasse et de pêche, ainsi que les événements qui ont mené à leur isolement du reste de la communauté. C’est donc à la fois dans le contenu du récit et dans le processus d’écriture du scénario (incluant la traduction) que nous retrouvons une remédiation de la tradition orale, ainsi que cette relationnalité « où toute chose et toute personne est en relation avec les autres[25] » dont parle Wilson, comme nous le confirme Marie-Hélène Cousineau :
Quand on a fait Before Tomorrow, il y avait Susan, Madeline et Mary Qulitalik, qui jouait aussi dans le film, et les trois ont beaucoup parlé ensemble ; il y avait aussi Attuat Akkitirq, qui était là pour les costumes. Chaque matin, ou le soir avant, nous avions une réunion pour discuter de quelle scène nous allions faire, et elles repensaient et réécrivaient les dialogues. C’était vraiment important pour Madeline, le langage et la précision des mots, car après l’avoir écrit en français et en anglais, on l’a fait traduire en inuktitut de Puvirnituq (Nunavik), et personne ne comprenait, car les acteurs d’Igloolik parlent un autre dialecte et vice versa. Il y a donc eu des démêlés à ce sujet. Par exemple, l’acteur Tumasie Sivuarapik a un grand monologue et il n’avait pas bien compris la traduction en inuktitut d’Igloolik. Il y a donc eu deux traductions, une dans chaque dialecte. Et les acteurs devaient vérifier qu’ils disaient la bonne chose dans les dialectes. Je ne parle pas la langue, donc ce sont elles (Madeline et Susan) qui avaient le contrôle sur les dialogues.
EMH
C’est en suivant ce même sentier de la collaboration que le second volet de la trilogie d’Igloolik, Uvanga, voit le jour en 2012. Le scénario original écrit par Marie-Hélène Cousineau s’inspire, comme ce fut le cas de Sonia Bonspille-Boileau pour Le Dep, de situations et d’individus observés à Igloolik au fil des rencontres et tournages passés. Cependant, alors que les relations Inuit-Qalunaat (Blancs ou non inuit) sont absentes de Before Tomorrow – quoique suggérées à travers la contamination de la communauté par des aiguilles données par des colonisateurs –, Uvanga raconte la contemporanéité inuit, avec ce qu’elle contient de métissage et d’échanges interculturels : « J’avais envie de montrer des situations entre Blancs et Inuit […]. Il y a beaucoup d’Inuit métissés et c’est quelque chose dont on ne parle pas. Les gens se posent des questions d’identité. Ils se disent : Je suis qui ? D’où je viens ? J’appartiens à quelle culture[26] ? »
Les personnages principaux, Thomas (né d’une mère blanche et d’un père inuit) et sa mère Anna, tous deux Montréalais, voyagent jusqu’à la petite île d’Igloolik afin que Thomas puisse connaître sa famille paternelle. Ces deux protagonistes s’expriment uniquement en anglais, tandis que les autres personnages, tous Inuit, s’expriment tantôt en anglais, tantôt en inuktitut. L’écriture scénaristique, outre la traduction, est d’abord un travail élaboré de description de personnages, effectué par la réalisatrice, accompagnée de Madeline Ivalu, de Susan Avingaq et de Carole Kunuk (qui travaille également comme interprète). Celles-ci contribuent à l’élaboration de situations réalistes dans lesquelles elles imaginent ces personnages évoluer.
Hormis ces considérations, l’écriture du scénario évolue au gré du paysage. Le soleil de minuit et la beauté désertique du Grand Nord apportent leur propre signature scénaristique à ce long métrage fictionnel aux allures de documentaire. De même, l’étape du montage mène à une modification du scénario original, par l’insertion de scènes intermédiaires filmées sur la banquise. Celles-ci encadrent davantage le récit, en situant une présence (fantomatique) au coeur du territoire. Le paysage, avec sa luminosité particulière et ses reliefs parfois menaçants, est par ailleurs un personnage en soi dans la majorité des films inuit, car les liens traditionnels qui unissent ces peuples de l’Arctique à leur territoire sont profondément enracinés « dans leur tradition orale, dans leur conception de la personne humaine et du cosmos, comme aussi dans les expériences vécues, passées et présentes[27] ».
Parce qu’il illustre de manière réelle et symbolique les changements survenus chez les Inuit depuis leur première rencontre avec les Blancs, ainsi que le souligne Before Tomorrow, le territoire est aussi un personnage important, en tant qu’alter ego de la protagoniste principale, dans le troisième et dernier volet de la trilogie d’Arnait, La rivière sans repos (2019). Le scénario du film est adapté du roman de la célèbre autrice Gabrielle Roy, publié en 1970, et qui raconte l’histoire (basée sur des faits réels qu’a recueillis Roy lors d’un voyage au Nunavik) d’une jeune femme inuk, Elsa, qui devient mère à la suite d’une agression par un soldat américain habitant temporairement la base militaire américaine située à Kuujjuaq. D’un point de vue temporel, le film se situe à la jonction de Before Tomorrow, qui illustre les débuts du colonialisme et ses impacts (physiologiques) sur les Inuit, et d’Uvanga, où la modernité et la perte de repères culturels et identitaires ont à jamais altéré le mode de vie traditionnel des peuplades du Nord. Avec La rivière sans repos, dont l’action se déroule principalement dans les années 1950, nous sommes spectateur·trices d’une période charnière dans l’histoire de la colonisation, où les Inuit sont confrontés à la sédentarisation, à la scolarisation et aux déplacements forcés, à une forte hausse des cas de tuberculose, ainsi qu’à l’adoption d’une technologie qui facilite leur vie en même temps qu’elle l’empoisonne. C’est d’ailleurs ce conflit entre deux cultures s’affrontant, de manière inégale, qui est reflété dans le roman et dans le film, où la majestueuse rivière Koksoak se pose comme une frontière entre deux réalités, tout en miroitant les états d’âme et certains moments décisifs de la vie d’Elsa.
En ce qui concerne plus précisément l’écriture scénaristique, inspirée par la profondeur du roman, Cousineau entame des discussions, à Iqaluit, avec des gens qui connaissent le livre et qui sont en mesure de confirmer la véracité des faits tels qu’ils sont présentés par Gabrielle Roy. Pour le scénario, la réalisatrice décide de conserver la trame du récit, tout en faisant d’Elsa un personnage plus fort et plus autonome que la version littéraire, et ce, pour rendre justice à la beauté et à la ténacité des femmes inuit qu’elle a connues durant les trente ans de collaboration avec Arnait. Madeline Ivalu se joint bientôt à elle à Iqaluit, accompagnée de l’interprète Seporah Ungalaq, afin d’écrire les premières pages qui résument l’histoire :
On a travaillé sur l’intrigue, la narration, et on s’est mises d’accord. Nous avons discuté du personnage et de ses motifs, du réalisme de certaines actions et réactions des personnages, avant que je commence l’écriture en anglais. Je n’ai pas eu recours à un consultant à l’extérieur du groupe. Le film a été financé très rapidement, et on a traduit le scénario en inuktitut. On travaillait davantage à Kuujjuaq, alors on l’a fait traduire dans le dialecte de Kuujjuaq, qui n’est pas le dialecte d’Igloolik ou de Puvurnituq. Ce qui a été traduit, ce n’est pas nécessairement les descriptions (ça coûte cher !), mais plus l’action des personnages et les dialogues.
EMH
Il y a donc encore une fois un travail de collaboration étroit avec les acteur·rices qui se poursuit tout au long du processus, qui influence à sa manière l’écriture du récit et qui recentre la question du respect au sein du processus de création. Tout comme Chloé Leriche (Avant les rues) et Myriam Verreault (Kuessipan), Cousineau cherche à faire entendre, par cette écriture à plusieurs voix, des récits qui plongent leurs racines dans des zones de vécu spécifiquement autochtones. De plus, dans un mouvement de réciprocité où l’écriture imprégnée par l’oralité redonne vie aux corps et aux paysages de l’Arctique, ce sont ces regroupements de « femmes qui aident d’autres femmes » qui assurent la survivance de témoignages passés et présents, d’ici et d’ailleurs, mais qui seront tous autochtonisés de manière à exprimer le « point de vue inuk » si cher à Zacharias Kunuk et à ses contemporain·es.
CONCLUSION : DONNER VOIX AUX FEMMES AUTOCHTONES À TRAVERS L’ÉCRITURE MISE EN SONS ET EN IMAGES
Il y a ce désir, présent dans tous les scénarios de films d’Arnait, mais aussi dans ceux de Sonia Bonspille-Boileau, d’écrire avec et pour ces femmes autochtones qui occupent une place prépondérante au sein d’histoires reflétant leur force de caractère et le rôle important qu’elles continuent de jouer dans leurs communautés, à titre de mères, de filles, de pédagogues, de cheffes de bande, d’artistes ou de guérisseuses. Que ce soit à travers l’entêtement d’Elsa à se plier ou non (au gré du temps et de ses humeurs) aux caprices de la modernité dans La rivière sans repos, ou la sagesse et la douceur des aînées Ninioq et Kuutujuk (Before Tomorrow) qui discutent tantôt avec humour de la sexualité, tantôt avec mélancolie de leur vie passée, les héroïnes de la trilogie d’Arnait incarnent la centralité d’une longue et fructueuse présence dans de multiples sphères de la vie quotidienne, où « leurs préoccupations étaient centrées autour de la famille et de la vie communautaire [et basées sur] leur compréhension des valeurs et connaissances héritées de leurs grand-mères[28] ». De même, la ténacité et la détermination du duo Susan-Ivy, à la recherche de leur soeur/fille disparue dans Rustic Oracle, comme le courage et le sang-froid de Lydia prise en otage dans Le Dep, démontrent comment cette nouvelle génération de femmes autochtones « affirment leur pouvoir individuel et collectif » en s’occupant de « déconstruire le trauma historique et contemporain[29] » par ces histoires écrites par et pour elles et qui résonnent haut et fort, bien au-delà des frontières culturelles et linguistiques. En outre, ces récits montrent comment la mise en récit et l’écriture de scénarios par des cinéastes (et femmes) autochtones racontant leurs histoires depuis leur point de vue constituent des exemples de résurgence et de souveraineté narrative. Cela permet aux peuples autochtones de reprendre en charge leur image aussi bien que leurs histoires, pendant longtemps racontées selon le point de vue de médiateur·trices externes, et de célébrer la survivance et le dynamisme des individus et des communautés qui, au-delà de la résistance, continuent de faire rayonner leurs cultures « de manière fluide, critique et générative[30] ».
Parties annexes
Note biographique
KARINE BERTRAND est professeure agrégée au Department of Film and Media de la Queen’s University et codirectrice du groupe de recherche interuniversitaire EPIC (Esthétique et politique de l’image cinématographique). Ses recherches portent sur le cinéma québécois, sur les cinémas autochtones et inuit, sur les pratiques orales cinématographiques ainsi que sur le road movie. Elle est actuellement chercheuse principale pour le volet Arnait Video Productions (un collectif de femmes inuit) du projet Archive-Counter-Archive, financé par le CRSH. Ses plus récentes publications portent sur le groupe musical U2 (Mackenzie et Iversen, 2021), la représentation des territoires autochtones dans le cinéma d’auteur (Cahill et Caminati, 2020), le rôle du témoignage dans le cinéma des femmes autochtones (Revue canadienne d’études cinématographiques, 2020), l’américanité dans le cinéma québécois (American Review of Canadian Studies, 2019), et le cinéma autochtone canadien et québécois (Oxford Handbook to Canadian Cinema, 2019).
Notes
-
[1]
Esther Pelletier, « Processus d’écriture et niveaux d’organisation du scénario et du film », Cinémas, vol. II, no 1, automne 1991, p. 46.
-
[2]
Aman Sium et Eric Ritskes, « Speaking Truth to Power: Indigenous Storytelling as an Act of Living Resistance », Decolonization. Indigeneity, Education and Society, 2013, vol. II, no 1, p. V ; toutes les traductions sont les nôtres.
-
[3]
Leanne Betasamosake Simpson, Dancing on Our Turtle’s Back. Stories of Nishnaabeg Re-Creation, Resurgence, and a New Emergence, Winnipeg, ARP Books, 2015, p. 41.
-
[4]
Gerald Vizenor, Survivance: Narratives of Native Presence, Lincoln, University of Nebraska Press, 2008, p. 39.
-
[5]
Ossie Michelin, « Why It’s Important for Indigenous People to Tell Our Own Stories », CBC News, 3 juin 2021, en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/first-person-indigenous-history-stories-narrative- sovereignty-1.6050453.
-
[6]
Kate Taylor, « Jesse Wente on Indigenous Stories Through a Different Lens », The Globe and Mail, 4 novembre 2018, en ligne : https://www.theglobeandmail.com/arts/film/article-jesse-wente-on-indigenous-stories- through-a-different-lens/ (page consultée le 26 août 2022).
-
[7]
Jay D. Bolter et Richard A. Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MIT Press, 1999, p. 45.
-
[8]
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York/Scarborough, Mentor, 1964, p. 85.
-
[9]
Kristen Knopf, Decolonizing the Lens of Power. Indigenous Film in North America, Amsterdam/New York, Rodopi B.V., 2008, p. 108-114.
-
[10]
Bernard Saladin d’Anglure, Au pays des Inuit. Un film, un peuple, une légende, Montpellier, Indigène, 2002, p. 12.
-
[11]
Rémi Savard, « La transcription des contes oraux », Études françaises, vol. XII, nos 1-2, avril 1976, p. 57-59.
-
[12]
Sarah Henzi, « Stratégies de réappropriation dans les littératures des Premières Nations », Études en littérature canadienne, vol. XXXV, no 2, 2010, p. 79.
-
[13]
Entrevue avec Sonia Bonspille-Boileau, Gatineau, décembre 2021. Désormais, les références à cette entrevue seront indiquées par le sigle ES, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[14]
Native Women’s Association of Canada, « NWAC Action Plan. Our Calls, Our Actions », 2021, p. 5, en ligne : https://www.nwac.ca.
-
[15]
Michelle H. Raheja, Reservation Reelism: Redfacing, Visual Sovereignty, and Representations of Native Americans in Film, Lincoln, University of Nebraska Press, 2010, p. 194.
-
[16]
Paul Zumthor, « Oralité », Intermédialités, no 12, automne 2008, p. 171-172.
-
[17]
Linda Tuhiwai-Smith, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples, Dunedin, University of Otago Press, 1999, p. 144.
-
[18]
Marika Bellavance, « Dans les coulisses du tournage de la série Pour toi, Flora », Ici Radio-Canada, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840259/pour-toi-flora-coulisses-tournage-serie-sonia-bonspille-boileau-andre-robitaille-pensionnats-autochtones (page consultée le 26 août 2022).
-
[19]
Sarah Henzi, « “La grande blessure” : legs du système des pensionnats dans l’écriture et le film autochtones au Québec », Recherches amérindiennes au Québec, vol. XLVI, nos 2-3, 2016, p. 179.
-
[20]
Leanne Betasamosake Simpson, Dancing on Our Turtle’s Back, p. 17.
-
[21]
Linda Tuhiwai-Smith, Decolonizing Methodologies, p. 144.
-
[22]
Karina Chagnon, « Entrevue avec Chloé Leriche, réalisatrice du film Avant les rues », Trahir, 4 avril 2016, en ligne : https://trahir.wordpress.com/2016/04/12/chagnon-leriche/ (page consultée le 26 août 2022). Désormais, les références à cette entrevue seront indiquées par le sigle EC et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[23]
Orla Smith, « TIFF Interview : Kuessipan Filmmakers on Their Innu Coming-of-Age Story », Seventh Row, 17 septembre 2019, en ligne : https://seventh-row.com/2019/09/17/kuessipan-interview/ (page consultée le 26 août 2022).
-
[24]
Entrevue avec Marie-Hélène Cousineau, décembre 2021. Désormais, les références à cette entrevue seront indiquées par le sigle EMH et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[25]
Shawn Wilson, Research Is Ceremony. Indigenous Research Methods, Halifax/Winnipeg, Fernwood Publishing, 2008, p. 58. Désormais, les références à ce texte seront indiquées par le sigle RC, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[26]
André Duchesne, « Uvanga : une histoire familiale sous le soleil de minuit », La Presse, 27 avril 2014, en ligne : https://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/entrevues/201404/26/01-4761171-uvanga-une-histoire- familiale-sous-le-soleil-de-minuit.php (page consultée le 26 août 2022).
-
[27]
Bernard Saladin d’Anglure, « La toponymie religieuse et l’appropriation symbolique du territoire par les Inuit du Nunavik et du Nunavut », Études Inuit, vol. XXVIII, no 2, 2004, p. 14.
-
[28]
Marlene Brant Castellano, « Heart of the Nations: Women’s Contribution to Community Healing », Madeleine Dion-Stout, Eric Guimond et Gail Guthrie Valaskakis (dir.), Restoring the Balance. First Nations Women, Community and Culture, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2009, p. 203.
-
[29]
Cynthia Wesley-Esquimaux, « Trauma to Resilience. Notes on Decolonization », Madeleine Dion-Stout, Eric Guimond et Gail Guthrie Valaskakis (dir.), Restoring the Balance. First Nations Women, Community and Culture, p. 28.
-
[30]
Sans auteur, « Survivance », The Decolonial Dictionary, en ligne : https://decolonialdictionary.wordpress.com/2021/04/15/survivance/ (page consultée le 20 juillet 2022).