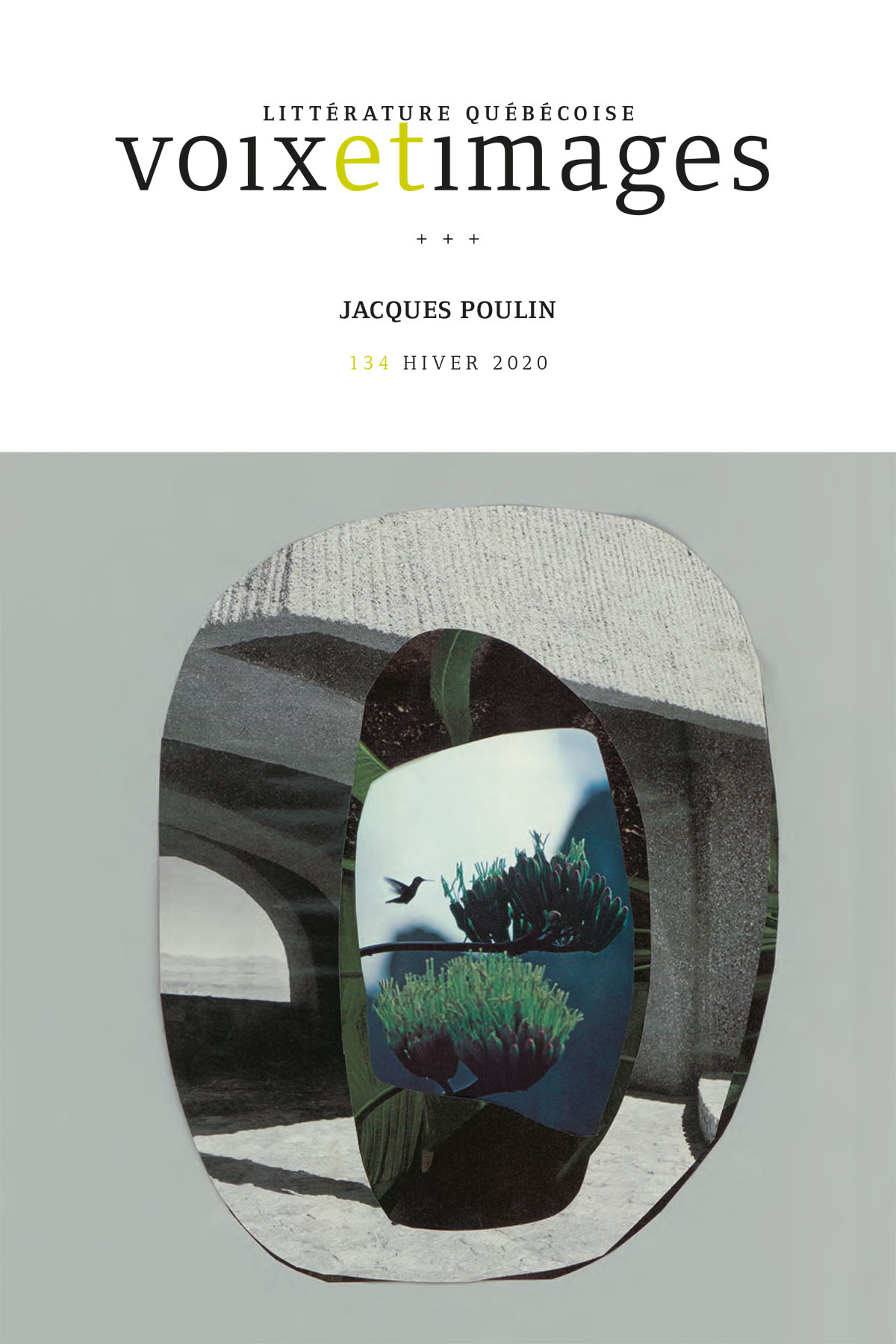Corps de l’article
Comment habiter notre monde autrement ? Il s’agit sans doute de l’une des questions les plus importantes, les plus urgentes auxquelles nous faisons face actuellement. La planète se transforme indéniablement, les sols s’en trouvent modifiés, l’air et l’eau sont de plus en plus pollués… Le réchauffement climatique et les déplacements de populations qu’il entraîne invitent à repenser l’idée d’appartenance au sol, à réfléchir à ce que cela veut dire d’être chez soi, sur sa parcelle de terre. Dans un ouvrage paru en 2017, l’anthropologue et philosophe Bruno Latour affirme en ce sens que « [l]a nouvelle universalité, c’est de sentir que le sol est en train de céder[1] ». Les publications sur la question de l’appartenance abondent et témoignent unanimement de l’urgence de changer notre rapport au territoire, aux animaux et aux plantes. Il y a trente ans, Pierre Morency nous invitait déjà à explorer l’univers du lièvre, du grillon et de l’épinette (L’oeil américain, 1989). En France, plus récemment, Jean Birnbaum demandait Qui sont les animaux ? (2010), Jean-Christophe Bailly faisait paraître Le parti pris des animaux (2013) et Emanuele Coccia, La vie des plantes (2016). Les Éditions Dehors publient en traduction des textes de grands environnementalistes américains tels que Holmes Rolston III et William Cronon, de même que le travail de Brian Massumi[2]. Tous dressent le même constat : il faut vivre différemment, penser une philosophie du vivre, comme le fait François Jullien (2011), voire revivre ainsi que le suggère Frédéric Worms (2012).
La question du territoire, de la vie sur terre et de l’appartenance est également au coeur d’ouvrages parus récemment au Québec. Si nous interrogeons presque tous — avec plus ou moins de temps ou d’application — nos actions, notre rôle, notre responsabilité, notre place dans le monde, pour certains, ce questionnement, voire cette longue introspection, oriente une « conduite de la vie[3] », comme l’écrit Jean-Pierre Issenhuth dans Le jardin parle. Dans La pomme et l’étoile[4], c’est une réflexion sur Ozias Leduc et Paul-Émile Borduas qui permet à Étienne Beaulieu de remettre en question son propre rapport au monde. Se penchant sur la vie et l’oeuvre des deux peintres, sur leur relation, ainsi que sur la place qu’ils occupent dans l’imaginaire québécois, Beaulieu cherche à « comprendre l’esprit du temps en se sondant soi-même » (7). C’est aussi, bien que d’une tout autre manière, un « imaginaire de l’appartenance[5] », c’est-à-dire un « espace que l’art contribue à forger et qui donne ancrage à la conscience de soi » (22), qu’Emmanuelle Tremblay étudie dans son ouvrage critique intitulé L’invention de l’appartenance. La littérature québécoise en mal d’autochtonie. Romancière et professeure à l’Université de Moncton, Emmanuelle Tremblay propose des analyses croisées d’oeuvres très différentes, parmi lesquelles on retrouve celles de Réjean Ducharme, de Monique Proulx, de Victor-Lévy Beaulieu, de Mona Latif-Ghattas, d’Herménégilde Chiasson et de Patrick Chamoiseau. Dès le titre, une question se fait jour : dans ce contexte, qu’est-ce que l’auteure entend par « autochtonie » ? Quelle définition retient-elle de ce terme employé dans divers champs du savoir ? Ainsi, Emmanuelle Tremblay rappelle-t-elle au lecteur différentes acceptions du mot. Dans une perspective écologiste et universelle, « [n]ous serions tous des autochtones dont le lien avec la Nature est à reconstruire pour assurer notre survie » (9). Du point de vue de l’historiographie, « l’autochtonie des premiers peuples est d’abord “une identité politique historiquement construite” (Gohier 2014 : 41) » (9), une « volonté d’ancrage dans le monde contemporain » (10) élaborée autour d’une même « résistance à la domination des pouvoirs économiques en place [et qui] correspond à une façon de faire valoir des droits sur un système d’exclusion » (10). Dans son livre, Tremblay se propose d’explorer le « fantasme de l’autochtonie » (8) qu’elle repère en littérature. Selon l’auteure, en effet, l’autochtonie revêt, outre le sens de présence originaire, celui d’une appartenance qui serait à faire ; elle « est à la fois le manque au fondement de la littérature québécoise et une production symbolique » (12). Aussi s’agira-t-il pour Tremblay d’explorer le « transnationalisme des cultures minoritaires » (20) et des « territoires symboliques [sur lesquels] la littérature réinvente […] l’appartenance » (24). Or, cette réinvention ne serait possible que dans le rapprochement avec l’Autre. Emmanuelle Tremblay soutient ainsi que, dans le recueil de poèmes Climats d’Herménégilde Chiasson, la blancheur de la page renvoie au manque, au vide, à la froideur et à l’hiver acadien, mais aussi à la potentialité de l’écriture, à ce qui est à venir. Selon elle, « la blancheur appelle le geste créateur qui en rompt la surface indifférenciée par l’inscription du sujet ; par là même, celui-ci fait son apparition au sein du monde, pour enfin acquérir une existence » (97). L’exploration de cinq territoires symboliques (celui de l’« indianité », de l’« art », de la « diversité », de la « diaspora » et de la « résistance ») permet à l’auteure de rassembler des écrivains issus de la francophonie des Amériques afin de « penser une cohésion de l’identité collective qui rende possible la revendication d’un héritage sans fabriquer de l’exclusion » (7). Dans une perspective transnationale et empruntant au care, Tremblay repère et fait s’entrelacer un réseau de « proximités » (8) chez des « êtres désancrés du monde » (123), des auteurs mus par un désir d’appartenance. Le livre se conclut sur la difficulté d’allier la « double contrainte d’intégration à un horizon culturel élargi — voire mondialisé — et de préservation d’un capital symbolique dans un contexte minoritaire » (175), mais rappelle aussi à quel point « l’imaginaire de l’appartenance est, en soi, pluriel » (222). Selon Tremblay, l’autochtonie devrait être considérée comme un devenir, « visant à se faire un territoire » (222). Cet objectif n’est pas sans rappeler le livre Nos cabanes de Marielle Macé[6], dans lequel la philosophe en appelle à « une repolitisation du lien (du lien) au sol. Décidément, une philia[7] » qui ne viserait pas à s’isoler, à se replier sur soi, à se barricader avant la tempête, « mais [à] élargir les formes de vie à considérer, [et à] retenter avec elles des liens, des côtoiements, des médiations, des nouages. Faire des cabanes pour relancer l’imagination[8] ».
Il est aussi question d’abris, de refuges dans l’essai d’Étienne Beaulieu. Celui d’Ozias Leduc qui lui servait d’atelier, mais aussi celui de l’auteur lui-même. Des lieux où réinventer l’appartenance, « imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Trouver où atterrir, sur quel sol rééprouvé, sur quelle terre repensée, prise en pitié et en piété[9] ». Correlieu, l’atelier d’Ozias Leduc, est un espace de création situé à deux pas de sa maison. C’est là qu’il « a donné au territoire un sens nouveau et presque magique » (25), où le mont Saint-Hilaire a atteint, grâce à sa peinture, une dimension spirituelle. Paul-Émile Borduas est quant à lui présenté comme un peintre ayant fait l’expérience d’un « mélange de déterritorialisation et d’enracinement » (188), d’un « enracinement dans le mouvement » (190). Condamné à quitter le Québec après la parution de Refus global, il « passe sa vie à tenter de trouver un équilibre entre deux choses, à l’image de son exact contemporain Hector de Saint-Denys Garneau, sans y parvenir réellement lui non plus » (23). Beaulieu raconte l’histoire de Leduc et de Borduas, qu’il présente comme étant à la fois proches et lointains, tout en revenant sur son propre parcours (sa jeunesse, son travail, ses amours). Se sentant égaré comme Borduas, il cherche un Correlieu comme Leduc. Beaulieu trouve ce point d’ancrage à la fois dans l’écriture et dans sa maison. Il installe, sur les murs intérieurs de celle-ci, du « bois de grange décoratif » grâce auquel il se sent plus proche « de ceux qui ont trimé dur derrière ces morceaux de bois mal équarris et qui vivaient les deux pieds dans le paysage toute leur journée de travail » (171). L’auteur multiplie les allers-retours entre sa propre vie et celles de Leduc et de Borduas, établissant au passage plusieurs liens entre leurs destinées et celle du Québec. Il décrit ainsi son projet :
[Prendre] deux peintres comme modèles pour réfléchir à mes tendances intérieures et contraires, qui ne sont pas seulement les miennes, mais celles de toute une nation balancée entre les tentations de l’ouverture et du repli, du sommeil inconfortable et du réveil brutal. Disons-le tout de suite : ce sont leurs légendes qui m’intéressent […].
7-8
Beaulieu est en quête de récits fondateurs — d’une certaine « autochtonie » au sens développé par Emmanuelle Tremblay —, tant pour le Québec, que pour lui-même : « [N]ous avons besoin de mythes et de légendes pour vivre et donner sens à notre présence sur un territoire, au sein d’une nation, dans notre vie quotidienne. » (22) C’est ainsi qu’il met en parallèle son existence, les épisodes décisifs qui l’ont composée, avec celles de Borduas et de Leduc (le lecteur peut d’ailleurs parfois s’étonner de certains des rapprochements effectués). L’ouvrage constitue une méditation « faite de digressions, de souvenirs, de divagations et de tentatives d’interpréter des faits collectifs et intimes très têtus » (6). Les pages du livre sont traversées par deux types ou registres d’écriture. L’une, plus personnelle, à laquelle l’auteur — dont le livre se termine avec l’affirmation d’une renaissance par l’écriture — confie aspirer ; l’autre, faite d’analyses et de lectures à caractère plus universitaire de la biographie et de l’oeuvre des peintres (où l’auteur fait usage de la citation et de références à la critique : Jean-Éthier Blais, Sophie Dubois, François-Marc Gagnon, Jean-Philippe Warren). Les commentaires des oeuvres nous plongent dans « le calme ontologique » (89) de Leduc, dans la « langue venue de nulle part » (90) de Borduas, et ces pages sont souvent très belles, voire plus convaincantes ou saisissantes que les autres. Beaulieu, qui enseigna à l’université avant de se tourner vers le cégep — transition dont il fait le récit dans l’ouvrage —, a des mots durs envers le milieu « feutré des colloques et des formules de politesse » (153), « cet espace protégé de la vie » (153) qu’il a choisi de quitter. Il dénonce également vigoureusement la prétendue « neutralité universitaire » (21). D’aucuns pourraient toutefois soulever qu’il s’agit parfois moins de tendre vers l’objectivité que de faire preuve d’une certaine réserve (par discrétion, prudence ou modestie), de souhaiter rester en retrait pour faire entendre d’autres voix que celles d’un « je » néanmoins bien présent.
Avec ce livre, Beaulieu cherche à trouver la paix et son propre Correlieu en effectuant un « retour au territoire » (123). Cela n’est pas sans rappeler « l’idéal d’authenticité » (25) qui constitue l’une des caractéristiques du « fantasme d’autochtonie » selon Emmanuelle Tremblay. Toutefois, pour Beaulieu, qui se décrit comme étant un « urbain déchu » (123), cet itinéraire « ne se fait aucunement sur le mode de l’enracinement qui était celui de Leduc […], mais en pensant à [l]a préservation [du territoire], et à la sienne » (123).
Il y a peut-être aussi de cela chez Jean-Pierre Issenhuth, qui mentionne avoir entrepris, plusieurs années avant sa disparition, de faire « un ménage réel » (248) dans sa vie. Cela consistait d’abord à bâtir une cabane, à se porter « sur le terrain des conditions de vie » où il pourrait « se tenir à distance, dans la mesure du possible, [de] la religion du confort, [du] culte des aises et de l’apparence, choses qui, dans l’époque, [lui] déplaisaient le plus » (248). Or, la cabane en question n’est pas seulement métaphorique. Elle se trouve là, au fond d’un petit bois, faite de « matériaux ramassés au bord d’une rivière. Vieux madriers, vieilles planches, vieux clous, vieilles fenêtres de bois condamnés à pourrir, tout ce qu’on jette, tout ce qu’on refuse, tout ce à quoi on n’attache aucune valeur [et qui l]’a toujours intéressé » (97). Issenhuth n’est pas habité du désir de se transformer en ermite, mais de celui d’interroger « sa présence au monde » (8), comme le souligne François Hébert dans sa préface. Si Étienne Beaulieu se posait la question du pourquoi (« Mais que faisons-nous ici, dans ce royaume de matière, pommes tombées d’un arbre inconnu, seuls parmi les étoiles et les vents d’ailleurs ? » [124]), Issenhuth réfléchit à celle du comment : il s’agit de « savoir habiter le monde », pour reprendre l’expression de Thomas Mainguy en quatrième de couverture. L’essayiste cherche à atteindre un « idéal d’équilibre » (210) et d’harmonie, à préserver une forme d’écologie — du grec oikos, « maison » (mot créé « par le biologiste allemand Ernst Haeckel pour désigner “la science de l’économie, des habitudes, du mode de vie, des rapports vitaux externes des organismes”[10] »). Issenhuth dévoile une « conduite », une façon d’agir, un « art de vivre » (109), entre autres, lorsqu’il commente les livres qui le passionnent. Il ne s’interdit aucun plaisir et aborde avec une même curiosité des oeuvres de genres variés (parmi lesquels on retrouve notamment des romans, de la poésie, des biographies et des livres scientifiques). En parcourant ce livre composé d’essais, de quelques poèmes, de brèves nouvelles et de six lettres échangées avec Pierre Vadeboncoeur, le lecteur a l’impression de se trouver au coeur du jardin de l’auteur, d’accéder aux « pensées de son esprit et [aux] émotions de son âme » (14). Ces textes sont plus courts, peut-être moins achevés, que les essais de Rêveries (2001), et se situent dans le prolongement de ceux publiés sous le titre Le petit banc de bois (2014). On y retrouve néanmoins l’écriture caractéristique de l’auteur, dans laquelle tous les signes du réel peuvent être transformés en littérature :
Un tournesol semé par un geai s’élève, seul, au milieu du jardin. Il est, avec le dahlia, par sa grandeur et dans la chaleur accablante, le rédempteur de la torpeur de tout. Telle est la vie merveilleuse, la vie qui fuse, établie ici à demeure. Occasionnellement, l’homme passe dans cette vie. Plus occasionnellement encore, la poésie passe dans l’homme. Sa parole — non son écriture — résonne alors à l’unisson du monde, à son coeur même et selon ses rythmes immuables.
15
Dans cet effort pour « apprendre à habiter la terre intelligemment » (38), l’écriture et la lecture permettent de tracer un sentier, de frayer un « chemin d’accès à l’expérience vécue » (35). Cette question de la lucidité[11], de la clairvoyance, revient d’ailleurs sans cesse dans les miniatures qu’Issenhuth offre au lecteur. En effet, l’auteur privilégie l’intelligibilité, en faisant à plusieurs reprises l’éloge de la « clarté » (166) d’un roman, par exemple, en mentionnant qu’un auteur « s’exprime avec précision » (20) ou que les études sur la poésie d’Hopkins qu’il vient de parcourir sont « faciles à lire » (18). Cette recherche de limpidité témoigne d’un désir « d’abolir la distance » (155), d’attribuer au langage une part de vérité, d’« authenticité » (laquelle est, selon Emmanuelle Tremblay, « un instrument d’affirmation d’une expérience du monde propre que des logiques externes tendent à oblitérer » [25]). Selon Issenhuth, cette « clarté » inonde l’oeuvre de différents auteurs : la poésie de Seamus Heaney ; le Jean Rivard d’Antoine Gérin-Lajoie ; « quatre belles pages » (136) de Philippe Sollers à propos de l’île de Ré ; les dialogues de Proust (même si, lorsque ce dernier tente d’« encadre[r] la recherche du vrai d’un lourd système de réflexions censées justifier son entreprise, la lumière baisse » [166]). À l’opposé de ces oeuvres, l’auteur critique vertement le « nouveau cours optionnel de français, intitulé Les projets de communication », condamne le jargon pédagogique — de la « bouillie pour les chats » (89) — d’un programme dont l’objectif consiste à « faire des communications réussies » (84 ; l’auteur souligne) et où la langue est réduite à un « produit » (85). Il va sans dire que la prose de l’essayiste est elle-même d’une lisibilité lumineuse.
Dans ces pages, le lecteur n’a accès qu’à des parcelles de la vie de l’auteur. On le retrouve ainsi, tôt le matin, écrivant au « Dunkin » longtemps après avoir posé ses pénates au « Bélair, un palace[12] », ou alors longeant les rues, « la veille du ramassage, des tas de rognures de gazon aux abords des maisons, sous [son] regard inquiet, et en automne, des sacs de feuilles mortes par centaines. Toutes ces matières devaient contribuer à produire l’humus, qui fut produit en effet, et qui continue de produire » (76). Et cette dernière phrase — décrivant la décomposition des végétaux, l’émergence d’un nouveau matériau — métaphorise magnifiquement le travail d’écriture d’Issenhuth, ce jardin qui fleurit et nous parle.
Ces trois ouvrages, bien que fort différents, nous invitent à repenser ce que le philosophe Holmes Rolston III écrivait dès les années 1980, à savoir que « [l]es humains ne sont pas véritablement limités par leur peau : la vie s’inscrit dans une dialectique environnementale. […] La culture ne s’édifie pas seulement contre la nature, mais également à partir de la nature[13] ». Car Emmanuelle Tremblay, Étienne Beaulieu et Jean-Pierre Issenhuth réfléchissent, chacun à leur manière, à leur appartenance au territoire, à leur inscription dans le monde, à leur attachement au sol sur lequel s’élèvent leur cabane et les nôtres.
Parties annexes
Note biographique
FRÉDÉRIC RONDEAU est professeur au Département de Modern Languages and Classics de l’Université du Maine à Orono (États-Unis). Ses recherches portent sur la poésie et l’essai, les revues littéraires et la contre-culture au Québec. Il s’intéresse plus particulièrement aux rapports qu’entretiennent la littérature et le politique, ainsi qu’aux phénomènes de marges. Il a publié Le manque en partage. La poésie de Michel Beaulieu et Gilbert Langevin (Presses de l’Université de Montréal, 2016) et a codirigé, avec Karim Larose, un ouvrage collectif intitulé La contre-culture au Québec (Presses de l’Université de Montréal, 2016). En 2018, il a fait paraître, avec Gilles Dupuis, Karim Larose et Robert Schwartzwald, Avec ou sans Parti pris. Le legs d’une revue (Nota bene).
Notes
-
[1]
Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, p. 19.
-
[2]
Holmes Rolston III, Terre objective. Essais d’éthique environnementale, traduit de l’anglais par Pierre Madelin, préface de Hicham-Stéphane Afeissa, Bellevaux, Éditions Dehors, 2017, 397 p. ; William Cronon, Nature et récits. Essais d’histoire environnementale, traduit de l’anglais (États-Unis) par Mathias Lefèvre, Bellevaux, Éditions Dehors, 2016, 285 p. ; Brian Massumi, Ce que les bêtes nous apprennent de la politique, traduit de l’anglais (Canada) par Erik Bordeleau, Bellevaux, Éditions Dehors, 2019, 176 p.
-
[3]
Jean-Pierre Issenhuth, Le jardin parle, Montréal, Nota bene, coll. « La ligne du risque », 2019, p. 17 et p. 36.
-
[4]
Étienne Beaulieu, La pomme et l’étoile, Montréal, Varia, coll. « Art », 2019, 201 p.
-
[5]
Emmanuelle Tremblay, L’invention de l’appartenance. La littérature québécoise en mal d’autochtonie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2018, p. 22.
-
[6]
Marielle Macé, Nos cabanes, Lagrasse, Verdier, 2019, 128 p.
-
[7]
Ibid., p. 62.
-
[8]
Ibid., p. 20.
-
[9]
Ibid., p. 18.
-
[10]
Jean-Marc Drouin, L’écologie et son histoire. Réinventer la nature, préface de Michel Serres, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1993, p. 20.
-
[11]
« Quoi qu’il en soit, cet exercice de lucidité, cette absence totale de complaisance envers soi-même me donnent à penser pour longtemps. » (36)
-
[12]
Jean-Pierre Issenhuth, Rêveries, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2001, p. 79.
-
[13]
Holmes Rolston III, « Valeurs humaines et systèmes naturels », Terre objective. Essais d’éthique environnementale, p. 162. L’auteur souligne.