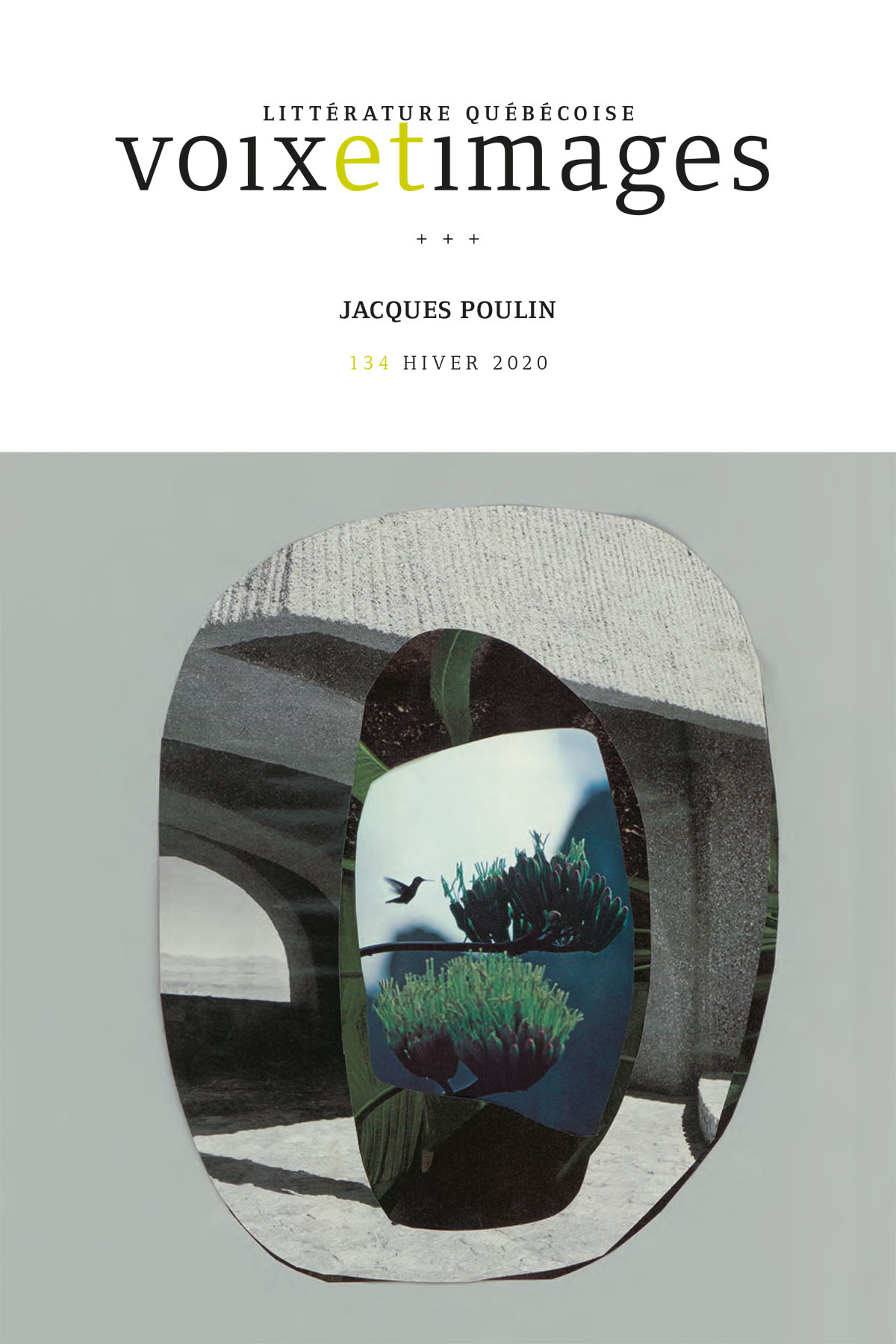Résumés
Résumé
« Connaissez-vous cet homme ? » demande Jack Waterman, une photo à la main, à Ferlinghetti dans Volkswagen Blues (1984). Bien que les romans de Jacques Poulin ne puissent à proprement parler être considérés comme des romans policiers, ils ne cessent de flirter avec le genre. Les enquêtes, les poursuites, les personnages-détectives, les dialogues évoquant les classiques de la littérature autant que du cinéma noir abondent dans son oeuvre. Cette relation se renforce d’ailleurs si l’on considère la démarche ludique que cette oeuvre sollicite sans cesse et qui pousse son lecteur à jouer avec elle. La poétique de l’entre-deux est lisible alors dans l’ambiance particulière qui baigne cette écriture, entourée de flou, comme d’une sorte de brouillard qui rappelle celui qui enveloppe tant de scènes au cinéma comme dans l’oeuvre de Poulin. Dans cette démarche, la ville, cadre récurrent du genre, s’impose avec le jeu des objets et des situations qu’elle offre à l’écriture. Cette ville est bien évidement la ville de Québec, si essentielle à l’oeuvre, où elle est plus qu’un simple décor, le pôle d’attraction de l’action, du mouvement des personnages. À travers cette étude, menant l’enquête à son tour, l’auteure se propose d’interroger la présence du registre policier dans cette oeuvre, afin de dévoiler — ou peut-être pour mettre à mal — l’énigme policière poulinienne.
Abstract
“Connaissez-vous cet homme?” is the question Jack Waterman asks Ferlinghetti, photo in hand, in Volkswagen Blues (1984). Although Poulin’s novels cannot properly be described as crime novels, they are always playing with this genre. Investigations, chases, detectives, and dialogues referring to noir literary and film classics are frequent. The relationship is even stronger if we consider the playfulness that Poulin’s work constantly solicits, drawing the reader into the game. A poetics of the in-between characterizes the special atmosphere that surrounds the writing: a blurred, fog-like quality shared by countless movies as well as scenes in Poulin’s work. The urban setting that is a recurring feature of the crime genre is a necessary feature, providing the writing with a shifting set of objects and situations. The city, of course, is Québec, a key element of the work: more than a mere backdrop, it is a powerful force affecting the novel’s action and its characters’ movement. In this article, the author herself becomes an investigator, questioning the presence of the crime novel register in Volkswagen Blues and seeking to elucidate—or perhaps roughly interrogate—the enigma of Poulin as a crime novelist.
Resumen
«¿Conocen ustedes a este hombre?», pregunta Jack Waterman, con una foto en la mano, a Ferlinghetti en Volkswagen Blues (1984). Aunque las novelas de Jacques Poulin no pueden, hablando con propiedad, considerarse como novelas policíacas, no dejan de coquetear con este género. Abundan en su obra las encuestas, las persecuciones, los personajes-detectives, los diálogos que evocan tanto los clásicos de la literatura como el cine negro. Por cierto, esta relación se refuerza si se considera el enfoque lúdico que dicha obra solicita constantemente y lleva a su lector a jugar con la misma. La poética del intervalo es entonces legible en el ambiente particular en el cual esta escritura está inmersa, rodeada de imprecisión, como una especie de niebla que recuerda aquella que rodea tantas escenas en el cine y en la obra de Poulin. En este enfoque, la ciudad, marco recurrente del género, se impone con el juego de los objetos y las situaciones que ofrece a la escritura. Dicha ciudad es evidentemente Quebec, tan esencial para la obra, donde más que un simple decorado, es el polo de atracción de la acción, del movimiento de los personajes. A través de este estudio, dirigiendo a su vez la encuesta, la autora se propone interrogar la presencia del registro policial en esta obra, a fin de desvelar -o quizás para echar a perder- el enigma policial de Poulin.
Corps de l’article
Pour qu’un roman soit bon, il faut de l’action, c’est-à-dire des événements, une intrigue assez bien menée pour qu’on ait envie de lire dans le seul but de savoir comment l’histoire va se terminer. En plus de l’action, il faut trois autres qualités : des personnages bien dessinés, un style, et une portée universelle[2].
If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive.
If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive[3].
« [C]omme détective privé, j’étais nul[4]. »
Romans policiers ou non ? Telle est l’enquête que je me propose de mener en suivant les indices disséminés dans l’oeuvre de Jacques Poulin, une oeuvre qui compte, à la date d’aujourd’hui, quatorze romans publiés entre 1967 et 2015, et dans laquelle la ville de Québec, et plus précisément le quartier du Vieux-Québec, joue un rôle tout à fait primordial. Accuser Poulin d’être un romancier coupable de ce genre n’est pas habituel[5] ; d’autres éléments sont normalement convoqués pour définir son écriture. Ainsi, je suggère de commencer par prendre en compte tous les indices qui jouent en sa faveur et infirment ma thèse, selon le principe d’une sorte de présomption d’innocence. L’antithèse viendra donc avant la thèse, ici, et cet ordre nous permettra de regarder l’oeuvre de Jacques Poulin telle qu’elle paraît en partant des informations désormais acquises par les critiques et spécialistes de sa production littéraire depuis plusieurs années. Cependant, dans une enquête digne de ce nom, rien ne doit être laissé au hasard et d’ailleurs, à force de creuser, il est possible de trouver des indices — à bien y regarder, il y en a quelques-uns — qui pourraient nous orienter vers une tout autre conclusion. Peut-on alors parler, sinon de genre policier, du moins d’une sorte de filiation du genre ? d’une réorientation ? et dans quel sens ? Ce questionnement nous amènera ainsi, si une relation quelconque existe bien entre le genre policier (pris dans le sens le plus large du terme) et les romans de Poulin, à mettre en évidence un mécanisme qui permettrait d’interroger les limites mêmes du (des) genre(s), de le(s) mettre en discussion, de le(s) mettre à mal, assurément, mais — ou peut-être de fait — de le(s) personnaliser, en quelque sorte, selon une approche qui n’est pas étrangère — elle — à la démarche poulinienne. C’est l’oeuvre de Poulin dans son ensemble qui constituera le terrain de jeu de notre enquête, laquelle s’effectuera à plusieurs niveaux, des indices les plus évidents à ceux qui se font plus subtils et qui interpellent la participation du lecteur, ô combien nécessaire pour le fonctionnement de toute oeuvre relevant manifestement du genre policier.
NON, CECI N’EST PAS UN ROMAN POLICIER
C’est sans doute d’abord ce commentaire aux tonalités magrittiennes qu’on a envie de formuler devant les romans de Poulin et même face au propos de cette étude. Car, en effet, d’emblée, rien ne permet de supposer que les romans de Poulin puissent être classés dans un tel genre. Écrivain minimaliste, de l’intime[6], des relations humaines, de l’incommunicabilité entre les êtres[7], de la recherche du bonheur, écrivain postmoderne[8], de l’américanité[9], de la ville de Québec[10]… tout autres sont les qualificatifs utilisés le plus souvent pour définir son travail d’écriture et qui font l’unanimité de la critique. Si l’on observe d’ailleurs le paratexte des romans publiés jusqu’à présent, on remarque tout de suite qu’aucun signe évident ne renvoie au genre policier : ni la couleur de la couverture, qui indiquerait l’appartenance à une collection particulière, ni le titre du roman ne peuvent laisser présager au lecteur la direction que pourrait prendre, malgré lui, sa lecture à partir du premier roman (de Poulin, ou du premier roman lu). Le seul roman qui, dans son paratexte, en quatrième de couverture, fasse référence à ce genre est Chat sauvage. Mais après avoir évoqué les références intertextuelles in praesentia (où l’on retrouve les noms d’auteurs que Poulin cite lors de ses rares entretiens et qu’il nomme dans son oeuvre : Hemingway, Chandler, Carver, etc.), cette présentation revient sur le thème de la recherche, de la « promesse de bonheur ». Les titres[11] de ses romans n’évoquent pas particulièrement non plus une véritable énigme, une enquête, encore moins un meurtre (l’intrigue, « l’histoire » dont Poulin parle, dans ses entretiens et dans ses romans, indispensable pour définir le roman policier en général, est tout autre). Le pacte de lecture qui permet à tout lecteur de se reconnaître dans un roman policier, et qui s’instaure avant même de commencer à en lire le texte, n’est pas non plus spécifié d’emblée. Ce contrat implique un code, des normes à suivre dans le roman de détection classique : crime, parfois sanglant, mystère, enquête, énigme à résoudre, stimulation de la curiosité du lecteur grâce au retardement des informations, dans l’attente du dénouement qui se concrétise, souvent, par un happy end où habituellement la justice et l’ordre triomphent[12] — ce qui pourrait, d’une façon plus synthétique, être résumé ainsi : « Les pièces maîtresses du roman policier sont placées sur l’échiquier : 1) le crime mystérieux ; 2) le détective ; 3) l’enquête[13]. » De plus, si l’on considère les fameuses vingt règles publiées pour la première fois en 1928 par Van Dine, reprises par Narcejac — non sans les mettre en discussion — dans Une machine à lire : le roman policier[14], qui doivent être suivies comme autant de commandements par tout écrivain de roman policier qui se respecte, Poulin ne semble pas en tenir compte non plus, et cela, en dépit de son écriture ritualisée et qui ne répugne certes pas aux règles et aux commandements[15].
Quant à la définition de Todorov, qui, dans Poétique de la prose[16], organise le roman policier en le classant selon les trois sous-catégories — ou « formes différentes » — que constituent le « roman à énigme », le « roman noir » et le « roman à suspense », les romans de Poulin ne peuvent pas vraiment y être classés de façon systématique et univoque. Dans ses romans, en effet, les éléments dont parle Todorov ne sont pas tous présents dans une égale mesure : ils ne sont ni tout à fait des romans à énigme, puisqu’ils ne se concentrent pas autour de la question finale ; ni vraiment des histoires à dévisser, ne comportant pas de mystère comme on peut en trouver dans les romans à énigme. Qui plus est, la violence physique, quand elle est présente dans ses oeuvres, n’est pas traitée comme elle l’est d’habitude dans le roman noir : elle est le plus souvent elle aussi équivoque, plutôt voilée, dissimulée, indécidable qu’affichée au premier degré[17]. Quant au roman à suspense, que Todorov définit comme une variante du roman à énigme, si une tension est bien perceptible de temps à autre dans plusieurs romans, elle reste ambiguë et diffuse, et ne débouche jamais sur un crime de sang ; cette catégorie ne peut donc pas non plus nous venir en aide pour définir le roman poulinien.
Ajoutons que le personnage de Poulin n’est pas un vrai détective, et cela, malgré le fait que, comme les détectives qui reviennent d’un roman à l’autre en fidélisant ainsi les amateurs du genre, il ait, de roman en roman, les mêmes caractéristiques et le même nom (le plus souvent Jack Waterman). La véritable enquête que le personnage poulinien, qu’il soit écrivain, traducteur ou lecteur, est amené à conduire est plutôt et surtout une quête ayant pour fin de trouver le mot juste, ou le livre juste, de trouver une place dans le monde, d’accepter l’Autre[18]… A priori donc, tout cela ne semble relever que de simples conjectures, et les accusations formulées de telle sorte ne peuvent finalement qu’être rejetées.
Néanmoins, déjà dès le premier roman, Mon cheval pour un royaume[19], figure un vrai détective, qui n’est pas protagoniste, mais qui cherche le personnage du caléchier disparu à l’improviste. Un autre détective, qui répond au nom vague de Milhomme, est présent dans La traduction est une histoire d’amour[20], et un autre encore joue un rôle, lui aussi secondaire, dans L’anglais n’est pas une langue magique[21], un homme que Francis baptise « Bogart », à cause de « son visage impassible, sa voix métallique » (APM, 68), le détective par excellence qui, comme nous le verrons, revient souvent dans l’oeuvre poulinienne et permet de souligner que ce n’est pas que le roman policier qui est convoqué dans l’oeuvre, mais le cinéma tout autant. De plus, si ce roman mérite d’être cité ici, c’est qu’il introduit clairement un dialogue avec le genre qui intéresse notre réflexion, pendant un interrogatoire révélateur, selon l’art de l’esquive de Jacques Poulin :
APM, 92[Francis :] — Vous connaissez les livres de mon frère ? demandai-je.
— J’en ai entendu parler, dit-il prudemment.
— Et vous les avez lus ?
— Non, je ne lis pas beaucoup.
— Même pas les romans policiers ?
— J’aime mieux regarder la télé, c’est plus reposant.
— Tant pis pour vous !
— Pourquoi dites-vous ça ?
— La télé, ça sert avant tout à faire marcher le commerce.
Nous retrouvons ici le souci de la lecture — et de la lecture de ses livres —, très présent dans l’oeuvre poulinienne, avec la critique de la culture de masse ; mais surtout, la dépréciation du genre policier, relevant justement de la culture de masse, est soulignée par ce « même pas », comme si ce genre se situait forcément tout en bas de l’échelle littéraire — n’oublions pas que Francis est lecteur sur commande —, alors qu’en réalité, ce jugement de valeur un peu hâtif à la première lecture pourrait être interprété comme une clé de lecture du roman. Ce genre est donc présent, mais toujours comme élément critique dans un roman où l’enquête se dessine en filigrane et où, du début à la fin, c’est le même Francis qui joue au détective en s’introduisant, par exemple, dans l’appartement d’une femme qui l’a contacté pour qu’il lui lise des nouvelles de Carver, n’hésitant pas à fouiller dans ses affaires ni même à voler son carnet d’adresses…
FINALEMENT, À Y REGARDER DE PLUS PRÈS…
Pourtant donc, comme elle le suggère d’ailleurs, l’affirmation magrittienne formulée plus haut n’est pas à prendre pour argent comptant, car plus on regarde l’oeuvre dans son ensemble, plus on remarque que les romans de Poulin, dans leur quasi-totalité, englobent ou sont construits autour d’une énigme à résoudre, certes à mesure inégale. Cet aspect n’a pas attiré l’attention de la critique, à quelques (rapides) exceptions près[22], mais il constitue l’une des strates qui se cachent derrière cette apparence de simplicité trompeuse de l’oeuvre, qu’on dévoile après de nombreuses lectures et qui permettent de montrer le polyèdre que constitue l’oeuvre de Poulin. Et si Lise Lachance parle d’un « parfum discret de polar[23] » à propos de Chat sauvage, en soulignant qu’il s’agit d’une « nouveauté » chez cet auteur, en réalité, un halo de mystère et la démarche de l’enquête, depuis Mon cheval pour un royaume comme on l’a vu, sont toujours présents dans ses romans. La fréquence de détails relevant du roman à intrigue, ou du roman d’enquête, focalisé sur un personnage qui renvoie à la figure d’un détective hors du commun, la récurrence de l’acte de la filature, les allusions au roman policier et la façon toute particulière de se positionner par rapport à ce genre (dans lequel il reste d’ailleurs impossible d’enfermer Poulin), tous ces éléments se font progressivement plus évidents, à un tel point que l’auteur lui-même semble les exploiter de façon ironique, car est toujours présent dans l’oeuvre un personnage qui, sans être un détective à proprement parler, joue avec ce rôle en confirmant ou en infirmant notre hypothèse.
Chez Poulin, l’énigme s’organise essentiellement sous la forme d’une recherche ou d’une quête où la personne et l’objet recherchés revêtent un caractère extrêmement variable. Cette quête se manifeste à travers un mécanisme et des caractéristiques qui reviennent d’un roman à l’autre et qui se déroulent dans des conditions similaires. Le jeu qui se constitue ainsi autour de l’énigme recoupe par ailleurs celui qui s’élabore à travers le dévoilement des intertextes : au lecteur, comme nous le verrons, de résoudre le cas… Aussi, si au départ l’énigme paraît claire et définie, petit à petit elle se raréfie, le pôle d’intérêt devenant changeant et le but des traversées du personnage-détective prenant une plus grande ampleur. Cette enquête oscille plutôt entre la disparition de quelqu’un (le caléchier dans Mon cheval pour un royaume, Théo dans Volkswagen Blues, Simon dans Le coeur de la baleine bleue[24], Marianne dans L’anglais n’est pas une langue magique) ou bien l’apparition d’un personnage qui arrive d’on ne sait où et dont on veut connaître l’identité (Marika dans Le vieux Chagrin, Sam Miller dans Chat sauvage, Limoilou et la vieille femme dans La traduction est une histoire d’amour, Boris le bouncer dans Un jukebox dans la tête), jusqu’à la disparition de Jack Waterman lui-même, enlevé dans L’homme de la Saskatchewan. Dans tous ces cas, le personnage poulinien (Jack lui-même ou son substitut, Francis — quand ils ne le font pas ensemble, devenant l’adjuvant l’un de l’autre ; seul ou alors accompagné de la Grande Sauterelle, de Marine ou de Mélodie, créant dès lors, d’une certaine façon, un double des couples classiques comme Watson et Sherlock Holmes) entame une enquête et se retrouve à suivre des personnages afin de tenter de résoudre le mystère. Mais le personnage poulinien ne se prend jamais au sérieux[25], car c’est en se déguisant (dans le sens propre du terme) et en prenant des attitudes spécifiques qu’il endosse le masque du détective : « Pour ne pas être reconnu, je mis mon chapeau de tennis, mes lunettes de soleil, un trench-coat mastic […] et je dévalai l’escalier intérieur en me moquant de moi-même : selon toute vraisemblance, j’allais me prendre encore une fois pour Bogart, le talent en moins. » (CS, 134) Une fois les clichés du détective privé réactualisés, cette enquête se concrétise toujours à travers des promenades qui s’effectuent essentiellement dans la ville, une ville où les personnages vont et viennent, sortent et rentrent à travers les portes du Vieux-Québec, une ville qui parfois participe et se fait complice. Par ailleurs, que Poulin ait recourt à ce genre, dans une oeuvre qui donne autant de place à la ville, ne doit pas étonner, car cette dernière, on le sait, représente le théâtre par excellence du genre policier[26]. La ville devient alors ce labyrinthe symbolique qu’il faut parcourir et dont il faut sortir en suivant tous les indices afin de résoudre l’énigme, et Québec — quoiqu’elle ne soit jamais véritablement décrite, comme j’ai eu l’occasion de le montrer ailleurs[27] —, avec ses rues étroites et anciennes, n’échappe pas à cette fonction.
En effet dans tous ces romans, la ville — et le quartier du Vieux-Québec tout particulièrement — joue un rôle important. Elle peut être adjuvant, antagoniste, constituer un obstacle à surmonter pour les personnages ou bien tout simplement rester spectatrice. Elle peut même être vue comme une sorte de labyrinthe dans lequel erre un personnage qui, dans son ambiguïté, dans sa dualité, est un Thésée qui fuit et qui va en même temps à la rencontre de son Minotaure, sans arriver pour autant à le tuer. En tout état de cause, la disparition du personnage recherché — ou le fait qu’il soit privé de parole, comme Théo dans Volkswagen Blues — peut constituer en quelque sorte sa mort narrative. De plus, la présence d’un personnage principal (lequel est parfois aussi narrateur) qui revient d’un roman à l’autre avec les mêmes caractéristiques fait aussi penser au genre policier. Cette démarche est en effet courante dans ce genre, et a pour but de fidéliser le lecteur. L’amateur du genre, habitué d’une série, sait tout de son détective, il en apprécie les qualités comme les défauts et arrive même parfois, dans une attitude ludique elle aussi typique du genre, à prévoir ses réactions ou ses démarches. Ce lecteur fidèle veut à la fois reconnaître et être surpris. On peut retrouver ce même mécanisme dans l’oeuvre de Poulin. Ce sont finalement les lieux traversés qui servent de fil d’Ariane pour résoudre l’énigme et deviennent le théâtre où se déroulent l’enquête et la réflexion sur l’écriture, toujours effectuée en parallèle par le personnage-écrivain/traducteur/lecteur. Cette réflexion, qui se manifeste comme une mise en abyme, prend forme à travers le regard que le personnage principal pose sur sa propre démarche à l’égard de la ville et de l’écriture. Ainsi même Volkswagen Blues[28], le roman phare de l’américanité, peut être lu à l’aide de cette clé : la Grande Sauterelle et Jack Waterman partent à la recherche de Théo, le frère de Jack, et, en suivant les indices qu’ils découvrent et interprètent au fur et à mesure, arrivent à San Francisco. Dans cette ville, l’ambiance et le vocabulaire utilisé rappellent ceux des romans policiers[29], mais surtout des films policiers, et en particulier des grands classiques américains, avec aussi un clin d’oeil aux classiques français. Pensons à la photo sur laquelle Jack reconnaît Théo dans le visage du seul homme désigné par la mention : « UNIDENTIFIED MAN[30] ». D’ailleurs, même s’il hésite au moment d’interroger l’homme qui pourrait les aider, car il a peur d’être pris pour « un détective privé », il déclare :
— Ça me donne l’impression d’être dans un film policier. Un vieux film avec Jean Gabin ou Humphrey Bogart[31]. Vous savez bien : il y a un bar un peu louche avec beaucoup de fumée et des ventilateurs de plafond, et le détective s’approche du comptoir et montre la photo au barman : « Avez-vous déjà vu cet homme ? » Le barman répond qu’il ne l’a jamais vu de toute sa vie, alors le détective met un billet de vingt dollars sur le comptoir : « Voilà de quoi vous rafraîchir la mémoire. » Et l’autre dit : « Ah oui ! Maintenant, je me souviens… » Vous voyez ce que je veux dire ?
VB, 296-297
Cette « impression », les dialogues essentiels, les questions classiques, maintes fois répétés dans les films des années 1940-1950 devenus des références, l’argent qui « rafraîch[it] la mémoire », l’ambiance « louche » et enveloppée de « fumée » : tout ici renvoie aux films dont les acteurs phares (qui deviennent les emblèmes des détectives par excellence) sont cités dans le passage. Le lecteur peut s’étonner de lire ce qu’il s’attendrait à trouver dans un roman — ou un film — policier et en même temps, progressivement, il s’y attend, ou mieux : Poulin le porte à s’y attendre, comme le ferait un écrivain de policier. Dans ce travail de rajout et de superposition, la phrase, de banale, devient inévitable et nécessaire. Elle colore et alimente l’atmosphère au sein de laquelle elle naît, en surchargeant la scène à laquelle le lecteur assiste. Cette scène empreinte d’ironie a aussi pour fonction de dédramatiser la situation, elle est une sorte de soupape qui, par l’autodérision, libère ici la tension et la crainte de rencontrer Théo — car la quête arrive à sa fin — éprouvées par Jack. Après avoir tant cherché son frère, Jack craint tout autant de le retrouver que de ne pas y parvenir, l’aboutissement de l’enquête suscite son anxiété, tout comme la rencontre éventuelle qui pourrait en découler. Dans cette situation de tension, le changement de registre allège l’ambiance et insère une pointe d’ironie, autre élément récurrent chez Poulin. Cette parenthèse n’empêchera pourtant pas Jack de demander : « Connaissez-vous cet homme ? » quelques lignes après, formulation elle aussi classique dans la bouche des détectives privés de fiction — et cette phrase également, le lecteur l’attend. L’auteur assaisonne la scène de tous les ingrédients nécessaires pour créer une ambiance de film policier. La dénonciation des procédés désamorce la tension en jetant les ferments de la dérision et laisse entendre que, cette fois, la scène n’aura pas lieu. Or l’écriture la réalise, ce qui revient à saper le travail de la narration. De fait, elle déjoue, désenchante et détruit par avance l’illusion narrative, puisqu’elle nous a déjà projetés dans le point de vue critique aux yeux duquel toute cette scène se réduit à une culture cinématographique où les films et les romans appartenant au genre sont finalement interchangeables.
Décidément, la discrétion n’est pas la qualité principale du détective poulinien. Il est un détective maladroit (à la Chandler), et qui commet toujours des faux pas, ce qu’un vrai détective professionnel ne ferait pas. On peut rajouter que, chaque fois, il en est conscient ; force lui est d’ailleurs de constater lui-même que « comme détective privé, [il] étai[t] nul » (CS, 45). Encore une fois, et c’est le cas dans toutes les scènes de ce genre, la dérision et même la parodie interviennent dans le registre du policier, qui est modifié, personnalisé par l’auteur québécois, et font sentir un vide derrière le récit.
D’UN INDICE L’AUTRE : L’ENQUÊTE DU LECTEUR
Le lecteur poulinien est donc convié à entrer en investigation, à mener l’enquête, à jouer le jeu. Il se sent impliqué dans une sorte d’accord silencieux — pacte cette fois-ci bien plus clair — avec le livre. Dans presque tous les romans de Poulin, il découvre une scène d’espionnage. Il se laisse entraîner dans la quête des personnages. Il est appelé à participer à la poursuite d’un homme (La traduction est une histoire d’amour, Un jukebox dans la tête) ou d’une femme (L’homme de la Saskatchewan) avec le narrateur ou le personnage principal, qui se trouve souvent pris au piège dans le jeu de la filature, quand il n’est pas suivi lui-même par quelqu’un (Les yeux bleus de Mistassini, L’homme de la Saskatchewan). Une situation de ce genre se répète dans Chat sauvage, mais ici la participation du lecteur est requise davantage encore et permet de dévoiler le jeu de l’auteur, qui dépasse le mécanisme du genre pour englober la référence intertextuelle. Jack cherche à découvrir l’identité d’un vieil homme qui ressemble à son père, dans un magasin, et, dans ce contexte, remet un billet de dix dollars au comptoir. Le passage des dix dollars rappelle la scène décrite précédemment (dans Volkswagen Blues) et joue par ailleurs sur une équivoque : le lecteur peut se demander si l’argent est donné pour rendre au vendeur son dû, ou bien pour lui rafraîchir la mémoire. En lui donnant l’argent, Jack demande : « — Excusez-moi, […] je voudrais savoir si vous connaissez un homme qui s’appelle Sam Miller… » (CS, 40) ; « Un vieux bonhomme grand et maigre… Il habite une rue voisine. » (CS, 46) Une fois de plus, nous nous trouvons devant une scène typique du genre. Ici, l’homme qui est l’objet de la quête du narrateur s’appelle Sam Miller. Il ressemble au narrateur et est originaire du même village que lui, un village qui s’appelle Marlow (CS, 46).
C’est au lecteur maintenant de jouer le rôle de détective, et plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent, à lui d’interpréter les indices donnés par l’auteur et de découvrir qu’un jeu de mots fait de ces trois noms un système révélateur. En effet, à une lettre près, on retrouve dans ce nom de lieu l’éponyme de Philip Marlowe, le plus grand détective de la littérature policière américaine, créé par Raymond Chandler à la fin des années 1930[32]. Quant à « Sam », il s’agit du prénom d’un autre détective de fiction très célèbre, Sam Spade, créé par Dashiell Hammett[33] entre 1929 et 1930, chef de file du roman policier américain des années 1920, tandis que « Miller » rappelle le nom de famille de Henry Miller, l’écrivain devenu mythe, qui a influencé les écrivains de la Beat Generation. Les deux détectives, Marlowe et Spade, ont en commun d’avoir été interprétés à l’écran par Humphrey Bogart, un acteur, comme nous l’avons vu, souvent cité par Poulin dans ce genre de scènes[34]. De plus, Sam est aussi le nom de l’un des personnages de la nouvelle The Killers (Les tueurs, 1927) d’Hemingway, l’écrivain phare de Poulin, nouvelle qui a été reprise de nombreuses fois au cinéma[35]. Ainsi, par le roman policier, on retrouve Ernest Hemingway qui, lui aussi, a flirté avec le roman policier.
Mais si le lecteur veut pousser plus loin son enquête, il pourrait découvrir que Marlow[36] est aussi le nom d’une municipalité, créée au début du xxe siècle et devenue par la suite Saint-Gédéon-de-Beauce, qui, située près de la frontière américaine avec l’État du Maine, est également le village natal de Jacques Poulin. Ce n’est peut-être pas un hasard alors si, dans un roman où le personnage principal mène une enquête en suivant un homme qui ressemble à son père, l’auteur a choisi de glisser des références autobiographiques qui s’entremêlent avec les références intertextuelles. Le lecteur de Poulin est rompu à ce genre de jeu littéraire.
Le personnage poulinien a donc des caractéristiques et des attitudes en commun avec le détective américain. Il en fait un exemple à suivre. Et de même que, face au comportement à adopter avec une femme, il se réfère à Ernest Hemingway, son exemple en conquêtes amoureuses, de même ici il se base sur son nouveau mentor dans la filature et en arrive à se demander : « Qu’est-ce que le fameux Bogie aurait fait à ma place ? » (CS, 137) ; on se souviendra que, dans Le vieux Chagrin, la même question est posée, cette fois en pensant à Hemingway, quant à l’attitude à avoir avec Marika : « Je me laissai aller à la rêverie et perdis mon temps à me demander ce que le vieux Hemingway aurait fait si c’était lui qui avait vu des pas dans le sable. » (VC, 25) C’est aussi l’originalité de ce détective loin d’être sans défauts qui fait de lui un modèle tout désigné pour le personnage poulinien : Marlowe n’est pas parfait, il a beaucoup d’humour, il adore la poésie et la littérature. Il est parfois contemplatif et philosophe. Il est contre la corruption du monde et n’est pas habile avec l’argent. Ses faux pas sont nombreux, mais il accepte de ne pas se faire régler ses honoraires, car il est moralement intègre ; en somme, une sorte d’antihéros parfois naïf, mais surtout sensible. Toutes ces caractéristiques ont un parfum très poulinien.
Raymond Chandler figure, comme on l’a vu, parmi les auteurs préférés de Jacques Poulin et de ses personnages. Si ces derniers ne sont pas aussi « hard-boiled » que le détective personnage de Chandler, du côté de l’écriture, en revanche, des similitudes se laissent deviner. D’ailleurs, Chandler, comme Jacques Poulin,
[…] éprouve la plus grande difficulté à concevoir ses intrigues. Ne puise-t-il pas dans ses nouvelles la matière de ses romans ? Ainsi, l’essentiel de The Big Sleep est tiré de « Killer in the Rain » et de « The Curtain », deux histoires pour ainsi dire collées bout à bout et auxquelles viennent s’adjoindre quelques fragments d’autres textes antérieurs[37].
On reconnaît dans cette écriture des traits qui rappellent certaines figures d’écrivains, à l’intérieur du récit, et, à travers elles, celle de l’auteur lui-même. Le Marlowe de Chandler, comme c’est généralement le cas dans les policiers qui ont pour protagoniste un détective, a un passé qui revient souvent et qui le rend reconnaissable de roman en roman (d’une enquête à l’autre). Cette épaisseur du personnage se déposant d’oeuvre en oeuvre (sans peser d’ailleurs) est un élément de cohérence que l’on retrouve chez Poulin et qui engage l’enquête du lecteur vers la recherche d’un passé à retrouver et l’approfondissement du récit.
The Big Sleep est également évoqué dans l’oeuvre. Dans Chat sauvage, Jack essaie de suivre une fille pour obtenir d’elle des renseignements sur l’homme pour lequel il doit écrire des lettres, ce même Sam Miller qui est aussi caléchier :
Sitôt rendu sur le trottoir, je vis que la fille s’était éloignée d’une vingtaine de mètres en direction de la terrasse Dufferin. […] Je me mis à la suivre […]. Je tenais mon parapluie incliné vers l’avant pour cacher mon visage. […] Je me sentais l’âme de Humphrey Bogart dans The Big Sleep. Mais lorsque je parvins à l’endroit où je l’avais perdue de vue, j’eus beau me tourner de tous les côtés : vers la terrasse, vers le Château, vers la rue Laporte, elle n’était nulle part.
CS, 85
La fille réapparaît, le narrateur la suit, mais elle disparaît à nouveau. Jack tente de la rattraper, et c’est à ce moment qu’elle arrive à le bloquer :
CS, 87— C’est toi qui étais à la librairie ?
— Oui.
— Et aujourd’hui tu m’as suivie… Pourquoi ?
— C’est vrai, dis-je. Comment vous en êtes-vous aperçue ?
— La pluie s’était arrêtée et ton parapluie était encore ouvert… C’était facile de voir que tu voulais cacher ton visage.
— Je suis vraiment nul !
Ces passages soulignent l’incapacité et l’autodérision[38] dont fait preuve le détective poulinien, mais ils montrent également comment la ville joue bien le rôle qu’on lui connaît dans les romans policiers : elle fait disparaître un suspect, le fait réapparaître comme par magie, la présence de la pluie étant un autre élément de connotation des poursuites policières de ce genre. La ville est aussi quelquefois alliée et aide du détective : « Je m’approchai rapidement et me blottis à l’angle de la première rue transversale qui était Saint-Augustin » ; puis, comme il n’est pas à l’aise et n’arrive pas à se sortir d’affaire, il demande à des femmes qui passent par là « quelle était la meilleure façon de se rendre à la gare du Palais » (CS, 137). La ville devient alors complice du détective maladroit. De plus, grâce à cette poursuite, le lecteur apprend à connaître — ou du moins se familiarise avec — les rues, toujours nommées avec précision, traversées sur les pas du détective et de ses proies (quand il ne s’agit pas de personnages qu’il lui faut protéger ou suivre parce qu’il est tombé sous leur charme).
EN GUISE DE CONCLUSION
Poulin, admirateur de Chandler, exploite le genre de cet auteur en partageant avec lui le soin du détail. Les romans de Poulin sont donc des policiers sans en être et sans avoir la prétention d’en être. Toutes les énigmes auxquelles le personnage a été confronté constituent autant d’artifices qui cachent le but véritable et ultime des romans de Poulin. Ce but est ce qui portera le personnage à une connaissance meilleure et plus approfondie de soi, mais transformera aussi, dans la recherche, l’espace traversé en labyrinthe.
Finalement, dans l’oeuvre poulinienne, peuvent être repérées trois sortes de détectives : le personnage aux prises avec la ville et avec les deux niveaux d’enquête (l’enquête réelle, et celle visant à atteindre son identité personnelle), le lecteur face à l’énigme et aux poupées russes à déshabiller des romans de Jacques Poulin et, enfin, l’auteur. Ce dernier explore à tâtons dans le noir, comme il aime à le répéter, en essayant de trouver le « coupable » : le terme faux ou inutile qu’il faut à tout prix éliminer dans les méandres des mots.
Chez Poulin, le jeu ne se joue pas que dans le roman que le lecteur est en train de lire. Il investit et implique toute l’oeuvre. L’absence de meurtre et la prolifération de situations qui contiennent une énigme à résoudre — pouvant dans certains cas être synthétisées comme une seule et même énigme — lui permettent de jouer un jeu beaucoup plus complexe avec le lecteur, jeu qui contribue à ancrer davantage ce dernier à l’oeuvre elle-même. Si le pari — impossible — du genre policier (en littérature comme au cinéma) consiste à mettre le lecteur perspicace dans des conditions telles qu’il ne puisse jamais arriver à la fin du livre/du film (impossible évidemment, car pour prouver sa victoire, sa supériorité vis-à-vis de l’auteur, il est bel et bien obligé d’arriver jusqu’au bout), chez Poulin, c’est justement au mécanisme inverse que le lecteur est confronté. À force de suivre pistes et indices, il est bien obligé, tout en mettant constamment à l’épreuve sa mémoire, de lire et de relire, de revenir en arrière, tout en avançant. Par là se matérialise le fait que, chez Poulin, le siège de l’enquête se déplace du texte écrit, comme une partition musicale (ce qui précipite le lecteur de roman policier vers la conclusion), vers la conscience du lecteur, où l’investigation se fait, se défait et se refait indéfiniment. Il y a finalement une enquête jamais finie qui s’élabore dans l’expérience du lecteur. Et cette enquête, c’est précisément celle de toute lecture.
Pas tout à fait un roman d’amour, pas tout à fait un roman historique, pas tout à fait un roman à énigme ou policier : c’est donc l’oeuvre du « pas tout à fait » — et en cela consisterait peut-être sa poétique — ou, pour reprendre le titre de ce numéro de Voix et Images, de l’entre-deux. Poulin joue avec et dans les limites non seulement de la ville, mais aussi des genres et, ce faisant, il attire dans l’énigme de son oeuvre le lecteur qui ne peut se satisfaire d’un seul élément, mais qui les cherche tous, parfois sans même le savoir. Aussi, si c’est bien une question de limites, ce terme peut être revisité, reconsidéré, sous un autre angle, notamment dans sa relation à une certaine forme poétique du genre et plus précisément, dans le cas qui nous occupe ici, du genre policier. Finalement, qu’est-ce qu’une limite, sinon la matérialisation d’un espace de l’entre-deux ? La limite sépare, certes, mais elle unit tout à la fois, et c’est dans ce sens que l’oeuvre de Poulin peut être définie comme une oeuvre de l’entre-deux.
Parties annexes
Note biographique
STEFANIA CUBEDDU-PROUX est docteure en littératures francophone et comparée, disciplines qu’elle enseigne à l’Université Paris Nanterre, où elle est membre associé du Centre des sciences des littératures en langue française. Sa thèse de doctorat, soutenue à l’université Paris Sorbonne, portait sur la ville de Québec dans l’oeuvre complète de Jacques Poulin et est en cours de publication. Tout en poursuivant ses recherches sur la littérature québécoise (entre autres, sur l’oeuvre de Jacques Poulin) et les représentations littéraires de l’espace urbain, elle a élargi ses recherches et publié de nombreux articles sur d’autres problématiques (texte et images, réécriture des mythes, migrations…). Elle a également codirigé les ouvrages L’Atlantique littéraire au féminin, xxe-xxie siècles. Approches comparatistes (PUBP, sous presse), Lettres francophones en chronotopes (L’Harmattan, 2017), Regards sur le cosmopolitisme européen : frontières et identités (Peter Lang, 2011).
Notes
-
[1]
Jacques Poulin, Volkswagen Blues, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, coll. « Babel », 1998 [1984], p. 297. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle VB suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[2]
Jacques Poulin dans François Ouellet, « Jacques Poulin » [Entretien], Nuit blanche, no 45, septembre-octobre-novembre 1991, p. 42.
-
[3]
Raymond Chandler, Playback, New York, Vintage books, 1988 [1958], traduit en français par Charades pour écroulés, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1991, 253 p. À la p. 236, Marlowe explique : « Si je n’étais pas dur, je ne serais pas en vie. Et si j’étais incapable de douceur, je ne mériterais pas d’être en vie », nous traduisons.
-
[4]
Jacques Poulin, Chat sauvage, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, coll. « Babel », 1998, p. 45. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle CS suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[5]
L’intuition de lire les romans de Jacques Poulin sous le filtre du roman policier m’est venue lors de la rédaction de ma thèse de doctorat intitulée Lire le Québec de Jacques Poulin sous l’oeil d’Italo Calvino, soutenue à l’Université Paris-Sorbonne et en cours de publication ; voir le chapitre 6.4 : « Sur les traces d’un roman policier ».
-
[6]
Jean Morency, « Jacques Poulin. Partir pour le pôle intérieur de soi-même », Nuit blanche, no 45, septembre-octobre-novembre 1991, p. 36-39 ; Pierre Hébert, Jacques Poulin. La création d’un espace amoureux, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Oeuvres et auteurs », 1997, 205 p.
-
[7]
Stefania Cubeddu, « Les grandes marées de Jacques Poulin : un échiquier fictif… dans le paradis d’une île », Africa, America, Asia, Australia, no 23, Roma, Bulzoni Editore, 2002, p. 43-50.
-
[8]
Lucie-Marie Magnan et Christian Morin, « Le vieux Chagrin », Lectures du postmodernisme dans le roman québécois, Montréal, Nuit blanche éditeur, coll. « Littérature(s) », 1997, 220 p., et Janet M. Paterson, Moments postmodernes dans le roman québécois, Ottawa, Presses de l’université d’Ottawa, 1990, 126 p.
-
[9]
Anne Marie Miraglia, « L’Amérique et l’américanité chez Jacques Poulin », Urgences, no 34, décembre 1991, p. 34-45 ; Jean Morency, Le mythe américain dans les fictions d’Amérique, de Washington Irving à Jacques Poulin, Québec, Nuit blanche éditeur, coll. « Terre américaine », 1994, 258 p. ; Jonathan M. Weiss, « Une lecture américaine de Volkswagen Blues », Études françaises, vol. XXI, no 3, hiver 1985, p. 89-96.
-
[10]
Poulin, écrivain de la ville de Québec : voilà qui a toujours été considéré comme un axiome. Pour une étude sur le rôle de la ville de Québec et surtout du quartier du Vieux-Québec dans l’oeuvre de Poulin, je me permets de citer mon étude : « Jacques Poulin et Italo Calvino. Prolégomènes pour une lecture croisée de la ville en littérature », Beïda Chikhi et Anne Douaire-Banny (dir.), Villes, vies, visions. Les villes, propriétés de l’écrivain, actes du colloque international organisé par le Centre international d’études francophones de l’Université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi, Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces littéraires », p. 89-101 ; je renvoie également à ma thèse de doctorat, précédemment citée.
-
[11]
En guise d’exemple, pensons à l’étude de Marc Lits, Le roman policier. Introduction à la théorie et à l’histoire du genre littéraire (2e édition complétée, Liège, Éditions du CEFAL, coll. « Bibliothèque des paralittératures », 1999 [1993], 208 p.), dans laquelle, au chapitre trois, il décompose le titre Double assassinat dans la rue Morgue (1841) d’Edgar Allan Poe — grand classique du genre, traduit par Baudelaire —, pour donner les caractéristiques essentielles du genre en mettant l’accent sur « l’organisation structurelle » (Double), l’« assassinat : le contenu thématique », l’importance de la ville (« dans la rue : la dimension sociologique ») et « la part d’imaginaire » (Morgue).
-
[12]
François Gallix, « Formes du roman de détection, quelques approches de la critique moderne », Americana, no 13, 1996, p. 13.
-
[13]
Boileau-Narcejac, Le roman policier, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 1994 [1975], p. 22. Il ne s’agit pas ici de faire une étude du genre. La tâche se révélerait beaucoup trop ardue, d’autant plus qu’une définition unique et univoque du genre policier n’existe pas. Il faudrait distinguer en fonction de l’espace géographique, de l’époque, des influences et des écoles du genre. De plus, il serait nécessaire d’étudier le roman policier au Québec afin de voir quelles en sont les caractéristiques essentielles et s’il se différencie ou non des genres français, américain ou autres. Nous pouvons cependant préciser que le roman policier québécois s’inscrit dans la lignée américaine et que ce genre est, en ce moment, particulièrement florissant. La période la moins prolifique semble être celle des années qui ont immédiatement suivi la Révolution tranquille — le roman de cette époque étant beaucoup plus préoccupé d’explorer les problèmes identitaires. Pour une étude sur ce sujet, nous renvoyons à Norbert Spehner, Le roman policier en Amérique française. Essai critique et guide de lecture analytique du roman policier, d’espionnage, d’aventures et de politique-fiction francophone, t. I : 1837-2000, Québec, Alire, 2000, et Scènes de crimes. Enquêtes sur le roman policier contemporain, Québec, Alire, 2007, 278 p. Pour une étude du polar américain, voir Benoît Tadié, Le polar américain, la modernité et le mal (1920-1960), Paris, Presses universitaires de France, 2006, 233 p. Ces ouvrages contiennent de riches bibliographies. Inutile de préciser que, bien évidemment, aucun des romans de Poulin n’y figure.
-
[14]
Thomas Narcejac, Une machine à lire : le roman policier, Paris, Denoël/Gonthier, coll. « Bibliothèque Médiations », 1975, p. 97-101.
-
[15]
Pensons aux « Dix commandements » dans Jacques Poulin, Les yeux bleus de Mistassini, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2002, p. 21.
-
[16]
Tzvetan Todorov, Poétique de la prose, Paris, Éditions du Seuil, 1992 [1971].
-
[17]
À quelques exceptions près néanmoins : dans Chat sauvage, Kim est victime d’une agression de la part de l’un de ses patients, mais tout est raconté rapidement et Poulin ne rentre pas dans les détails — comme si le fait de ne pas la raconter ni la mettre en mots pouvait effacer la scène. Poulin se concentre davantage sur les actions à accomplir pour rassurer la victime. Cela ne veut pas dire que la violence n’est pas présente dans l’oeuvre de Poulin, mais elle est mise en scène et travaillée différemment : pensons à la violence de la société vis-à-vis de l’individu qui se manifeste progressivement dans l’île des Grandes marées (publié pour la première fois en 1978, voir l’édition Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 1995, 216 p.), à l’agression de Jack Waterman dans Les yeux bleus de Mistassini (chapitre 18, p.137-146), à son enlèvement dans L’homme de la Saskatchewan (Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2011, 120 p., chapitre 19, p.96-99) et à l’uppercut qu’il reçoit dans Un jukebox dans la tête (Montréal, Leméac, 2015, 146 p., chapitre 24, p.132-134), pour ne donner que quelques exemples. Mais dans ces cas aussi, les faits semblent moins importants que les conséquences et les gestes posés pour les marginaliser, pour les dépasser, voire pour mettre en évidence l’amitié et le soutien que les personnages peuvent apprécier. Le thème de la violence (Le vieux Chagrin [Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 1989, 155 p.], Un jukebox dans la tête…) nécessiterait d’ailleurs une étude plus approfondie. Désormais, les références à Le vieux Chagrin seront indiquées par le sigle VC suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[18]
Anne Marie Miraglia, L’écriture de l’Autre chez Jacques Poulin, Candiac, Éditions Balzac, coll. « L’univers des discours », 1993, 245 p.
-
[19]
Jacques Poulin, Mon cheval pour un royaume, Montréal, Leméac, coll. « Poche Québec Littérature », 1987 [1967], 190 p.
-
[20]
Jacques Poulin, La traduction est une histoire d’amour, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2006, 131 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle THA suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[21]
Jacques Poulin, L’anglais n’est pas une langue magique, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2009, 155 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle APM suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[22]
Jean-Cléo Godin glisse dans son article l’adjectif « policier » en parlant de Mon cheval pour un royaume, mais sans aller plus loin. Voir Jean-Cléo Godin, « Entre la pierre et l’extase », Nord, no 2, hiver 1972, p. 41.
-
[23]
Lise Lachance, « Jacques Poulin. Nostalgie parisienne », Le Soleil, 15 mars 1998, p. B10. Déjà dans la quatrième de couverture du roman, on peut lire : « Vive, entraînante, parfois drôle, l’action de Chat sauvage adresse un clin d’oeil au roman de détective. » Aucune étude, jusqu’à présent et à notre connaissance, ne s’est essayée à explorer cette piste.
-
[24]
Jacques Poulin, Le coeur de la baleine bleue, Montréal, Leméac, coll. « Poche Québec Littérature », 1987 [1970], 201 p.
-
[25]
Cet aspect n’est pas propre au registre policier dans le roman, car il intervient aussi au moment où le personnage poulinien essaie de définir son travail d’écriture, son état d’âme, interprète certains événements historiques…
-
[26]
Pensons par exemple au Paris des romans de Simenon.
-
[27]
Je me permets de citer mon étude : Stefania Cubeddu, « La ville invisible de Jacques Poulin. Une lecture de la ville de l’auteur québécois à travers le regard d’Italo Calvino », Anne Douaire-Banny (dir.), Isthmes francophones : du texte aux chants du monde. Mélanges offerts à Beïda Chikhi, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Lettres francophones », 2012, p. 393-404.
-
[28]
Comme Ginette Michaud l’avait évoqué dans son article « Récits postmodernes ? » (Études françaises, vol. XXI, no 3, hiver 1985, p. 67-88), la carte postale du début du roman constitue un début d’enquête.
-
[29]
Au début du roman, Jack Waterman et la Grande Sauterelle sont occupés à déchiffrer la carte postale de Théo (VB, 10-19). Ginette Michaud souligne l’incipit, particulièrement réussi, de ce roman qui propose « d’entrée de jeu une énigme à résoudre » et qui, par le même procédé, prend au piège le lecteur, se sentant lui aussi appelé à essayer d’interpréter la graphie presque illisible de la carte photocopiée dans le roman. Voir Ginette Michaud, « Récits postmodernes ? », p. 79.
-
[30]
La photographie insérée dans la page (VB, 292) est un document réel. Jacques Poulin va jusqu’à citer ses sources : en bas de la photo sont nommés des écrivains tels que Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, etc., et une date est affichée : 1977.
-
[31]
On reconnaît ici un procédé classique de Poulin dans les références intertextuelles qui convoquent une fois de plus le cinéma — Gabin et Bogart lui permettant aussi, surtout dans ce roman, d’évoquer les références française et américaine de la culture québécoise. Il est aisé de reconnaître ici l’ambiance, par exemple, du film Le faucon maltais (The Maltese Falcon) de John Huston (1941), un classique du genre qui est l’adaptation du roman éponyme de Dashiell Hammett (1930), mettant en scène le détective Sam Spade. Gabin a quant à lui incarné, par exemple, le personnage de Maigret (Maigret tend un piège de Jean Delannoy, 1958).
-
[32]
Philip Marlowe fait son entrée en littérature avec le roman Le grand sommeil/The Big Sleep (1939) de Raymond Chandler (que le réalisateur Howard Hawks adaptera pour le cinéma en 1946). Le détective, sombre et plein d’humour, sera personnifié par Humphrey Bogart, qui contribuera à en faire l’un des plus grands héros mythologiques du roman noir et du polar. Avec le même détective, pensons aussi à Playback (1958) du même Chandler, traduit en français par Charades pour écroulés, op. cit.).
-
[33]
Son importance dans la littérature américaine est capitale : Hemingway, Chandler et, en Europe, Simenon ont reconnu son influence sur leurs oeuvres.
-
[34]
Pour en donner d’autres exemples, citons aussi le chapitre VIII de La traduction est une histoire d’amour, qui a pour titre « La voix rocailleuse d’Humphrey Bogart » (THA, 41-44), et Chat sauvage : « Qu’est-ce que le célèbre Bogie aurait fait à ma place ? » (CS, 137).
-
[35]
Pensons à The Killers de Robert Siodmak (1946), de Andreï Tarkovski (1956) et de Don Siegel (1964), pour ne citer que quelques exemples célèbres.
-
[36]
Pour plus de détails, voir les sites Internet suivants : http://histoire-du-quebec.ca/saint-gédéon-de-beauce ; http://grandquebec.com/villes-quebec/saint-gedeon-beauce/ ; et https://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/fr/historique (pages consultées le 8 novembre 2019).
-
[37]
Paule Lévy, « Dualité et paradoxes dans The Big Sleep de Raymond Chandler », Americana, no 13, 1996, p. 52.
-
[38]
Poulin insiste sur cet aspect de son détective, le chapitre 18 de Chat sauvage ayant d’ailleurs pour titre « L’invraisemblable détective » (CS, 135-142).