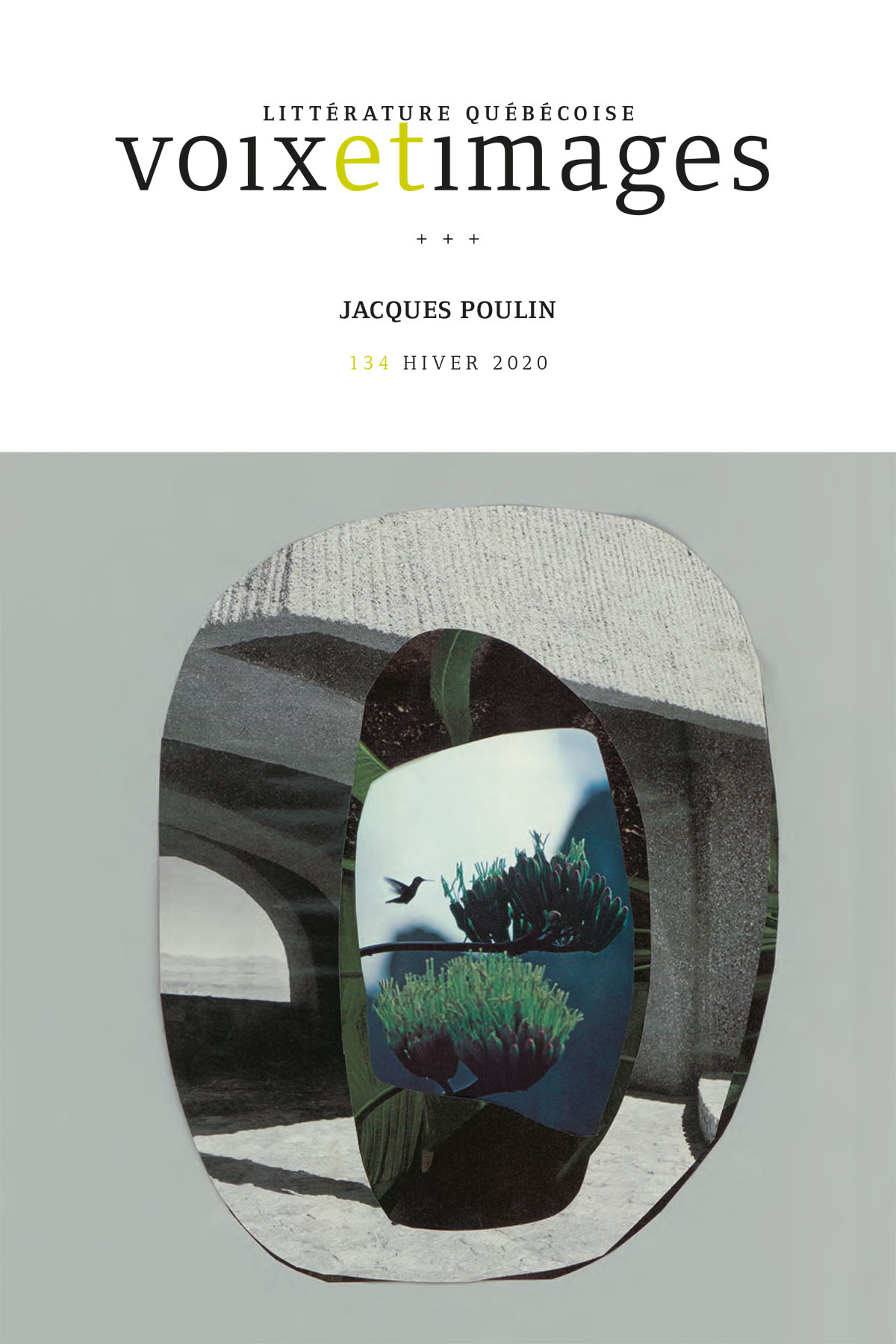Résumés
Résumé
Aujourd’hui, il serait problématique d’imaginer que le « grand roman de l’Amérique » puisse ne pas inclure des personnages et des thèmes autochtones. Cependant, la représentation d’Autochtones par des auteurs allochtones s’avère une entreprise tout aussi problématique. Comment s’y prendre en évitant les images fausses, réductrices, soit d’une manière respectueuse et bien informée ? Dans cet article, Pamela Sing propose des éléments de réponse à cette question en examinant le rôle joué par le personnage de la Métisse dans Volkswagen Blues et dans L’homme de la Saskatchewan de Jacques Poulin.
Abstract
Today, imagining the “great American novel” without any Indigenous characters or themes would be seen as problematic. Equally problematic, however, is the representation of Indigenous characters by non-Indigenous writers. How can this be done in a respectful and well-informed way, avoiding false and reductive images? Pamela Sing suggests possible answers by examining the role of the Métisse in Jacques Poulin’s Volkswagen Blues and L’homme de la Saskatchewan.
Resumen
Hoy en día sería problemático imaginar que la «gran novela de América» pudiera no incluir personajes y temas indígenas. No obstante, la representación de indígenas por autores no indígenas resulta una empresa igual de problemática. ¿Cómo actuar evitando las imágenes falsas, reductoras, esto es, de una manera respetuosa y bien informada? En este artículo, Pamela Sing propone elementos de respuesta a esta cuestión al examinar el papel que desempeña el personaje de la indígena en Volkswagen Blues y L’homme de la Saskatchewan (El hombre de Saskatchewan), de Jacques Poulin.
Corps de l’article
Les travaux d’Edward Saïd au sujet de l’orientalisme confirment que la tentative de saisir une culture autre que la sienne est une entreprise délicate et problématique, quasiment toujours vouée à l’échec[1]. D’une part, les préjugés et les stéréotypes influencent inévitablement le « regard » prétendument posé sur l’autre et risquent de mener à sa déshumanisation. D’autre part, la représentation qui en ressort dit plus du sujet que de l’objet. Cela étant, ne conviendrait-il pas de reconnaître la valeur intellectuelle, littéraire et socioculturelle d’oeuvres où l’écriture de l’autre résulte d’une approche éthique, nuancée qui ne cherche ni à exotiser ni à instrumentaliser son sujet, mais plutôt à révéler la richesse, la complexité et la spécificité de son caractère et de sa culture ?
Il s’agit là d’une question certes importante en ce qui concerne tous les groupes culturels vivant au sein d’un pays dont l’un des traits nationaux essentiels est sa diversité, mais à l’ère de la Commission de vérité et réconciliation, il semble particulièrement pertinent de nous pencher sur la représentation de l’autre autochtone. Or, tandis que les lectorats canadiens et québécois commencent à se sensibiliser à diverses réalités concernant les Premières nations, il en va autrement de la reconnaissance des Métis. Si, vers le milieu du xixe siècle, ceux de l’Ouest canadien croyaient que leur peuple constituait la Nouvelle Nation[2], la résistance — ou rébellion — du Nord-Ouest en 1885, qui s’est soldée par une défaite aux mains des troupes fédérales, suivie de la pendaison de Louis Riel, condamné pour haute trahison, leur a valu l’opprobre de tous, qu’ils aient été en faveur ou non de ce soulèvement armé contre le gouvernement canadien. Leur altérisation a conduit à la dissolution de plusieurs de leurs communautés, à la désidentification/réidentification d’un grand nombre d’individus, ainsi qu’à l’existence extrêmement discrète de ceux qui sont « demeurés » Métis. « Disparus » de la conscience collective canadienne, devenus « le peuple oublié du Canada[3] », les Métis n’ont commencé à réapparaître sur la scène publique que près d’un siècle plus tard. Dans l’introduction à son autobiographie Halfbreed (1973), grande oeuvre des littératures autochtones au Canada, Maria Campbell s’adressait à nous, lecteurs, insistant sur le fait qu’elle nous visait en l’écrivant, car elle voulait que nous sachions ce que c’était, être une Métisse dans notre pays : « Je veux vous raconter nos joies et nos peines, la pauvreté oppressante, les frustrations et les rêves[4]. » Deux décennies plus tard cependant, deux Métisses intellectuelles et activistes, Emma LaRocque (née en 1949) et Janice Acoose (née en 1954), constataient, en 1991 et en 1995 respectivement, la nécessité de faire connaître l’humanité des peuples autochtones : le discours social déshumanisait l’indianité et il ne reconnaissait même pas l’existence de la métissitude ou de la métissité[5]. Depuis lors, les temps ont changé. Tant et si bien que d’aucuns prétendent qu’actuellement, c’est cool, d’être Métis[6].
Qu’en est-il dans le domaine littéraire au Québec, et plus particulièrement chez Jacques Poulin ? Car cet auteur a fait paraître deux romans ayant pour protagoniste une jeune Métisse portant le même nom. Jusqu’à quel point est-elle représentée de façon « acceptable », soit dans une perspective qui se veut libertaire, ni répressive ni manipulatrice ? Vingt-sept ans séparent les deux romans. A-t-elle évolué dans l’intervalle ?
Le retour d’un même personnage pourrait sembler anodin dans la mesure où l’un des traits les plus communément relevés chez Poulin est la permanence de certains éléments (mots, tournures, personnages, situations et passions). Tandis que d’aucuns y voient un défaut[7], il est plus probant de reconnaître avec Lise Gauvin que, si « chaque roman s’amuse à citer les précédents », il ne s’agit pas de pur sentimentalisme : le système de renvois sert plutôt à « déjouer la simple réminiscence et [à] se contester[8] ». Dans une étude parue en 1992, Ginette Michaud renchérissait sur ce qu’observait Gauvin en ajoutant que la pratique, certes, favorise la complicité des lecteurs, mais
il s’agit, plus essentiellement, de la possibilité de déplacer dans l’après-coup ce qui a été écrit avant, de modifier et de renouveler l’interprétation que le lecteur pouvait avoir d’un texte, en l’obligeant de la sorte, par tout un jeu très complexe sur le temps romanesque, fait de retours en arrière et d’anticipations, de rappels et de projections, à une constante et active relecture qui, mine de rien, remet en cause les limites et les frontières passant entre chaque livre, et jusqu’à l’idée même du livre[9].
Poulin a prétendu que L’homme de la Saskatchewan n’est pas une suite à Volkswagen Blues[10], mais tel que je m’appliquerai à le faire ressortir dans cette étude, le rôle joué par le personnage de la Métisse prête à tout le moins une certaine continuité aux deux ouvrages. Aussi chercherai-je à déterminer si le personnage a évolué, tout en tenant compte du caractère soit stéréotypé, soit innovateur de ses attributs. Je commencerai cependant par une courte mise en contexte visant à donner quelques précisions sur le terme « Métis » et sur l’évolution de sa signification au Québec.
QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES TERMES « MÉTIS » ET « MÉTIS »
Au Canada, la définition du terme « Métis » engage bien des débats, et ce, non seulement parmi les « autorités » juridiques, politiques et académiques, mais aussi parmi les Autochtones. Pour la plupart des Canadiens, le terme se réfère aux gens d’origines mixtes. Selon certains, il faut qu’au moins un ancêtre soit Autochtone. Pour d’aucuns, le terme devrait être à la disposition d’Autochtones qui, à cause de leur ascendance mixte et des dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens, ont été dépossédés de leur appartenance à une communauté des Premières nations. Pour Chris Andersen, chercheur métis, les Métis sont l’un des peuples autochtones, c’est-à-dire une nation distincte ayant une histoire et des codes d’appartenance spécifiques qu’il faut respecter. Selon sa définition, les Métis sont devenus un peuple à force de partager une même expérience qui s’est cristallisée en une identité nationale pendant une période spécifique de l’histoire du Canada. Leur nation a vu le jour dans les prairies canadiennes, plus précisément dans la région de la rivière Rouge[11], et si cette histoire et ces codes ne font pas partie de la réalité d’un individu ou d’une communauté, même s’ils s’identifient comme étant Métis, ils ne peuvent être considérés comme des Métis (écrit avec une majuscule[12]). Tout autre est la position de Denis Gagnon, ancien titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse (2004-2014) et directeur du projet « Le statut de Métis au Canada » subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) (2013-2018) : selon lui, la lutte des « autres » Métis pour faire reconnaître leurs droits ancestraux et juridiques est légitime[13].
Or en 2003, la Cour suprême du Canada a rendu le jugement Powley, qui atteste l’existence d’une communauté métisse dans la région de Sault-Sainte-Marie en Ontario[14]. Au cours des 3 années suivantes, quelque 40 communautés à travers le Canada ont réclamé le statut de Métis. Jusqu’ici, aucune tentative n’a réussi, mais cela n’a nullement empêché les uns et les autres, dont 69 360 individus au Québec en 2016[15] — ce qui représente une augmentation de 149,2 % depuis 2006 —, de s’identifier comme « Métis ». Aucune loi n’accorde de reconnaissance officielle aux communautés métisses au Québec, bien que, de toutes les provinces, ce soit au Québec que les chiffres de croissance démographique pour les Métis sont les plus élevés.
FAÇONS D’ÊTRE ET DE FAIRE « MÉTISSES »
En plus de l’intérêt accru pour l’identité proprement métisse, le discours social témoigne d’un certain engouement pour ce qu’on pourrait appeler des « valeurs » ou « attitudes » dites métisses. En 2011, l’historien et sociologue québécois Denys Delâge, qui avait déjà abordé en 1984[16] l’aspect relationnel entre les habitants de la Nouvelle-France et les Autochtones en affirmant que l’habitus des premiers avait été influencé par celui de ces derniers, avançait que
la colonisation française en Amérique du Nord s’est caractérisée par un modèle métis[17] de relations avec les Amérindiens dont les cultures ont inspiré la critique sociale de l’Occident. Après la Conquête de la cession de 1763, les francophones auraient refoulé la part amérindienne en eux afin de réclamer des droits identitaires à titre de civilisés[18].
Dans cette perspective, avoir peur de passer pour des Sauvages équivaut à avoir honte de soi. Entre autres exemples de tentatives visant à rectifier la situation en embrassant le caractère autochtone de certaines attitudes et de certains comportements québécois, je citerai le film écrit et réalisé par Carole Poliquin et Yvan Dubuc qui est paru en 2015 : L’empreinte. Un voyage au coeur de notre identité[19].
Quant au Métis imaginaire dans des textes proprement littéraires, un tour d’horizon rapide révèle sa rareté au Québec, qu’il s’agisse d’oeuvres de nature autofictionnelle ou fictionnelle. Sans nullement prétendre à l’exhaustivité, je citerai les auteurs et titres suivants : [i] de Jacques Ferron, le roman Le ciel de Québec[20] ; [ii] de Robert Lalonde, des romans, dont Le dernier été des Indiens[21], Le diable en personne[22] et Sept lacs plus au nord[23] ; [iii] de Virginia Pésémapéo Bordeleau, deux romans — Ourse bleue[24] et L’amant du lac[25] ; [iv] de Michel Noël, deux romans pour la jeunesse — Le Métis amoureux[26] et Pien/Métis[27] ; [v] du bédéiste François Lapierre, deux tomes de la série Sagah-Nah — Celui qui parle aux fantômes[28] et La confrérie des tueurs de monstres[29] ; et [vi] de Romeo Saganash, le poème « Mahiganou »[30]. S’y ajoutent des traductions qui contribuent à alimenter l’imaginaire du lectorat québécois. En 2015, le recueil de poésie Une vraie bonne petite Métisse[31] de Marilyn Dumont, version française de A Really Good Brown Girl[32], a paru aux Éditions Hannenorak à Wendake — des 825 exemplaires tirés, 320 se sont vendus au Québec jusqu’au printemps 2019. En 2017, le roman Ligne brisée[33] de Katherena Vermette, version française de The Break[34], a paru chez Québec/Amérique. Je n’ai pas accès aux chiffres de vente pour la version française, mais soulignerai qu’elle a connu une deuxième impression et que, défendue par Naomi Fontaine, elle a remporté le Combat national des livres en 2018. Les Éditions Hannenorak ont fait paraître en novembre 2019 le recueil de poésie Mangeurs de pemmican, la traduction française de The Pemmican Eaters de Marilyn Dumont.
Ayant introduit « sa » Métisse sur la scène littéraire québécoise bien avant la parution de toutes les oeuvres que je viens de citer, hormis celle de Ferron et la première de Lalonde, Jacques Poulin fait figure d’avant-gardiste dans le domaine.
LA MÉTISSE POULINIENNE EN 1984
La Métisse de Volkswagen Blues est une jeune personne que le protagoniste québécois prend en stop. À la recherche de son frère Théo dont il a perdu la trace, l’homme a pour seul indice une carte postale datant de quinze ans, sur laquelle est imprimée une ancienne écriture. Faisant preuve d’une écoute attentive et d’une logique claire, la jeune fille s’ingénie à percer le mystère entourant la carte postale et, ce faisant, fait comprendre au Québécois quel itinéraire il devra suivre pour poursuivre ses recherches. De façon apparemment spontanée, non seulement l’accompagne-t-elle jusqu’à son appartement à Québec, mais elle n’hésite pas à prendre le volant et accepte son invitation à y passer la nuit — lui, sur le sofa, explicite-t-il. Le lendemain matin, elle part avant qu’il ne se réveille. Reviendra-t-elle ? Il reste dans l’incertitude à cet égard, car elle n’a pas laissé de mot. Lorsque, plus tard dans la journée, ils se retrouvent à l’appartement, l’homme essaie en vain de cacher son émotion. Sans être insensible à l’état d’âme du Québécois, elle explique simplement, presque nonchalamment, qu’elle ne pouvait lui communiquer ce qu’elle allait faire, parce qu’elle ne sait jamais à l’avance ce qu’elle va faire. Elle est visiblement un esprit libre, contrairement à l’homme. Celui-ci réalise tout de même que « [c]ette fille [est] spéciale. Il ne la connaissait pas encore très bien, mais il se sentait tout près d’elle et il la sentait tout près de lui[35] ».
Une semaine passe, pendant laquelle l’homme s’occupe des préparatifs de son voyage tout en se demandant si la jeune fille l’accompagnera. Il constate qu’elle ne parle pas beaucoup, mais qu’elle lit de façon vorace ; d’ailleurs, elle navigue déjà mieux que lui parmi les livres de sa bibliothèque. Lorsqu’elle évoque son futur voyage, il a l’impression qu’elle en sait bien plus que ce qu’elle en dit. Finalement, ils partent ensemble pour Saint Louis, dans le Missouri, après quoi ils suivent la piste de l’Oregon jusqu’à San Francisco.
Il ressort de tout cela le portrait d’une jeune fille autodidacte dotée de beaucoup de mémoire, intuitive, observatrice, perspicace, autonome et peu loquace. Sûre d’elle, elle maîtrise très vite les détails et nuances de n’importe quelle nouvelle situation. Tandis que son nom, Pitsémine, est une francisation du terme montagnais ou innu « Pitshemin », qui signifie « sauterelle », son surnom, la Grande Sauterelle, rend hommage à l’un de ses traits physiques les plus frappants et, pour différents personnages masculins, les plus séduisants : ses longues jambes. La première fois que Jack Waterman la remarque, avant de la prendre en stop, c’est dans un terrain de camping : « [I]l vit une grande fille maigre qui était vêtue d’une robe de nuit blanche et marchait pieds nus dans l’herbe […]. Les cheveux de la fille étaient noirs comme du charbon et nattés en une longue tresse qui lui descendait au milieu du cou. » (VB, 9) Ses autres traits, dont son visage osseux, son teint foncé et ses yeux très noirs et légèrement bridés (VB, 11), paraissent confirmer son autochtonie, mais étant de mère montagnaise et de père blanc, elle dit ne pas être « une vraie Indienne » (VB, 29, 58, 223), mais une Métisse (VB, 29) — écrit avec une majuscule. Elle est née dans une roulotte à La Romaine[36], sur la Côte-Nord ; son père était camionneur sur la Côte-Nord et à la Baie-James, et sa mère est femme de ménage au musée de Gaspé.
« INDIENS PAS FRILEUX », PRINCESSE OU EXTRATERRESTRE ?
Lorsque, au cours de leur premier soir sur la route, la Grande Sauterelle se plaint du froid, Jack s’étonne : « — Je pensais que les Indiens n’avaient jamais froid… » (VB, 58), dit-il, et elle de lui rappeler aussitôt qu’elle avait dit ne pas être une vraie Indienne. Il s’excuse, mais en installant les sacs de couchage, il fait « comme si sa mission était de préparer le lit de nulle autre que la princesse Kateri Tekakouitha » (VB, 59). Tel que le souligne Acoose, les représentations stéréotypées de la femme autochtone privilégient cette figure de la princesse, prolongement du « Bon Sauvage », et celle de la squaw dévergondée (I, 39). Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, la femme y est finalement privée de son humanité. Chez Poulin, toutefois, la référence est riche de connotations.
La « princesse » Kateri Tekakouitha était une jeune Agnière (1656-1680) convertie au christianisme, qui a été déclarée « vénérable » en 1943 et béatifiée en 1980. Si sa légende valorise sa perfection chrétienne[37], il s’agit surtout d’une narration où, contrairement aux récits hagiographiques de la Nouvelle-France qui attribuaient à l’Autochtone le rôle secondaire de figure d’altérité, pour le missionnaire, Tekakouitha est transformée en héroïne. Par ailleurs, cette dernière représente à tout le moins deux sortes de métissage : primo, dans la mesure où ses parents étaient membres de deux tribus traditionnellement ennemies — sa mère était algonquine et son père, agnier (mohawk) — ; et secundo, au sens où son image comme « sainte Sauvagesse[38] » change selon les époques : dans un portrait datant d’environ 1680, fait par Chauchetière, son directeur spirituel, elle porte des habits autochtones et le voile chrétien, mais elle a le teint plutôt clair[39] ; une gravure datant du xviiie siècle, de Jean-Baptiste Scotin, est clairement inspirée du tableau de Chauchetière, mais lui attribue un teint plus foncé ; d’autres images datant de la première moitié du xxe siècle la représentent le teint clair, mais le voile y cède la place à des tresses[40], tandis que le discours clérical au Québec fait abstraction de son caractère autochtone ; pendant la seconde moitié du même siècle et depuis lors, son indianité est presque toujours mise de l’avant.
Qui plus est, lorsque le personnage central de Faites de beaux rêves[41], une femme « mère poule » nommée Limoilou, qu’on appelle souvent « Lili[42] », raconte la légende de l’Amérique, elle l’inscrit dans « une sorte de show historique, une grande […] fresque historique » (FBR, 108). Elle s’appelle alors Kateri et porte une « longue robe blanche […], un bandeau de cuir sur le front et ses cheveux noirs [sont] tressés en deux longues nattes qui descend[ent] sur sa poitrine » (FBR, 109). Le récit qu’elle fait est celui de la genèse de l’Amérique du Nord du point de vue autochtone : le Grand Esprit du Monde Céleste envoie son épouse, la Femme Céleste, peupler le Monde d’En Bas. Plus tard dans la soirée, en conversation avec Amadou (commis aux écritures qui serait un avatar de Jack Waterman), Limoilou jette un doute sur son identité. Tandis que les autres personnages croyaient que le rôle de conteuse lui revenait parce qu’elle « savait par coeur trente des cent quarante-trois Histoires, contes et récits de l’Encyclopédie de la Jeunesse » (FBR, 7), elle déclare que la « légende » qu’elle a racontée est « une vieille légende » connue de « tous les Iroquois » (FBR, 116). Ensuite, elle établit un lien entre ses origines ancestrales et celles de Kateri et, après avoir laissé entendre que Limoilou n’est pas son vrai nom, elle insiste pour qu’Amadou dise, au lieu de « l’éternel », « le Grand Esprit » (FBR, 117). En acceptant de continuer le jeu, Amadou lui permet de s’approprier un autre détail de la biographie de Kateri (FBR, 118), mais après avoir dit qu’elle ne veut pas froisser « sa » robe parce qu’« elle est à Jane », elle déclare ensuite qu’elle « ne joue pas vraiment ». « Fais semblant que tu joues pour vrai », réplique alors Amadou (FBR, 120).
Toute cette ambivalence identitaire vient donc investir le personnage de la Grande Sauterelle. Tandis que la traversée du continent oblige Jack à reconnaître que si la présence française a marqué l’espace, ce ne fut pas toujours de façon héroïque, et que de cette présence, il ne reste que des traces — « le “Grand Rêve de l’Amérique” s’était brisé en miettes » (VB, 101) —, pour la Grande Sauterelle, le voyage rappelle avant tout la violence que les Blancs ont pratiquée contre le bison et les « Indiens ». La légende de l’Amérique racontée par Limoilou/Kateri n’y est évoquée que sous la forme de la carte géographique « d’une Amérique du Nord avant l’arrivée des Blancs » que Jack et la Grande Sauterelle consultent au musée de Gaspé — celle-ci, avec des yeux « brillants et humides » —, et ce, seulement après qu’ils se sont attardés « en particulier [sur] une très grande et très belle carte géographique de l’Amérique du Nord où l’on pouvait voir l’immense territoire qui appartenait à la France au milieu du 18e siècle » (VB, 20 ; je souligne).
En plus de tout cela, la Grande Sauterelle ne revêt guère le caractère d’une « princesse ». Au contraire, son expertise en mécanique, ses savoirs dans le domaine de l’histoire amérindienne et des coutumes tribales, son mépris pour certains règlements et certaines lois, sa grande souplesse et son adaptabilité, son côté fonceur, son sens infaillible de l’orientation, bref, autant d’attitudes, d’aptitudes et de traits de caractère que d’aucuns ont tendance à associer aux hommes, font d’elle une compagne de route idéale pour l’homme qu’est Jack. À force de la fréquenter, d’être épaté par ses multiples et étonnants talents et de discuter avec elle, il se sensibilise au point de vue autochtone à l’égard de nombreuses questions. Résultat : son discours et sa vision du monde eurocentriques s’en trouvent considérablement renouvelés — métissés, dirait-on.
Quant à la Métisse elle-même, au début du périple, elle exprime son désespoir en confiant à Jack qu’elle sera pour toujours « partagée entre » ses deux moi. Elle trouve, par exemple, « que la nature est plus belle quand il n’y a rien », mais aime aussi les lumières (VB, 57). Au stade où elle en est, sa double nature est une contradiction intolérable et angoissante, non pas une plus-value.
Vers la fin de leur voyage — et du récit : il s’agit du 24e des 33 chapitres —, la Métisse réitère tristement qu’elle n’est « même pas une vraie Indienne… […] ni une Indienne ni une Blanche, [mais] quelque chose entre les deux », donc, « […] finalement, […] rien du tout » (VB, 223-224). Jack réplique qu’il n’est pas du tout de cet avis : « Je trouve que vous êtes quelque chose de neuf, quelque chose qui commence. Vous êtes quelque chose qui ne s’est encore jamais vu. » (VB, 224) Or cette nuit-là, il rêve que la Grande Sauterelle est une extraterrestre. La signification de cette séquence s’éclaire grâce aux concepts associés aux « pensées métisses » élaborées par l’écrivain antillais Édouard Glissant dans les années 1990.
À l’ère du « bouleversement perpétuel où les civilisations s’entrecroisent, des pans entiers de culture basculent et s’entremêlent[43] » selon Glissant, qui avance que, face à l’impossibilité de diriger le moment d’avant pour atteindre le moment d’après, seules des pensées métisses, des pensées ouvertes, incertaines de leur puissance, des pensées du tremblement où jouent la peur, l’irrésolu, la crainte, le doute, l’ambiguïté, permettent de saisir le « chaos-monde » ou le « tout-monde ». Or en valorisant les métissages non pas « simples », mais qui produisent de façon continue de l’inédit et de l’imprévisible, Glissant dit l’impossibilité, même pour les anciens colonisés qui tentent de se raccrocher à leur passé ou à leur ethnie, de prétendre à une identité fixe, bien définie, pure. Dans sa perspective, la mise en mouvement des cultures et, conséquemment, les chocs de cultures et leurs corollaires, la disharmonie, le désordre et l’interférence, deviennent créateurs. Glissant souligne ainsi que si cela nous remplit de craintes de remettre en cause l’unité de notre identité, une identité refermée sur elle-même, associée à une langue, à une nation, à une religion, parfois à une ethnie, race, tribu, clan, bref à une entité bien définie, nous nous devons pourtant de construire une personnalité instable, mouvante, créatrice, fragile, au carrefour de soi et des autres : une identité-relation.
Au terme de leur voyage ensemble, Jack, initié à la pensée métisse, retourne à Québec, tandis que la Grande Sauterelle décide de rester à San Francisco où elle aura l’occasion de développer davantage le sens relationnel de son identité.
VINGT-SEPT ANS PLUS TARD…
L’exergue du roman que Poulin fait paraître vingt-sept ans plus tard soulève la question de l’appropriation identitaire : « Tous les Métis sont nos frères,//et nous sommes tous des Métis[44]. » Au regard du propos tenu dans cet article, il n’est pas innocent que le romancier attribue cette déclaration à un auteur « inconnu », et j’aime à penser qu’en la choisissant, il voulait dire que sur le plan culturel, « nous sommes tous métissés ». Le narrateur du roman affirme justement ceci dans l’antépénultième chapitre : « Comme tout le monde, je n’ignorais pas que les descendants des Français, presque aussi métissés que le gardien Isidore, étaient maintenant regroupés, pour la plupart, dans un recoin de l’Amérique. Un îlot francophone dans un océan d’anglophones. » (HS, 110)
Dans L’homme de la Saskatchewan, Jack s’était engagé à écrire l’autobiographie d’un hockeyeur nommé Isidore Dumont, le petit-neveu de Gabriel Dumont, qui identifie son grand-oncle comme « le fameux Métis qui était le commandant militaire de la rébellion menée par Louis Riel en 1885 » (HS, 22 ; l’auteur souligne), mais il délègue le projet à son frère cadet, Francis, et lui demande de n’en parler à personne. Puisque celui-ci est lecteur professionnel, sa mission exige qu’il apprenne l’art d’écrire, et ce, tout en se familiarisant avec la culture et le caractère de la personne dont il devra traduire l’histoire sur la page, en écrivant à la première personne. Francis ne peut guère compter sur l’appui de Jack qui, lui, voudrait pouvoir s’occuper uniquement de son nouveau projet d’écriture. Les cassettes des entrevues entre Jack et le jeune Franco-Métis lui seront utiles, mais pour assurer la crédibilité de son « je » fictif, il lui faut un contact plus intime, plus complet. C’est ainsi que, pour reprendre l’analogie de Poulin[45], tel le cowboy solitaire du western Shane[46], qui arrive à cheval et s’installe chez un petit fermier qu’il protège contre les grands propriétaires terriens perpétuant la loi du fusil du Far West, la Grande Sauterelle arrive à bord du vieux Volks et campe dans le stationnement en face de l’immeuble où Jack et Francis ont chacun un appartement. Pendant son séjour à Québec, elle aidera les frères à déjouer les tactiques du puissant commissaire anglophone de la Ligue nationale de hockey et de son homme de main pendant l’écriture de l’autobiographie du hockeyeur.
Cette image en dit long sur les intentions de l’auteur vis-à-vis de la représentation de l’autre métis. Femme à la fois cowboy et « Indienne », le portrait de la Métisse correspond toujours peu à celui de la femme autochtone stéréotypée. Qui plus est, depuis le dénouement du roman de 1984, elle a séjourné dans la ville cosmopolite de San Francisco[47] ainsi que dans la communauté métisse de Batoche, en Saskatchewan.
IDENTITÉS EN MOUVANCE
La Grande Sauterelle arrive aux côtés de Francis effectivement munie de photos, documents et récits, bref, de savoirs à proprement dits métis. Comme Francis tombe amoureux d’elle[48], ces savoirs acquièrent une valeur affective et revêtent un caractère particulièrement immédiat et poignant pour lui ; en témoigne son commentaire concernant le récit de la chasse au bison dans les plaines de l’Ouest canadien : « Cette fille était une Métisse de l’Est ; le sang indien qui coulait dans ses veines était celui des Montagnais de la Côte-Nord, et pourtant, rien qu’à l’écouter, j’imaginais facilement le long cortège des charrettes bâchées qui s’éloignaient de la rivière Rouge ou de la Saskatchewan-Sud […]. » Le récit de la Grande Sauterelle terminé, Francis constate qu’il en a la « tête […] pleine de bruits et de mouvements et même d’odeurs » (HS, 29-30). Il en ressort que, toujours une efficace conteuse, la Grande Sauterelle ne se contente plus de partager des bribes de l’histoire de différentes Premières Nations, mais relate des récits complets concernant les pratiques culturelles et les moments historiques clés d’une communauté de Métis sûrs de leur identité.
Sur les plans caractériel et physique, la Grande Sauterelle a peu changé depuis Volkswagen Blues. Vers le début de leurs fréquentations, Francis note que « [c]’était une fille indépendante, [qui] n’en faisait qu’à sa tête, ne respectait aucune règle, n’avait pas d’horaire ; il lui arrivait souvent de vivre la nuit » (HS, 38). Sur le plan physique, ses traits les plus frappants sont toujours les « jambes interminables et d’une maigreur extrême, […] le visage osseux, le teint foncé [et l]es yeux noirs et légèrement bridés » (HS, 18) que Francis remarque lors de leur première rencontre. Très rapidement, cependant, le regard amoureux du jeune homme lui permet d’apercevoir des nuances qui transformeront quelque peu la figure de la Métisse.
Le temps d’une courte conversation, le frère cadet de Jack remarque que « [p]ersonne n’avait des yeux aussi noirs qu’elle, […] sauf peut-être [s]a mère » (HS, 21). Quelques rencontres plus tard, de Métisse, elle devient « la belle Métisse » (HS, 66). Ensuite, lorsque Francis observe les hommes qui la regardent jouer au billard au bar St. Matthews, elle sort du moule de personnage androgyne pour devenir la femme fatale qui inspire les « sifflements d’admiration » émis par ceux qui, l’air ébahi, apprécient le spectacle qu’elle leur offre : « [A]u lieu d’utiliser le râteau pour atteindre la [bille] blanche, elle se courbait au-dessus du tapis et allongeait une jambe sur la table, ce qui faisait retrousser son short déjà très court. » (HS, 68) Nullement « victime » du regard masculin, ni « princesse indienne » ni « squaw dévergondée », la Grande Sauterelle se comporte en femme autonome qui n’hésite pas à tirer avantage de ses atouts[49]. Du reste, bien qu’elle ait appris l’art du billard auprès de son père allochtone, son talent pour le jeu l’associe à Gabriel Dumont, dont l’une des possessions emblématiques était une table de billard. Plus tard, pendant qu’elle parle à Francis du rôle des mères métisses de la région du Manitoba, celui-ci note de minuscules changements : « On aurait juré que ses pommettes anguleuses s’étaient arrondies. Ses yeux noirs comme le poêle avaient pris des nuances plus claires. Sa chevelure, qu’elle avait dénouée avant la douche, faisait maintenant penser à un châle enveloppant ses épaules. » (HS, 79) Aussi, vingt-sept ans après que Jack a affirmé que la Métisse était « quelque chose de neuf », le petit frère de Jack constate qu’en discutant avec elle, « il se passait quelque chose de neuf dans [s]on coeur. […] C’était un sentiment neuf, ou presque » (HS, 80). Force est de conclure qu’en fréquentant la Métisse, le Québécois acquiert de nouvelles dimensions et connaissances qui lui permettent de s’épanouir personnellement et, par conséquent, de mieux simuler par écrit le « je » du gardien de but. En même temps, sa découverte de différents aspects de la Métisse révèle une femme dont les particularités séduisantes incluent les traits de sa métissité, sans pour autant s’y limiter.
L’enregistrement des entrevues entre Isidore Dumont et Jack accomplit un objectif similaire. En les écoutant, Francis apprend la « petite histoire » derrière la rébellion des Métis, dont notamment le courage d’un Joseph Ouellette qui, âgé de quatre-vingt-treize ans, s’est battu jusqu’au bout : son exemple a profondément ému tous les Métis, y compris ceux qui n’avaient pas soutenu la rébellion. De plus et peut-être avant tout, l’écoute des entrevues expose le frère cadet aux attitudes, à la vigueur et à la passion du jeune Métis.
Or non seulement celui-ci parle-t-il davantage de son grand-oncle que de lui-même ou du hockey, en outre et surtout, il s’indigne de l’anglicisation du sport et lutte contre l’assimilation des francophones. À l’instar de Gabriel Dumont et des siens qui avaient mené une guérilla afin de conserver leurs droits territoriaux et linguistiques[50], Isidore Dumont milite pour qu’à Montréal, l’univers du sport soit aussi français[51] qu’il est anglais à Toronto. La Ligue nationale ne saurait tolérer la diffusion de telles idées subversives et, par conséquent, sans savoir que c’est Francis qui est en train d’écrire la « fausse autobiographie » du gardien de but franco-métis, son commissaire envoie un homme de main espionner Jack. Les frères le surnomment Mad Dog, surnom d’un personnage célèbre de la lutte professionnelle au Québec, renommé pour son comportement et son apparence de « chien enragé ». Les proches de Jack, qui font toujours leur possible pour lui faciliter la vie, se soucient de sa sécurité et restent aux aguets.
Parmi ces proches se trouvent, en plus de Francis, la Petite Soeur, Marine, la traductrice de Jack et, depuis La traduction est une histoire d’amour[52], un avatar de Limoilou/Kateri de Faites de beaux rêves. Il s’agit de « la petite Limoilou », une jeune fille de dix-sept ans aux cheveux blonds qui porte les cicatrices d’un suicide raté. Devenue la protégée de Marine, Limoilou fait des efforts pour « réapprendre à vivre » (HS, 35) et est désormais intégrée à la petite bande à laquelle Francis se réfère par le vocable « les filles ». Quant à deux des traits essentiels de Limoilou/Kateri, son caractère de mère poule et sa spiritualité, ils font maintenant partie, le premier, du discours mnémonique de la Grande Sauterelle et, le second, de ses croyances (HS, chapitre 15 : « Les anges gardiens »). La lecture croisée des romans où figurent l’une ou l’autre Limoilou ou la Grande Sauterelle permet de déceler le thème de la résilience, leitmotiv on ne peut plus important dans les discours identitaires concernant les Autochtones du Canada.
Après que, craignant le pire, Mad Dog et son employeur eurent enlevé Jack et confisqué son ordinateur, mais sans y trouver le manuscrit, ils poursuivent leur quête chez Jack, où la Grande Sauterelle et Francis les attendent — car la Métisse avait décidé dès la disparition de Jack qu’il leur faudrait monter la garde chez lui pendant que « tout le monde », c’est-à-dire « les filles », cherchait les ravisseurs et leur victime dans les « endroits louches du Faubourg » (HS, 101).
Pendant que le commissaire cherche le manuscrit, le comportement des deux frères provoque la colère de Mad Dog, qui profère alors des menaces. C’est la Grande Sauterelle qui, en montrant qu’elle porte une arme, réussit à calmer la situation. Après l’arrivée à l’appartement des « filles », c’est la Petite Soeur qui prend en main la sécurité des siens[53] (HS, 108). Dès lors, les menaces cèdent la place à une invitation au dialogue. En réponse à celle-ci, Francis invente le contenu d’un faux manuscrit afin de protéger le contenu subversif du vrai manuscrit de la fausse autobiographie, puis, de fil en aiguille, il expose de façon convaincante la perspective du gardien de but franco-métis.
La rencontre se solde par la reconnaissance de la légitimité des griefs d’Isidore Dumont/Francis : le commissaire convient que, dès lors, « à Montréal, l’hymne national sera chanté en français d’un bout à l’autre » (HS, 109). Pour avoir réussi à se mettre « dans la peau du hockeyeur » (HS, 96), le frère cadet acquiert de l’agentivité, s’affirme et finit par fonctionner efficacement dans le monde contemporain. La publication du vrai manuscrit provoquera un tollé, mais l’essentiel est que la prétendue autobiographie marque le passage du refoulement des frustrations du francophone minoritaire à leur expression positive et créative. En outre, Francis a des relations sexuelles avec la Grande Sauterelle, la femme qu’il aime plus que tout au monde. Il s’agit là d’une chose rarissime chez un héros poulinien. « J’étais heureux, parfaitement heureux pour la première fois de ma vie » (HS, 116), avoue celui qui se met à croire en l’existence d’un paradis pour les petits frères (HS, 117).
Le rôle attribué à Isidore Dumont dans L’homme de la Saskatchewan rappelle ce qu’Albert Braz[54] a affirmé au sujet de la majorité des Québécois qui, depuis le xixe siècle, ont écrit sur Louis Riel, à savoir que celui-ci n’est jamais le véritable objet de l’ouvrage, mais un prétexte servant à exprimer le mécontentement des habitants du Québec. Il semblerait que le lieutenant de Riel, quant à lui, serve aussi à inspirer des élans audacieux. Chez Poulin, la voix et les paroles du petit-neveu de Gabriel Dumont ont un effet « virilisant » sur le narrateur qui, peu à peu, réussit à dompter ses doutes et ses craintes « de petit frère » et à passer à l’action, mais sans pour autant devenir moins sensible envers autrui. Ce faisant, d’écrivain apprenti, il devient écrivain accompli et réussit ainsi à poser le geste subversif que constitue la diffusion d’idées militantes concernant les droits linguistiques de la minorité franco-canadienne. Pour le Québécois, l’expérience consistant à s’exposer au jeune Métis dont il finit par assimiler des traits et des points de vue ne l’indianise pas, mais met en mouvement la personne qu’il avait été. Francis ne s’approprie pas la culture de celui dont il écrit l’autobiographie, mais en développant une compréhension intellectuelle et affective de cette culture, il crée des liens avec elle, sans pour autant en abolir les différences.
Quant à la Grande Sauterelle, entre le moment où elle a déposé Jack à l’aéroport de San Francisco et son retour sur la scène vingt-sept ans plus tard, elle a développé une pensée non dualiste afin de vivre sa complexité culturelle et identitaire. À l’époque de la traversée du continent avec Jack, étant « très jeune », elle ne savait pas si elle était « Blanche ou Indienne », et se demandait même parfois si elle était une fille ou un garçon (HS, 92) ; elle en est maintenant venue à accepter qu’elle est à la fois Blanche et Indienne, et qu’elle est bien une fille, mais une fille dotée d’attitudes, d’aptitudes et de comportements traditionnellement associés aux garçons. Or il ne s’agit pas d’une fusion, mais d’un métissage de l’entre-deux. Pitsémine/la Grande Sauterelle a appris à user de sa différence comme d’une arme à double tranchant : d’un côté, en relâchant les liens aux origines, sinon en s’y arrachant, qu’il s’agisse de « l’ »autochtonie, « du » blanchissement, de « la » québécité ou bien de « la » féminitude et, de l’autre, en se servant de son écart pour rester libre par rapport aux modèles de participation au monde articulés, fixes ou stables. Dès lors, elle ne cesse d’acquérir de nouveaux savoirs, c’est-à-dire de différer d’elle-même. C’est ce qui lui permet d’éviter de perdre son caractère et ses pratiques « sauvages » — au sens de créatrices, inédites —, lesquels constituent la part la plus substantielle d’elle-même[55]. Métisse inscrite sous le signe de la pensée métisse au sens de Glissant, soit toujours en transition, en devenir, elle ne saurait rester aux côtés de Francis, qui sent qu’elle l’aime presque autant qu’il l’aime. L’expérience métisse, apprend-il à la fin du roman, « [u]ne graine dans l’oeil ou quelque chose du genre » (HS, 121), ne saurait consister à garder, mais plutôt à connaître ce qui se dérobe.
Parties annexes
Note biographique
PAMELA V. SING est professeure émérite depuis juillet 2019, de la Faculté Saint-Jean, campus francophone de l’Université de l’Alberta, et a signé jusqu’ici plus de 75 textes, dont la majorité porte sur les littératures franco-canadiennes ou québécoise. Ses publications parues en 2019 sont Marguerite-A. Primeau, première femme de lettres du Far Ouest canadien, collectif qu’elle a codirigé avec Jimmy Thibeault (Université de Sainte-Anne), et la préface aux Mangeurs de pemmican, la traduction française de The Pemmican Eaters de la poète métisse primée Marilyn Dumont. En 2018, Sing a publié, entre autres, « Écrire un passé “altéritaire” : éléments du discours alimentaire dans Le Pavillon des miroirs de Sergio Kokis » et « Pionnier/pionnière cherche Sauvagesse/Sauvage pour rencontre amoureuse dans l’Ouest : quelques exils, asiles et suites ».
Notes
-
[1]
Edward Saïd, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978, p. 272.
-
[2]
Olive Patricia Dickason, « From “One Nation” in the Northeast to “New Nation” in the Northwest: A Look at the Emergence of the Métis », Jacqueline Peterson and Jennifer S. H. Brown (dir.), The New Peoples: Being and Becoming Métis in North America, Winnipeg, University of Manitoba Press, coll. « Manitoba Studies in Native History », 1985, p. 19-36.
-
[3]
Donald Bruce Sealey et Antoine S. Lussier, The Métis: Canada’s Forgotten People, Winnipeg, Manitoba Métis Federation Press, 1975, 200 p.
-
[4]
Maria Campbell, Halfbreed, Toronto, McClelland and Stewart, 1973, p. 8.
-
[5]
Voir Hartmut Lutz, « Emma LaRocque », Contemporary Challenges. Conversations with Canadian Native Authors, Saskatoon, Fifth House Publishers, 1991, p. 181 ; et Janice Acoose (Misko-Kìsikàwihkwè [Red Sky Woman]), Iskwewak. Kah’ Ki Yaw Ni Wahkomakanak. Neither Indian Princesses nor Easy Squaws, Toronto, Women’s Press, 1995, p. 32. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle I suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[6]
Stéphane Dandeneau, Pauline Turenne, Christiane Perreault, Laura Penner et Laurence Kirmayer, « Un Métchif, c’est jamais pris » (Aîné). Résumé du projet : Récits de résilience des Métis francophones du Manitoba, Montréal, Réseau de recherche en santé mentale chez les Autochtones, 2013 [2012], 132 p.
-
[7]
La parution en 2015 du 14e roman de Jacques Poulin, Un jukebox dans la tête, a amené l’auteur d’une chronique littéraire à évoquer l’image « d’une vieille tante qu’on aime bien, accueillante et chaleureuse, [mais dont la] fidélité touchante au passé et à l’identique [suscite] la lassitude, la déception, l’ennui ». Il citait comme preuve le fait que, contrairement aux romans publiés entre 1978 et 1993 — à savoir Les grandes marées, Volkswagen Blues, Le vieux Chagrin, La tournée d’automne, auxquels s’ajouterait L’anglais n’est pas une langue magique (2009) —, les derniers romans pouliniens présentent les « mêmes ingrédients ». Reprochant au romancier de ressasser de plus en plus « ses propres clichés », le chroniqueur concluait son texte en opinant que la « “petite musique” bien reconnaissable, avec ses notes de mélancolie et de minimalisme, ses variations sur les mêmes thèmes et les mêmes motifs […], est d’une tristesse infinie ». Christian Desmeules, « Petite musique en boucle », Le Devoir, 7 février 2015, en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/431037/petite-musique-en-boucle (page consultée le 8 novembre 2019).
-
[8]
Lise Gauvin, « Une voix discrète », Le Devoir, 29 avril 1978, p. 33.
-
[9]
Ginette Michaud, « Jacques Poulin : petit éloge de la lecture ralentie », François Gallays, Sylvain Simard et Robert Vigneault (dir.), Le roman contemporain au Québec (1960-1985), Montréal, Fides/Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa, coll. « Archives des lettres canadiennes », 1992, p. 367.
-
[10]
Régis Tremblay, « Jacques Poulin : le fantôme de l’écrivain », Le Soleil, 1er octobre 2011, en ligne : https://www.lesoleil.com/archives/jacques-poulin-lefantome-delecrivain-4624d293069cb080a18eb05a43e389a6 (page consultée le 8 novembre 2019).
-
[11]
Pour ce qui est de la nation métisse historique de la Rivière-Rouge, Auguste-Henri Trémaudan, avocat, journaliste et homme de lettres, a expliqué que, « [a]u début du dix-neuvième siècle, la nation métisse, alors dans son épanouissement, comprenait deux groupes assez distincts, les Métis français ou Bois-Brûlés, dont la langue paternelle était le français, et les Métis anglais dont la langue paternelle était l’anglais. Mais comme les Bois-Brûlés étaient de beaucoup les plus nombreux, et généralement les plus développés, c’est chez eux surtout qu’il faut chercher le respect des traditions ancestrales et les traits les plus caractéristiques pour esquisser un tableau des moeurs et de la mentalité de la nation métisse ». Auguste-Henri de Trémaudan, Histoire de la nation métisse dans l’Ouest canadien, Montréal, Éditions Albert Lévesque, coll. « Documents historiques », 1935, p. 47.
-
[12]
« J’emploie “Métis” pour me référer à l’histoire, aux événements, aux chefs et aux territoires, à la langue et à la culture associés au développement des Métis chasseurs de bison et négociants des Plaines du nord, en particulier pendant la période allant des commencements des brigades constituées pour effectuer les chasses au bison au début du xixe siècle jusqu’à l’Insurrection du Nord-Ouest de 1885. » Je traduis. L’original se lit ainsi : « I use “Métis” to refer to the history, events, leaders, territories, language, and culture associated with the growth of the buffalo hunting and trading Métis of the northern Plains, in particular during the period between the beginning of the Métis buffalo brigades in the early nineteenth century and the 1885 North West Uprising. » Voir Chris Andersen, « Métis ». Race, Recognition, and the Struggle for Indigenous Peoplehood, Vancouver, UBC Press, 2014, p. 24.
-
[13]
Voir, entre autres, Denis Gagnon et Hélène Giguère (dir.), L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Anthropologie/Ethnologie », 2012, 346 p. ; Denis Gagnon, « Les “autres” Métis », L’Encyclopédie canadienne/Historica Canada, 21 juin 2016, en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-autres-metis (page consultée le 8 novembre 2019).
-
[14]
Ce jugement stipule que « [l]e mot “Métis” […] vise les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes, façons de vivre et identité collective reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuit d’une part et de leurs ancêtres européens d’autre part. Les communautés métisses ont vu le jour et se sont épanouies avant que les Européens ne consolident leur emprise sur le territoire et que l’influence des colons et des institutions politiques du vieux continent ne devienne prédominante ». (R. c. Powley [2003] 2 R.C.S. 207 : paragr. 10).
-
[15]
Statistique Canada, Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016, en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025a-fra.htm (page consultée le 8 novembre 2019).
-
[16]
Denys Delâge, Le pays renversé. Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est, 1600-1664, Montréal, Boréal express, 1984, 416 p.
-
[17]
Une perspective similaire s’exprime dans A Fair Country : Telling Truths about Canada (2009), essai traduit en français sous le titre Mon pays métis. Quelques vérités au sujet du Canada, et dont l’auteur John Ralston Saul soutient que les Canadiens forment une société métisse construite sur les principes amérindiens de paix, de justice et de bon gouvernement. Il est pertinent que dans son poème « To a Fair Country », la poète métisse Marilyn Dumont détaille les nombreux aspects injustes du système de certificats mis au point par le gouvernement canadien dans le but d’éteindre les droits territoriaux des Métis, autant d’aspects qu’elle voudrait oublier. Voir Marilyn Dumont, The Pemmican Eaters, Toronto, ECW Press, 2015, p. 52-53.
-
[18]
Denys Delâge, « La peur de “passer pour des Sauvages” », Les Cahiers des dix, no 65, 2011, p. 1-45, en ligne : https://doi.org/10.7202/1007771ar (page consultée le 8 novembre 2019) ; je souligne. Reprises sous la forme d’une conférence présentée dans le cadre des Conférences Gérard-Parizeau le 27 novembre 2013, que Delâge prononçait en tant que 13e lauréat du prix Gérard-Parizeau, les prémisses de l’étude ont sans doute eu un plus vaste écho auprès du public québécois qu’en 2011.
-
[19]
Carole Poliquin et Yvan Dubuc (réalisateurs), L’empreinte. Un voyage au coeur de notre identité, Les productions ISCA, 2015, 88 minutes.
-
[20]
Jacques Ferron, Le ciel de Québec, Montréal, Éditions du Jour, coll. « Les romanciers du jour », 1969, 403 p.
-
[21]
Robert Lalonde, Le dernier été des Indiens, Paris, Éditions du Seuil, 1982, 157 p. Le narrateur autodiégétique est le petit-fils d’un couple exogame — la grand-mère était une « belle sauvagesse » ; aussi, bien qu’il ait le sentiment de « naître » auprès de son amoureux, Kanak l’Indien, il s’agit d’un personnage métissé, non pas d’un Métis. J’en fais mention principalement à cause de la façon dont le personnage s’identifie dans un roman antérieur. Voir la note 27 du présent article.
-
[22]
Robert Lalonde, Le diable en personne, Paris, Éditions du Seuil, 1989, 185 p.
-
[23]
Robert Lalonde, Sept lacs plus au nord, Paris, Éditions du Seuil, 1993, 156 p. Le protagoniste de ce roman, Michel, qui est celui du Dernier été des Indiens, 37 ans plus tard, s’identifie deux fois comme « demi-métis », et une fois comme « quart-de-sang sauvage » (p. 47, 64 ; 122).
-
[24]
Virginia Pésémapéo Bordeleau, Ourse bleue, Lachine, Pleine lune, coll. « Plume », 2007, 199 p.
-
[25]
Virginia Pésémapéo Bordeleau, L’amant du lac, Montréal, Mémoire d’encrier, coll. « Roman », 2013, 141 p.
-
[26]
Michel Noël, Le Métis amoureux, Québec, Cormac, 1993, 94 p.
-
[27]
Michel Noël, Pien, Waterloo, Éditions Michel Quintin, coll. « Grande nature », 1996, 195 p. ; republié sous le titre Métis, Montréal, Bayard Canada livres, coll. « Crypto », 2019, 251 p.
-
[28]
François Lapierre, Sagah-Nah, t. I : Celui qui parle aux fantômes, Toulon, Soleil, 2002, 46 p.
-
[29]
François Lapierre, Sagah-Nah, t. II : Confrérie des tueurs de monstres, Toulon, Soleil, 2004, 48 p.
-
[30]
Récité par Chloé Sainte-Marie à Montréal en 2001 au festival Présence autochtone, ce poème a paru dans Maurizio Gatti, Littérature amérindienne du Québec : écrits de langue française, préface de Robert Lalonde, Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Cahiers du Québec. Littérature », 2004, p. 115-118.
-
[31]
Marilyn Dumont, Une vraie bonne petite Métisse, traduit de l’anglais par Sylvie Nicolas, Wendake, Éditions Hannenorak, 2015, 75 p.
-
[32]
Marilyn Dumont, A Really Good Brown Girl, London (Ontario), Brick Books, 1996, 77 p.
-
[33]
Katherena Vermette, Ligne brisée, traduit de l’anglais par Mélissa Verreault, Montréal, Québec/Amérique, coll. « Latitudes », 2017, 446 p.
-
[34]
Katherena Vermette, The Break, Toronto, House of Anansi Press, 2016, 352 p.
-
[35]
Jacques Poulin, Volkswagen Blues, Montréal, Québec/Amérique, coll. « Littérature d’Amérique », 1984, p. 38. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle VB suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[36]
En langue innu-aimun : « Unamenshipit » ; Wikipédia indique qu’il s’agit d’une réserve « Première Nation » appartenant à la tribu innue des Unamen Shipu. Selon le site Web https://www.unamenshipu.com/historique (page consultée le 8 novembre 2019), les Innus de la Basse-Côte-Nord étaient l’un des derniers groupes autochtones nomades en Amérique du Nord, reconnus pour la fabrication de canoës en bouleau et de raquettes, ainsi que pour leurs voyages traditionnels en canoës ou en raquettes. La réserve nommée Unamen Shipu a été créée le 31 mars 1956.
-
[37]
Comme le souligne Patrick Coleman, l’extériorité inviolable de Kateri Tekakouitha fait qu’elle peut être l’objet de force fantasmes sexuels pervertis dans Beautiful Losers de Leonard Cohen sans que cela affecte son image parfaite. Voir Patrick Coleman, Equivocal City : French and English Novels of Postwar Montreal, Montréal/Kingston/London/Chicago, McGill-Queen’s University Press, 2018, p. 305.
-
[38]
Claude Chauchetière, La vie de la bienheureuse Catherine Tegakoüita, dite à présent la sainte Sauvagesse, Manate (New York), Presse Cramoisy de Jean-Marie Shea, 1887, 179 p.
-
[39]
Le tableau, qui est peut-être la première représentation iconographique jamais faite du personnage, est affiché dans l’église de la mission jésuite à Kahnawake.
-
[40]
L’un des vitraux du sanctuaire de la basilique Notre-Dame de Montréal en témoigne.
-
[41]
Jacques Poulin, Faites de beaux rêves, Montréal, L’Actuelle, 1974, 163 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle FBR suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[42]
Kateri Tekakouitha était connue sous le vocable du « Lys — Lily en anglais — des Mohawks ».
-
[43]
Frédéric Joignot, « Pour l’écrivain Édouard Glissant, la créolisation du monde est “irréversible”. Entretien avec Édouard Glissant », Le Monde, 3 février 2011 [republication de l’intégralité de l’entretien qu’il avait accordé au Monde 2, en 2005], en ligne : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2011/02/03/pour-l-ecrivain-edouard-glissant-la-creolisation-du-monde-etait-irreversible_1474923_3382.html (page consultée le 8 novembre 2019). Il est notable que Volkswagen Blues ait suscité des commentaires négatifs de la part de certains critiques littéraires autochtones indignés de voir, entre autres, que le rôle d’un personnage métis se réduisait au stéréotype d’un guide subalterne sans agentivité. Force est de conclure à une lecture erronée de leur part, motivée peut-être par un positionnement idéologique. Une critique a même été jusqu’à affirmer que la « promotion d’une culture hybride » menaçait d’« éliminer l’Autochtone » (voir Heather Macfarlane, « Volkswagen Blues Twenty-Five Years Later: Revisiting Poulin’s Pitsémine », Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne, vol. XXXIV, no 2, 2009, p. 5-21). Il s’agit très exactement là de la sorte de crainte dont parle Glissant, dans la mesure où le métissage élimine effectivement la possibilité de parler d’une identité « pure ».
-
[44]
Jacques Poulin, L’homme de la Saskatchewan, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2011, 120 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HS suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[45]
Régis Tremblay, « Jacques Poulin : le fantôme de l’écrivain ».
-
[46]
George Stevens (réalisateur et producteur), Shane, Paramount Pictures, 1953, 118 minutes.
-
[47]
Selon la Grande Sauterelle, « [c]’est une ville où l’on se sent bien quand on n’est pas comme tout le monde » (HS, 21).
-
[48]
Francis affirme que « la Grande Sauterelle [l]e séduisait non seulement par son physique, mais aussi par son mystère. En plus, elle avait un sens aigu de la liberté à cause de ses origines indiennes » (HS, 42).
-
[49]
Les hommes qui acceptent de jouer contre elle en mettant une somme en jeu croient « naturellement » remporter la partie, mais finissent plutôt par payer leurs préjugés d’ordre sexiste.
-
[50]
Le jeune Métis affirme qu’à l’époque du grand-oncle, de nombreux Franco-Métis parlaient le michif (Poulin écrit « le méchif »), mais que ceux de sa génération parlent le français (HS, 32).
-
[51]
Il voudrait que l’équipe au complet soit francophone, depuis les propriétaires jusqu’aux entraîneurs et joueurs, afin d’être à l’image du Québec, et pour que les Québécois puissent s’y identifier.
-
[52]
Jacques Poulin, La traduction est une histoire d’amour, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2006, 131 p.
-
[53]
Plus tôt dans le roman, lorsque Francis et la Petite Soeur comprennent que Mad Dog exerce « un genre de surveillance ou quelque chose de plus radical » vis-à-vis de leur frère aîné, Francis, pour épater sa soeur, propose d’aller « casser la gueule [au] bonhomme ». Elle l’étonne en se montrant tout à fait prête à le faire : « [E]lle serrait les poings et affichait un air farouche. — Allons-y ! dit-elle. » (HS, 51) Par ailleurs, la devise de Marine est « En cas de doute, fonce tête baissée. » (HS, 49) L’intérêt de ces détails réside dans le fait que, chez Poulin, ce n’est pas que la femme métisse qui a la capacité de s’imposer.
-
[54]
Albert Braz, The False Traitor: Louis Riel in Canadian Culture, Toronto, University of Toronto Press, 2003, 245 p.
-
[55]
Simon Nadeau, L’autre modernité, Montréal, Boréal, coll. « Liberté grande », 2013, p. 197.