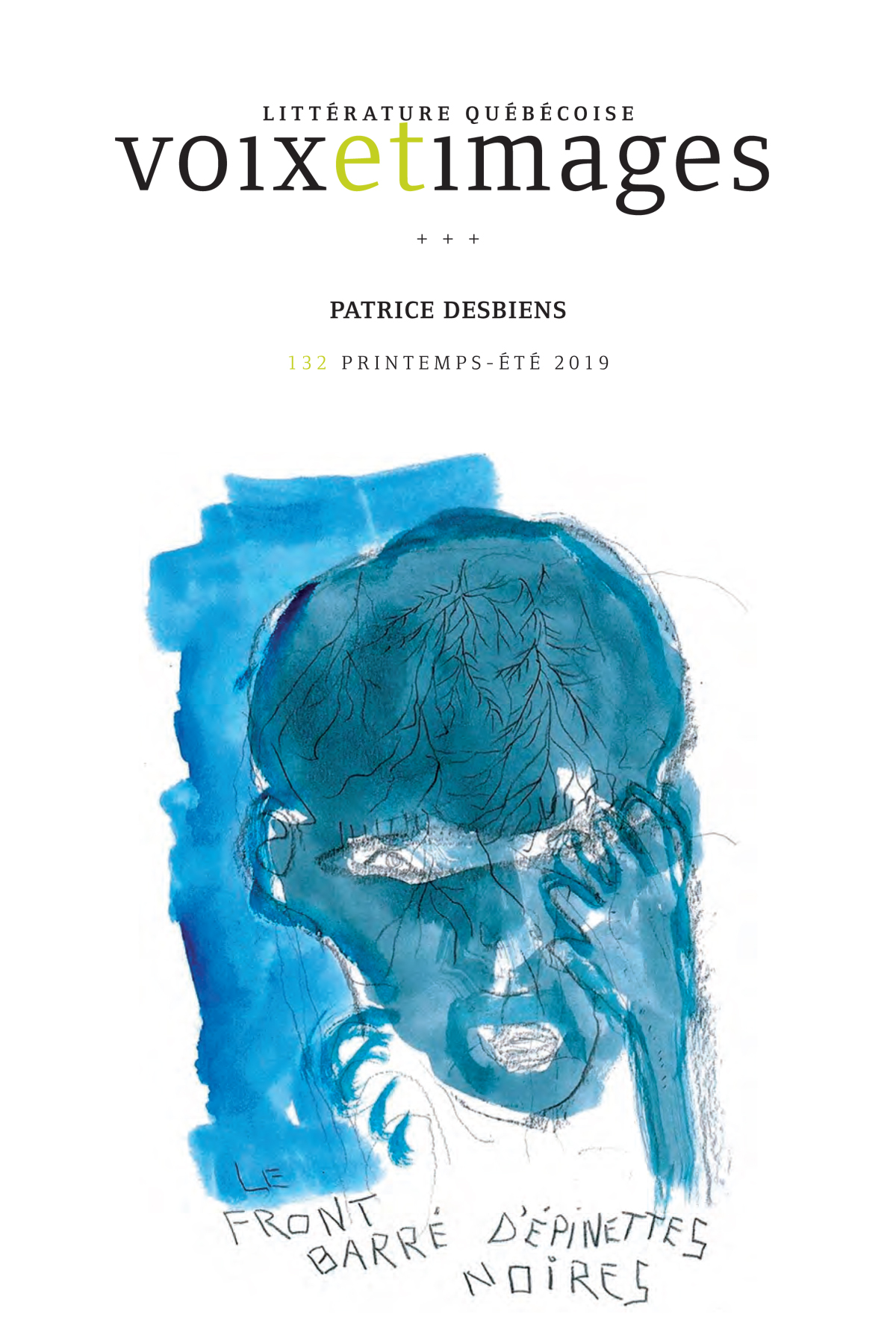Résumés
Résumé
Reconnu comme un des plus importants poètes franco-ontariens, Patrice Desbiens n’a pourtant pas remporté d’importants prix littéraires. Cet article explique cet écart entre la notoriété de l’auteur et sa consécration par une analyse de sa réception critique qui oscille entre l’éloge sans retenue et la critique virulente. Il montre que les choix esthétiques du poète — qui privilégie ce que l’autrice appelle une « esthétique de la pauvreté » — contribuent à cette réception mitigée.
Abstract
Although he is acknowledged as one of the most important Franco Ontarian poets, Patrice Desbiens has not won any major literary award. This article explains the gap between Desbiens’s fame and his level of recognition through an analysis of his critical reception, which swings back and forth between unmitigated praise and virulent critique. It shows that the poet’s aesthetic choices—favouring what is described as “an aesthetics of poverty”—contribute to the mixed response he elicits.
Resumen
Aunque se le reconoce como uno de los más importantes poetas franco-ontarianos, Patrice Desbiens no ha sido galardonado con ningún premio literario importante. En este artículo, se explica esta diferencia entre la notoriedad del autor y su consagración, mediante un análisis de su recibimiento crítico, que oscila entre el elogio sin reservas y la crítica virulenta. Es una muestra de que las opciones estéticas del poeta –que privilegia lo que la autora denomina “estética de la pobreza”– contribuyen a este recibimiento mitigado.
Corps de l’article
Patrice Desbiens est sans conteste l’un des écrivains franco-ontariens les plus connus, voire reconnus. Selon François Ouellet, l’important capital symbolique dont jouit l’oeuvre de Desbiens depuis le milieu des années 1990[2] s’est transmué, dans les années 2000, en une véritable consécration. Il me semble cependant que celle-ci est fragile puisqu’elle est limitée à certaines formes de reconnaissance alors que d’autres lui sont refusées, dont une lecture renouvelée[3] et l’attribution de prix littéraires prestigieux. Il y a là un paradoxe intéressant que j’explorerai ici par une étude de la réception critique de l’oeuvre de Desbiens. Puisque la consécration prend forme dans le temps, j’analyserai la critique journalistique[4] de l’oeuvre de Desbiens de façon diachronique. Je montrerai que la réception critique de l’oeuvre se fonde sur des présupposés quant à l’esthétique privilégiée par Desbiens, qui se sont cristallisés dans les années 1990, moment clé dans la trajectoire du poète de Timmins, et qui empêchent l’avènement d’une véritable consécration. Mon hypothèse est que la stagnation du processus de reconnaissance est due à l’attitude ambivalente de la critique face à l’esthétique de la pauvreté privilégiée par Desbiens.
DE L’INVISIBILITÉ À LA NOTORIÉTÉ : LE PARCOURS DE L’OEUVRE
La carrière littéraire de Patrice Desbiens commence par la publication de poèmes, le plus souvent en anglais, dans des revues et des journaux à Toronto. Ce n’est qu’une fois qu’il s’établit au Québec, en 1970, qu’il commence à publier en français, à compte d’auteur. Ses deux premiers recueils, Cimetière de l’oeil, paru en 1972, et Larmes de rasoir, en 1973, n’ont fait l’objet d’aucun compte rendu critique, ce qui est peu étonnant puisque les recueils à compte d’auteur sont mal diffusés et souvent connus exclusivement des proches de l’auteur. Ce qui surprend plutôt, c’est le fait que deux recensions dans des journaux importants, Le Soleil de Québec et Le Devoir de Montréal, portent sur le troisième recueil, Ici, paru en 1974 toujours à compte d’auteur. Cette première réception québécoise est particulièrement intéressante, car elle donne le ton pour celle qui suit et qui perdure aujourd’hui. Le poète et essayiste Philippe Haeck souligne dans le titre même de son article — « La critique sociale de Desbiens et Toupin » — la dimension sociale de la poésie de Desbiens. Bien qu’il la trouve « trop légère », vouée à susciter le rire, « ce qui désamorce toute critique radicale », il croit qu’elle « montre que le texte poétique ne flotte pas dans un ailleurs, qu’il est en lutte avec tous les autres textes, dont le texte publicitaire[5] ». La poésie se trouve dès lors valorisée surtout en raison de ses thèmes et de son propos, de son côté terre à terre. Jean Royer, poète et critique de grande renommée, abonde dans le même sens, mais en s’intéressant davantage à l’écriture et au ton : « Sa critique [celle que Desbiens fait de la société] se passe dans des images à la fois connues et inattendues, jamais prétentieuses, sinon de choquer, d’attendrir ou de faire rire. Ici, c’est la dérision qui l’emporte, qui emporte la révolte contre le quotidien[6]. » Et il poursuit : « [L]e langage de Desbiens se veut opératoire. C’est le ton du couteau, l’image écorchée à vif. La facilité n’est pas absente de plusieurs pages, mais le propos est toujours clair[7]. » Les adjectifs qu’il choisit pour parler du langage poétique de Desbiens (« spontané et simple », « brut et brutal », « sauvage », « à vif ») sont ceux qui reviendront tout au long de la carrière du poète, tout comme le jugement critique qu’il pose en ce qui concerne « la facilité ». Il est clair que ces adjectifs, comme le jugement d’ensemble, ne sont pas ceux qu’on associe habituellement au langage poétique. Desbiens se démarque donc. Le recueil a droit à une lecture grâce à son originalité puisque c’est une des caractéristiques recherchées de la poésie. La « facilité », en revanche, est honnie dans l’écriture poétique. Ce compte rendu, comme le précédent, montre le défi auquel se heurtera la critique : l’oeuvre est-elle assez originale pour être primée ou tombe-t-elle trop dans la facilité, la drôlerie et le simplisme ?
Il faudra attendre 1979, l’année de parution de L’espace qui reste, pour que paraissent des comptes rendus en Ontario[8]. En juin, un article est consacré à cinq recueils parus chez Prise de parole « depuis deux ans[9] », dont Les conséquences de la vie de Desbiens, livre dont la publication en 1977 n’avait pas été remarquée par la critique[10]. L’unique phrase qui porte sur le recueil de Desbiens est révélatrice de tout ce qui sera associé à l’esthétique du poète. Le jugement est, lui, plus que favorable :
Patrice Desbiens, enfin, nous donne un joyau avec Les conséquences de la vie, une poésie tout aussi quotidienne que celle de [Gaston] Tremblay, mais une vision discontinue, heurtée, appuyée sur l’anecdote, sur l’événement banal, mais sachant s’extirper de cette gangue pour atteindre au pur objet poétique[11].
Ici aussi, les adjectifs choisis ont un poids certain : « quotidienne », « discontinue », « heurtée », « banal » ne sont pas des « qualités » généralement associées au discours poétique. C’est pour cette raison que le poète doit savoir « extirper » sa poésie « de cette gangue pour atteindre » le poétique. La qualité de l’oeuvre tient donc à cette capacité de transmuer le vulgaire en poésie, mais elle reste très près de ce vulgaire.
Cinq articles sont, pour leur part, consacrés à L’espace qui reste, dont un de Paul Gay, critique d’Ottawa. Dans cette recension, Gay parle aussi du recueil précédent, Les conséquences de la vie. La poésie de Desbiens, le poète « sauvage[12] », est présentée comme une mise en scène simple mais décapante de la réalité dont elle souligne le côté dérisoire, par un langage-choc, que Gay associe au surréalisme. On retrouve à nouveau les mots-clés associés à l’écriture de Desbiens : réalisme, authenticité, désespoir et dérision ainsi que simplicité. Là encore, ce sont des termes (réalisme et simplicité, surtout) qui sont rarement mis en lien avec la conception traditionnelle de l’art poétique.
Les critiques de l’Ontario mettent toutefois davantage l’accent sur le désespoir que ceux du Québec. La journaliste du Northern Life de Sudbury, Janice Stein, est la première à mentionner ce qui deviendra un peu la marque de commerce de Desbiens. L’article, qui porte sur le lancement de L’espace qui reste à Toronto, soirée lors de laquelle Desbiens a lu ses textes, traite presque exclusivement de l’homme, de son apparence décharnée, signe de la vie dissolue qu’il mène et de l’alcool qu’il ingurgite. Il s’ouvre sur ces mots : « The poet had a desperate air about him — like a horse with nostrils flaring and rolling eyes[13]. » La critique soulève ainsi plusieurs des caractéristiques qui rattacheront Desbiens aux « poètes maudits » : « L’Espace qui reste is a collage of experiences pulled together from a journal he has kept over the last two years — gut feelings jotted down day after drunken day, sprawled in bars throughout Ontario[14]. » Elle ajoute : « He writes most of his stuff when he is drunk, slouched in bars, pad in hand. The alcohol loosens the prison of his mind, lets out pent-up emotions he has suppressed for years[15]. » Stein souligne également le lien qui s’établit entre Desbiens et ses lecteurs, mais sans toutefois faire du poète le porte-parole de la communauté franco-ontarienne :
The control he exerts over the mood of the group is quite remarkable to watch. […] They bear intimate witness to the world he describes — a world peopled by down and outers, the hopeless dregs of our society. By laying bare his own weakness, he creates a sympathetic bond with the people around him, the lingering mood is felt by everyone[16].
Olivier Asselin[17], qui écrivait régulièrement dans la revue franco-ontarienne Liaison au début des années 1980, parle lui aussi de cette réalité menant au désespoir qui mine le poète :
Écrire ce réel, lucidement, écrire, pour s’immuniser. […] Et Patrice Desbiens l’écrit avec force, cette réalité acide qui a tout rongé. Rythme sec. Qui rend tel quel. Le lyrisme a été tué. Aucun espoir. Chaque image brise, heurte et nous ramène dans cet insupportable quotidien qui n’offre et n’admet rien[18].
Si Asselin reconnaît que cette poésie « a son effet », « [p]ar l’utilisation de noms propres chargés de dénotations, par de brutales oppositions, par un humour acide et des images cinglantes dans un rythme sec et rigide », il reste quelque peu ambivalent devant ce qu’il perçoit comme « une complaisance que semble avoir l’auteur à se morfondre dans ce réel pénible », « un certain désir masochiste de se contempler dans un tel état » et « un ego qui désire ardemment assumer le destin romantique du poète tel qu’une certaine idéologie le véhicule ». Il s’agit pour Asselin d’une poésie qui « contient tous les stéréotypes entourant le mythe de l’Artiste depuis le Romantisme ». Il conclut cependant que
l’abondance des « je » tout le long du texte et l’aspect extrêmement intense de certaines images permettent de penser qu’il y a plus ici que le simple désir enfantin d’assumer le destin du poète-martyr. Il semble plutôt s’agir d’un narcissisme poussé qui mène à une perception endopsychique du monde (égocentrisme), forme extrême de romantisme, non sans rapport à une certaine forme de masochisme. Retenons simplement que la poésie de Patrice Desbiens possède parfois une richesse d’expression étonnante qui procure au lecteur une jouissance esthétique certaine.
Asselin revient sur le côté minimaliste de la poésie de Desbiens dans un compte rendu de l’ouvrage collectif La Souche, qui réunit des textes de cinq étudiants, dont Michel Dallaire et Patrice Desbiens. Le critique souligne à nouveau les éléments caractéristiques de la poésie de Desbiens, dont sa concision, son réalisme, son exploration du désespoir et la dérision que le poète privilégie : « L’extrême concision de ces poèmes refuse toute littérature, et le contenu, d’une absurdité déconcertante, tourne en dérision toute aspiration aux lourdes justifications intellectuelles[19]. » Reste à savoir si ce jugement est positif ou non. En effet, soit les adverbes et les adjectifs viennent moduler les propos, comme en témoignent le « parfois » de l’avant-dernière citation et « l’extrême » de la dernière, soit les éléments qui qualifient l’oeuvre (« absurdité déconcertante ») peuvent être interprétés positivement ou négativement.
Au Québec, l’engouement semble plus grand. Ainsi, Clément Moisan est tout à fait enthousiasmé à la lecture de L’espace qui reste. Non seulement trouve-t-il qu’il s’agit là du recueil « le plus original et le plus authentique [des] trois recueils parus à Prise de parole[20] » dont il fait le compte rendu (les deux autres sont Souvenances de Gaston Tremblay et 10/11 d’Alexandre Amprimoz), mais il termine sur ces mots : « Il y aurait beaucoup à dire de ce recueil qui me paraît une réussite d’écriture. On entendra certes parler de Patrice Desbiens, qui possède un univers bien à lui et peut l’exprimer dans son propre langage. C’est la marque d’un poète authentique[21]. » Alors qu’Asselin perçoit dans la poésie de Desbiens une certaine complaisance, qu’il associe à la posture de poète-martyr adoptée par l’auteur, c’est-à-dire celle du poète incompris, rejeté par la société, pauvre et maudit, Moisan y voit une poésie à la Miron, puisque « le poète se décrit comme aliéné[22] » dans les villes qu’il mentionne, soit Timmins et Toronto. Les deux critiques relèvent les mêmes choses dans les poèmes — le réalisme, le désespoir, la misère, la répétition, l’humour[23] —, mais l’un les interprète plus positivement que l’autre. La poésie de Desbiens appelle les deux types de lectures en ce qu’elle se moque un peu, voire beaucoup, de la poésie en bonne et due forme. Il s’agit d’un élément récurrent de l’oeuvre qui contribue, à mon avis, à l’ambivalence de la critique.
L’année 1979 marque aussi le retour de Patrice Desbiens en Ontario. Il s’installe alors à Sudbury, où il s’inscrit, brièvement, à l’Université Laurentienne (semestre d’automne 1979) et où il côtoie d’importants acteurs du milieu littéraire, dont Robert Dickson, Jean Marc Dalpé et Brigitte Haentjens, qui contribueront largement à la réputation du poète. C’est toutefois avec la parution de L’homme invisible/The Invisible Man, en 1981, que la critique établira des liens clairs entre la biographie de Desbiens, l’expérience minoritaire franco-ontarienne et sa poésie[24]. Ce qui était au départ perçu comme une posture d’écrivain (celle de l’écrivain maudit ou du poète tout court) devient celle d’un homme torturé par son destin. Les comptes rendus qui portent sur le récit sont plus nombreux ; j’en ai compté une douzaine ainsi qu’une mention dans un article de Quill & Quire qui recense les « New Stars in the Galaxy of Canadian Poetry[25] » et dont l’auteure, Rosemary Aubert, qualifie L’homme invisible/The Invisible Man de « experimental work[26] ». Quatre des autres articles sont publiés au Québec. Celui dans Livre d’ici, signé Michel Beaulieu, est le premier à faire directement référence au vécu du poète : « On a souvent dit que l’adversité produit des oeuvres fortes : Desbiens le confirme de nouveau d’éclatante façon[27]. » Dans son compte rendu de L’espace qui reste, Beaulieu avait déjà souligné le lien unissant Desbiens à l’Ontario français, mais en ne réduisant pas l’oeuvre à ce seul espace :
Dans L’espace qui reste, Patrice Desbiens plonge au plus creux de l’expérience de la vie quotidienne, la vie réelle. Dans ces poèmes les faits et gestes les plus banals deviennent hautement significatifs, créant des parallèles inattendus avec la qualité de la vie française en Ontario, ou ailleurs[28].
Le poète et critique sudburois Michel Dallaire marque, lui, plus clairement le lien avec la réalité franco-ontarienne : « Si le (les) texte(s) de Desbiens provoque(nt) parfois le rire, il(s) provoque(nt) aussi une réflexion sur la réalité qu’est le fait d’être invisible[29]. » Les écarts, nombreux, entre la poésie de Desbiens — qui prend pour ce livre la forme du récit — et la norme poétique dérangent certains critiques ou les font sourire. C’est le cas d’Antonio D’Alfonso, qui s’écrie : « De la grande littérature ? Absolument pas. Cependant, il y a quelque chose de jeune, de frais, d’honnête, de libre ici qui fera le plaisir de plusieurs cégépien(ne)s[30]. » Il y voit un ouvrage pour les « jeunes adultes », catégorie utilisée en littérature de langue anglaise : « Il est temps qu’on fasse une littérature consacrée à ces personnes qui ne sont pas enfants ni adultes. L’homme invisible/The Invisible Man de Patrice Desbiens fait partie de cette littérature[31]. » On peut certes argumenter que D’Alfonso, qui dit par ailleurs que le livre raconte « les voyages d’Audie Murphy (alias l’homme invisible)[32] », n’a pas bien compris l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que l’oeuvre dérange, car elle ne correspond pas aux normes esthétiques en vigueur.
Les années 1980 sont fécondes pour Desbiens, qui publie six recueils entre 1981 (L’homme invisible/The Invisible Man) et 1989 (Amour ambulance)[33]. Même si Desbiens est désormais bien connu des critiques, on parle peu de ses nouvelles parutions. Cinq comptes rendus portent sur Sudbury, huit sont consacrés à Dans l’après-midi cardiaque, six aux Cascadeurs de l’amour, cinq à Poèmes anglais et deux seulement à Amour ambulance. Prenons l’exemple de Dans l’après-midi cardiaque, qui a été finaliste au Prix du Gouverneur général. Bien que les critiques notent la « maturité[34] » acquise, ils continuent à considérer Desbiens comme le « poète concret qui recourt à son environnement immédiat pour fulgurer le réel[35] », le poète « sort[i] de l’école de la vie[36] », « [l]’envers de l’intellectuel[37] », le poète « terre à terre, plus concret que ses confrères québécois[38] », qui nous rappelle « le quotidien morne et lugubre[39] ». On relève à nouveau son ironie, la dérision et l’humour qui viennent adoucir la dureté de la vie mise en scène[40]. Enfin, le côté prosaïque de sa poésie est souligné à plusieurs reprises[41]. Cette « poésie apoétique[42] » ne fait pas l’unanimité. Si certains critiques comme Mark Benson ne posent pas de jugements clairs, d’autres prennent position. Antonio D’Alfonso, dont l’opinion sur l’oeuvre de Desbiens évolue, voit en lui « un poète important de sa génération. Sinon un des plus importants, par le fait que ses textes réfèrent à un monde au-delà de sa propre personne. Le je de Desbiens est un nous[43] ». Le jugement que D’Alfonso porte sur ce livre de Desbiens est donc opposé à sa lecture de L’homme invisible/The Invisible Man. En revanche, pour Robert Yergeau, Dans l’après-midi cardiaque manque d’originalité, parce que « Desbiens joue à être Desbiens[44] ». Ce reproche, qui apparaît ici pour la première fois, sera émis par d’autres critiques au fil des ans. L’ambivalence notée perdure donc : d’un côté, ceux qui crient au génie ; de l’autre, ceux qui trouvent cette poésie facile et répétitive. Selon Yergeau, il s’agit d’une poésie qui « collectionne les fadaises et véhicule une morale de pacotille[45] ». Le critique choisit par la suite un florilège de vers qui, tirés de leur contexte, illustrent effectivement son propos[46]. Il note que « certains textes ne baignent pas dans les mêmes eaux que ceux-là », mais ils « ne suffisent pas cependant à assurer l’intérêt et la qualité de Dans l’après-midi cardiaque[47] ». Pierre Nepveu hésite entre les deux verdicts. D’un côté, le « réalisme cru, et pourtant très littéraire, [de Desbiens] n’est pas sans rappeler certains textes de Renaud ou Major à l’époque de Parti pris, avec son côté ti-pop, ses fautes de goût, son engagement de paumé[48] » ; de l’autre, le poète « est constamment menacé par la facilité et l’image (parfois confortable) du poète-beat[49] ». Si le recueil « est bourré de défauts : le genre poète-beat n’est évidemment pas nouveau, les tournures maladroites ne sont pas rares et les comparaisons hyperréalistes (“le soleil luit/comme une Timex Acutron/sur le poignet poilu du ciel”) sont menacées par le procédé[50] », il n’en demeure pas moins que « dans ce journal du quotidien, avec tout ce qu’il y a de brouillon, passe un courant d’émotion qui tient à la fois à l’unité du propos et au fait que le prosaïsme y est soutenu avec assez d’insolence pour qu’ironie et détresse ne fassent plus qu’un[51] ». François Paré aussi note qu’« [i]l y a beaucoup d’inégalité dans ce dernier recueil[52] ». Il poursuit :
C’est surtout que Desbiens piétine dans la morosité et le désarroi et qu’on a assez souvent le goût de le laisser s’enfoncer, comme lecteur, dans son abandon morbide. Pourquoi devrais-je toujours lui donner vie, lui qui semble jouir de la mort et de l’oubli ? Pourtant il y a dans le livre quelques poèmes d’une superbe profondeur qui relèvent à eux seuls le défi de l’écriture[53].
Ainsi, certains poèmes « rachètent la trop grande facilité de certains autres poèmes qui auraient dû rester dans les tiroirs. Car c’est une chose de tenter d’exprimer la difficulté de dire dans ce pays inexistant ; c’en est une autre de perdre son temps (et celui du lecteur) à dire des balivernes[54] ». Le critique conclut que « [c]’est dommage, parce que, avec un peu plus d’abandon et une meilleure facture formelle, cette oeuvre deviendrait non seulement notable, mais tout simplement remarquable[55] ». L’ambivalence de la critique explique sans doute pourquoi le Prix du Gouverneur général lui a échappé. Impossible pour le poète d’obtenir à l’unanimité un jugement favorable de la critique puisque certains valorisent une conception plus « traditionnelle » de la poésie qui trouve le prosaïsme, la « vulgarité » et la répétition peu aptes à produire une oeuvre de qualité, alors que d’autres trouvent dans la fulgurance de certaines images, la profondeur de la détresse humaine mise en scène, l’originalité de la démarche quelque chose à louanger.
ENTRE LA RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE ET LA LÉGITIMATION LITTÉRAIRE
Les recueils qui paraissent dans les années 1990 et 2000 ne connaîtront pas une première réception plus importante que celle des oeuvres des années 1970 et 1980, et les sujets abordés ne seront pas bien différents, et ce, même si le bassin de critiques se renouvelle et que la critique savante se découvre une passion certaine pour l’oeuvre de Desbiens[56]. Les marques de reconnaissance symbolique se multiplient pourtant. D’abord, plusieurs recueils du poète sont réédités à la fin des années 1990 et durant les années 2000 : L’homme invisible/The Invisible Man suivi de Les cascadeurs de l’amour, en 1997 et 2008 ; Sudbury (poèmes 1979-1985) qui comprend L’espace qui reste, Sudbury et Dans l’après-midi cardiaque, en 2000, 2007 et 2013 ; ainsi que Poèmes anglais, suivi de Le pays de personne, suivi de La fissure de la fiction, réédition parue en 2010. Les rééditions témoignent de la place importante qu’occupe l’oeuvre de Desbiens dans le champ littéraire francophone du Canada. Ce sont toutefois surtout les reconnaissances venues de l’extérieur du milieu littéraire qui confèrent à Desbiens et à son oeuvre un capital symbolique important. Le film de Valmont Jobin sur la vie et l’oeuvre de Desbiens[57] en est un exemple frappant. Néanmoins, ce film, comme de nombreux comptes rendus et articles de type « portrait d’auteur », met plus l’accent sur la vie du poète que sur sa poésie. Desbiens fait aussi une apparition dans le film Le dernier des Franco-Ontariens de Jean Marc Larivière[58], en 1996. Il participe également à de nombreux spectacles sur scène, d’abord avec Jean Marc Dalpé en 1987 et 1988 (Dalpé-Desbiens, en 1987, et Cris et blues, live à Coulson, en 1988, spectacle qui partira en tournée ontarienne et sera présenté à Limoges, en France), puis au Festival international de littérature de Montréal en 2005 (Sudbury blues, au Lion d’Or). Il convient de souligner davantage le spectacle donné en 1991 avec René Lussier (Grosse guitare rouge), qui a mené Desbiens en France et en Belgique[59], et qui a servi d’inspiration pour un spectacle donné par le poète au Gala de la Nuit sur l’étang de 1995, à Sudbury, en compagnie des frères Lamoureux du groupe Brasse-Camarade, et repris à l’automne de la même année. Il a aussi conduit à la production d’un disque compact :
En mars [1998], à l’occasion du 50e anniversaire de Patrice Desbiens, le musicien-compositeur René Lussier et quelques amis (Jean Derome, Guillaume Dostaler, Pierre Tanguay) lui offrent un cadeau exceptionnel : du temps en studio pour enregistrer ses poèmes préférés dans une ambiance de club de jazz. Le résultat, un disque compact produit par René Lussier et intitulé Patrice Desbiens et les Moyens du bord[60], paraît en 1999[61].
Des artistes très connus, dont Richard Desjardins, Chloé Sainte-Marie et Thomas Hellman, chanteront également ses textes. Des spectacles sont donnés en son honneur. En 1988, Desbiens est président d’honneur du Salon du livre de l’Outaouais. La même année, il est invité au Salon du livre du Mans. En février 2003, alors qu’il est l’invité d’honneur du festival Voix d’Amériques, un spectacle lui rend hommage. Il en va de même du « spectacle Satori à Québec : hommage à Patrice Desbiens [qui] est présenté au Largo resto-club en juin [2008] et de nouveau à la demande générale en septembre [2008], au café-spectacle du palais Montcalm dans le cadre du Festival de jazz de Québec[62] ». Les journalistes parlent aussi de lui, notamment le très influent chroniqueur Pierre Foglia, qui affirme que Desbiens est un « des trois seuls poètes qu’il lisait parfois[63] », puis en fait son « poète du samedi[64] » dans sa chronique du 17 octobre 1998. Enfin, Desbiens est admiré de maints artistes et écrivains, dont Louis Hamelin, qui lui dédie un de ses poèmes[65] et publie un portrait très flatteur du poète intitulé « Un super-héros dépareillé : Pat-Man[66] » dans la revue Liaison. Michel Nareau définit ainsi l’attrait qu’ont Desbiens et d’autres écrivains pour Hamelin :
La posture de Louis Hamelin à l’endroit de ses maîtres en écriture relève […] d’une sorte de respect ironique : admiration réelle pour leur grandeur, mais sans obséquiosité, s’apparentant parfois à une distance moqueuse. Tout se passe comme s’il s’agissait davantage de confrères, avec lesquels on peut blaguer, que de figures d’autorité, comme si la dette à leur endroit, une fois reconnue, était aussitôt acquittée. Et elle l’est, non seulement dans les grandes références auxquelles renvoient les romans, mais aussi dans les confidences et aveux très explicites contenus dans L’humain isolé, Le voyage en pot et Fabrications où sont convoquées les figures internationales de James Joyce, de Franz Kafka, de Malcolm Lowry, de Mailer, de Tolstoï ou de Tournier, et québécoises d’Aquin, de Ducharme, de Mordecai Richler et de Gabrielle Roy, mais également de Patrice Desbiens, de Christian Mistral et d’autres personnages qui constituent pour lui une sorte de « marginocratie », une communauté de « frères » élus qu’il semble placer au-dessus de tout et de tous et dont ses personnages de fiction s’avèrent souvent des doublets[67].
Si l’on en croit Catherine Hébert, la notoriété de Desbiens semble toutefois confinée au milieu artistique et aux écrivains :
Considéré par plusieurs comme le plus grand poète franco-ontarien, voire un génie, Desbiens demeure méconnu du grand public, qui ignore qu’il est, entre autres, l’auteur de très belles chansons de Chloé Sainte-Marie et Richard Desjardins. […] Un manque de reconnaissance qui ne semble pas le troubler. « Écrire, ce n’est pas une affaire de reconnaissance. »[68]
Pourtant, dans les années 2000, des spectacles théâtraux sont produits à partir de ses recueils. Cela commence lors de la tenue de la Quinzaine Desbiens, organisée par le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury, qui
[…] comprend : une production théâtrale, Quand les mots viennent du Nord (qui plus tard est renommée Du pépin à la fissure[69]), textes choisis de Un pépin de pomme sur un poêle à bois et de La fissure de la fiction, […] une exposition à la Galerie du Nouvel-Ontario de bannières d’art créées par l’artiste et poète Herménégilde Chiasson à partir des textes de Patrice Desbiens ; et une adaptation théâtrale des Cascadeurs de l’amour, production du Théâtre la Tangente de Toronto[70].
En 2005, Robert Marinier et Roch Castonguay conçoivent un spectacle à partir de L’homme invisible/The Invisible Man. Le spectacle est produit par le Théâtre de la Vieille 17 d’Ottawa. Une deuxième adaptation de L’homme invisible/The Invisible Man est créée en 2011 pour le Theatre Kingston et reprise en 2012 à Montréal par le Théâtre du futur et le festival Zoofest[71]. D’autres spectacles, tels Tout ça m’assassine[72] de Dominic Champagne et À quoi ça sert d’être brillant si t’éclaires personne de Lisa L’Heureux et Gabriel Robichaud, s’inspirent aussi de l’oeuvre de Desbiens ou lui empruntent des vers pour servir de titre.
Les prix se font toutefois rares. Certes, Desbiens reçoit en 1987 le Prix du Nouvel-Ontario, qui est « remis annuellement à une personne qui s’est distinguée par sa contribution importante au développement culturel, artistique et social de l’Ontario français[73] ». Ce prix, qui n’est pas un prix littéraire, reconnaît l’importance de l’oeuvre de Desbiens pour la communauté franco-ontarienne, mais est-il aussi une reconnaissance de sa littérarité ? Sans doute, mais il reste que c’est un prix de moindre importance que le Prix du Gouverneur général qui lui a échappé deux ans plus tôt. Desbiens recevra aussi le Premier Prix du Salon du livre du Grand Sudbury, « décerné à un auteur chevronné originaire de l’Ontario français, ou associé à l’Ontario français, dont la production bien établie a maintenu un haut niveau de qualité et a gagné l’appréciation vive de ses lecteurs[74] ». Il s’agit d’une reconnaissance littéraire, mais la portée en est surtout locale, d’autant plus que, à ma connaissance, le prix n’a été remis que cette année-là. Il est toutefois le lauréat de deux prix proprement littéraires : le prix Champlain (en 1996, pour Un pépin de pomme sur un poêle à bois) et le Prix de poésie Estuaire des Terrasses Saint-Sulpice (en 1997, pour La fissure de la fiction). Le prix Champlain, qui a été créé et géré par le Conseil de la vie française en Amérique jusqu’à récemment, vise à « promouvoir et [à] mettre en valeur la vitalité et la qualité de l’activité littéraire dans l’ensemble des communautés de langue française au Canada[75] », alors que le Prix de poésie des Terrasses Saint-Sulpice, parrainé par la revue Estuaire, a été remis de 1990 à 2008 à plusieurs poètes d’importance tels que Denise Desautels, Herménégilde Chiasson, Gérald Leblanc et Paul Chamberland, dont les oeuvres ont en commun de proposer « une approche différente de la poésie, tant sur le plan thématique que sur le plan formel[76] ». Or, les livres primés de Desbiens n’ont pas plu à tous les critiques. Hugues Corriveau, par exemple, voit dans Un pépin de pomme sur un poêle à bois une surenchère mélodramatique[77], au contraire de Robert Dickson, un grand ami de Desbiens, lequel juge qu’il s’agit d’« un très très grand recueil […] [et du] plus beau livre de Patrice[78] ». Cet avis, exprimé par Dickson durant un échange avec le poète que rapporte la revue Liaison, permet à Desbiens d’enchaîner en rappelant qu’« un jury du Conseil des arts de l’Ontario lui a refusé une bourse d’écriture sous prétexte qu’il se répétait[79] ». Il ne précise pas si la demande portait sur un des recueils publiés dans Un pépin de pomme sur un poêle à bois, mais il est possible de le croire. Selon Desbiens, il ne s’agit pas de répétition, mais de « continuité[80] ». Il cite à l’appui un des poèmes du recueil qui porte sur le fait qu’il se répète. Elizabeth Lasserre, qui termine à l’époque une thèse sur l’oeuvre de Desbiens et qui est une des premières critiques à publier des articles savants sur son oeuvre, juge qu’il s’agit d’un grand Desbiens. Elle signale que le triptyque regroupe
[t]rois ouvrages et trois univers différents, avec pour points communs les thèmes classiques de Desbiens : le rapport de force de deux langues et de deux cultures, la voracité aveugle de la société de consommation dominante et son intolérance envers ses marges, le déchirement intime de l’être et sa quête symbolique d’un amour qui puisse l’unifier[81].
Selon elle, l’ouvrage innove cependant puisque « le style a changé, présentant une plus grande maîtrise technique et moins de violences et de débordements que dans les écrits précédents[82] ». Tout en nuances, la critique souligne les avantages et les désavantages de cette nouvelle façon d’écrire de Desbiens : « [S]i la poésie perd en force de frappe et en souffrance brute, elle gagne beaucoup en précision et en complexité, au grand plaisir du lecteur[83]. » Daniel-Louis Beaudoin signe la critique la plus virulente au sujet de ce recueil, celle qui signale ce que l’on reproche régulièrement au poète : son prosaïsme, que l’auteur appelle ici sa « grotesque niaiserie[84] ».
La fissure de la fiction, qui paraît deux ans plus tard, a aussi droit à une critique écartelée entre l’affirmation du génie de l’auteur et le malaise face à ce qui est vu comme une écriture peu poétique et répétitive. De « ce curieux poème narratif[85] », François Ouellet dit qu’il s’agit d’un chef-d’oeuvre[86], Jocelyne Felx, d’« un texte des plus émouvants[87] », alors que Gilles Côté[88] et Roger Chamberland[89] refusent de formuler un jugement et que David Cantin soutient que « cette recherche d’effets est devenue beaucoup trop prévisible[90] ». L’ambivalence règne donc, même lorsqu’il s’agit d’ouvrages primés. Les recueils parus depuis n’ont pas été retenus pour des prix littéraires et ont joui d’une réception critique mince, comme c’est le cas pour Désâmé (2005) et Pour de vrai (2011), qui n’ont donné lieu, à ma connaissance, qu’à quelques comptes rendus[91]. Pourtant, l’engouement des artistes perdure, et les universitaires (chercheurs et étudiants) poursuivent leur étude de cette oeuvre qui les fascine.
ESTHÉTIQUE DE LA PAUVRETÉ : UN ATOUT OU UN DÉSAVANTAGE ?
Comment expliquer l’ambivalence de la réception critique de Patrice Desbiens ? L’étude des comptes rendus publiés lors de la parution des oeuvres, du discours des pairs ainsi que de l’attribution des prix montre que les éléments qui sont louangés par les uns sont ceux qui sont décriés par les autres. Ces éléments sont ceux qui fondent ce que j’appelle l’esthétique de la pauvreté propre à Desbiens : pauvreté de la langue, pauvreté des moyens stylistiques et pauvreté du monde mis en scène. La pauvreté est d’abord perçue par plusieurs critiques soit comme une représentation générale de la vie de poète (marginal ou maudit) ou de Desbiens en particulier, soit comme une métaphore de la réalité franco-ontarienne. Elle mène alors à des lectures plus positives de l’oeuvre. Les études savantes — articles, chapitres de livres, mémoires et thèses — qui portent sur ces aspects sont nombreuses, comme le montre la bibliographie de la critique publiée dans ce numéro de Voix et Images, et elles témoignent de la prégnance de ces éléments tant dans l’oeuvre du poète que dans les grilles de lecture des critiques. En 1997, Elizabeth Lasserre forge le concept de « rhétorique du quotidien » pour parler de l’écriture de Desbiens[92]. Pour ma part, je préfère parler d’esthétique de la pauvreté. Puisque l’esthétique de la pauvreté se manifeste par l’emploi de certaines figures de style et de stratégies scripturaires, dont les principales sont la concision, la fragmentation, la répétition et le prosaïsme, celles-ci peuvent être lues, perçues et jugées soit positivement, soit négativement. Ces choix stylistiques et thématiques ont fait la réputation du poète.
L’intérêt que porte Desbiens « à la dimension habituelle, voire banale, de la vie[93] » suscite cependant des réactions diamétralement opposées chez la critique. « [L]e rejet violent de tout esthétisme littéraire[94] » n’a pas comme seul effet de « ram[ener] l’écriture vers la tristesse du quotidien et lui ôte[r] tout pouvoir de rédemption[95] », elle a aussi comme conséquence de placer l’oeuvre de Desbiens dans un entre-deux poétique, entre la poésie et le langage ordinaire. Cette « poésie publique, accessible au plus grand nombre[96] », cette « poésie impure qui n’a rien de l’écriture à prétention savante[97] », qui « s’enracine dans une façon de faire très narrative, proche du conte urbain ou de ce que les anglophones nomment avec justesse le spoken word[98] », qui ne correspond pas aux normes génériques, suscite clairement l’engouement chez la critique savante, les poètes et autres artistes qui pigent dans l’oeuvre un florilège dont ils font l’analyse ou l’adaptation théâtrale ou musicale. Toutefois, la critique journalistique et les jurys littéraires qui jugent un seul ouvrage à la fois afin d’en jauger la qualité littéraire en fonction des normes dominantes ne peuvent pas être aussi sélectifs. D’un côté, puisqu’il refuse « [l]’esthétisme, le vers bien léché, la métaphore transcendante[99] », le poète est louangé pour son non-conformisme. De l’autre, le ressassement des mêmes questions, la reprise des mêmes poèmes légèrement modifiés ou non d’un recueil à l’autre, la simplicité apparente, voulue ou non, mettent mal à l’aise certains
Parties annexes
Note biographique
LUCIE HOTTE est professeure titulaire au Département de français et Directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa, où elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche sur les cultures et les littératures francophones du Canada. Ses recherches portent sur ses trois principaux champs d’intérêt : les théories de la lecture, les littératures minoritaires et l’écriture des femmes. Elle s’intéresse aussi à la réception critique des oeuvres d’écrivains marginaux. Elle a beaucoup publié sur les littératures franco-canadiennes et les enjeux institutionnels propres aux littératures minoritaires. En 2017, elle a reçu la médaille commémorative du 150e anniversaire de la Confédération du Sénat canadien en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la promotion de la culture franco-ontarienne. Lucie Hotte est également membre de la Société royale du Canada. Elle travaille actuellement à deux projets de recherche subventionnés par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
Notes
-
[1]
Je remercie mes assistants de recherche, Mathieu Simard et Ariane Brun del Re.
-
[2]
François Ouellet mentionne « la thèse de doctorat d’Elizabeth Lasserre, le prix Champlain du Conseil de la vie française en Amérique, la réédition en un seul volume de L’homme invisible et des Cascadeurs de l’amour chez Prise de parole ou, encore, la parution du disque Patrice Desbiens et les Moyens du bord » comme exemples attestant le capital symbolique acquis. Voir François Ouellet, « Patrice Desbiens par lui-même : 1974-1995 », Jacques Paquin (dir.), Nouveaux territoires de la poésie francophone au Canada, 1970-2000, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa/CRCCF, coll. « Archives des lettres canadiennes », 2012, p. 239.
-
[3]
Dans son étude éclairante de la construction de la figure du « poète Desbiens » par la critique, parue en 2000, Louis Bélanger soutient que « [l]e cheminement du discours critique sur Patrice Desbiens en Ontario français ne permet plus […] de réduire la portée de son oeuvre à la démarche identitaire et iconoclaste d’un poète longtemps assujetti à l’expression culturelle de sa communauté d’origine » (Louis Bélanger, « Patrice Desbiens : au coeur des fictions sociales », Ali Reguigui et Hédi Bouraoui [dir.], Perspectives sur la littérature franco-ontarienne, édition revue et augmentée, Sudbury, Prise de parole, coll. « Agora », 2007 [2000], p. 256). J’en suis, pour ma part, moins convaincue.
-
[4]
Mon analyse porte essentiellement sur le discours journalistique et donc social sur l’oeuvre de Desbiens. Elle se fonde cependant également sur une synthèse de sa réception savante et une étude des diverses formes de reconnaissance accordées par les pairs, les poètes et les autres artistes.
-
[5]
Philippe Haeck, « La critique sociale de Desbiens et Toupin », Le Devoir, 7 juin 1975, p. 17.
-
[6]
Jean Royer, « Poèmes du contre-quotidien », Le Soleil, 26 juillet 1975, p. C6.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Un premier compte rendu était cependant paru dans Le Voyageur de Sudbury en 1977 : Jean-Paul Pratte, « Les conséquences de l’écriture », Le Voyageur, 8 juin 1977, supplément culturel, p. 42.
-
[9]
Michel Beaulieu, « Quelques poètes d’outre-frontière », Le livre d’ici, vol. IV, no 34, 30 mai 1979, p. 1. Cet article, comme plusieurs autres parus au Québec dans les années 1970 et 1980, sera repris dans des publications ontariennes. Ainsi, il paraîtra aussi dans L’Express de Toronto, le 8 juin 1979, p. 12, et dans Le Nord de Hearst, le 27 juin 1979, p. K11.
-
[10]
Un seul compte rendu a pu être retracé, soit celui de Pratte dans Le Voyageur.
-
[11]
Michel Beaulieu, « Quelques poètes d’outre-frontière », p. 1.
-
[12]
Paul Gay, « Patrice Desbiens le surréaliste », Le Droit, 20 septembre 1980, p. 18.
-
[13]
Janice Stein, « Gut feelings jotted down day after drunken day », Northern Life, 7 novembre 1979, p. 2. Je traduis : « Le poète avait un air désespéré — comme un cheval dont les narines sont dilatées et les yeux roulent. »
-
[14]
Ibid. Je traduis : « L’espace qui reste est un collage d’expériences tirées du journal personnel qu’il a tenu au cours des deux dernières années, y griffonnant ses impressions pendant des journées passées dans un état d’ivresse, avachi dans des bars à travers l’Ontario. »
-
[15]
Ibid. Je traduis : « Il écrit la plupart de ses trucs quand il est saoul, affalé dans les bars, bloc-notes en main. L’alcool libère la prison qu’est son esprit, permet aux émotions refoulées depuis des années de s’échapper enfin. »
-
[16]
Ibid. Je traduis : « Le contrôle qu’il exerce sur l’humeur du groupe est plutôt remarquable à observer. […] Ils sont intimement témoins du monde qu’il décrit — un monde peuplé de déchards, la racaille désespérée de notre société. En exposant sa propre faiblesse, il établit un lien de sympathie avec les gens qui l’entourent, une humeur persistante qui est ressentie par tout le monde. »
-
[17]
Olivier Asselin est aujourd’hui professeur d’histoire de l’art à l’Université de Montréal.
-
[18]
Olivier Asselin, « Le cancer poétique de Patrice Desbiens : L’espace qui reste », Liaison, vol. III, no 9, avril 1980, p. 32. Les passages qui suivent sont tirés du même article.
-
[19]
Olivier Asselin, « La Souche. Je suis poète », Liaison, no 16, juin 1981, p. 9.
-
[20]
Clément Moisan, « Alexandre Amprimoz, 10/11 ; Gaston Tremblay, Souvenances ; Patrice Desbiens, L’espace qui reste, Éditions Prise de parole », Livres et auteurs québécois 1979, 1980, p. 92.
-
[21]
Ibid., p. 94.
-
[22]
Ibid., p. 93.
-
[23]
Moisan dit, par exemple : « Mais ce qui domine c’est l’aisance du verbe, la liberté de jouer, de jouer avec les mots et de leur faire dire avec un humour tendre, parfois grinçant, cruel même, une vie plate et sans poésie. Le poète use souvent de la répétition, de la réitération, pour traduire la banalité de l’existence et produire ainsi un effet de successions identiques de mêmes réalités vides ou insignifiantes. » (Ibid.) Pour Asselin, cette insignifiance déteint sur la poésie, qui devient elle-même insignifiante.
-
[24]
Jean-Paul Pratte avait cependant ouvert la porte à cette interprétation : « Patrice Desbiens est un Franco-Ontarien emmuré. C’est ce qui le rend poète de la réalité. Son recueil Les conséquences de la vie décrit très bien son milieu de vie trop souvent morose. » (Jean-Paul Pratte, « Les conséquences de l’écriture », p. 42.) Ce « milieu de vie » n’est toutefois pas défini comme franco-ontarien, bien que l’auteur parle de « la poésie du Nord » (ibid.).
-
[25]
Je traduis : « Les nouvelles étoiles dans la galaxie de la poésie canadienne. »
-
[26]
Rosemary Aubert, « New Stars in the Galaxy of Canadian Poetry », Quill & Quire, vol. XLVIII, no 4, avril 1982, p. 30. Je traduis : « travail expérimental ».
-
[27]
Michel Beaulieu, « Poète de Timmins : L’homme invisible de Patrice Desbiens », Livre d’ici, vol. VII, no 38, 23 juin 1982, p. 2.
-
[28]
Michel Beaulieu, « Un nouveau recueil de poèmes pour Patrice Desbiens », Le Nord, 10 octobre 1979, p. H24.
-
[29]
Michel Dallaire, « Le trait d’union, une réalité en soi », Liaison, no 23, août-septembre 1982, p. 43.
-
[30]
Antonio D’Alfonso, « Patrice Desbiens. L’homme invisible/The Invisible Man », Nos livres, vol. XIII, avril 1982, p. 155.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
Ibid.
-
[33]
Il s’agit de L’homme invisible/The Invisible Man, édition bilingue, Sudbury/Moonbeam, Prise de parole/Penumbra Press, 1981, 46 p.; Sudbury : textes 1981-1983, Sudbury, Prise de parole, 1983, 63 p. ; Dans l’après-midi cardiaque, Sudbury, Prise de parole, 1985, 77 p. ; Les cascadeurs de l’amour, Sudbury, Prise de parole, coll. « De-Ville », 1987, 73 p. ; Poèmes anglais, Sudbury, Prise de Parole, coll. « De-Ville », 1988, 62 p. ; et Amour ambulance, Trois-Rivières, Écrits des Forges, 1989, 85 p.
-
[34]
« Je pense que ce recueil a plus de maturité que les précédents, l’homme avance dans la vie et l’écrivain dans l’écriture, ce qui devrait conduire Desbiens à des sommets insoupçonnés. Ce qui était défaut est maintenant parfaitement intégré à son projet poétique. » Paul Bélanger, « Dans l’après-midi cardiaque », Nuit blanche, no 24, juillet-août-septembre 1986, p. 5.
-
[35]
Ibid.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Mark Benson, « Maniaques dépressifs », Canadian Literature, no 112, printemps 1987, p. 140.
-
[38]
Ibid.
-
[39]
Ibid. Voir aussi Robert Yergeau, « Dans l’après-midi cardiaque : Desbiens joue à être Desbiens », Liaison, no 38, printemps 1986, p. 56. François Paré parle des « mêmes partis pris pour les choses les plus ordinaires de notre monde ». François Paré, « Dans l’après-midi cardiaque de Patrice Desbiens. La voix de l’homme qui a peur », Le Droit, 12 juillet 1986, p. 36.
-
[40]
Voir J[ean] D[umont], « Desbiens, Patrice, Dans l’après-midi cardiaque, Sudbury, Prise de parole, 1985, 77 p. », L’Apropos, vol. IV, no 1, 1986, p. 120-121 ; Mark Benson, « Maniaques dépressifs », p. 140 ; François Paré, « Dans l’après-midi cardiaque de Patrice Desbiens. La voix de l’homme qui a peur », p. 36.
-
[41]
Voir, entre autres, Mark Benson, « Maniaques dépressifs », p. 140.
-
[42]
Ibid. Yergeau parle pour sa part « d’antipoète primaire » (« Dans l’après-midi cardiaque : Desbiens joue à être Desbiens », p. 56), alors que François Paré note « la difficulté de la parole poétique » (« Dans l’après-midi cardiaque de Patrice Desbiens. La voix de l’homme qui a peur », p. 36). Pourtant, dans son compte rendu de Sudbury, Yergeau portait un jugement plus favorable sur la poésie de Desbiens. Voir Robert Yergeau, « La traversée du réel. Patrice Desbiens : le Bukowski nordique », Lettres québécoises, no 36, hiver 1984-1985, p. 34.
-
[43]
Antonio D’Alfonso, « Desbiens (Patrice). Dans l’après-midi cardiaque », Nos livres, 1986, no 6439.
-
[44]
Robert Yergeau, « Dans l’après-midi cardiaque : Desbiens joue à être Desbiens », p. 56.
-
[45]
Ibid.
-
[46]
Par exemple : « La terre est ronde/le monde est platte/c’est pas l’inspiration qui manque ». Cité dans ibid.
-
[47]
Ibid.
-
[48]
Pierre Nepveu, « Sudbury Blues. Dans l’après-midi cardiaque de Patrice Desbiens », Spirale, no 62, été 1986, p. 22. L’auteur souligne.
-
[49]
Ibid.
-
[50]
Ibid.
-
[51]
Ibid.
-
[52]
François Paré, « Dans l’après-midi cardiaque de Patrice Desbiens. La voix de l’homme qui a peur », p. 36.
-
[53]
Ibid.
-
[54]
Ibid.
-
[55]
Ibid.
-
[56]
L’analyse de la réception savante de Desbiens demande un article à elle seule. Une suite à mon étude est donc à venir.
-
[57]
Valmont Jobin, Mon pays, Montréal, Office national du film du Canada, 1991, 29 min, VHS. Desbiens est également apparu dans le film Les mots dits (1981) aux côtés de quatre poètes franco-ontariens : Robert Dickson, Sylvie Trudel, Jean Marc Dalpé et Michel Vallières.
-
[58]
Jean Marc Larivière, Le dernier des Franco-Ontariens, Montréal, Nunacom/Office national du film du Canada, 1996, 58 min.
-
[59]
Voir Ève Dumas, « Patrice Desbiens, poète jour et nuit », La Presse, 16 août 2003, p. D6.
-
[60]
Patrice Desbiens et les Moyens du bord, poèmes de l’auteur issus de différents recueils écrits entre 1974 et 1995 sur des musiques improvisées par Jean Derome, Guillaume Dostaler, René Lussier et Pierre Tanguay, Montréal, DAME, 1999, 1 disque numérique.
-
[61]
[S. n.], « Biobibliographie », Patrice Desbiens, Sudbury (poèmes 1979-1985), Sudbury, Prise de Parole, coll. « BCF. Bibliothèque canadienne-française », 2013, p. 262.
-
[62]
Ibid., p. 265.
-
[63]
Pierre Foglia, « Les états culturels », La Presse, 14 octobre 1997, p. A5.
-
[64]
Pierre Foglia, « Vous le faites exprès, c’est ça ? », La Presse, 17 octobre 1998, p. A10.
-
[65]
Louis Hamelin, « Vingt ans plus tard à l’hôpital », Estuaire, no 144, avril 2011, p. 69-79.
-
[66]
Louis Hamelin, « Un super-héros dépareillé : Pat-Man », Liaison, no 95, janvier 1998, p. 19-21.
-
[67]
Michel Nareau et Jacques Pelletier, « L’écriture comme appropriation de soi et du monde », Voix et Images, vol. XLI, no 1, automne 2015, p. 10.
-
[68]
Catherine Hébert, « Fiction pulpeuse », Voir, vol. XVII, no 33, 21 août 2003, p. 26. La journaliste cite Desbiens, qu’elle interviewe pour cet article.
-
[69]
Du pépin à la fissure, qui met en scène l’intégrale des recueils Un pépin de pomme sur un poêle à bois et La fissure de la fiction, sera produit par le Théâtre du Nouvel-Ontario.
-
[70]
[S. n.], « Biobibliographie », Patrice Desbiens, L’homme invisible/The Invisible Man suivi de Les cascadeurs de l’amour, p. 197.
-
[71]
Voir Nicole Nolette, Jouer la traduction. Théâtre et hétérolinguisme au Canada francophone, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Regards sur la traduction », 2015, p. 152 et 170-176.
-
[72]
Renaud Plante (dir.), Tout ça m’assassine. Courtes pièces sur l’air du temps, avec « Poèmes, première partie » et « Poèmes, deuxième partie » de Patrice Desbiens, « La déroute » de Dominic Champagne et « Confession d’un cassé » de Pierre Lefebvre, Montréal, Somme toute, coll. « Répliques », 2013, 133 p.
-
[73]
[S. n.], « denise truax reçoit le Prix du Nouvel-Ontario », en ligne : http://www.prisedeparole.ca/2016/04/ 04/denise-truax-recoit-le-prix-du-nouvel-ontario/ (page consultée le 25 février 2019).
-
[74]
[S. n.], « Prix et distinctions », Lettres québécoises, no 131, automne 2008, p. 70.
-
[75]
Le prix est désormais remis par le Regroupement des éditeurs franco-canadiens. [S. n.], « Prix Champlain », en ligne : http://refc.ca/prix-champlain/ (page consultée le 25 février 2019).
-
[76]
[S. n.], « Prix de poésie Terrasses Saint-Sulpice de la revue Estuaire », en ligne : http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/index.html (page consultée le 25 février 2019).
-
[77]
Voir Hughes Corriveau, « Et souigne la baquaise dans le coin de la boîte à bois ! », Lettres québécoises, no 80, hiver 1995, p. 37-38.
-
[78]
Cité dans Paulette Gagnon, « Patrice Desbiens : tout a commencé ici », Liaison, no 84, novembre 1995, p. 15. Il importe de signaler que cet article est un entretien avec Desbiens, auquel Dickson assiste, et non pas un compte rendu du livre.
-
[79]
Ibid. L’auteure souligne.
-
[80]
Ibid.
-
[81]
Elizabeth Lasserre, « Desbiens est de retour, Desbiens est en forme », Liaison, no 83, septembre 1995, p. 41.
-
[82]
Ibid.
-
[83]
Ibid.
-
[84]
Daniel-Louis Beaudoin, « Patrice Desbiens. Un pépin de pomme sur un poêle à bois », Moebius, no 66, hiver 1996, p. 150. Il faudrait citer tout l’article, dont l’ironie est acerbe.
-
[85]
Gilles Côté, « La fissure de la fiction, Patrice Desbiens », Nuit blanche, no 70, printemps 1998, p. 11.
-
[86]
« La fissure de la fiction, d’une réussite tout à fait remarquable, contient probablement les meilleures pages écrites par Desbiens depuis L’homme invisible/The Invisible Man, ce qui n’est pas peu dire. » François Ouellet, « La béance du quotidien », Liaison, no 94, novembre 1997, p. 27.
-
[87]
Jocelyne Felx, « Villes subjectives. Entre l’intime et l’universel, l’éternité a aussi des racines », Lettres québécoises, no 90, été 1998, p. 33.
-
[88]
Gilles Côté, « La fissure de la fiction, Patrice Desbiens », p. 11-12.
-
[89]
Chamberland, qui commence le court paragraphe qu’il consacre au recueil en signalant que « [l]a parution d’un livre de Patrice Desbiens est toujours un événement car nous ne savons jamais ce que cet écrivain nous réserve », le termine en disant : « Voilà un petit livre qui tient du journal, du recueil de pensées glanées au jour le jour, du poème parfois, mais qui pose l’authenticité comme règle d’écriture. » (Roger Chamberland, « Poésie », University of Toronto Quarterly, vol. LXVIII, no 1, hiver 1998-1999, p. 43.) Le jugement est donc loin d’être clair puisque « petit livre », « glanées », « poème parfois » sont de l’ordre du jugement négatif, alors que « l’authenticité comme règle d’écriture » pourrait être vue comme un élément positif.
-
[90]
David Cantin, « Désespoir ironique », Le Devoir, 17 janvier 1998, p. D3.
-
[91]
Nicolas Doire, « Désâmé, de Patrice Desbiens : Quand la mort se rapproche du quotidien », Liaison, no 128, automne 2005, p. 56; Gabriel Landry, « Less is more », Voix et Images, vol. XXX, no 3, printemps 2005, p. 170 ; François Paré, « Le mythe incomparable du pauvre », Canadian Literature, no 190, automne 2006, p. 155-156 ; et Mathieu Simard, « La vérité, toute la vérité », Salon double, 2013, en ligne : http://salondouble.contemporain.info/la-verite-toute-la-verite.
-
[92]
Elizabeth Lasserre, « Écriture mineure et expérience minoritaire : la rhétorique du quotidien chez Patrice Desbiens », Études françaises, vol. XXXIII, no 2, automne 1997, p. 63-76.
-
[93]
Ibid., p. 65.
-
[94]
Ibid., p. 75.
-
[95]
Ibid.
-
[96]
Jocelyne Felx, « Trois visions du quotidien », Lettres québécoises, no 98, été 2000, p. 43.
-
[97]
Ibid.
-
[98]
Marc Lemyre, « Patrice Desbiens et les Moyens du bord : solide échafaud », Liaison, no 105, février 2000, p. 23.
-
[99]
Jacques Paquin, « Chroniques de poètes », Lettres québécoises, no 111, automne 2003, p. 39.