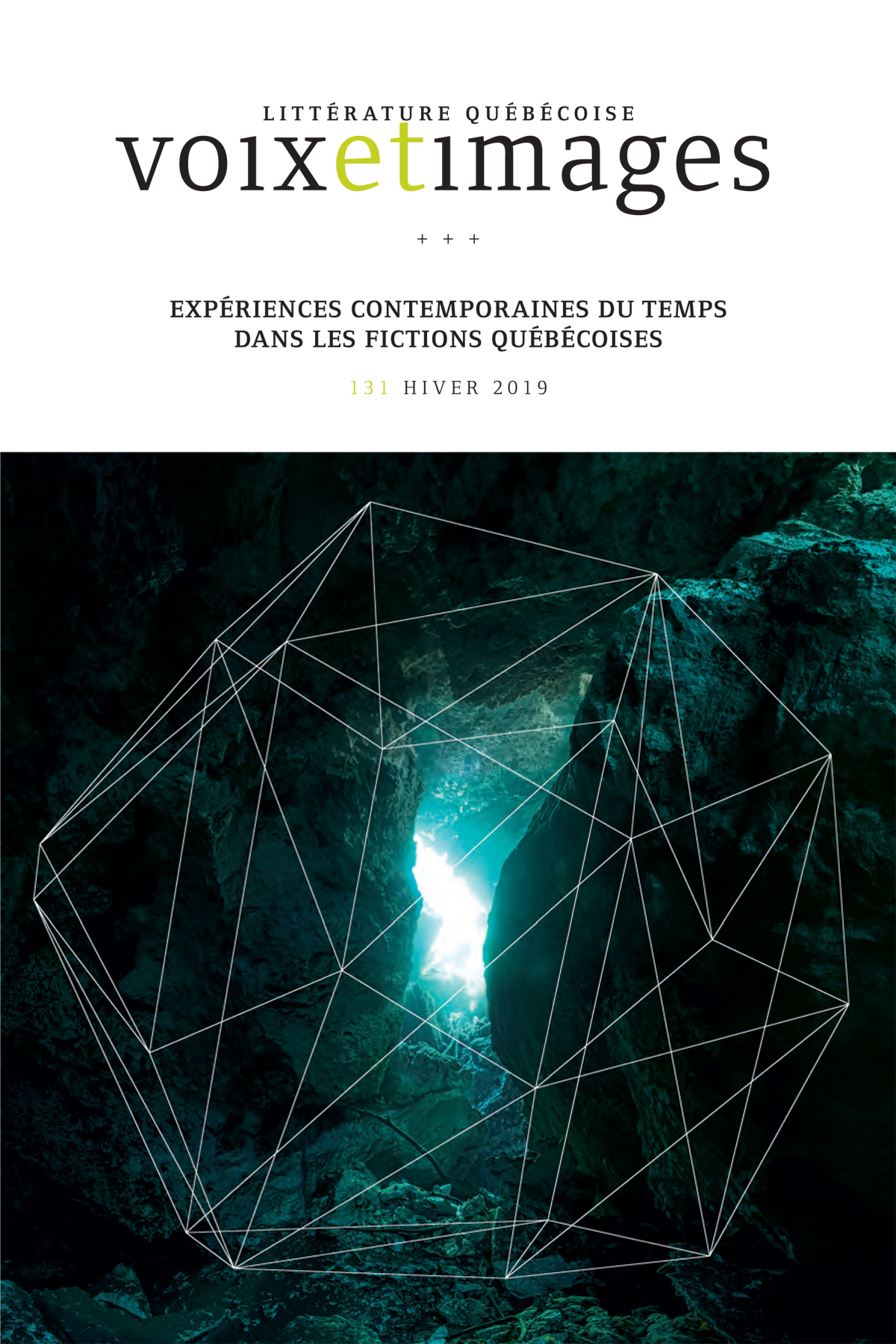Corps de l’article
Dans leur courte présentation de La poésie des Herbes rouges[1], Roxane Desjardins et Jean-Simon Desrochers reviennent sur le procès de « formalisme » qu’on a fait à la maison des frères Hébert (Marcel et François), en préférant, pour leur part, tracer le fil des « étonnements » : « le langage demeure une matière imprévisible, puissante » (10-11), ajoutent-ils. Ils insistent entre autres sur la cohabitation, à côté de ce souci langagier, de thèmes et d’approches comme ceux de la « contre-culture, [du] féminisme, [du] marxisme et [du] lyrisme » (10).
Comment, en effet, souligner les cinquante ans des éditions des Herbes rouges sans tomber dans la mise au tombeau, mais sans non plus être si débonnaire que l’événement en perde toute valeur ? C’est bien un étrange parcours, peut-être typiquement québécois, que celui que tracent cette revue d’abord, puis cette maison d’édition, qui ont eu comme projet d’innover et d’expérimenter, et qui perdurent dans le paysage poétique québécois. Celui-ci s’est grandement transformé ces dernières années, avec l’arrivée de plusieurs jeunes éditeurs. Dans un article récent de La Presse, Chantal Guy[2] notait justement, parmi les dix tendances de la littérature récente d’ici, une valorisation des jeunes auteurs, et tout particulièrement des « primoromanciers ». De même, les Quartanier, Poètes de brousse, Écrou, Peuplade, Oie de Cravan, Lézard amoureux et autres, en misant notamment sur des mises en pages soignées, ont pris de court les départages habituels entre grands et petits éditeurs, de même que les problèmes liés aux tirages. Le livre de poésie est, de toute manière, un objet à diffusion restreinte : aussi bien, dès lors, en faire un objet de valeur, qui transmettra à son lecteur une expérience mémorable, à contre-courant du flux informationnel et communicationnel qui nous submerge. En ce sens, les cinquante ans des Herbes rouges sont peut-être symptomatiques — et pour cette raison hautement significatifs — du contexte littéraire québécois, et même peut-être plus encore de notre contexte actuel.
L’Inconvénient proposait récemment un numéro sur l’uniformisation de l’exception[3], un thème cher à la revue. Les Herbes rouges, « contre-culturelles » et « étonnantes », participent-elles de cette mouvance ? Ont-elles préparé, à leur manière, cette explosion de petits éditeurs, tous situés dans la « différence » ? On peut bien sûr le croire, lorsqu’on rencontre des rébellions, des expérimentations et des surprises qui durent ainsi, au risque de se répéter. Mais pour qui parcourt cette anthologie, elle semble davantage marquée par un haut coefficient d’historicité. Certes les figures de style abondent, les marques de formalisme ne sont pas absentes, dans les divers protocoles utilisés, l’exploration des formes poétiques, les déconstructions syntaxiques, les niveaux de langue qui s’entrechoquent. Certes, cette « ouverture du réel » (10) que défendent les éditeurs, lorsque la suggestion tombe à pic sur une chose tangible trop présente, lorsque le ton de la vitupération domine, lorsque le langage parlé et vulgaire s’immisce dans la perfectibilité et la fragilité des formes, n’a rien a priori d’historique, lorsqu’elle mise sur le « flash » plutôt que sur la longue portée. Mais Les Herbes rouges présentent ce qui aura peut-être toujours manqué à l’Hexagone, son aînée comparable : une cohésion, un esprit de groupe qui dépasse les individualités, en sus d’un constant souci social (plutôt que politique, c’est-à-dire moins idéaliste, moins idéologique, plus pragmatique et plus observateur). Si l’Hexagone fut la NRF du Québec, Les Herbes rouges en furent une Éphémère continuée. L’Hexagone nous donna les aspirations du Québec, alors que Les Herbes rouges nous en donnèrent le réel situé. La première propose une histoire orientée, celle de l’avènement du pays ; pendant que la seconde dit : « Attendez, voici ce qui est vraiment arrivé. » D’où, forcément, un style un peu adolescent, une posture de révolte et de véhémence, comme s’il fallait écarquiller des yeux fermés. Mais une fois la poussière tombée, ce ne sont plus ces coups d’épée qui frappent, mais bien plutôt le portrait dessiné — et trop peu connu.
« Quel est l’éléphant dans la pièce ? » semblent se demander les poètes des Herbes rouges, avec un esprit frondeur, avec l’énergie de celui qui va exhiber ce que personne n’ose voir. Ce fut le corps, d’abord, pendant les années florissantes de la marche à la reconnaissance. Puis, ce qu’on a nommé l’intimisme, qui serait plutôt une tension entre le quotidien et l’universel. Puis un nouveau lyrisme, marqué par l’écriture personnelle et le retour des images. Enfin, depuis 2000 et à la faveur d’une nouvelle génération, une écriture plus suivie et narrative.
Le tout premier texte cité, de Marcel Hébert, nomme explicitement « Les corps d’encre » (15), à quoi répond peu après le « Corps convulsé » de Paul Chamberland ; ils seront suivis par toute une génération qu’on a qualifiée de formaliste, en oubliant que la forme première qu’ils accaparaient était celle des corps. A posteriori, en 1980, Normand de Bellefeuille le reconnaîtra narquoisement, en disant qu’il est « [é]tonnant d’ailleurs que l’on ait fait tout un courant, pour ne pas dire un genre, autour de cette simple coïncidence homophonique », qui fait rimer « sexe » et « texte ». Puis il ajoute : « Je n’y ai jamais vraiment cru bien que j’en aie aussi profité, on est moderne non ! » (137 ; l’exclamation finale se réclame de Rimbaud, dont il relate la lecture). Il ne s’agit pas seulement d’exhiber un corps trop longtemps défendu, mais peut-être davantage d’exhiber l’exhibition, de rendre évidente cette sortie, ce dehors conquis, dans une belle désinvolture toujours joueuse.
La suite basculera entre l’évidence des choses matérielles, ce « remue-ménage », ces « draps », « odeurs », « bruits », « pièce à débarras » et « salon » (128) qu’annonce Marcel Labine en 1979, et cette « autre histoire », façonnée elle aussi dans la matière (montagne, ruisseau, anneau, caravanes, drapeau) mais prospective, grâce au poème : « La langue est bizarre et incompréhensible. Elle est capable de prévoir ce qui allait suivre. […] Des pèlerins venus d’on ne sait où la saluent avec un drapeau. Mais ceci est une autre histoire. Nous n’en sommes pas encore là. » (François Charron, 167) Cet extrait est tiré du recueil François (1984), et on peut croire effectivement que la candeur et la simplicité d’un tel titre évoque l’intimisme ; mais ce serait ne pas voir sa part d’objectivité, au sens propre, ce regard porté vers l’extérieur et l’avant, vers les objets quotidiens comme vers le monde environnant. Au total donc, le formalisme s’avère beaucoup plus charnel qu’on aurait cru, et l’intimisme beaucoup plus objectif et universel.
C’est donc plutôt la période suivante qui marquera un retour au Je, qui implique dès lors un Tu, et qui ouvre la voie aux impressions, aux sensations, à tout un monde imaginaire. On en trouverait la formule et le programme dans ce poème d’André Roy, publié dans L’accélérateur d’intensité en 1990 [1987] :
201Les images vraies seront celles sur lesquelles je pleurerai quand tu auras disparu.
Les mots, on ne les prononcerait pas
qu’ils sortiraient tout seuls de la bouche.
Quelque part, je le sais, la Terre roule en sens inverse.
Jeune homme, lis la poésie
pour le souvenir des métaphores
qui, un jour, ont échappé aux lois de la pesanteur.
Je ne m’étonnerai pas de mon passé quand je te toucherai.
L’objectivité a montré ses failles, « la Terre roule en sens inverse » et on cherche à échapper « aux lois de la pesanteur ». On se tourne dès lors vers le passé, vers « la poésie » et « le souvenir des métaphores », seuls remèdes, non tant par mouvement réactionnaire, mais plutôt parce que la seule vérité se situe dans l’esprit, dans « les images vraies » quand tout le reste a « disparu ». José Acquelin et René Lapierre cristallisent plusieurs de ces tendances. Pour le premier, « la vie est moins compliquée que les vivants », ce qui montre la primauté d’un processus intérieur sur ses produits tangibles, et c’est à ce niveau que se situe la poésie : « il y a une chanson juste au milieu/elle naît au même moment/que ceux qui la chantent » (249). Pour le second, le monde existe tant qu’il est intériorisé, dans l’action du dialogue d’abord, et même, dans le changement de genre, le masculin devenant féminin, qui marque un endossement de l’altérité et un accueil plénier : « Alors je m’élève et deviens une éponge, et la nuit entre en moi comme une encre de mer, un alcool sombre, une eau d’anthracite. Et je deviens pluie ou forêt, gerboise, plancton, perdue dans l’immensité de ton absence ; dans ce vide-là où la mort serait un tendre, tendre baiser. » (251)
La dernière phase est marquée par une marche en avant et un mouvement, les actions du sujet sont prises à partie, de même que ses paroles, ses mots courants, qui innervent la diction poétique et lui donnent des allures de narration. La jeune génération adopte volontiers ce ton, de Tania Langlais à Roxane Desjardins : « que ça continue de rouler le soleil/je t’en prie ferme la porte » (317) ; « mais tu te déplaces au pas de course sur mes poumons/parce que tu habites au sommet de ma tête une envie démesurée/de dévorer les autres » (409). Au nouveau lyrisme succède donc, peut-être, un antilyrisme, la poésie devenant narrative et surtout prosaïque, sans désenchantement pourtant, mais au contraire avec un investissement certain. La poésie cherche à reconnaître le monde environnant, à se reconnaître, ou plutôt, à offrir au lecteur un paysage qu’il saura reconnaître. La poésie est faite par tous, selon le souhait de Ducasse, un mantra qu’auraient pu endosser les premiers poètes des Herbes rouges. Ainsi, par-delà ces phases successives, se dessine une nette continuité, ou plutôt un jeu de variations sur un même thème.
Le parti pris des éditeurs contribue à cet effet de longévité. En effet, cette « anthologie », peut-être mal nommée ainsi, présente l’ensemble des publications des Herbes rouges, tant la revue que l’éditeur. Certes ils ont dû choisir, parmi les recueils ou les suites, un poème ou une page en particulier. Mais tout le catalogue est représenté. Cette coupe parfaitement horizontale a ses attraits, au-delà du principe démocratique qui l’anime. Cette contrainte non contraignante offre un certain ludisme, qui serait bien l’un des derniers avatars d’un formalisme revenu de ses prétentions. La structure parfaitement chronologique, en tranches de dix ans, comme l’abécédaire, révèle des liens insoupçonnés, presque cabalistiques. La circularité n’est pas absente, surtout lorsqu’on rencontre à intervalles des images et des formules semblables. Mais il n’est pas innocent que la dernière période soit marquée par le thème de la vieillesse, tant chez les aînés que les plus jeunes ; et on ne sait plus alors si les poètes pensent à leur alma mater, ou au monde qui les environne. Lorsque François Charron avance, en 2006, « À l’envers, tu t’avances dans la joie d’avoir vieilli » (332), il pense certainement à son propre parcours ; mais Yannick Renaud, la même année et du haut de ses vingt-huit ans, semble donner le la d’une décrépitude ambiante : « Celui qui porte en lui le vent réalisera que vieillir s’apprend à force d’incompréhension./Le silence, tu le berceras, sachant que la mort reste encore le privilège des vivants. » (335) Ce serait dans ce mélange des forces et des âges que se présenteraient, aujourd’hui, Les Herbes rouges.
+
Pour preuve, trois recueils publiés dans la dernière année, de trois auteurs de générations différentes : Bien commun de Marcel Labine[4], dont le premier texte, « Lisse », remonte à 1975; Comment nous sommes nés de Carole David[5], qui pour sa part est entrée dans la maison en 1986, avec Terroristes d’amour; enfin Golgotha de Benoit Jutras[6], dont Nous serons sans voix fut publié en 2002.
Le recueil de Labine, manifestement hostile à notre époque, multiplie les attaques contre la société consumériste et désincarnée. Même si les formes évoquent des tonalités plaintives propres à un mauvais romantisme (lamentations, saudades, imprécations, hapax, etc.), la rhétorique est beaucoup plus celle de l’invective, de la parodie et de la condamnation. La plainte proviendrait plutôt du poème lui-même qui, malgré toute son énergie, n’arrive jamais vraiment à toucher ses cibles, comme Labine le note avec une lucidité tout aussi amère que stupéfiante : « Je sais que ce récit/N’y changera rien. » (165) Le poète pleure la disparition du « bien commun », d’un esprit d’entraide et de désintéressement qui aurait animé d’autres époques; mais le regard devient résolument passéiste et légèrement décalé, si on songe que cet « âge d’or » n’a peut-être jamais existé. Ainsi, regrettant les « vieux navigateurs » d’antan, animés par les rêves, il condamne les explorateurs d’aujourd’hui qui partent, « GPS en main,/[…]/Harponner Moby Dick », avant de conclure : « Au siècle des rancunes,/Vous verrez ce qu’il en coûte/De traquer le Grand Cachalot. » (133-134) Cette historiette me semble décalée, car Achab n’a jamais été un « vieux navigateur », sinon au sens où il fut le « dernier » navigateur, le modèle plus que l’antimodèle des avides et rancuniers d’aujourd’hui. Étrange manière, donc, de dire que le passé n’était pas plus fin que le présent, quand le propos voudrait faire entendre l’inverse. Et décalé, surtout, car la critique contre le consumérisme ne date pas d’hier, ce qui explique bien, d’ailleurs, l’abondance proprement étourdissante des métaphores qui parsèment ce recueil : les cibles sont si connues qu’elles ont déjà donné lieu aux travestissements les plus divers. Et à force de métaphoriser les travers de notre société, on en vient à ne plus reconnaître grand-chose, pris dans une autre forme de magma qui répond au supposé « bien commun » contemporain. Ce serait là une « ancienne manière » des Herbes rouges, qui ne fonctionne plus vraiment aujourd’hui.
Carole David est certainement plus actuelle, par son féminisme nouveau, par son imaginaire à la frontière du féerique et du gothique, par une écriture aussi naïve qu’incisive. « Éveillées par le malheur » (11), ses protagonistes se situent à l’heure des naissances, des éveils, des premières fois et des relances, sans jamais s’illusionner de faux espoirs mais en s’ouvrant constamment aux rêves néanmoins. On est dans une tempérance bien de notre temps, dans une écriture qui dénombre sans dramatiser, qui voit sans s’alarmer, où le bien et le mal ont définitivement disparu et que seule demeure une capacité à la survie. On songe aux « Ailes du désir », à cette espérance tout en gris, à des sourires feutrés et à des larmes insensibles : Woody le Pic côtoie le chérubin, le bowling moderne laisse place au cauchemar et à la chorégraphie, Bambi prête la main au Phénix (60-63, 38-39). Et le « nous » discret du titre en appelle peut-être plus fermement à une communauté où chacun a sa malchance, sa fée mauvaise qui veille à déconstruire les héros : « […] mortels, nous passerions/notre avenir dans un déluge, occupés à nous vêtir […] » (19).
Benoit Jutras, dans un recueil fort, a peut-être trouvé une voie, une échappatoire à cette époque qui se survit. L’écriture est volcanique, elle purifie par le feu, sans malice ni vergogne. La facture du recueil frappe, par une structure circulaire où les parties initiales sont reprises à la fin, en chiasme. Et pourtant, jamais cet ordre rigoureux ne donne l’impression de la redite ou de la monotonie, car s’y mêle un joyeux chaos qui défie toutes les rationalités. Plutôt que de structure, il vaudrait mieux parler de forme, donc, plus organique, plus dynamique. La parataxe est constante et produit des amalgames incendiaires :
le linge brûlé de toi tout brûlé now what fatiguée c’est fini, ton argent ton squelette ta voix tes cheveux partis, ils te mentent les nuits with shotguns, ta vie bad seed forget it le viol de toi, tes enfants pas les tiens, pas d’église walk straight for once, on and on eyes shut oublie forever.
137
Et malgré tout, la candeur est là, à travers un oeil d’enfant grand ouvert, qui a peur du « loup » (« j’en ai fait des loups autour de ton lit » [44]), et qui demande : « pourquoi il n’y a plus d’oliviers/dans la bouche de ma mère » (15). C’est le « mal dire » qui devient poésie, comme un achèvement et une somme des moyens d’expression, qui reprend à fleur de peau l’étonnement primitif, pas celui du rebelle mais celui de l’émerveillé sans prétention :
25Comment mal dire et quoi
moi en série d’étoiles dans le corps droit
moi petit graal de chambre
garçon chapitre jeté au feu
car privé c’est privé c’est désert
ça pue l’aigle.
Celui qui dit « mystère marche avec moi » (187), reprenant le mot de David Lynch, n’en vise pas moins une éclaircie, un réconfort, dans cette traversée du feu où il pourra retrouver une pureté perdue, et communier après le désastre :
Nous sommes sortis dans la chaleur, le soleil était insolent, nos parents étaient au champ, notre joie flottait dans l’air comme des poils de chiens blonds. Nous avons passé au crépuscule la frontière derrière les ifs. Sans autre réconfort face à l’opprobre que celui du tabac et du vin, nous avons quitté le froid des Écritures.
140
Ce sont encore, ou peut-être d’abord, des herbes rouges, des alcools brûlant les planches. Mais l’adolescent a fait place à l’enfant, les superpouvoirs succèdent à la révolte. Le poète n’est pas sur la place publique, il est dans les ruelles, et vous attend.
Parties annexes
Note biographique
NELSON CHAREST est professeur de poésie moderne à l’Université d’Ottawa. Il a publié aux éditions Nota bene un essai intitulé Vaisseau, le grand poème, un numéro de la revue Études littéraires portant sur « Le verset moderne » ainsi que le collectif Genres littéraires et peinture. Il a en outre publié des études sur Pierre Morency, Pierre Perrault, James Sacré, Coleridge, Nelligan, Loranger, Verlaine et Mallarmé, notamment. Il prépare un ouvrage sur la brièveté en poésie. Il a aussi publié aux éditions Le lézard amoureux un recueil intitulé Les icônes démodées.
Notes
-
[1]
Roxane Desjardins et Jean-Simon Desrochers (dir.), La poésie des Herbes rouges. Anthologie, Montréal, Les Herbes rouges, 2018, 445 p.
-
[2]
« Dix tendances (seconde partie) », La Presse, 11 mars 2018, en ligne : http://mi.lapresse.ca/screens/f3ce3645-8c0b-415c-9ef8-d6477fe104bb__7C___0.html (page consultée le 11 février 2019).
-
[3]
Numéro intitulé « Le néoconformisme », L’Inconvénient, no 75, hiver 2019. La revue avait précédemment publié un numéro intitulé « L’indifférente multiplication des différences », L’Inconvénient, no 24, hiver 2006.
-
[4]
Marcel Labine, Bien commun, Montréal, Les Herbes rouges, 2018, 190 p.
-
[5]
Carole David, Comment nous sommes nés, Montréal, Les Herbes rouges, 2018, 66 p.
-
[6]
Benoit Jutras, Golgotha, Montréal, Les Herbes rouges, 2018, 186 p.