Résumés
Résumé
Les anthropologues ont longtemps été imprégnés d’un certain athéisme méthodologique lorsqu’il s’agissait d’étudier les religions lointaines des « autres ». Or, une telle approche ne semble plus adaptée au genre de terrains réalisé aujourd’hui. Nous examinons brièvement les causes de ce « glissement tectonique » au sein de l’anthropologie, ainsi que ses conséquences pour les terrains religieux. Ensuite, nous explorons les nouvelles possibilités qu’offre l’émergence de ce que certains qualifient d’anthropologie « post-séculière », dont un nouveau dialogue avec la théologie.
Abstract
Anthropologists have long been inculcated to employ «methodological atheism» in their study of the exotic religions of other peoples. Such an approach no longer seems appropriate for the kinds of fieldwork being done today. I briefly examine the causes of this «tectonic shift» in anthropology, as well as its consequences for field studies of religion. Following this, I explore the new possibilities that are opening up with the emergence of what certain authors call «post-secular» anthropology, among them, a new dialogue with theology.
Corps de l’article
Les anthropologues ont longtemps été imprégnés d’un certain athéisme méthodologique lorsqu’il s’agissait d’étudier les religions lointaines des « autres ». Or, une telle approche ne semble plus adaptée au genre de terrains réalisé aujourd’hui. L’autre religieux se retrouve souvent chez soi ; il n’est pas rare que l’anthropologue soit (ou devienne) membre du groupe religieux à l’étude. Quoi qu’il en soit, les personnes que nous étudions sont toujours plus susceptibles de nous lire qu’avant. L’anthropologie du dedans (insider anthropology) est devenue de plus en plus courante. La distanciation des anthropologues par rapport à leurs objets d’étude n’est plus considérée comme gage d’objectivité. Par ailleurs, elle ne reflète plus forcément la rigueur intellectuelle du chercheur. En définitive, la réflexivité a largement remplacé l’objectivité à cet égard. Cet intérêt croissant pour les approches centrées sur l’expérience (également dénommées approches phénoménologiques ou expérientielles) fait de l’intersubjectivité un sujet central chez les anthropologues, notamment dans leurs études sur la religion (par exemple, Fabian 2001).
Après une courte présentation de l’athéisme méthodologique, nous reviendrons brièvement sur les causes de ce « glissement tectonique » au sein de l’anthropologie des dernières décennies, ainsi que ses conséquences pour les terrains religieux. Ensuite, nous explorerons les nouvelles possibilités qui s’étendent à travers l’émergence de ce que certains qualifient d’anthropologie « post-séculière », laquelle comprend un nouveau dialogue avec la théologie.
1. L’athéisme méthodologique
L’athéisme méthodologique représente la posture à adopter « par défaut » depuis les débuts de l’anthropologie. Dans cette optique, l’anthropologue mène sa recherche en partant du principe que les croyances de ses interlocuteurs sont fausses ; « le regard du chercheur est centré sur la création des dieux, des diables à partir de l’imaginaire humain » (Bialecki 2014). Il va sans dire que l’existence possible d’une tout autre réalité, d’une transcendance quelconque, est écartée de son approche. Avec cet « athéisme réductif » (Ewing 1994), la religion est réduite à ses fonctions purement économiques, politiques, psychologiques ou autres. Ainsi, nous ne sommes plus très loin de la religion perçue comme une forme de fausse conscience. L’athéisme méthodologique n’implique pas directement les croyances personnelles du chercheur, bien que la foi religieuse soit présentée comme un obstacle potentiel à l’objectivité face aux croyances des autres. L’approche consiste donc à éviter que la foi du chercheur devienne source de biais.
Une variante plus récente se distingue de l’athéisme méthodologique (tout particulièrement en sociologie) : l’agnosticisme méthodologique (Porpora 2006), où le chercheur ne se positionne pas sur la véracité ni la fausseté des croyances de l’Autre, mais en fait abstraction. Dans le cas de l’athéisme méthodologique, la réalité des informateurs est niée ; dans le cadre de l’agnosticisme méthodologie, elle est soit ignorée, soit mise de côté. Or, dans les deux cas, la polarité entre la science et la religion est tenue pour acquise et la distance imposée entre le chercheur et l’Autre demeure intacte.
The mantra of methodological agnosticism has required « religious » scholars to bracket (religious) commitments from their professional lives : to act, think and write as if the most neutral or objective position for enquiry is that of the agnostic or atheist. A « non-alignedness of religion » is imposed in the discipline, premised on the need for « distance » from « indigenous religious commitments » (Gellner 2001, 340).
Fountain 2013, 314
La distanciation du religieux, traditionnellement requise par la méthodologie anthropologique, découle principalement de l’influence de l’évolutionnisme d’Auguste Comte sur les pères britanniques de l’anthropologie moderne, pour qui la science représentait le progrès par rapport à la religion, mais aussi du positivisme (terme inventé par Comte) d’Émile Durkheim. Selon ce dernier, la religion était un phénomène voué à disparaître en faveur de la science des normes ; soit, la sociologie (Larson 2014). D’après les pères fondateurs de l’anthropologie, tels qu’Edward Tylor, James Frazer et Henry Maine, le christianisme représentait une expression avancée de la religion mais demeurait une étape dans le parcours de l’humanité vers la raison (Livingstone 2015, 438). Tout comme l’athéisme méthodologique, l’agnosticisme méthodologique était préconisé pour tous, peu importe leurs croyances religieuses. Celles-ci étaient conçues comme source de biais potentiel pouvant affecter les cadres méthodologiques en vigueur dans les années 1970, et qui persistent encore aujourd’hui (Bell et Taylor 2014). D’où la parution de l’article intitulé : « Must a Scholar of Religion Be Methodologically Atheistic or Agnostic ? » (Cantrell 2018).
Néanmoins, certaines voix dissidentes et illustres se faisaient déjà entendre dès le xixe siècle. Parmi celles-ci, le chercheur comparatiste sur la religion, William Robertson Smith (1846-1894) ; ce dernier avait trouvé des ressources pour la foi et la théologie dans ses recherches anthropologiques (Livingstone 2015). Par la suite, plusieurs figures éminentes de l’anthropologie britannique se sont distanciées des prémisses de l’athéisme méthodologique ; parmi eux, on comptait E. E. Evans-Pritchard, Mary Douglas et Victor Turner, ainsi que son épouse et collaboratrice, Edith Turner. En outre, Evans-Pritchard et le couple Turner se sont convertis au catholicisme, et Mary Douglas a été élevée dans cette foi (Larson 2014).
D’après ces anthropologues, le fait d’être croyants ne posait pas d’obstacle à leurs travaux scientifiques ; il s’agissait plutôt d’un atout qui pouvait même s’inscrire au centre de leurs recherches, notamment celles du couple Turner sur le pèlerinage chrétien (1978). En cela, ils allaient donc à contrecourant de leur discipline qu’Evans-Pritchard (1962, 44) désignait d’ailleurs comme « complètement séculariste » (« a thoroughly secularist discipline »). Ce dernier estimait ses collègues africanistes comme incapables de comprendre des religions non occidentales, et ce en raison de leur athéisme (Fortes 1987, 288 ; voir aussi Blanes 2006). De son point de vue, la religion est mieux appréhendée par quelqu’un qui connait l’expérience de la religion. Selon lui, « le non-croyant risque de parler de la religion comme un homme aveugle des couleurs, ou bien, une personne sans oreille d’une belle composition musicale » (Evans Pritchard 1965, 121, repris par Engelke 2002, 6). Quant à Victor et Edith Turner, leur conversion au catholicisme — suite à leur désillusion face au marxisme — a suscité l’hostilité de leurs collègues au département d’anthropologie sociale de l’Université de Manchester, majoritairement marxistes et de conviction athée ou agnostique. Ces derniers considéraient leur conversion comme allant à contresens de leur identité, connue comme la « Manchester School » : « It is not too much to say that there was at least a fear that the conversion of the Turners might have destroyed the Manchester School » (Larson 2014, 182).
Le couple finit par s’établir aux États-Unis.
Dans le contexte américain, le relativisme culturel permettait aux anthropologues de s’immerger dans des religions exotiques, mais ce, à condition de prendre une distance convenable par la suite. Dans les années 1970, les avertissements contre le danger de « devenir natif » (going native) abondaient toujours dans le domaine de l’anthropologie américaine, le cas de Frank Cushing pouvant servir de preuve à l’appui. En effet, Cushing avait été initié à une fraternité religieuse zuni (warrior society) et refusait de divulguer leurs secrets sacrés. Un cas plus récent concerne Benetta Jules-Rosette, convertie à la religion qu’elle étudiait en Zambie (Tedlock 1991 ; voir aussi Jorgensen 2015).
2. Vers l’anthropologie expérientielle[1]
Il est impossible de résumer en quelques lignes les multiples causes de l’émergence de l’anthropologie centrée sur l’expérience. L’anthropologie féministe et la présence d’un plus grand nombre de femmes au sein des départements d’anthropologie depuis les années 1980 ont sans doute contribué à un nouvel intérêt pour le corps et les émotions, thèmes jusqu’alors plutôt marginaux. En parallèle, les critiques de l’anthropologie objectiviste, illustrées par Clifford et Marcus (1983) et Fabian (1983), mais plus généralement par le courant postmoderniste et son questionnement relatif à la science, ont également eu un impact sur les façons de faire et d’écrire le terrain ethnographique. Les transformations derrière le nouvel intérêt pour l’expérience en anthropologie — et notamment l’expérience incorporée (embodied) — vont même au-delà de l’académie et impliquent la religion tout comme les sciences sociales. Face à cette tendance, l’ethnologue belge André Droogers (1994) a repéré des développements parallèles en anthropologie et dans le domaine du religieux, en particulier dans son étude sur les pentecôtistes. Cette concordance, selon l’auteur, correspond à un changement épistémologique où le « réalisme naïf » cède la place à ce qu’il dénomme « l’holisme existentiel », tant en religion qu’en anthropologie.
Nous qualifiions l’anthropologie expérientielle comme une variante des approches phénoménologiques, où l’intersubjectivité entre l’anthropologue et les personnes étudiées représente une voie légitime vers la connaissance, et où le monde vécu (le Lebenswelt de Schutz et de Husserl) des autres est accessible au chercheur (du moins en partie)[2]. Une autre prémisse de l’anthropologie expérientielle relève du fait que les connaissances du chercheur dérivent de son positionnement par rapport à l’objet de recherche. Le travail de terrain n’est pas seulement le moyen d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration des connaissances, mais constitue également le processus même de construction du savoir ethnographique, et donc, incarne une donnée en soi. Le chercheur qui décide d’adopter une perspective proche de l’expérience de l’autre, désignée en anglais comme experience-near (Wikan 1991), s’engage de façon holistique (feeling-thinking selon l’auteure).
À l’heure actuelle, le statut d’étranger de l’anthropologue n’est plus garante d’objectivité ou de rigueur scientifique ; par ailleurs, il est de plus en plus courant de mener des recherches « natives », d’une perspective interne de chez soi. Néanmoins, les auteurs du courant expérientiel doivent souvent faire face à des remises en question de leur crédibilité scientifique, notamment lorsque leur objet d’étude concerne la religion ou la spiritualité. De fait, la démarche expérientielle se doit d’être combinée à des techniques d’enquête conventionnelles (recueil de généalogies, entrevues semi-structurées, etc.). Par ailleurs, plusieurs chercheurs appartenant à ce courant et travaillant sur le religieux font preuve d’une réflexivité exemplaire (par ex., Ewing 1994 ; 2008), ce qui semble souvent faire défaut dans les études objectivistes et distanciées (McGuire 2002).
L’approche expérientielle peut s’appliquer à un éventail assez varié de phénomènes, et se montre particulièrement appropriée à l’étude de l’expérience incorporée (embodied), tels les arts martiaux (par ex., Samudra 2008). Dans le domaine de la religion et des spiritualités, nous pensons aux travaux d’Edith Turner sur la guérison (1994), de Bowie (2014), ainsi qu’à l’anthropologie « existentielle » de Piette (2005) dans son étude sur le deuil. Mentionnons également les travaux de Dubisch (2005, 2008) sur la guérison énergétique et de Michal Pagis (2009, 2010) sur le yoga vipassana. Plusieurs auteurs, dont Barbara Tedlock (2005), Jean-Guy Goulet (2008) et nous-mêmes (Meintel 2011), ont vécu des expériences extraordinaires (visions, divination, clairvoyance) à travers les terrains participatifs qu’ils ont menés. Ceci n’a pas entravé leurs analyses, mais bien au contraire, cela leur a permis de les enrichir (Goulet 2011, 118).
Précisons que le positionnement idéologique ou religieux des ethnologues par rapport aux personnes étudiées est variable[3] ; par exemple, des études très intéressantes sur l’expérience soufi ont été menées par des chercheures qui ne se sont pas converties (Ewing 1994 ; Pezeril 2010). Une vaste enquête que nous avons dirigée sur les religions et spiritualités contemporaines au Québec[4] était justement centrée sur l’expérience religieuse des personnes étudiées. Les assistants se situaient de façons très diverses par rapport aux groupes avec lesquels ils travaillaient ; certains étaient étrangers au groupe, d’autres étaient membres ou anciens membres et une partie d’entre eux avait ou avait eu des rôles de leadership au sein du groupe. Par ailleurs, leur positionnement face à la religion était très variable ; en effet, quelques-uns se définissaient même comme étant agnostiques. Toutefois, cela ne les a pas empêchés d’employer des moyens pour se rapprocher de l’expérience des participants. Notons que dans un certain nombre de cas, leur positionnement relatif au religieux a évolué au cours de la recherche ; de manière générale, ce changement n’était pas accompagné d’une conversion mais plutôt d’une certaine ouverture spirituelle.
3. Ludisme méthodologique
Dans l’une de ses études, André Droogers, que nous avons déjà cité, et Kim Knibbe se demandent comment comprendre la religion dans un contexte où elle ressemble moins à un ensemble de croyances qu’à des pratiques/performances : « How to understand religion in a context where it was not so much “believed” as “enacted”, where new perspectives of being and new perspectives on the supernatural are opened up ? » (Knibbe et Droogers 2011, 288).
Le questionnement des auteurs nous paraît très pertinent pour le religieux de nos jours, où le contenu des croyances semble moins important que le fait de croire, mais aussi où les croyances (soit, des propositions auxquelles les gens adhèrent) ne sont pas nécessairement les causes de leurs comportements et peuvent fortement varier au sein d’une même religion ou d’un courant spirituel (Mair 2012 ; Asad 2003 ; voir aussi Lemieux et Milot 1992).
L’argument de Droogers (1996) au sujet du ludisme méthodologique est trop complexe pour l’exposer en détail ici. Schématiquement, l’auteur propose que l’anthropologue entre dans le « jeu » du religieux, tout en sachant qu’il devra s’en distancier intellectuellement pour pouvoir rédiger, analyser, et commenter ce qu’il a observé (et vécu)[5]. Comme nous l’avons souligné plus haut, les anthropologues qui s’inscrivent dans le courant « existentiel » finissent par faire cette alternance. Tout en constatant l’aspect créatif et ludique du religieux, Droogers propose aux anthropologues d’intégrer cet aspect ludique à leur méthode (c’est-à-dire de jouer sur deux registres à la fois) et de découvrir leurs propres marques dans les religions qu’ils étudient. Ainsi, selon l’auteur, l’étude interdisciplinaire du religieux fera un bond en avant. Dans une co-publication ultérieure (Knibbe et Droogers 2011), les auteurs concèdent que les répercussions humaines du ludisme méthodologique sont imprévisibles. Finalement, dès que l’anthropologue accepte de « jouer le jeu », sa subjectivité s’ouvre de manière imprévisible, tout comme dans les approches expérientielles (voir, par exemple, Fabian 2001). C’est toujours le cas, même quand les anthropologues s’octroient de la distance pour rédiger et analyser les résultats de leur recherche, comme le font ceux qui s’inscrivent dans le courant « expérientiel ».
Nos recherches entrent particulièrement en résonance avec les propos de Droogers. Aux îles du Cap-Vert, où nous avons travaillé dans les années 1970 et 1990, les personnes que nous rencontrions parlaient d’un certain rituel (tabanca) célébré sur l’île de Santiago comme d’un « jeu de l’esprit ». Dans le cadre de ce rituel, des gens noirs et pauvres, qui semblaient avoir des origines africaines, détenaient divers rôles, tels que la « reine » et le « roi ». D’autres mentionnaient la nécessité de « jouer sérieusement » (brinca sério) pour les fêtes populaires des saints, célébrées chaque été dans les différentes îles de l’archipel. Plus près de chez nous, nous avons mené des recherches dans une église spiritualiste à Montréal. Dans le cadre d’une enquête basée sur des entrevues et de l’observation participante, j’ai fréquenté un petit groupe (ou « cercle » selon le parler spiritualiste) dans lequel le but était d’éveiller les dons spirituels des participants, notamment la voyance. Typiquement, les néophytes commençaient à pratiquer la voyance en laissant venir à leur esprit des images qu’ils considéraient simplement, au début, comme des produits de leur imagination. Au début de l’enquête, notre approche a été justement de « jouer le jeu », et ce, sans aucune attente. En fait, nous pensions que nous ne « verrions » rien dans les exercices de voyance. La suite (détaillée dans Meintel 2007 et 2011) a été surprenante et parfois déroutante. Enfin, les effets de la « participation intime » sur le chercheur, traités par Droogers (Note 6), ne sont pas toujours limités par le temps et l’espace dédiés du terrain.
4. L’anthropologie « post-séculière » et la théologie
Selon Joel Robbins (2006), l’anthropologie des récentes décennies théorise le monde en termes de violence et de conflit (à ce sujet, voir aussi Ortner 1984 et Ortner 2016). Inspiré par le théologien Milbank (1990), Robbins estime que l’anthropologie a perdu de vue la mission qui l’avait inspirée auparavant, soit celle de découvrir l’altérité radicale et ses ontologies sociales complètement différentes des nôtres. Cette mission portait l’espoir de découvrir que quelque part dans ce monde, les gens vivent une vie qui « valait vraiment la peine » (2006, 292). Bien que cette mission trahissait une certaine naïveté, elle connotait l’idée que les autres avaient des acquis culturels — des savoirs, des façons de vivre en société — que nous pouvions étudier à profit. Nous avions, enfin, quelque chose à apprendre des autres.
Récemment, le sécularisme qui prédominait dans l’anthropologie a subi des remises en question, en particulier en anthropologie de la religion. Charles Stewart (2001), par exemple, envisage ce qu’il appelle le « sécularisme » comme un obstacle à la recherche. Selon l’auteur, l’anthropologie « s’accroche à l’idéal du sécularisme », et ce, malgré le renouveau religieux à travers le monde. En conséquence, il y a peu de variations dans les perspectives des chercheurs quant aux analyses anthropologiques de la religion. Par ailleurs, le chercheur marqué par le sécularisme se trouve dans une position difficile sur le terrain : « How can I expect them to reveal the mystical secrets of their religion to me if I neither “believe” in those secrets nor, for that matter, in the mystical power of any religion ? » (Stewart 2001, 327).
Une complication supplémentaire relève du fait que, comme l’a judicieusement remarqué André Mary (2000), les personnes étudiées par les anthropologues sont souvent amenées à lire leurs publications et trouvent offensants les guillemets employés par des chercheurs qui semblaient pourtant respecter leur vision du monde.
Le courant postmoderniste en anthropologie a ébranlé la polarité classique entre science et religion, tout en soulignant la dimension construite et contextuelle des modèles scientifiques (voir Droogers 2002, 60). Ce changement ainsi que d’autres, mentionnés plus haut, ont donné lieu à de nouvelles approches méthodologiques et épistémologiques[6] qui gagnent en légitimité, notamment en ce qui concerne l’étude du religieux. Dès lors, il devient de nouveau admissible d’apprendre « de » et non seulement « sur » les gens que nous étudions.
Certains auteurs, tels que Fountain (2013), Merz et Merz (2015, 2017), font allusion à l’émergence d’une anthropologie « post-séculière » et cherchent un nouvel engagement dans la théologie. Selon Fountain, cette anthropologie n’existe pas encore, mais ses contours commencent à se dessiner dans les critiques de l’athéisme méthodologique, et aussi dans les réflexions sur l’impact du sécularisme sur la construction du savoir en anthropologie et sur son exclusion de la théologie des approches anthropologiques. Citons, à titre d’exemples, les anthropologues qui aspirent au développement d’une anthropologie dépassant la simple observation de la misère du monde — thème soulevé par Robbins (2006) — et qui sont à la recherche de ressources théologiques dans le but de construire une herméneutique de l’espoir (Fountain 2013, 317).
Tandis que Fountain met l’accent sur la pertinence de l’étude de la théologie chrétienne pour l’anthropologie du christianisme, Merz et Merz insistent sur l’importance d’une rencontre critique ; la théologie étant, tout comme de l’anthropologie, façonnée par ses origines occidentales et chrétiennes. Les auteurs, qui s’identifient comme chrétiens, commentent l’absence de théologie africaine, notamment dans ses formes non chrétiennes (voir aussi van Binsbergen 1991) :
Re-establishing the relationship between anthropology and theology should take the form of a dialogue in which anthropology contributes to theology as well, especially in view of a better representation of non-Western theologies, whether they be specifically Christian or not.
Merz et Merz 2015, 6
Meneses et ses coauteurs (2014, 86), qui se considèrent comme chrétiens évangéliques, estiment que si la théologie chrétienne était employée au moins comme outil critique, cela permettrait à l’anthropologie de développer une compréhension plus riche de l’humanité comme « more than just a species in nature ». Par ailleurs, ils proposent une analyse de la violence dans laquelle ils tentent d’illustrer l’apport de la pensée chrétienne à l’analyse anthropologique de ce problème. Faisant écho à Priest (2001), Howell juge que les chrétiens et le christianisme sont stigmatisés en anthropologie comme « l’Autre répugnant », « the repugnant cultural other »[7], « occupying a subject position analogous to other subject positions which are characterized by moral/ethical commitments, for example, feminism » (Howell 2007, 372).
L’auteur mobilise plusieurs exemples pour mettre en valeur l’intérêt des perspectives religieuses, surtout chrétiennes, dans les recherches anthropologiques, par exemple, sur le pêché (Priest 2000).
Enfin, Bielo (2018) reprend la question de la relation entre l’anthropologie et la théologie, en proposant non seulement un dialogue, mais aussi des collaborations entre les deux disciplines qui pourraient favoriser l’épanouissement humain tout en luttant contre l’injustice. En effet, la rigueur empirique des recherches en anthropologie pourrait renforcer la critique prophétique en théologie, contribuant ainsi au succès public de celle-ci[8]. Bielo (2018) poursuit ses réflexions en suggérant aux anthropologues souhaitant mobiliser leurs recherches à des fins normatives (combattre l’injustice, par exemple) de s’inspirer des travaux en théologie ethnographique, telles que l’étude de Mary McClintock Fulkerson (2007) sur une congrégation socialement diverse à Durham, North Carolina, et celle de Nathalie Wigg-Stevenson (2014) sur la vie théologique d’un groupe baptiste à Nashville. À l’inverse, l’auteur conseille aux théologiens de regarder au-delà des modèles classiques de terrain et de suivre l’exemple de l’anthropologue Laura Nader (1969), qui a préconisé l’étude des élites contrôlant les structures institutionnelles de la société.
Conclusion
Nous avons souvent entendu dire qu’à la différence des anthropologues, les théologiens se situent à l’intérieur du religieux. Actuellement, un certain nombre d’anthropologues acceptent de se placer à l’intérieur du religieux et prennent le risque d’être « affectés » (Favret-Saada 1990) ou « transformés » (Goulet et Miller 2007) et de découvrir que leurs informateurs détiennent un savoir qui pourrait se révéler valide pour eux aussi, en tant qu’êtres humains (Ewing 1994, 571). Bien que cette anthropologie post-séculière soit au stade d’émergence, on y discerne déjà plusieurs caractéristiques récurrentes, notamment l’ouverture vers le savoir et les approches théologiques et le rejet de l’athéisme méthodologique comme condition sine qua non en matière de rigueur intellectuelle. On remarque également une ouverture de la part de certains chercheurs vers des travaux intégrant l’engagement religieux de l’anthropologue. Un nouveau dialogue semble sur le point d’être amorcé entre une anthropologie dite « post-séculière » et la théologie — au profit potentiel des deux disciplines[9]. Tout comme Bielo, cité plus haut, nous espérons que ce dialogue engendre des collaborations actives où la tradition empirique de l’anthropologie sera enrichie par l’imagination morale de la théologie.
Parties annexes
Note biographique
Deirdre Meintel est professeure titulaire et directrice du Groupe de recherche Diversité urbaine au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Elle travaille actuellement sur des analyses de données d’une enquête sur les religions au Québec qui a touché plus que 230 groupes religieux ou spirituels à travers la province. Elle développe également des projets de recherche sur les migrants catholiques au Québec et sur les collaborations interconfessionnelles. Elle a récemment publié (2018) D. Meintel, et al., L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain, Presses de l’Université de Montréal.
Notes
-
[1]
Cette section est largement basée sur Meintel (2016).
-
[2]
Bloch (2007, 67) souligne que l’intersubjectivité (mutual mind reading) est la condition même d’une compréhension mutuelle nécessaire aux êtres humains.
-
[3]
Nous songeons ici à la monographie de James Aho sur des membres de la droite religieuse dans l’état d’Idaho aux États-Unis.
-
[4]
232 groupes issus de plusieurs régions et villes ont été touchés par cette recherche financée par le FRQSC et le CRSH.
-
[5]
« They need to find an equilibrium between distant observation and intimate participation. While observing, they belong to two domains ; while participating, they belong to one only. When only observing they cannot participate, and vice versa. Fieldworkers often report on the play-acting needed in such situations. They too experience […] tension between multiple selves and the illusion of wholeness, and find a way to manage these contradictions. » (Droogers 1996, 59-60).
-
[6]
On doit y inclure le courant ontologique en anthropologie que nous n’avons pas présenté en raison de contraintes d’espace (voir, par exemple, Clammer et al. 2004).
-
[7]
Le terme est emprunté à Susan Harding (1991), qui juge que les chrétiens conservateurs représentent cet Autre répugnant des anthropologues.
-
[8]
« […] mobilizing the empirical rigor of anthropology to refine and advance the public success of prophetic theological critique » (Bielo 2018, 30).
-
[9]
Voir en particulier Lemons (2018), Theologically Engaged anthropology, un recueil de contributions d’anthropologues et de théologiens.
Bibliographie
- Aho, J. (1990), The Politics of Righteousness, Seattle, University of Washington Press.
- Asad, T. (2003), Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford, Stanford University Press.
- Bell, E. et S. Taylor (2014), « Uncertainty in the Study of Belief. The Risks and Benefits of Methodological Agnosticism », International Journal of Social Research Methodology, 17/5, p. 543-557.
- Bialecki, J. (2014), « Does God Exist in Methodological Atheism ? On Tanya Lurhmann’s When God Talks Back and Bruno Latour », Anthropology of Consciousness, 25/1, p. 32-52.
- Blanes, R. L. (2006), « The Atheist Anthropologist. Believers and Non-Believers in Anthropological Fieldwork », Social Anthropology, 14/2, p. 223-234.
- Bloch, M. (2007), « Durkheimian Anthropology. Going in and out of Each Other’s Bodies », dans H. Whitehouse et J. Laidlaw, dir., Religion, Anthropology and Cognitive Science, Durham, Carolina Academic Press, p. 63-80.
- Bowie, F. (2014), « Believing Impossible Things. Scepticism and Ethnographic Inquiry », dans J. Hunter et D. Lukes, dir., Talking With the Spirits. Ethnographies from Between the Worlds, Brisbane, Daily Grail Publishing, p. 19-56.
- Cantrell, M. A. (2016), « Must a Scholar of Religion Be Methodologically Atheistic or Agnostic ? », Journal of the American Academy of Religion, 84/2, p. 373-400.
- Clammer, J., S. Poirer, et E. Schwimmer (2004), « Introduction. The Relevance of Ontologies in Anthropology. Reflections on a New Anthropological Field », dans J. Clammer, S. Poirier et E. Schwimmer, dir., Figured Worlds, Ontological Obstacles in Intercultural Relations, Toronto, University of Toronto Press, p. 3-22.
- Desjarlais, R. et C. J. Throop (2011), « Phenomenological Approaches in Anthropology », Annual Review of Anthropology, 40, p. 87-102.
- Droogers, A. (1994), « Normalization of Religious Experience. Healing, Prophecy, Dreams and Visions », dans K. Poewe, dir., Charismatic Christianity as a Global Culture, Columbia, University of South Carolina Press, p. 33-49.
- Droogers, A. (1996), Methodological Ludism Beyond Religionism and Reductionism, dans A. van Harskamp, dir., Conflicts in Social Science, London / New York, Routledge, p. 44-67.
- Dubisch, J. (2005), « Body, Self and Cosmos in “New Age” Energy Healing », dans E. Lorek-Jezinska et K. Wieckowska, dir., Corporeal Inscriptions. Representations of the Body in Cultural and Literary Texts and Practices, Torun, Nicholas Copernicus University Press, p. 221-235.
- Dubisch, J. (2008), « Challenging the Boundaries of Experience, Performance, and Consciousness. Edith Turner’s Contributions to the Turnerian Project », dans G. S. T. John, dir., Victor Turner and Contemporary Cultural Performance, New York, Berghahn Books, p. 324-335.
- Engelke, M. (2002), The Problem of Belief. Evans-Pritchard and Victor Turner on “the Inner Life”, Anthropology Today, 18/6, p. 3-8.
- Evans-Pritchard, E. E. (1962), « Religion and the Anthropologists », Essays in Social Anthropology, London, Faber, p. 29-45.
- Evans-Pritchard, E. E. (1965), Theories of Primitive Religion, Oxford, Clarendon Press.
- Ewing, K. P. (1994), « Dreams from a Saint. Anthropological Atheism and the Temptation to Believe », American Anthropologist, 96/3, p. 571-583.
- Fabian, J. (2001), « Remembering the Other. Knowledge and recognition », Anthropology with an Attitude. Critical Essays, Stanford, Stanford University Press, p. 158-178.
- Favret-Saada, J. (1990), « Être affecté », Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 8, p. 3-9.
- Fortes, M. (1987), Religion, Morality and the Person. Essays on Tallensi Religion, Cambridge, Cambridge University Press.
- Fountain, P. (2013), « Toward a Post-Secular Anthropology », The Australian Journal of Anthropologye, 24, p. 310-328.
- Gellner, D. N. (2001), « Studying Secularism, Practising Secularism. Anthropological Imperatives, in Secularism. Personal Values and Professional Evaluations, » Social Anthropology, 9/3, p. 337-340.
- Goulet, J.-G. (1998), Ways of Knowing. Experience, Knowledge, and Power among the Dene Tha, Vancouver, UBC Press.
- Goulet, J.-G. (2011), « Trois manières d’être sur le terrain. Une brève histoire des conceptions d’intersubjectivité », Anthropologie et sociétés, 35/3, p. 107-125.
- Goulet, J.G., et B. G. Miller (2007), dir., Extraordinary Anthropology. Transformations in the field, Lincoln, University of Nebraska.
- Harding, S. C. (1991), « Representing Fundamentalism. The Problem of the Repugnant Cultural Other », Social Research, 58/2, p. 373-393.
- Howell, B. M. (2007), « The Repugnant Cultural Other Speaks Back. Christian Identity as Ethnographic “Standpoint” », Anthropological Theory, 7/4, p. 371-391.
- Jackson, M. (1989), Paths Toward a Clearing, Bloomington, Indiana University Press.
- Jackson, M. (1996), Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology, Bloomington, Indiana University Press.
- Jorgensen, D. L. (2015), « Participant Observation », dans R. Scott and S. Kosslyn, Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences, Wiley Online Library, p. 1-15.
- Knibbe, K. et A. Droogers (2011), « Methodological Ludism and the Academic Study of Religion », Method and Theory in the Study of Religion, 23, p. 283-303.
- Larson, T. (2014), The Slain God. Anthropologists and the Christian Faith, Oxford, Oxford University Press.
- Lemieux, R. et M. Milot (1992), dir., Les Croyances des Québécois. Esquisses pour une approche empirique, Cahiers de recherches en sciences de la religion, 11.
- Livingstone, D. (2015), « Finding Revelation in Anthropology. Alexander Winchell, William Robertson Smith and the Heretical Imperative, BritishJournal for the History of Science, 48/3, p. 435-454.
- Mair, J. (2012), « Cultures of Belief », Anthropological Theory, 12/4, p. 448-466.
- Mary, A. (2000), « L’anthropologie au risque des religions mondiales », Anthropologie et sociétés, 24/1, p. 117-135.
- Merz, J. et S. (2015), « Secular and Religious Symbiosis. Strengthening Postsecular Anthropology through Commitments to Faith », Communication présentée à la Annual Conference of the Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth, ASA15 : Symbiotic anthropologies : theoretical commensalities and methodological mutualisms, University of Exeter, 13-16 avril ; www.academia.edu/12735521/Secular_and_Religious_Symbiosis_Strengthening_Postsecular_Anthropology_through_Commitments_to_Faith.
- Merz, J. et S. (2017), « Occupying the Ontological Penumbra. Towards a Postsecular and Theologically Minded Anthropology », Religions, 8/5, 80, p. 1-17.
- Mcguire, M. (2002), « New Old Directions in the Social Scientific Study of religion. Ethnography, Phenomenology and the Human Body », dans J. V. Spickard, S. Landres et M. McGuire, Personal Knowledge and Beyond. Reshaping the Ethnography of Religion, New York, New York University Press, p. 195-211.
- Fulkerson, M. M. (2007), Places of Redemption. Theology for a Worldly Church, Oxford, Oxford University Press.
- Meintel, D. (2007), « When the Extraordinary Hits Home. Experiencing Spiritualism », dans J.-G. Goulet et B. G. Miller, dir., Extraordinary Anthropology. Transformations in the field, Lincoln, University of Nebraska, p. 124-157.
- Meintel, D. (2011), « Apprendre et désapprendre. Quand la médiumnité croise l’anthropologie », Anthropologie et sociétés 35/3, p. 89-106.
- Meintel, D. (2016), « Anthropologie expérientielle », disponible sur www.anthropen.org/quisommesnous.
- Merleau-Ponty, M. (1973), « Phenomenology and the Sciences of Man », dans M. Natanson, dir, Phenomenology and the Social Sciences, vol. I, Evanston, Northwest University Press, p. 47-108,
- Milbank, J. (1990), Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Oxford, Blackwell.
- Nader, L. (1969), « Up the Anthropologist. Perspectives Gained from Studying Up », dans D. Hymes, dir., Reinventing Anthropology, New York, Vintage Press, p. 284-311.
- Ortner, S. (1984), « Theory in Anthropology since the Sixties », Comparative Studies in Society and History, 26/1, p. 126-166.
- Ortner, S. (2016), « Dark Anthropology and Its Others. Theory since the Eighties », Journal of Ethnographic Theory, 6/1, p. 47-73.
- Pagis, M. (2009), « Embodied Self-Reflexivity », Social Psychology Quarterly, 72/3, p. 265-283.
- Pagis, M. (2010), « Intersubjectivity in Silence. An Ethnographic Study of Meditation Practice », Ethnography, 11/2, p. 309-328.
- Pezeril, C. (2010), « L’anthropologue “insouffisant”. Implication du corps et esprit de la voix en pays Baay Faal », Social Compass, 57/4, p. 449-464.
- Piette, A. (2005), Le temps du deuil. Essai d’anthropologie existentielle, Paris, Les Éditions de l’Atelier et Éditions ouvrières.
- Porpora, D. V. (2006), « Methodological Atheism, Methodological Agnosticism and Religious Experience », Journal for the Theory of Social Behaviour, 36/1, p. 57-75.
- Priest, R. (2000), « Christian Theology, Sin and Anthropology », dans W. R. Adams et F. Salamone, dir., Anthropology and Theology. God, Icons and God-Talk, Lanham, University Press of America, p. 59-75.
- Priest, R. (2001), « Missionary Positions. Christian, Modernist, Postmodernist », Current Anthropology, 42/1, p. 29-69.
- Robbins, J. (2006), « Anthropology and Theology. An Awkward Relationship ? », Anthropological Quarterly, 79/2, 285-294.
- Saillant, F. (2011), « Des images en partage. Récit d’une transformation réciproque », Anthropologie et sociétés, 35/3, p. 107-125.
- Samudra, J. K. (2008), « Memory in Our Body. Thick Participation and the Translation of Kinesthetic Experience », American Ethnologist, 35/4, p. 665-681.
- Stewart, C. (2001), « Secularism as an Impediment to Anthropological Research », Social Anthropology, 9/3, p. 325-328.
- Tedlock, B. (1991), « From Participant Observation to the Observation of Participation », Journal of Anthropological Research, 47, p. 69-94.
- Tedlock, B. (2005), The Woman in the Shaman’s Body. Reclaiming the Feminine in Religion and Medicine, New York, Random House.
- Tedlock, D. (1997), « The Poetics of Time in Mayan Divination », dans J. Leavitt, dir.,, Poetry and Prophecy. The Anthropology of Inspiration, Ann Arbor, University of Michigan, p. 77-92.
- Turner, E. (1994), « A visible Spirit Form in Zambia », dans J.-G. Goulet et D. Young, Being Changed by Cross-Cultural Encounters ; the Anthropology of Extraordinary Experience, Peterborough, Broadview Press, p. 71-95.
- Turner, A. (2000), « Embodied Ethnography. Doing culture », Social Anthropology, 8/1, p. 51-60.
- Turner, V. et E. (1978), Image and Pilgrimage in Christian Culture, New York, Columbia University Press.
- Van Binsbergen, W. (1991), « Becoming a Sangoma. Religious Anthropological Field-Work in Francistown, Botswana », Journal of Religion in Africa, 21/4, p. 309-344.
- Wigg-Stevenson, N. (2014), Ethnographic Theology. An Inquiry into the Production of Theological Knowledge, New York, Palgrave.
- Wikan, U. (1991), « Toward an Experience-Near Anthropology », Cultural Anthropology, 6/3, p. 285-305.

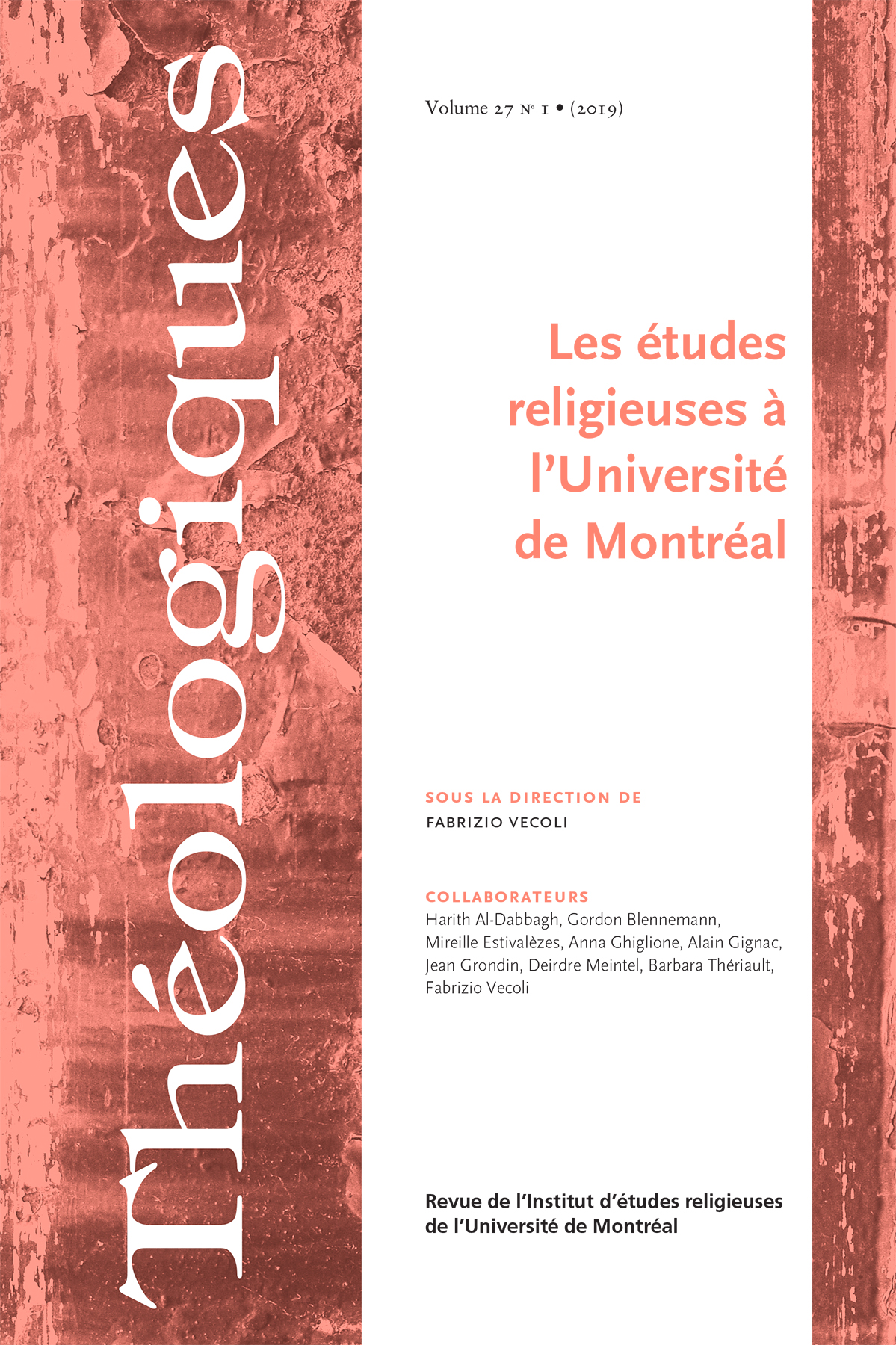
 10.7202/1007858ar
10.7202/1007858ar