Résumés
Résumé
800 mètres est un « drame sportif » né du stade pour le stade, représenté au Roland-Garros en 1941 en tandem avec Les Suppliantes d’Eschyle, avec des musiques d’Arthur Honegger, toutes deux perdues. Inspiré des tragédies grecques par sa conception formelle ainsi que dramaturgique, 800 mètres est la traduction en mots, gestes et sons des idées formulées par André Obey autour des Jeux olympiques de Paris en 1924.
L’un des principaux acteurs de la réflexion sur les rapports entre la musique et le sport et de la promotion du sport auprès des intellectuels français, Obey préconise la naissance d’un art olympique et élabore un riche portrait métaphorique du sport comme musique. Cet article reconstruit la genèse de 800 mètres, montre comment ce drame met en scène les idées philhelléniques d’Obey, et analyse la conception musico-dramatique complexe de l’oeuvre en se basant sur de documents d’archives textuels, iconographiques et sonores.
Abstract
800 mètres is a “sports drama” born out of the stadium for the stadium, staged at Roland-Garros in 1941 together with Aeschylus’s The Suppliants. The music for both plays, now lost, was by Arthur Honegger. Inspired by Greek tragedies in both its formal and dramaturgical conception, 800 mètres is the translation into words, gestures and sounds of the thoughts that André Obey expressed at the time of the Olympic Games in Paris in 1924. Obey has been one of the main actors in the reflection on the relationship between music and sport. In promoting sports among French intellectuals, Obey advocates the birth of an Olympic art and elaborates a rich metaphorical portrait of sport as music. Based on textual, iconographic and sound archival documents, this article reconstitutes the genesis of 800 mètres, shows how this drama stages Obey’s philhellenic ideas, and analyzes the complex musical-dramatic conception of the work.
Corps de l’article
Il y a des années qu’on souhaite la renaissance du théâtre grec. Le sport y convie, riche de dieux et de héros.
Obey 1924c
Les 5 et 6 juillet 1941, l’acteur et metteur en scène Jean-Louis Barrault proposait un spectacle double au stade Roland-Garros à Paris : Les Suppliantes d’Eschyle suivies par 800 mètres. Les éléments unificateurs entre les deux pièces étaient nombreux : Arthur Honegger qui a composé les musiques de scène, André Obey qui a adapté la première et écrit la seconde, la Grèce antique ainsi que le sport. Dans cet article, nous analyserons la genèse et la dramaturgie musicale de 800 mètres, ce qui permettra notamment de souligner l’idéal classique ayant inspiré cette traduction théâtrale d’une compétition de course (où le protagoniste rate la première position de très peu, mais dont la vraie victoire consiste à maîtriser sa colère et à serrer la main du vainqueur), exemple unique de « drame sportif » tel que théorisé par Obey en 1924, à l’occasion des Jeux olympiques de Paris.
À cette époque, Obey relie strictement le sport et la musique : « Quant au sport, au coeur du sport, à l’athlétisme, je vous jure qu’il est musical, mieux : qu’il est musique » (Obey 1924e). Malgré ses déclarations ultérieures qui minimiseront son engagement dans l’écriture de 800 mètres en 1941, sa démarche de théâtralisation d’un événement sportif demeure fidèle à ses conceptions de 1924, et est par conséquent intrinsèquement musicale, non seulement par le fait de donner à la musique une grande place, mais dans la conception même de la transposition théâtrale de la course. Tel un air d’opéra, où le temps est élargi pour pouvoir approfondir musicalement les sentiments qui gouvernent le personnage, le temps de l’action théâtrale ne correspond pas au temps vécu : une course qui dure moins de deux minutes est ici étirée, et les acteurs courent au ralenti[2], avec le soutien du tam-tam et de la batterie qui représentent musicalement la course en lui donnant son rythme et sa continuité. Dans le drame sportif d’Obey, la musique et les gestes (eux-mêmes accentués par la musique) priment sur la composante verbale.
L’analyse de cette oeuvre pose des défis philologiques sur les plans textuel et musical : il existe plusieurs versions de l’oeuvre, et la partition de Honegger est considérée comme perdue. Il s’agira tout d’abord de parcourir les étapes ayant mené au spectacle de 1941, à partir des nombreux textes de l’entre-deux-guerres où Obey discute l’essence humaniste du sport (une idée qui a son origine en Grèce) et la nécessité d’un art sportif. Ensuite, l’analyse des didascalies d’Obey indiquant dans le détail la forme, la sonorité et le rôle des musiques de scène pour 800 mètres permettra d’accéder indirectement à la musique perdue de Honegger, dont elles sont, au moins partiellement, un « fantôme ». Cette analyse permettra d’ailleurs de supporter l’hypothèse que les musiques utilisées pour une version radiophonique tardive du drame, en 1964, ne soient pas celles de Honegger, et ce, pour des raisons musico-dramatiques encore davantage que stylistiques.
L’intuition d’un art sportif et grec
Critique musical et sportif, écrivain et dramaturge, André Obey (1892-1975) est l’un des nombreux intellectuels français conquis par le sport au début des années 1920. Les articles sur la musique et le sport qu’il a publiés dans l’hebdomadaire L’Impartial français durant les Jeux olympiques de Paris en 1924 ainsi que le recueil L’Orgue du stade paru en cette même année en font la figure de référence du débat sur les liens entre la musique et le sport[3]. L’histoire de son « drame sportif » 800 mètres, qui ne prendra forme que 17 ans plus tard, remonte à une intuition énoncée dans une série de deux articles sur l’« art sportif » écrits à la suite des Jeux de Paris :
[D]ans ma pensée (dans mon rêve plutôt) l’art né du stade pour le stade est d’abord dramatique, disons tragique, au sens grec. Je suis navré de ne pouvoir préciser. Je n’ai que la sensation vague — et pourtant forte — de cet art-là qui m’inspirera peut-être un jour. J’en ai une idée claire mais non distincte. Il m’est impossible de transmettre à autrui la vibration d’atomes créateurs que cette idée fait naître en moi.
Obey 1924e, nous soulignons
Les deux passages soulignés méritent une analyse spécifique.
« Dramatique/Tragique — Grec »
Obey souhaite et invoque la naissance d’un art olympique. Cet art se présente à lui sous la forme indéterminée d’une intuition : « dans ma pensée (dans mon rêve plutôt) » ; « Je suis navré de ne pouvoir préciser » ; « Je n’ai que la sensation vague — et pourtant forte » ; « J’en ai une idée claire mais non distincte ». Dans cet article et dans d’autres passages de ses écrits de cette année-là, Obey définit l’art olympique par cinq éléments :
– Élément 1 : C’est un art qui a ses racines dans la Grèce antique — topos des pionniers du mouvement olympique (de Panagiotis Soutsos à Pierre de Coubertin, en passant par William P. Brookes[4]) et des intellectuels défendant les bienfaits du sport (notamment, Henry de Montherlant) dans une société française encore méfiante envers l’activité sportive[5]. Il l’avait explicité dans un article paru durant les Jeux olympiques (célébrés du 4 mai au 27 juillet), « Le stade en quête d’auteurs » :
Que les poètes, les musiciens, les dramaturges aillent au stade, vivent au stade. […] Nous avons besoin d’une grande oeuvre qui roule, fleuve nourricier, l’ordure et le reflet ; d’une grande oeuvre éternelle qui plante en terre grecque ses racines profondes mais dont le feuillage chante au ciel moderne, ivre d’ondes électriques. Nous attendons — et nous l’aurons — le drame olympique […].
Obey 1924c
– Élément 2 : Bien qu’issu de la Grèce antique, l’art olympique auquel Obey songe chante la modernité et prend forme dans la modernité : « une grande oeuvre éternelle qui plante en terre grecque ses racines profondes mais dont le feuillage chante au ciel moderne, ivre d’ondes électriques » ; « [un drame olympique] couronné d’un vol d’avions, sur quoi planera, issue du haut-parleur, […] la voix du monde » (Obey 1924c, nous soulignons). La diffusion par haut-parleur, nommée à l’époque « diffusion indirecte », représente le comble de la modernité à l’époque de l’essor de la radio et de la démocratisation des disques[6]. Notons que dans le 800 mètres de 1941, le coryphée (le Speaker) est un « homme de la radio » ;
– Élément 3 : C’est un art qui naît du stade « riche de dieux et de héros » ; tel que déjà mentionné (voir la citation de l’élément 1 ci-dessus), pour le concevoir, Obey invite donc les poètes, les musiciens et les dramaturges à aller au stade, car le sport est essentiel et complet, réunit toutes les données propres à un drame en lien avec les différents visages de la condition humaine : « Héroïsme. Peur. Audace. Épouvante. Gloire. Loyauté. Hypocrisie. Triomphe. Orgueil. Bref ! l’essentiel de tout ça. » (lettre d’Obey à Florent Schmitt, 7 avril 1928[7]) ;
– Élément 4 : C’est donc un humanisme condensé qui se présente au stade et qui se traduit artistiquement dans la forme d’une tragédie grecque pour le stade : c’est un art pour le plein air, pour le peuple passionné de sport (« subtil et naïf, crédule et frondeur, sévère mais juste »), qu’Obey oppose au public de théâtre (« mesquin, sceptique, imbécile et snob », Obey 1924c) ;
– Élément 5 : Finalement, c’est un art musical, parce que, d’après Obey, le sport est intrinsèquement lié à la musique : les deux sont des activités physiques, et le sport peut être décrit en termes musicaux — c’est ce que l’écrivain réalise dans L’Orgue du stade (1924a), où il associe métaphoriquement les sept courses classiques aux sept tuyaux d’un orgue, chacune avec sa voix : 100 mètres, hautbois ; 200 mètres, flûtes ; etc. (p. 10 et suivantes). Obey croit également qu’il est possible d’avoir l’intuition de cet art sportif « en écoutant résonner des titres — et des oeuvres — comme Noces de Strawinsky, Cromedeyre[-le-Vieil] de Jules Romains ou les Mariés [de la tour Eiffel] de Jean Cocteau », ces titres ayant un pouvoir évocateur « un peu comme des accords debussystes… » (Obey 1924e). Dans les premières pages de son roman Savreux vainqueur (1923), Obey décrit d’ailleurs la religion du sport en comparant la musique et le sport dans leur pouvoir de « révélation extatique d’une vie interne, inaccessible à la raison[8] ».
« M’inspirera peut-être un jour »
Obey envisage de concrétiser son intuition d’une oeuvre d’art inspirée du sport pour la première fois en 1928, soit quatre ans après les Jeux de Paris, à l’aube de l’olympiade suivante. Son projet — qu’il considère comme « le premier essai d’art sportif » — est décrit dans une lettre à Florent Schmitt[9], compositeur qu’il connaît depuis l’âge de 18 ans et duquel il était extrêmement proche malgré la différence d’âge[10]. Il s’agira d’écrire un court drame (« 6 à 8 minutes ») où la musique joue un rôle essentiel (Schmitt se fait donc proposer une collaboration[11]) : une version théâtralisée et musicale — audiovisuelle — d’une course à pied, le 800 mètres.
D’ailleurs, tel qu’il le déclare dans ses entretiens radiophoniques de 1965 avec Henri Dutilleux, Obey vit une frustration : il déclare avoir toujours eu une très forte sensibilité musicale (« Il se trouve que j’ai, et que j’ai toujours eu, l’oreille musicienne, que j’ai eu de la musique en moi », Dutilleux 1965, entretien no 1[12]), mais être incapable de s’exprimer musicalement, malgré sa formation de musicien (il était pianiste[13]). Devenir écrivain, c’était donc une façon de trouver un moyen d’expression : « J’étais un écrivain non pas par véritable vocation, mais par raccroc. Parce que ne pouvant pas m’exprimer musicalement, il fallait bien que je trouve un moyen d’expression qui puisse me rapprocher de la musique » (entretien no 4). En 1929, Obey décrit son travail administratif pour le Monde musical (qui consistait, très prosaïquement, à remplir des fiches biographiques de musiciens) comme une source d’excitation et d’ivresse, sorte de matérialisation des rêves suscités par la lecture des noms des musiciens lorsqu’il était adolescent. Une autre façon, donc, d’être en contact avec la musique sans pouvoir en composer. Dans un des entretiens, Dutilleux remarque que souvent, dans les écrits d’Obey, on retrouve des sections qui semblent être de la musique, ce que l’écrivain explique ainsi : « Ce n’est pas une transposition. C’est une espèce de procédé désespéré pour remplacer le langage musical qui m’échappe par quelque chose d’équivalent » (entretien no 2). De véritables transpositions du sonore et du musical sont également courantes dans la prose d’Obey. Décrire les sons de la vie courante par des métaphores ou associations musicales est un trait typique de sa prose ; par exemple, une voix « expansive et précise comme un solo de saxophone », ou « le soupçon […] de nasillement évoquait la vibration de l’archet sur la corde grave d’un alto » (Obey 1927b, 16) ; ou encore, à propos des enseignes lumineuses qui éliminent la noirceur de la nuit parisienne : « Un plein-feu implacable incendie le boulevard d’un été de théâtre […]. Vaste jazz-band polyphonique et harmonieux, l’orchestre de la publicité marie ou entre-choque [sic] ses timbres » (Obey 1926). Dans la nouvelle de 1924 Le Huit cents mètres de Paul Martin, première oeuvre où Obey représente cette course, le protagoniste Paul Martin se prépare au départ en cherchant à ne pas se faire paralyser par les regards, les cris et les attentes de la foule du stade ; sa concentration a un caractère musical : « Il se tient fermé, serré, sous le charme d’une musique interne qui est la voix de sa certitude organique — qui est le prélude de seconde en seconde plus puissant de sa course » (Obey 2012, vol. [2], 155).
Pour donner à ses pièces de théâtre la musique qu’Obey n’a pas les compétences de composer lui-même, la collaboration avec un musicien — Schmitt en l’occurrence — est donc la solution idéale. Obey vise une collaboration active, dans laquelle il puisse exprimer son idée musicale « sur le tas » et demander qu’elle soit traduite en notes : « penser avec un musicien […] une certaine forme de musique, de théâtre musical que nous pourrions faire ensemble, beaucoup plus que l’interprétation d’une pièce de théâtre écrite par moi par un musicien » (entretien no 9[14]).
La lettre à Schmitt contient tous les éléments du drame olympique tel qu’Obey l’avait conçu dans les écrits de 1924. Obey le décrit, dans l’ordre, comme d’un art pour le stade[15], moderne[16], un art né du stade[17], tiré d’une nouvelle qu’il a écrite en 1924 en s’inspirant d’une course aux Olympiques, d’où sa brièveté[18] par opposition aux genres académiques[19]. Son inspiration sonore et musicale[20] naît, elle aussi, du stade — d’une certaine façon, les sons du stade donnent forme à l’intuition d’Obey :
J’ai gardé dans l’oreille un tas de souvenirs sonores des jeux de 1924 à Colombes[21], des timbres providentiels. Il y avait d’abord une escouade de cornemuses (highlanders) qui faisait vraiment plein air. Ça sentait le gazon, le jardinage, l’histoire naturelle. Mais est-il possible d’avoir des cornemuses ? J’ai noté aussi 3 banjos, un autre jour. Et un soir des trompettes de cavalerie qui avaient presque la majesté de « présentation » et d’« encadrement » de la cithare hellénique [voici encore l’élément 1] ou du luth médiéval autour d’une chanson de geste, d’une affirmation héroïque.
Lettre d’Obey à Schmitt, 7 avril 1928
À partir de ces souvenirs auditifs, Obey est assez prescriptif, dans cette lettre à Schmitt, quant à la conception musicale de la pièce. Il la conçoit en trois parties qu’on comprend être entièrement mises en musique : « Le départ. La course (avec toute sa texture fuguée). L’arrivée en forme de strette avec un chevauchement de sentiments et d’idées musicales à peine indiqués naturellement… ». Le tout devra être joué par des « instruments très simples […], des instruments bruts et “entiers” », et avec une attention particulière au timbre et au style des voix[22]. Pour caractériser les voix, Obey tire son imagination sonore des disques (c’est la modernité, élément 2) : le choeur de quatre hommes constituant le peloton (le Suisse protagoniste[23], un Américain, un Anglais et un Finlandais) devrait être « quelque chose du genre des Revellers [sic pour Revelers[24]], mais en force, en simplicité — quelque chose de carré, d’architectural », tandis que le récitant devrait avoir « cette voix à la fois unanime et solitaire qu’ont certains chanteurs ou diseurs nègres [sic] dans les derniers [disques] Columbia ».
Florent Schmitt appréciait bien Obey, mais n’était probablement pas la personne la plus indiquée pour collaborer à un tel projet. En considérant le catalogue de ses oeuvres, il est permis de supposer que, pour le compositeur, la Grèce antique figurait parmi les lieux exotiques (dans le temps ou dans l’espace) qu’il privilégiait dans ses choix de mises en musique (que l’on pense aux Dionysiaques ou au monde hébraïque la Tragédie de Salomé). En revanche, la transposition de l’esprit grec dans un stade moderne était sans doute plus éloignée de sa poétique, la Grèce demeurant pour lui un lieu d’exotisme historique davantage qu’un idéal classique actualisable dans une démarche moderniste. Cela dit, le principe d’une oeuvre musicale à sujet sportif ne le contrariait pas, comme il l’affirmait à l’époque des Jeux olympiques parisiens de 1924, en réponse à l’enquête « La musique et le sport » lancée par le Guide du concert : « Tous les sujets peuvent être prétexte à l’inspiration, des Ramayâna à la Gazette de Hollande, du Déluge aux gaz asphyxiants, selon les exigences de l’inspiration » (Schmitt 1925).
Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas trouvé de suite à la lettre d’Obey. Il faudra attendre 1941 pour que le « drame sportif » 800 mètres voie le jour. Un drame sportif qui se veut une véritable tragédie grecque :
Que ce 800 mètres soit sportif, cela me paraît évident : il a pour thème la course athlétique du même nom. Qu’il soit drame, c’est-à-dire action, je l’espère de tout mon coeur. Mais, il faut dire les choses sans peur et sans reproches, ce 800 est une tragédie […], j’entends « un poème dramatique, exprimé en style noble (quoique un brin argotique), qui représente des personnages héroïques dans une situation propre à exciter l’enthousiasme de la terreur ou de la pitié, et qui se termine par un événement funeste ». C’est même, car l’action ne comporte, en face du choeur, qu’un seul personnage héroïque, c’est même, dis-je, une tragédie de la bonne époque.
On a dit un peu partout, j’ai dit moi-même et répété […] que les luttes du stade étaient des tragédies, que j’ai fini par y croire.
Obey 1941, 1, c’est l’auteur qui souligne
La réalisation de la musique imaginée par Obey sera alors confiée à Arthur Honegger, le compositeur qui, à l’époque de la lettre à Schmitt, composait son mouvement symphonique intitulé Rugby, la pièce emblématique de la musique à sujet sportif de l’entre-deux-guerres[25]. Par ailleurs, Honegger serait arrivé aux répétitions pour 800 mètres « sur une petite bicyclette de course rouge [en disant à Obey] “Je suis en train de gagner le Tour de France en imagination” » (Dutilleux 1965, entretien no 12).
Les sources
800 mètres constitue un objet d’étude assez complexe sur le plan philologique. Des quatre phases de ce long projet, trois seulement correspondent à des versions abouties de l’oeuvre : une nouvelle (Les Huit cents mètres de Paul Martin, publié dans L’Orgue du stade en 1924) ; une pièce de théâtre (800 mètres, « drame sportif », version 1941, au sein du spectacle « Théâtre-Musique-Sport » pour les sportifs prisonniers de guerre, Stade Roland-Garros, 5 et 6 juillet 1941 ; Image 1) ; un drame radiophonique (800 mètres, version 1964, diffusé le 4 octobre 1964 sur France Culture[26]). Entre la nouvelle et l’écriture de la pièce de théâtre en 1941, se situe la deuxième phase du projet, le plan de « mise en action » de la nouvelle qu’Obey explicite dans sa lettre à Florent Schmitt du 7 avril 1928.
Ces versions diffèrent non seulement sur le plan du contenu[27] mais aussi dans la forme matérielle des sources textuelles et paratextuelles qui s’offrent au chercheur qui s’attarde à reconstruire l’histoire dramaturgique et musicale de cette oeuvre multiforme. Le texte du « drame sportif » de 1941 est transmis dans deux tapuscrits d’Obey conservés dans le fonds Jean-Louis Barrault (le metteur en scène du spectacle au stade Roland-Garros), avec corrections de la main d’Obey et de Barrault ; nous appellerons ces deux tapuscrits Ta et Tb, ce dernier étant la version du texte vraisemblablement utilisée pour le spectacle[28]. Le texte musical — la partition d’Arthur Honegger jouée par l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dirigé par Charles Münch — est perdu[29]. Quant au paratexte, il est constitué de photographies des répétitions et du spectacle[30], de maquettes[31] et d’articles parus dans la presse[32] — dont un texte d’Obey, « La tragédie du 800 mètres » (1941). Les sources paratextuelles renseignant sur le spectacle de 1941 s’enrichissent en 1965 et 1970 des entretiens radiophoniques qu’Obey accorde à Henri Dutilleux et à l’émission Le sport et la musique respectivement.
Image 1
Annonce du spectacle au Stade Roland-Garros, Comoedia, 5 juillet 1941, p. 3
Les sources textuelles de la version du drame diffusée à la radio en 1964 comprennent, en plus de l’enregistrement, deux copies d’un même tapuscrit (Tc) avec des annotations manuscrites différentes[33] ; ce tapuscrit intègre des éléments de Ta et de Tb. La seule version publiée du texte de 800 mètres est une édition moderne très incorrecte de ce tapuscrit de 1964 (dans Obey 2012[34], vol. [2], 181-215). Quant au texte musical – la partition de la musique jouée dans le drame radiophonique —, il est (probablement) perdu et d’auteur inconnu : les fiches de l’INA relatives à la diffusion radiophonique de l’oeuvre ne contiennent en effet aucune mention de l’auteur de la musique utilisée ni des interprètes, et aucune partition n’a été retrouvée dans les archives de la Maison de la Radio. Il s’agit probablement d’une compilation à partir d’une banque sonore et orchestrale. Le paratexte de cette version radiophonique de l’oeuvre d’Obey est constitué par une interview-présentation radiophonique de Barrault précédant la diffusion de l’oeuvre et par une introduction d’Obey (« À propos du Huit cents mètres »), datée de 1964, qui précède l’édition moderne du texte de la pièce (Obey 2012 [1964] ; la source n’est pas spécifiée[35]).
1941 : la musique selon Obey
Si l’on se fie aux déclarations d’Obey faites au cours des entretiens radiophoniques tardifs (1965 et 1970, auxquels on peut ajouter « À propos du Huit cents mètres » de 1964), la création d’un drame olympique était loin, en 1941, d’être encore un de ses objectifs. Il parle alors de 800 mètres comme d’« une petite chose que Barrault m’avait fait faire sur commande » (Dutilleux 1965, entretien no 5), une sorte de coda à la mise en scène des Suppliantes d’Eschyle au stade Roland-Garros le 5 et 6 juillet 1941 :
Au milieu de 1941, j’ai vu Barrault arriver chez moi […], et il est venu me dire : « Dis-donc, qu’est-ce que tu dirais si on montait quelque chose en plein air ? », « Ah… Bah, oui, si tu le dis […] c’est possible […]. Et où ça, en plein air ? », « Eh bien, au stade Rolland-Garros », « Quelle drôle d’idée », « Oui, figure-toi, le stade Rolland-Garros, je viens d’y passer, il y avait des oiseaux, il y avait du soleil, il y avait des petits bruits de plein air là-dedans, c’était absolument grisant, il faut absolument que je monte quelque chose là-dedans […] ». Il est allé trouver l’administration municipale, et le lendemain quand il est revenu me voir il avait l’autorisation de monter ça à Roland-Garros etc. parce que, quand il a décidé de faire quelque chose, il fait quelque chose. Et nous nous sommes mis, à ce moment-là, à travailler sur son projet qui était de monter Les Suppliantes. Alors, on a monté Les Suppliantes avec la musique d’Honegger dirigée par Münch, Charles Münch. Et ce travail avec Münch, Honegger et Barrault est encore un des grands souvenirs de ma vie, c’était absolument merveilleux. Le spectacle n’était pas suffisant et c’est pour le compléter que j’ai écrit cette petite chose qui durait environ trois-quarts d’heure[36] et qui s’appelait 800 mètres.
Dutilleux 1965, entretien no 8
Il n’est pas étonnant qu’Obey jette un regard rétrospectif aussi peu enthousiaste sur 800 mètres, qui contraste avec le ton engagé de ses articles de 1924. Les Olympiques de Paris avaient brisé son idéalisation du sport ; ceux-ci se révélaient être une entreprise matérialiste vouée aux intérêts pécuniaires bien davantage qu’à Zeus ou à Apollon. Obey explicite sa désillusion dans les colonnes de L’Impartial français en 1927. « Auriez-vous donc perdu la foi ? » (Obey 1927d), demande un lecteur étonné par le ton désormais très factuel des chroniques sportives de l’auteur de L’Orgue du stade. Obey répond en attaquant à la fois les sportifs, le public du sport[37], les administrateurs[38] et — véritable coup de grâce à sa « foi » en l’olympisme humaniste de matrice coubertinienne — les sportives. Selon Obey le sport serait chez ces dernières un jeu plutôt qu’un drame, leur corps ne permettant pas « cette harmonie mathématique des mouvements […] qui sont toute la musique, muette mais poignante, d’un duel […] Lowe-Paul Martin[39] » et qui peut rendre les Jeux olympiques un « poème dramatique » (Obey 1927c).
La lettre à Schmitt de 1928 se situe donc à une époque où Obey affirmait ne plus croire au sport ni au rôle (et au pouvoir) des intellectuels dans sa promotion — ni, par conséquent, à l’intérêt de la fondation de l’art olympique. Le sursaut d’enthousiasme pour ce thème qui ressort de la lettre témoigne donc d’une attitude ambivalente, puisqu’il survient à une époque où Obey déclare avoir perdu tout espoir de pouvoir parler aux sportifs du sujet de 800 mètres, c’est-à-dire la victoire sur soi-même comme véritable signification du sport, l’effort physique comme contribution puissante au Γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton, « connais-toi toi-même ») :
Les combats « désintéressés » qui agitent mon lyrisme, ces victoires athlétiques dont les plus belles, pour moi, sont celles qu’on remporte sur soi-même, tout ce solitaire monde moral, cette mystique et cet absolu sportifs où j’erre (où je m’égare), sont pour eux sans valeur, sans réalité. Ils ne les méprisent pas, ils ne peuvent les comprendre.
Obey 1927d, c’est l’auteur qui souligne
En 1941, 800 mètres semble avoir surtout une fonction de remplissage (« nécessité d’allonger la sauce »), « une oeuvre qui, sans trop s’éloigner de la tragédie grecque [Les Suppliantes], fît cependant contraste avec elle… » (Obey 1964, 177). Un choix de complémentarité, donc : puisqu’on « pli[ait] le sport au service de la tragédie » en représentant Eschyle au stade, « en retour, mettre la tragédie au service du sport » (Obey 1964, 177). Ce qui d’ailleurs ne risquait pas de déplaire dans un contexte sociopolitique — le régime de Vichy — où le sport était particulièrement valorisé[40]. Et la partition de Honegger est décrite par Obey comme « une espèce de musique ou au moins une batterie pour accompagner ce 800 mètres » (Dutilleux 1965, entretien no 5), ou encore « une musique qui se réduisait à une espèce de batterie » (entretien no 12), presque improvisée en suivant les indications d’Obey :
[Interviewer :] De quelle façon l’a-t-il composée ?
[Obey:] Ah bien, ça, avec moi, parce que je lui ai dit : « Écoute, voilà ce qu’il faudrait que tu écrives, faudrait que tu écrives une chose qui fait pam pam pam », « Bon, très bien », alors il pondait des notes, pam pam : « Ça va comme ça ? », « Attends une seconde », « Alors maintenant, qu’est qu’on va mettre ? », « Un coup de gong ! ». Et pour rythmer le 1, 2, 3, 4, et puis alors derrière il y aurait une espèce de musique de fond qui ressemblera à la musique de… de… d’un Russe, etcetera. Et alors il a fait ça comme ça et ça marchait.
[Int :] Mais il a composé ça comment, dans le silence de son cabinet de travail ?
[Ob :] Ah non ! La veille, la veille des trucs sur les choses mêmes.
[Int :] Sur le Stade Roland-Garros ?
[Ob :] Sur son genou.
Le sport et la musique 1970
Rétrospectivement et à distance, Obey exagère et simplifie. À la veille du spectacle, Le Petit Parisien annonce que « le commentaire musical d’Arthur Honegger » souligne le « mode lyrique » de la pièce, non pas son côté percussif (Anonyme 1941a). L’Atelier remarque que « [l]es ensembles des deux pièces [Les Suppliantes et 800 mètres] furent fort bien réglés et accompagnés par la musique d’Honegger » (Anonyme 1941b, nous soulignons). L’impitoyable critique des Nouveaux Temps juge que « [l]e compositeur ne parvint pas, malgré la richesse orchestrale qu’il y déploya aussi [comme dans Les Suppliantes], à soutenir l’intérêt de Huit cents mètres » (Armory 1941, 35).
En revanche, d’autres critiques semblent confirmer un portrait moins élaboré de la musique d’Honegger (le programme du spectacle fait une distinction entre la « musique » pour Les Suppliantes et le « commentaire musical » de 800 mètres, voir Image 1 plus haut). Arthur Hoérée (1941) se limite à analyser la musique pour LesSuppliantes[41] ; Marcel Delannoy (1941) affirme que dans 800 mètres « la prétention musicale était plus modeste, mais la réussite incontestable. Le rythme s’intégrait à l’action, lui apportait âme, moteur, chaleur, vie subconsciente. Ici, le rôle du musicien est de servir. Honegger a su s’y plier » (c’est l’auteur qui souligne). Georges Pioch (1941) « avoue n’avoir que très peu perçu de l’accompagnement composé pour 800 mètres », la faute au plein air.
Nature des interventions musicales prescrites par Obey
Si ces commentaires aident à se faire une idée du résultat sonore du spectacle, les sources textuelles permettent d’esquisser un portrait singulièrement précis de la conception musicale d’Obey, et par conséquent de la partition perdue de Honegger (dont la tâche était de réaliser concrètement ce qu’Obey avait en tête). Obey prescrit en détail, dans ses didascalies, ce que devrait être la musique de la pièce. S’il se limite parfois à indiquer de façon générale une intervention musicale (par exemple, « Brève fanfare »), le plus souvent il est très précis sur ce qu’il a en tête quant à la durée des interventions musicales et à leur caractère[42]. Ce caractère est exprimé tantôt par une description, tantôt par une association. Obey décrit le type de sonorité ou de geste musical qu’il souhaite, et parfois associe son idée à un modèle, pour que le compositeur puisse la comprendre immédiatement (un procédé déjà utilisé dans la lettre à Schmitt, lorsque Obey songeait à « quelque chose du genre des Revellers [sic] »). En décrivant le morceau-leitmotiv qu’il appelle « bruit de choeur », il en donne tout d’abord une description — ou devrait-on écrire plutôt une prescription ? « Une sorte de batterie d’usine à quatre temps, large, sourde, puissante, monotone, avec quelques éclats d’instruments çà et là ». Pour préciser, il ajoute : « Pour fixer les idées : je pense à ce fond sonore qui commence Panorama américain ». Nous reviendrons sur ce cas précis dans la dernière section de l’article.
Ailleurs, Obey écrit carrément une sorte de partition verbale ou graphique. La partition est verbale lorsque les instruments sont traités comme autant de personnages qui s’expriment par la voix qui leur est propre. Par exemple (Tb, 2) :
ORCHESTRE (répondant d’un bloc)
Vlan !
Boum !
Tzinn ! (une sorte d’accord final de jazz[43])
Bang !
Dom !
Ou encore (Tb, 23-24[44]) :

Si ces « partitions verbales » font partie du texte de la pièce, les « partitions graphiques » sont des annotations manuscrites sur les tapuscrits. Nous aborderons en détail plus loin (Exemple 1) la « partition » du tam-tam qui accompagne la course.
Obey indique onze différentes « interventions » musicales (utilisons ce terme neutre, qui englobe à la fois les véritables morceaux et les ponctuations musicales), dont certaines reviennent plusieurs fois au cours de la pièce. À celles-ci s’ajoutent des effets sonores non proprement musicaux (par exemple, les bruits que le Maître de cérémonie doit produire avec sa canne[45]) et de nombreuses indications pour les acteurs, souvent appelés à émettre des sons ou à prononcer leur texte sur un rythme donné ou avec une intonation musicale (nous verrons quelques exemples plus loin). Dans Tb, le témoin le plus proche de la représentation de 1941 (il contient plusieurs indications de mise en scène de la main de Barrault), une autre main (probablement celle d’Obey) a indiqué au stylo noir des chiffres encerclés correspondant aux interventions musicales. On peut raisonnablement penser qu’il s’agit de renvois aux numéros musicaux composés par Honegger. En ce sens, le tapuscrit n’est pas seulement une sorte de « partition muette » des idées d’Obey (un fantôme verbal de la musique qu’il entendait dans sa tête), mais aussi un fantôme de la partition perdue d’Honegger — qui, d’après ce qu’il est possible de déduire des annotations manuscrites à Tb, différait à quelques reprises des didascalies d’Obey (voir Tableau 1).
Tableau 1
Les interventions musicales dans 800 mètres
Fonctions musico-dramatiques dans 800 mètres
La plupart des fonctions musico-dramatiques identifiées par Pascal Lécroart (2004) dans son étude sur les musiques de scène pour le théâtre de Paul Claudel (une typologie valable pour l’analyse des musiques de scène en général) se retrouvent dans la pièce. Nous aborderons, dans cette section, les quatre macrocatégories suivantes : musique autonome, d’accompagnement, diégétique/fonctionnelle (présente dans la fiction en tant que musique) et complémentaire aux gestes ou aux mots. Les didascalies montrent à quel point Obey conçoit la pièce de façon audiovisuelle, avec les interventions musicales qui se fondent au texte et au geste (« conçu pour la pelouse et la caisse de résonance du stade », écrivait-il à Schmitt treize ans auparavant). Ce caractère « fusionnel » et interdépendant entre la musique et les autres composantes du drame a été souligné par Paul Le Flem dans son compte rendu du spectacle : « la musique participe à l’ensemble, morcelée, hachée, désarticulée […]. Elle glisse dans la masse plus qu’elle ne risque des commentaires » (Le Flem 1941, cité dans Halbreich 1994, 730). Significativement, les catégories de musiques de scène où la musique est (a) autonome par rapport au texte (intermèdes, musique de danse pour les éventuels ballets extradiégétiques, et numéros entremêlés ; voir Lécroart 2004, 222-224) sont absentes de la « partition muette » d’Obey. Le dramaturge demande plutôt à la musique de remplir certaines fonctions qu’on peut faire entrer dans la catégorie de (b) l’accompagnement. Premièrement, la fonction de « soutien musical », qui se réalise dans la forme du mélodrame. Dans 800 mètres, cette catégorie musico-dramatique inclut notamment les deux « fonds d’orchestre » imaginés pour accompagner le choeur parlé, dont nous parlerons dans la dernière section. Deuxièmement, la « musique latérale ou parallèle » qui, douée d’une structure indépendante mais complémentaire au texte, provoque les mots des personnages plutôt que de les commenter.
Obey ne demande que très peu de (c) musique diégétique/fonctionnelle, puisque son drame est une transposition musico-dramatique d’une course, non pas une recréation réaliste d’un événement sportif[46]. Le dramaturge lui préfère la variante métaphorique que Paul Claudel appelait « musique de bruits » (Lécroart 2004, 221-222), métaphoriquement diégétique, présente dans la fiction en tant que bruit, transformé en son musical avec fonction de décor. Une manifestation très simple de ce procédé est le redoublement, par un ou plusieurs instruments de musique, d’un bruit scénique. Dans 800 mètres, on rencontre quelque chose de similaire (bien qu’il s’agisse davantage d’une amplification que d’une transformation du bruit) lorsque la grosse-caisse double l’action du Maître de cérémonie qui abat sa canne[47]. Un cas plus élaboré est constitué par ce qu’Obey appelle le « choeur de souffles », présent à quatre reprises dans Tb (p. 40, 41, 42 et 46) et complètement supprimé dans la version radiophonique de 1964[48]. Il s’agit d’une musicalisation du souffle des coureurs qu’Obey réalise en deux versions (Tb, 40-41[49]) :
1er choeur de souffles des coureurs (à quatre temps, lent, très en ordre, très élémentaire)
Ha !
Ha !
Ha !
Ha ![50]
(binaire) :
Ha-ha !
Ha-ha !
Ha-ha !
Ha-ha ![51]
(ternaire) :
Ha-ha-ha !
Ha-ha-ha !
Ha-ha-ha !
Ha-ha-ha !
Ha-ha-ha !
[…]
Deuxième choeur de souffles des coureurs (même rythme)
(simple) :
On
Va !
On
Va ![52]
(binaire) :
On va !
On va !
On va !
On va ![53]
En général, dans 800 mètres Obey recherche une (d) complémentarité de musique, gestes et mots qui va jusqu’à la compénétration. À l’« illustration musicale » (qui accentue la signification des mots), il semble préférer sa version plus indirecte, que Lécroart appelle « musique sémantique » puisqu’elle ajoute du sens aux mots « lorsqu’elle imprègne la parole de pensée » (Lécroart 2004, 183).
La forme la plus extrême de complémentarité entre le texte et la musique mise en oeuvre dans 800 mètres est la « musicalisation du langage ». Cette forme de complémentarité entre l’action théâtrale et la musique peut se traduire en un parler rythmé (avec l’éventuel soutien des percussions), un Sprechgesang ou encore du chant. Les indications d’Obey vont de la vague prescription d’un « chant » (que le compositeur devra, vraisemblablement, réaliser[54]) jusqu’à être très précises, comme lorsqu’il écrit que les premiers sons que le Speaker radiophonique émet dans le micro doivent être « comme un commencement de gamme[55] » ou encore lorsqu’il spécifie en notation le rythme pour la déclamation d’une phrase[56]. Si Obey a tendance à concevoir en termes musicaux tous les éléments du drame, y compris les mots des personnages, c’est en raison de sa conception intrinsèquement musicale du sport (« il est musique »). Deux exemples seront analysés en détail pour illustrer deux autres formes de complémentarité entre le texte et la musique, respectivement la musicalisation d’un geste sonore et la musicalisation du geste scénique des acteurs (par l’utilisation d’un instrument-personnage).
Musicalisation d’un geste sonore
Prenons l’exemple des sonneries qui accompagnent l’entrée des coureurs. Pour Lundgren, « l’homme du nord », Obey demande « [d]eux notes brumeuses de trompette » ; ensuite, « [l]a trompette en sourdine, toute seule, très haut, déploie au-dessus de sa tête les franges bleu-pur, bleu-glacé, des Scandinavies » (Tb, 26). Pour Marva, « l’homme du nord-est », Obey prescrit « [u]ne brève sonnerie (exhumée du Sacre du printemps) » (27) ; et pour Heltzer, « l’homme de l’est », une « [f]anfare (wagnérienne) » (27). C’est de la musique qui est partiellement diégétique (une fanfare qui accueille l’entrée de chaque coureur), mais surtout sémantique. Cette transformation enrichie d’un geste sonore peut être interprétée de deux façons qui ne s’excluent pas mutuellement. D’une part, il s’agit d’une déformation riche en sens d’une musique diégétique : dans la « vraie vie », se feraient entendre des fanfares neutres, qui deviennent des fanfares enrichies sémantiquement dans la transposition théâtrale de ce geste sonore. D’autre part, on assiste ici inversement à une transformation musicale d’une fonction à la fois diégétique et sémantique, l’hymne national : dans la « vraie vie », on entendrait l’hymne national saluant chaque coureur, tandis que dans la pièce on entend une autre musique qui renvoie à la nation du coureur. Remarquons que dans la version radiophonique de 1964, la fonction sémantique de ces fanfares est perdue et la fonction diégétique renforcée : on entend toujours la même fanfare (qui est celle déjà entendue en ouverture de la pièce) pour les trois athlètes, et, qui plus est, la fanfare précède l’annonce des coureurs plutôt que la suivre durant l’entrée du coureur (en lui donnant ainsi une caractérisation sonore[57]). Remarquons également qu’à l’origine, Obey avait prévu que seuls les trois premiers coureurs aient droit à leur sonnerie personnalisée (pour éviter l’effet pléonastique ?). Aucune indication n’est en effet présente pour l’entrée de Ramondès, « homme du sud », Stallard, « du nord-ouest » et Richardson, « de l’ouest », tandis que « notre homme » est accompagné sur la piste par « une formidable acclamation » du choeur qui « fléchit un peu, hésite, repart, et puis, soudain, se transfigure en un large chant très doux, très fort, très lent » (Tb, 31). Mais les numéros encerclés au stylo noir dans Tb témoignent d’une extension de la fanfare à tous les coureurs (sauf Jean, « notre homme », le protagoniste du drame) lors de la représentation. Est-ce que ces fanfares avaient, elles aussi, une caractérisation nationale ? Ou uniquement les trois premières ? Ou aucune ? Était-ce toujours la même comme dans l’enregistrement de 1964 ?
Musicalisation du geste scénique (instrument-personnage)
Une autre forme de complémentarité entre le texte, la musique et le geste est la « musique acteur », qui répond aux répliques ou agit comme un personnage. Ce sont les cas, déjà mentionnés, de l’orchestre qui réagit au Maître de cérémonie avec « une sorte d’accord final de jazz » ainsi que du dialogue entre le Speaker et les cymbales.
Plus élaboré est le personnage-instrument constitué par le tam-tam, qui représente la course (et plus particulièrement la course de Jean, comme nous l’expliquerons sous peu) et dont les actions ne sont pas seulement indiquées dans les didascalies, mais représentées, sur Tb, par une sorte de partition graphique tracée au stylo bleu à côté du texte (le commentaire déjà cité de Delannoy — « Le rythme s’intégrait à l’action, lui apportait âme, moteur, chaleur, vie subconsciente » — se réfère probablement à cette section du drame). Cette ligne couvre l’entièreté de la course, s’étendant sur 19 pages du tapuscrit (la deuxième section du drame, après l’entrée des athlètes et avant la célébration chorale de l’esprit sportif). Elle commence en correspondance de la didascalie « Puis un tam-tam (syncopé, dramatique) commence à “tirer le fil” de la course » (Tb, 39) et se termine à la didascalie « Fin du tam-tam. […] Silence total » (57). D’autres didascalies décrivent les réactions du tam-tam au déroulement de la course[58] et prescrivent son renforcement par la batterie (45 et suivantes). La fonction des lignes manuscrites consiste, d’un côté, à visualiser la continuité de la présence de ce correspondant sonore de la course et, de l’autre côté, à en décrire (prescrire ?) l’allure. En effet, la ligne n’est pas tracée de façon uniforme ; elle se compose plutôt d’une multiplicité de traits suggérant des variations dans les modes d’attaque et dans l’intensité du jeu (lignes horizontales servant à indiquer probablement des coups isolés, spirales suggérant le roulement, courbes qui varient en ampleur selon — supposément — la force demandée au percussionniste). Qui a tracé ces lignes ? Il s’agit probablement de Barrault, car a été utilisé le même crayon bleu utilisé dans Tb pour d’autres indications de mise en scène et pour écrire le nom « Barrault » sur la première page du tapuscrit. Cette partie du tam-tam est une véritable description musicale du geste scénique stylisé : elle montre — en les transposant en sons — la course que les acteurs stylisent sur place (voir Image 2[59]).
Image 2
Photographie du spectacle, Comoedia, 12 juillet 1941, p. 3.
La partie du tam-tam est-elle une transcription de la part du metteur en scène de la partition de Honegger, ou bien est-elle la trace d’une composition musicale à quatre ou six mains (Barrault, Obey, Honegger) réalisée « la veille des trucs sur les choses mêmes », telle que la décrira Obey dans ses entretiens de 1970 ?
Au-delà de cette question d’auctorialité, revenons à l’analyse musico-dramatique. Le tam-tam (dont les actions sont prescrites par les didascalies d’Obey et visualisées par les lignes manuscrites) revêt le rôle d’instrument-personnage, et incarne plus particulièrement la course de Jean. Au début de la course (Tb, 39), le tam-tam sonorise indifféremment la course de Jean et celle des autres. Jean pense gagner, mais, comme dans la tragédie grecque, son hybris est punie[60] : en effet, Marva le dépasse in extremis et gagne la course (Tb, 53-57). Dans l’exemple qui suit, nous transcrivons la scène (en indiquant quelques variantes particulièrement significatives par rapport à sa première version dans Ta) ainsi que les indications manuscrites concernant le tam-tam ; les parties des didascalies concernant les actions du tam-tam sont en gras (Exemple 1).
Au début de l’exemple, lorsque Jean réalise qu’il ne gagnera peut-être pas et que la célébration anticipée de sa victoire se transforme soudainement en « tragédie » (au sens grec : les événements constituent une réaction à l’hybris du protagoniste), les didascalies et les annotations manuscrites prescrivent un changement au niveau de la sonorisation de la scène. L’« arrêt brusque » du tam-tam[61], remplacé par un autre tam-tam « très sourd et haletant », fonctionne comme une subjective sonore : le tam-tam jusqu’alors perçu comme l’incarnation sonore du rythme de la course opère maintenant comme un zoom sur ce qui advient à l’intérieur de Jean, aussi bien physiologiquement (son rythme cardiaque « haletant »[62]) que psychologiquement (l’anxiété qui se substitue à l’excitation mêlée d’hybris). Cependant, la nature du trait manuscrit décrivant ce nouveau tam-tam — une petite spirale continue —, contredit le caractère « haletant » demandé par la didascalie ; on dirait plutôt un fond grave et informe contribuant à donner au dialogue entre le Speaker-coryphée et le Choeur un caractère ténébreux, instable et potentiellement dangereux. La reprise du premier tam-tam (annotation manuscrite) au moment où Jean décide de « s’accrocher » à la course plutôt que d’« abandonner » jette une nouvelle lumière, a posteriori, sur le rôle tenu par le tam-tam jusqu’à maintenant : on peut en effet interpréter le premier tam-tam comme étant Jean, et son arrêt au début de notre exemple comme un pendant musical de l’arrêt brusque de sa certitude de victoire qui se traduit par l’interruption de son monologue (« Je vais du côté de la… »). Cette reprise du premier tam-tam est représentée graphiquement par des traits horizontaux tout d’abord courts et puis plus longs, comme pour rythmer la reprise de l’élan du coureur jusqu’à la cadence régulière de sa course. Le second tam-tam sort de sa fonction purement subjective qui consiste à souligner l’inquiétude de Jean, explicitée par le choeur et ses petites voix intérieures (Jeanne et Jojo, qui symbolisent respectivement la confiance en soi et le découragement sceptique[63]), et semble désormais représenter la course des autres (ou uniquement de Marva ?), qui se termine en effet au même moment que celle de Jean (à la fin de notre exemple : « arrêt des coureurs », indication manuscrite et fin des traits ; « Fin du tam-tam »).
Cette polyvalence du rôle du tam-tam, à la fois coeur de Jean et de la course, subjectif et objectif, se retrouve déjà dans la description de la fin de course faite par Obey dans un texte de 1924 qui prend la forme d’un compte rendu d’une pièce imaginaire qui aurait été composée par Igor Stravinsky et inspirée par les 1500 mètres[64] : « Commence, alors, à battre un lointain tambour, tambour “cardiaque” de vie et de mort, qui fête la gloire infernale des fins de course. La foule se lève. Elle crie, acclame, supplie, conjure. Le tambour du coeur couvre tout, devient tam-tam, timbales, grosse caisse » (Obey 1924d).
Les bases théoriques de la dramaturgie musicale d’Obey
La conception musico-dramatique de 800 mètres que notre analyse a mise en lumière coïncide parfaitement avec les idées à propos du rôle et de la forme des musiques de scène qu’Obey a exposées dans une série de quatre articles parus dans L’Impartial français en 1927 (Obey 1927e-h). Le critique-dramaturge se dit généralement insatisfait des musiques de scène utilisées dans les pièces de théâtre auxquelles il assiste, qui ne sont pas assez stylisées : à propos d’une mise en scène de Jazz de Marcel Pagnol (1927) au Théâtre des Arts, il critique l’utilisation en direct d’un disque, car « [i]l fallait, je ne sais pas… styliser comme on dit (et comme on ne fait jamais), non point photographier les apparences du disque, mais les brouiller au contraire pour en évoquer l’âme, en extraire le timbre, en faire un personnage, une réalité dramatiques… » (Obey 1927e, 15). Une musique réaliste ne contribue au drame que comme décor. En revanche, une bonne musique de théâtre — bonne du point de vue de sa fonction, indépendamment de sa qualité musicale — n’est pas une musique autosuffisante, mais il faudrait qu’elle soit « un résidu, un précipité dramatique, le sel même, le principe des mots de théâtre » (Obey 1927g, 15) ; il faudrait que « tout en restant libre et souveraine, [elle] se montre assez soumise aux intentions et aux volontés de théâtre pour y collaborer au lieu de le trahir » (Obey 1927g, 15). Pour ce faire, il faut calibrer « au millimètre et au milligramme près par la règle, le compas, l’éprouvette graduée » (Obey 1927e, 15) le rapport entre les mots et la musique, afin que celle-ci puisse « capter et […] diriger toutes les vibrations que les mots du dialogue et le jeu des acteurs sont, du moins il faut le croire, impuissants à éveiller toutes » (Obey 1927e, 14). Les indications laissées par Obey dans 800 mètres vont précisément dans cette direction : la stylisation des sons plutôt que leur reproduction réaliste (la musicalisation des bruits et des mots, la stylisation des sonneries qui accompagnent l’entrée des coureurs), des interventions musicales calibrées « au millimètre » (les indications de durée, les prescriptions de début et de fin de chaque événement sonore), une conception de la musique comme « personnage, réalité dramatique » (le tam-tam) et, en général, la quête constante de complémentarité entre musique, gestes et mots qui caractérise la « partition » de 800 mètres dans le script de 1941.
1964 : une oeuvre différente
Il existe de nombreuses différences entre le tapuscrit de 1941 et celui de 1964, une cinquantaine de variantes majeures — des passages entiers ont été modifiés ou supprimés — et de très nombreuses variantes mineures. Nous nous limiterons ici à discuter des différences musico-dramatiques car, dans l’enregistrement de 1964, la finesse de la conception musico-dramatique d’Obey que nous venons de décrire n’est souvent pas respectée, et il y a un décalage presque systématique entre les prescriptions musicales des didascalies et leur réalisation. La partition de 1964 n’est certainement pas celle préparée par Honegger en 1941 : non seulement l’orchestration le prouve (l’utilisation de cordes, harpe(s) et flûte(s) au stade est à exclure), mais sa dramaturgie musicale diffère complètement par rapport au tapuscrit de la première version. En effet, dans la mesure où l’on admet que les chiffres encerclés sur Tb sont un fantôme de la partition de Honegger, force est de constater qu’elles ne correspondent pas aux morceaux joués en 1964 (voir plus haut Tableau 1). On pourrait toutefois raisonnablement penser que la partition est toujours celle de Honegger, mais que les morceaux ont tout simplement été redistribués et réorchestrés[65]. Cette hypothèse comporte toutefois un problème considérable, soit une différence musicale majeure entre les deux versions, qui a une conséquence non négligeable sur la dramaturgie de la pièce. Cette différence majeure concerne ce qu’Obey appelle « cloches de choeur » (no 5), et qui ne correspond pas à un seul morceau en 1964, mais à deux (5a, 5b). Le Tableau 2 offre un aperçu du décalage presque systématique entre les prescriptions musicales des didascalies et la réalisation telle qu’on peut l’entendre dans l’enregistrement.
Tableau 2
Correspondances entre les interventions musicales prescrites pas les didascalies de Tb (voir Tableau 1, col. B) et celles de l’enregistrement de 1964
Le choeur entre bruit et musique
Obey, en voulant composer une tragédie grecque sinon par la forme du moins par son inspiration, accorde une importance fondamentale au choeur. Cet élément est central dans la conception de 800 mètres comme oeuvre complémentaire aux Suppliantes. C’est ce que montre d’ailleurs l’Image 3, où le choeur à l’arrière-plan pourrait aussi bien être celui de 800 mètres — à l’avant-plan — que celui des Suppliantes, les deux spectacles étant en répétition en même temps. La complémentarité va dans les deux sens : en plus de « rendre grec » le 800 mètres, LesSuppliantes de Barrault comportaient en effet une composante athlétique, les cinquante fils d’Egyptos étant joués par les pompiers de Paris, assez forts pour pouvoir « coltiner » les cinquante Danaïdes du choeur au rythme de la musique de Honegger, tel qu’Obey le raconte dans ses entretiens avec Dutilleux de 1965[66] (entretien no 12).
Image 3
Charlemagne, « On répète les Suppliantes d’Eschyle au stade Roland-Garros », La Semaine à Paris, 3-8 juillet 1941, p. 6.
Depuis la Renaissance, le choeur « revêt le pouvoir symbolique d’un emblème, celui […] d’un retour à l’antique qui passe par l’appropriation d’une manière tout autant que d’une matière » (Louvat-Molozay 2002, 177). La manière, c’est la présence du choeur tout au long de la pièce à la fois comme somme d’individus interagissant entre eux et comme personnage collectif, qui s’exprime bien sûr de façon verbale (surtout dans un échange de type responsorial avec le coryphée), mais agit surtout comme élément de sonorisation (la « rumeur chorale » est décrite en détail dans les didascalies, qui en prescrivent toutes les articulations et ses nuances[67]). La matière, c’est le contenu du message véhiculé par le choeur, « l’un des principaux lieux de [l’]articulation entre la représentation d’un destin et la réflexion générale » (178).
Le choeur était une composante fondamentale de la transposition artistique de la course dès la première version de 800 mètres, la nouvelle de 1924. Dans cette version initiale, le protagoniste Paul Martin, avant même d’être entouré par « la foule des gradins [qui] se penche sur lui » pendant la course, est submergé par les conseils, les doutes, les statistiques et les pronostics de ses « amis » de Lausanne, ces « tacticiens de l’apéritif » qui constituent la composante discursive du sport : « C’est le choeur des tragédies grecques, l’opinion publique, ces messieurs de la famille… » (Obey 2012 [1964], 150-151[68]). Dans la pièce de 1941, cette fonction de commentaire confiée à des personnages internes à la diégèse, mais qui n’agissent pas, sinon par leur présence sonore (verbale ou de bruitage), s’articule en trois figures de plus en plus importantes pour structurer l’action et la charger sémantiquement. Le choeur émet d’abord seulement du son, une masse informe qui « gronde » (Tb, 2-3). Ensuite, il incarne la masse très réaliste du public du stade, « Peuple-Sport, subtil et naïf, crédule et frondeur, sévère mais juste, Dèmos aux cent mille têtes, au grand coeur unique » (Obey 1924c) (c’est donc une scénographie sonore : des mots et des bouts de phrases dressant un portrait sonore du brouhaha qui précède la course[69]). Enfin, le choeur devient une voix poétique collective qui, en alternance avec le Speaker-coryphée, offre une réflexion générale en réaction aux événements et énonce ainsi l’esthétique du sport d’Obey, sans pour autant abandonner la fonction diégétique de public de la course.
Pour accompagner le choeur, ou mieux pour se fondre à sa voix, Obey prescrit deux sortes de fonds instrumentaux, qu’il nomme respectivement « bruit du choeur » et « cloches du choeur ».
No 4, « bruit de choeur »
« Une sorte de batterie d’usine à quatre temps, large, sourde, puissante, monotone, avec quelques éclats d’instruments çà et là. (Pour fixer les idées : je pense à ce fond sonore qui commence Panorama américain) » (Tb, 8). Panorama américain est le titre d’un double disque composé et dirigé par Danièle Amfitheatrof[70] à la tête des Concerts Pasdeloup, paru chez Pathé en 1935 et gagnant du Grand Prix du disque Candide en 1937[71]. Dans l’enregistrement de 1964, ce morceau est une valse chaotique et grotesque dont le commencement semble effectivement reprendre la sonorité du début de Panorama américain (lui aussi en rythme ternaire). Si on exclut qu’il s’agisse du morceau composé en 1941 par Honegger (qui connaissait sans doute ces disques ou qui aurait pu les écouter directement par l’entremise d’Obey), il est néanmoins vraisemblable que la personne qui a composé la musique en 1964 pour la radio ait pu facilement accéder à ces vieux enregistrements et s’en inspirer.
No 5, « cloches du choeur »
« Fond d’orchestre, beaucoup plus musical [que le « bruit du choeur »], celui-ci […] (pour les moments d’unanimité, d’émotion, de pathétique choral) » (Tb, 8). En 1941, l’utilisation des « cloches du choeur » se limite à deux moments de la pièce, créant ainsi deux sommets lyriques et émotifs : en accompagnement du premier moment lyrique de la pièce, le long hymne au sport et au plein air récité de façon responsoriale par le Speaker et le Choeur ; et à la fin du drame, lorsque Jean, arrivé deuxième pour un souffle, rend hommage au vainqueur, symbole ultime du caractère pacificateur du sport. En 1964, ce rôle « plus musical » est confié à deux morceaux différents, 5a et 5b, qui reviennent chacun trois fois dans l’enregistrement, pour un total de six moments « très musicaux ». De plus, les deux moments où les didascalies de 1941 prescrivaient le no 5, l’enregistrement de 1964 présente respectivement 5a et 5b : le rôle structurant de la musique subit donc un changement majeur, puisque ces deux moments ne sont plus liés par la musique qui les accompagne et qui leur était spécifique. Si l’on considère que le no 4, en 1964, est aussi très musical (ne se limitant donc pas à être « une sorte de batterie d’usine »), le résultat est une version de la pièce beaucoup plus lyrique qu’en 1941. La conception musico-dramatique de la version de 1964 diffère énormément de celle de 1941 et contredit la plupart des didascalies et des théories musico-dramatiques d’Obey : la version de 1964 privilégie nettement la fonction d’accompagnement du texte par rapport à la recherche d’une complémentarité et d’une musicalisation de la parole. La transformation médiatique que la pièce a subie peut justifier ces changements : l’action théâtrale où la musique remplissait essentiellement un rôle de sonorisation du geste scénique est désormais un drame radiophonique répondant à d’autres exigences musico-dramatiques.
Conclusion
Le caractère unique de 800 mètres ne réside pas tant dans son sujet sportif (qui était une véritable mode dans l’entre-deux-guerres[72]), mais dans le fait que la pièce théâtrale est conçue pour une représentation dans le stade, « de telle sorte qu’on puisse donner l’illusion du sport » (Dutilleux 1965, entretien no 12). La nature de ce drame sportif donne à la musique un rôle de premier plan dans la structuration et dans la perception de l’action, une course présentée au ralenti et du point de vue subjectif du coureur protagoniste. Quelle était cette musique ? En absence de la partition de Honegger, c’est la musique imaginée par Obey qui a fait l’objet de notre analyse. Dans une pièce qui se déroule d’un seul souffle, sans division en scènes ni pauses, la place de la musique joue un rôle clé dans la structuration de la perception du drame. L’étude philologique de la conception musico-dramatique inscrite dans le script de 800 mètres permet de comprendre en profondeur la nature du drame sportif imaginé et ensuite réalisé par Obey, à la fois grec et moderne, gestuel et musical.
Obey a été un acteur fondamental de la réflexion sur la musique et le sport dans la France de l’entre-deux-guerres, et 800 mètres constitue un cas très complexe de traduction artistique d’une réflexion esthétique par un critique qui est aussi dramaturge. Il s’agit donc d’un exemple particulièrement significatif et unique en son genre de lien direct entre la réflexion critique et l’activité professionnelle (artistique en l’occurrence) d’un musicographe. De plus, l’état incomplet des sources et leur rôle de « fantôme » par rapport aux sources perdues en font un cas philologiquement complexe et herméneutiquement stimulant de dramaturgie musicale ambitieuse, où plusieurs idées d’Obey sur le rôle et la nature des musiques de scène subsistent dans des formes différentes (indications par lettre, didascalies, enregistrement).
L’histoire de la conception et le processus de réalisation de 800 mètres illustrent la théorie et la pratique de l’art olympique selon Obey. Une forme d’art où le sport offre la traduction moderne la plus directe — gestuelle et musicale — du drame humain des tragédies grecques. Une course stylisée constitue pour Obey l’humain stylisé. Cependant, Obey n’était pas satisfait du résultat. Il le déclarait déjà à la veille du spectacle, en 1941. Si sur papier, tout semblait fonctionner dans cette transposition sportive de la tragédie grecque,
[s]ur la scène, cette scène qui est un stade (un vrai stade, tout culotté d’authentique gloire sportive, mais sec de patine théâtrale), face à douze mille places vides, d’un ciment sourd, aveugle, obtus et collectif […], en plein air, dans ces remous d’air qui jouent avec la voix humaine comme, avec le bouchon, la houle, ah ! sur la scène, c’est effrayant de se sentir, malgré le cothurne à l’antique (devenu chaussure orthopédique), cul-de-jatte, traîne-fesses, homme-tronc, nabot ! Oui, effrayant en vérité de voir comme il est impossible non pas même de se hisser au niveau du blanc genou grec, ni même de cette cheville dorée où le cuir des lanières imitait le bruit du baiser, mais simplement, tout simplement, de faire un peu de vraie poussière.
Obey 1941, 2, c’est l’auteur qui souligne
Ainsi, la Grèce demeure trop lointaine pour pouvoir être réactualisée. Le sport, trop matériel pour incarner le drame. Le stade, trop sourd pour restituer la musique du sport traduite en notes et en voix.
Parties annexes
Annexes
Annexe 1. Lettre d’André Obey à Florent Schmitt, 7 avril 1928
BnF, Musique, Lettres autographes vol. 81, VM BOB 21585, lettre 150.
Mon cher Florent,
Vuillermoz vient de me téléphoner. Oui, nous pouvons faire quelque chose ensemble. J’ai une idée assez bonne je crois. Je vous ai envoyé jadis un bouquin bleu qui s’appelait L’Orgue du stade. Si vous l’avez encore, prenez-le. Si vous ne l’avez plus je vous le renverrai. Bon. Prenez l’avant-dernier chapitre, le 800 mètres de Paul Martin et veuillez le lire. Il s’agirait dans ma pensée de mettre ça « en action » et pour le plein air. Il y aurait à faire à mon sens le premier essai d’art sportif. Ça durerait 6 à 8 minutes. (Je vous mets tout ça en désordre mais ça se casera.) Ça serait conçu pour la pelouse et la caisse de résonance du stade. Il faudrait beaucoup d’air entre les voix. J’ai gardé dans l’oreille un tas de souvenirs sonores des jeux de 1924 à Colombes. Je vous dirai tout cela un jour.
Un récitant (pour le décor, le récit de la course et la foule)
Une voix d’homme (le coureur de 800)
Un choeur d’hommes, 4 voix (le peloton [américains, anglais, finlandais])
Des instruments très simples là-dessous, des instruments bruts et « entiers ».
- En imaginant ce truc-là, j’ai « entendu » le récitant avoir cette voix à la fois unanime et solitaire qu’ont certains chanteurs ou diseurs nègres [sic] dans les derniers Columbia.
- Pour la voix de l’athlète, j’ai entendu un timbre flageolant, divagant, éperdu, enfantin presque. Une espèce d’examen de conscience, rapide, bien entendu et stylisé, qui, en 5 minutes, nous fasse passer par tous les grands sentiments qu’éprouve — que devrait éprouver — un athlète olympique. Héroïsme. Peur. Audace. Épouvante. Gloire. Loyauté. Hypocrisie. Triomphe. Orgueil. Bref ! l’essentiel de tout ça.
- Pour le choeur à 4 voix, quelque chose du genre des « Revellers [sic pour Revelers] » mais en [p. 2] force, en simplicité — quelque chose de carré, d’architectural.
Tout ça tombant sur le stade et sur la foule du haut d’un haut-parleur.
À Colombes, en 1924, j’ai noté — je vous le répète — des timbres providentiels. Il y avait d’abord une escouade de cornemuses (highlanders) qui faisait vraiment plein air. Ça sentait le gazon, le jardinage, l’histoire naturelle. Mais est-il possible d’avoir des cornemuses ?
J’ai noté aussi 3 banjos, un autre jour.
Et un soir des trompettes de cavalerie qui avaient presque la majesté de « présentation » et d’« encadrement » de la cithare hellénique ou du luth médiéval autour d’une chanson de geste, d’une affirmation héroïque.
Je bafouille, bien entendu. Je cherche à chatouiller votre imagination. Il me faut 48 heures pour écrire ce petit drame athlétique. Est-ce que, en gros, ça vous dirait quelque chose ? Vous voyez le truc ?
Le départ.
La course (avec toute sa texture fuguée)
L’arrivée en forme de strette avec un chevauchement de sentiments et d’idées musicales à peine indiqués naturellement…
Et par-dessus tout un essai d’art bref, d’art brusque, d’art essentiel et en plein air. Sortir du gris de la cantate officielle, du blanc de l’invocation aux dieux pour trouver ces triangles crus — rouge, vert, bleu, or — qu’on voyait à Mycènes sur les murs ensoleillés du stade.
Voyez-vous quelque chose là-dedans ?
Bien affectueusement,
André Obey
Annexe 2. Synopsis comparées des 4 versions de l’oeuvre[75]
Tableau comparatif des personnages
1) Le Huit cents mètres de Paul Martin (1924)
Genre : Nouvelle
Publication : Dans L’Orgue du stade
Personnages : Les 9 coureurs de la finale du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Deux voix intérieures incarnent les deux traits de personnalité en opposition chez Paul Martin, l’une l’encourageant (l’athlète, enthousiaste et confiant), l’autre le démoralisant (l’étudiant en médecine, rationnel et sceptique). Il existe deux voix chorales, celle des amis amateurs du sport de Lausanne, ville natale de Paul Martin, et celle du public du stade.
Intrigue : C’est la finale du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Paris vue à travers l’expérience d’un des coureurs, le Suisse Paul Martin. L’athlète est à la fois découragé (« Tu ne devrais pas être ici », « Tu seras le dernier ! ») et excité (« Tu gagneras ! ») face à la difficulté de cette épreuve. Dans les vestiaires, ses pensées sont hantées par le regard des autres sur sa participation à la finale : la foule des sportifs résonne dans sa tête (les discours entendus avant de partir pour les Jeux, et ceux qui commenteront le résultat de cette course), en même temps qu’elle résonne, réelle et menaçante, dans le stade (« On va le livrer aux bêtes »). Une fois les athlètes sortis sur la piste, « sous le regard innombrable du Congrès des nations », Paul Martin se concentre afin de ne pas être submergé par ce sentiment de gêne paralysant. La tension qui l’habite lui fait faire un faux départ, ce qui en rajoute à son sentiment d’inadéquation (« quelque chose de ridicule, d’infamant presque »). À la fin des premiers 300 mètres de la course, Paul Martin arrive à se convaincre qu’il peut réussir à gagner et commence une conquête acharnée de la première position (« Commencement du drame ») ; il pense qu’après avoir dépassé Stallard la course sera gagnée, mais c’est Lowe qui remonte à la dernière seconde et l’emporte.
2) Projet inabouti, présenté dans la lettre à Florent Schmitt de 1928 (Annexe 1)
Genre : « Mise en action » pour le plein air de la course représenté dans la nouvelle ; un « essai d’art bref, d’art brusque, d’art essentiel et en plein air ».
Personnages : Le peloton est réduit à cinq coureurs (une voix d’homme et un choeur de quatre voix d’hommes). Un récitant décrit le décor et la course ainsi qu’il donne voix à la foule.
Intrigue : Tel que précisé dans la lettre, « Le départ. La course (avec toute sa texture fuguée). L’arrivée en forme de strette avec un chevauchement de sentiments et d’idées musicales à peine indiqués naturellement… ».
3) 800 mètres, version 1941
Genre : Drame sportif
Première représentation : Paris, Stade Roland-Garros, 5 juillet 1941
Personnages : Les neuf coureurs de la finale du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Paris qu’on retrouve dans la nouvelle de 1924 sont réduits à sept pour le drame. Le protagoniste n’est plus Suisse mais Français (Jean) ; les six autres incarnent une géographie stylisée (Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud, Ouest, Est) ; Obey maintient les noms de Stallard et Richardson. Une fille (Jeanne) et un garçon (Jojo) personnifient les deux voix intérieures du protagoniste. La course est introduite par un Maître de cérémonie accompagné par deux Assesseurs et cinq Boys et commentée par un Speaker (« l’homme de la radio ») qui sert de coryphée au Choeur, incarnation de la voix du stade. L’Orchestre est traité en personnage qui réagit lorsqu’on l’interpelle.
-
Intrigue : Après une fanfare annonçant le début du spectacle, le Maître de cérémonie et les Assesseurs appellent l’Orchestre, le Choeur et les Boys qui, à leur tour, appellent le Speaker. La foule entre dans le stade. Premier choeur : éloge du stade et du plein air (« Anneau magicien »). Le Maître de cérémonie appelle les coureurs au départ. Deuxième choeur : le combat sportif comme un ordre auquel il faut obéir (« Tragédie de l’été »). Les six coureurs étrangers entrent sur la piste, appelés par le Maître de cérémonie et accompagnés par des fanfares. L’entrée de Jean est précédée par une longue présentation du Speaker et accompagnée par une « formidable acclamation » du Choeur. Le peloton se dirige vers la ligne du départ. Troisième choeur : Le départ des « sept frères ennemis ». Le Speaker commente l’attitude de Jean, qu’il qualifie de double, moitié mâle (la raison) et moitié femelle (l’héroïsme) ; ces deux composantes du coureur s’incarnent dans les voix de Jojo et de Jeanne qui parlent à Jean sur la ligne du départ, respectivement pour le décourager et l’encourager. Après un faux départ de Jean, la course commence. Les deux voix et le Speaker s’adressent au protagoniste, lequel commence lui-aussi à exprimer directement ses sensations et ses pensées ; les autres coureurs n’ont pas de voix, mais leur présence se manifeste par des « choeurs de souffles ». Au moment où « notre homme commenc[e] de s’insinuer entre Richardson et Marva », quatrième choeur : « Voici le drame », décrivant la « guerre de l’âge du sport ». Lorsque Richardson s’écarte, Jean exulte et dépasse Heltzer ; Jean s’emballe, se sent tout-puissant, et il passe Stallard « bien trop au large », ce qui lui fait perdre des instants précieux. Cinquième choeur : « Après le drame, la tragédie ». Jean n’arrive pas à remonter le terrain perdu et arrive deuxième après Marva, « battu d’une poitrine ».
Comme dans la nouvelle de 1924, le protagoniste pense avoir gagné après avoir dépassé Stallard, mais un autre coureur (Lowe dans la nouvelle, Marva dans le drame) surgit et gagne la course. Tel qu’exprimé par Jeanne, « Il reste le plus dur combat », celui entre la délusion personnelle et l’esprit sportif. Ce dernier triomphe, avec Jean qui « enroule avec grâce et pudeur [son] bras autour de Marva et pose un court instant son front sur l’épaule du vainqueur ». Choeur final : profession de foi collective dans le sport en tant que manifestation de la vraie essence de l’humain incorrompu par la civilisation, avec apostrophe finale à la jeunesse, espoir du futur.
4) 800 mètres, version 1964
Genre : Drame radiophonique
Diffusion : 4 octobre 1964, France Culture
Personnages : Les sept coureurs sont les mêmes qu’en 1941. Le rôle du Speaker fusionne avec celui du Maître de cérémonie et du Speaker de 1941. Un récitant s’ajoute pour décrire certains passages de la course (souvent repris des didascalies de 1941), remplacement radiophonique de la présence visuelle.
Intrigue : La même qu’en 1941, raccourcie, avec variantes. La scène initiale est la plus coupée et remaniée en raison de la réduction du nombre des personnages (seul le Speaker subsiste). Les « choeurs de souffles » sont supprimés.
Note biographique
Federico Lazzaro est chercheur au sein de l’équipe « Musique en France aux xixe et xxe siècles : discours et idéologies », où il coordonne les projets de recherche et d’édition du site pressemusicale.oicrm.org ainsi que la Nouvelle Histoire de la musique en France (1870-1950). Il enseigne à l’Université de Montréal, à l’Université de Sherbrooke et au Conservatoire de musique de Montréal. En plus de ses travaux sur la musique en France dans la première moitié du xxe siècle (articles sur Debussy, Ravel, Jolivet, le nationalisme musical, musique et sport, musique et machines), ses publications ont porté sur Monteverdi, Gesualdo, Rota et Rossini (édition critique de Sigismondo pour Ricordi, 2010). Son livre Écoles de Paris en musique (1920-1950) : Identités, nationalisme, cosmopolitisme (Paris, Vrin, 2018) a reçu en 2019 le Prix H. Robert Cohen/RIPM de l’American Musicological Society et le Prix chercheur étoile Paul-Gérin-Lajoie du Fonds de recherche du Québec. Il est co-directeur avec Steven Huebner de Migration artistique et identité à Paris, 1870-1940/Artistic Migration and Identity in Paris, 1870-1940 (New York, Peter Lang, 2020), et avec Michel Duchesneau de Musique-Disque-Radio en pays francophones, 1890-1950 (Paris, Vrin, à paraître). La Société québécoise de recherche en musique (SQRM) lui a octroyé en 2014 le prix Présences de la musique et en 2018 le Prix chercheur émergent. Il est le responsable des recensions aux Cahiers de la SQRM et ancien rédacteur en chef de Gli Spazi della musica.
Notes
-
[1]
Une forme condensée de cette étude a été présentée au congrès annuel de 2019 de la Société de musique des universités canadiennes (MusCan) (Vancouver, 5-7 juin). Cette recherche a été financée par le Fonds de recherche du Québec, société et culture (FRQSC) dans le cadre d’un stage postdoctoral à l’Université d’Ottawa.
-
[2]
Ce procédé antithéâtral a été surligné par le critique théâtral de Comoedia (Purnal 1941), qui le qualifie de littéraire.
-
[3]
Nous analysons ces textes et ce débat, et notamment l’enquête « La musique et le sport » lancée par Le Guide du concert en octobre 1924, dans un chapitre des actes du colloque André Obey, créateur dramatique complet (sous la direction de Sophie Gaillard et Marie Sorel, à paraître).
-
[4]
Pour l’histoire non coubertinocentrique de la relance des Jeux olympiques au xixe siècle, voir Young 2004, chapitre 13 : « The Origin and Authenticity of the Modern Olympic Games ». Sur le culte du corps grec et le développement de la valorisation de l’activité physique en Angleterre et France au xixe siècle, voir Leoussi 1998.
-
[5]
La méfiance, d’autant plus accentuée lorsqu’il est question de sport féminin (voir Holt 1991 ; Arnaud et Terret 1996 ; Stewart 2001) s’appuie sur le postulat à la fois chrétien, cartésien et idéaliste de la séparation entre le corps et l’esprit (et du danger que le développement du premier ne puisse que nuire au second). Parmi les nombreuses études sur l’histoire sociale du sport en France dans la première moitié du xxe siècle, voir Arnaud 1997, Callède 2000, Andrieu 2002, Andrieu 2004 et Tétart 2007 ; plus particulièrement sur les Jeux olympiques de Paris 1924, Terret 2008 (vol. 3 et 4 surtout). Nous avons analysé quelques réflexes musicaux du discours souvent sarcastique envers l’activité sportive dans Lazzaro 2017a ; pour les représentations littéraires de ces enjeux, voir les deux études classiques de Pierre Charreton (1985. et 1990), et plus particulièrement sur le sport féminin, Bauer 2011.
-
[6]
Le Guide du concert publiera une enquête-débat sur l’audition « directe » et « indirecte » en 1930 (« Audition directe et audition indirecte », 1930). Sur l’enregistrement et la radio comme points tournants de l’esthétique et de la pratique musicale en France, voir Duchesneau et Lazzaro (à paraître).
-
[7]
Bibliothèque nationale de France (BnF), Musique, Lettres autographes vol. 81, VM BOB 21585, lettre 150, reproduite intégralement dans l’Annexe 1.
-
[8]
« [L]e petit Savreux recevait, l’oeil béant, l’initiation au Sport. Religion d’aujourd’hui — et de jadis […] qui est grande bien moins par son catéchisme musculaire, ses litanies de performances ou de records que par la révélation extatique d’une vie interne, inaccessible à la raison. Foi de tout le corps en l’harmonie transcendantale de ses fluides en l’avènement d’une Force, occulte à la façon de la Musique et qui rejoint, peut-être, par-delà les siècles rationnels, la gymnique grecque et les rythmes redoutables des yoghis. » (Obey 1923, 16-17)
-
[9]
Voir note 7. La BnF conserve deux autres lettres d’Obey à Schmitt, précédant celle-ci (lettres 148-149. du même recueil), la première non datée (mais de 1920 : le lendemain de la première d’Antoine et Cléopâtre à l’Opéra le 14 juin, Obey le remercie pour les places et manifeste son enthousiasme pour l’oeuvre) et la seconde du 8 avril 1922.
-
[10]
Obey raconte sa rencontre avec Florent Schmitt et l’amitié qui s’en suivit dans sa série d’entretiens radiophoniques avec Henri Dutilleux diffusés en 1965, et plus particulièrement dans le troisième épisode.
-
[11]
Obey avait déjà évoqué son souhait de collaborer avec le compositeur dans sa lettre du 8 avril 1922 : « Je vous aime tant, Florent Schmitt, et votre musique a si souvent éclairé des heures noires. J’ai exposé à des gens à galette un vaste rêve cinématographique. Ça les a effrayés, ça les a — aussi — intéressés : je vous expliquerai le projet longuement. Et j’oserai vous demander — mon roman fini — une collaboration étroite. Il y a de belles choses à faire et beaucoup d’argent à gagner. La société d’édition est, bien entendu, germano-belge. Notre douce France meurt de se croire la première nation du monde ». Dans la même lettre, il relatait ses tentatives de carrière en tant que critique musical : « J’ai essayé dix fois en vain d’accoucher des articles Durand-Prunières [c’est-à-dire, pour La Revue musicale]. Ça ne se tient pas. Je manque trop de technique harmonique, orchestrale, etc. Vous pensez bien que je m’incline amicalement devant Roland-Manuel qui a écrit de bonnes, sensibles et solides pages sur vous et sur Ravel. J’ai travaillé, d’ailleurs, et je vous dédiera [sic] un livre qui paraîtra après le roman que je termine et qui s’appellera le Journal d’un trépané (vous en avez lu un fragment dans la Rose rouge). »
-
[12]
Toutes les transcriptions d’émissions radiophoniques sont par nos soins. Lorsque l’italique est utilisé, c’est pour mettre en évidence des mots jugés importants dans le contexte de la citation et non pour traduire graphiquement une inflexion particulière du locuteur.
-
[13]
Dans Le Joueur de triangle (1928), Obey transpose en forme de roman sa formation à l’école de musique de Douai.
-
[14]
Remarquons que Le viol de Lucrèce d’Obey (1931) a donné lieu en 1946 à l’opéra éponyme de Benjamin Britten.
-
[15]
L’élément 4 de la liste ci-dessus : « pour le plein air » ; « conçu pour la pelouse et la caisse de résonance du stade » — notons les deux niveaux, visuel et auditif, du spectacle.
-
[16]
L’élément 2, avec les voix et la musique « tombant sur le stade et sur la foule du haut d’un haut-parleur ».
-
[17]
Élément 3.
-
[18]
« [U]n essai d’art bref, d’art brusque, d’art essentiel ».
-
[19]
« Sortir du gris de la cantate officielle, du blanc de l’invocation aux dieux pour trouver ces triangles crus — rouge, vert, bleu, or — qu’on voyait à Mycènes sur les murs ensoleillés du stade » (la Grèce, élément 1).
-
[20]
Élément 5.
-
[21]
Les Jeux de Paris de 1924 se sont déroulés au stade olympique de Colombes (Hauts-de-Seine), nommé, depuis 1928, en l’honneur du joueur de rugby Yves du Manoir.
-
[22]
Remarquons à ce propos que dans L’Orgue du stade, le tuyau d’orgue associé aux 800 mètres était la voix humaine, en raison de la souffrance qu’implique cette course ; voir Obey 2012, vol. [2], 10 et 26.
-
[23]
Pour la genèse de la nouvelle, voir Obey 1941.
-
[24]
The Revelers étaient un quatuor vocal avec piano étatsunien actif à partir de 1925. Une partie du court-métrage musical tourné en 1927, où le groupe chante trois de ses chansons, est accessible sur YouTube : Revelers — Dinah, https://youtu.be/m4LZFaxHV80, consulté le 17 janvier 2020.
-
[25]
Rugby (Mouvement symphonique no 2) sera créé à Paris le 19 octobre 1928, quelques mois après la lettre d’Obey à Schmitt. Pour une lecture analytique de Rugby en relation avec d’autres poèmes symphoniques à sujet sportif de la même époque, voir Lazzaro 2017b.
-
[26]
Réalisation de Gilbert Caseneuve, enregistrement conservé à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). L’enregistrement a une durée de 49 minutes 50 secondes, la diffusion ayant eu lieu entre 15h10 et 16h. La pièce commence à 00 :17 :30, précédée d’une entrevue avec Jean-Louis Barrault, déjà en cours au moment où l’enregistrement conservé commence ; il est possible que le texte d’Obey « À propos de Huit cents mètres » (1964) ait été lu avant l’entrevue de Barrault, mais cette hypothèse ne peut pas être confirmée puisqu’aucun enregistrement entre 14h56 et 15h10 n’est conservé dans les archives de l’INA. L’enregistrement est coupé sur le dernier mot de la pièce, et il n’est donc pas possible de savoir si une musique conclusive suivait.
-
[27]
Pour la présentation des variantes concernant les personnages et l’intrigue entre ces différentes versions, voir l’annexe 2, dont nous suggérons la lecture préalablement à celle de la suite de l’article afin de se familiariser avec les noms et les séquences narratives qui seront mentionnés et analysés dans les pages qui suivent.
-
[28]
Ta : tapuscrit (original) de 59 fol. recto, avec annotations manuscrites (stylo bleu, stylo noir, crayon bleu) ; BnF, Arts du spectacle, fonds Jean-Louis Barrault, 4-COL-178 (79). Tb : tapuscrit (copie carbone) de 62 fol. recto, avec annotations manuscrites (stylo bleu, stylo noir, crayon, crayon bleu, crayon rouge) ; BnF, Arts du spectacle, fonds Jean-Louis Barrault, 4-COL-178 (78).
-
[29]
À partir de 1941, les partitions de musiques de scène de Honegger restent inédites. Pascal Lécroart en conclut que « dans la première partie de sa carrière, Honegger a été soucieux de donner la possibilité d’un devenir musical autonome à ses partitions à travers des éditions ou des réadaptations. À partir de 1941, alors même que sa carrière est parfaitement établie, il reprend une activité de compositeur de musique de scène importante, mais sans chercher à valoriser musicalement ce travail indépendamment de la scène. » (Lécroart 2018, 93-118, 108)
-
[30]
Photographies d’archives conservées dans le fonds Jean-Louis Barrault : 4-COL-178 (2203), une photo des répétitions de 800 mètres au stade signée DNP ; 4-COL-178 (2202), 19 photos dont quatre du spectacle (ou de la répétition générale) signées Brucken. Plusieurs photographies dans la presse se trouvent dans le dossier de presse du spectacle, « Recueil. Les Suppliantes de Eschyle, 800 mètres de André Obey », Bibliothèque nationale de France, Arts du spectacle, 8-RSUPP-755, accessible sur Gallica, ark:/12148/btv1b105094945, consulté le 16 mai 2020 (Recueil).
-
[31]
Onze maquettes de costumes et de décor par Lucien Coutaud, BnF, Arts du spectacle, fonds Jean-Louis Barrault, MAQ-3302, MAQ-3303, MAQ-9406 à 9407, MAQ-9408 à 9413, MAQ-9414.
-
[32]
Plusieurs de ces articles se trouvent dans Recueil.
-
[33]
Une copie est conservée à la Maison de la Radio (je tiens à remercier Catherine Paycheng, documentaliste à la Maison de Radio France, pour ces informations et pour m’avoir fourni une copie du tapuscrit), l’autre à la BnF, Arts du spectacle, 4-YA-RAD-350. Il s’agit d’un tapuscrit de 44 fol. recto. La copie qui se trouve à la BnF ne comprend aucune annotation manuscrite sauf quelques signes à la page 7 ; le tapuscrit de la Maison de la Radio présente quelques annotations de plus qui confirment qu’il a été utilisé pour la représentation radiophonique de la pièce.
-
[34]
Ce volume a été préparé par l’association Les amis de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) en collaboration avec Les amis d’André Obey et le quotidien L’Équipe, à l’occasion des Jeux olympiques de Londres en 2012 (voir le texte de présentation de Stéphane Traineau ainsi que la préface de François Morinière dans Obey 2012, vol. [1], 5-6 et 9-11).
-
[35]
Voir note 26.
-
[36]
Dans Obey 1941, il écrit « près de vingt minutes ».
-
[37]
« Pour eux, le grand athlète est celui qu’on paie cher » (Obey 1927i).
-
[38]
« Jusques à quand les poètes, les philosophes, les musiciens seront-ils écartés par les businesmen [sic] des affaires lyriques de l’humanité ? » (Obey 1927c).
-
[39]
Obey fait ici référence à l’épisode qui constitue la source de 800 mètres et qui incarne, cette citation le démontre bien, l’essence du sport pour Obey : la finale du 800 mètres aux Olympiques de 1924 se terminant par une lutte serrée entre Paul Martin et Douglas Lowe, qui remporte la course par 0,2 secondes (site officiel du Comité international olympique, https://www.olympic.org/fr/paris-1924/athletisme, consulté le 16 mai 2020 ; il existe une photographie de l’arrivée des deux coureurs presque en même temps dans Rapport [1924], 111). Dans le drame, les deux coureurs sont transposés respectivement dans les personnages de Jean et Marva.
-
[40]
Sur la place du sport sous Vichy, voir notamment Prêtet 2016, ainsi que les chapitres sur ce sujet dans Tétart 2007.
-
[41]
L’article de Hoérée, « La partition d’Honegger », est placé juste après l’article de Roland Purnal sur les deux pièces (voir Recueil, p. 39). Cet article constitue un diptyque avec celui de Purnal (dramaturge, poète et critique dramatique), qui commente le côté théâtral du spectacle.
-
[42]
Par exemple : « Pendant cinq ou six secondes, rythmée par une puissante machinerie sonore, la course est un grand personnage » ; ou encore : « chant du choeur (très court : une douzaine de mesures) ».
-
[43]
Dans Ta, une accolade manuscrite qui embrasse tous les sons et pointe vers la didascalie clarifie que l’« accord final de jazz » est constitué par l’ensemble des parties.
-
[44]
Ce « dialogue » est aussi présent dans Ta (mais absent de Tc), bien que dans une autre scène : il s’agit de la plus grande variante entre Ta et Tb, qui intéresse les p. 20-27 de Ta et p. 18-24 de Tb.
-
[45]
Tb, 3 : « Le M. C. frappe violemment le ciment avec sa canne (il a une canne) » ; p. 4 : « Roulement irrité de la canne sur le ciment » ; p. 38 : « GROSSE-CAISSE : Boum ! (en même temps que le M. C. abat sa canne) ». Le Maître de cérémonie disparaît dans la version de 1964.
-
[46]
La fonction diégétique est remplie notamment par les fanfares du début (nos 1 et 2). Cela est surtout vrai dans la version de 1964, où le speaker semble attendre la fin de la « Brève fanfare » (n° 1) pour pouvoir parler (« C’est fini ?... Bon. On y va. »).
-
[47]
Voir plus haut, note 45.
-
[48]
La présence sonore forte des souffles était déjà présente dans la nouvelle de 1924 : « Les autres, il les entend souffler, il les entend courir. Ils soufflent et courent bref et lourd. Lui aussi, il s’entend courir et souffler. Aucune comparaison ! Il court et souffle long et frais. » (Obey 2012, vol. [2], 165).
-
[49]
La première version doit être réutilisée pour le troisième choeur de souffles, « mais plus fort, plus grondant, plus “méchant” » ; pour le quatrième choeur de souffles, la version à utiliser n’est pas explicitée, mais il doit être « plus rapide, bousculé, avec de la violence, de la guerre dans les souffles, sur les visages, dans les gestes : un ralenti de “bagarre” en course, avec coups de coudes, coups de “pointes” ».
-
[50]
À côté, au crayon : « 10 monté ».
-
[51]
À côté, au crayon : « 10 descente ».
-
[52]
À côté, à gauche, au crayon, symbole de crescendo. À droite, au crayon, à côté de chaque ligne : « 5 — ».
-
[53]
À côté, à gauche, au crayon, symbole de decrescendo.
-
[54]
C’est le cas du no 8 (7 dans Tb, 31) : « L’acclamation du choeur fléchit un peu, hésite, repart, et puis, soudain, se transfigure en un large chant très doux, très fort, très lent […]. À la fin du chant du choeur (très court : une douzaine de mesures), notre homme se tourne et fait, de ses deux bras levés, un geste de remerciement et de promesse au choeur. »
-
[55]
Tb, 6-7 : « SPEAKER (dans le micro comme l’ogre qui s’éveille) : Broum !.. Ha ! Broumm ! Broumm !.. (comme un commencement de gamme) Ha !.. Há !.. Ha !.. Ha !.. Mi-mi !.. Mi-â ! Mi-ô ! Mi-û !.. Ha-him !.. Mi-â !.. A-mi ! Mes… chers… amis… (plus vite) mes chers amis… (soudain sa voix coule d’un jet) ».
-
[56]
Dans Tb, 18, le Maître de cérémonie doit prononcer en « psalmodiant » : « Les… coureurs… du… huit cents mètres… au… départ ! ». Dans Ta, 19, Obey a noté à la main le rythme de cette déclamation psalmodiante. Dans Tc, ce passage est modifié et « Une voix lointaine » doit dire « psalmodiant » : « Pré-sen-ta-tion… des… coureurs… du… huit cents mètres… ».
-
[57]
Tc, 17-18. Les indications dans le tapuscrit sont, dans l’ordre, « Deux notes brumeuses de trompette » (comme dans Tb), « Trompette » et « Fanfare ».
-
[58]
« Tam-tam solo, quatre secondes » (Tb, 40), « Tam-tam fort (quatre secondes) » (42), etc.
-
[59]
Une didascalie (Tb, 38-39) décrit bien le caractère stylisé de cette course mise en scène : « Départ “véritable” des sept hommes. Trois pas exacts, comme pour un vrai départ : septuple chute, rattrapée au premier pas, redressée au deuxième pas, transformée en course, au troisième. Mais la course, dès le quatrième pas, le cède à une sorte de danse lente, extrêmement lente : un ralenti chorégraphique ou plutôt une mimique de la course ; un déploiement de ces sept corps muscle à muscle, un étirement, un allongement de ces sept corps — une impression de tension constante, d’effort, de lutte, de vitesse, donnée par une “perfection” de lenteur » (nous soulignons).
-
[60]
Cette question de la punition de la « démesure », typique de la tragédie grecque, est explicitée dans le passage de Ta supprimé dans Tb, reproduit sur fond gris dans l’exemple 1.
-
[61]
La didascalie indique plutôt « de la batterie ».
-
[62]
À la fin de notre exemple, la didascalie d’Obey explicite le côté cardiaque du tam-tam : « le tam-tam […], comme un coeur qui rentre dans l’ordre, s’assourdit et se ralentit ».
-
[63]
Dans la nouvelle de 1924, ces deux tensions s’opposant dans l’âme du coureur correspondent aux deux natures de Paul Martin, l’athlète (« aventureux, lyrique », qui pense : « Tout va bien ! Tout est normal ! ») et l’étudiant en médecine (« sentimental par nature, sceptique par expérience », qui pense : « Tu ne devrais pas être ici. C’est un miracle que tu te sois qualifié […]. Tu sombres dans le ridicule. Va-t-en [sic] d’ici ; tu n’es qu’un parvenu olympique ») ; Obey 2012, vol. [2], 147-148.
-
[64]
En plus d’imaginer une oeuvre musicale en la décrivant en détail, Obey s’était livré à l’exercice inverse de mettre en images (sous la forme d’un scénario pour un film) une musique existante, le fox-trot Ivy de Paul Whiteman (Obey 1924b).
-
[65]
Peut-être Barrault s’est-il procuré la partition de Honegger ? Il était en contact avec son épouse Andrée Vaurabourg-Honegger pour avoir des copies de partitions : voir sa lettre pour la remercier des photocopies de Tête d’or (Lettre de Jean-Louis Barrault à Madame Arthur Honegger, 13 juin 1959, Musique, VM BOB-19936, lettre 76). Dans son entrevue de 1970, Obey déclare : « [Interviewer :] Qu’est-ce qu’elle est devenue, cette partition ? [Obey:] Ça je ne sais pas. » Il n’en possédait donc pas de copie, et ce n’est pas lui qui aurait pu la donner aux producteurs radio en 1964.
-
[66]
Presque tous les comptes rendus du spectacle dans le Recueil commentent la présence des pompiers, qui se seraient aussi produits dans un entracte gymnique. Une photo publiée dans La Semaine, où deux pompiers en caleçon montent des marches en soulevant dans les airs deux jeunes femmes, est accompagnée de la légende suivante : « Ces pompiers de 1941 répètent le geste que firent les athlètes grecs en l’an 461 avant J.-C. » (Recueil, 39).
-
[67]
Elle est définie comme « ce grand bruissement marin qui vous saisit d’un coup quand un poste de radio vous branche sur une salle pleine » (Tb, 10).
-
[68]
On pourra comparer cette doxa chorale au « choeur des sportifs » qui réagit à la nouvelle de la traversée de l’Atlantique en avion effectuée par Francesco De Pinedo en 1927, dans Obey 1927a : « Donc, le marquis de Pinedo vient de traverser l’Atlantique en avion… / Le choeur des sportifs : Ah ! Non ! — Il n’a pas traversé l’At… ! / Le choeur : Entendons-nous ! ».
-
[69]
Dans la nouvelle : « Le Stade attend le huit cents d’un désir circulaire, gigantesque, cacophonique. Pas deux êtres, sur ces quinze mille, qui veuillent la même chose. Mais tous veulent, furieusement, quelque chose » (Obey 1924a, 154).
-
[70]
Ce qui explique la phrase d’Obey dans l’entretien de 1970 : « une espèce de musique de fond qui ressemblera à la musique de… de… d’un Russe » : Amfitheatrof est né à Saint-Petersbourg en 1901.
-
[71]
Il est possible d’écouter le disque et plus particulièrement le début auquel Obey fait référence sur le portail des Bibliothèques patrimoniales de Paris, à l’adresse suivante : https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000000496#prettyPhoto, consulté le 17 janvier 2020. Le disque a été le lauréat de la catégorie Jazz symphonique (le palmarès est publié dans Candide, no 717, 9 décembre 1937, 17).
-
[72]
La création, en 1931, d’une Association des écrivains sportifs (encore en activité : http://ecrivains-sportifs.fr/) réunissant plus de 70 membres (dont Obey) au moment de sa fondation donne une idée de l’engouement pour le thème du sport à cette époque.
-
[75]
Spécification présente en 1941 seulement ; en 1964, le récitant lit la didascalie qui précise que c’est un « petit homme brun, à plate face finnoise, un peu préhistorique ».
-
[74]
Les 26 réponses à cette enquête seront publiées dans les nos 3 à 10 et 15 à 18.
-
[73]
Ce renvoi réfère au dossier de presse dont la référence est présentée sous le titre Recueil dans la présente liste. Le contenu en est brièvement expliqué à la note 30.
Bibliographie
- Andrieu, Gilbert (2002). Du sport aristocratique au sport démocratique : Histoire d’une mutation, 1886-1936, Joinville-le-Pont, Actio.
- Andrieu, Gilbert (2004). Les Jeux olympiques : Un mythe moderne, Paris, L’Harmattan.
- « Audition directe et audition indirecte » (1930). Enquête, Le Guide du concert, vol. 17, no 1, 3 et 10 octobre, p. 9-10[74].
- Armory [Carle Lionel Dauriac] (1941). « L’hellénisme au stade, le vérisme chez les jeunes », Les Nouveaux Temps, Paris, 15 juillet ; dans Recueil, p. 34-36.
- Arnaud, Pierre (dir.) (1997). Les athlètes de la République : Gymnastique, sport et idéologie républicaine, 1870-1914, 2e éd., Paris/Montréal, L’Harmattan.
- Barrault, Jean-Louis (1941). « Joie de l’effort », Comoedia, Paris, 21 juin, p. 1-2 ; republié le 5 juillet ; dans Recueil, p. 2 et p. 16-18.
- Bauer, Thomas (2011). La sportive dans la littérature française des années folles, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
- Callède, Jean-Paul (2000). Les politiques sportives en France : Éléments de sociologie historique, Paris, Economica.
- Charreton, Pierre (1985). Les fêtes du corps : Histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France, 1870-1970, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne/Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’expression contemporaine.
- Charreton, Pierre (1990). Le sport, l’ascèse, le plaisir : Éthique et poétique du sport dans la littérature française moderne, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne/Centre interdisciplinaire d’étude et de recherche sur l’expression contemporaine.
- Delannoy, Marcel (1941). « Au Stade Roland-Garros », Les Nouveaux Temps, Paris, 15 juillet ; dans Recueil, p. 41.
- Duchesneau, Michel et Lazzaro, Federico (dir.) (à paraître). Musique-Disque-Radio en pays francophones, 1890-1950, Paris, Vrin.
- Dutilleux, Henri (1965). Entretiens avec André Obey : Entre cour et jardin, France-Inter, 3 juillet-25 septembre. 13 entretiens radiophoniques.
- Halbreich, Harry (1994). L’oeuvre d’Arthur Honegger, Paris, Honoré Champion.
- Hoérée, Arthur (1941). « La partition d’Honegger », Comoedia, Paris, 12 juillet ; dans Recueil, p. 31.
- Holt, Richard (1991). « Women, Men and Sport in France, c. 1870-1914 : An Introductory Survey », Journal of Sport History, vol. 18, no 1, p. 121-134.
- L’Atelier, (1941b). « Théâtre, musique, sport au stade Roland-Garros », Paris, 12 juillet ; dans Recueil, p. 40.
- Lazzaro, Federico (2017a). « Chanter l’athlète moderne, entre ridiculisation et glorification », Revue musicale OICRM, vol. 4, no 2, « Enjeux culturels dans la presse musicale française, 1900-1925 », p. 75-98. Accessible en ligne : http://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol4-n2/athlete-moderne, consulté le 16 mai 2020.
- Lazzaro, Federico (2017b). « Le son du sport, ou l’orchestre-stade de Martinů, Honegger et Lazăr », Euterpe, no 29, « Le son orchestral de 1918 à 1955 », p. 31-39.
- Lécroart, Pascal (2004). Paul Claudel et la rénovation du drame musical : Étude de ses collaborations avec Darius Milhaud, Arthur Honegger, Paul Collaer, Germaine Tailleferre, Louise Vetch, Sprimont, Mardaga.
- Lécroart, Pascal (2018). « Du statut des musiques de scène dans la production d’Arthur Honegger », dans Sylvie Douche (dir.), Musiques de scène sous la iiie République, Lyon, Microsillon, p. 93-118.
- Le Flem, Paul (1941). « Semaine Honegger », Paris-Midi, 8 juillet, p. 2.
- Leoussi, Athena S. (1998). Nationalism and Classicism : The Classical Body as National Symbol in Nineteenth-Century England and France, New York, St. Martin’s Press.
- Le Petit Parisien, (1941a). « Le comédien Jean-Louis Barrault jouera 800 mètres écrit à la gloire de l’athlétisme », Paris, 4 juillet ; dans Recueil[73], p. 15.
- Louvat-Molozay, Bénédicte (2002). Théâtre et musique : Dramaturgie de l’insertion musicale dans le théâtre français (1550-1680), Paris, Honoré Champion.
- Obey, André (1923). Savreux vainqueur : Moeurs d’après guerre, Paris, J. Ferenczi et fils, coll. « Colette ».
- Obey, André (1924a). L’Orgue du stade, Paris, Gallimard/Nouvelle Revue Française, coll. « Les documents bleus, 16 ».
- Obey, André (1924b). « Symphonies », L’Impartial français, Paris, 1er mars, p. 13.
- Obey, André (1924c). « Le stade en quête d’auteurs », L’Impartial français, Paris, 10 mai, p. 13.
- Obey, André (1924d). « Ce que pourrait être un Quinze cents mètres d’Igor Strawinsky », L’Impartial français, Paris, 1er novembre, p. 13.
- Obey, André (1924e). « D’un art sportif [1] », L’Impartial français, Paris, 15 novembre, p. 13.
- Obey, André (1926), « Nuit de Paris », Paris-Soir, 9 avril, p. 1.
- Obey, André (1927a). « Une voix d’homme », L’Impartial français, Paris, 4 janvier, p. 15-16.
- Obey, André (1927b). « Marine », L’Impartial français, Paris, 1er mars, p. 15.
- Obey, André (1927c). « “Sigfrid” Idyll », L’Impartial français, Paris, 8 mars, p. 15.
- Obey, André (1927d). « Championnat de France », L’Impartial français, Paris, 15 mars, p. 15.
- Obey, André (1927e). « Musiques de scène [i] », L’Impartial français, Paris, 22 mars, p. 14-15.
- Obey, André (1927f). « Musiques de scène (suite) [ii] », L’Impartial français, Paris, 29 mars, p. 14-15.
- Obey, André (1927g). « Musiques de scène (suite) [iii] », L’Impartial français, Paris, 5 avril, p. 14-15.
- Obey, André (1927h). « Musiques de scène (suite et fin) [iv] », L’Impartial français, Paris, 12 avril, p. 14-15.
- Obey, André (1927i). « …Temporis acti », L’Impartial français, Paris, 2 mai, p. 15.
- Obey, André (1928). Le Joueur de triangle, Paris, Grasset.
- Obey, André (1929). « Organisation », Le Monde musical, vol. 40, no 2, 28 février, p. 47.
- Obey, André (1941). « La tragédie du 800 mètres », Comoedia, Paris, 28 juin, p. 1-2 ; republié le 5 juillet ; dans Recueil, p. 4-5 et 18-20.
- Obey, André (2012). Jeux olympiques : Paris 1924, Londres 1948, 2 vol., Paris, Fluo.
- Obey, André (2012) [1964]. « À propos du Huit cents mètres », dans André Obey, Jeux olympiques : Paris 1924, Londres 1948, Paris, Fluo, vol. [2], p. 175-179.
- Pioch, Georges (1941). « Stade Roland-Garros : Les Suppliantes ; 800 mètres », L’Oeuvre, Paris, 12 juillet ; dans Recueil, p. 26.
- Prêtet, Bernard (2016). Sports et sportifs français sous Vichy, Paris, Nouveau Monde éditions.
- Purnal, Roland (1941). « Le spectacle du stade Roland-Garros : Les Suppliantes d’Eschyle et un drame d’André Obey », Comoedia, Paris, 12 juillet ; dans Recueil, p. 39.
- Rapport [1924]. Les Jeux de la viiie Olympiade, Paris 1924 : Rapport officiel, sous la dir. de A. Avé, Paris, Librairie de France. Produit par le Comité Olympique Français. Accessible en ligne via les collections numériques de la LA84 Foundation, https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/12645/rec/1, consulté le 16 mai 2020.
- Recueil. « Recueil. Les Suppliantes de Eschyle, 800 mètres de André Obey », Bibliothèque nationale de France, Arts du spectacle, 8-RSUPP-755, accessible sur Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105094945, consulté le 16 mai 2020.
- Schmitt, Florent (1925). Réponse à l’enquête « La musique et le sport », Le Guide du concert, vol. 11, no 18, 13 février, p. 524.
- Le sport et la musique (1970). France Culture, 18 juin. Émission radiophonique comprenant une entrevue d’André Obey.
- Stuart, Mary Lynn (2001). For Health and Beauty: Physical Culture for Frenchwomen, 1880s-1930s, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Terret, Thierry (dir.) (2008). Les Paris des Jeux olympiques de 1924, Biarritz, Atlantica, 4 volumes .
- Tétart, Philippe (dir.) (2007). Histoire du sport en France : Du Second Empire au régime de Vichy, Paris, Vuibert.
- Young, David C. (2004). A Brief History of the Olympic Games, Malden, Blackwell.
Liste des figures
Image 1
Annonce du spectacle au Stade Roland-Garros, Comoedia, 5 juillet 1941, p. 3
Image 2
Photographie du spectacle, Comoedia, 12 juillet 1941, p. 3.
Image 3
Charlemagne, « On répète les Suppliantes d’Eschyle au stade Roland-Garros », La Semaine à Paris, 3-8 juillet 1941, p. 6.
Liste des tableaux
Tableau 1
Les interventions musicales dans 800 mètres
Tableau 2
Correspondances entre les interventions musicales prescrites pas les didascalies de Tb (voir Tableau 1, col. B) et celles de l’enregistrement de 1964
Tableau comparatif des personnages

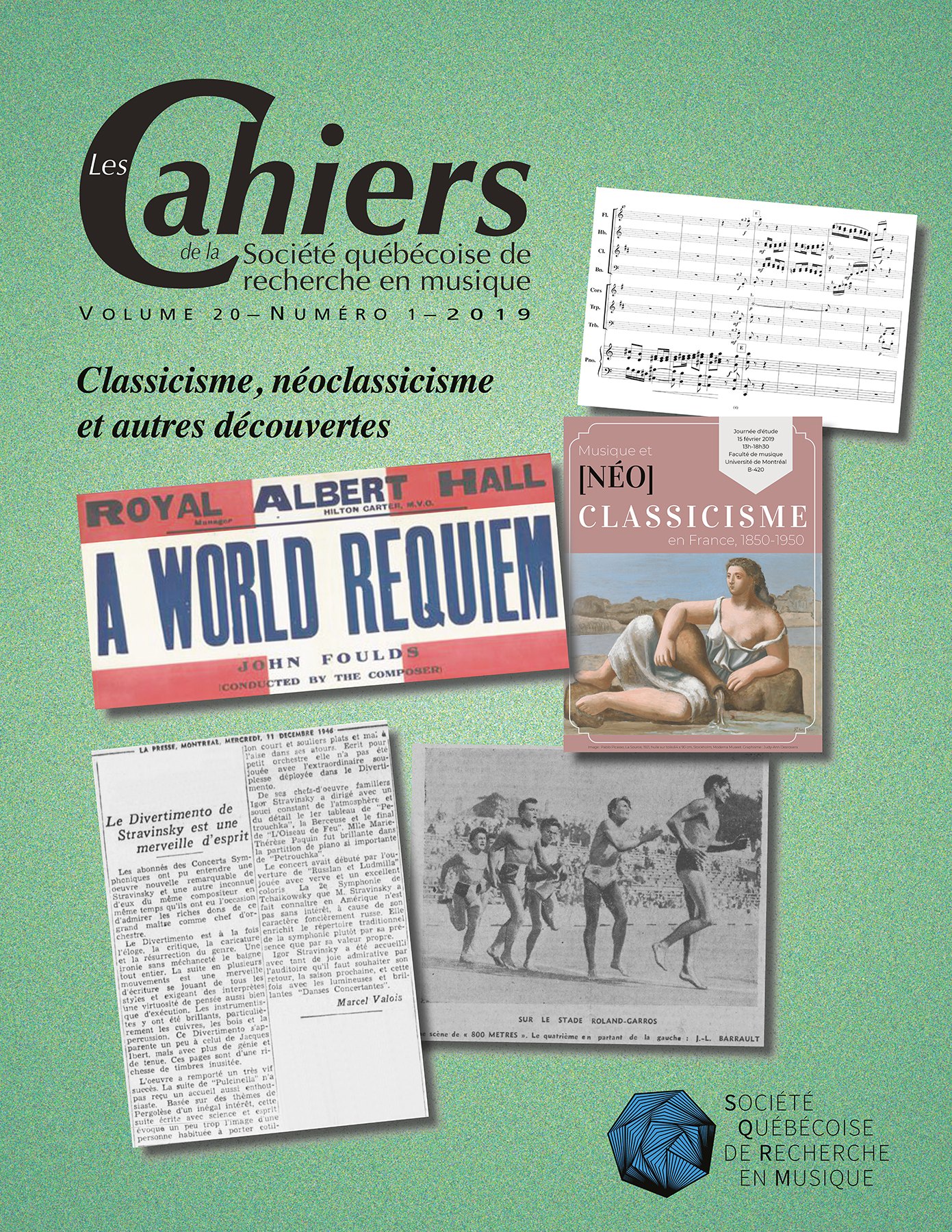






 10.7202/1043221ar
10.7202/1043221ar