Résumés
Résumé
Cet article présente les épreuves sociales vécues par dix jeunes adultes en situation de pauvreté et de raccrochage scolaire. L’analyse des rapports sociaux constitutifs de leur histoire de vie a permis de formaliser une compréhension du processus de construction identitaire de chacune et de chacun de ces jeunes adultes. Pour plusieurs, l’expérience du raccrochage scolaire apparaît comme une voie pour réussir une période de moratoire et s’émanciper de rapports sociaux qui ont inhibé la construction de leur identité. Cet article permettra aussi d’identifier les contraintes persistantes à l’émancipation à un moment où ils cherchent à entrer positivement dans l’âge adulte alors qu’ils vivent en situation de pauvreté.
Mots-clés :
- pauvreté,
- construction identitaire,
- raccrochage scolaire,
- épreuves sociales,
- approche biographique
Abstract
This article presents the social challenges experienced by 10 young adults in a situation of poverty while going back to school. The analysis of each young adult’s life stories made it possible to formalize an understanding of their identity-building process by analyzing all the social relationships that constitute their life history The experience of school reentry appears, for many, as a way to fight against poverty and emancipate themselves from social relations that have inhibited the construction of their identity. This article will also identify the persistent constraints to emancipation at a time when they are seeking to enter adulthood positively while living in poverty.
Keywords:
- poverty,
- identity construction,
- school reentry,
- social challenges,
- biographical approach
Corps de l’article
Introduction
Les causes du décrochage scolaire sont multidimensionnelles et inscrites à des niveaux micro, méso et macrosociaux (Mercier, 1995; Desmarais, 2012). Plus précisément, le risque de décrocher de l’école varie en fonction des positions sociales occupées, et non « des vicissitudes ou des tares de personnalité des personnes qui vivent ces situations » (Carrette et Vaillancourt, 2000, p. 3). Les statistiques en témoignent. Au Québec, en 2011-2012, le taux de sortie sans diplôme ni qualification pour les jeunes filles était de 12,9 % alors qu’il était de 19,8 % pour les jeunes garçons (Bulletin statistique de l’éducation, 2015). Pour cette même année, les personnes qui proviennent d’un milieu défavorisé[1], qui sont issues de l’immigration (première génération[2]), qui ont un handicap, des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage[3] et/ou qui ont un retard scolaire[4] sont surreprésentées parmi les jeunes qui ont décroché en 4e et 5e secondaire garçons (Bulletin statistique de l’éducation, 2015). Le risque de décrocher augmente d’autant plus quand des jeunes occupent simultanément plusieurs positions sociales. Parmi l’ensemble des déterminants du décrochage scolaire, la situation de pauvreté est un facteur majeur, comme le démontre l’indice du milieu socio-économique (IMSE)[5]. Au Québec, en 2015-2016, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) ou d’une qualification après cinq ans dans le réseau public est de 70 % en milieu favorisé (rang IMSE 1, 2, 3) et de 52,7 % en milieu défavorisé (rang IMSE 8, 9, 10) (Homsy et Savard, 2018). À titre de comparaison, pour la même cohorte (2015-2016), 87,6% des jeunes qui fréquentent l’école secondaire privée obtiennent un diplôme ou une qualification après cinq ans (Homsy et Savard, 2018).
Depuis 20 ans[6], les jeunes adultes qui ont décroché avant l’obtention d’un DES raccrochent massivement à la Formation générale des adultes (FGA)[7]. En 2010, 44,4 % des élèves inscrits au second cycle du secondaire en formation générale des adultes dans les quelque 200 Centres d’éducation des adultes (CEA) du Québec étaient âgés de 16 à 19 ans, comparativement à 31,5 % en 2001 (Doray et Bélanger, 2014). Or, beaucoup de jeunes qui raccrochent à la FGA redécrochent avant d’avoir obtenu leur DES. En 2006[8], Langevin, Cartier et Robert faisaient état d’une recherche menée en FGA dont les résultats indiquaient que 50 % des jeunes de 16-19 ans y étant inscrits ne persévéraient pas jusqu’au diplôme. Or, bien que l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ne protège pas nécessairement contre la pauvreté[9], l’éducation demeure un important levier de lutte à cette dernière.
Paradoxalement, très peu de recherches prennent pour objet la situation spécifique des jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire. Les recherches effectuées au Québec dans les dernières années ont porté sur leurs difficultés pédagogiques (Rousseau et collab., 2010), leurs difficultés psychosociales (Marcotte, Cloutier et Fortin, 2010) et sur les défis inhérents aux trajectoires d’immigration (Potvin et Leclercq, 2010). Cet article adopte un angle peu visité. À l’aide de données provenant d’entretiens biographiques menés avec dix jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire (à la Formation générale des adultes), il pose la focale sur leurs processus de construction identitaire. Au regard de leur histoire de vie, il s’agit de mettre au jour un ensemble d’épreuves — liées à la famille, à l’école et à l’emploi — auxquelles ont fait face, les jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire. Dans cet ensemble d’épreuves, nous verrons que la pauvreté traverse l’ensemble des rapports sociaux et marque de manière significative les expériences à travers lesquelles les jeunes ont construit leur identité dans le temps.
Je présenterai d’abord le cadre théorique adopté dans cette recherche. Puis j’exposerai les outils méthodologiques utilisés pour interpréter les récits de vie recueillis chez les jeunes. Enfin, je présenterai les données biographiques pour l’ensemble de leurs récits, et ce, en mettant de l’avant celui de Jessy. Chaque section présente chronologiquement les rapports sociaux constitutifs de la construction identitaire des jeunes adultes à différentes étapes de vie : l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Mes pistes interprétatives transversales succèdent à la présentation des données.
Épreuve sociale et moratoire : des concepts pour penser la construction identitaire
Dans le cadre de cette recherche[10], j’appréhende la construction identitaire des jeunes adultes avec une approche clinique en sciences humaines (Sévigny, 1993), plus spécifiquement à l’aide des concepts d’épreuve (Martuccelli, 2010) et de moratoire (Erikson, 1972). L’approche clinique, compréhensive (Hanique, 2007) et globale (Desmarais, 2012), consiste à poser un regard interdisciplinaire sur les problèmes sociaux à partir de cas individuels, et ce, dans une perspective de recherche de solutions (Sévigny, 1993). En d’autres mots, pour comprendre l’individu, il faut étudier son histoire personnelle à l’intersection de l’histoire sociale et des rapports sociaux qui le constituent (Sève, 2008). Le développement émancipateur de l’individu est conditionnel à ces rapports sociaux puisqu’il en découle des activités favorisant l’acquisition de capacités. À l’opposé, l’aliénation est une dépossession des possibilités de développement dans la personnalité (Sève, 2012).
Les jeunes rencontrés dans cette recherche ont vécu des épreuves liées à un ensemble de rapports sociaux. Pour Martucelli (2010), c’est dans « l’ensemble des épreuves sociales » que l’individu se singularise, se révèle. Le concept d’épreuves sociales permet de comprendre les figures d’individualité ainsi que les mécanismes d’exclusion sociale puisque, face à l’épreuve, l’individu, avec les ressources dont il dispose, ne peut que réussir ou échouer. La construction de l’identité dépend en ce sens des positions sociales objectives que l’individu occupe tout au long de la vie (Sève, 2008). Dans la foulée, pour Châtel et Soulet (2003), la vulnérabilité est certes vécue à l’échelle de l’individu singulier dans ses caractéristiques personnelles. Néanmoins, l’agir en situation de vulnérabilité se déroule toujours dans un cadre d’action, lui-même lié à la « position des individus dans la structure sociale » (Châtel et Soulet, 2003 p. 173); à une situation de pauvreté, dans le cas des jeunes de cette recherche. Toutefois, l’individu ne peut se réduire à sa position dans un ensemble de rapports sociaux; il est actif dans la construction de son identité. C’est aussi un être de désirs et de projets (de Gaulejac, 2009) qui travaille à s’affranchir de sa position sociale et de son histoire personnelle.
Les personnes qui ont participé à cette recherche ont vécu des épreuves lors de trois périodes fondatrices de leur processus de construction identitaire : l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Lors de la période de l’enfance, le rôle de la famille dans le processus de construction identitaire est très significatif. Cette dernière peut faciliter ou nuire à l’acquisition du sentiment de confiance de base qui permet à l’enfant « de se fier à la foi des autres et d’avoir le sentiment fondamental d’être soi-même digne de la confiance des autres » (Erikson, 1972, p. 179). Dans la théorie d’Erikson, l’enjeu du stade de l’adolescence est de stabiliser l’identité autour de nouveaux repères au terme d’un « moratoire », une période où la personne suspend les décisions sur son avenir et expérimente différents rôles. Le moratoire est à Erikson (1972) ce que l’épreuve est à Martucelli (2006) : on peut le réussir ou l’échouer. S’il réussit son moratoire, le jeune adulte en ressort doté de l’assurance renouvelée de ses désirs et des talents qui sont reconnus par la communauté (Erikson, 1972). À l’opposé, le moratoire échoue si à son terme la personne intègre trop rapidement une place sociale qui ne lui convient pas ou qui lui a été assignée trop tôt ou avec autorité. Les jeunes qui ne réussissent pas à s’intégrer à l’intérieur des places sociales existantes sont susceptibles d’adopter une identité négative; un recours pour les jeunes qui, à l’adolescence, souffrent d’une confusion d’identité (Erikson, 1972). Ces jeunes n’ont pas réussi, à la suite à l’obtention de la reconnaissance des autres, à se percevoir positivement comme sujet de désir et d’actions. L’identité négative apparaît comme une manière inconsciente de résister contre l’ordre social ayant participé de leur désordre individuel. Plusieurs de ces jeunes adhèrent à une culture anti-école. Willis (2011) a identifié que la culture anti-école est apprise chez les jeunes en milieux défavorisés et qu’elle leur permet de se définir en opposition à l’institution scolaire.
L’approche biographique : un outil méthodologique au service de la construction identitaire
La construction identitaire ne peut se comprendre autrement que dans la temporalité (Ricoeur, 1990). J’ai adopté l’approche biographique pour comprendre la spécificité des histoires de vie des personnes en situation de pauvreté. Cette approche est contributive lorsqu’elle révèle la singularité des cas en profondeur sans toutefois perdre de vue une analyse des niveaux de réalités sociales qui transcendent et déterminent les singularités. Elle met ainsi le sujet en rapport dialectique avec le collectif auquel il appartient (Desmarais, 2016). Pour bien les comprendre, j’ai choisi d’entrer en relation avec les participantes et participants à cette recherche. J’ai consacré 170 heures de présence sur le terrain durant une année et j’ai rencontré chaque jeune durant l’équivalent de deux journées où nous menions des activités d’observation participante[11], un entretien biographique et deux séances de restitution. Pour bien saisir le sens de leurs propos, j’ai invité les jeunes à réagir aux reconstructions thématiques que j’ai faites des transcriptions de leurs récits de vie, dans une perspective de co-construction de sens. Le matériau analysé dans cet article est constitué des dix entretiens biographiques d’une durée d’une heure et demie à deux heures.
L’entretien biographique vise à dégager une compréhension de l’articulation des différents domaines d’existence de la vie des gens, et ce, dans la durée (Bertaux, 2010). Pour éviter le piège d’une recherche d’exhaustivité, j’ai choisi d’articuler le vécu de la pauvreté avec une série de rapports sociaux : le rapport à la famille, à l’école, à l’emploi, aux pairs, au quartier[12]. J’ai analysé les données avec une approche abductive[13] en trois phases. La première phase consistait à associer un énoncé interprétatif faiblement abstrait à des extraits de verbatim (Strauss et Corbin, 1990). Dans la deuxième phase j’ai regroupé les énoncés interprétatifs (associés à leurs extraits de verbatim) qui étaient similaires en matière de sens et différents dans la forme sous les catégories inspirées de mon cadre théorique (les rapports sociaux énumérés ci-haut). Ainsi, chaque récit a été écrit selon une logique diachronique[14] et synchronique[15] dans l’esprit de rendre l’expérience de vie des participants et participantes de manière phénoménologique (Paillé et Mucchielli, 2010). Bien que cette étape franchie soit heuristiquement riche en soi (on le verra à la lecture du récit de Jessy), elle ne permet pas de théoriser l’objet. Dans une troisième phase, chaque récit phénoménologique (comme celui de Jessy) a fait l’objet d’un travail d’interprétation. Pour ce faire, j’ai emprunté à Paillé et Mucchielli (2016) la méthode de l’analyse par catégories conceptualisantes, ce qui a permis de cerner des concepts qui éclairent l’expérience de la pauvreté dans le processus de construction identitaire.
Pauvreté et raccrochage scolaire : profils sociodémographiques
Le recueil et l’analyse de données sociodémographiques sont indispensables pour comprendre les récits biographiques (Desmarais, 2018). Cette section offre une présentation des ressources dont dispose l’ensemble des participantes et participants à la recherche, puis celles dont dispose Jessy. Les personnes ayant participé sont un groupe de sept hommes et de trois femmes. La moyenne d’âge des jeunes adultes est de 23 ans. Toutes les personnes sont nées au Québec à l’exception de deux adultes.
Parcours scolaire de l’école primaire au Centre d’éducation des adultes
Une seule personne faisait partie d’une classe d’adaptation scolaire au primaire alors que quatre autres en ont fait partie au secondaire. Une seule personne a doublé une année scolaire au primaire alors que sept personnes ont doublé au moins une matière ou une année au secondaire. Les jeunes ont décroché de l’école en moyenne à 15 ans et demi. Le portrait du niveau d’avancement des jeunes adultes au CEA est très diversifié. Trois personnes ont presque complété tous les cours préalables à l’obtention d’un Diplôme d’études secondaires (DES) ou les cours préalables à l’inscription pour l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP). Trois autres sont inscrites au premier cycle du secondaire. Les quatre dernières progressent dans leurs matières de base en 3e, 4e et 5e secondaire. Quatre jeunes adultes en sont à leur 1re tentative de raccrochage et quatre en sont à leur 2e tentative. Une personne en est à sa 3e expérience et une dernière personne en est à sa 7e expérience de raccrochage scolaire.
Vie familiale
Les parents des dix jeunes adultes sont divorcés. Quatre jeunes adultes ont séjourné dans des foyers d’hébergement, des familles d’accueil ou des Centres pour jeunes contrevenants en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants. Les familles de six jeunes adultes ont fait l’objet d’interventions de la part de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Les jeunes ne connaissent pas tous les salaires ou les parcours de formation de leurs parents. Deux des pères ont un DEC; un père détient un DEP et un autre détient un DES. Deux pères n’ont « aucune scolarité », un autre a terminé sa 2e secondaire et un dernier a terminé sa 4e secondaire. Trois mères ont un DEC et une mère détient un DEP. Une mère n’a « aucune scolarité », une autre a complété sa 2e secondaire. Les deux dernières ont complété une 4e secondaire. Les pères de quatre des jeunes adultes sont prestataires d’aide sociale (un d’entre eux a une contrainte à l’emploi). Un autre est en situation d’itinérance. Ceux qui ont un emploi ont des revenus de 40 000 $, de 47 000 $ et de 60 000 $ par année. Un autre est décédé. Cinq des dix mères des jeunes adultes sont prestataires d’aide sociale (une d’entre elles a une contrainte à l’emploi). Les mères de deux personnes ont un emploi et gagnent un salaire de 30 000 $ et de 35 000 $ par année. Deux jeunes ne détenaient pas cette information concernant leur mère. Dans la situation actuelle, quatre personnes habitent toujours chez leurs parents ou grands-parents, quatre autres habitent en couple ou en colocation. Une personne habite seule et une autre habite avec son fils.
Revenus des personnes participantes
Parmi les participantes et participants à cette recherche, huit personnes sont parvenues à obtenir un financement d’Emploi-Québec[16]. Une autre n’a pas réussi à convaincre son agent d’Emploi-Québec qu’elle était qualifiée pour ce programme. Une dernière a choisi de se contenter des revenus plus faibles du programme d’aide sociale de base puisque celui-ci ne contraint pas les bénéficiaires à choisir une formation et un rythme de réussite. Les deux personnes qui sont prestataires de l’aide sociale[17] vivent largement sous le seuil de faible revenu. Leurs prestations mensuelles sont de 636 $ et de 563 $ par mois. Les huit personnes qui bénéficient du programme de formation de la main-d’oeuvre d’Emploi-Québec reçoivent des prestations variant entre 230 $ et 1100 $, ce qui leur procure en moyenne un revenu annuel de 9100 $[18]. Elles vivent considérablement sous le seuil de faibles revenus bien qu’elles aient « réussi » à obtenir une aide financière bonifiée par le programme de formation de la main-d’oeuvre.
Se construire en situation de pauvreté : les épreuves de la famille, de l’école et de l’emploi
L’analyse des histoires de vie des jeunes adultes a permis d’identifier un ensemble d’épreuves sociales vécues par le groupe à différents âges de la vie. Durant l’enfance, ces épreuves sont liées à la pauvreté et aux rapports familiaux, aux pairs, au quartier. À l’adolescence, ces personnes vivent des épreuves dans des emplois aliénants où elles peinent à expérimenter une période de moratoire participant du développement d’une identité positive. À l’entrée dans l’âge adulte, elles bénéficient d’un financement qui leur permet de stabiliser leur situation, mais qui les maintient en situation de pauvreté. À travers cet ensemble d’épreuves, elles cherchent à se stabiliser et à se construire en cohérence avec leurs désirs. L’expérience de la pauvreté traverse l’ensemble de ces rapports sociaux et marque les expériences à travers lesquelles les personnes se construisent dans le temps.
Des besoins relationnels non répondus durant l’enfance
Les participantes et participants à cette recherche ont vécu des épreuves en rapport avec leur famille, l’école et leur quartier lors de la période de l’enfance. Les rapports familiaux ont marqué Jessy dans son processus de construction identitaire. Il a grandi en banlieue de Montréal jusqu’à l’âge de quatre ans. Ses parents composaient alors avec des problèmes de consommation et déménageaient fréquemment, n’étant pas en mesure de payer leur loyer. En raison notamment de problèmes de consommation, les parents de Jessy se sont séparés lorsque ce dernier avait huit ans. Il avait dix ans quand son père a connu d’importants problèmes de consommation de crack. Il a habité avec lui dans un appartement insalubre qui était sur le point de s’effondrer : « Je ne mangeais pas les trois quarts du temps. »
Durant cette année, Jessy considère qu’il a manqué de supervision et qu’il a commencé en conséquence « à consommer un peu de marijuana, un peu de méthamphétamine, un peu de toute… ».
La mère de Jessy l’a repris, puis pendant une période qui a duré dix ans, les deux sont passés d’un appartement à l’autre. La mère avait subi les avances d’un propriétaire, était expulsée pour non-paiement ou était victime de violence conjugale de la part d’un chum. Néanmoins, Jessy appréciait le rôle de pourvoyeur qu’a joué l’un des chums de sa mère : « On n’a jamais manqué de manger avec ce gars-là! »
Jessy précise qu’il n’a jamais eu de problème à l’école. « Tout ce qu’il y avait, selon son dire, c’était une question familiale » qui a impliqué la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à quelques reprises. À la suite de plusieurs situations où la police dut intervenir pour mettre fin à des gestes de violence conjugale et familiale, Jessy et sa mère se sont vu assigner une travailleuse sociale : « Parce que moi et ma mère, comme on n’avait pas d’argent, on s’est souvent chicanés. Ma mère… c’est quand même quelqu’un de violent. »
Au primaire, Jessy s’est fait imposer des cours de guitare à chaque récréation durant une année complète afin de l’empêcher d’intimider les autres : « Sûrement que je n’étais pas ben smatte avec le monde. »
La DPJ est intervenue dans la famille quand Jessy a arrêté de fréquenter l’école et que sa mère et lui étaient devenus itinérants.
À l’instar de Jessy, presque tous les personnes participantes mentionnent qu’ils ne pouvaient avoir l’assurance que leurs parents pouvaient répondre à leurs besoins et bien prendre soin d’eux. Certains ont assigné à d’autres personnes (voisin, père d’un ami, grands-parents, etc.) la figure du parent, car à leurs yeux, leurs propres parents n’étaient pas dignes de confiance, leur engagement étant soit excessivement laxiste vu leurs problèmes de consommation ou de santé mentale, soit violent. Les parents de deux personnes étaient littéralement menaçants. Elles travaillent encore à se libérer des situations de violences familiales qu’elles ont subies et qu’elles revivent en pensée quotidiennement. Plusieurs jeunes adultes ont senti qu’ils n’étaient pas désirés par au moins un parent. Toutes les participantes et tous les participants proviennent d’une famille dont les parents se sont séparés lorsqu’ils étaient enfants. Ce sont surtout les mères (de 6 participantes et participants) ou les grands-mères (de 3 participantes et participants) qui les ont pris en charge à la suite de la rupture. Une personne a été prise en charge par sa tante. Les pères de cinq des personnes ont délaissé leur responsabilité dès la naissance de leur enfant ou après le divorce. Seulement quatre personnes ont toujours un lien avec leur père. Par ailleurs, lorsqu’elle était adolescente, une personne a rompu la relation avec son père, car ce dernier était très violent. Pour tous les jeunes sauf un, les épreuves scolaires coïncident notamment avec des épreuves familiales. Trois personnes dont les parents consomment ont commencé à prendre de la drogue dès l’adolescence. La DPJ est intervenue auprès de cinq des familles.
Pour les jeunes, le rapport aux pairs est influencé par les quartiers dans lesquels ils ont grandi. Jessy se souvient d’avoir été très « nomade » et donc plutôt seul durant le secondaire. Le cannabis était son seul « vrai ami ». Dès l’âge de 8 ans, il s’était fait une réputation, car il était le plus jeune du quartier à en fumer. Il faisait des crises quand il en manquait et cela l’amenait à s’endetter. Ses pourvoyeurs de cannabis ont abusé de sa vulnérabilité et l’ont violenté. Jessy a compris qu’il avait intérêt à se joindre à des personnes qui pourraient le protéger[19]. « Tu sais, quand t’es le petit Jessy avec sa mère qui est sur l’aide sociale…, ils n’hésitent pas à venir te taxer chez vous. »
En échange de la protection reçue, Jessy devait vendre de la drogue et intimider (taxer) d’autres jeunes à son tour. La description que deux jeunes font du quartier où ils ont grandi s’apparente à la description que quatre autres ont faite des rapports entre pairs à l’école primaire et secondaire : un espace inégalitaire où les plus puissants dominent les plus vulnérables. Les participantes et participants ont en commun d’avoir vécu de l’intimidation à l’école ou dans le quartier et d’avoir posé des gestes pour se protéger. Protéger leur intégrité signifiait de se joindre à une bande afin de se rendre moins vulnérables aux agressions.
À l’adolescence : un moratoire spécifique en situation de pauvreté
À l’adolescence, après avoir quitté l’école, les jeunes ont exercé des emplois qui les ont empêchés de se construire positivement. Jessy s’est trouvé un emploi d’opérateur dans une buanderie où les conditions étaient à son dire « épouvantables ». Il a quitté cet emploi pour travailler dans un restaurant où il pouvait manger gratuitement un repas par jour. Après d’importants conflits avec les patrons qu’il percevait comme des exploiteurs, Jessy a décidé qu’un retour à l’école serait plus prometteur : « Moi je me dis, les cuisines là, pour ce que t’es payé… ils peuvent bien se le mettre où je pense. »
Les employeurs de Jessy ne lui permettaient pas de faire plus de 25 heures par semaine[20]. Pour empocher un salaire qui équivaut à une semaine pleine de travail, Jessy a décidé de continuer de recevoir ses prestations d’aide sociale en même temps qu’il travaillait. Il réalise qu’il a dû mettre « du temps en maudit » avant de se stabiliser, condition préalable à un retour à l’école selon lui.
Jessy rappelle plusieurs fois dans son récit qu’il n’a jamais eu de problèmes à l’école et qu’il a décroché, car il avait des problèmes familiaux et des problèmes d’argent. Il pense qu’il n’aurait jamais quitté l’école à 15 ans s’il avait été financé plus rapidement durant son parcours scolaire afin de contribuer à payer le loyer. Après avoir habité chez l’un de ses oncles qui vendait de la drogue et où il y avait « tellement de punaises dans son bloc, qu’ils l’ont démoli », Jessy et sa mère ont été dépossédés de leurs biens puis hébergés durant trois mois par un organisme communautaire du centre-ville. La directrice de l’organisme les a accompagnés dans la recherche d’un HLM duquel ils se sont fait évincer faute de n’avoir pu payer le loyer durant un an. Jessy a réussi à obtenir de l’aide sociale et s’est inscrit dans un Centre d’éducation des adultes deux ans après avoir quitté l’école secondaire. Parallèlement, sa mère a été référée à un service communautaire qui s’adresse à des femmes qui ont une expérience de travail du sexe. Elle a bénéficié d’un fonds qui lui a permis d’éliminer la majeure partie de la dette qui la pénalisait depuis des années pour avoir fraudé l’aide sociale[21] : « Alléluia qu’on a recommencé à vivre! »
Jessy a dû interrompre l’école après que sa mère et lui se soient fait expulser de deux appartements où il y avait des « coquerelles grosses comme des chats ».
Parmi les participantes et participants, une seule personne a vécu positivement une expérience en emploi, parmi plusieurs expériences négatives. Les expériences négatives en emploi ont accentué chez les jeunes des sentiments d’infériorité. Étant donné les expériences d’intimidation ou d’échecs scolaires qu’ils y ont vécues, cinq jeunes adultes ont quitté l’école secondaire pour améliorer leur bien-être. Ces jeunes cherchaient à fuir les sentiments de honte, de méfiance et d’infériorisation que l’école avait provoqués. Une personne se sentait étrangère à l’école et aux classes spéciales qu’elle a dû intégrer : « L’école, c’est pas ma place. […] Moi, j’ai fait les classes spéciales. Là par où chie l’école. Toute la marde sort par là. »
C’est dans le milieu de l’emploi que les jeunes espéraient retrouver un sentiment de confiance et une place où leurs talents seraient reconnus (Erikson, 1972). Or, tous les jeunes, sauf une personne qui n’a jamais travaillé, ont vécu des sentiments d’aliénation en emploi entre le moment où ils ont décroché et la situation actuelle. Ces sentiments d’aliénation prenaient différentes formes. Une personne évoque la noirceur qui caractérisait ses pensées au moment où elle travaillait à l’usine. Elle compare ses anciens emplois à « des prisons ». Les jeunes adultes ont décrit des emplois où les tâches sont répétitives et éprouvantes pour le corps. Une personne travaillait illégalement dans le milieu de la construction et n’a pas bénéficié d’indemnité pour un accident de travail lorsqu’elle s’est blessée grièvement sur un chantier. Une autre s’est blessée sur son lieu de travail et n’a pas pu réintégrer son emploi par la suite. Les activités en emplois de trois personnes ont provoqué ou exacerbé des sentiments de dépression. Une dernière personne a subi plusieurs violences en travaillant dans le milieu de la prostitution.
Pour les jeunes en situation de pauvreté, comme Jessy, on constate que l’urgence de pourvoir à leurs besoins matériels de base ne laisse ni temps ni espaces pour expérimenter différents rôles sociaux, tels que définis par Erikson (1972). Pour certaines et certains, d’importantes prises de conscience sont à la source de leur désir de retourner aux études, dans certains cas, après d’intenses expériences de détresse durant lesquelles le suicide a même été envisagé. Chaque jeune a expérimenté une transition, une période d’activités déterminées, entre autres, par leur situation de pauvreté (entre autres, emplois précaires, déménagements multiples, et travail du sexe dans des conditions très éprouvantes). Les jeunes ont en commun d’avoir réfléchi durant cette période à une nouvelle figure d’individualité à laquelle ils s’identifient et dont l’atteinte passe par l’école.
Raccrocher à l’âge adulte : renoncer à un désir de formation contre une stabilité financière
En général, les personnes qui « réussissent » à obtenir un financement d’Emploi-Québec disent que cette aide est déterminante pour leur réussite. Par contre, elles sont forcées de renoncer à l’acquisition d’une formation générale en échange d’un financement qui leur permet de se stabiliser. De plus, le régime pédagogique de la formation générale des adultes leur pose des défis d’apprentissage importants. Les participantes et participants à cette recherche sont ambivalents quant aux retombées des programmes d’assistance sociale dont elles bénéficient. Jessy considère que les démarches pour obtenir le financement d’Emploi-Québec sont très dissuasives. Il déplore que les jeunes ne puissent avoir accès à du financement dès l’âge de 16 ans, au moment où ils décrochent. Il observe que cette mesure encourage les jeunes comme lui à décrocher pendant deux ans[22]. Il préfèrerait qu’Emploi-Québec finance une plus grande gamme de métiers ou qu’il accepte de financer l’obtention du DES : « Ils te payent pour finir une formation qu’eux autres ont choisie pour toi. »
Certains participants et certaines participantes disent que leurs démarches pour obtenir du financement furent assez éprouvantes. Ces personnes ont dû faire la preuve qu’elles méritent un financement d’Emploi-Québec. Pour ce faire, elles disent avoir dû démontrer qu’elles avaient un projet qualifiant conforme à leur personnalité et aux attentes du marché de l’emploi, qu’elles étaient « motivées », et surtout qu’elles étaient assez pauvres pour en avoir besoin. Or, la pauvreté s’accompagne d’un stigmate et les jeunes cherchent au quotidien à éviter de montrer qu’ils sont pauvres. En ce sens, les démarches d’Emploi-Québec obligent un renversement de cette dissimulation quotidienne du stigmate. Puisque du point de vue des jeunes, très peu de personnes « réussissent » à obtenir un plein financement, qui leur permet à peine de survivre, celles et ceux qui l’obtiennent se considèrent comme privilégiés et cherchent à combler les rythmes de progression imposés, même s’ils ne sont pas réalistes. En acceptant ce financement indispensable à leur survie, ces personnes doivent renoncer à leur propre rythme d’avancement et à certaines options de formation, notamment une formation générale de base par l’obtention d’un DES. La finalité du financement d’Emploi-Québec n’est pas la formation générale, mais bien l’insertion professionnelle. La plupart des jeunes disent qu’ils auraient aimé pouvoir choisir leur parcours de formation plutôt que de s’en faire assigner un.
En raccrochant, les jeunes cherchent à s’affranchir des emplois aliénants desquels ils dépendaient. Or, certains jeunes adultes réalisent que les conditions qui les lient à Emploi-Québec perpétuent une relation de dépendance. Une fois de plus, ces personnes sont forcées de choisir l’option la moins pire à l’intérieur d’un spectre de choix étroit et contraignant. Matériellement vulnérables, elles acceptent de s’inscrire dans une formation qui répond à un besoin du marché plutôt qu’à leur désir et renoncent au temps nécessaire pour réfléchir à leur besoin de formation. Ceux qui apprécient le plus le programme de retour en formation sont ceux qui, comme trois personnes ayant participé à cette recherche, avaient des intérêts professionnels convergents (donc finançables) avec les besoins du marché de l’emploi. Étant donné leur position sociale, les personnes ont vécu de grandes périodes d’instabilité. Au moment où je les rencontre, le fait de raccrocher à l’école et d’obtenir un financement participe d’une stabilisation de leur cadre d’action. Jessy juge que sa situation actuelle est favorable comparativement à ce que sa mère et lui ont vécu dans le passé. Jessy espérait terminer sa 4e secondaire quelques mois après notre rencontre. Son plan de formation d’Emploi-Québec prévoit qu’il obtienne ses préalables pour intégrer un DEP. Ultimement, son objectif est d’avoir des « emplois valorisants ». À titre d’exemple, il se projette dans l’avenir : « Peut-être avec un enfant, une femme, un petit 4 et demi, un golden retriever. […]. Euh… puis plein de bouffe dans le frigo. Avec plein de steak. Oh! Yeahman, ça serait fort! »
La formation scolaire apparaît pour certaines et certains comme une voie privilégiée d’émancipation. Pour d’autres, elle représente plutôt la suite d’une série d’aliénations. Pour une personne, l’enseignement individualisé qui domine à l’éducation des adultes revêt un caractère aliénant. Elle exprime ironiquement que cette pédagogie est cohérente avec ce qui lui apparaît comme un destin inhérent à sa position sociale : assumer des tâches répétitives. De même, une autre personne a le sentiment de se préparer à son futur métier d’ouvrier qui, elle l’anticipe, sera fait de tâches répétitives. Ce constat la frustre, car elle dit être retournée en formation pour se procurer un emploi où elle peut déployer sa créativité. Elle semble toutefois douter que sa formation actuelle ou les conjonctures futures la mènent à cet idéal.
À l’opposé, pour certaines personnes, le travail intellectuel est émancipateur et leur permet de dynamiser positivement leurs pensées. L’une d’elles se dit très étonnée d’éprouver autant de plaisir à apprendre les mathématiques et les sciences. Certaines réalisent qu’elles ont renversé leur rapport à l’école. Le fait d’intégrer une école différente les aide à opérer ce renversement. Toutes parlent du CEA comme d’un endroit où elles se sentent en sécurité et où les gens sont respectueux des différences, contrairement à l’école secondaire qu’elles ont fréquentée. Dans le passé, la culture anti-école à laquelle elles adhéraient leur était « utile ». Elles pouvaient faire partie d’une bande et lutter contre les sentiments d’humiliation et de honte qu’avait générés l’école. Toutefois, cette « culture » avait par ailleurs un coût psychique important. Une personne prend certainement conscience que l’apprentissage a un caractère thérapeutique. Elle l’ignorait, mais d’en être privée dans son emploi antérieur la faisait souffrir. Le fait d’apprendre des contenus lui fait du bien, en contraste avec la morosité qu’elle a ressentie dans les huit années passées à travailler à l’usine et à consommer. Le renversement de la culture anti-école autorise les jeunes à s’identifier au personnel de l’école, à leur intervenant psychosocial et aux enseignantes et enseignants.
Le raccrochage scolaire : une voie d’émancipation potentielle
L’analyse des données a permis de tracer les contours du processus de construction identitaire de jeunes adultes en situation de pauvreté et de raccrochage scolaire. Leurs propos indiquent qu’ils cherchent à se libérer des rapports sociaux (famille, école, quartier, emploi) qui les ont contraints dans le développement de leur personnalité. Le raccrochage scolaire constitue pour eux une voie d’émancipation potentielle même s’ils doutent des débouchés offerts par la formation. Sur le plan identitaire, certains ont vécu un moratoire duquel ils sont sortis avec une meilleure connaissance d’eux-mêmes. Rappelons que pour Erikson (1972, p.163-164), le moratoire se caractérise par « des marges d’options diverses ». La condition la plus favorable pour réussir le moratoire est « de prendre le temps d’expérimenter librement différents rôles ». Or, étant donnée leur position sociale, le spectre des options et des rôles à la disposition des jeunes était très étroit.
La plupart des jeunes se sont construits dans ce que Châtel et Soulet (2003) définit comme des « cadres du déficit » où les personnes souffrent d’instabilité, d’incertitude et d’imprévisibilité. Cette définition est à l’image de la succession de ruptures et de transitions qui se sont imposées à Jessy durant son parcours. Au moment où je les rencontre, les jeunes tentent une 1re, une 2e, et jusqu’à une 7e tentative de raccrochage scolaire. Cette fois, ils estiment « fiable » le nouveau cadre d’action dans lequel ils vivent. Selon leurs propos, ces personnes aspirent à un « cadre de la normalité[23] » où la part d’imprévisibilité de leur situation est contrebalancée par une part de contrôle et de prévisibilité sur le plan relationnel, normatif et matériel. Sur le plan relationnel, elles disent travailler à stabiliser leur réseau. Sur le plan matériel, certaines ont dû consentir à une baisse importante de revenus en retournant aux études. D’autres gagnaient des revenus très variables, car leur employeur ne pouvait leur garantir un nombre fixe d’heures de travail. Or, les revenus que procure Emploi-Québec sont faibles certes, mais stables. De plus, la stabilité résidentielle (très significative pour trois personnes qui ont déménagé chaque année depuis l’enfance) leur donne le sentiment d’être plus autonomes dans leurs efforts. Elles vivent toutes en situation de pauvreté. Néanmoins, elles se considèrent en position d’autonomie lorsqu’elles comparent leur situation actuelle à l’instabilité passée.
Étant donné le volume d’épreuves constitutives de leur histoire de vie, le contexte du raccrochage scolaire (la pédagogie et les modalités de financement) apparaît comme une épreuve supplémentaire dans leurs parcours; à une épreuve que certaines craignent d’échouer (à nouveau) vu les ressources dont elles disposent.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Ils représentent le tiers des jeunes ayant décroché, mais forment seulement 21,8 % des personnes inscrites.
-
[2]
Ils représentent 19,1 % des jeunes ayant décroché, mais forment seulement 9,3 % des personnes inscrites.
-
[3]
Ils représentent 40,1 % des jeunes ayant décroché, mais forment seulement 13,1 % des personnes inscrites.
-
[4]
Les élèves qui ont un retard scolaire (apprécié en fonction de l’adéquation entre l’âge et le niveau atteint) constituent 65,1 % des personnes ayant décroché alors qu’ils représentent seulement 20,7 % de personnes inscrites.
-
[5]
« L’indice du milieu socio-économique est un indice composé de la proportion de mères sans diplômes pour les deux tiers de son poids et de la proportion de parents inactifs pour une pondération d’un tiers » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011).
-
[6]
Au début des années 2000, la mission de l’éducation des adultes a changé progressivement. Dans la foulée de la lutte au décrochage scolaire, Doray et Bélanger (2014) constatent que les écoles pour adultes sont devenues des annexes de l’école secondaire : un foyer d’accueil pour jeunes en difficulté ou, du moins, éprouvant des difficultés au secteur des jeunes. Entre 2001 et 2010, l’effectif à l’éducation des adultes a augmenté de 48,6 % les 16-19 ans sont responsables de 32 % de cette augmentation.
-
[7]
La mission de la Formation générale des adultes est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de tous les adultes. Le régime pédagogique en vigueur est l’enseignement individualisé (MELS, 2012)
-
[8]
Il semble qu’il n’y ait pas de statistiques plus récentes. Le secteur de l’éducation des adultes ne fait pas l’objet d’attention de la part des chercheurs.
-
[9]
En 2012, au Québec, la moitié des personnes (en excluant les personnes étudiantes) qui gagnent un salaire minimum au Québec détiennent un Diplôme d’études secondaires (DES) (Institut de la Statistique du Québec, 2013). Or, le cumul d’un salaire minimum pour une charge de travail à temps plein (9,65 $ en 2011) ne permet pas de franchir les seuils de pauvreté, surtout dans les grandes villes (Yerochewski, 2014).
-
[10]
Cette recherche a été produite dans le cadre de ma thèse de doctorat en Sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal (obtenue à l’automne 2018 et dirigée par Jean-Baptiste Leclercq (UdeM) et Danielle Desmarais (UQAM).
-
[11]
J’ai pratiqué la méthode go-along qui consiste à accompagner les personnes dans différents espaces significatifs pour eux (Kusenbach, 2012). Cette méthode s’est avérée compatible avec une approche clinique. Les données récoltées dans mon journal de bord ont fait l’objet d’une publication sur l’épistémologie et la méthodologie de l’approche clinique en sciences humaines (Charlebois, 2018).
-
[12]
Le choix de ces épreuves est inspiré des recherches menées par le Réseau PARcours coordonné par Danielle Desmarais entre les années 2007 et 2015.
-
[13]
Ce moment où se rencontre le cadre théorique d’une recherche et les nouvelles expériences vécues en terrain est abductif, selon Peirce (Cefaï, 2003). L’abduction est l’analyse, c’est-à-dire l’activité qui consiste à dynamiser les savoirs acquis à l’aide des liens effectués entre les nouvelles données et les recherches antérieures. C’est selon Alvesson et Skoldberg (2009) une attitude intellectuelle qui permet de mobiliser ses préconceptions pour produire des hypothèses à partir des singularités observées en terrain et de confronter les nouvelles données jusqu’à la production d’une nouvelle compréhension. Ces opérations concilient la déduction et l’induction dans une même activité.
-
[14]
Une logique diachronique permet de saisir le parcours dans la temporalité, notamment en se saisissant des événements marquants, des transitions, des ruptures, etc.
-
[15]
Une logique synchronique permet de saisir les représentations et les pratiques des acteurs au sein des différents espaces de vie (Desmarais, 2016).
-
[16]
Pour être éligibles au programme de formation de la main-d’oeuvre d’Emploi-Québec, les personnes doivent étudier à temps plein, être admissibles à l’aide sociale, manquer de compétences en lien avec les besoins du marché, avoir au moins 16. ans, avoir quitté l’école depuis au moins 24 mois, être à risque de chômage prolongé et être « confrontées à des barrières à l’emploi à cause d’un manque de formation » (MTESS, 2016, p.4). Pour obtenir un supplément de prestation mensuelle (pouvant aller jusqu’à 400$) ou une allocation si elles n’ont pas accès à l’aide sociale de base, les personnes doivent avoir formulé un projet professionnel précis et conforme aux besoins du marché de l’emploi. Elles doivent aussi démontrer aux agents d’Emploi-Québec que ces objectifs de formation sont réalistes en fonction de leurs capacités acquises.
-
[17]
Les prestations offertes par ces programmes ne permettent pas aux bénéficiaires de sortir d’une situation de pauvreté. En 2016, le montant annuel que reçoivent les personnes prestataires (« aptes au travail ») de l’aide sociale est de 7081 $ (CEPE, 2016). Or, le seuil de faible revenu fixé par la Mesure du panier de consommation pour une personne seule à Montréal est de 17 263 $. Les personnes qui sont bénéficiaires de l’aide sociale couvrent ainsi moins de 50 % de leurs besoins de subsistances avec leurs prestations.
-
[18]
Ce revenu devrait être majoré pour trois jeunes adultes dont le conjoint, les grands-parents et les parents contribuent à les soutenir.
-
[19]
Encore enfant, Jessy se tenait avec des garçons beaucoup plus vieux (« 22 ou 23 ans »).
-
[20]
Les emplois à temps plein au salaire minimum sont très rares et ils ne permettent pas de franchir le seuil de la pauvreté (23 298 $) dans une ville comme Montréal (Yerochewski, 2014).
-
[21]
À l’époque, afin de progressivement rembourser sa dette à l’aide sociale, la mère de Jessy retirait seulement 355 $ par mois de ses prestations. Suite à l’annulation de la dette, sa mère a retrouvé un montant « normal » de 660 $ par mois.
-
[22]
Une des conditions pour obtenir du financement est de ne pas avoir été inscrit à l’école durant deux années complètes.
-
[23]
Quatre personnes expriment qu’ils aspirent à incarner la figure d’une « personne normale ».
Bibliographie
- Alvesson, Mats, et Kaj SKÖLDBERG (2009). Reflexive methodology. New vistas for qualitative research, 2e éd., London, Sage, 432 p.
- BERTAUX, Daniel (2010). Les récits de vie : Perspective ethnosociologique, Paris, 3e éd., Armand Colin, 126 p.
- BULLETIN STATISTIQUE DE L’ÉDUCATION (2015). « Les décrocheurs annuels des écoles secondaires du Québec? Qui sont les décrocheurs en fin de parcours? Que leur manque-t-il pour obtenir un diplôme? », réf. du 20 avril 2019, http://www.education.gouv.qc.ca/
- CARRETTE, Jean, et Yves VAILLANCOURT (2000). « Travailler le social : pour une redéfinition », Nouvelles pratiques sociales, Vol. 13, No 1, p. 1 - 4.
- CEFAÏ, Daniel (2003). L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte, 624 p.
- CENTRE D’ÉTUDES SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION (CEPE) (2016). La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au Québec : état de situation, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, réf du 21 juin 2018, https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_situation_2016.pdf
- CHARLEBOIS, François-Xavier (2018). « « Terrain » où recherche et accompagnement se confondent dans une approche clinique en sciences humaines », dans Isabelle Fortier, et collab. (dirs.), Clinique en sciences sociales : Sens et pratiques alternatives, Québec, Presses de l’Université de Québec, Chapitre 4, p. 67-78.
- CHÂTEL, Vivianne, et Marc-Henry SOULET (dirs.) (2003). Agir en situation de vulnérabilité, Les Presses de l’Université Laval, 214 p.
- DE GAULEJAC, Vincent (2009). Qui est « je »? : sociologie clinique du sujet, Paris, Seuil, 219 p.
- DESMARAIS, Danielle (2016) « L’approche biographique », dans Benoit Gauthier (dir.) Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- DESMARAIS, Danielle, et collab. (2012). Contrer le décrochage scolaire par l’accompagnement éducatif. Une étude sur la contribution des organismes communautaires, Presses de l’Université du Québec, 216 p.
- DESMARAIS, Danielle (2018). « Parcours éducatif et potentiel heuristique de l’approche biographique : enjeu de recherche, de formation et d’intervention », Conférence internationale : Vitalité des approches biographiques, Wroclaw, 9 - 11 mai 2018.
- DORAY, Pierre, et Paul BÉLANGER (2014). « Retirer à Pierrette pour donner à Alexandre », Revue des sciences de l’éducation, Vol. 40, No 2, p. 215-251.
- ERIKSON, Erik H. (1972). Adolescence et crise. La quête de l’identité, Flammarion, 348 p.
- HANIQUE, Fabienne (2007) « De la sociologie compréhensive à la sociologie clinique » dans de Gaulejac, V., Hanique, F. et P. Roche (dirs.), La sociologie clinique. Enjeux théoriques et méthodologiques, Érès, p. 105-130.
- HOMSY, Mia, et Simon SAVARD (2018). Décrochage scolaire au Québec : dix ans de surplace, malgré les efforts de financement, Institut du Québec, 50 p.
- INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2013). Pouvoir d’achat et durée du travail de la population non étudiante travaillant au salaire minimum, réf. du 9 septembre 2016, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/pouvoir-achat-etudiant-minimum.pdf.
- KUSENBACH, Margarethe (2012) « Go-Alongs », dans Sara Delamont (dir.) Handbook of Qualitative Research in Education, Edward Elgar Publishing Limited, p. 252-264.
- LANGEVIN, Louise, Sylvie C. CARTIER et Josianne ROBERT (2006). « Comprendre le portrait d’apprentissage perçu par les élèves « raccrocheurs » pour mieux intervenir, résultats d’une recherche », Vie pédagogique, Vol. 141, No novembre-décembre, p. 1-6.
- MARCOTTE, Julie, Richard CLOUTIER et Laurier FORTIN (2010). Portrait personnel, familial et scolaire des jeunes adultes émergents (16-24 ans) accédant aux secteurs adultes du secondaire: identification des facteurs associés à la persévérance et à l’abandon au sein de ces milieux scolaires, [rapport de recherche], Québec, Université du Québec à Trois-Rivières, 83 p.
- MARTUCELLI, Danilo (2006). Forgé par l’épreuve : l’individu dans la France contemporaine, Armand Colin, 480 p.
- MARTUCELLI, Danilo (2010). La société singulariste, Armand Colin, 259 p.
- MERCIER, Lucie (1995). « La pauvreté: phénomène complexe et multidimensionnel », Service social, Vol. 44, No 3, p. 7-27.
- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2011). La stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA): contrer les écarts de réussite entre les milieux défavorisés et ceux qui sont plus favorisés, réf. du 20 avril 2019, http://www.education.gouv.qc.ca/
- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012). Régime pédagogique de la formation générale des adultes, Québec, Gouvernement du Québec, réf. du 27 février 2019 : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%209
- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2016). Mesure de formation de la main-d’oeuvre. Section 1 : modalité du volet individu, Emploi-Québec, réf. du 8 février 2017, http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/01Guide_MFOR_volet_individus.pdf
- PAILLÉ, Pierre, et Alex Mucchielli (2016). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, 4e édition, Armand Colin, 430 p.
- POTVIN, Maryse, et Jean-Baptiste LECLERCQ, (2010). « Trajectoires sociales et scolaires de jeunes de 16-24 ans issus de l›immigration en formation générale des adultes et analyse de deux projets de «persévérance scolaire» », Direction des services aux communautés culturelles (DSCC) du Ministère de l’Éducation de l’Éducation des Loisirs et du Sport.
- RICOeUR, Paul (1990). Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, 425 p.
- ROUSSEAU, Nadia, et collab. (2010). « L›éducation des adultes chez les 16-18 ans : La volonté de réussir l’école et la vie! », Éducation et francophonie, Vol. 38, No 1, p. 154-177.
- SÉVIGNY, Robert (1993). « L’approche clinique dans les sciences humaines », dans Eugène Enriquez, et collab. (dirs.), L’analyse clinique dans les sciences humaines, Éditions Saint-Martin, p. 3-28.
- SÈVE, Lucien (2012). Aliénation et émancipation, La Dispute, 219 p.
- SÈVE, Lucien (2008). L’homme. Penser avec Marx aujourd’hui, La Dispute, 704 p.
- STRAUSS, Anselm, et Juliet CORBIN (1990). « L’analyse de données selon la grounded theory. Procédures de codage et critères d’évaluation », dans Daniel Cefaï (dir.) L’enquête de terrain, 2003, Paris, La Découverte, p. 363 - 379.
- WILLIS, Paul (2011). L’école des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des boulots d’ouvriers, Marseille, Agone, 438 p.
- Yerochewski, Carole (2014). Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité. Travailleuses et travailleurs pauvres au Québec et dans le monde, Coll. Problèmes sociaux, Presses de l’Université du Québec, 187 p.

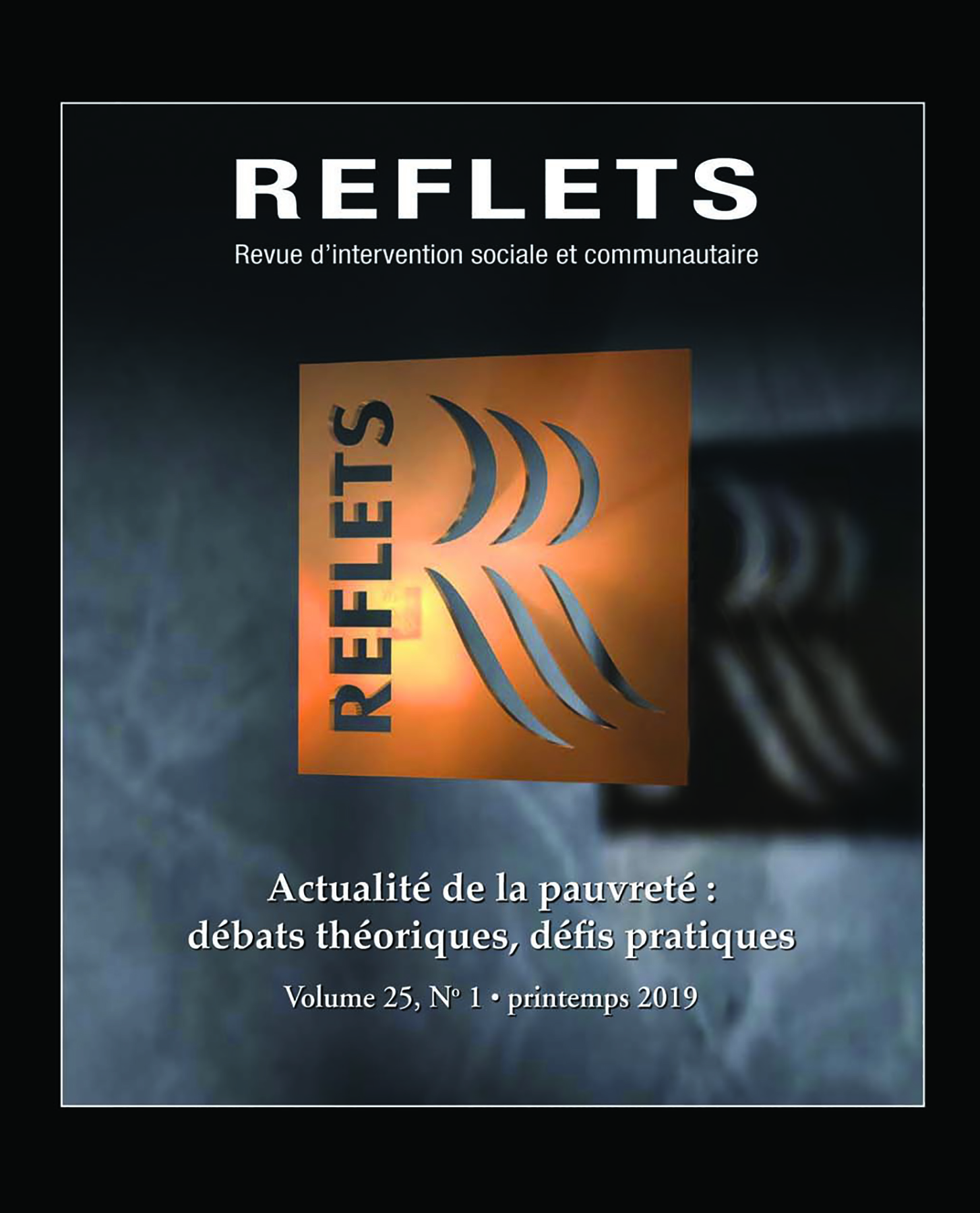
 10.7202/1028420ar
10.7202/1028420ar