Résumés
Résumé
Quelles sont les émotions ressenties par les enquêtrices et les enquêteurs pendant un entretien? Qu’est-ce qui les déclenche? Comment ces émotions sont-elles visibles? Que nous révèlent ces émotions sur la relation d’enquête et l’objet de recherche? Voici des questions auxquelles cet article se propose de répondre. Postulant que les affects sont un révélateur du social, nous nous sommes penchées sur leurs effets dans le cadre d’une recherche collective sur les apprentissages de la sexualité. Nous inspirant de l’épistémologie féministe du point de vue et du concept de travail émotionnel, nous montrons dans cet article comment la prise en compte des affects des enquêtrices avant, pendant et après l’entretien permet de limiter les biais de recherche et de consolider une posture d’enquête réflexive.
Mots-clés :
- Affects,
- épistémologie féministe,
- réflexivité,
- travail émotionnel,
- recherche collective
Abstract
What emotions do investigators feel during an interview? What sets them off? How are these emotions visible? What do they reveal about the investigative relationship and the research subject? This article suggests answers to these questions. Starting from the postulate that affects reveal social situations, we questioned their effects within a collective research project on learning sexuality. We were inspired by a feminist epistemology of point of view and by the concept of emotional work in order to show in this article how allowing for the investigators’ affects before, during and after the interview enables us to limit research bias and to strengthen a position of reflective investigation.
Keywords:
- Affects,
- feminist epistemology,
- reflectiveness,
- emotional work,
- collective research
Corps de l’article
Introduction
« Je vous demande de raconter une expérience, la découverte d’un texte, d’une oeuvre, laquelle a représenté pour vous un déclic féministe, dans le sens d’une prise de conscience des inégalités de genre. » Voici la requête formulée à 18 étudiantes de maîtrise lors de la première séance d’un atelier de méthodologie en études genre. Ce dernier visait à l’appropriation des épistémologies féministes et à leur mise en pratique sur le terrain.
Lors de cette première séance de travail, chacune des participantes, dont l’enseignante, a raconté une anecdote. Une étudiante a partagé sa prise de conscience, au moment de l’entrée dans la sexualité, du fait que les attentes de ses parents concernant ses pratiques étaient différentes de celles de ses frères aînés. Une autre a confié qu’à l’âge de 12 ans, sa grande taille était perçue comme un problème et qu’un médecin lui avait conseillé de prendre des hormones pour ralentir sa croissance et « trouver un mari ».
Ce partage d’expériences individuelles a créé les conditions favorables à l’émergence d’un collectif, d’un « nous », et a constitué l’élément déclencheur d’un processus de recherche autour d’un sujet commun : les apprentissages de la sexualité. Les récits de déclic féministe ont également amené au centre du séminaire la question des affects puisque le groupe a relevé le caractère émotionnel de cette expérience, qui les avait particulièrement touchées et émues. Elles se sont alors questionnées sur la place qu’il était possible de donner aux affects dans le processus de recherche. L’enseignante a dès lors décidé de mobiliser l’épistémologie féministe du point de vue et le concept de travail émotionnel pour saisir ce qu’apporte la conscience des affects à la relation d’enquête.
Cet article expose comment nous avons mis en place des outils pour conscientiser les affects, augmenter la réflexivité et clarifier notre posture d’enquête. Nous montrons qu’en collectivisant et en verbalisant les affects, nous pouvons déconstruire sa dimension individuelle et en faire un levier pour comprendre les dynamiques sociales et les fluctuations des rapports de pouvoir dans la relation d’enquête.
Nous allons d’abord exposer les outils théoriques utilisés dans notre démarche méthodologique. Nous présenterons ensuite notre dispositif d’enquête collectif, lequel avait pour but de saisir les affects avant et pendant le travail de terrain. Enfin, nous montrerons comment le sentiment de gêne ou de malaise peut, une fois conscientisé, se transformer en outil méthodologique pour s’affranchir des prénotions et limiter les biais d’analyse.
Théoriser les affects : un défi sociologique
Si l’histoire de la sociologie des émotions a montré que Weber (1921/1995) et Durkheim (1912) avaient déjà amorcé une théorisation des affects, la sociologie a produit peu d’outils méthodologiques pour prendre en compte cette dimension des pratiques humaines jusque dans les années 1990 (Woodward, 1996), et ce, malgré leur caractère central et transversal (Turner, 2009). Cette lacune sociologique peut s’expliquer par deux éléments. Premièrement, par le constat que la pensée des Lumières a produit une dichotomie entre les émotions et la raison, laquelle oppose également le corps à l’esprit. Deuxièmement, par l’impossibilité pour les théories constructivistes critiques de rendre compte des émotions et de leur corporalité au risque de verser dans l’essentialisme.
Des recherches actuelles ont mis en lumière que la construction binaire qui distingue la raison de l’émotion opère une hiérarchie entre ces deux notions en privilégiant la première au détriment de la deuxième (Stoetzler & Yuval-Davis, 2002). Les historiens Deluermoz, Fureix, Mazurel et Oualdi (2013) y font référence en les nommant « fausses oppositions ». Selon ces derniers, ce « psychologisme réducteur éloigna durablement les sciences sociales de [l’étude de l’émotion] » (Deluermoz et al., 2013, p. 2) et produit cette dernière comme une perturbation de l’âme et du corps, opposée binairement à la raison.
Dans cette perspective, les émotions n’ont pas leur place dans la production du savoir puisqu’elles excluent la raison, perçue comme étant le propre de la masculinité (Corbin et al., 2016; Hochschild, 2003b). Les études féministes ont en effet montré que les arguments médicaux rattachaient les émotions à la féminité et aux femmes, considérées comme des victimes de leurs affects, enfermées dans leurs émotions et dans leur corps (de Beauvoir, 1949). Les perceptions négatives reliées aux affects ont dès lors été utilisées contre les femmes (Gorton, 2007) alors que la construction du masculin s’est fondée sur un idéal de maîtrise des émotions (Jeantet, 2018). De plus, Sigmund Freud et Charles Darwin se sont alignés pour lier les émotions à l’instinct animal et les produire comme un réflexe automatique découlant de notre constitution biologique (Hochschild, 2003b). Pour ces raisons, entre autres, les émotions ont fait l’objet d’un boycottage de la part de la communauté scientifique qui hiérarchise les savoirs en opposant le naturel au masculin et aux sciences sociales. La marginalisation de l’émotion a participé à une politique genrée de la recherche qui a valorisé – et masculinisé – le détachement, la rationalité et l’objectivité au détriment de l’engagement, de la subjectivité et de la passion, notions fréquemment féminisées (Anderson & Smith, 2001). Les approches critiques décoloniales ont quant à elles montré en quoi la pensée cartésienne radicale, en produisant une rupture entre le corps et l’esprit, a participé à dévaloriser les affects (Quijano, 2007). Elles ont également mis en lumière comment cette distinction entre la nature et le social empêchait de conceptualiser les émotions (Ahmed, 2004) et combien il était difficile de penser les affects en dehors du cadrage fourni par la psychanalyse européenne (Gunev, 2009). Ces travaux postulent qu’un travail de décolonisation des perceptions des affects s’avère nécessaire pour déconstruire la doxa produisant les émotions comme individuelles, dangereuses et « non scientifiques ». Cette déconstruction oeuvre à reconnaître la transversalité des affects et leur nécessité dans la production du savoir (Holland, 2007).
Le « tournant affectif » (Clough, 2008) fait, pour sa part, référence au retour des émotions dans les années 1990. Ainsi, de nombreuses recherches se saisissent des affects dans une perspective de sciences sociales et humaines en cherchant à les appréhender de manière théorique et méthodologique. La difficulté des sciences sociales à penser le corps physique éclaire une autre distinction qui rend difficile la théorisation des affects : celle opérée entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Cette division qui a pour effet de renvoyer l’étude du corps à la biologie entrave l’étude des dynamiques sociales reliées aux affects. Dans cette perspective, Brennan (2004) refuse la distinction entre le biologique d’une part et le psychosocial d’autre part, et encourage les sciences sociales à s’inspirer des connaissances produites par la neurobiologie lorsqu’elles offrent une base plus solide à la théorisation des affects et de la corporalité. En effet, depuis les années 1990, les neurosciences ont montré le rôle important des affects dans les processus de décision et ont impulsé le retour aux émotions comme objet d’études dans d’autres disciplines.
Le renouveau que connaît la pensée de Spinoza, tant en philosophie (Braidotti, 2011) qu’en neurosciences (Damasio, 1994) ou encore en sociologie (Stoetzler & Yuval-Davis, 2002), montre la volonté de développer de nouveaux outils permettant de penser les affects hors de la binarité nature/culture. En effet, pour le philosophe, non seulement les émotions, les désirs et les affects sont au centre de la vie politique, mais l’esprit est également pensé comme étant la conscience du corps et non comme étant opposé à celui-ci (Gatens, 2009).
Malgré cet engouement, il n’existe pas de consensus sur les termes utilisés dans ce domaine. Parfois l’émotion est reliée aux ressentis physiques, parfois à l’expression des sentiments, ou encore à leur dimension biologique. La diversité des définitions témoigne de la méconnaissance de l’objet émotionnel, affectif et sentimental.
Pour une méthodologie incarnée
Afin de nourrir notre posture méthodologique et dialoguer avec les sciences nommées biologiques, nous avons choisi de reprendre les définitions proposées par le neuropsychologue Damasio (2003) sur les émotions et les sentiments. Ce chercheur a montré comment les émotions jouent un rôle dans les processus de décision. Il a recréé un lien entre ces dernières, qu’il nomme, s’inspirant de Spinoza, « modifications corporelles »[1] [traduction libre] (Damasio, 2003, p. 301), et la raison. La perception des émotions porte ainsi sur le ressenti du corps. Il se représente « la perception des émotions à la manière de l’observation, depuis une fenêtre, d’un paysage continuellement changeant, dans lequel figurent des objets en mouvement, plus ou moins lumineux, plus ou moins bruyants » (Damasio, 2006, p. 11). Les sentiments, quant à eux, matérialisent le chemin que prennent les émotions pour être connues par l’esprit. Dans cette perspective, ils deviennent des émotions médiatisées, des « témoins de la façon dont la vie est vécue » (Pailler, 2004, p. 170).
Les neurosciences apportent ainsi des connaissances heuristiques dans l’observation et la description des données corporelles. Elles ne permettent toutefois pas de saisir les processus sociaux qui sont à l’oeuvre dans le domaine des affects. En effet, la neuropsychologie donne une explication fonctionnaliste des émotions : en résumé, elles permettraient au corps de trouver l’équilibre et le bien-être (Damasio, 2003).
Nous reprenons la distinction des émotions et des sentiments proposée par les neurosciences et nous les regroupons sous le chapeau des affects. Toutefois, nous mettons en oeuvre une approche constructiviste de ces affects et nous nous éloignons de la compréhension fonctionnaliste produite par les neurosciences. Les ressentis corporels que sont les émotions et les définitions que nous leur donnons peuvent aussi être appréhendés comme des processus sociaux qui se matérialisent dans le corps. Postuler que les émotions sont des ressentis physiques n’équivaut en aucun cas à dire que les émotions se résument à des données biologiques. Mauss (1921) avait par ailleurs déjà montré la dimension profondément sociale des émotions et Lévi-Strauss (1962), le fait que ces dernières ne sont pas les causes, mais les réactions à des faits sociaux. Les affects constituent ainsi une dimension de l’expérience relationnelle de sujets engagés dans des pratiques situées (Volvey, 2016).
Dans notre méthodologie, nous avons cherché à connaître la manière dont les données corporelles sont transformées en savoir conscient puisque les émotions sont des expériences incarnées (Holland, 2007). Dans ce cadre de compréhension des affects, les sentiments sont reliés aux ressentis corporels, le corps étant lui aussi social et socialement construit (Fahs, 2011). En effet, les intégrer dans les sciences sociales revient à inclure le corps dans la recherche puisque l’étude des affects passe d’abord par le fait de les ressentir et d’en prendre conscience. Cette étape de conscientisation est nécessaire pour comprendre et verbaliser ce qui déclenche une émotion, comme la peur, la colère, la honte, la joie, et pour mettre en lumière les normes sociales qui les sous-tendent. Les affects sont dans cette perspective mobilisés comme un révélateur du social.
Afin de lier les connaissances en neurosciences à celles de la sociologie, nous nous appuyons sur l’épistémologie féministe du point de vue qui s’intéresse aux conditions de production du savoir et à l’objectivité scientifique (Haraway, 1992). Haraway a en ce sens montré que la dichotomie qui opposait les sciences naturelles aux sciences sociales reposait sur le présupposé normatif d’une objectivité scientifique.
La théorie du point de vue situé et le travail émotionnel comme leviers de connaissances
L’épistémologie féministe du point de vue, laquelle a vu le jour dans les années 1970, examine les conditions de production du savoir et le positivisme prônant l’objectivité scientifique (Anderson, 1993; Smith, 1974). Selon cette perspective, la production de la connaissance est toujours située. Il n’existe pas de savoir objectif, mais une multiplicité de points de vue sur des objets (Longino, 1988). La prise en compte du caractère situé de la connaissance et des limites que cela peut engendrer dans sa production permet de prendre conscience de certains biais de recherche et de construire une science plus précise.
La théorie du point de vue rappelle que des positions sociales distinctes en ce qui concerne le genre, la classe, la race ou l’âge fournissent différentes opportunités pour regarder l’ordre social (Collins, 1997; Harding, 1997). Les limites de l’objectivité scientifique représentent un support pour penser les affects dans une perspective sociologique. En effet, les scientifiques ont écarté les émotions et les sentiments au prétexte de leur défaut d’objectivité, ce qui aboutit à une compréhension incomplète du monde social. La remise en question de la production d’un savoir objectif et rationnel permet de réintégrer les affects dans le processus de recherche.
Malgré le fait que le « positionnement constitue un moyen de répondre à l’exigence de réflexivité dans le compte rendu du travail de terrain » (Clair, 2016, p. 83), les articles s’appuyant sur la théorie du point de vue se situent principalement dans une perspective théorique. Il existe peu de recherches méthodologiques sur les processus qui lient les positions sociales aux pratiques de recherche, ainsi que les pratiques aux points de vue et à la production de connaissance (Stoetzler & Yuval-Davis, 2002).
Le concept de travail émotionnel, proposé par Hochschild (2003a), est un outil qui permet de mettre en lumière certains de ces processus. Selon la sociologue, le travail émotionnel se produit lorsqu’une personne fournit un effort pour que l’apparence de ses émotions soit conforme à ce qu’elle pense qu’il est attendu d’elle. Dans cette perspective, le fait de modifier son comportement, son attitude et sa gestuelle corporelle est une pratique sociale qui permet de s’ajuster à l’environnement présent et aux membres qui font partie de l’interaction en question.
Hoffmann (2007) reprend le concept d’Hochschild dans le contexte spécifique de l’entretien. Postulant que la recherche qualitative est un défi émotionnel, elle cherche à combler une lacune méthodologique découlant du fait qu’il n’y a pas d’espace pour parler des ressentis sur le terrain d’enquête. Elle rejoint Kleinman et Copp (1993) pour dire que les chercheurs et chercheures partagent une culture dominée par une idéologie de la science qui produit les émotions comme suspectes et empêchant l’objectivité. Ces dernières devraient être supprimées du processus d’enquête. Pourtant, selon Arendell (1997), la recherche qualitative, à l’instar des entretiens, est remplie de pratiques émotionnellement complexes. Les chercheurs et chercheures seront davantage influencés par leurs affects et le travail émotionnel produit s’ils ne produisent pas un travail de réflexivité. Dans cette perspective, la tentative de prendre conscience des émotions ressenties pendant un entretien soutiendra une connaissance approfondie des données récoltées et du contexte de recherche. Les émotions sont dès lors appréhendées comme un outil d’analyse (Harris & Huntington, 2000).
Hoffmann (2007) envisage les émotions comme des révélateurs des dynamiques sociales et des rapports sociaux asymétriques et cherche à comprendre les formes que prend le pouvoir pendant un entretien. Dans ce contexte spécifique, le travail émotionnel est produit par la personne qui en a le moins à un moment donné. Ce concept représente donc un outil heuristique qui permet d’appréhender les affects dans la relation d’enquête. Elle s’appuie sur les trois dimensions du pouvoir proposées par Lukes (1974) pour en saisir les changements dans la relation d’enquête. La première est une forme de pouvoir explicite, lorsque par exemple une personne interrogée refuse de répondre à une question ou décide de terminer un entretien. La deuxième est une contestation indirecte du pouvoir, visant notamment à influencer les priorités et les thématiques. L’enquêteur ou l’enquêtrice peut par exemple ne plus oser poser de questions sur un certain thème si la personne enquêtée a critiqué le sens ou l’utilité de ses propos. La troisième dimension du pouvoir réside dans le contrôle ou l’influence sur la façon de penser, sur ce qui peut ou ne peut pas être dit. Elle a directement trait au point de vue situé et aux histoires qui seront privilégiées.
De cette réflexion méthodologique, nous retenons de l’épistémologie du point de vue que tout savoir est situé et que la réflexivité permet la transparence des conditions de production du savoir. En ce qui concerne le concept de travail émotionnel dans les entretiens, tel que le définit Hoffmann, il permet de prendre conscience des asymétries mouvantes dans la relation d’enquête et d’utiliser les affects comme des données au service d’une production de connaissances plus complète.
Une recherche collective sur la sexualité : méthodologie
Au cours d’un séminaire d’une durée de quatre mois, nous avons construit une problématique commune sur les apprentissages de la sexualité qui avait pour objectif de mettre en lumière les lieux, les moments et les relations en lien avec la sexualité, en partant d’expériences individuelles. Nous voulions aussi saisir l’influence des normes d’âge, de genre et de sexualité dans la construction de celle-ci.
En mettant en oeuvre un processus de décision par consentement et non une prise de décision à la majorité, évitant ainsi d’écarter les points de vue minoritaires, nous avons élaboré une problématique traitant des apprentissages de la sexualité. Nous avons utilisé la méthodologie des récits de vie (Bertaux, 2005) pour récolter les données et les participantes à la recherche (voir l’Encadré 1) avaient pour objectif de mener deux entretiens biographiques sur ce sujet avec la même personne enquêtée. La question de départ de l’entretien biographique était : « Peux-tu me parler de moments importants qui ont constitué ta sexualité? » Elles avaient le choix de mener leur enquête auprès de différents publics, selon leurs intérêts (hommes, femmes, personnes cisgenres, ayant des pratiques hétérosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles). Les personnes enquêtées avaient entre 19 et 77 ans au moment des entretiens.
En se fondant sur le concept de travail émotionnel, les participantes avaient notamment pour tâche d’être attentives aux affects ressentis et perçus pendant l’entretien, ainsi qu’au moment de leur transcription. Elles ont considéré les affects comme des marqueurs incarnant les rapports sociaux (Jeantet, 2018) et éclairant les changements de pouvoir dans la relation d’enquête (Kusenbach, 2002). Rétroactivement, nous nous rendons compte que le codage des affects a manqué de systématique et de rigueur compte tenu du caractère expérimental du séminaire.
La première rencontre consistait en un entretien pendant lequel la personne interrogée racontait ses apprentissages. Pour le deuxième entretien, nous nous sommes inspirées de la méthode mise en oeuvre par Chaxel, Fiorelli et Moity-Maïzi (2014) dans les entretiens biographiques et avons utilisé des cartes cognitives pour illustrer le récit de vie. À la suite du premier entretien, chaque étudiante a réalisé un schéma qui a servi de support à la seconde discussion. Cet outil a influencé la relation d’enquête et a permis à l’enquêtrice de clarifier, de préciser ou de saisir les expériences sexuelles de la personne interrogée. Ces schémas ont aussi révélé des zones d’ombre qui ont pu être abordées lors du deuxième entretien. À l’instar des étudiantes, l’enseignante a mené deux entretiens et produit un schéma.
L’appel à contribution pour ce numéro de la revue Recherches qualitatives, reçu plusieurs mois après la fin du séminaire, a été l’occasion de poursuivre le processus de réflexion sur l’importance des affects dans la recherche en sciences sociales. Trois étudiantes se sont proposées pour collaborer à l’écriture du présent article et entamer un processus de rédaction collective. Nous avons choisi de nous focaliser sur les sensations ressenties par les chercheures pendant l’entretien et non sur celles des personnes enquêtées, car nous nous sommes aperçues que notre dispositif méthodologique ne le permettait pas. Les séances n’ayant pas été enregistrées, la prise de notes pendant l’atelier a servi de support pour les autrices du présent article. Les citations mobilisées sont tirées des dossiers écrits par les étudiantes (parmi lesquelles trois des autrices) ayant servi de validation académique. Elles ont toutes accepté que leurs propos soient mobilisés anonymement pour cet article.
La construction d’un espace pour conscientiser et collectiviser les affects
Compte tenu du caractère passé sous silence et individualisé des affects, la première étape pour les traiter sociologiquement a consisté à en prendre conscience. Les échanges en groupe ont soutenu ce processus de conscientisation des ressentis corporels (les émotions) et des pensées associées à ces derniers (les sentiments). En participant à des tours de parole au début et à la fin de chaque atelier, les chercheures ont pris conscience de leurs ressentis physiques à deux moments distincts. Elles ont ainsi pu expérimenter la fluctuation de leurs affects ainsi que la similarité ou la différence des émotions vécues par les 19 personnes (les 18 étudiantes et l’enseignante) réalisant un processus d’enquête. La verbalisation des ressentis corporels et des sentiments a révélé leur présence dans les interactions de chacune. Ceci leur a donné des outils pour les conscientiser, les penser et les considérer comme des données d’enquête. Pour un grand nombre d’entre elles, cette pratique a élargi le « monde des possibles » : il existait des espaces pour dire et parler des affects à l’université, pour « en faire quelque chose ». Ce travail a ainsi éclairé le silence entourant les affects autant dans la formation en sciences sociales que dans la vie quotidienne (Anderson & Smith, 2001).
Rétrospectivement, l’enseignante a pris conscience que les tours de parole finaux constituaient un outil pour mesurer la volonté des étudiantes à s’engager dans cette recherche. Elle a été interpelée par le stress et la fatigue verbalisés par les enquêtrices et a régulièrement adapté la charge de travail à ces ressentis subjectifs. Ainsi, elle a diminué la quantité de données à récolter, sans toutefois perdre de vue la finalité principale, laquelle était de renforcer la posture d’enquête. Dans leurs travaux écrits et durant les tours de clôture, des étudiantes ont partagé qu’elles se sont senties déstabilisées par la dimension « bricolée » et les changements d’objectifs. L’enseignante elle-même a parfois quitté l’atelier en doutant de la suite à donner à ce cours.
L’outil des tours de parole possède toutefois une dimension normative, dans le sens qu’il constitue une injonction à parler. Par exemple, Amélie a confié qu’elle avait parfois ressenti le partage des affects comme « une sorte d’obligation à parler, à avoir quelque chose à dire. Très souvent, je ne savais pas quoi dire et n’avais pas spécialement envie de partager, et je me sentais pourtant obligée de dire quelque chose. » Elle n’a pas verbalisé ce malaise au moment des tours de parole. Elle nuance toutefois que les tours de clôture lui semblaient utiles puisque « revenant sur la séance, ils nous permettaient de partager nos états d’esprit, nos difficultés, nos craintes ou notre satisfaction ». Confirmant les constats d’Hoffmann (2007), les étudiantes prenaient en charge collectivement une partie du travail émotionnel lié aux entretiens, lequel s’effectue habituellement de manière solitaire.
Ces tours de parole ont aussi éclairé la gêne générée par le thème de recherche choisi. En effet, dans la société contemporaine, la sexualité est construite comme intime (Bozon & Rennes, 2015), reposant sur une autre dichotomie opposant le privé au public. Dans ce contexte, le fait de poser à quelqu’un des questions sur sa sexualité peut provoquer un malaise chez les chercheures. En même temps, cette construction de la sexualité comme intime participait à rendre le thème attractif pour la majorité des étudiantes.
Nous avons ainsi discuté du travail émotionnel fourni par chaque chercheure en amont de l’entretien. La sensation de malaise s’est avérée d’autant plus forte que les chercheures étaient peu expérimentées en recherche. Ainsi, Amélie confie : « Je me sentais peu à l’aise de parler de sexualité avec une inconnue. » Certaines étudiantes éprouvaient de la gêne à poser des questions sur cet objet et se sont questionnées sur leurs propres perceptions de la sexualité en lien avec leur position sociale. Mobilisant les écrits sur l’épistémologie féministe du point de vue, elles ont pris conscience de certains a priori présents dans leur posture d’enquêtrice. Par exemple, Paola raconte que, dans une recherche précédente, elle avait éprouvé des difficultés à mener des entretiens avec des hommes cisgenres et blancs qui avaient tenu des discours convenus. Elle voulait travailler sur sa posture pour « mériter » l’information en tant qu’enquêtrice. Une autre chercheure a choisi d’interroger une personne dont elle savait que la sexualité se situait en dehors de ses normes personnelles afin de se confronter à ses propres représentations de la sexualité : « Ce choix n’était pas d’emblée confortable, mais j’ai estimé que cette démarche pourrait contribuer à déconstruire mes propres cadres de pensée. »
Catherine, une autre étudiante participant au séminaire, abonde dans ce sens :
Lorsque j’ai appris que nous ferions une recherche sur les apprentissages des sexualités, j’ai su qu’il s’agirait d’un vrai défi. Le travail personnel réalisé pour parler de sexualité avec mes collègues et [mon enquêtée] fut assez conséquent. Dès lors, je me sens complètement à même de mener une autre recherche sur le même thème, qui me semble être un incontournable en études genre. Je suis fière d’avoir relevé le défi et reconnaissante d’avoir été aidée par toutes les femmes du séminaire qui ont su respecter mon opinion et mes expériences.
Les propos de Catherine mettent en avant un des impacts du partage des affects qui est leur collectivisation. En effet, comme l’a montré Salaris (2017) dans son travail auprès des victimes du Distilbène, le fait de conscientiser et de verbaliser les affects en groupe déconstruit leur caractère individuel et les transforme en expériences socialement recevables. Les chercheures ont ainsi compris qu’elles n’étaient pas seules à ressentir des émotions particulières. Collectiviser signifie ici un processus de « désindividualisation » des affects : si je ne suis pas seule à éprouver ce que je ressens, c’est qu’il y a un processus social qui est à l’oeuvre. Mes émotions (ce que je ressens physiquement) et mes sentiments (mes pensées liées à ces ressentis) deviennent ainsi des objets d’étude observables qui peuvent être mis à l’extérieur de soi. Le partage (Rimé, 2005) amène ainsi un effet transformateur qui soutient l’objectivation du subjectif et permet son étude. Il a aussi révélé la transversalité des affects dans les interactions humaines et la nécessité de leur prise en compte dans l’analyse sociologique. Toutefois, comme nous l’avons montré plus haut, la dimension obligatoire de l’expression collective des sentiments (Mauss, 1921) conduit également à ce que certaines émotions soient tues. Les ressentis passés sous silence demeurent pourtant un inconnu dans ce processus d’enquête collective, car ils n’ont pas été explorés.
Cette étape préparatoire de conscientisation et de partage a également amené la question de la gestion des émotions pendant l’entretien. Lorsqu’on ressent une émotion pendant un entretien, qu’en fait-on? Doit-on la montrer, la dire, la cacher? Comment réagit-on lorsqu’elle se manifeste, par exemple, par le rire ou les larmes?
Les discussions sur ces éléments ont mis en lumière la dimension normative des affects et de leur manifestation physique. En effet, si les rires et les sourires émis par l’enquêtrice et la personne enquêtée pendant un entretien étaient peu questionnés, la place des larmes semblait problématique. Cela révèle qu’il existe des émotions perçues comme étant « admissibles » et d’autres « inacceptables » dans le contexte de l’entretien.
Lors des discussions sur les enjeux liés aux affects, nous nous sommes questionnées sur le rôle des chercheures et nos interrogations ont révélé en filigrane l’idéal type d’une personne neutre, objective, rationnelle et désincarnée qui ne subit pas ses émotions. Cherchant à dépasser ce modèle, les enquêtrices ont été attentives aux affects ressentis pendant l’entretien ainsi qu’aux pensées qui y étaient reliées. Cette conscience avait pour but d’améliorer leur posture en soutenant la réflexivité (Arendell, 1997). En outre, le partage des affects a consolidé leur confiance en leurs capacités et dans leur rôle d’enquêtrice au moment de l’entretien. Ces constats confirment les résultats des recherches menées par Corbeil et Marchand (2006, 2010) sur l’augmentation de l’agentivité de groupes de femmes par l’intervention et la thérapie féministes.
Les affects comme vecteurs de réflexivité sur la position située
Les affects de malaise et de gêne, utilisés de manière synonyme, sont ceux qui ont été le plus souvent évoqués et de manière unanime par les chercheures. En effet, de la hiérarchie produite entre la raison et les affects découlent des croyances que les émotions ne sont pas scientifiques, sont irrationnelles ou qu’elles biaisent la recherche. Les enquêtrices sont ainsi amenées à les cacher, pour ne « pas perdre la face » (Goffman, 1974) pendant l’entretien et à se sentir mal à l’aise lorsqu’elles les ressentent de manière intense.
Nous allons partir de ces ressentis de gêne et de malaise pour mettre en lumière les apports de la conscientisation et de la collectivisation des affects. Nous ne définirons pas ce que nous entendons par gêne ou malaise, mais reprenons les termes utilisés par les participantes à la recherche. Lise, par exemple, résume ces affects en ces termes :
Nous sommes nombreuses à avoir ressenti, à un moment ou à un autre de nos entretiens, une gêne, la peur d’utiliser des mots qui blessent ou même un sentiment de ne pas être forcément légitimes d’entrer à ce point dans l’intimité de nos enquêtés [ou enquêtées].
Ces divers sentiments d’illégitimité sont ainsi des expériences partagées par les chercheures.
Des propos inattendus qui déstabilisent les enquêtrices
Certaines situations de gêne ressenties par les enquêtrices peuvent être lues en lien avec la deuxième dimension du pouvoir décrite par Hoffmann (2007), laquelle a trait au choix des thèmes abordés pendant l’entretien. Cette émotion est parfois déclenchée par des propos inattendus tenus à différents moments de l’entretien. Ceci met en avant la présence de nos catégories de perception, qui ne sont pas magiquement annulées par la technique de l’entretien (Beaud & Weber, 1997) et qui continuent d’opérer.
Par exemple, Vera avait choisi une enquêtée hétérosexuelle, en imaginant réaliser un entretien sur des apprentissages de sexualité construits comme normaux. Toutefois, son enquêtée lui a fait part, en début d’entretien, d’un abus qu’elle avait subi enfant et qui constituait le point de départ de son récit. L’imprévisibilité de ces propos s’est accompagnée d’une gêne ressentie par Vera liée au fait « qu’elle ne savait pas comment réagir » dans le contexte de l’entretien. Maude confie également avoir dû fournir un fort travail émotionnel lorsque son enquêtée lui a raconté une agression sexuelle subie, ne sachant pas comment réagir et se demandant si elle devait montrer son émotion. Quant à Alicia, elle raconte qu’elle a produit un travail émotionnel intense au moment où son enquêtée lui a raconté avoir été abusée par son père dans son enfance : « J’ai alors décidé de rester silencieuse pour la laisser parler et de mon côté laisser passer mes émotions. » Cette citation confirme les travaux de Rimé (2005) qui ont montré que la gêne et le malaise sont des réactions courantes face à la souffrance d’autrui liées au manque de « savoir-faire » dans de telles situations.
Beaud et Weber (1997) rappellent que l’entretien, en tant qu’instrument de recherche, n’est pas « neutre » et que son contenu est influencé par nos prénotions. Il contient aussi des préjugés que nous possédons envers les personnes enquêtées et le thème de l’enquête (Paillé & Mucchielli, 2003). Ces préjugés concernant ce dernier sont visibles dans les citations précédentes et montrent que les étudiantes n’étaient pas préparées à entendre parler de violences sexuelles dans le cadre des apprentissages de la sexualité, provoquant de ce fait des moments déstabilisants. Les propos des enquêtrices mettent ainsi en lumière un impensé dans la préparation aux entretiens. Elles confirment également que les entretiens qualitatifs exigent un travail émotionnel complexe, car ils ne sont pas réduits à un ensemble de questions restreintes; ils peuvent parfois se développer dans des domaines que l’enquêtrice n’avait pas anticipés. De cet impensé s’ensuit un déplacement du pouvoir, au sens de Hoffmann (2007), qui déstabilise les chercheures. Hoffmann révèle par exemple que la verbalisation d’expériences construites comme violentes peut mettre les enquêtrices dans une situation gênante, car elles ne savent pas si elles doivent réagir en montrant leurs émotions ou en les cachant. Leurs partages réflexifs après l’entretien ont montré qu’elles manquaient d’outils méthodologiques pour s’appuyer sur les affects qui les traversaient et les utiliser comme leviers de savoir dans la relation d’enquête.
Des déplacements de pouvoir ont également lieu lorsque la personne enquêtée retourne sa question à l’enquêtrice. Par exemple, Paola confie que
l’enquêté m’a aussi posé des questions personnelles pendant l’entretien. En conséquence, il y a eu des moments de retour de pouvoir au cours de l’interview, durant lesquels je ne savais pas si l’enquêté voulait débuter un partage d’émotions avec moi ou s’il désirait se libérer de l’attention pendant un instant.
Dans ces moments particuliers, Paola a choisi de répondre aux questions de l’enquêté. À l’opposé, Florence raconte avoir été confrontée à un moment donné à une question de sa part concernant sa propre sexualité : « Lorsque je lui ai demandé si elle avait un souvenir marquant de sa sexualité, elle m’a demandé un exemple auquel je n’ai pas répondu en expliquant que je ne pouvais pas dans mon rôle de chercheuse. » Que la stratégie choisie par l’enquêtrice soit de répondre ou non aux questions, ces citations illustrent l’importance de se préparer en amont à l’éventualité d’être interrogée par la personne enquêtée. Il est alors possible de porter un regard réflexif sur la grille d’entretien en portant l’attention sur la potentielle gêne générée par des questions spécifiques. Cette conscience permet de clarifier sa posture d’enquête et, le cas échéant, de modifier la grille d’entretien en conséquence.
D’une autre manière, pour développer des ressources pendant l’entretien, quelques chercheures se sont appuyées sur l’épistémologie du point de vue et ont pris conscience de leurs affects avant d’entrer sur le terrain afin de clarifier leurs présupposés normatifs. En effet, les retours sur la notion du travail émotionnel dans les entretiens révèlent que l’inattendu n’amène pas forcément le malaise si une conscientisation des préjugés est effectuée en amont. Amélie confie :
Ne connaissant pas du tout mon enquêtée avant l’entretien, je n’avais aucune idée de sa vie, son histoire. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle m’a finalement raconté. J’ai donc dû faire un travail actif pour « rentrer » dans son monde, dans une perspective compréhensive, et la suivre dans ses anecdotes, tenter de comprendre pourquoi elle choisissait de me raconter telle ou telle histoire.
Cette citation montre qu’Amélie était prête « à se laisser surprendre par le terrain » (Paillé & Mucchielli, 2003, p. 11) et que l’imprévisibilité des propos de l’enquêtée ne l’a pas déstabilisée puisqu’elle avait fourni un important travail de réflexivité en amont de l’entretien pour clarifier sa posture. Le sentiment de malaise ressenti au début de la recherche s’est ainsi atténué à la suite de ce travail de réflexivité.
Ces exemples indiquent que les chercheures fournissent un travail émotionnel pour d’une part donner le sentiment souhaitable par rapport à la personne participant à l’enquête et, d’autre part, savoir quel est le sentiment requis par le contexte de la recherche. Ce travail dépasse alors la relation d’enquête et interroge spécifiquement les conditions de la production du savoir scientifique. Peinant à se défaire de l’idéologie selon laquelle les affects altèrent l’objectivité du chercheur ou de la chercheure, les étudiantes cherchaient principalement à s’assurer que le savoir produit soit toujours perçu comme scientifique et non biaisé même si l’enquêtrice se trouvait être en empathie avec la personne enquêtée.
La conscientisation de la posture d’enquête
L’usage du mot juste, celui qui ne sera pas blessant ou maladroit, la relance adroite et adéquate, voilà notamment ce que les chercheures souhaitent vivre durant l’entretien. Pourtant, les questions posées rencontrent parfois des silences, des incompréhensions ou encore de la résistance. Elles peuvent également générer des réponses qui ressemblent davantage à des discours attendus. Ces expériences sont parfois liées au positionnement de chaque chercheure.
Ainsi, Chloé mentionne être consciente du travail de réflexivité qu’elle a réalisé après l’entretien concernant sa « volonté d’éduquer son enquêté au féminisme vis-à-vis de la sexualité » et donc d’avoir peut-être influencé et induit certaines réponses. En effet, en introduction de l’entretien, elle se présente comme féministe et se rend compte que ce positionnement a pu influencer et biaiser l’entretien. Son enquêté a alors choisi de raconter ses apprentissages dans un cadre en adéquation avec le point de vue de l’enquêtrice. Lola abonde dans ce sens en décrivant sa posture pendant l’entretien :
Lors de l’entretien, j’ai eu parfois l’impression qu’il changeait d’avis sur les propos qu’il tenait pour correspondre à mon point de vue ou encore qu’il avait peut-être réfléchi à l’avance au contenu qu’il allait partager avec moi. J’ai eu le sentiment que ce qui avait été dit durant nos échanges était très intellectualisé et contrôlé. […] Étant moi-même dans le contrôle, je n’ai pas réussi à l’emmener ailleurs, par crainte de le brusquer, mais aussi par peur que cela m’entraîne dans un endroit où je ne souhaitais pas aller. Sentiment renforcé par le fait que face à certains propos tenus, j’ai ressenti une certaine provocation de sa part comme s’il voulait tester mes limites ou voir ce que j’étais finalement prête à entendre. Peut-être aussi un moyen pour lui de reprendre du pouvoir dans notre interaction.
Lola confie également être beaucoup intervenue pendant l’entretien, utilisant la deuxième dimension du pouvoir décrite par Hoffmann (2007), sans doute pour garder le contrôle sur son contenu et influencer la direction et le sens des histoires racontées, dont elle pensait qu’elles pourraient potentiellement la mettre mal à l’aise. Odile s’est quant à elle aperçue que pendant l’entretien elle « a tenu pour acquises certaines choses sans lui demander son avis parce que ça [lui] paraissait évident » et parce qu’elle « a vécu des choses similaires » à son enquêtée. Elle a remarqué que les propos de l’enquêtée faisaient écho à sa propre expérience et que cette affinité aurait pu être l’origine d’un biais de recherche. Questionnant ses propres stéréotypes, Olga a remarqué au fil de l’entretien que les thèmes qu’elle imaginait être importants pour son enquêté masculin, comme la performance sexuelle, ne semblaient pas l’être pour lui. Elle a réalisé que ses « lunettes féministes » pouvaient réduire sa représentation de l’expérience sexuelle des hommes et l’empêcher d’entrer dans le monde des autres, de comprendre leurs catégories opératoires et peut-être leur sexisme. Elle a ainsi pris du recul par rapport à ses propres perceptions de la sexualité masculine et a appris de son enquêté. Ainsi, en étant attentive à ses affects, Olga, à l’instar d’autres étudiantes, « a lâché prise » par rapport à ses catégories interprétatives et a pu « voir, penser, comprendre autrement » (Paillé & Mucchielli, 2003, p. 143) pour se relier au monde de l’autre.
Cette difficulté rencontrée par les chercheures et exprimée par de la gêne représente ce qu’Hoffmann (2007) nomme la « troisième dimension du pouvoir »[2] [traduction libre] (2007, p. 321), soit la manière dont l’un des intervenants ou l’une des intervenantes peut exercer une influence sur la façon de penser de l’autre, de privilégier certaines histoires ou encore de les transformer. En portant une attention particulière à leurs affects, à ceux de la personne enquêtée ainsi qu’au travail émotionnel fourni, elles ont pu mesurer l’impact de certains de leurs propos sur les réponses recueillies. Le travail réflexif qu’elles ont produit pendant et après l’entretien leur a alors permis d’aller explorer d’autres interprétations des récits récoltés.
Réflexions sur le sentiment d’illégitimité dans la relation d’enquête
Grâce à la conscientisation des affects, les enquêtrices se sont aperçues qu’elles ressentaient un certain malaise sur le terrain, car elles ne se percevaient pas comme légitimes dans leur position de chercheures. Ainsi, Amélie partage :
Une partie importante du travail émotionnel effectué, dont j’ai retranscrit la trace, tient justement à l’asymétrie du pouvoir dans la relation, à ma défaveur. Au tout début de l’entretien, je ne sais pas vraiment comment me présenter, ce qui provoque en moi un malaise : je n’ai pas le contrôle sur la façon dont j’apparais face à mon enquêtée. […] Un peu plus tard, je traverse ce qui me semble être une perte totale du pouvoir et du contrôle de l’orientation de l’entretien, puisque j’ai l’impression que mon enquêtée ne souhaite plus parler. Je ne me sens plus légitime à poser des questions et en même temps, j’ai peur de « rater » l’entretien, de ne pas avoir « assez ». […] Cette peur de ne pas être légitime à faire parler et ne pas vouloir « forcer » l’enquêtée s’est aussi manifestée pour la prise du rendez-vous pour le deuxième entretien, qui a été compliquée : je n’ai pas osé la relancer pendant un temps assez long, après une absence de réponse.
D’autres enquêtrices ont fait part de leur malaise lorsque les personnes participant à la recherche trouvaient les questions « trop vagues ». Cette critique les déstabilisait dans leur rôle de chercheure et mettait en doute la pertinence de leur grille d’entretien. D’autres encore, comme Chloé, ont ressenti une grande gêne lorsqu’elles se sont aperçues que leurs enquêtées et enquêtés avaient mal compris le sujet de l’entretien pensant qu’il portait sur l’éducation sexuelle en milieu scolaire. Chloé a ainsi eu de la peine à rediriger les questions pour « réussir son entretien ».
Ces ressentis de gêne et de malaise ont été discutés en groupe entre les deux entretiens et dans les moments d’analyse des données. Ces échanges ont révélé le caractère émotionnel complexe de la relation d’enquête et les croyances liées à la « bonne production du savoir ».
Plusieurs étudiantes ont fait part de ce sentiment d’illégitimité en tant qu’enquêtrices. Certaines étudiantes ont d’ailleurs reconnu une composante genrée de la posture d’enquête, illustrée par la citation d’Émilie :
J’ai remarqué que la plupart des collègues présentes, y compris moi, ont soulevé à plusieurs reprises beaucoup d’appréhensions et de doutes vis-à-vis de leurs compétences. Elles ont souligné de plus subir un stress important. Ces observations exemplifient ce que la perspective de genre a montré à plusieurs reprises : les femmes ont moins confiance en elles que leurs homologues masculins. La valorisation du travail par les paires permet selon moi d’améliorer la confiance en soi.
Comme nous l’avons montré plus haut, les échanges en groupe sur l’expérience d’enquête ont outillé les étudiantes sur le terrain. Ils les ont ainsi aidées à comprendre ce sentiment d’illégitimité et de l’analyser avant de retourner sur le terrain. Par exemple, les discussions ont donné le courage à Lise d’approfondir le sujet par des relances lors du second entretien. Paola confie pour sa part que « [l]a possibilité de pouvoir parler sans tabou du stress et de nos doutes à propos de l’enquête a énormément aidé à soulager le travail émotionnel qu’une recherche entraîne ». Ce constat montre que les affects cessent de représenter des obstacles à la réalisation d’une enquête et peuvent devenir des ressources dès lors qu’ils sont verbalisés, discutés, et que leur dimension construite est analysée.
Conclusion
Nous avons montré comment la conscience des affects mobilisés dans une recherche soutient d’abord un processus de collectivisation des ressentis qui permet de mettre en lumière leur caractère social. La verbalisation des affects a transformé les ressentis individuels en affects collectifs. De plus, leur conscience et leur partage en groupe les externalisent et rendent possible leur analyse en tant qu’objet d’étude. Ces processus ont aussi permis aux étudiantes-chercheures d’augmenter leur confiance dans la relation d’enquête.
Nous avons pu mettre en avant que la prise en compte et l’examen des affects apportent à la recherche en sciences sociales, notamment en consolidant la position des chercheures : ils les préparent au défi émotionnel que constitue la recherche qualitative. La conscientisation des affects éclaire l’étude sur les préjugés et les attentes des enquêtrices et enquêteurs. Cela augmente la réflexivité et soutient la prise de conscience des biais de recherche véhiculés par les croyances et les valeurs des enquêteurs et enquêtrices. En effet, la gêne ressentie a permis aux étudiantes de clarifier les normes sociales et les stéréotypes qui fondaient leur point de vue. Elles ont également expérimenté que des attitudes ou l’usage de certains concepts pouvaient limiter l’espace de parole de la personne participant à l’enquête. L’inattendu leur a parfois permis d’ajuster leurs lunettes ou alors d’acquérir des outils pour se positionner différemment lors d’un prochain entretien. La prise de conscience des affects a ainsi apporté de la rigueur au processus de production du savoir et a soutenu la conscience de leur point de vue situé.
Toutefois, nous avons également pris conscience de certaines limites du dispositif méthodologique expérimenté pendant les quatre mois d’atelier. Nous nous sommes concentrées dans cet article sur les ressentis des enquêtrices, car nous ne sommes pas à même d’analyser ceux des personnes participant à l’enquête et la question de leur appréhension demeure ouverte. En effet, après ce travail sur les affects, nous savons que la tristesse peut se cacher derrière le rire ou qu’une posture perçue comme affectivement neutre peut masquer un malaise intense. Peut-on alors présupposer des émotions de l’autre sans les vérifier? De plus, comment prendre en compte la temporalité des affects, en d’autres termes, que reste-t-il d’un ressenti quand son expérience physique n’existe plus ou s’est transformée? Comment travailler sur la mémoire des émotions?
Une autre limite concernant notre méthode a trait à l’absence du traitement analytique des émotions perçues comme positives. En effet, le travail de conscientisation réalisé a surtout mis en lumière les affects construits comme négatifs et n’a pas rendu visibles les émotions construites positivement, alors que l’expérience de ces dernières enseigne également sur les processus à l’oeuvre dans la relation d’enquête.
Les témoignages des étudiantes ont également montré que le travail réflexif sur les affects pouvait être vécu comme une obligation d’exprimer ses sentiments. Il existe en effet des affects perçus comme non dicibles et passés sous silence. Le dispositif méthodologique n’a pas permis de les révéler. Ceci offre des pistes pour l’élaboration d’un futur séminaire au cours duquel les étudiants et étudiantes pourraient porter une attention particulière à ce qui n’est pas dit, sans obligation de le verbaliser, afin de saisir quelles sont les émotions considérées comme socialement admises dans le contexte universitaire.
Malgré ces limites, cette expérience collective a montré que conscientiser, reconnaître et mobiliser les affects dans les différentes étapes de l’enquête et les appréhender comme données de terrain est essentiel. Leur analyse représente de plus un levier pour dépasser les dichotomies produites entre les sciences sociales et naturelles. C’est la conclusion de Gaëlle, une des étudiantes participant à la recherche : « Et si les émotions faisaient justement le lien entre corps et esprit, entre biologie et social, entre soi et les autres? »
Parties annexes
Notes biographiques
Anne Perriard esttitulaire d’une thèse de doctorat en sociologie et chercheure postdoctorale à la Haute École genevoise de travail social. Dans ses recherches, elle cherche à saisir les effets de la catégorisation par âge dans les politiques sociales et met en oeuvre des méthodes qui rendent compte des impacts de l’imbrication des rapports de pouvoir. Reconnaissant la dimension transversale des affects, elle explore également des outils soutenant leur analyse sociologique.
Carole Christe est titulaire d’un diplôme de maîtrise en études genre à l’Université de Genève. Son mémoire porte sur les socialisations sexuées dans l’apprentissage de la danse contemporaine, pour lequel elle a réalisé une ethnographie en immersion de plus d’un an. Elle entreprend actuellement une carrière académique dans le domaine de la sociologie des arts vivants contemporains à l’Université de Lausanne.
Cécile Greset est titulaire du brevet d’avocat et d’une maîtrise en études genre. Elle travaille actuellement en tant que juriste au sein d’une juridiction genevoise et collabore à une recherche portant sur la prise en charge des violences sexuelles à Genève, sous la direction de la professeure Marylène Lieber. Dans le cadre de ses travaux, elle s’attache à développer une critique du droit suisse dans une perspective féministe.
Micaela Lois détient un diplôme de maîtrise en études genre de l’Université de Genève. Son projet de mémoire porte sur les constructions et les performances des féminités néolibérales au sein de communautés fermées au Chili. Elle s’intéresse aux processus de gentrification en Amérique latine ainsi qu’à la construction des normes de genre dans une perspective géographique.
Notes
Références
- Ahmed, S. (2004). The cultural politics of emotions. Abingdon : Oxon.
- Anderson, E. (1993). Value in ethics and economics. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Anderson, K., & Smith, S. (2001). Editorial : Emotional geographies. Transactions of the Institute of British Geographers, 26(1), 7-10.
- Arendell, T. (1997). Reflections on the researcher-researched relationship : A woman interviewing men. Qualitative Sociology, 20, 341-368.
- Beaud, S., & Weber, F. (1997). Guide de l’enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques. Paris : La Découverte.
- Beauvoir (de), S. (1949). Le deuxième sexe, I. Paris : Gallimard, Folio essais.
- Bertaux, D. (2005). Le récit de vie. Paris : Armand Colin.
- Bozon, M., & Rennes, J. (2015). Histoire des normes sexuelles : l’emprise de l’âge et du genre. Clio, 2(45), 7-23.
- Braidotti, R. (2011). Nomadic theory the portable Rosi Braidotti. New York, NY : Columbia University Press.
- Brennan, T. (2004). The transmission of affect. Ithaca, NY : Cornell University Press.
- Chaxel, S., Fiorelli, C., & Moity-Maïzi, P. (2014). Les récits de vie : outils pour la compréhension et catalyseurs pour l’action. Revue ¿ Interrogations ?, 17, 1-14.
- Clair, I. (2016). Faire du terrain en féministe. Actes de la recherche en sciences sociales, 213(3), 66-83.
- Clough, P. (2008). The affective turn : Political economy, biomedia and bodies. Theory, Culture & Society, 25(1), 1-22.
- Collins, P. (1997). Comment on Hekman’s “Truth and method : Feminist standpoint theory revisited” : Where’s the power? Signs, 22(2), 375-381.
- Corbeil, C., & Marchand, I. (2006). Penser l’intervention féministe à l’aune de l’approche intersectionnelle : défis et enjeux. Nouvelles pratiques sociales, 19(1), 40-57.
- Corbeil, C., & Marchand, I. (2010). L’intervention féministe d’hier à aujourd’hui. Montréal : Éditions du Remue-ménage.
- Corbin, A., Courtine, J.-J., & Vigarello, G. (2016). Histoire des émotions. Paris : Seuil.
- Damasio, A. (1994). Descartes’ error : Emotion, reason, and the human brain. New York, NY : Putman.
- Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza. Joy, sorrow and the feeling brain. Orlando, FL : Hartcourt.
- Damasio, A. (2006). L’erreur de Descartes : la raison des émotions. Paris : Odile Jacob.
- Deluermoz, Q., Fureix, E., Mazurel, H., & Oualdi, M. (2013). Écrire l’histoire des émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse. Revue d’histoire du XIXe siècle, (47), 155-189. https://doi.org/10.4000/rh19.4573
- Durkheim, É. (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris : F. Alcan.
- Fahs, B. (2011). Breaking body hair boundaries : Classroom exercises for challenging social constructions of the body and sexuality. Feminism & Psychology, 22(4), 482-506.
- Gatens, M. (2009). Feminist interpretations of Benedict Spinoza. University Park, PA : The Pennsylvania State University Press.
- Goffman, E. (1974). Les rites d’interaction (trad. A. Kihm). Paris : Minuit.
- Gorton, K. (2007). Theorizing emotion and affect. Feminist theory, 8(3), 333-348.
- Gunev, S. (2009). Subaltern empathy : Beyond European categories in affect theory. Concentric : Literary and Cultural Studies, 35(1), 11-30.
- Haraway, D. (1992). Ecce homo, ain’t (ar’n’t) I a woman, and inappropriate/d others : The human in a post-humanist landscape. Dans J. Butler, & J. Wallach Scott (Éds), Feminists theorize the political (pp. 86-100). New York, NY : Routledge.
- Harding, S. (1997). Comment on Hekman’s “Truth and method : Feminist standpoint theory revisited” : Whose standpoint needs the regimes of truth and reality? Signs, 22(2), 382-391.
- Harris, J., & Huntington, A. (2000). Emotions as analytic tools : Qualitative research, feelings, and psychotherapeutic insights. Dans K. Gilbert (Éd.), The emotional nature of qualitative research (pp. 129-146). Boca Raton, FL : CRC Press.
- Hochschild, A. R. (2003a). The managed heart : Commercialization of human feeling. Berkeley, CA : University of California Press.
- Hochschild, A. R. (2003b). Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale. Travailler, 9(1), 19-49.
- Hoffmann, E. (2007). Open-ended interviews, power, and emotional labor. Journal of contemporary ethnography, 36(3), 318-346.
- Holland, J. (2007). Emotions and research. International Journal of Social Research Methodology, 10(3), 195-209.
- Jeantet, A. (2018). Les émotions au travail. Paris : CNRS Éditions.
- Kleinman, S., & Copp, M. (1993). Emotions and fieldwork (Vol. 28). Thousand Oaks, CA : Sage.
- Kusenbach, M. (2002). Up close and personal : Locating the self in qualitative research. Qualitative Sociology, 25(1), 149-152.
- Lévi-Strauss, C. (1962). Le totémisme aujourd’hui. Paris : Presses universitaires de France.
- Longino, H. E. (1988). Science, objectivity, and feminist values. Feminist Studies, 14(3), 561-574.
- Lukes, S. (1974). Power : A radical view. London : MacMillan.
- Mauss, M. (1921). L’expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens). Journal de psychologie, 18, 425-434.
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2003). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Armand Colin.
- Pailler, J.-J. (2004). Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions, d’Antonio R. Damasio. Revue française de psychosomatique, 25(1), 165-172.
- Quijano, A. (2007). « Race » et colonialité du pouvoir. Mouvements, 51(3), 111-118.
- Rimé, B. (2005). Le partage social des émotions. Paris : Presses universitaires de France.
- Salaris, C. (2017). Mobiliser par émotions, mobiliser les émotions. Le cas des victimes du Distilbène. Revue française de science politique, 67(5), 857-878.
- Smith, D. E. (1974). Women’s perspective as a radical critique of sociology. Sociological Inquiry, 44(1), 7-13.
- Stoetzler, M., & Yuval-Davis, N. (2002). Standpoint theory, situated knowledge and the situated imagination. Feminist Theory, 33(3), 315-333.
- Turner, J. H. (2009). The sociology of emotions : Basic theoretical arguments. Emotion Review, 1(4), 340-354.
- Volvey, A. (2016). Sur le terrain de l’émotion : déconstruire la question émotionnelle en géographie pour reconstruire son horizon épistémologique Carnets de géographes, 9. Repéré à http://journals.openedition.org/cdg/541
- Weber, M. (1995). Économie et société (T 1). Paris : Pocket. (Ouvrage original publié en 1921).
- Woodward, K. (1996). Anger… and anger : From Freud to feminism. Dans H. J. O’Neill (Éd.), Freud and the passions (pp. 73-95). University Park, PA : University of Pennsylvania Press.

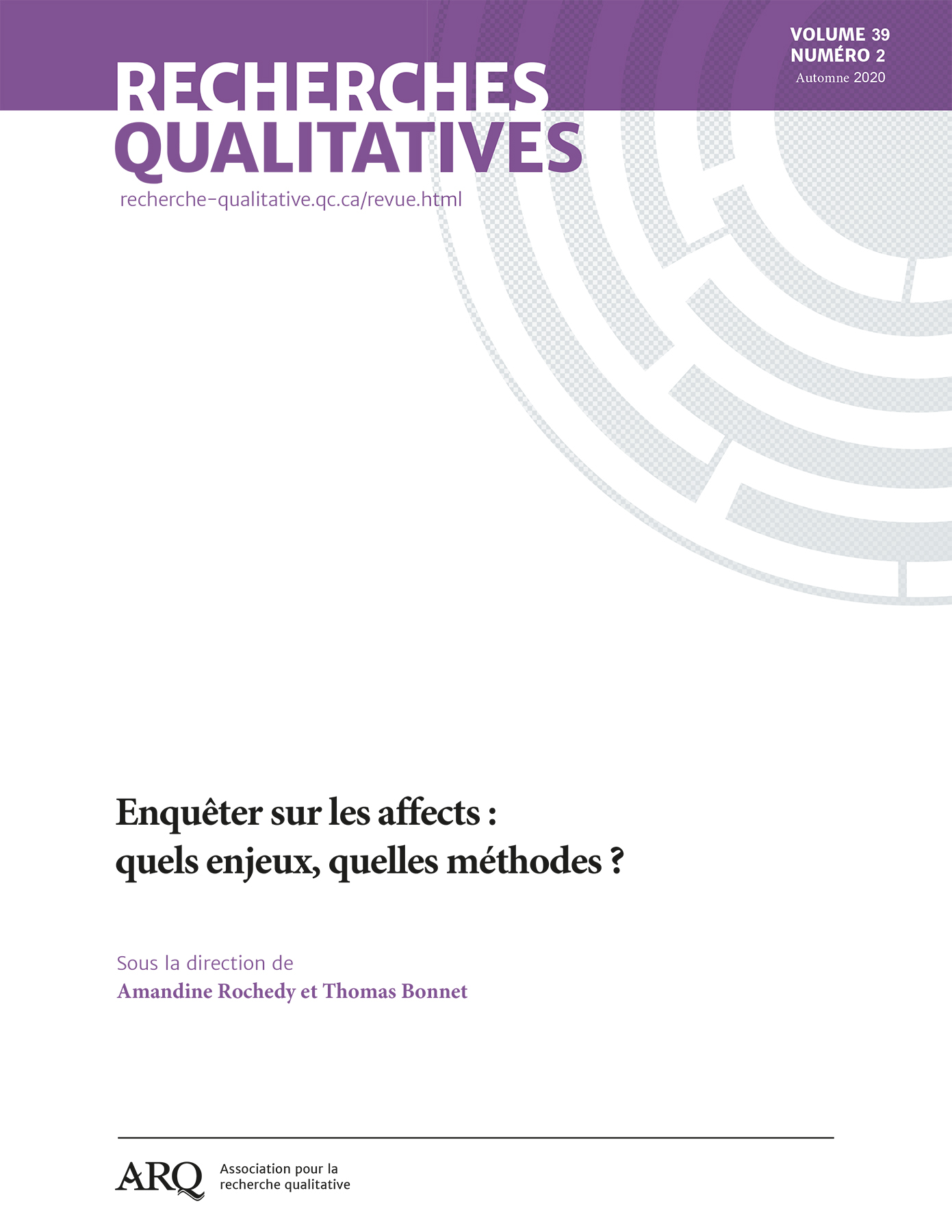
 10.7202/014784ar
10.7202/014784ar