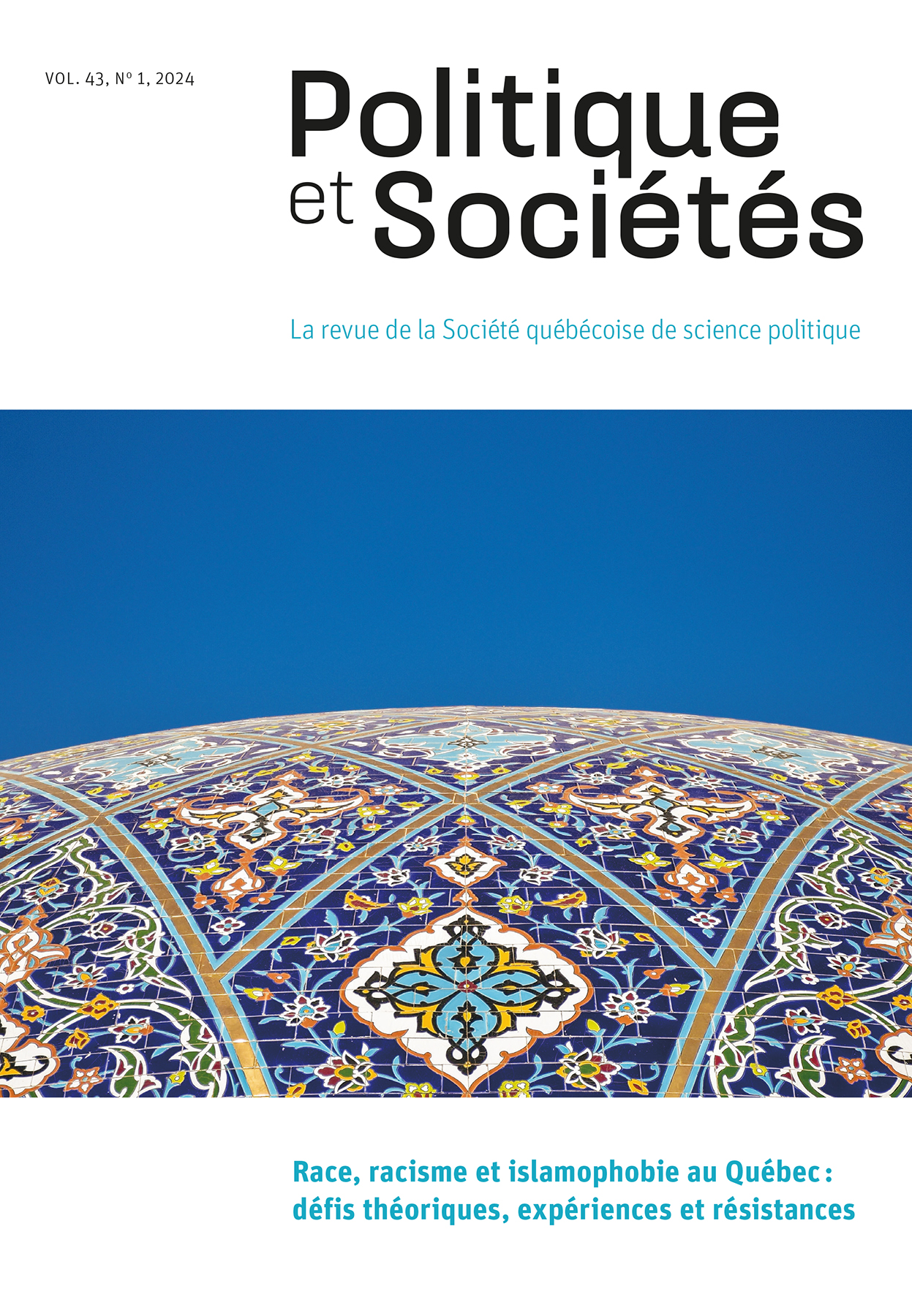Corps de l’article
En 1968, alors que le Québec tarde à se doter d’un cadre législatif en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, Gérald Fortin, un des premiers sociologues québécois de l’occupation du territoire et de la transformation du monde rural, émet une thèse novatrice : le Québec est une ville à inventer. En bref, il soutient que le Québec est entré dans une période de déconcentration, de régionalisation et de connexion des territoires, processus qui a pour effet de jeter dans la désuétude la distinction traditionnelle entre la ville et la campagne. Inquiet de la constitution d’une technocratie d’État invalidant les efforts de participation citoyenne dans les institutions démocratiques locales, mais conscient de l’impasse dans laquelle se trouvent ces dernières, Fortin appelle alors la création d’institutions participatives en phase avec l’urbanisation du territoire en cours.
Plus de 50 ans plus tard, au moment où le gouvernement du Québec annonce la mise en chantier d’une nouvelle politique nationale d’aménagement du territoire, plusieurs idées de Fortin demeurent d’actualité. Pourtant, les recherches actuelles en études urbaines laissent penser que la formule devrait être modifiée : le Québec ne serait-il pas plutôt une « banlieue » à inventer ? Car, si le Québec n’est plus constitué de villes et de campagnes séparées les unes des autres, mais de régions urbaines plus ou moins connectées formant un inséparable continuum, c’est dire que le concept traditionnel de « ville » n’est plus à même de saisir ce qui advient du territoire québécois.
Pour le groupe Global Suburbanisms: Governance, Land and Infrastructure in the Twenty-first Century, un méga projet de recherche dirigé par le politologue Roger Keil, les urbanistes et les planificateurs doivent laisser tomber leurs idéaux d’urbanité, issus de leur fréquentation des vieux quartiers des grandes villes, où l’on va à pied de son appartement au café, à la boulangerie, à la salle de spectacles. Aussi agréables soient-ils, ces lieux ne sont pas représentatifs des transformations massives du territoire ni transposables dans les nouveaux espaces suburbains qui se constituent depuis 75 ans. L’hypothèse qui guide les nombreux travaux de ce groupe de recherche est que l’urbanisation se fait maintenant de l’extérieur vers l’intérieur ou, dit autrement, que la banlieue rythme le développement urbain contemporain.
De fait, on tend à oublier que des choses aussi simples que l’eau chaude et la ventilation électrique de salle de bain n’existaient pas au moment où furent construits les vieux quartiers prisés des grandes villes. Si aujourd’hui les appartements y apparaissent conformes à l’idée du tout-à-l’électricité, c’est en banlieue que, pour la première fois, sont bâties des habitations qui incluent l’ensemble de ces dispositifs technologiques. Pour le groupe Global Suburbanisms, cela montre l’effet de rétroaction du mode de vie suburbain : au coeur des grandes villes, on voit maintenant des ménages unifamiliaux de classe moyenne aisée habiter des appartements autrefois surpeuplés, avec une petite cour arrière où, à l’aide d’une haute clôture, ils réclament une intimité digne de la banlieue pavillonnaire.
L’ouvrage collectif The Life of North American Suburbs, dirigé par Jan Nijman, est l’un des plus récents livres issus du projet Global Suburbanisms. Profitant d’un important financement du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) de 2010 à 2018, ce groupe a organisé une dizaine de séminaires thématiques et deux conférences internationales en plus de publier onze ouvrages collectifs. Ce livre qui contient quinze études de cas, huit sur les États-Unis, six sur le Canada et une sur Mexico, est à l’image de la production foisonnante du groupe : la quantité, inévitablement, dilue quelque peu la qualité.
L’objectif de l’ouvrage est de brosser un portrait de la diversité des banlieues nord-américaines afin d’en défaire l’image stéréotypée et de développer une meilleure compréhension des changements qui les affectent. Le premier article de Richard Harris donne le ton. Celui-ci utilise le cas torontois pour démontrer de manière convaincante l’inadéquation des stéréotypes par rapport à une réalité suburbaine dans laquelle cohabitent des intérêts différents et des populations diversifiées. Chacun à sa manière, les articles qui suivent reprennent une problématique semblable et montrent en quoi leur cas d’étude diffère par rapport à un idéal-type qui, malgré tout, ne veut pas mourir. En effet, si les banlieues offrent entre elles une diversité dont l’apothéose semble être Santa Fe, en banlieue de Mexico, où se trouvent, contiguës à une enclave urbaine regroupant les revenus les plus élevés du pays, un établissement de migrants regroupant les revenus les plus bas, la forme typique de la banlieue nord-américaine d’après-guerre constituée de maisons unifamiliales pavillonnaires de classe moyenne aisée et dépendant du transport automobile subsiste néanmoins. Certes, certaines banlieues résidentielles typiques ont changé et se sont densifiées tandis d’autres se sont appauvries et dépeuplées. Pourtant, de nouvelles se construisent encore en ce moment, au grand dam des apôtres du nouvel urbanisme et de la densification.
Dans la conclusion de l’ouvrage, Jan Nijman argumente en faveur d’un plus grand dialogue entre les recherches théoriques et les recherches empiriques, tout en reconnaissant que la grande diversité des situations et des problèmes illustrés dans ce livre rend difficile la construction d’un modèle théorique comme celui de la ville concentrique de la sociologie urbaine de Chicago du début du XXe siècle. Malgré tout, deux grands principes ressortent. Tout d’abord, il faut cesser de voir la banlieue dans une relation de dépendance asymétrique avec la ville-centre : le développement et la prospérité de la banlieue ne dépendent pas nécessairement de la vitalité du centre. La banlieue doit être conçue simultanément comme une entité autonome et comme une partie d’une région urbaine. Ensuite, il faut voir la banlieue comme un espace en évolution, « a transitionnal space », écrit Nijman. Le principal défi des conceptualisations futures est ainsi d’inclure une dimension relationnelle et évolutive dans la compréhension du phénomène suburbain.
En ce qui a trait aux suggestions qui s’adressent directement aux urbanistes et à ceux et celles qui élaborent les politiques publiques, la conclusion du dernier article du livre, de Jill Grant, rejoint exactement les réflexions de Gérard Beaudet dans ses deux plus récents ouvrages. Cette dernière écrit : « The continuing development of conventional suburbs suggests that planning policy can only ensure change in contexts where other factors simultaneously contribute to urban transformation. » (p. 343) L’aménagement du territoire dépend ainsi d’un ensemble de facteurs, notamment du monde du travail et de la culture, mais aussi d’enjeux liés à l’histoire des lieux, à la démographie et à l’immigration. Pour Grant, comme pour Beaudet, une infrastructure ou une politique publique ne peut à elle seule inverser des tendances lourdes et multifactorielles. Le pouvoir des politiques et des urbanistes est au mieux limité.
Cela dit, si les thèses se recoupent, les écrits de Gérard Beaudet sont assez différents de ceux du groupe Global Suburbanisms. Beaudet est un universitaire atypique dont la pratique et l’écriture sont marquées par un fort engagement civique et l’absence de formatage disciplinaire. Habitué des coups de gueule, il a récemment multiplié les prises de position contre le mode de gestion du Réseau express métropolitain (REM) et contre le tracé du REM de l’Est, projet qui fut finalement retiré des mains de la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, CPDQ-Infra, mais dont l’issue demeure encore incertaine.
Le diptyque qu’il propose offre un arrière-plan théorique et historique à ces attaques musclées et développe une position nuancée concernant la possibilité d’infléchir le développement de la banlieue montréalaise grâce à la construction d’infrastructures de transport en commun. Somme de connaissances d’une grande richesse, les deux livres de Beaudet dont il est ici question (Banlieue, dites-vous ? et Le transport collectif à l’épreuve de la banlieue) empruntent un regard synoptique, font une large part à la recherche des origines historiques du développement suburbain dans le Grand Montréal et engagent un dialogue avec l’actualité politique. Toutefois, ils ont aussi les défauts de leurs qualités : une problématique un peu floue, une structure sinueuse et quelques répétitions sont au menu. N’empêche, pour qui veut comprendre l’état de l’urbanisation dans le Grand Montréal ou prendre part au débat concernant la mise en place d’une nouvelle politique nationale d’aménagement du territoire, ces deux livres de Beaudet sont incontournables.
Le premier, Banlieue, dites-vous ? La suburbanisation dans la région métropolitaine de Montréal, qui se veut, malgré sa taille plus imposante, prolégomènes au second, Le transport collectif à l’épreuve de la banlieue du Grand Montréal, brosse un portrait panoramique de l’évolution de la banlieue montréalaise. Caractérisée par un désir d’évasion par rapport à la ville-centre, cette banlieue est définie par l’auteur comme l’ensemble du « territoire qui s’étend à l’extérieur du coeur de l’agglomération tel qu’il apparaissait à la fin des années 1920 » (p. 1), soit avant que la construction résidentielle ne soit mise sur pause pendant environ vingt ans en raison de la crise économique et de la guerre. Quand la construction résidentielle reprend après la guerre, la réalité matérielle a radicalement changé : des politiques fédérales ouvrent l’accès au prêt hypothécaire, l’industrie de la construction s’est modernisée et le mode de transport automobile se généralise.
Le modèle de la banlieue résidentielle se met alors en place rapidement et de manière irréversible. Toutefois, il n’évolue pas de manière aussi uniforme et homogène qu’on pourrait le penser ; il laisse place à une certaine diversité que Beaudet expose au moyen d’une description exhaustive des types d’établissements dans la périphérie montréalaise.
L’ouvrage commence par revenir sur les origines américaines des idées qui sont mobilisées par les promoteurs de la banlieue montréalaise. Puis, superposant une division thématique et chronologique, l’auteur traite successivement des premières politiques d’urbanisme au Québec, de l’évolution des gouvernements locaux et de la diversification des formes matérielles de la banlieue. Prise séparément, chaque section est intéressante, mais les liens entre elles sont parfois ténus et ils auraient mérité une problématisation plus fine.
Pour résumer à grands traits, la thèse de Beaudet est que l’évolution de la banlieue ne correspond pas à une opposition stricte avec la ville. Les différences tendent à s’amenuiser, sans jamais disparaître complètement. Ainsi, ceux et celles qui cherchent des différences intrinsèques et permanentes s’aveuglent, tandis que ceux et celles qui les sous-estiment et veulent implanter des infrastructures et des modes de vie propres aux quartiers centraux dans les banlieues sont systématiquement déçus.
Le deuxième ouvrage prend le relais du premier et traite de la difficile implantation du transport en commun en banlieue et de la mise en oeuvre du transit-oriented development (TOD) exigé par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté urbaine de Montréal (CMM). Plus proche du contenu de ses interventions publiques, Beaudet soutient ici que le transport en commun est un facteur parmi d’autres permettant d’infléchir les modes de vie, mais pas une cause déterminante permettant de créer l’urbanité ex nihilo. Il s’attaque alors à l’enthousiasme démesuré envers les nouvelles solutions techniques qui mésestiment les contraintes de la réalité suburbaine.
Beaudet commence, dans les deux premiers chapitres, par revenir sur l’histoire du transport en commun à Montréal. Puis, dans le troisième, il explique pourquoi le TOD est devenu le concept clé de la stratégie d’aménagement du PMAD. Finalement, dans le quatrième et dernier, il passe en revue ce qui a été fait dans les dix dernières années en termes de TOD à Montréal.
Beaudet fait valoir qu’une attention démesurée placée uniquement sur les infrastructures de transport en commun produit finalement l’inverse de ce qu’elle prétend, soit un développement suburbain désorganisé et étendu. Plus précisément, il critique le manque de vision métropolitaine à l’échelle de la CMM. Selon lui, en l’absence d’une stratégie globale de localisation, les organisations dédiées à l’aménagement du territoire sont condamnées à une compétition dont le résultat ne peut être que contraire aux objectifs de planification que se donne la CMM. Le TOD ne fonctionne qu’en présence d’un territoire qui possède des caractéristiques qui le prédestinent à une densification et une mixité des usages. En cohérence avec ses prises de position publiques, Beaudet dégonfle ici l’enthousiasme technophile des élus et des nombreux experts et fonctionnaires qui ont la tâche de défendre les projets de TOD autour de nouvelles dessertes de transport en commun. Le transport est un facteur parmi d’autres, et non une panacée. À lui seul, il n’incurvera pas significativement les mauvais plis du développement suburbain empesés par des décennies de laisser-aller.
Deux livres complètent la réflexion et permettent de mieux comprendre la profondeur des problèmes auxquels devra faire face le gouvernement québécois dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire.
Tout d’abord, Clermont Dugas étudie la persistance des iniquités territoriales malgré les nombreuses politiques provinciales qui ont été mises en place depuis les années 1960. Héritier de Fernand Dumont, Gérald Fortin et consorts, Dugas offre un panorama historique et thématique des études régionales québécoises. À la manière du livre de Beaudet sur la banlieue montréalaise, son objet est multiscalaire. Aménagement, développement et environnement au Québec traite de l’évolution de l’occupation du territoire et des disparités régionales au Québec, mais aussi des nombreuses interventions politiques qui ont visé à résoudre ces problèmes et des différentes théories sur lesquelles ces interventions se sont appuyées.
Faisant siennes des idées que l’on retrouve dans les trois ouvrages susmentionnés, l’auteur commence par décrire le mouvement de centralisation et de déconcentration qui a traversé le Québec au XXe siècle. Il s’attarde alors au passage d’une économie de production à une économie de consommation dans les villes moyennes et les communautés rurales et soutient que, conséquemment, les différences entre les modes de vie en campagne et en ville se sont amenuisées. Il décrit ensuite l’ensemble des facteurs qui expliquent l’existence et l’évolution des iniquités territoriales en allant du climat et des ressources naturelles à la perception des lieux, en passant par les mécanismes de l’économie et les politiques gouvernementales.
Puis, l’auteur s’attarde aux différentes théories et actions politiques ayant visé la réduction des iniquités territoriales au Québec depuis les années 1960. Sa démonstration débouche sur un paradoxe qui rappelle les idées de Gérard Beaudet et de Jill Grant : à trop vouloir réduire les iniquités, l’État tombe dans un autoritarisme technocratique qui produit l’inverse de ce qui est désiré. Dugas s’appuie sur l’expérience, largement discutée dans la littérature scientifique, du Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec. S’appuyant sur la théorie de la polarisation régionale, le BAEQ a proposé la fermeture de plusieurs villages et le rassemblement des communautés rurales. Il avait cependant sous-estimé l’attachement au territoire des habitants et habitantes. Plusieurs ont résisté et décidé de rester, ce qui a donné lieu aux opérations « solidarité ». Même si cela a participé à une modification heureuse de l’action publique régionale, entretemps, l’Est-du-Québec ne s’est retrouvé que plus défavorisé par rapport aux régions urbaines centrales.
Dugas explique ensuite que la théorie du développement régional a remplacé celle de la polarisation à la fin des années 1970, avant de laisser place, vingt ans plus tard, à la théorie du développement durable. Pour l’auteur, aucune théorie n’est parfaite, chacune vise un objectif différent et comporte plusieurs angles morts, ce que semblent oublier les chantres actuels du développement durable. Selon Dugas, cette théorie, et surtout l’importation de l’idéologie de la lutte à l’étalement urbain à l’extérieur des zones de rayonnement des grandes villes comme Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, handicape la revitalisation de certaines régions. D’une part, l’image de la banlieue monstrueuse n’est tout simplement pas conforme à la réalité du développement immobilier à l’extérieur des grandes villes et, d’autre part, le discours du développement durable oublie très souvent cet autre objectif, pourtant essentiel, de réduire les iniquités territoriales.
En cohérence avec cette critique, un des passages les plus intéressants de l’ouvrage porte sur les effets paradoxaux et contre-productifs de la Loi sur la protection du territoire agricole. L’auteur soutient que cette loi s’appliquant uniformément à tout le Québec s’est montrée peu adaptée aux objectifs de réduction des iniquités territoriales et de développement régional. En voulant contrer le morcellement du territoire agricole, elle a favorisé l’avènement des très grandes exploitations employant peu de personnels qualifiés et a rendu plus difficile la diversification de l’activité économique dans les régions agricoles et, conséquemment, elle a contribué au déclin de leur attractivité.
Finalement, si l’on accepte de faire de la région dans la province le parallèle de la banlieue dans la région urbaine, la conclusion théorique de Dugas est assez proche de celles de Nijman et de Beaudet. Selon lui, la région doit être conçue comme une entité à la fois autonome et dépendante : autonome, parce qu’il faut penser ses spécificités et l’attachement territorial des habitants, malgré les incohérences et les disparités que cela implique ; dépendante, parce que certaines iniquités territoriales doivent être combattues grâce à une vision globale du territoire provincial dans laquelle les parties sont interdépendantes.
En outre, dans cette économie de la consommation décrite par Dugas, le centre provincial, soit la métropole montréalaise, devient essentiellement un lieu d’innovation technologique et de divertissement pour un public globalisé, ce à quoi s’intéresse Josianne Poirier. Dans Montréal fantasmagorique, un bref livre issu de sa thèse de doctorat en histoire de l’art, elle mobilise un cadre théorique emprunté aux écrits du philosophe allemand Walter Benjamin et étudie trois oeuvres lumineuses : Cité mémoire, l’oeuvre interactive retraçant l’histoire de Montréal présentée dans le Vieux-Port, Connexions vivantes, le grand projet d’illumination du pont Jacques-Cartier, et les interventions du Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) comme Luminothérapie, un concours artistique d’oeuvres lumineuses chassant supposément la grisaille hivernale. Malgré quelques raccourcis dans l’usage des théories et dans le traitement de l’historiographie montréalaise, cet ouvrage concis et agréable à lire met le doigt sur les problèmes fondamentaux de ces activités culturelles. L’autrice démontre que les oeuvres qu’elle étudie participent à une ludification de l’espace public et une neutralisation de l’histoire, en plus de valoriser l’innovation technologique pour elle-même.
Poirier expose comment ces oeuvres repoussent à l’extérieur de l’espace public les personnes indésirables tout autant que les émotions dérangeantes. L’oeuvre L’ampleur de nos luttes de Jenny Cartwright projetée devant le Monument-National en 2008 sert de contrepoids. Dénonçant les lois répressives et remettant à l’ordre du jour les luttes féministes oubliées, cette oeuvre montre le potentiel des animations lumineuses urbaines. Le refus du PQDS de financer ce projet, prétextant que les contenus mettant de l’avant une cause politique ne sont pas proprement artistiques, montre bien la vision étriquée de l’art et le carcan capitaliste dans lequel s’inscrivent les principaux bailleurs de fonds des animations qui illuminent Montréal depuis vingt ans. Ces derniers sont incapables de considérer que l’art peut choquer, critiquer et déranger ; les animations lumineuses qu’ils financent servent à créer une image de marque et à produire des retombées économiques positives.
Retraçant le discours qui a précédé la mise en place de Connexions vivantes, Poirier critique aussi l’enflure technophile qui accompagne la mise en place de ce type de dispositif. Au départ, l’illumination du pont Jacques-Cartier devait refléter l’humeur de la ville. Pourtant, si, en effet, les spectacles quotidiens changent au gré des informations colligées en ligne par des algorithmes sophistiqués, personne n’est capable d’en tirer une quelconque interprétation : « la faiblesse sémantique de Connexions vivantes, écrit Poirier, semble inversement proportionnelle à son degré de sophistication technique » (p. 109). La technique est au service d’elle-même tel « un serpent créatif qui se mord la queue » (p. 111).
Poirier termine en critiquant la pacification de l’histoire à l’oeuvre dans Cité mémoire et les interventions du PQDS. Plutôt que de montrer ce qui est problématique dans l’histoire montréalaise, c’est-à-dire de remémorer les défaites de la justice et les traces de l’exploitation dans le présent, comme le voudrait Benjamin, ces dernières présentent une vision consensuelle et lisse des luttes historiques ; faisant comme si la Grande Paix de 1701 laissait présager des interactions harmonieuses entre colons et premiers peuples ou comme si la transition du Red Light vers l’actuel QDS s’était faite sans heurts.
En somme, pour Poirier, le financement public des animations lumineuses urbaines participe actuellement d’une compréhension de l’art selon laquelle les activités culturelles sont des outils de promotion économique s’adressant à un public globalisé que l’on s’arrache. À l’ère de la banlieue généralisée, l’art et la culture ne se portent pas bien. La compétition des territoires hyperconnectés réduit l’art à une marchandise et laisse toute la place aux bonimenteurs de l’innovation technologique. Politiques culturelles et politiques d’aménagement du territoire marchent main dans la main et Poirier nous invite à revoir les deux, dans le même mouvement.
En conclusion, il peut apparaître peu attrayant de vouloir s’inventer collectivement comme une immense banlieue, comme une province-banlieue ! La ville, évoquant les idées de centralité, de densité et de prospérité, tout autant que celles de diversité, de créativité et de monumentalité, stimule un imaginaire plus attirant que celui de la banlieue, généralement conçue comme un lieu terne, uniformisant et sans histoire. Or, la recherche contemporaine en sciences politiques et en études urbaines nous apprend d’une part que la banlieue a une histoire complexe et est beaucoup plus diversifiée que l’on veut bien le croire, et d’autre part que les ambitions de grandeur et de nouveautés de la ville-centre sont porteuses d’iniquités et d’exclusion. La banlieue est un lieu habité, idéalement à mi-chemin entre la nature et la culture qui permet à tout un chacun une forme d’intimité. Malgré tout le mal qu’on peut en penser, une large part de la recherche scientifique actuelle soutient qu’une politique provinciale d’aménagement du territoire devrait pérenniser la banlieue comme milieu de vie et en partager le plus équitablement possible les bénéfices et les inconvénients au niveau provincial.
Pour ce faire, il faudrait réduire la compétition entre les territoires et stimuler une culture locale qui ne soit pas qu’outil d’attractivité et de croissance, tout en ayant conscience qu’une politique seule peut difficilement atteindre de tels objectifs.