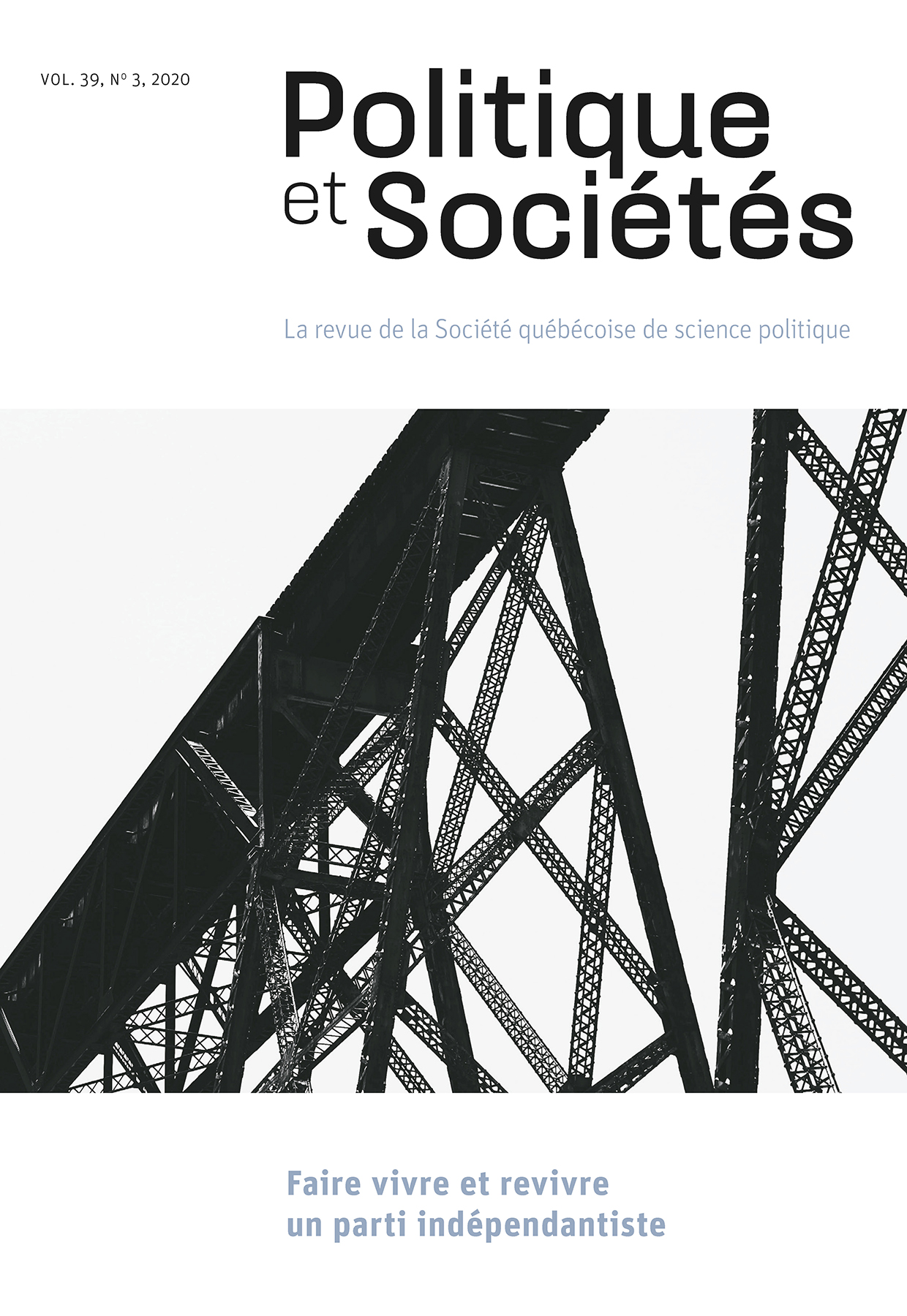Corps de l’article
L’idée que la liberté d’expression est de plus en plus menacée a bien fait son chemin au Québec ; on serait aujourd’hui dans l’ère du « politiquement correct », période dans laquelle la discussion démocratique se réaliserait plus difficilement. Néanmoins, très peu d’ouvrages se sont penchés sur la réalité québécoise et encore moins celle à l’intérieur du cadre académique. C’est ce que l’ouvrage collectif Liberté surveillée : quelques essais sur la parole à l’intérieur et à l’extérieur du cadre académique, sous la direction de Normand Baillargeon, s’attelle à faire. Regroupant des contributions d’auteur·e·s issu·e·s de disciplines allant du droit à l’anthropologie, l’ouvrage expose sous la forme d’essais leurs diverses inquiétudes quant à la liberté d’expression. Il est possible de voir à travers l’ouvrage plusieurs conceptions de la liberté d’expression se succéder et les essais peuvent être regroupés sous trois grandes thématiques : les approches juridiques quant à la liberté d’expression, la censure dans les milieux féministes et, finalement, la liberté académique.
La première partie permet à toute personne intéressée de s’initier aux diverses traditions juridiques du droit à la liberté d’expression, ainsi qu’à ses possibles limitations. Le chapitre de Pierre Trudel offre non seulement une perspective juridique qui illustre comment celle-ci évolue selon les divers contextes culturels et traditions juridiques dans lesquels elle s’inscrit, mais aussi pourquoi la liberté d’expression est un principe incontesté tant au niveau international que national. C’est que ce principe philosophique s’inscrit au coeur des discussions entourant la démocratie, en ce que la possibilité de discuter et de critiquer en est son fondement. L’auteur montre notamment que ce droit est parfois interprété de manière plus extensive dans certains pays alors que d’autres – comme le Canada – optent pour une approche plus restrictive, imposant certaines limites en fonction des valeurs et des tabous qui leur sont propres. Dans tous les cas, il est rare qu’aucune limite ne soit prévue par la loi et, encore, la régulation sociale ne se limite pas à la stricte application de règles de droit.
Le Canada fait partie des quelques pays qui ont adopté des dispositions légales concernant l’expression de discours haineux, qu’on pourrait définir comme une « expression publique qui “incite à la haine contre un groupe identifiable” » (Maclure, p. 69-70). Alors que certains – dont le directeur du collectif – préconisent l’approche de John Stuart Mill et son principe de non-nuisance (harm principle), qui proscrit uniquement les discours pouvant entraîner des préjudices corporels, d’autres comme Jocelyn Maclure soulignent que cette approche ne tient pas compte de certains torts, notamment psychologiques. C’est que ces discours sapent la confiance en soi, élément essentiel à la participation dans les débats publics, surtout lorsqu’il s’agit de se battre contre des images négatives à leur égard (p. 77). Ainsi, pour Maclure, interdire les discours haineux est un mal nécessaire pour inclure l’ensemble des personnes au sein de la société. Son approche est particulièrement intéressante du fait qu’elle s’éloigne de l’approche millienne qui domine dans l’ouvrage et prône une interprétation plus large du principe de non-nuisance propre à John Stuart Mill. Sans défendre qu’un encadrement juridique plus large des discours haineux et offensants soit nécessaire, Maclure défend plutôt que « la contrepartie éthique de notre droit légal à offenser, à ridiculiser et à blesser est de bien réfléchir aux conséquences de nos actes d’expression pour les autres, en prenant en considération les valeurs et les engagements qui les définissent » (p. 91). Ce n’est pas parce que les propos ne sont pas interdits au sens de la loi et, donc, que les démocraties libérales les tolèrent, qu’il faut les accepter collectivement.
La première section d’essais se conclut par l’analyse socio-juridique de Maryse Potvin et Siegfried L. Mathelet sur les discours racistes et haineux au Québec, qui complète bien l’analyse de Maclure, en ce que les auteur·e·s expliquent comment les discours haineux propagés par certains groupes populistes identitaires peuvent avoir des effets préjudiciables sur les personnes visées par le propos. Il·elle·s soulignent ainsi que les poursuites judiciaires au Québec sont difficiles, puisque les discours haineux sont souvent faits sur les médias sociaux, qu’ils sont banalisés et que le fardeau de la preuve repose fréquemment sur les victimes.
La deuxième section est composée de trois essais qui portent critique au « féminisme radical ». Ils soutiennent que la rectitude politique a aujourd’hui envahi les mouvements féministes, empêchant toute remise en question de certains thèmes comme l’identité de genre et la légitimité du travail du sexe. Pour Rhéa Jean et Annie-Ève Collin, ces féministes constituent une menace d’un point de vue épistémique, parce qu’elles favorisent le savoir militant au détriment de la scientificité. Diane Guilbault et Michèle Sirois dénoncent quant à elles que les féministes radicales, en adoptant une approche intersectionnelle, aient vidé « le » féminisme de ses objectifs principaux en s’attardant à d’autres formes de discrimination, notamment le racisme. Ainsi, ces femmes disent avoir été censurées, que ce soit par leur expulsion de regroupement féministe, par la « désinvitation » ou par des « campagnes de salissage ».
La dernière thématique porte plus spécifiquement sur les enjeux entourant la liberté d’expression dans le cadre universitaire. Joseph Yvon Thériault s’attarde à la réactualisation du débat entre démocratie délibérative et démocratie conflictuelle. Il concentre son essai sur les raisons et les problèmes liés à l’adoption par des milieux de gauche et certains mouvements étudiants de modes de fonctionnement pour mieux répartir la prise de parole au sein de l’espace public. Définissant dans un premier temps les concepts de safe space et de trigger warning, l’auteur concentre le reste de son essai sur leurs effets pervers. Selon lui, même si ceux-ci ont pour objectif de créer des espaces sécuritaires, la proscription de certaines opinions relève du registre idéologique, puisque les personnes qui adoptent ces approches s’approprieraient le droit de déterminer ce qu’est un propos tolérable ou non. Thériault défend que ces procédés ont aussi pour effet d’infantiliser les étudiant·e·s et les militant·e·s qui sont alors perçu·e·s comme « fragiles », en plus de réactualiser la hiérarchisation entre les professeur·e·s et les étudiant·e·s, les premiers adressant des triggers warning selon leur pré-jugement moral du sujet présenté en classe. Si ces initiatives s’inscrivent dans une perspective d’empowerment et ne sont pas antidémocratiques au sens où la démocratie de protestation est légitime, le problème réside selon l’auteur dans le fait de remplacer l’espace public par ces safe spaces. Ce désir d’immédiateté démocratique et la non-condamnation par l’institution universitaire (particulièrement l’Université du Québec à Montréal) se traduisent par la perte d’un élément essentiel à la démocratie : le principe de conflictualité.
Le collectif se clôt par l’essai de Jean-Marie Lafortune et Hans Poirier, qui retracent les origines et les caractéristiques de la liberté universitaire. On y voit comment celle-ci s’incarne des points de vue états-unien, allemand et anglais, mais aussi comment ce principe a une importance fondamentale, ayant même fait l’objet de résolutions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO). Pourtant, la liberté académique ne s’est jamais matérialisée au sein d’instruments juridiques québécois, outre qu’au sein de certaines conventions collectives de professeur·e·s. S’accordant sur le fait que la liberté d’expression doit être encadrée juridiquement et socialement, la liberté universitaire doit selon Lafortune et Poirier bénéficier d’une liberté plus grande, régulée par « un processus d’autocontrainte propre à la vie universitaire » (p. 245). Cette liberté n’est pas sans comporter certaines responsabilités ; l’adoption d’une rigueur et d’un professionnalisme est de mise. Les universités devraient quant à elles s’assurer que les résultats de recherches issues de cette liberté universitaire soient diffusés en toute sécurité. Enfin, les auteurs soulèvent à leur tour les menaces qui guettent la liberté universitaire. Ils défendent que « [l]’application insidieuse des principes de gouvernance, qui dépossède les membres de la communauté universitaire de leur capacité à participer aux décisions qui touchent leur établissement au bénéfice de membres “indépendants” au service d’intérêts politiques partisans et économiques intéressés, frappe déjà la liberté universitaire de sévères restrictions au Québec comme ailleurs » (p. 256). Ainsi, les universités doivent se protéger des groupes d’influence qui émergent, tant à l’interne qu’à l’externe.
Si l’ouvrage permet à toute personne de s’initier aux enjeux entourant la liberté d’expression, il faut souligner qu’il demeure un survol partiel et parfois empreint de données subjectives. Alors que la première section oppose des visions différentes de la liberté d’expression et mobilise une littérature diversifiée et scientifique, cette qualité ne se retrouve pas dans la seconde. Les références se limitent en grande partie à des articles de journaux et à l’autocitation, ce qui est assez problématique lorsque les essais dénoncent les faiblesses épistémiques des féministes radicales. Enfin, dans l’ensemble et à quelques exceptions près, l’ouvrage Liberté surveillée dirigé par Normand Baillargeon traite de la question de la censure dans les universités comme une réalité qui émerge de la « gauche », ce qui peut occasionner plusieurs angles morts, notamment lorsqu’on sait que des militant·e·s de l’extrême droite ont aussi interrompu des conférences dans les milieux académiques.