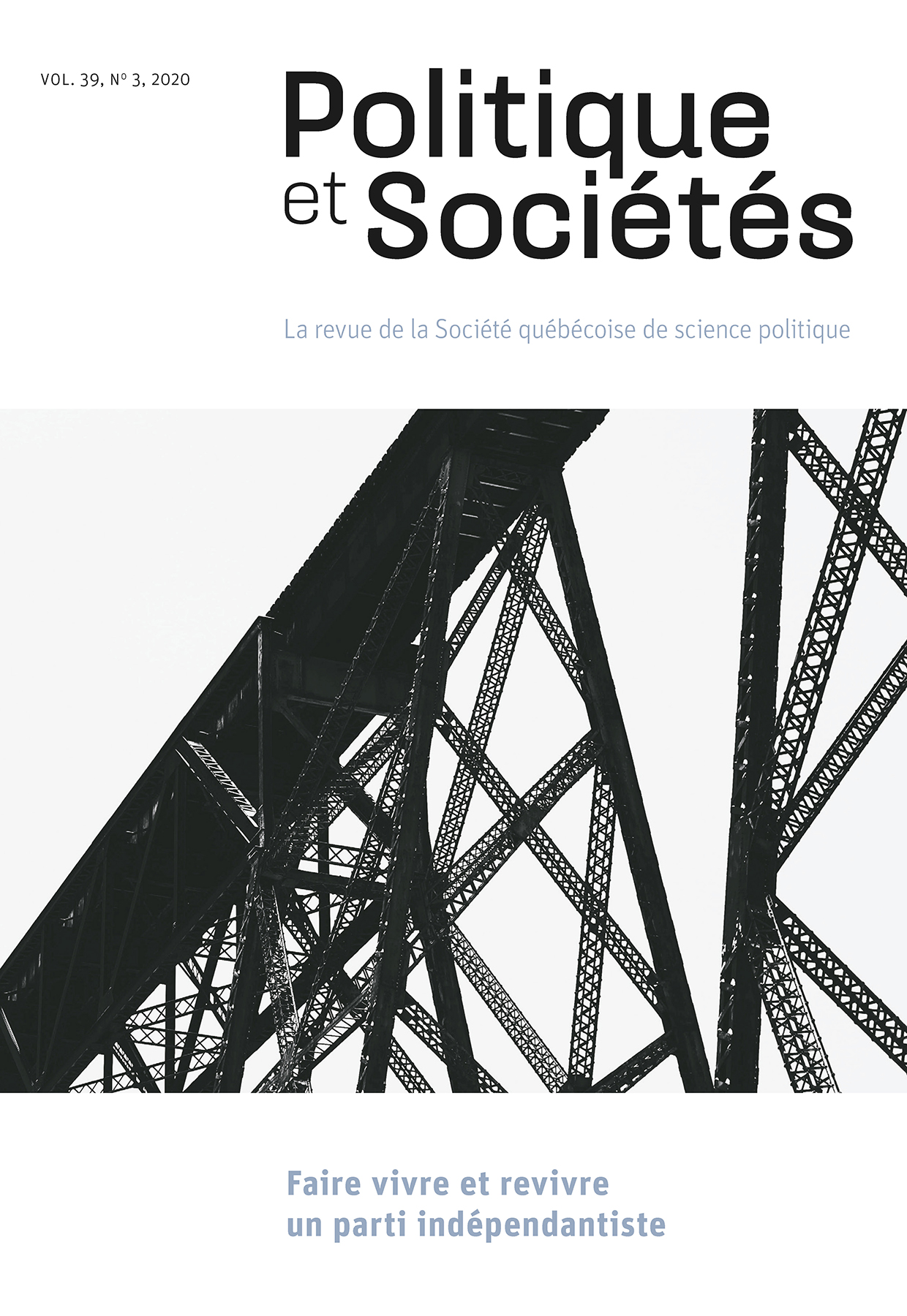Corps de l’article
Dans ce monde où les villes réclament une plus grande place en raison, dixit le politologue américain Benjamin Barber, de leurs capacités à défendre l’ouverture et la tolérance face à la montée du populisme et du nationalisme, il est bon de prendre un pas de recul afin d’étudier comment les grandes villes sont devenues, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le terreau par excellence des luttes pour la justice sociale et la reconnaissance de la diversité sous toutes ses formes. Et pour le public québécois, il pourra être surprenant d’apprendre que Toronto, pourtant surnommée « a city that works » et considérée quelque peu insipide face à la bouillante Montréal, du moins durant les trois premières décennies suivant la Seconde Guerre, fut le lieu d’importantes actions politiques et de débats d’idées ayant contribué à la constitution de ce qui est maintenant convenu d’appeler la nouvelle gauche. Ainsi, le livre de Peter Graham et Ian McKay, fruit d’une thèse de doctorat réalisée par le premier sous la direction du second, un des principaux historiens de la gauche au Canada, a de prime abord de nombreux atouts pour plaire, d’autant plus que la recherche qui le sous-tend est pointue et fort détaillée.
Radical Ambition : The New Left in Toronto couvre une large période qui va de la fin des années 1950, au moment où une nouvelle gauche émerge de la lutte pour la paix et le désarmement dans le contexte de la guerre froide, au milieu des années 1980, lorsque l’enthousiasme pour le renouvellement du progressisme semble laisser place à des réactions autoritaires et à une libéralisation économique ambiguë. Plusieurs aspects intéressants sont à noter. Tout d’abord, Peter Graham et Ian McKay montrent bien comment la lutte pour la paix et l’arrivée massive de draft dodgers américains au Canada agit comme un catalyseur pour les mouvements de gauche, notamment sur les campus universitaires. S’attardant à reconstruire les débats qui animent alors les groupes politiques, les auteurs mettent en lumière un ensemble de questions qui s’y sont posées et desquelles émerge la nouvelle gauche. Notons-en trois : 1) Le marxisme est-il la meilleure grille d’analyse des enjeux politiques et le meilleur guide des actions à entreprendre ? 2) Les partis politiques traditionnels, entendons ici le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral, mais aussi les différentes variantes de partis communistes, peuvent-ils encore être pertinents ? 3) L’État-nation canadien peut-il agir comme rempart contre l’impérialisme américain ? Inégales, les réponses à ces questions créent un monde fragmenté dans lequel les fronts d’actions politiques se multiplient, ce que montrent bien Graham et McKay.
Superposant un découpage chronologique et thématique, Radical Toronto passe en revue les principaux sujets qui ont animé la nouvelle gauche torontoise durant les années 1960 et 1970. Allant de la réforme du système d’éducation à la rénovation urbaine, en passant par l’organisation communautaire, la quête d’un parti révolutionnaire et l’émergence du Black Power, du féminisme et de l’identity-based resistance, la vision d’ensemble perd cependant en clarté au profit d’un pluralisme et d’un souci du détail. En effet, d’un chapitre à l’autre, les acteurs, les actrices et les enjeux changent, au point où la continuité apparaît parfois plutôt ténue. Afin de conserver les fils bien noués, la problématique générale et les catégories utilisées pour mettre en ordre les archives auraient mérité un traitement un peu plus serré. L’intérêt des auteurs pour la création d’un réseau d’institutions alternatives, communautaires et décentralisées explique, peut-on penser, pourquoi ils s’attardent longuement sur les expérimentations scolaires et critiquent la professionnalisation de l’action communautaire et de certains partisans du réformisme urbain. Cependant, ce n’est pas toujours clair s’il faut voir, dans ces institutions, l’essence de la nouvelle gauche. Caractérisée par une préférence pour le local et la participation communautaire, et par un refus des grandes idéologies et des grands partis, tout comme de la discipline marxiste, la nouvelle gauche semble ici saisie autant par ce qu’elle a préfiguré que par ce qu’elle fut. Ajoutant aux difficultés interprétatives, le concept de « nouvelle gauche » est utilisé alternativement comme une catégorie analytique forgée par l’étude historique et comme une dénomination fabriquée par les acteurs et actrices eux-mêmes. Qui plus est, si le premier chapitre laisse entendre que la modernisation de Toronto occupera une place centrale dans l’analyse, il aurait été pertinent de présenter des données un peu plus substantielles sur la situation de Toronto dans l’économie mondiale et sur son développement géographique. En effet, autant la focalisation sur un lieu précis est grande dans la recherche des auteurs, autant on a parfois l’impression que les enjeux discutés – notamment en ce qui a trait au système scolaire ou à la prolifération des armes nucléaires – relèvent de politiques provinciales, fédérales ou même internationales, et que les spécificités géographiques et matérielles du développement de Toronto importent peu.
Il est aussi à noter quelques irritants dans le travail d’édition. Le format avec de grandes marges de côté laissées aux légendes des images apparaît peu utile. De plus, la longue bibliographie commentée peut être intéressante, mais 40 pages semblent abusives, surtout que l’ouvrage est déjà plutôt massif. Par ailleurs, une liste des abréviations – le nombre effarant d’acronymes de groupes et d’associations qui ponctuent le récit pourrait donner le tournis – aurait été fort appréciée.
Finalement, ici et là, la question du Québec ressurgit, que ce soit dans le débat autour du nationalisme canadien, ou encore quand les acteurs et actrices de la nouvelle gauche torontoise se demandent comment réagir à la proclamation des mesures de guerre ou, plus généralement, aux velléités séparatistes du mouvement indépendantiste. À ce titre, on sent que même dans la nouvelle gauche torontoise, l’attitude à adopter face aux revendications du Québec est perçue comme un test pour l’unité canadienne, ce qui n’est pas dénué d’intérêt pour les politologues québécoises et québécois.