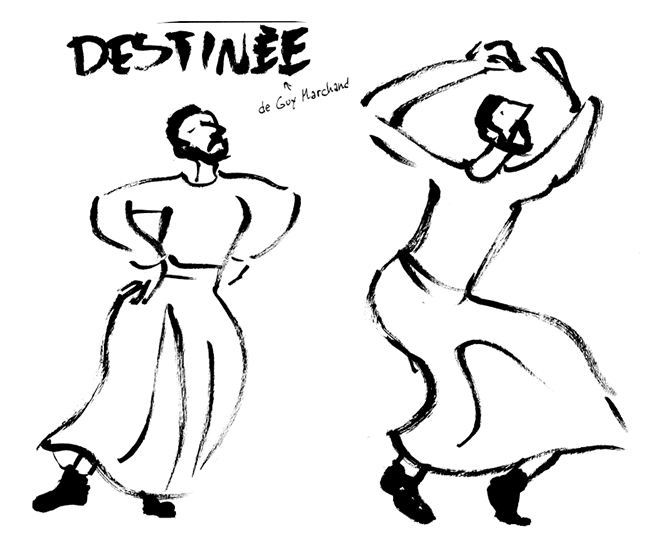Résumés
Résumé
Sous la forme d’une conférence mise en dialogue lors d’un souper, ce texte plurivoque explore le « degré zéro » de l’écriture chorégraphique éprouvé par la danse performative. Qu’advient-il du corps dansant quand la chorégraphie évacue l’idée même de « danse »? Cette écriture scénique engage une temporalité et un état de présence spécifiques qui, inscrits dans l’ici et maintenant, génèrent un effet de réel. À travers une mise en jeu du corps qui tend à sa réduction, à son effacement, voire à sa disparition, cette « dramaturgie du vivant » attise paradoxalement l’imaginaire du ou de la spectateur·trice.
Mots-clés :
- danse performative,
- chorégraphie,
- dramaturgie,
- corps,
- textualité
Abstract
Between a conference and a dialogue during a supper, this multivocal text explores the “zero degree” of choreographic writing experienced by performative dance. What happens to the dancing body when the choreography takes away the very idea of “dancing”? This stage writing involves a specific temporality and a state of presence which, here and now, generate an effect of reality. Through a bringing into play of the body which tends to reduction, to erasure, even to its disappearance, this “dramaturgy of the living” paradoxically stirs the imagination of the spectator.
Corps de l’article
Petites vaches avec lesquelles jouent Karina Iraola et Brice Noeser dans Ruminant Ruminant. Théâtre La Chapelle, Montréal (Canada), 2017.
Communication revue, corrigée et augmentée sous la forme d’un « dessert-conférence » commandé par Brice Noeser chez Audrée Juteau, en compagnie de Karina Iraola, Maria Kefirova, Marie Mougeolle et Susan Paulson.
Préambule
Le mercredi 16 mai 2018, à Montréal. Nous sommes attablé·es sous une tonnelle dans le jardin de la danseuse Audrée Juteau et le jour décline. Je viens d’arriver au souper, comme prévu, à l’heure du dessert. Le chorégraphe Brice Noeser qui s’intéresse particulièrement au langage dans son travail de création m’a invitée à partager quelques réflexions sur le corps dansant et sa relation à l’écriture, en compagnie d’un groupe de cinq danseuses avec qui il vient de terminer une semaine de recherche. Il tenait à clore sa résidence par un échange discursif hors du studio.
À cette occasion, j’ai proposé d’exposer différentes notions explorées dans ma thèse de doctorat en études et pratiques des arts autour du « degré zéro » de l’écriture chorégraphique et de ce que j’appelle la « dramaturgie du vivant », c’est-à-dire comment la danse s’élabore en deçà de l’énonciation et au-delà du désir de dire, à travers la mise en jeu du corps, et comment elle s’incarne et se performe davantage qu’elle ne parle. Initialement préparé dans le cadre du séminaire de recherche Bodytexts. Writing the Body / Textualités du corps de l’Association canadienne de la recherche théâtrale (ACRT) qui s’est tenu à Ottawa du 30 mai au 2 juin 2015, le texte de cette conférence fut ainsi éprouvé dans un contexte radicalement différent : celui d’un souper. Plutôt que de publier ma communication telle quelle, j’ai choisi de restituer le fil de la discussion qu’elle a suscitée et de présenter ainsi mon texte initial troué et enrichi par les interventions des artistes présent·es lors de cette soirée.
En tant que praticienne qui réfléchit (sur) sa pratique, je tiens particulièrement dans mon travail de recherche à faire parler la danse et le corps à travers différents registres de récits qui s’interfèrent, laissant notamment transparaître ma perception singulière ou encore celle émanant des interprètes. J’imagine ainsi diverses stratégies – telles que la mise en scène du dialogue ou la correspondance épistolaire[1] – pour que la pratique infuse l’écriture de mes articles, conférences ou essais théoriques. Et vice versa : j’aime intégrer dans l’espace de représentation de mes projets de création, le(s) récit(s) et les réflexions (parfois contradictoires) issus du processus par le biais de témoignages, d’écrits, de traces qui à la fois portent, induisent et hantent l’oeuvre. Comme mes recherches s’abreuvent de ma pratique (et réciproquement), mes travaux représentent l’occasion d’élaborer de multiples façons d’écrire (sur) la danse, qu’il s’agisse d’écriture chorégraphique, performative, dramaturgique ou même théorique.
Cette invitation m’a permis de réaliser combien mes tentatives de relier ma pratique à la théorie font directement écho à la dialectique des danseur·euses en studio et à leur pensée résolument ancrée dans l’expérience du corps. Leurs interventions et digressions lumineuses insérées à même mon texte soulignent à quel point la pensée du corps s’innerve et résonne à travers d’innombrables questions-réponses, associations, doutes, échos, ajustements et nuances.
(La danse) mise en bouche
Ce soir, j’ai donc l’opportunité de partager mes réflexions sur la poétique du corps à des artistes de la danse qui expérimentent diverses formes de textualité à travers le projet auquel elles collaborent présentement. Dans sa démarche artistique, Brice Noeser s’intéresse à une écriture chorégraphique générée – et constamment court-circuitée – par le langage, notamment par le récit absurde et le non-sens. Pour le duo Ruminant Ruminant qu’il a créé et interprété avec Karina Iraola, il a mis en place une série de contraintes sémantiques troublant la partition chorégraphique (dialoguer dans deux langues différentes, se lancer des défis de calcul mental tout en poursuivant la chorégraphie, entonner une chanson qu’on entend dans des écouteurs…) au point de devenir un moteur de création cultivant l’ambiguïté (ou l’anomalie) comme vecteur d’imaginaire.
Illustrations du duo Ruminant Ruminant créé et interprété par Karina Iraola et Brice Noeser.
Ce rendez-vous discursif auquel Brice me convie fait suite à un séminaire in(ter)disciplinaire dans le cadre d’un projet de La 2e Porte à Gauche où je l’ai invité un an plus tôt à participer, et dont la finalité publique était envisagée sous la forme d’un banquet[2]. Il s’agissait alors de réunir autour d’une table une douzaine d’artistes issu·es du champ chorégraphique et des arts visuels pour qu’il·elles échangent pendant une semaine autour de la question : « Qu’est-ce que la danse produit (d’autre)? » Dans ce séminaire constitué à la fois d’expérimentations pratiques, de conférences, de lectures et de discussions, danseur·euses, artistes visuel·les et chercheur·euses se sont côtoyé·es sans être confiné·es à un rôle : « La théoricienne danse et la danseuse théorise dans un environnement qui cherche, par la pratique, à vivre ces rôles autrement et à voir comment ils se chevauchent et s’influencent[3] ». Dépourvu de la nécessité de produire, ce contexte de travail basé sur l’échange a permis de « poser la question de la forme spectacle comme n’étant plus la finalité d’une pratique en arts vivants[4] ».
Au terme de ce séminaire, Brice m’écrivait ce courriel :
Cette semaine a eu un impact dans ma façon de penser mon quotidien, de penser à mes projets et à mes envies. […] Ayant eu le privilège de rencontrer des artistes aux démarches variées et ayant échangé chaque jour avec eux, j’ai été amené, sans vraiment m’en rendre compte, à redéfinir ce dont j’ai envie et besoin pour nourrir ma propre pratique artistique. Dans l’élan de cette semaine, je me suis remis à l'écriture de mon projet de recherche qui vise à me créer un horaire de lectures, d’écriture et de danse pour voir comment les connaissances s’imprègnent et s’évaporent. […] J’en suis donc à me questionner sur les liens et les influences possibles entre l’intellectualisation et la pratique en mouvement : quelle sorte de danse peut émaner d’un corps pensant?[5]
Le souper de ce soir est un potluck. Chacun·e a amené un plat à partager. À mon arrivée, les convives finissent leurs assiettes et s’apprêtent à passer au plateau de fromages. Sur la table, il reste deux parts d’une pizza arménienne, trois kebbés, un peu de houmous et un fond de taboulé. En guise de mise en bouche et en lien avec les préoccupations chorégraphiques de Brice, je lance à l’assemblée cette question : qu’est-ce qui fait « danse » au sein d’un projet scénique? La « choré-graphie » (c’est-à-dire l’écriture – au sens propre – du mouvement), la présence du corps sur scène, le parcours de l’artiste (en fonction du champ de sa pratique) ou encore la réception du public (en lien avec ses références)? Pour répondre à cette question, je m’intéresse particulièrement aux oeuvres qui étirent le champ du chorégraphique à travers l’effacement des signes mêmes de la « danse » comme dans Tales of the Bodiless, une pièce sans corps créée en 2011 par Eszter Salamon dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles et construite autour de la diffusion de quatre textes portant sur la disparition du corps. Ces fictions coécrites par la chorégraphe elle-même et la dramaturge Bojana Cvejić sont également publiées dans un ouvrage ayant le même titre. Le spectacle tend à imaginer un univers post-humain et à offrir au public l’expérimentation d’un monde sans corps. Malgré l’absence apparente de danse, je trouve pertinent d’observer comment l’organisation du chorégraphique s’opère dans cette pièce à travers la temporalité mise en place, la dramaturgie du texte, l’utilisation des éclairages, l’évocation du corps et sa disparition, en passant par son immobilité et, enfin, à travers la perception sensorielle du public (notamment affectée par la sonorisation de l’espace, les différentes textures vocales et l’expérience immersive de l’obscurité).
À la suite de cet exemple, Maria Kefirova se remémore une autre pièce sans corps qu’elle a pu voir en Europe : il s’agit d’une lecture intitulée We To Be et créée en 2015 par la chorégraphe norvégienne Mette Edvardsen. Assise dans le public, la chorégraphe lit un texte à voix haute tandis que le plateau demeure vide. Le spectacle est simultanément diffusé à la radio. Quand la salle est plongée dans le noir, la performeuse poursuit sa lecture grâce à une veilleuse. Même si aucun corps n’est représenté sur scène, il y a toutefois une intrigue et des personnages. Maria se souvient qu’une personne non voyante était présente dans le public. Nous évoquons alors l’existence d’audiodescriptions de pièces de danse contemporaine destinées à des spectateur·trices en situation de handicap visuel. Nous fantasmons sur les spectacles qui pourraient en émerger. Brice s’imagine interpréter la danse transcrite par l’audiodescription. L’une d’entre nous suggère l’idée d’être simplement convoqué·es dans une salle de théâtre pour écouter le texte lui-même et constater ses effets sur notre imaginaire. Ces déplacements performatifs de la « danse » nous invitent à repenser l’écriture chorégraphique.
En guise de préambule, ces premiers échanges informels ont permis de « mettre la table ». Alors que l’assemblée se sert du fromage, je débute ma conférence…
Chorégraphie et textualités
Pour Stéphane Mallarmé, la danse représente « un poème dégagé de tout appareil du scribe » (1945 : 304). Force est de constater que ce corps dansant qui ne dit rien me parle pourtant. En effet, la simple présence scénique d’un corps, quel qu’il soit, me trouble et affecte mon regard. Le chorégraphe Merce Cunningham l’avait compris quand il déclarait : « Je crois profondément que le mouvement est expressif au-delà de toute intention » (1980 : 115), même quand celui-ci est délibérément abstrait. Mon intérêt en tant que chercheuse se porte ainsi davantage sur ce que la danse me fait plutôt que sur ce qu’elle me dirait. En effet, quel est l’impact de la partition gestuelle sur mon corps de spectatrice en termes de dynamique du mouvement, d’énergie, de temporalité, de partage de l’espace, de sensorialité et de kinesthésie?
Karina souligne comment les mots touchent directement le corps : « Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots » (Barthes, 1977 : 87).
Le philosophe Michel Bernard propose à ce titre une « approche chorégraphique de la textualité » en comparant la lecture au travail d’interprétation en danse puisque, selon lui, l’imagination d’un·e lecteur·trice se singularise et s’enrichit également à travers son expérience kinesthésique (2001 : 131-132). Cette vision recoupe l’analyse de Barthes (1984) sur le·la lecteur·trice qui devient à son tour « scripteur·trice » du texte. Pour le public, il ne s’agit donc pas tant d’interpréter un sens au spectacle que d’incorporer littéralement l’action pour « se mouvoir fictivement et, par là, solliciter une tactilité et une écoute imaginaires » (Bernard, 2001 : 131).
Brice rebondit sur une de ses lectures favorites, L’inconscient malgré lui, du philosophe Vincent Descombes qui parle du dire et de l’expression du dire : l’auteur y déplie tous les recoins du langage, dont, notamment, l’indicible, le secret, le mensonge ou encore le vraisemblable. La discussion se poursuit et, de fil en aiguille, nous évoquons le pouvoir dominant en Occident du sens, du texte et de la parole. Brice se sent tourmenté par la nécessité de mettre ses idées en mots. Son incapacité à saisir et à dire tout ce qui se passe en lui et autour de lui l’obsède. En favorisant des situations de perte de contrôle et de déstabilisation, il cherche à déjouer le pouvoir intrinsèque de la langue.
Brice : Il est impressionnant de constater comment la parole peut nous immobiliser. Dans une de mes recherches, j’ai questionné le temps accordé à l’échange verbal dans le cadre d’une répétition versus le temps accordé au faire. Dans mon travail chorégraphique, j’ai tendance à vouloir être démocratique et à partager mes réflexions. Or, je me suis rendu compte que cela pouvait représenter une difficulté pour les danseur·euses de leur communiquer mes doutes ou de leur déballer ma liste d’idées. On peut parler pendant une heure et demie et, au final, il·elles ont beaucoup trop d’informations à gérer tandis que je m’épuise et me perds… En tant qu’interprète, j’ai parfois pu être moi-même noyé d’informations. Afin de pallier ce poids du langage dans ma démarche, je teste différentes stratégies, comme m’abstenir de parler pendant une journée pour communiquer sans paroles et privilégier l’action. Cette contrainte amène les gens à être plus attentifs. Un autre jour, au contraire, je suis resté assis pour ne rien montrer mais tout décrire.
La danse contemporaine s’est ainsi davantage libérée du joug du sens, en réinventant l’anatomie du corps : « [Elle] a attiré l’attention du spectateur sur les zones non sémiques de l’homo sapiens : autrement dit des zones qui ne contrôlent pas un discours » (Louppe, 1997 : 65). Son mode d’expression s’est ainsi déplacé du sens (l’univers narratif du ballet et de la pantomime) au viscéral (l’expressionisme propre à la modernité), puis vers l’abstraction (l’émancipation du sens et de l’intention) et, enfin, vers l’organique (privilégiant les sensations). Le corps de l’interprète sur scène participe à un réseau de signes qui l’induit et le colore. Ses mouvements tissent et détissent le sens, ou encore le renversent, l’annulent et le démultiplient à travers un simple regard, une posture ou une respiration.
Le degré zéro de la danse
Dans Le degré zéro de l’écriture, Barthes distingue la langue de l’écriture : alors que « la langue est un corps de prescriptions et d’habitudes, commun à tous les écrivains d’une époque » (1972 : 177), l’écriture serait une « fonction », c’est-à-dire « le rapport entre la création et la société » ou encore « une façon de penser la Littérature » (ibid. : 180). Pour le sémiologue, « [l]’écriture est précisément ce compromis entre une liberté et un souvenir » (ibid. : 181). En appliquant ce concept au champ chorégraphique, j’établis une distinction similaire entre la danse et la chorégraphie. En effet, si l’on considère la danse comme « un corps de prescriptions et d’habitudes », relativement commun à certaines pratiques d’une époque, d’une culture et d’une formation spécifique, la chorégraphie en serait une fonction, soit « le rapport entre la création et la société », et plus précisément une façon de penser la Danse en lien ou en rupture avec l’histoire de la danse et l’histoire de l’art, ainsi qu’avec le contexte social, culturel et politique dans lequel elles s’inscrivent.
Le degré zéro de l’écriture, défini par Barthes comme une écriture « neutre » ou plutôt « amodale[6] » (ibid. : 60), peut se décliner en danse à travers l’épuration de l’espace scénique, du temps et de la posture du corps dansant. Cette tentative d’une « absence idéale du style » (idem) propre au degré zéro représente aussi un style de l’absence, proposant des « chorégraphies sans danse[7] » : « Le choix d’utiliser des objets, l’absence de tout illusionnisme, la retenue maximale de notre présence sur scène faisai[en]t partie d’une stratégie permettant de faire apparaître une chorégraphie, où paradoxalement pas le moindre pas de danse ne serait même esquissé! » (Bel, dans Siegmund, 2002.)
Karina : La danse est un vaste territoire protéiforme et elle ne se réduit pas (fort heureusement!) à l’enchaînement de phrases de mouvements qui bougent dans l’espace! Cette conception de la danse existe depuis si longtemps qu’il demeure difficile d’envisager d’autres perspectives. Tout comme les oeuvres d’arts moderne et « la séduction rétinienne » déplorée par Marcel Duchamp[8]. Il faudrait diversifier notre vocabulaire pour nommer différentes esthétiques en danse.
Marie : J’aime penser que la danse est davantage dans le regard qu’on porte sur elle que dans sa forme (même si j’aime follement les dance steps!). Elle est un potentiel présent dans l’espace, qui demande à ce qu’on ouvre suffisamment notre regard pour la (perce)voir. Elle n’est pas une restriction, elle est un possible. J’aime les projets qui m’appellent à être présente. Si je devais définir la présence, je dirais que c’est un état d’ouverture à la fragilité de l’instant. Cet état de présence nécessite d’être constamment réactualisé, et notamment de la part du public.
Malgré la pauvreté des moyens utilisés, une chorégraphie sans danse peut susciter une expérience extrêmement troublante, comme si la Danse ne trouvait plus de pureté que dans l’absence de tout signe[9]. Ainsi, à travers la disparition des signes traditionnels de la danse et une réduction des éléments du spectaculaire, le champ du chorégraphique glisse vers une écriture dramaturgique. Chorégraphier ne consiste plus nécessairement à mettre en scène le mouvement, mais à mettre en jeu le corps à travers une écriture scénique qui, à défaut d’être performante, se révèle performative.
Katya : Je parle d’une écriture chorégraphique même lorsque les signes de la danse disparaissent, car nous demeurons avant tout face à une proposition de corps, qui met en jeu une personne sur scène. J’établis à ce titre un parallèle avec la devise minimaliste « Less is more » et le fameux paradoxe du comédien développé par Denis Diderot qui stipule que moins un·e comédien·ne s’identifie à son personnage pour, au contraire, l’interpréter avec sang-froid, plus il·elle suscitera, paradoxalement, de l’émotion chez le·la spectateur·trice. Le public me paraît s’identifier ainsi davantage au personnage quand celui-ci est interprété avec distance et sans affect. Et même si les interprètes semblent moins danser, il·elles suscitent malgré tout l’identification en convoquant sur scène un radical effet de réel.
Brice : Quand je regarde un spectacle, je suis avant tout intéressé par la personne. Si je ne vois pas bien les visages ou quand la proposition est basée sur une technique touffue ou très bavarde, je m’ennuie. Même s’il peut y avoir des exceptions, car certain·es interprètes arborent une présence singulière dans une partition ultra technique. La personne m’embarque alors avec elle. Cela correspond à mon goût au cinéma : dans les films, j’aime être plongé dans le temps réel du jeu de l’acteur·trice, entendre les bruits et toute la captation sonore quand il n’y a pas nécessairement de paroles. J’essaie d’amener ce jeu de plans rapprochés dans mon travail afin de révéler ces détails subtils d’intention que la présence d’une caméra sur scène soulignerait davantage. C’est une des raisons pour lesquelles j’aimerais que le public se rapproche de l’interprète, pour être davantage en lien avec les intentions qui circulent dans le corps.
Une écriture scénique
Considérer la boîte noire comme une « page blanche », c’est l’envisager comme un espace neutre, abstrait du monde réel[10] : « Le théâtre est un espace degré zéro : peint en noir, il essaie d’avoir moins de signes possibles afin que chaque représentation, chaque mise en scène, chaque chorégraphie puissent produire un espace à partir de ce “zéro” et construire un château au Danemark ou une jungle » (Bel, dans Wavelet, 2005 : 9). Le degré zéro de l’écriture chorégraphique consiste à substituer au corps-outil (le corps virtuose) un corps-matière qui impose aux interprètes, tout comme au public, un travail de deuil. Quand le corps s’expose sans idéalisation, l’artifice disparaît au profit du réel. Au-delà de saper tout effet d’illusion, ce travail de soustraction réduit tout rapport de séduction. S’élabore ainsi une dramaturgie de l’espace, du temps, du sens et du sensible – l’écriture scénique du spectacle – plus qu’une choré-graphie au sens académique du terme (c’est-à-dire une écriture de la danse centrée sur le mouvement).
Brice : J’étais tellement axé sur le langage et les jeux de paroles qu’il y avait, dans mon travail chorégraphique, une absence totale du corps, un oubli, un délaissement. Nous étions souvent assis·es par terre, désengagé·es de nos corps. J’ai entamé ma nouvelle création avec le souci de réengager le corps dans mes jeux de langage. Le langage étant incarné par un corps, je pose la question suivante : comment l’expression verbale nous chorégraphie-t-elle?
Katya : Chorégraphier désigne encore communément l’idée d’organiser le corps dans l’espace. Pourtant, chorégraphier implique également – et avant tout – d’organiser l’espace et le temps. Chorégraphier consiste donc à « écrire le mouvement » dans un sens très large. Le mouvement, dans ce contexte, ne se limitant pas au corps dansant, s’inscrit dans l’espace comme à travers l’épreuve d’une temporalité spécifique. Même à travers une posture immobile, rien ne demeure figé, d’autant plus dans le cadre du spectacle vivant. Ainsi, ce n’est pas parce que le mouvement est réduit, épuré ou performatif, qu’il est moins chorégraphique. Au contraire, il est mis en scène d’une manière singulière dans un contexte spécifique qui traduit une certaine sensibilité.
Brice : Pour mon travail chorégraphique, je pars souvent de morceaux d’idées, d’éléments épars avec lesquels j’ignore quoi faire. Réfléchir à la direction que je veux prendre me permet de spécifier la place de chaque élément. C’est l’inverse chez Lynda Gaudreau pour qui l’idée arrive en premier. Sa méthode consiste à partir d’une question ou d’un sujet d’où des formes vont émerger. Quand je travaille avec elle, elle me ramène constamment à cette interrogation : « C’est quoi ta question? » Car je finis moi-même par me perdre à travers toutes ces formes! J’aborde d’abord mon travail par la forme, puis j’essaie de le clarifier par la question.
Le degré zéro de l’écriture chorégraphique engage un désir de réel. L’exposition brute du corps impose à l’interprète « d’être là, d’être vrai dans la mise en acte, excluant les subterfuges de la représentation » (Roux, 2007 : 193). En s’éloignant de l’artifice, les créateur·trices aspirent à faire surgir le réel à travers une écriture minimaliste. La chorégraphie ne s’y définit plus comme « l’écriture du mouvement » mais plus largement comme une « écriture du vivant ».
Un temps performatif
Dans ces propositions dites « performatives[11] », le timing et l’ordonnancement des séquences prennent une dimension déterminante dans l’écriture dramaturgique du spectacle et dans les effets suscités par cette mise en scène (et en espace). Les « blancs », les silences et les longueurs, tout comme les « noirs », installent une durée qui suggère plus qu’elle ne représente. Le spectacle s’inscrit dans une temporalité à percevoir, voire à endurer[12].
Katya : Tout comme les interprètes sur scène, le public est mis à l’épreuve du temps. Ensemble, nous traversons une expérience qui relève un défi physique. Je souligne cette analogie entre la réception d’un spectacle vivant et un sport d’endurance. En course à pied, on décrit le « mur du marathon » comme un phénomène physiologique lié à une forme d’épuisement. Il correspond à un seuil de fatigue à partir duquel un·e sportif·ve est sur le point d’abandonner la course. Cependant, s’il·elle persiste tout en ralentissant sa cadence, il·elle peut franchir cet obstacle et se sentir soudain mu·e par des ressources insoupçonnées. Comme dans un spectacle performatif qui nécessite de dépasser un certain seuil – notre capacité d’écoute et d’attention, notre tolérance face à la répétition, notre degré de patience...
Brice : En tant que créateur, j’ai de la difficulté à infliger cette épreuve au public. J’ai pourtant vécu ce genre d’expérience comme spectateur et j’aime ce voyage, ce passage à travers l’ennui… Je peine souvent avec la lenteur. Néanmoins, ce type de temporalité me fait vivre un engagement, une forme d’empathie, une attention soutenue, malgré la durée et la répétition – au lieu de perdre mon attention, au contraire, elle la maintient. Dans mes créations, j’ai des idées qui pourraient s’étaler sur la durée, mais je n’assume pas d’imposer cette dernière au public. Devant une proposition qui s’étire sur le temps, j’ai d’abord tendance à la trouver facile ou trop simple. Je me questionne aussi face à certains corps désengagés. Parfois, au bout d’un moment, cela me séduit. Enfin, l’ivresse de la répétition d’une même action peut finir par me méduser.
Il s’agit d’un temps que je qualifie de « performatif » : l’action performative s’effectue sur scène sans magie, ni stylisation, afin de favoriser l’effacement du « comme si » théâtral. La présence de l’interprète s’avère alors hyperréaliste : elle participe d’une temporalité ordinaire qui correspond au temps réel de l’action, ni raccourcie, ni esthétisée par des variantes rythmiques et dynamiques. Lorsque les mouvements s’enchaînent sans phrasé et climax, le public est invité à expérimenter un rapport au temps différent que celui généralement composé d’une gamme de modulations rythmiques chargée de capter et de relancer son attention. Cette expérience particulière de la temporalité s’inscrit ici et maintenant dans l’effectuation de l’action. Curieusement, on retient souvent le caractère conceptuel de ces danses (souvent immobiles, voire invisibles) bien qu’elles engagent avant tout un rapport intensifié au temps, à l’activation du présent et au partage du moment.
Pour accompagner ma conférence, j’ai apporté un gâteau au chocolat et à la poire… Pendant qu’on le découpe, Maria Kefirova nous reconstitue de mémoire une stimulante idée du philosophe Alva Noë :
Désorganisez-vous et parfois ralentissez. L’art permet l’ennui et les questions. Cela donne l’opportunité de passer de ne pas voir à voir / de ne pas comprendre à comprendre. Et le public peut se surprendre à le faire – passer de la non-compréhension à la compréhension. L’art peut nous réorganiser[13].
Maria : Ce qui m’intéresse, c’est qu’une situation soit vivante. C’est là où le mouvement réside. J’aime défaire le sens préconçu du mouvement pour ouvrir un nouvel espace de perception.
Marie : « L’art peut nous réorganiser ». En tant que spectatrice autant qu’en tant qu’interprète ou créatrice, c’est très concret de sentir les manières dont le spectacle me fait bouger et bouleverse mes perceptions, mes préjugés, mes sensations, mes limites. Mon parcours d’interprète à travers une oeuvre est un trajet qui m’affecte, dans lequel s’injecte, notamment, du vécu. Si je fais ce métier, c’est pour qu’il me déplace, pour qu’il nous emmène ailleurs, moi tout comme le public, pour qu’on s’engage ensemble dans une relation.
Karina : Je relie cette idée de « l’art comme cognition incarnée » à la poétesse Marie Uguay[14] et à sa conception de l’écriture comme moyen de transformation de soi pour « voir autrement », ainsi qu’au concept de jouissance théorisé par Barthes. D’après lui, le concept de plaisir conforte le·la lecteur·trice en partageant ses codes, ses normes et ses valeurs, tandis que la jouissance l’ébranle, le·la divise et le·la pluralise.
Le corps comme poétique
Pour Laurence Louppe, le corps détient un caractère lyrique propre à l’organique, et ce, dans des mouvements de tension expressionnistes tout comme à travers un état de corps dit « abstrait » ou « neutre » (mouvement sans accent, absence de dessin). Ce lyrisme intrinsèque au corps présente pour Louppe la condition d’émergence du poétique. Le corps, même présenté de manière prosaïque et pauvre, engage une multiplicité de fictions et de jeux poétiques, autant formels que signifiants, sensibles ou symboliques, tel « un corps toujours en chantier [qui] n’en finit pas avec son propre devenir » (2007 : 47). C’est à ce titre qu’une certaine danse émerge à travers la dynamique de métamorphoses infinies du corps et de ses usages, comme à travers sa dissolution (ou son absence) :
Sous le nom de « danse », il y a un devenir de formes, de fonctions, d’institutions, de pratiques, de techniques, de projets, bref, de raisons radicalement différentes. […] Si le geste n’avait qu’un sens, si rien ne venait troubler ou perturber les certitudes et les inscriptions du corps socialisé, il n’y aurait pas de danse
(Charmatz et Launay, 2002 : 175).
Même quand elle s’avère minimale, la corporéité constitue non seulement la texture de l’oeuvre (sa matière), mais également sa poétique – l’écriture par laquelle transitent des partis pris esthétiques qui s’incorporent littéralement. Vecteur de sens et de devenirs, cette mise en jeu du corps instaure un modèle à la fois esthétique et politique.
Katya : Dans les danses dites « performatives », il s’agit de ne plus faire croire, de ne plus chercher à construire un espace fictif. Peut-on se contenter du réel non amplifié? Cela consiste à ne plus dominer le·la spectateur·trice, ni chercher à le·la séduire. Est-ce possible? Ce désir correspond à une utopie de l’être-ensemble résolument politique, au sens où elle réorganise l’espace et les relations qui s’y tissent (notamment les jeux de pouvoir).
Marie : Il y a pour moi dans le terme « danse performative » le danger d’un nouveau dogme esthétique. Il est rattaché à une certaine famille d’oeuvres, alors que j’aimerais qu’il la déborde. J’ai l’impression que le réel non amplifié est aujourd’hui fictif et séducteur. Dans le sens où le réel est inacceptable tel quel. L’être-ensemble dont il est question ici est pour moi avant tout poétique, donc utopique, en effet. Et c’est cette utopie qui me met au travail.
Brice : On a un certain pouvoir quand on est sur scène. C’est lié à la question de savoir versus ne pas savoir. Dans mon travail, on joue beaucoup sur le malentendu, la confusion ou le langage codé. J’aimerais performer à partir d’un élément connu du public et que nous ignorons. Une autre idée de relation a guidé notre recherche cette semaine : quels sont les signes que le public nous envoie à son insu et comment ces signes peuvent-ils générer quelque chose sur scène?
La dramaturgie du vivant
Même si les corps mis en jeu n’expriment rien, leur présence sur scène double l’oeuvre d’une épaisseur sensible. En effet, l’interprète mis·e en scène n’est jamais neutre. Sa simple exposition l’affuble d’une troublante humanité. L’interprète regarde vraiment le public dont il·elle n’ignore pas la présence. Bien que son regard semble désaffecté, ses yeux demeurent mobiles, ce qui rend sa présence plus vivante.
Pour les artistes de la scène, le vivant demeure un élément de composition essentiel[15]. Cette notion désigne pour moi quelque chose qui prend résolument vie sur scène. Même lorsque la scène demeure vide, une musique suffit à donner corps à l’espace, à le rendre vivant, à le doter d’une présence singulière. Le vivant se concentre sur ce qui advient. Le spectacle consiste à réunir un ensemble de conditions pour faciliter l’émergence de cet advenir. Cette expérimentation in vivo permet une mobilité du sens.
Katya : Imaginons que la scène est vide. Survient alors un air de Chopin. Ou bien le bruit d’un drone. Ou encore un tube de musique pop…
Maria : La musique a ce pouvoir d’incarnation.
Katya : Imaginons maintenant la scène vide, mais sans musique. La lumière change. Là aussi, l’espace prend soudain « vie » à travers le changement de luminosité.
L’irruption du vivant sur scène consiste, paradoxalement, à vider l’espace plutôt qu’à le remplir. Plutôt que de construire et d’ériger, il s’agit au contraire d’ôter, de défaire, d’extraire, de se détacher, de reculer, pour laisser les choses advenir par elles-mêmes en leur laissant « un temps » (le temps de l’installation est important, d’où l’idée d’un effet). Alors quelque chose de vivant surgit sur scène, échappe au spectacle et le fonde en même temps.
Posture
Toute corporéité[16] porte en elle une dramaturgie[17] : « Notre posture érigée détermine notre attitude face au monde; elle est un mode spécifique d’être-dans-le-monde » (Strauss, cité dans Launay et Roquet, 2008 : 1). La manière dont l’interprète entre en scène et se tient debout face au public induit une posture tout à la fois esthétique et politique. Laurent Goumarre parle d’ailleurs d’une « esthétique de la posture » qui représente « l’enjeu, la matière, la finalité d’un horizon chorégraphique […], un mouvement (presque immobile) discursif » (2002 : 44). Alors que la position appelle un déploiement, une attente, un état transitoire répondant à « une logique économique de production », la posture propose un pli : elle travaille « une autre appréhension du mouvement, du corps et de l’acte chorégraphique » (idem). Avant même de se mettre en mouvement, la façon de se tenir sur scène, d’ignorer ou non la présence du public, de s’affirmer avec ostentation ou, au contraire, de s’effacer, trahit une attitude face à la danse, à l’art et au monde. À ce titre, la posture constitue sans doute le degré zéro du mouvement dansé en tant que bassin de l’expressivité du geste déterminant sa charge expressive.
Katya : Même hors du spectacle… Regardez simplement les gens marcher dans la rue et vous découvrirez toutes sortes de personnages! Au fond, le spectacle n’est souvent qu’une entreprise de reconstitution du réel…
Marie : Le spectacle est avant tout une tentative d’acceptation du réel, combinée à une non-acceptation manifeste du réel. Certaines oeuvres mettent en valeur une composante du réel, essaient de la révéler. D’autres nous engagent à nous sentir vivant·es, transformé·es par ce réel. D’autres encore nous invitent à le transformer. Donc oui, il s’agit d’une reconstitution, mais si le spectacle se tient à cette simple reconstitution, il échoue, ou plutôt il achoppe.
Karina : Je suis interpellée par ces questions sur le réel parce que je me demande de quoi cette notion est porteuse. Le réel existe-t-il sur scène? Il s’agit plutôt d’un genre de réel, un réel-fiction... Un réel qui s’immisce à travers les interstices de la création, un hors-champ qui pénètre le cadre… quand on s’organise pour le laisser entrer. Convoquer le réel pour faire surgir quelque chose de « vivant » m’attire depuis longtemps, c’est pourquoi j’aime l’idée d’inclure les failles, les échecs, les maladresses, les hésitations, les accidents et les imprévus au sein d’une création.
La (relative) passivité de l’interprète entraîne un détachement vis-à-vis de l’expression et du pathos. Cette désaffection lui donne l’air d’être détaché·e de son mouvement, à la manière du solo de Lutz Förster dans Nelken (1982) de Pina Bausch où le danseur traduit la chanson The Man I Love en langue des signes. Sa posture se rapproche alors de celle d’un·e marionnettiste, dont la présence s’efface derrière son pantin au profit de ses mouvements. L’interprète arbore une attitude impassible à travers un état de corps désaffecté. Sans ostentation, ce détachement de la représentation déhiérarchise l’image du corps dansant idéal traditionnellement marqué par le tonus musculaire. Cette déconstruction s’incorpore au point de faire surgir une posture singulière.
Hyperprésence
Sur scène, l’interprète n’est plongé·e ni dans un univers fictif[18], ni dans une bulle introspective. Au niveau du regard, son absence de projection affiche un certain « sous-jeu[19] ». On dirait que le·la danseur·euse n’est pas en spectacle. Ce mode de présence que je qualifierais de « brute » tend à gommer la distanciation scène / salle. Cet état d’hyperprésence accentue l’effet de l’ici et maintenant.
Karina : Les films de Maurice Pialat témoignent de ce désir de laisser surgir le réel. Une scène de repas filmée d’une traite, avec urgence et sans filet, offre une grande mobilité aux corps et une liberté de création aux acteur·trices qui se retrouvent dans le registre de la performance. Pialat fabrique, met en place les conditions nécessaires pour que le réel s’immisce dans la fiction. Pour le réalisateur, ces moments de vie émergent des failles, des erreurs, des ajustements et des maladresses des acteur·trices. Pialat assumait pleinement la porosité qu’il y a entre la représentation et la vie. Dans ses films, il obtient ce va-et-vient entre vécu et jeu à partir de multiples procédés qu’il fabrique lors des tournages. Dans À nos amours, le réalisateur, qui jouait le père de Suzanne (interprétée par Sandrine Bonnaire), surgit dans une scène alors qu’à ce moment du scénario, son personnage devait être mort. N’ayant informé qu’une personne de l’équipe technique et le personnage de la mère, le malaise est palpable chez les acteur·trices, ce qui confère à la scène une intensité et peut-être une hyperprésence parce que le registre du jeu s’amuse avec la vraie vie. Bien que Pialat aspire à être plus authentique en étant moins théâtral et plus ancré dans la vraie vie, près du documentaire, ce qui m’attire, c’est la fabrication de ces « jeux », de l’artificiel, qui génère quelque chose de vrai, de vivant et d’intime, mais qui n’est pas complètement « réel ». Je pense à Jules Renard qui disait : « L’air qu’on respire a comme un goût mental ».
Katya : En cinéma, le courant dogma tente aussi d’effacer les artifices et les effets spéciaux au profit de la réalité (en optant pour un éclairage naturel, une captation en une seule prise et en temps réel avec le son pris en direct[20]). Ce courant offre un parallèle intéressant avec l’attitude performative que décrit Céline Roux (2007). Non seulement le tournage se déroule (en théorie…) sur une seule prise, donc ici et maintenant, mais en plus, le procédé de la caméra à l’épaule apporte à l’oeuvre cinématographique un effet de réel, renforcé par l’absence d’éclairage spécial et de postsynchronisation. Ces procédés n’en demeurent pas moins des partis pris esthétiques chargés de construire une illusion : les réalisateur·trices du mouvement dogma ne filment pas une scène réelle, mais la créent. Les acteur·trices, même s’il·elles ne jouent (en principe) qu’une fois chaque scène, font « comme si » et incarnent des personnages au service d’une fiction. Le jeu de l’acteur·trice devient alors une performance filmée.
Karina : À propos de la présence, Marguerite Duras parlait ainsi des acteur·trices de son film India Song : « Ils étaient un peu moins présents qu’ils ne l’auraient été s’ils avaient joué. C’est ce moins-là qui compte pour moi, ils ont tous un peu l’air absents, distraits[21] ». Le cinéaste Robert Bresson assume également cette qualité de « sous-jeu » chez ses acteur·trices. L’usage de la fragmentation qui caractérise son esthétique m’inspire énormément : « Elle est indispensable si on ne veut pas tomber dans la représentation » (1975 : 17-18). Jean-Louis Provoyeur souligne les gestes chez Bresson : « Soit le geste signifie immédiatement (prendre ou donner de l’argent, brandir une arme). Soit le plus souvent, il reste élémentaire, neutre, insignifiant. Il s’agit plutôt du degré zéro du geste, un paradigme de mouvements qui constitue le lexique gestuel bressonien » (2003 : 176-177). Ce qui m’intéresse chez ces cinéastes et d’autres (comme Jacques Tati, Antonioni, Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda, Jean-Luc Godard…), c’est la fabrication de ces règles et dispositifs qui génèrent d’autres intensités de présence.
Pour Trisha Brown, ce mode de présence particulier qui consiste à « être là, s’exposer sans artifices, présent comme dans la vie quotidienne, ni plus ni moins, comme dans sa vie privée, dans l’intimité de son chez soi » correspond à « faire acte de présence » (citée dans Roux, 2007 : 167-168). Ce degré zéro de la présence consiste à « être là sur le plateau, comme assis dans le salon » (Bel, dans Wavelet, 2005 : 30), dans un état de corps dénué d’affect. Ce type de présence demande aux danseur·euses un travail qui n’est ni naturel, ni banal.
Katya : Le surgissement du réel sur scène (ou la tentative du surgissement du réel sur scène) est une forme d’écriture scénique. Il est un choix, il est conscient. Cependant, mettre le réel sur scène demeure une entreprise utopique. Le réel n’existe pas sur scène. Dans son analyse de la corporéité spectaculaire, Bernard démontre combien la danse déconstruit tout fantasme de réalité prêté au corps par la tradition philosophique occidentale : « Le corps que l’on nous montre sur scène non seulement n’est pas réel, mais ne peut l’être » (2001 : 87).
Brice : J’ai retranscrit une conférence de Barthes, et une phrase sur l’inadéquation fondamentale du langage et du réel me reste en mémoire : « Le réel n’est pas représentable, et c’est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par des mots qu’il y a une histoire de la littérature » (1978 : 22). En voulant représenter le réel, on crée de la littérature ou du spectacle. Dans mon travail, j’utilise le mot « réel », mais on est à cheval entre le réel et la fabrication. Ça me paraît moins intéressant quand on sait d’avance les rôles qu’on va occuper ainsi que les termes du jeu. Ça devient alors un jeu théâtral qui me fait décrocher. En créant nos jeux, nous tentons de mettre les gens au défi.
En guise de conclusion : la naissance du ou de la spectateur·trice…
Le degré zéro de l’écriture chorégraphique privilégie l’appropriation de l’oeuvre par le public. Moins on en montre, plus on active l’imagination. Il s’agit alors d’ouvrir un cadre, un espace, une temporalité, plutôt que de les remplir. L’enjeu consiste avant tout à partager une expérience au public, notamment à travers l’épreuve du temps. Cela nécessite un regard actif, prêt à remplir lui-même les creux, les trous, les vides, à travers une temporalité qui s’éprouve physiquement. La représentation organise ainsi les conditions d’émergence de la subjectivité, transposant à la scène les principes théorisés en littérature par Barthes (1968) à travers le concept de « la mort de l’auteur » qui renverse le mythe de l’écriture.
Ce degré zéro de l’écriture scénique favorise la naissance du ou de la spectateur·trice[22] comme vecteur d’imaginaires et prolongement de l’oeuvre. Le public s’approprie cette dernière, privilégiant la sensation au Sens, sans toutefois l’annuler ni l’éviter, puisqu’ils sont indissociables. C’est dans le tissage entre corps et langage que se compose la texture de l’oeuvre, qui ne se réduit pas à l’un des deux champs. Cette articulation dynamique – que j’aime considérer comme organique – permet de ne pas fermer la création sur un sens clos, mais de l’ouvrir à une multiplicité de sens. Si le corps est le degré zéro de la danse, l’image le degré zéro de l’art et le signe le degré zéro du sens, alors la notion de « vivant » est sans doute le degré zéro du spectacle, en tant que véhicule de sens(ations).
Épilogue
Il y a quelques semaines, dans le but de me préparer à cette intervention sous forme de « dessert-conférence », Brice me contextualisait ainsi son nouveau projet :
Cette recherche fondamentale prend la forme d’une pratique tentaculaire faite de réflexions, de mouvements et de rencontres. Accompagné par différent·es artistes, je propose des laboratoires ponctués d’interventions d’autres collègues invité·es à enrichir les explorations, en confrontant ou en confortant les axes de recherche. […] En créant des contraintes ou en tendant des pièges au corps et à l’intellect, je tente, avec mes collègues, de rendre la pensée visible et de provoquer des réflexions imprévisibles, émergeant des problèmes créés. […] Nous pourrions [alors] imaginer une parole faite de virages et de demi-tours, de propos qui tourneraient en rond et en spirale, histoire d’épuiser la langue et les concepts qui se cachent derrière les mots pour voir ce qu’il en reste et souligner la négociation entre penser et faire[23].
Brice : Au départ, j’avais formulé mon projet autour de la manipulation du langage à travers la rhétorique. J’ai trouvé des youtubeur·euses fascinant·es qui décortiquent les discours de politicien·nes et les éléments de langage qui sont leurs outils. Le langage exerce une forme d’autorité à travers les règles de la langue. Barthes déclare à ce titre dans une leçon inaugurale de sémiologie littéraire intitulée « La langue est fasciste » :
Parler et à plus forte raison discourir, ce n’est pas communiquer […], c’est assujettir. […] La langue implique une forme d’aliénation, notamment parce que je suis obligé de choisir en français entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits, […] c’est-à-dire que le suspens affectif ou social m’est refusé
(1978 : 13).
Je trouve intéressant de voir combien ces notions de pouvoir sont présentes dans la langue. Et la seule façon de sortir de ce pouvoir, c’est de le subvertir, de travailler contre la langue pour ne pas en être emprisonné·e.
S’est ajouté au dessert une bouteille de vin blanc qui nous a rendu·es un peu moins articulé·es. Le reste est comme un rêve qui échappe au langage…
Parties annexes
Note biographique
Artiste, dramaturge et commissaire, Katya Montaignac crée des « objets dansants non identifiés ». Docteure en études et pratiques des arts, elle enseigne au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal et pour le Regroupement québécois de la danse. Avec Sophie Corriveau, elle crée le projet Nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs qui met en scène les témoignages de quinze danseur·euses issu·es de différentes pratiques (Agora de la danse, 2016; Maison pour la danse à Québec, 2018; Théâtre Aux Écuries, 2019). Outre de nombreux articles pour différentes revues, elle est également l’autrice d’un livre sur Joséphine Baker (2002), la coautrice de l’ouvrage Danse-Cité : traces contemporaines (2009), et elle signe le texte « RE : (se) questionner » (2018) dans le recueil sur le Festival TransAmériques paru aux éditions Somme Toute. En 2019, elle publie, parallèlement à la pièce chorégraphique De la glorieuse fragilité de Karine Ledoyen dont elle signe la dramaturgie, un ouvrage éponyme composé de récits sur le deuil de la danse.
Notes
-
[1]
Ce fut le cas respectivement avec Marie Claire Forté, Nadège Grebmeier Forget et Nicolas Cantin : « Une intimité partageable », Aparté, n° 4, avril 2017; « Cuisiner l’inconfort », Jeu, n° 155, avril 2015; « Poser une main sur sa cuisse. Et ne rien faire d’autre », esse arts + opinions, n° 78, juin 2013.
-
[2]
Ce projet s’est finalement achevé en novembre 2018 sous la forme d’un 5 à 7 convivial intitulé ATTABLER et présenté à l’Agora de la danse.
-
[3]
Témoignage de la danseuse Hanako Hoshimi-Caines, participante aux séminaires in(ter)disciplinaires que j’ai dirigés de novembre 2016 à mai 2017 au sein de La 2e Porte à Gauche alors en résidence à l’Agora de la danse.
-
[4]
Témoignage de la chercheuse Véronique Hudon, participante aux séminaires de La 2e Porte à Gauche de novembre 2016 à mai 2017 à l’Agora de la danse. Sur ce projet, voir aussi Mougeolle, 2016.
-
[5]
Extrait d’un courriel (« A posteriori », 9 mai 2017) de Brice Noeser.
-
[6]
À propos du degré zéro de l’écriture, Barthes parle d’une écriture « amodale » qui se situerait « entre le subjonctif et l’impératif », c’est-à-dire « entre le cri et le jugement » : « Sans participer à aucun d’eux; elle est faite précisément de leur absence; mais cette absence est totale, elle n’implique aucun refuge, aucun secret; on ne peut donc dire que c’est une écriture impassible; c’est plutôt une écriture innocente. Il s’agit de dépasser ici la Littérature en se confiant à une sorte de langue basique, également éloignée des langages vivants et du langage littéraire proprement dit » (1972 : 60).
-
[7]
J’adapte à la danse le concept de « degré zéro » tel que défini par Barthes à propos des « écritures neutres » comme celles de Camus, de Blanchot ou de Queneau : « Comme si la Littérature, tendant depuis un siècle à transmuer sa surface dans une forme sans hérédité, ne trouvait plus de pureté que dans l’absence de tout signe, proposant enfin l’accomplissement de ce rêve orphéen : un écrivain sans Littérature » (1972 : 11).
-
[8]
Entretien avec Marcel Duchamp réalisé par Philippe Collin et tourné à Paris à la Galerie Givaudan en janvier 1967, disponible pour l’écoute à l’adresse suivante : www.ina.fr/emissions/archives-du-xxeme-siecle
-
[9]
J’applique ici à la Danse ce que Barthes avance à propos de la Littérature concernant la recherche utopique d’une forme de degré zéro de l’écriture : « Cette parole transparente […] accomplit un style de l’absence qui est presque une absence idéale du style; l’écriture se réduit alors à une sorte de mode négatif dans lequel les caractères sociaux ou mythiques d’un langage s’abolissent au profit d’un état neutre et inerte de la forme » (1972 : 60).
-
[10]
La « boîte noire » du théâtre – qu’Oskar Schlemmer et Peter Brook nomment respectivement « la boîte optique » (1978 : 50) et « l’espace vide » (1977) – opère une césure spatio-temporelle par rapport à la réalité : privé de la lumière extérieure, le public perd la notion du temps et entre plus facilement dans une fiction ou, du moins, dans un espace-temps neutralisé, comme suspendu pendant le temps de la représentation.
-
[11]
Céline Roux (2007) désigne par le terme « danses performatives » des oeuvres polymorphes et transdisciplinaires qui, dans le champ chorégraphique, inscrivent une distance critique face à la notion de représentation. En lien avec la « performativité » du langage définie par John Austin (1970) comme un énoncé qui opère au moment même où il se prononce – Quand dire, c’est faire –, la performativité d’une action opère dans l’ici et maintenant. Le mouvement scénique « performe » ainsi au sens où il agit dans le cadre même de son contexte de (re)présentation.
-
[12]
C’est précisément parce que la temporalité se prolonge à travers l’immobilité que le public finit par imaginer malgré lui certains liens.
-
[13]
« Disorganize yourself and at times go slower. Art gives the opportunity for boredom and questions. It gives the opportunity to move from not seeing to seeing / from not understanding to understanding. And the audience can catch themselves in the act of doing it – moving from not understanding to understanding. Art can reorganize us ». Cette citation, partagée par courriel après le souper et traduite par mes soins, est tirée d’une entrevue avec Alva Noë, dans le cadre du colloque « L’art comme cognition incarnée » organisé par Hexagram, Université du Québec à Montréal, 17 mars 2017 (vimeo.com/214438467). Dans son livre, Strange Tools: Art and Human Nature (2015), ce philosophe spécialiste en sciences cognitives soulève les questions suivantes : qu’est-ce que l’art? Pourquoi est-il important pour nous? Que nous dit-il sur nous-mêmes? En s’appuyant sur la philosophie, l’histoire de l’art et les sciences cognitives, Noë souligne le pouvoir de transformation de l’art. L’art est un mode de recherche, un outil étrange, un défi qui ne vise pas la satisfaction, mais la confrontation, l’intervention et la subversion. Par exemple, la danse nous révèle comment le mouvement nous organise et la peinture va au-delà de la représentation pour questionner le rôle des images dans nos vies.
-
[14]
D’après un documentaire réalisé par Jean-Claude Labrecque en 1982, disponible à l’adresse suivante : www.onf.ca/film/marie_uguay
-
[15]
L’utilisation des parenthèses dans le titre de l’ouvrage de Roland Huesca (2010), L’écriture du (spectacle) vivant, souligne l’idée selon laquelle tout spectacle consiste à mettre en scène le « vivant » en le convoquant ou en l’engageant.
-
[16]
Michel Bernard préfère au terme « corps » la notion de « corporéité », « dont la connotation abstraite et indéfinie [lui] paraît plus adéquate à l’expérience ambiguë que vous vivons et que l’art contemporain – au premier chef, la danse – contribue à nous dévoiler » (2001 : 225-226).
-
[17]
Pour le kinésiologue Hubert Godard, la posture érigée présente ainsi un lieu d’inscription précédant (et teintant) le mouvement à travers « des éléments psychologiques, expressifs, avant même toute intentionnalité de mouvement ou d’expression. Le rapport avec le poids, c’est-à-dire avec la gravité, contient déjà une humeur, un projet sur le monde » (1998 : 224).
-
[18]
Pour Alain Badiou, la danse s’inscrit dans la « virginité » de l’espace : « Le décor est de théâtre, non de danse. La danse est le site tel quel, sans ornement figuratif » (1998 : 101).
-
[19]
Expérimenté par les performeur·euses et danseur·euses postmodernes américain·es, cet état scénique s’est radicalisé chez certain·es créateur·trices contemporain·es comme Grand Magasin ou encore Philippe Quesne en théâtre, au point de devenir un mode de présence récurrent – qui constitue une nouvelle convention – dans les oeuvres chorégraphiques issues du courant performatif.
-
[20]
En 1995, les réalisateurs danois Lars Von Trier et Thomas Vinterberg ont signé un « voeu de chasteté » en guise de manifeste artistique. Inspirées par les figures dissidentes des années 1960 telles que Jean-Luc Godard, leurs démarches s’inscrivent en réaction aux grosses productions de l’industrie cinématographique et à ses procédés technologiques (filtres, trucages, maquillages, effets spéciaux, etc.) : « [Leur] but avoué est de contrer certaines dérives du cinéma contemporain » qui visent à « tromper le public » à travers « des illusions servant à communiquer des émotions » chargées « de pathos et d’amour » (Björkman, 2000 : 161).
-
[21]
Pour entendre Marguerite Duras à propos de son film India Song, et plus précisément l’extrait dont il est question dans l’article (à 7:57 minutes), consulter la page suivante : youtu.be/uroVKwFhtfs
-
[22]
Barthes souligne : « Un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation; mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à présent, c’est le lecteur : le lecteur est l’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture » (1968 : 45).
-
[23]
Extrait d’un courriel (« Autour de ma recherche », 10 avril 2018) de Brice Noeser.
Bibliographie
- AUSTIN, John L. (1970 [1962]), Quand dire, c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil, « Points essais ».
- BADIOU, Alain (1998), « La danse comme métaphore de la pensée », dans Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, « L’Ordre philosophique », p. 91-111.
- BARTHES, Roland (1984 [1968]), « La mort de l’auteur », dans Le bruissement de la langue : essais critiques IV, Paris, Seuil, « Essais littéraires », p. 61-67.
- BARTHES, Roland (1978), Leçon, Paris, Seuil.
- BARTHES, Roland (1977), Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, « Tel Quel ».
- BARTHES, Roland (1972 [1953]), Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, « Points essais ».
- BERNARD, Michel (2001 [1955]), « Danse et texte : danseurs et tenseurs ou pour une lecture chorégraphique des textes », dans De la création chorégraphique, Pantin, Centre national de la danse, p. 125-135.
- Björkman, Stig (2000), Lars von Trier : conversation avec Stig Björkman, trad. Marie Berthelius, Paris, Cahiers du cinéma.
- BRESSON, Robert (1975), Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, « Blanche ».
- BROOK, Peter (1977), L’espace vide : écrits sur le théâtre, Paris, Seuil.
- CHARMATZ, Boris et Isabelle LAUNAY (2002), Entretenir : à propos d’une danse contemporaine, Pantin, Centre national de la danse; Dijon, Presses du réel.
- CUNNINGHAM, Merce (1980), Le danseur et la danse : entretiens avec Jacqueline Lesschaeve, Paris, Belfond, « Entretiens ».
- GODARD, Hubert (1998), « Le geste et sa perception », dans Isabelle Ginot et Marcelle Michel (dir.), La danse au XXe siècle, Paris, Larousse-Bordas, p. 224-229.
- GOUMARRE, Laurent (2002), « Pour une esthétique de la posture », Art Press, no 282, p. 41-44.
- LAUNAY, Isabelle et Christine ROQUET (2008), « De la posture à l’attitude : ou ce qu’un danseur peut dire aux hommes politiques », dans Posture(s), imposture(s), Vitry-sur-Seine, Musée contemporain du Val-de-Marne, p. 80-89.
- LOUPPE, Laurence (1997), Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, « La pensée du mouvement ».
- MALLARMÉ, Stéphane (1945), « Ballets », dans Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, vol. 1 (« Crayonné au théâtre »), p. 303-307.
- MOUGEOLLE, Marie (2016), « Le collectif comme mode d’intervention : Perturbations de La 2e Porte à Gauche », L’Annuaire théâtral, n° 60, p. 75-89.
- PROVOYEUR, Jean-Louis (2003), Le cinéma de Robert Bresson : de l’effet du réel à l’effet du sublime, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels ».
- ROUX, Céline (2007), Danse(s) performative(s) : enjeux et développements dans le champ chorégraphique français, 1993-2003, Paris, L’Harmattan, « Le corps en question ».
- SCHLEMMER, Oskar (1978), Théâtre et abstraction, trad. Éric Michaud, Lausanne, L’Âge d’homme.
- SIEGMUND, Gerald (2002), « Entretien avec Jérôme Bel », Ballet international / Tanz Aktuell, www.jeromebel.fr/index.php?p=5&cid=201
- WAVELET, Christophe (2005), Entretien avec Jérôme Bel, transcription réalisée par Katya Montaignac, Pantin, Centre national de la danse, DVD.
Liste des figures
Illustrations du duo Ruminant Ruminant créé et interprété par Karina Iraola et Brice Noeser.