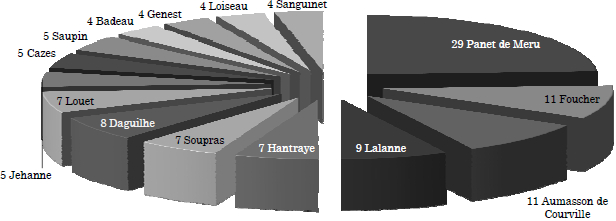Résumés
Résumé
Le débat historique et juridique sur le droit applicable au moment de la Conquête a fait couler beaucoup d’encre depuis les travaux des années 1970. L’objectif de cette publication est d’appréhender la part prise par les notaires et la pratique arbitrale dans la « confrontation » supposée entre le système juridique de common law et la tradition juridique civiliste en matière de droit privé. Alors que certains historiens évoquent une « résistance passive » durant les années 1760-1774 de la part des populations face au droit anglais qui leur serait imposé, il semble, au regard des résultats de cette recherche, qu’il existe plutôt une « collaboration active » entre les praticiens du droit de tradition juridique française d’une part, et les juridictions et administrateurs britanniques d’autre part. Si les tenants de la « résistance passive » sont d’avis que les notaires permirent en partie la « survivance » du droit français, il semble que cette préservation des normes françaises, constatée de manière marquante ici, exprime une relation confluente entre système juridictionnel et pratique conventionnelle du droit, entre tradition judiciaire britannique et normes de droit privé françaises. La pratique arbitrale, outil de cette conciliation, s’est imposée naturellement aux protagonistes de cette période, essentiellement en raison de la proximité des mécanismes et des modes d’exécution de cette pratique en common law et en droit français. Pont entre les deux systèmes, elle permet de trancher en amont et en aval de l’Acte de Québec le noeud gordien de la confrontation des traditions juridiques.
Abstract
Questions surrounding Quebec law at the time of the British Conquest resulted in lively historical and legal debates since the 1970s. The purpose of this study is to assess the role of notaries and arbitration in the supposed “clash” between a common law justice system and a civilian private law tradition. While some historians have put forward a “passive resistance” thesis on the part of populations affected by the imposition of British law between 1760 and 1774, the results of this study show that there is, in fact, evidence of “active collaboration” between French legal practitioners on the one hand and British officials on the other hand. If the proponents of the “passive resistance” theory posit that the notaries contributed in part to the “survival” of French law, it seems that the preservation of French legal norms, clearly visible here, is the expression of a convergent relationship between jurisdictional system and customary practice of law, between British judicial tradition and French private law norms. The protagonists of this period were naturally drawn to arbitral practice, a tool for this conciliation, essentially because of the similarities between the mechanisms and methods of execution in the common law and French law. As a bridge between these two systems, one could say that both before and after the Quebec Act, arbitration was the stroke that cut through the Gordian knot of clashing legal traditions.
Corps de l’article
Introduction
Après la fin des combats en Amérique du Nord et la capitulation de Montréal en 1760, le changement de puissance coloniale occasionne immédiatement des répercussions sociales, économiques et militaires dans la vie quotidienne de la majorité des Canadiens. Le régime militaire mis en place, qui prendra fin avec la Guerre de Sept ans en 1763, laisse toutefois les questions juridiques en suspens. Craignant pour leur avenir, les administrateurs français — conseillers au Conseil supérieur, juges, hauts fonctionnaires de l’administration coloniale — repartent pour une bonne part en France, où ils sont contraints de rendre des comptes sur leur gestion[1]. Le notariat constitue l’une des seules institutions qui traversent cette période transitoire sans quasiment aucune altération[2]. Il devient, dès lors, un point d’ancrage pour les populations, mais aussi pour les institutions nouvelles qui perçoivent, dès le régime militaire, l’avantage qu’elles peuvent retirer en s’appuyant sur ces hommes de loi. C’est d’ailleurs durant le régime militaire, soit de 1760 à 1764, que les notaires québécois sont reconnus pour la première fois comme un corps professionnel, uniquement dans le district de Trois-Rivières toutefois[3]. Ailleurs, dans la province en formation, ils obtiennent des commissions particulières ou continuent à exercer leurs fonctions sans commissions officielles. À partir de 1765, le cumul de charges le plus répandu est celui de notaire et d’avocat, cette dernière profession étant introduite par le régime civil britannique, après une quasi-interdiction sous le régime français[4]. Dans les deux centres urbains que sont Québec et Montréal[5], presque tous les notaires plaident. Ils reprennent en cela l’héritage du régime français, où les notaires faisaient figure de représentants des parties, comme praticiens, grâce aux procurations qu’ils recevaient[6].
Sur les questions d’héritage ou de conflits juridiques entre les deux grandes communautés, l’historiographie, divisée il y a cinquante ans alors que s’opposaient les écoles dites de Montréal et de Québec[7], tend désormais à rapprocher pour partie les points de vue et les sensibilités. Ainsi, Donald Fyson a démontré brillamment que les francophones ont eu recours aux institutions britanniques provinciales et locales (notamment les jurys d’accusation et de jugement) dans un esprit de concorde, plutôt que dans une perspective conflictuelle[8].
André Morel, l’un des pionniers de l’histoire du droit au Québec, a publié en 1960 un article qui fera date sur « [l]a réaction des Canadiens devant l’administration de la justice de 1764 à 1774 », l’interprétant comme « [u]ne forme de résistance passive »[9]. Prolongeant les travaux de Michel Brunet[10], il souligne le décalage inévitable entre norme et pratique[11]. Il remarque que si la Proclamation royale de 1763 semble imposer l’application du droit anglais, les témoignages des contemporains semblent attester d’une persistance du recours, par les praticiens et les nouveaux sujets, aux règles du droit privé français[12]. Toutefois, Morel constate qu’il existe des « témoignages à l’effet que les tribunaux étaient tenus, de façon presque systématique, à l’écart des contestations »[13], notamment par le recours à l’arbitrage, essentiellement sous l’égide des prêtres et des notaires[14]. Les témoignages des administrateurs et le très faible nombre d’affaires de famille soumises à l’attention des juges de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal lui permettent de conclure à un boycottage des institutions judiciaires britanniques[15]. Selon André Morel, il s’agit là d’une forme de résistance passive qui, sans être concertée, se traduit par un « recours régulier à l’arbitrage »[16]. Contredisant cette analyse, Jean-Philippe Garneau voit dans les travaux d’André Morel l’expression d’une vision trop positiviste des choses[17]. Il regrette que Morel ne se soit pas davantage attaché aux rapports entre praticiens et familles, estimant trop réductrice la dialectique norme et pratique[18] et déplorant l’absence d’étude des fonds notariés. Dans les travaux qui font suite à cet article, Jean-Philippe Garneau met en exergue l’arbitrage ou le règlement des différends devant notaires[19] soulignant, en nuançant sa critique, que :
le professeur Morel ne disposait pas alors de certaines facilités de recherche (comme les banques de données notariale ou judiciaire) ou d’un accès aisé et complet aux sources judiciaires de cette période. D’ailleurs, notre critique va bien plus à l’absence de travaux en histoire du droit qui fait que des hypothèses vieilles de plus de quarante ans prévalent encore en histoire du droit [...][20].
Ainsi, l’implication des notaires québécois dans les modes alternatifs de résolution des différends n’est pas ignorée[21], même si elle est discutée. Si plusieurs publications d’importance, notamment les travaux d’André Vachon ou ceux de Julien S. MacKay[22], ont permis de mieux connaître la profession des notaires québécois dans une perspective historique, leur rôle de médiateur ou d’arbitre est souvent oublié par les juristes[23], tant en France[24] qu’au Québec[25]. Ce fait nous incite à aborder l’arbitrage à travers les greffes des notaires, outil précieux permettant de connaître en détail l’activité des professionnels de l’époque[26].
La base de données Parchemin, qui recense l’ensemble des fonds notariés de l’époque de la Nouvelle-France jusqu’en 1784, recense 380 documents renvoyant à des actes d’arbitrages (procès-verbaux d’arbitrage, sentences arbitrales, acte arbitral)[27] sur la période de 1626 à 1784. Ce faible nombre s’explique en raison du fait que peu d’arbitrages revêtent un caractère officiel et juridiquement constaté. Ce n’est donc, bien évidemment, qu’une facette de ce phénomène qui peut être appréhendée par le biais des études de notaire[28], la part des arbitrages oraux ou faits par d’autres notables reste difficile à caractériser[29].
Le nombre de notaires en 1775 est en légère augmentation par rapport au régime français[30]. Au sein de ce groupe social, malgré un ensemble très divers, des caractéristiques communes s’affirment néanmoins : ils sont soit nés et formés en France, soit nés en France — plus rarement en Nouvelle-France — puis formés au sein de la pratique coloniale. Si un examen par les pairs semble avoir été exigé, aucun véritable diplôme n’est requis. C’est donc la pratique qui garantit la qualité du praticien[31], celle-ci complétant bien souvent quelques lettres classiques[32]. Il en découle une certaine disparité dans la connaissance des lois et coutumes, et la culture juridique d’un notaire peut aller du simple bon sens jusqu’à une véritable scientia juris pour de rares élus urbains[33]. La pratique en région fait alors figure de galop d’essai pour les notaires peu au fait des us et coutumes juridiques. Le notaire occupe une place centrale dans la vie juridique de la Nouvelle-France, puis de la province de Québec, comme praticien à la fois installé et reconnu par le pouvoir. Il est également l’un des rares notables capables de représenter les communautés d’habitants, au côté des capitaines de milice[34] et des prêtres, notamment dans le monde rural.
La connaissance du droit appliqué au moment de la Conquête, si elle a connu des avancées — notamment en droit criminel[35] — est encore marquée par une certaine controverse[36]. On a longtemps considéré — surtout parmi les juristes — que, suite à la Proclamation royale, l’ordonnance du 17 septembre 1764 avait introduit d’un seul mouvement le droit privé, public et criminel anglais[37]. Pour certains auteurs, cette période est marquée par une application forcée du droit privé britannique, comme semblent le montrer certaines pétitions et témoignages d’époque[38]. Un autre courant historique relevait au contraire le maintien des règles du droit civil français dans la pratique[39]. Récemment, les travaux de Donald Fyson et Jean-Philippe Garneau, notamment, ont conclu à la mise en place d’un système hybride[40], même si la perception positiviste, au regard des textes officiels essentiellement, supporte davantage l’hypothèse d’un passage au droit privé britannique durant la période 1764-1774[41].
Dans la perspective historico-juridique, l’arbitrage, dont André Morel avait relevé l’utilisation, permet de régler des différends hors du cadre judiciaire, sur une autre base juridique, en faisant notamment appel aux notaires. Le recours à l’arbitrage notarié constitue alors une pratique juridique permettant semble-t-il la mise en place du nouveau système juridique. Concrètement, l’administration anglaise garde sa confiance dans la profession notariale et comprendra rapidement que ces juristes peuvent servir de point d’ancrage à une nouvelle tradition juridique en formation, plus efficacement que des juristes formés exclusivement à la common law. Les juridictions britanniques et les administrateurs n’hésitent alors pas à faire participer ces derniers à des activités judiciaires ou parajudiciaires, telles que les convocations d’assemblées de parents ou l’établissement de terrier, afin d’affermir la propriété foncière. Ces notaires obtiennent généralement tous une nouvelle commission au moment de la Conquête[42]. Par le biais de la procédure arbitrale, héritage commun aux deux ensembles normatifs, les notaires vont assurer en pratique un maintien de la tradition juridique française, avant de participer à la formation d’un droit original, formé de l’amalgame des traditions civilistes et de common law. Il faut toutefois souligner que le recours au terme « arbitrage » pour cette période ne correspond pas aux canons de la terminologie moderne[43], les distinctions entre médiation, arbitrage, conciliation et expertise étant largement caduques pour ce contexte[44].
Si le passage au régime civil avait pu laisser supposer que les notaires allaient devoir s’adapter à la forme britannique du notaire public, il n’en est rien et la forme française fut conservée. Même nommés par le pouvoir britannique sous la forme anglaise, ils ont assuré leurs fonctions selon la Coutume de Paris et en respectant ses formes. La fin de la période militaire et les premières années de la période civile britannique montrent une très forte augmentation du nombre d’actes d’arbitrage[45]. La pratique arbitrale au moment de la Conquête constitue la résonance d’une adaptation au nouvel environnement juridique. L’arbitrage devient un outil idoine pour une population sous un nouveau régime et pour un pouvoir pragmatique, pouvant tous tirer parti de la plasticité de la technique arbitrale.
Deux niveaux de lecture peuvent expliquer le recours aux modes de prévention et règlement des différends par les notaires : à travers l’arbitrage, les notaires exploitent un outil existant dans des formes similaires dans les systèmes français (IA) et anglais (IB). Ceci permet un maintien de la tradition juridique française dans une période où une certaine ambiguïté existe au regard du droit applicable (II). De plus, l’intelligence des administrateurs et des juridictions britanniques permet une intégration forte de la pratique arbitrale au sein du processus judiciaire, menant ainsi à la conciliation des traditions et des systèmes juridiques différents (III).
I. Les différentes expressions de la lex arbitraria : Un pont entre les cultures juridiques
L’intérêt de la procédure arbitrale est d’autant plus fort qu’elle existe, dans des termes proches, au sein des deux traditions juridiques, civiliste et de common law. Dans cette perspective, l’arbitrage figure, à bien des égards, comme l’outil idéal permettant le passage d’un système juridique d’origine européenne relativement homogène à un véritable système juridique colonial mixte.
A. La tradition juridique arbitrale française
La pratique arbitrale est avérée depuis longtemps en France, où elle se répand surtout à partir du douzième siècle[46]. La réalité et le développement de la pratique sont largement étayés par des études portant aussi bien sur les pays du Sud, de droit écrit[47], que pour le Nord de la France, de tradition coutumière[48]. L’ordonnancement normatif législatif de l’ancien droit favorise le recours à cette pratique[49]. L’ordonnance d’avril 1667 fait ainsi référence brièvement à l’arbitrage[50]. Elle consacre en outre plusieurs articles aux experts[51]. En théorie, le rôle de l’expert est distingué de celui de l’arbitre, mais dans la pratique, les deux sont souvent confondus[52]. Dans le contexte de la Nouvelle-France, un règlement enregistré au Conseil souverain en 1667, mais peu appliqué, enjoint même le recours à l’arbitrage comme une condition préalable à certaines demandes en justice :
Qu’avant qu’aucune partie plaignante ou aucun demandeur habitant des côtes puisse se pourvoir en justice à Québec, par voie de procédure, il tentera la voie de la composition à l’amiable, en sommant sa partie par un voisin ou deux dignes de foi, de remettre ses intérêts à un ou plusieurs arbitres, ou à la décision du capitaine de quartier, en matière de peu au-dessous de quinze livres, de légère querelle, débats ou injures proférées[53].
Pour les auteurs de l’ancien droit français, l’arbitrage apparaît comme un mode particulièrement satisfaisant de résolution des conflits. Il prend place dans un cadre naturel et fait appel à la loi commune des hommes. Comme le souligne Gaspard de Réal :
Il est manifeste que, par le droit naturel, tous les différends entre des personnes indépendantes doivent être soumis à des arbitres. [...] Le jugement de l’arbitre, dans l’état de liberté naturelle, doit être une Loi souveraine pour les deux parties ; car cet état ne connoît ni les appels, ni les procédures, ni les autres formes que les Sociétés civiles ont introduites[54].
C’est notamment Jean Domat[55], un penseur fidèle à la tradition jusnaturaliste, qui développe ce thème d’un point de vue théorique avec le plus d’ampleur. Il se trouve alors cité dans les différents Dictionnaires et Recueils juridiques accessibles en Nouvelle-France[56]. L’arbitrage, garantissant un faible coût de résolution du différend et une certaine célérité, représente une voie procédurale avantageuse comparée à celle de la justice étatique.
Ainsi Bouchel[57], Jousse, Couchot ou Henrys se font les laudateurs de la pratique arbitrale. Le second soutient notamment qu’ « on peut compromettre en général de toutes choses qui peuvent être le sujet d’un procès »[58], alors que pour Couchot, « [t]ous ceux qui sont en état de procéder de leur chef pardevant les Juges ordinaires, ont la liberté de se soumettre à l’arbitrage, et on compromet sur toutes sortes d’affaires, pourvu que le Roi et le public n’y ayent aucun intérêt »[59]. Les possibilités de recourir à l’arbitrage paraissent donc très étendues et Claude Henrys n’hésite pas à proclamer que « les arbitrages sont une des plus belles parties de la fonction des avocats »[60]. La confidentialité, l’absence de publicité, la rapidité, la souplesse et l’économie sont des arguments de poids en faveur de cet outil transactionnel. Ce sont les mêmes atouts qui font de la pratique arbitrale une clé de la procédure en common law, tant au Royaume-Uni qu’en Amérique du Nord. Comme dans le droit français, ce sont les domaines du droit commercial[61] et des affaires de famille[62] qui font le plus l’objet d’arbitrages.
B. La tradition juridique arbitrale anglo-saxonne
La pratique arbitrale se développe très tôt dans les moeurs juridiques anglaises[63]. Durant le Haut Moyen-Âge anglais, le processus de conciliation s’est largement développé et avait pour but davantage de réconcilier que de juger. L’institution médiévale du « loveday » — opposée à celle des « lawdays »[64] — est ainsi apparue. Dès cette époque, comme le souligne Douglas Hurt Yarn, apparaissent des cas d’arbitrage prolongeant des causes pendantes, les solliciteurs ayant parfois introduit le litige afin d’obliger les autres parties à l’arbitrage, de renforcer leur position dans celui-ci ou simplement de mettre un terme au conflit[65]. Après cette période, c’est dans le monde des marchands que l’arbitrage se développe de la manière la plus flagrante[66]. Fondée sur la bonne foi contractuelle, la lex mercatoria se trouvait naturellement ouverte à la résolution amiable des différends. On en trouve trace dans la pratique britannique dès le treizième siècle[67] et elle se situe au coeur de la résolution des conflits commerciaux en common law[68]. Exercée en marge du système judiciaire institutionnel étatique, la résolution amiable des différends s’exprime en premier lieu dans les cours des foires — dites des « pieds poudrés » (piepowder)[69] — car les marchands avaient encore la poussière des champs sur leurs pieds lors du prononcé de la sentence. Au sein de ces juridictions, l’arbitrage s’impose comme un outil indispensable, car rapide et relativement souple formellement. En 1353, les lois concernant les produits de base (notamment le Statute of Staples) peuvent être considérées comme une reconnaissance législative de l’arbitrage dans ce contexte[70]. À cette époque, marchands et juridictions trouvèrent leur intérêt dans l’arbitrage. Pour les premiers, la souplesse et la rapidité de la procédure sont source d’économies. Pour les secondes, l’arbitrage évite un engorgement et complète judicieusement le processus judiciaire[71]. Dès le Moyen-Âge, on trouve, outre les arbitrages extrajudiciaires, des arbitrages « juridictionnels »[72], c’est-à-dire intervenant lors d’un litige pendant devant une cour de justice[73], comme c’est le cas dans le droit français et dans le contexte de la Conquête. Dans cette pratique, le compromis a d’abord pris la forme d’un acte authentique (deed), soit un document scellé. Celui-ci comporte l’obligation de se soumettre à l’arbitrage et d’exécuter la sentence, car une entente orale à ce sujet n’est pas reconnue par les cours royales. En cas d’inexécution du document, les recours sont limités. La contestation initiale peut toujours être tranchée par une cour de justice, ce qui rend difficile la preuve d’un préjudice tangible pour la partie qui souhaitait procéder devant des arbitres. Avec le temps, les juristes demandent plutôt à chaque partie de remettre à l’autre une obligation conditionnelle de payer une somme fixe, qui est constatée dans un acte authentique (conditioned bond)[74].
Au dix-septième siècle, les juridictions continuent de renvoyer à l’arbitrage les contestations portées devant elles, à la demande des parties. Comme le souligne Stewart Kyd, cette procédure se trouve essentiellement employée dans les litiges commerciaux, en raison de la complexité des questions traitées, particulièrement pour l’apurement des comptes :
[W]hen mercantile transactions came to be frequently the subject of discussion in the courts, it was soon found that a judge and a jury were very unfit to unravel a long and intricate account, and did therefore became a practice, in cases of that kind, and others which seemed to be proper for the same tribunal, to refer the matters, by consent of the parties, under a rule of nisi prius, which was afterwards made a rule of that court out of which the record proceeded, and performance of the award was enforced by process of contempt[75].
De manière générale, la pratique en matière d’arbitrage en common law est suffisante pour que plusieurs auteurs, dont Kyd, John March[76] et l’auteur de l’Arbitrium Redivivum, consacrent des traités à la matière. On trouve en effet de nombreuses causes, tant commerciales que civiles, soumises à l’arbitrage, tant devant les cours londoniennes que lors des assises régionales. Ainsi, comme le souligne l’auteur du Arbitrium Redivivium, « [a]rbitrament is much esteemed and greatly favoured in our common law ... »[77]. Dès les années 1650, la Cour des plaidoyers communs renvoie à l’occasion des parties vers l’arbitrage en rendant une ordonnance (rule of court), parfois en usant envers les plus récalcitrants de l’emprisonnement, lorsqu’ils refusent de se soumettre à celle-ci ou d’exécuter la sentence[78]. Hors des litiges soumis aux juridictions, il semble que les justiciables aient favorisé la pratique arbitrale en amont de tout contentieux, dans des out-of-court arbitration. De nombreux actes témoignent, au dix-septième siècle, de la volonté des parties de souscrire à des obligations (bonds) prévoyant une peine pour la partie qui refusera le recours à l’arbitrage et ses résultats[79], dans la même logique que l’ancien droit français. Henry Horwitz et James Oldham rapportent par exemple l’acte entre Thomas Tookie et Thomas Atwood en 1697, deux marchands londoniens qui acceptent de soumettre tout différend à l’arbitrage, posant comme peine la somme de cinq cents livres afin d’exécuter « the award, order, arbitrament, final end and determination » formés par deux autres citoyens londoniens[80].
Lord Mansfield et John Locke[81] vont contribuer à la consécration statutaire de la pratique arbitrale à travers l’Arbitration Act[82] de 1698. Selon les termes de ce texte, les parties peuvent stipuler dans leur compromis que celui-ci sera entériné par le tribunal, si l’une d’elles produit une déclaration sous serment souscrite par l’un des témoins à l’acte (affidavit). Le renvoi à l’arbitrage est alors ordonné par la Cour (rule of court). En cas de refus d’exécuter la sentence, la partie en défaut peut être condamnée pour outrage au tribunal et emprisonnée, sauf si la décision a été obtenue par corruption ou par des méthodes indues[83]. Si la loi anglaise sur l’arbitrage a pour but de promouvoir le commerce, son champ d’application apparaît beaucoup plus vaste. En effet, il englobe tous les « Merchants and Traders, or others, concerning Matters of Account or Trade, or other Matters »[84], à condition toutefois qu’il s’agisse d’un recours fondé sur un droit personnel, par opposition à la revendication d’un bien réel (real estate). À cette époque, on trouve la même plasticité terminologique en anglais, où nous trouvons les termes arbitrament ou award[85], qu’en français, avec les termes suivants : sentences arbitrales, arbitrage, conciliation, résolution, etc. La pratique ne distingue pas de manière très rigoureuse le recours à l’un ou l’autre terme[86]. Matthew Bacon, un juriste ayant largement contribué, par son Compleat Arbitrator, à l’affirmation de la pratique au dix-huitième siècle, semble noter un développement de l’arbitrage dans le cadre des litiges soumis aux tribunaux à partir de l’Arbitration Act[87]. Blackstone, quant à lui, rend compte de ce phénomène dans un contexte moins restreint :
Arbitration is where the parties, injuring and injured, submit all matters in dispute, concerning any personal chattels or personal wrong, to the judgment of two or more arbitrators; who are to decide the controversy: and if they do not agree, it is usual to add, that another person be called in as umpire, (imperator) to whose sole judgment it is then referred: or frequently there is only one arbitrator originally appointed. This decision, in any of these cases, is called an award[88].
Comme dans le contexte français[89], les juges ne font pas preuve d’hostilité à l’égard de cette procédure, à l’image de Lord Mansfield qui use largement de cette technique dans l’exercice quotidien de la justice[90]. La pratique se présente alors comme une solution souple nécessitant peu d’intervenants. C’est également une solution apte à terminer le différend, distinguant les references et les arbitrations. Les premières consistent en un renvoi, lorsqu’une juridiction est saisie, à un mode moins formaliste de règlement des différends, avant le procès. Les secondes consistent en la saisie, par les parties elles-mêmes, en dehors d’un contentieux, de tierces personnes aptes à trancher le différend naissant, la loi de 1698 autorisant l’homologation du compromis par la cour. En ce qui concerne les arbitres, comme en Nouvelle-France, ils se répartissent en trois catégories : les notables locaux, les voisins et les experts[91]. À cet égard, comme en France, un grand nombre d’arbitrages semble destiné à évaluer ou délimiter des biens, sans qu’une véritable question juridique soit tranchée. Dans les deux systèmes de droit, on trouve les mêmes caractéristiques de la pratique arbitrale : un volontarisme des parties, la confiance, l’existence de l’arbitrage volontaire, soit prévu par clause au contrat, soit décidé postérieurement à un différend, ainsi que l’arbitrage faisant suite à une procédure judiciaire. Deux arbitres — parfois un tiers arbitre — étant juristes, notables proches ou voisins ont le pouvoir de trancher le différend. Dans les deux systèmes, une sentence arbitrale met fin en principe à celui-ci, une clause prévoyant généralement que si l’une des parties conteste la décision devant la cour, elle perdra la somme d’argent généralement mis en gage au moment de la signature du compromis ou sera redevable de la peine pécuniaire prévue dans le contrat. La logique transsystémique de cette pratique est donc relativement forte et cohérente, notamment avec l’usage commercial qu’il en est fait en Europe. Ainsi, en citant James Oldham, si « [a]rbitration is, of course, as old as the hills »[92], on peut penser de même que cette tradition juridique se trouvait autant adaptée au contexte colonial qu’au contexte européen, les atouts de cette pratique se trouvant même amplifiés dans les colonies.
En Amérique du Nord, l’arbitrage figure en première ligne des modes non juridictionnels de résolution des différends, sans se cantonner aux questions commerciales. Tout comme en Europe, la sphère du droit privé s’ouvre en effet de plus en plus à cette pratique au dix-septième et surtout au dix-huitième siècle. Les études sur la pratique arbitrale avant et après la Révolution américaine sont nombreuses et fouillées. Elles apportent un éclairage important sur l’utilité de l’amiable composition dans le contexte colonial bien spécifique de cette période : la pratique arbitrale au Connecticut[93], au New Jersey[94], dans l’État de New York[95], en Pennsylvanie[96], au Massachusetts[97] ou dans le New Hampshire[98] a été analysée, laissant apparaitre les particularismes coloniaux de cet outil[99].
Dès les années 1640, des pratiques arbitrales sont couramment attestées dans le Rhode Island, le Connecticut, la Nouvelle-Angleterre, le New Hampshire et en Virginie[100]. Lorsque la Nouvelle-Amsterdam est devenue anglaise, la Cour de New York n’a fait que perpétuer une pratique antérieure, présentée comme la continuité d’une tradition hollandaise incitant les juges à renvoyer les causes complexes à l’arbitrage[101]. On retrouve, dans ce contexte, la pratique des references et des arbitrations sous l’administration hollandaise, puis sous l’administration britannique[102]. Ainsi, dans l’État de New York, un fort pragmatisme préside à l’incorporation des pratiques hollandaises dans les nouveaux standards britanniques, qui annoncent l’attitude des administrateurs britanniques dans la province de Québec[103]. Dans l’évolution de la pratique new-yorkaise, le recours à l’arbitrage est fréquent, tant à l’initiative des juridictions que par le biais de clauses arbitrales. Une certaine pression sociale semble même se faire jour à partir des années 1730, afin de régler au plus vite les litiges commerciaux. Les juristes jouent alors un rôle accru dans la résolution de ces litiges[104]. La pratique du renvoi (reference) est même actée dans l’ordonnancement juridique de la Supreme Court of Judicature par An Act for the better Determination of personal Actions depending upon Accounts[105]. On peut souligner que, selon Eben Moglen, les affaires soumises à l’arbitrage de 1758 à 1762 sont traitées en moins de quatre semaines, ce qui représente généralement un peu moins de la moitié du temps requis pour qu’un jury se prononce[106].
Lorsque la pratique arbitrale se trouve être totalement dans les mains des colons d’origine britannique, elle semble se développer en conservant un fort héritage anglo-saxon. Toutefois, la souplesse et l’adéquation sociale du phénomène arbitral semblent faire apparaître des caractéristiques qui transcendent tant l’espace que le temps. Comme le soulignait Zephania Swift, juriste du Connecticut, l’arbitrage consiste dans « an amicable and neighbourly mode of settling personal controversies »[107] et se trouve donc en phase avec toute société qui connaît ce type de différend, révélant les mêmes avantages :
[Arbitrators] are not tied down to the same strictness, formality and precision as courts of law. While they have greater latitude in the mode of proceeding than courts of law, they have ampler powers to do compleat and perfect justice between the parties in the decision of the matters of dispute[108].
La liberté semble là encore un point essentiel dans le recours à l’arbitrage. L’arbitrage apparaît plus régulièrement dans les dernières décennies du dix-septième siècle. Ainsi, au Connecticut, les actes d’arbitrage mentionnés dans les pétitions soumises à la General Assembly dans le cadre de procédures judiciaires concernent tous des résidents de la même ville ou des membres d’une même famille[109]. C’est alors un compromis arbitral, oral ou écrit, qui initie la procédure et qui détermine la nature du différend, ainsi que les limites du pouvoir des arbitres — amis, familles ou notables — chargés de trancher le différend. La difficulté de rendre les accords oraux effectifs engageait le plus souvent les parties à fonder l’arbitrage sur des actes authentiques (deeds). Comme dans le contexte anglais ou français, possédant certes tous ses aspects pratiques, la sentence arbitrale ne possède pas de force exécutoire. Les arbitres n’ont pas les pouvoirs des tribunaux et les parties ne peuvent faire exécuter la sentence directement, ce qui distingue la sentence d’un jugement. L’aspect consensuel prime donc. Pour pallier cette réalité, les parties, conformément à la pratique anglaise[110], prirent l’habitude de souscrire entre eux une obligation sous forme d’acte authentique, exigible uniquement en cas d’inexécution du compromis ou de la sentence, comme ce sera le cas dans la pratique française et canadienne. Cette obligation est juridiquement indépendante du compromis et demeure en vigueur même si l’arbitrage n’a pas lieu.
Les deeds deviennent la règle un siècle plus tard dans le Connecticut ainsi qu’en Angleterre[111], en réponse à une évolution de la société où la confiance est plus difficilement accordée à une population en constant mouvement et en évolution permanente. Cette pratique des obligations conditionnelles (conditioned bonds) se retrouve également dans la pratique coloniale au Maryland, comme le montre la sentence arbitrale Herman v. Overzee[112] en janvier 1660, ou celle de Herman v. Colclough[113].
Au Maryland, on trouve le même type d’évolution. Les volumes des archives retracent un usage assez large de l’arbitrage au sein des différentes institutions, Provincial Court ou General Assembly[114]. On trouve dans ces fonds par exemple une obligation datée de 1657 entre Samuel Tilghman of Racliffe, Edward Packer et Henry Parnel, qui stipule le renvoi à l’arbitrage en cas de différend concernant l’achat d’une plantation :
The Condiction of this Obligation is such, that if the above named Samuel Tilghman does stand to the Judgement & award of Mr Thomas Gerard & Mr Henry Meese mutually chosen by the abovesed parties, to end & conclude all differences happening or being, betweene the abovesed parties, as Concerning the Plantation lately bought of Walter Beane, & now in the possession of the parties abovesayd that then this Obligation to bee voyd, & of none effect, or ells to stand in full force & vertue[115].
On trouve dans ce compromis la technique classique des tiers arbitres[116], comme dans la pratique française et celle de la Nouvelle-France[117], ainsi que la clause pénale, obligation indépendante imposée à la partie qui n’accepterait pas le recours à l’arbitrage[118]. La sentence arbitrale (arbitraters award) qui en découle est largement similaire[119] à celle que nous retrouverons dans la pratique de la Nouvelle-France.
Dans son étude, Bruce H. Mann souligne plusieurs traits de la pratique arbitrale coloniale anglaise qui se retrouveront dans la pratique de la province de Québec. Il lie fortement la pratique coloniale anglaise au caractère communautaire de la colonie. Lorsque celle-ci est composée essentiellement de cultivateurs, provenant d’une même origine, d’un groupe social et religieux préconstitué, il relève une amiable composition peu contraignante et peu formaliste. La force exécutoire réside essentiellement dans la difficulté, pour un membre de la communauté, de poursuivre ses relations avec celle-ci s’il ne suit pas la sentence arbitrale[120].
Ainsi, les lignes fortes de la pratique arbitrale, tant en common law qu’en ancien droit français, tant en Europe qu’en Amérique, sont communes. La procédure pose en définitive peu de difficultés juridiques. Elle repose, comme de nos jours, sur les fondements de la confiance et de la bonne foi, instrument avant tout des parties, pour « le meilleur et pour le pire ». Comme le soulignait Stewart Kyd :
Every one whom the law supposes capable of judging, whatever may be his character for integrity or wisdom, may be an arbitrator or umpire; because he is appointed by the choice of the parties themselves, and it is their folly to choose an improper person; but a person cannot be an arbitrator, who, by nature or accident, has not discretion; as one of non-sane memory, or one who is deaf and dumb, because being deprived of the use of those senses, which are more peculiarly the medium through which knowledge is conveyed to the mind, he cannot be supposed capable of judging[121].
Cette souplesse et ce consensualisme expliquent en partie pourquoi l’arbitrage reste un outil crucial lors de la période de la Conquête, les acteurs et les normes subsistant malgré le changement de pouvoir politique et l’emprise militaire.
II. Permanence des sources de droit et des acteurs après la Conquête
Les notaires Panet, Fouchet ou Sanguinet[122] sont emblématiques de l’ascension sociale de certains notaires après la Conquête, notamment par le cumul des charges de notaire et d’avocat introduit par les Anglais en 1765. Une fois la puissance britannique installée, une évolution au sein de ce groupe en formation se fait jour. Logiquement, des notaires d’origine britannique font leur apparition — en faible nombre dans un premier temps — mais de manière suffisamment significative pour marquer une nouvelle pratique juridique et de nouvelles relations. John Burke fut le premier notaire commissionné à Montréal par Thomas Gage en 1762[123]. Edward William Gray et Richard McCarthy lui firent suite, mais ils ne prirent qu’une faible place au sein de la communauté notariale[124]. Après la Conquête, les proportions entre les notaires nés en France et les notaires issus de la colonie ne sont pas globalement modifiées par rapport au régime français. Ainsi, de nombreux notaires commissionnés après l’arrivée des Britanniques sont encore d’origine française, comme c’est le cas de Mathurin Bouvet, François le Guay ou Valentin Jautard[125]. Concernant la formation, les exigences sont faibles, elle se fait essentiellement au coeur de la pratique.
Si leurs formations ne constituent pas — a priori — leur force, leur connaissance du milieu et, in fine, du droit français va constituer leur sésame afin de rendre leur fonction indispensable. Ils parviennent ainsi assez rapidement à s’implanter comme relais entre la population et l’administration britannique. Outre les notaires Panet qui ont régné à Montréal, mais surtout à Québec, sur les postes officiels après ou concomitamment à l’exercice du notariat, on remarque la famille Delisle à Montréal qui, après la Conquête, a su s’installer solidement au sein des emplois publics[126]. On peut mettre en exergue le lien de confiance et d’amitié qui lient certains des praticiens de cette époque, comme Pierre Panet de Méru et Pierre Mézière : ils arbitrent ensemble, ils plaident l’un contre l’autre et font appel à l’autre lorsqu’ils ne peuvent instrumenter eux-mêmes.
La petite communauté notariale est resserrée après la Conquête et certains — Panet et Mézière à Montréal ou Saillant et Louet à Québec — instrumentent largement en commun, renvoyant à leur confrère un client lorsqu’ils ne peuvent le défendre comme avocat dans une cause. Ils font figure, sous l’impulsion des juridictions britanniques, d’arbitres joints dans des causes qui leur sont renvoyées par les juridictions britanniques[127].
En s’adaptant rapidement au régime anglais, ces individus — comme les notaires Panet[128] — poursuivent tous les objectifs d’une carrière personnelle, mais participent également, par leur pratique quotidienne, à la sauvegarde de la tradition juridique des populations francophones et à celle du patrimoine que représente la Coutume de Paris. Ils vont prendre, avec d’autres, une grande part dans le développement de l’arbitrage notarié sous le régime britannique. Les relations entre notaires jouent alors un rôle d’importance dans la défense des droits des Canadiens français. Panet, Sanguinet et Mézière furent parmi ceux qui se mirent en avant dans les agitations, pétitions et manifestes qui émaillèrent la période de l’adoption de l’Acte de Québec[129]. C’est un autre trait marquant des notaires-avocats de cette période. Ils n’hésitent pas, à l’instar de leurs collègues français des dix-huitième et dix-neuvième siècles, à s’engager dans le débat politique[130]. Malgré cela, les notaires urbains[131] semblent jouir globalement de la confiance des négociants anglais fraichement installés[132].
Analysant les sources du droit appliqué dans les actes notariés de cette période, il est manifeste que les notaires appliquent la Coutume de Paris sans tenir compte des évolutions juridiques et politiques. Si on trouve, à partir des années 1771-1772 environ, des actes rédigés en anglais par des notaires francophones[133], il n’y a pas ou très peu d’actes fondés sur le droit privé anglais. Les parties anglophones à l’acte sont rares, même s’il est possible de trouver des pièces où les deux parties le sont[134]. Leur nombre semble suivre l’installation des colons d’origine anglaise dans la colonie[135].
Ainsi, la Coutume de Paris continue de s’appliquer, en contravention avec l’esprit — si ce n’est la lettre — de la Proclamation royale, mais en parfaite conformité avec la pratique de la Cour des plaidoyers communs. Le 30 juillet 1768, Pierre Panet et Mézière, dans le cadre d’un arbitrage concernant le partage d’une succession, écrivent :
[À] l’égard des biens nobles dépendant de la succession de ladite feue Dame Louise Boucher, nous disons de notre opinion que conformément à la coutume suivie en ce païs et les sentences des meilleurs commentateurs, les enfants mâles de Mesdames Demuy, De Varennes, De Niverville et Sabrevois, venant de leurs chefs et non par représentation de leur mère à la succession de ladite feu Dame Boucher, envers leurs cousins germains, et quoiqu’issus de mâles, ils doivent partager avec eux dans lesdits biens meubles, dans lequel partage ne devant pas être compris les filles issues de Mme Boucher épouse de M le Gardeur parce qu’elles sont dans le cas de la prohibition portées par la coutume. Fait à Montréal le 30 juillet 1768[136].
Cet exemple ne serait pas suffisant pour conclure à une permanence du droit français, mais en suivant la pratique notariale, nous constatons — à la suite des travaux de certains historiens[137] — un recours permanent à l’ancien droit hexagonal. Durant toute cette période, figurent à l’envi des actes de mariage faisant explicitement référence à la Coutume de Paris et au douaire coutumier. Leur rôle est particulièrement marquant dans le cadre du maintien de la pratique arbitrale, mais également dans l’accomplissement d’actes juridiques de la vie quotidienne[138].
Les actes de droit privé instrumentés restent fondés sur le droit français. Lorsque Sanguinet instrumente une procuration qu’établit Jean-Claude Panet en octobre 1765, au profit de son épouse Marie-Louise Barolet, il rédige celle-ci conformément à la Coutume de Paris[139] et à la pratique de la Nouvelle-France. Il était alors permis au mari de confier, par procuration, la gestion de la communauté de biens à sa femme, qui recouvrait alors l’exercice de sa capacité juridique pour un temps déterminé[140]. Le contrat de mariage instrumenté par Pierre Panet de Méru le 8 avril 1769 s’avère encore plus significatif du maintien patent du droit français, en raison des parties et des représentants à l’acte. Sont alors présents à l’acte John Fraser, juge de la Cour des plaidoyers communs, et Daniel Robertson, juge de paix. La présence de ces notables britanniques s’explique par le fait que le père du futur marié, Charles-François Tarieu de Lanaudière, est à la tête d’une famille de notables du régime français qui entretenait de fort bonnes relations avec le nouveau pouvoir[141]. Présents au contrat de mariage du fils Charles-Louis, ces représentants de l’administration britannique ne s’offusquèrent pas de signer un acte instrumenté en 1769 par Pierre Panet dans les termes suivants :
Seront les futurs époux mis de commun en tous biens meubles et conquêts et immeubles suivant la coutume anciennement et jusqu’icy suivie en ce païs, sous laquelle leur future communauté sera régie et gouvernée, renonçant expressément à toutes autres loix et coutumes contraires[142].
Ainsi, sous le regard et la signature d’administrateurs britanniques, une clause prévoit en 1769 d’échapper expressément au droit britannique au profit de l’application de la Coutume de Paris. Cet acte est un argument de poids contre l’idée de résistance passive, et étaye au contraire la bienveillance des autorités locales anglaises au maintien des règles juridiques d’origine française dans les rapports entre les nouveaux sujets francophones de Sa Majesté[143]. Dans un contrat de mariage du 10 octobre 1772, le notaire Leguay indique que « lesdits futurs époux, unis et communs en tout bien meuble, conquêts et immeubles suivant [...] la Coutume de Paris anciennement suivie en ce païs »[144]. On retrouve encore, en novembre 1774, une formule similaire, dans un acte de mariage instrumenté par le notaire de Boucherville, François Racicot :
Pour cette coutume seront les dits futurs époux [mis] en commun en tous biens conquêts & immeubles qu’ils feront et acquéreront pendant et constant le dit futur mariage suivis précédemment dans la province de Québec au désir delaquelle leur communauté sera régie et gouvernée encore qu’il fasse leurs demeures ou des acquisitions en paÿs deloix et coutume à ce contraire aux quels ils ont tous présentement dérogé et renoncé sur ce regard[145].
Constituant un douaire coutumier au profit de l’épouse, le notaire Racicot et les parties se conforment en tout point à la tradition juridique française et à la Coutume de Paris[146]. Ces contrats sont dans la droite ligne de la pratique française et diffèrent peu des actes postérieurs à l’Acte de Québec[147]. Ainsi, seule l’absence de la clause excluant expressément le recours à d’autres coutumes ou lois témoigne du passage de l’Acte de Québec dans l’ordonnancement normatif et dans la pratique du notariat de la province. La formulation demeure quasiment la même par la suite[148] et est insérée dans les actes de mariage préremplis, utilisés par le notaire Foucher à la fin des années 1770. Enfin, les contrats de mariage ne sont pas les seuls à conserver l’ancien droit français durant la période de 1760 à 1774. Des contrats de concession de terres[149] ou des requêtes demandant la réunion d’assemblées de parents perpétuent la pratique juridique française[150].
III. La juridictionnalisation de l’arbitrage : La conciliation des systèmes et des droits dans la province de Québec
La pratique arbitrale est utilisée dès l’instauration du régime militaire, ayant l’avantage de la souplesse et existant dans la pratique tant de la common law que du droit français, connu des capitaines de milice[151]. On retrouve ainsi des actes d’arbitrage initiés par ces derniers[152], par les cours de justice[153] ou par les gouverneurs militaires[154]. Dès cette époque, la distinction entre règlement juridictionnel et arbitrage s’avère difficile[155]. La participation des juridictions mises en place par le pouvoir anglais se poursuit au moment de la mise en place du régime civil. Paradoxalement, l’entrée en vigueur de la Proclamation royale de 1763 et la mise en place d’un nouveau système judiciaire en 1764 introduisent une période d’incertitude sur la norme à appliquer qui n’a pratiquement, comme nous venons de le voir, aucune conséquence visible dans les actes notariés. La pratique de l’arbitrage notarié s’appuie alors largement sur le soutien et la permanence des notaires installés sous le régime français, comme Louet ou les notaires Panet, et le relais des juridictions. Cette permanence est somme toute logique. La plupart des juges durant cette période ne semblent pas bénéficier d’une formation en droit français, et il doit leur paraître assez naturel de renvoyer les débats sur le fondement de la Coutume de Paris aux notaires formés à son emploi.
A. Le notariat, « amicus curiae » des juridictions britanniques
L’enseignement essentiel au vu des prémices de cette recherche réside dans l’évolution des actes arbitrés par des notaires, une évolution qui suit assez fidèlement celle des actes trouvant leurs initiatives devant une juridiction britannique. Ainsi, en croisant les renvois à l’arbitrage des fonds de la Cour des plaidoyers communs aux actes faisant référence à cette procédure dans les fonds notariés, il est patent que ce sont les juridictions qui soutiennent en partie le recours à l’arbitrage, notamment jusqu’en 1770. On constate de même un recours à des notaires référents (Louet à Québec) ou à des binômes de notaires (Panet de Méru et Mézière ou parfois Foucher ainsi que Saillant et Jean-Claude Panet à Québec). Toutefois, le recours au notaire n’est pas lié de manière adamantine à l’impulsion des juridictions britanniques, ce qui laisse à penser que cette position clé des notaires est également reconnue par la population. Celle-ci ne rejette donc pas ces acteurs du fait de leur implication dans les procédures extrajudiciaires des juridictions de la nouvelle puissance coloniale, le pragmatisme semblant régner de part et d’autre. Sans perdre la reconnaissance de leurs concitoyens, les notaires agissent de moins en moins comme arbitres, alors qu’ils instrumentent toujours de nombreux arbitrages volontaires ou juridictionnels après 1777. La situation politique et juridique stabilisée, le coût d’un arbitre de profession notariale dépasse visiblement le gain juridique qu’il peut représenter, les parties se contentant de faire instrumenter l’acte tranchant le différend.
Contrairement à la résistance passive évoquée par l’école historique de Montréal, il faut constater un pragmatisme actif, de part et d’autre, les juridictions se déchargeant d’un contentieux difficile et source de conflits avec les populations au profit des notaires. Ceux-ci présentent le triple avantage de la connaissance juridique, d’une certaine fidélité au nouveau pouvoir à qui ils doivent leurs nouvelles commissions, ainsi que d’une proximité et d’une reconnaissance par la population. Ils participent donc à la préservation du droit français tout en consolidant leurs positions personnelles et collectives, jusqu’à ce que l’Acte de Québec vienne consacrer sa préservation. Le développement économique les oriente ensuite soit vers la fonction d’avocat à partir de 1785, soit vers les grands greffes liés aux activités économiques des grands marchands britanniques. Cette conjonction entre praticiens, populations et juridictions britanniques peut être confirmée par les écrits des administrateurs britanniques de la colonie, et par l’attitude de certains juristes londoniens qui vont favoriser la conciliation des systèmes, plutôt que l’affrontement.
Ainsi, si la Proclamation royale du 7 octobre 1763 permet aux gouverneurs d’établir des tribunaux afin d’« entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises »[156], l’idée de la survivance du droit français en matière de droit privé est immédiatement présente dans l’esprit des administrateurs. Le gouverneur Murray affirme ainsi que la saisie de la Cour des plaidoyers communs[157] doit être réservée aux seuls Canadiens, c’est-à-dire aux nouveaux sujets de Sa Majesté britannique[158]. Il précise que cette juridiction a été établie dans l’attente que ces derniers se familiarisent suffisamment « avec nos lois et nos méthodes concernant l’administration de la justice dans nos cours »[159]. Les juges de la Cour des plaidoyers communs doivent d’ailleurs, selon les termes de l’ordonnance, « décider suivant l’équité en tenant compte cependant des lois d’Angleterre en autant que les circonstances et l’état actuel des choses le permettront »[160]. L’équité est alors le paravent derrière lequel se cache le droit français. Selon William Hey, les juges de cette cour admettent ainsi « les lois du Canada dans les procès entre Canadiens, même si la cause de l’action a été mue depuis septembre 1764 »[161]. Francis Masères stigmatise quant à lui l’incertitude dangereuse qui règne dans le droit durant cette période : « L’incertitude qui règne au sujet des lois et les doutes que l’on entretient au sujet de la légalité du maintien des anciennes lois et coutumes en usage au temps du gouvernement français, constituent le premier et l’un des principaux embarras »[162]. Dans les fonds des notaires Panet, les matières soumises à l’arbitrage portent sur l’ensemble des activités juridiques de l’époque : successions, comptes de tutelle, servitudes, obligations personnelles et commerciales[163]. Certaines affaires mettent en jeu la confusion des fonctions de notaire et d’avocat, quelques troubles se faisant jour dans la pratique, comme dans l’affaire opposant Jean-Claude Panet et Guillaume Roy[164]. Dépassant les luttes picrocholines de ces deux protagonistes, on peut remarquer que les relations entre les notaires de Québec sont fortes, Guillemin, Saillant et Panet entretenant visiblement des relations étroites et de confiance. La permanence des cadres juridiques permet au nouveau régime de s’installer sans heurts majeurs. En effet, comme cela pouvait être le cas sous le régime français[165], ce sont souvent les juridictions civiles britanniques qui nomment les arbitres[166], et non pas les parties. De même, le type de questions abordées dans les compromis ou dans les sentences ne diffère pas sensiblement de celles qui étaient examinées auparavant dans ce cadre.
Après la Conquête, le nombre d’actes notariés faisant référence à l’arbitrage connaît d’importantes fluctuations, sans doute en raison des changements de régimes juridiques[167]. Dans ce contexte, les notaires jouent des rôles différents lorsqu’une procédure d’arbitrage est amorcée, mais continuent d’agir comme arbitres. On peut alors analyser à la fois quantitativement et qualitativement ces données.
La participation des notaires aux activités des juridictions mises en place par le pouvoir anglais continue sous le gouvernement civil, jusqu’à la fin de la période étudiée. Comme par le passé, ils rédigent des compromis et des sentences. De 1740 à 1784, le nombre d’actes se rapportant à l’arbitrage connaît toutefois une évolution en dents de scie, comme le montre le graphique ci-après. De 1760 à 1784, 244 actes notariés se rapportent à l’arbitrage. De ce nombre, trente-deux sont initiés ou prennent place dans le cadre d’une procédure devant l’une des Cours des plaidoyers communs. Vingt autres arbitrages sont consécutifs à un passage devant les juges de paix, quatre le sont après une décision de la Cour des prérogatives et une affaire est le fait d’un administrateur militaire (un gouverneur de province non identifié). Ces volumes représentent, en pourcentage, treize pour cent des arbitrages notariés pour la Cour des plaidoyers communs, huit pour cent pour les juges de paix et moins de deux pour cent pour les sentences consécutives à un contentieux devant la Cour des prérogatives. Durant cette période, presque vingt-trois pour cent des décisions arbitrales prennent place dans le cadre d’une procédure contentieuse devant les juridictions anglaises ou sont amorcées par elles. Ce chiffre, significatif, montre que l’hypothèse de la résistance passive doit être fortement nuancée.
Nombre d'actes d'arbitrage notariés, 1740-1784
Si les arbitrages sont en augmentation après la mise en place du régime civil, c’est autant le fait des populations que du pouvoir judiciaire. Si, en 1765 et 1766, le nombre de décisions reste assez proche du maximum d’actes atteint durant la période française[168], l’année 1767 marque un pic avec vingt-et-un actes, confirmé en 1768 (vingt-six actes) et en 1769 (dix-neuf actes). De plus, le nombre d’actes par année ne redescend plus en dessous de la barre des quatre actes (pour les années 1775 et 1776), le minimum de la période anglaise rejoignant quasiment le maximum de la période française.
En 1767 et durant les années consécutives, on assiste à une explosion du nombre d’arbitrages enregistrés par les notaires de la province, alors qu’une participation importante des juridictions anglaises à la pratique arbitrale, en matière de droit privé, se confirme. Sur les vingt-et-une décisions arbitrales inventoriées, six décisions sont initiées par les juges de paix et cinq par la Cour des plaidoyers communs, le reste des actes étant des arbitrages extrajudiciaires souhaités uniquement par les parties. Soixante-huit pour cent des arbitrages réalisés cette année-là sont donc pris à l’initiative des juridictions établies par le pouvoir anglais. Pour l’année 1768, un tiers (trente-cinq pour cent) des affaires arbitrées, enregistrées dans les fonds notariés, consistent en des renvois faits par les juridictions anglaises, presque vingt-et-un pour cent des affaires arbitrées étant le fait des juges de paix.
Les décisions arbitrales participant à un contentieux et provenant des juges de paix portent sur des questions diverses. En 1767, nous recensons une réquisition de grains[169], une implantation de fossés à la limite de deux seigneuries[170], une vente d’une terre sans réunion d’un conseil de famille[171], un contrat de vente de terrain[172], un litige touchant une pension alimentaire[173] et, enfin, un problème d’entretien d’un cours d’eau[174]. Pour les années 1768 et 1769 sont concernées une reddition de compte de fourniture, une servitude de passage, une gestion de tutelle, une reddition de compte de succession, une dissolution de communauté et une coupe illégale de bois. Pour les décisions arbitrales faisant suite à des contentieux engagés devant la Cour des plaidoyers communs, celles-ci portent sur le paiement de l’établissement d’un terrier par le notaire Saillant[175], une dissolution de deux communautés[176], un contrat de concession de terre[177], l’évaluation d’un pouvoir octroyé à une épouse[178] et, enfin, une affaire relative à une succession et à une gestion de compte de tutelle[179]. Pour les années 1768 et 1769 sont concernés la gestion d’une communauté, une dette relative à la liquidation d’une succession, deux redditions de compte de communauté et un partage entre créanciers des biens découlant de la liquidation d’une communauté.
Les décisions relevant d’un contentieux provenant de la Cour des plaidoyers communs[180] montrent un monopole absolu, dans un premier temps, du notaire Louet. Celui-ci semble devenir le relais privilégié de la Cour de Québec, même si d’autres notaires sont appelés à jouer ce rôle par la suite. Les arbitrages extrajudiciaires touchent, quant à eux, les mêmes matières et font intervenir comme arbitres des notaires, mais aussi des notables ou des experts. Ces données laissent entrevoir une implication inédite pour la doctrine juridique des juridictions d’origine anglaise dans la pratique juridique au sein des populations francophones, mais montrent également qu’elles n’interviennent pas afin d’appliquer le droit anglais. Elles laissent plutôt les notables francophones décider du droit applicable. Une étude systématique permet d’affiner cette perspective et d’analyser les rapports exacts entre populations, juridictions et application de la norme durant cette période cruciale pour l’histoire juridique du futur Canada.
On retrouve cette participation des notaires à l’arbitrage initié par les juridictions coloniales tout au long de la période, avec toutefois une diminution du nombre de cas soumis par les tribunaux à partir de 1770. Pour les années 1770, 1771 et 1772, aucun arbitrage notarié n’est initié devant une juridiction. En 1773, deux affaires sur neuf proviennent de juridictions : il s’agit d’une donation dans le cadre d’une succession confiée à Panet de Méru et de l’estimation du fonctionnement d’un moulin confiée au notaire Jehanne. Les pourcentages d’actes instrumentés provenant de contentieux pendants devant les tribunaux reprennent dans les années suivantes : vingt-deux pour cent en 1773 et 1774, cinquante pour cent en 1775 et vingt pour cent en 1776. Cette activité reste toutefois erratique[181], même si la tendance semble aller vers une diminution de l’utilisation des arbitrages notariés comme extension du processus judiciaire. Le graphique ci-dessous fait ressortir ce phénomène.
L’incitation des cours britanniques à l’arbitrage en amont des décisions judiciaires ne doit pas étonner au regard de la pratique de common law à Londres, sous l’influence de Lord Mansfield[182]. Par ailleurs, cela rejoint certaines constatations faites pour le contexte colonial d’Amérique du Nord. Dans ce cadre, les arbitres ne sont pas soumis à la rigueur de la loi et aux formalités légales, mais sont toutefois strictement assujettis aux bornes posées par les parties et aux pouvoirs qu’elles leur ont conférés.
Pourcentage du nombre d'actes d'arbitrage notariés suite à un contentieux devant une juridiction britannique
B. L’arbitrage, une pratique ancrée dans la société locale
La pratique arbitrale reflète alors une grande continuité des sources du droit avec la période française, assurant notamment la permanence du droit français en matière d’affaires de famille. L’analyse des actes arbitrés par des notaires durant le régime britannique montre aussi une forte prépondérance de trois d’entre eux : Pierre Panet de Méru, Mézière et Aumasson de Courville. Ce dernier et Foucher — et à un moindre titre Louet — agissent également, à plusieurs reprises, comme arbitre unique. Durant la période étudiée, plusieurs notaires sont intervenus en tant qu’arbitre une seule et unique fois[183]. Un seul arbitre notaire d’origine britannique apparaît dans ce groupe d’actes : il s’agit du notaire Richard McCarty, arbitrant une question de succession en compagnie de Pierre Panet de Méru[184].
Le graphique ci-dessous représente, parmi toutes les affaires où un notaire a agi comme arbitre, la proportion attribuable à chacun d’entre eux.
Nombre d'actes arbitrés par chacun des notaires intervenant comme arbitres
On peut comparer cette répartition à la proportion d’actes instrumentés par des notaires, sans qu’ils soient forcément arbitres à l’acte. Logiquement, la répartition des actes instrumentés est plus vaste que celle des actes arbitrés par des notaires[185]. Les actes nés de la pratique locale, éloignée des grands centres, expliquent ce phénomène[186].
Nombre d'actes relatifs à l'arbitrage instrumentés par chacun des notaires
Les matières couvertes dans les actes notariés se rapportant à un arbitrage ne montrent pas une singularité forte lorsqu’on les compare avec celles du régime français[187]. In fine, la qualité des arbitres confirme l’institutionnalisation de la pratique arbitrale. Sur les 382 arbitres de ce corpus, ce sont les habitants et les notaires qui interviennent de manière prépondérante. Il faut souligner que ces rapports entre les habitants et les notaires doivent être envisagés en tenant compte du type d’arbitrage et de leurs mécanismes propres. Ainsi, les différends portant sur les affaires de famille, notamment les successions, font souvent intervenir les notaires comme arbitres, leur nombre étant alors généralement de deux. Par contre, les différends où interviennent les habitants, habituellement des causes de servitudes ou de délimitation de terres, font fréquemment intervenir de quatre à six arbitres, conformément à l’ordonnance de 1764, augmentant artificiellement les chiffres[188].
Répartition des arbitres en fonction de leurs différentes qualités
Les différends faisant intervenir des notaires comme arbitres sont les plus nombreux pour les années 1765 à 1770, tandis que les arbitrages d’habitants deviennent majoritaires par la suite, certaines années ne faisant intervenir aucun notaire. À partir de 1777, ces derniers interviennent à nouveau de manière plus significative, les arbitrages par notaires et par habitants se trouvant dans des proportions équivalentes, malgré des disparités importantes[189]. La comparaison entre cette évolution et celle relative aux arbitrages nés dans le cadre contentieux, sous l’égide des juridictions britanniques ou par la volonté des parties, permet d’établir certaines conclusions. Première indication, arbitrages conventionnels (ou volontaires) et arbitrages juridictionnels accompagnent dans leur évolution les arbitrages du fait des notaires et des habitants[190]. L’arbitrage par les notaires, une fois la stabilité juridique retrouvée et lorsque la guerre semble s’éloigner, trouve moins d’appuis parmi les institutions et les populations[191].
De plus, les évolutions entre arbitrages extrajudiciaires et différends tranchés par des habitants ou des membres de la famille sont similaires[192]. Enfin, et c’est peut-être l’enseignement essentiel, l’évolution des actes arbitrés par des notaires suit assez fidèlement l’évolution des actes initiés devant une juridiction britannique. Les notaires permettent ainsi bien, au regard de la confiance des juridictions britanniques et de l’implantation dans la sphère locale, la transmission d’un patrimoine juridique et le passage d’un système normatif homogène à un pluralisme juridique pacifié. Ainsi, si l’on a cru, à la suite des travaux d’André Morel, qu’en « matière familiale et successorale, les différends » n’étaient pas même « portés devant les tribunaux et se [réglaient] de façon clandestine sans que les tribunaux en [fuss]ent saisis »[193], il nous semble certain que cette affirmation doit être nuancée. Si de tels différends existent effectivement, l’action et l’implication des juridictions britanniques dans la pratique arbitrale notariée sont claires et d’importances, nous sommes loin ici de la clandestinité ou d’un règlement hors du droit et de la légalité.
Conclusion
En reprenant la formulation judicieuse de Louis Marquis[194], on peut relever au terme de cette recherche qu’il s’agit, dans ce contexte historique, d’une conciliation pragmatique des systèmes « au soleil » du pouvoir judiciaire et colonial. Si la période 1760-1774 a été analysée comme un temps de crise pour le notariat[195] de la province, il faut souligner une permanence et une adaptation forte : d’une part, les charges de notaire furent conservées par le pouvoir britannique dans leur très large majorité et, d’autre part, les normes françaises ont subsisté sans interruption au sein des greffes de ces derniers.
Toutefois, il est vrai que les tergiversations quant à la norme à appliquer et le peu de cas que faisait le droit anglais du notariat contribuaient à une fragilisation de leur situation[196]. C’est alors une situation très contrastée, à mi-chemin entre le maintien des pratiques françaises et la nécessaire adaptation au nouveau contexte[197]. L’arrivée du système judiciaire britannique, de manière surprenante, s’est présentée comme un tremplin pour ceux qui disposaient de la connaissance juridique et étaient capables d’obtenir une commission d’avocat, au premier rang desquels figuraient évidemment les notaires. Seuls notables ayant une compétence juridique au moment de la Conquête, ils sont naturellement les relais des populations, qui trouvent une certaine sécurité dans leur commerce. De plus, ils constituent les appuis essentiels des administrateurs coloniaux[198], qui leur font jouer le rôle d’interface entre les mesures du nouveau pouvoir et cette population qui ne partageait ni la même langue, ni la culture juridique des nouvelles élites au pouvoir[199]. Enfin, institution anecdotique dans le système britannique, le notariat, par le biais de la fonction d’avocat, va asseoir la situation de son corps tout en voyant disparaître une partie de ses membres au sein du barreau à partir de 1785.
C’est notamment grâce à la pratique arbitrale que s’est réalisée la conciliation des droits et des antagonismes supposés, affichés ou craints, entre la common law et le droit civil. La pratique étant aussi bien connue du monde anglo-saxon que de la tradition civiliste, reposant sur les mêmes mécanismes fondamentaux et la même logique qui transcendent les systèmes, l’arbitrage trouve naturellement à s’exprimer dans le contexte colonial. L’outil étant à disposition, il fallait encore en trouver les acteurs. Les notaires, mais aussi les juges et les populations, tant les Canadiens que les marchands britanniques, comprirent immédiatement l’intérêt de la technique durant la période d’ambiguïté normative et, in fine, de transition qui est close par l’Acte de Québec. En s’emparant de cet instrument, en accord avec les institutions et les pouvoirs locaux, les populations et la pratique montrent le chemin au gouvernement, les légistes londoniens ne faisant, par l’Acte de Québec, qu’entériner l’oeuvre pragmatique des populations, des administrateurs et des juristes.
L’arbitrage ne disparaît bien évidemment pas après cette période. Il subsiste devant les juridictions britanniques, mais aussi à travers l’institution des juges de paix[200], qui vont assurer la continuité de la pratique. La procédure arbitrale subsiste de même dans la société en général, où on perpétue ce mode alternatif de règlement des conflits comme en témoigne le fonds Baby[201]. Dépassant ces causes de peu d’importance, la pratique arbitrale et le recours aux juristes d’origine française s’avèrent essentiels du point de vue des juridictions britanniques, qui usent de cet outil — concomitamment à la procédure du jury en droit privé jusqu’en 1774 — pour assurer leurs assises dans la province. Les notaires et les avocats — par leur représentation des justiciables et le règlement en cour ou hors cour de conflits interpellant particulièrement le droit privé français — participèrent[202], en compagnie des juges, à un important processus de diffusion et de construction d’une culture juridique originale[203], faite d’emprunts et d’amalgames[204], qui est à la source de notre droit privé. La logique de l’Acte de Québec se trouve déjà dans la pratique des administrateurs, des notaires, des tribunaux et des populations à travers l’institution arbitrale. On peut alors conclure, à la manière de Pierre du Calvet dans son Appel à la justice de l’État :
Le Bill de Québec vous décerne la Jurisprudence Française, sous laquelle vous êtes né ; c’est en effet la Judicature qui [c]adre le mieux avec vos propriétés et vos goûts ; mais pour en couronner l’assortiment, il lui faut d’être administrée sous les auspices de l’illustre et bienfaisante Constitution d’Angleterre : Paris jugera vos héritages, mais Londres gouvernera vos personnes. Dans cette économie, votre bonheur sera de tout point accompli [italiques dans l’original][205].
Parties annexes
Notes
-
[1]
Quant à l’élite coloniale, elle a le choix entre rester ou partir, ce qui provoque interrogations et déchirements au sein des familles. Pour ceux qui reviennent en métropole, l’insertion sociale est difficile. Les nobles qui restent, en grande partie des officiers militaires, sont durement touchés par la disparition de l’armée coloniale et la perte de nombreux privilèges liés à leur statut. Les marchands, quant à eux, sont affectés par l’installation de négociants anglais venus de la métropole ou des colonies anglaises. Ils restent toutefois pour la plupart dans la colonie. Le clergé et les membres des ordres religieux doivent dorénavant trouver sur place leurs moyens de subsistance et définir leurs rapports avec l’État protestant. Voir José E Igartua, « The Merchants of Montreal at the Conquest: Socio-Economic Profile » (1975) 8 : 16 Histoire sociale 275 ; Donald Fyson, « Domination et adaptation : Les élites européennes au Québec, 1760-1841 » dans Claire Laux, François-Joseph Ruggiu et Pierre Singaravélou, dir, Au Sommet de l’Empire : Les élites européennes dans les colonies (XVIe-XXe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 2009, 167.
-
[2]
Si André Vachon, dans son Histoire du notariat canadien, soulignait que l’Acte de Québec mettait fin à une crise de plus de dix ans pour le notariat, il convient de nuancer largement ce terme. D’une part, les charges de notaire furent conservées par le pouvoir britannique dans leur très large majorité et d’autre part, les normes françaises ont subsisté sans interruption au sein des greffes de notaires : André Vachon, Histoire du notariat canadien, 1621-1960, Québec, Presses de l’Université Laval, 1962 à la p 62 [Vachon, Histoire]. Voir aussi David Gilles, « Le notaire, arbitre naturel des différends ? Une longue tradition québécoise » (2011) 1 : 2 Revue d’arbitrage et de médiation 105 [Gilles, « Arbitre »].
-
[3]
Seaman Morley Scott, Chapters in the History of the Law of Quebec, 1764-1775, Ann Arbor, University of Michigan, 1933 à la p 283.
-
[4]
Christine Veilleux, Aux origines du barreau québécois, 1779-1849, Québec, Septentrion, 1997 aux pp 16-25.
-
[5]
Cette étude porte essentiellement sur les notaires urbains, ceux-ci étant les plus actifs du point de vue arbitral et ayant joué un rôle clé auprès des juridictions britanniques. À propos des notaires ruraux, voir Louis Lavallée, « La vie et la pratique d’un notaire rural sous le régime français : Le cas de Guillaume Barette, notaire à La Prairie entre 1709-1744 » (1994) 47 : 4 Revue d’histoire de l’Amérique française 499 ; Michel Guénette, Les notaires de Laprairie, 1760-1850 : Étude socio-économique, mémoire de maitrise en histoire, Université de Montréal, 1992 ; Michel Guénette, « Un portrait de l’activité notariale à Laprairie de 1760 à 1850 (Première partie) » (1993) 95 : 5-6 R du N 314 ; Michel Guénette, « Un portrait de l’activité notariale à Laprairie de 1760 à 1850 (Deuxième partie) » (1993) 95 : 7-8 R du N 434.
-
[6]
Voir Paul-Olivier Lalonde, « Les avocats, race interdite en Nouvelle-France », Magazine Justice [du Ministère de la Justice du Québec] 4 : 5 (septembre 1982) 5.
-
[7]
Charles-Philippe Courtois, dir, La Conquête : Une anthologie, Montréal, Typo, 2009.
-
[8]
Donald Fyson, « The Canadiens and British Institutions of Local Governance in Quebec from the Conquest to the Rebellions » dans Nancy Christie, dir, Transatlantic Subjects: Ideas, Institutions, and Identities in Post-Revolutionary British North America, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2008, 45 [Fyson, « Governance »].
-
[9]
André Morel, « La réaction des Canadiens devant l’administration de la justice : Une forme de résistance passive » (1960) 20 : 2 R du B 53 [Morel, « Réaction »].
-
[10]
Michel Brunet, « Les Canadiens après la conquête : les débuts de la résistance passive » (1958) 12 : 2 Revue d’histoire de l’Amérique française 170 [Brunet, « Résistance »].
-
[11]
Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 53.
-
[12]
L’Ordonnance établissant des cours civiles de 1764 prévoit que, lorsque le montant en litige excède dix livres, le demandeur peut s’adresser soit à la Cour du Banc du Roi, qui doit appliquer « les lois d’Angleterre », soit à la Cour des plaidoyers communs, qui doit se fonder sur « l’équité en tenant compte cependant des lois d’Angleterre » : JA Murray, Ordonnance établissant des cours civiles, 17 septembre 1764, reproduit dans Adam Shortt et Arthur G Doughty, dir, Archives Publiques du Canada, Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, 2e éd, Ottawa, Imprimeur de sa très excellente majesté le Roi, 1921, 180 aux pp 181-182 [Cours civiles].
-
[13]
Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 57. Il trouve des traces de la désaffection des tribunaux dans les archives de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal.
-
[14]
Le gouverneur Carleton et le procureur général Masères ont témoigné à l’époque de l’attachement des francophones à la partie du droit privé relative aux « affaires de famille ». Ainsi, s’adressant au Roi en 1764, les auteurs réclament à cinq reprises que les affaires de famille soient entendues selon le droit français (ibid aux pp 61-62). Pour une analyse détaillée de cette action et des débats historiographiques qui lui ont fait suite, voir l’analyse de Michel Morin, « Introduction » dans Arnaud Decroix, David Gilles et Michel Morin, Les tribunaux et l’arbitrage en Nouvelle-France et au Québec, Montréal, Thémis, 2011, 1.
-
[15]
« [Même s’il] ne fut peut-être pas aussi généralisé que certaines affirmations de Carleton et de Hey pourraient nous le laisser entendre » (Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 62, tel que cité par Decroix, Gilles et Morin, supra note 14 à la p 315).
-
[16]
Morel, « Réaction », supra note 9 à la p 63.
-
[17]
Jean-Philippe Garneau, « Droit et “affaires de famille” sur la Côte-de-Beaupré : histoire d’une rencontre en amont et en aval de la Conquête britannique » (2000) 34 : 2 RJT 515 [Garneau, « Conquête »].
-
[18]
Ibid aux pp 524-525.
-
[19]
Jean-Philippe Garneau, Droit, famille et pratique successorale : Les usages du droit d’une communauté rurale au XVIIIe siècle canadien, thèse de doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal, 2003 à la p 66 [Garneau, Usages].
-
[20]
Ibid à la p 66, n 142, tel que cité par Decroix, Gilles et Morin, supra note 14 à la p 7.
-
[21]
Pour une période postérieure, voir John EC Brierley, « Arbitrage et idée de droit dans la pensée juridique révolutionnaire et dans le système juridique du Québec » dans Sylvain Simard, dir, La Révolution française au Canada français, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1991, 365.
-
[22]
Julien S MacKay, « La profession de notaire au Québec » (2003) 8 : 3 Histoire Québec 11.
-
[23]
À l’exception notamment des travaux de Jean-Philippe Garneau (Garneau, « Conquête », supra note 17) et de Donald Fyson, « Judicial Auxiliaries Across Legal Regimes: From New France to Lower Canada » dans Claire Dolan, dir, Entre justice et justiciables : Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005, 383 aux pp 383-84 [Fyson, « Auxiliaries »]. À propos du contexte postérieur à la Conquête, voir Donald Fyson, « Les dynamiques politiques locales et la justice au Québec entre la Conquête et les Rébellions » (2007) 16 : 1 Bulletin d’histoire politique 337 ; Fyson, « Governance », supra note 8 ; Hélène Lafortune et Normand Robert, Le notaire et la vie quotidienne des origines à 1870, Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1986 ; Christine Veilleux, Les gens de justice à Québec, 1760-1867, thèse de doctorat en histoire, Université Laval, 1990. Pour un aperçu de l’activité professionnelle des notaires en Nouvelle-France, voir EC Common, « The Role of the Notary in the Province of Quebec » (1958) 36 : 3 R du B can 333 ; Archiviste de la province de Québec, « Les notaires au Canada sous le régime français » dans Bureau du secrétaire de la province de Québec, Rapport de l’archiviste de la province de Québec, Québec, Imprimeur de sa majesté le Roi, 1921-1922, 1 ; André Vachon, « Inventaire critique des notaires royaux des gouvernements de Québec, Montréal et Trois-Rivières (1663-1764) » (1955) 9 : 3 Revue d’histoire de l’Amérique française 423 ; André Vachon, « Inventaire critique des notaires royaux des gouvernements de Québec, Montréal et Trois-Rivières (1663-1764) (suite) » (1956) 10 : 1 Revue d’histoire de l’Amérique française 93 ; Vachon, Histoire, supra note 2 ; Jean-Paul Poisson, « Présentation du notariat franco-canadien » (1983) 34 Le Gnomon : revue internationale d’histoire du notariat 5, reproduit dans Jean-Paul Poisson, Notaires et société : Travaux d’histoire et de sociologie notariales, t 2, Paris, Economica, 1990, 489 ; Dominique Boily, Les contrats de mariage : Étude de la pratique notariale sur l’île de Montréal de 1700 à 1740, mémoire de maitrise en histoire, Université de Montréal, 1999 ; Michel Duquet, L’infrajudiciaire et les notaires de Québec, 1650-1784, thèse de doctorat en histoire, Université d’Ottawa, 2008.
-
[24]
Pour un aperçu de la pratique arbitrale dans l’ancienne métropole, voir Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales » (1982) 1 : 3 Histoire, économie et société 369 ; Jeremy Hayhoe, « L’arbitre, intermédiaire de justice en Bourgogne vers la fin du XVIIIe siècle » dans Dolan, supra note 23, 617 à la p 621 ; Jérôme Ferrand, « Sur les différends pendants par devant la cour de parlement ... Approche herméneutique de l’arbitrage moderne à partir des sources dauphinoises » (2007) 85 : 1 Rev hist dr fr & étran 23 [Ferrand, « Herméneutique »] .
-
[25]
Il est difficile de rendre compte de la pratique arbitrale dans son ensemble avant la Conquête. Celle-ci, comme nous l’avons montré dans une recherche à paraître prochainement, se partage entre les juridictions seigneuriales subsistantes ; l’activité de l’intendant en tant que juridiction et amiable compositeur, mais également celle des juridictions pouvant renvoyer à l’arbitrage occasionnellement et, in fine, l’arbitrage volontaire sans acte notarié laissant peu ou pas de trace. Voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14. Malgré un certain oubli de cet héritage québécois, le Québec a connu un fort engouement pour les moyens de prévention et de règlement des différends (PRD ou ADR en anglais) dans les dernières années. Sur la logique sociale et la singularité de ce processus dans le débat judiciaire québécois, voir Louise Lalonde, « Valeurs de la justice négociée et processus de médiation » dans Vincente Fortier, dir, Le juge, gardien des valeurs ?, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 2007, 184 ; Louise Lalonde, « La médiation judiciaire : nouveau rôle pour les juges et nouvelle offre de justice pour les citoyens, à quelles conditions ? » dans André Riendeau, dir, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 23 ; Louise Lalonde, « Les modes de PRD : vers une nouvelle conception de la justice ? » (2003) 1 : 2 Revue de prévention et de règlement des différends 17 ; Jean-François Roberge, « La conférence de règlement à l’amiable : les enjeux du raisonnement judiciaire et du raisonnement de résolution de problème » (2005) 3 : 1 Revue de prévention et de règlement des différends 25 ; Jean-François Roberge, « Comment expliquer la diversité de la médiation judiciaire au Canada ? » (2007) 5 : 3 Revue de prévention et de règlement des différends 1 ; Jean-François Roberge, « La médiation judiciaire innovante peut-elle améliorer le système judiciaire canadien ? Synthèse et analyse des réponses de la communauté juridique canadienne » dans Vincente Fortier, dir, Le droit à l’épreuve des changements de paradigmes : Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, Montpellier, Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2008, 165 ; Jean Poitras, « Qu’est-ce qui fait que les gens collaborent durant une médiation ? » (2006) 4 : 1 Revue de prévention et de règlement des différends 1.
-
[26]
Il faut toutefois souligner que le recours au terme arbitrage pour cette période ne correspond pas aux canons de la terminologie moderne, les distinctions entre médiation, arbitrage, conciliation et expertise étant largement caduques pour ce contexte. Pour une étude sur la pratique de l’arbitrage conventionnel dans le contexte québécois, et l’utilisation des différents termes, voir Louis Marquis, « L’influence du modèle juridique français sur le droit québécois de l’arbitrage conventionnel » (1993) 45 : 3 RIDC 577 [Marquis, « Influence »]. On trouve dans les actes notariés les formules « sentence arbitrale », « compromis arbitral », « arbitrage », « convention », « arbitration » ; seules les trois premières formules ont permis de constituer ce corpus. Voir John A Dickinson, « Les actes notariés et la recherche historique » (1989) 69 Le Gnomon : revue internationale d’histoire du notariat 8 [Dickinson, « Actes »].
-
[27]
Malheureusement, il faut être conscient que ces termes ne sont pas les seuls à pouvoir rendre compte de la pratique arbitrale ou de l’amiable composition. Toutefois, deux choix s’ouvraient à nous. Le premier était de se baser sur les inventaires publiés des notaires, et de procéder alors par sondage, aucune étude exhaustive ne pouvant être menée. Le deuxième était de se servir des outils modernes, tels que la base de données Parchemin, afin d’obtenir un spectre plus large, constant sur la période de la Conquête, mais également tributaire des défauts de cet outil. En effet, à travers cette base, il n’est pas possible de distinguer entre les transactions qui visent un transfert de biens, par exemple, et les transactions qui expriment le fait de transiger, c’est-à-dire un accommodement entre deux parties. Les personnes qui ont constitué cette base n’ont pas poussé la distinction juridique des actes, visiblement davantage intéressées par les questions de généalogie et de sociologie. Ainsi, ne pouvant faire la part des choses entre actes transitoires et transactions arbitrales, et pour les mêmes raisons entre un accord sur une convention et un accord mettant un terme à un différend, nous avons été contraints d’écarter les termes « transactions » et « accords » en étant conscients qu’alors une partie de la pratique arbitrale notariée nous échappe. Afin d’y pallier, nous nous sommes servis, pour des périodes antérieures, d’inventaires publiés, comme celui du notaire Maugue, et pour notre période, de certains sondages dans les fonds des notaires ayant le plus instrumenté, sans passer alors par l’interface de la base de données.
-
[28]
Les 240 actes d’arbitrage rédigés et enregistrés dans les fonds notariés de 1740 à 1784 témoignent immédiatement d’un déséquilibre dans la répartition des actes d’arbitrage, ce qui laisse penser à une transformation de la pratique. Ainsi, pour la période française, de 1740 à 1760, seuls 31 actes notariés concernant un arbitrage sont saisis par les notaires de la Nouvelle-France dans la même base de données : Gilles, « Arbitre », supra note 2.
-
[29]
Cette pratique est, pour certains, un « mode de traitement extra-judiciaire des conflits » qui se traduit « souvent par des règlements oraux dont la plupart échappent à l’historien » (Pascal Bastien et al, « Introduction » dans Benoît Garnot, dir, Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2007, 5 à la p 6). D’autres auteurs privilégient la notion de « distorsions entre les normes juridiques et les pratiques judiciaires » (ibid à la p 444). Les notions de parajustice et d’infrajustice sont discutées actuellement par les historiens. Voir Benoît Garnot, « Les victimes pendant l’Ancien Régime (XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles) » dans Association française pour l’histoire de la justice, La cour d’assises : Bilan d’un héritage démocratique, Paris, La Documentation française, 2001, 241 ; Benoît Garnot, « Entre communauté et institution judiciaire : le pouvoir de juger dans la Bourgogne rurale au XVIIIe siècle » dans Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey, dir, La régulation sociale entre l’acteur et l’institution, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005, 50 [Garnot, « Bourgogne »] ; F Chauvaud, « Débats » dans Benoît Garnot, dir, L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, 189 à la p 194 [Garnot, Infrajudiciaire].
-
[30]
Voir Joseph-Edmond Roy, Histoire du notariat au Canada, vol 2, Lévis, imprimé à la Revue du notariat, 1900 aux pp 54 et s [Roy, Notariat]. André Vachon parle d’une stagnation aux alentours d’une quarantaine de notaires : Vachon, Histoire, supra note 2 à la p 68.
-
[31]
Ce qui semble justifier la distinction entre notaires ruraux et notaires urbains, ces derniers étant plus qualifiés que les premiers, si l’on en croit une lettre de Panet à Jenkyns Williams qui relève que les émoluments des premiers sont inférieurs d’un tiers à ceux des notaires urbains. Cette lettre est citée par Scott, supra note 3 à la p 285.
-
[32]
Si ces notaires, lors de leur formation, eurent peu à toucher aux lettres classiques, certains d’entre eux laissèrent à la postérité des journaux, des ouvrages, comme Jean-Claude Panet et Simon Sanguinet et leur relation de la Conquête : Jean-Claude Panet, « Siège de Québec en 1759 » dans Société Littéraire et Historique de Québec, Manuscripts Relating to the Early History of Canada, 4e série, Québec, Dawson, 1875, 3 ; Richard Ouellet et Jean-Pierre Therrien, dir, L’invasion du Canada par les Bastonnois : Journal de M Sanguinet (suivi du Siège de Québec), Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1975. Louis de Courville, quant à lui, laissa un pamphlet critique sur les derniers temps du régime français (Aegidius Fauteux, « Le S... de C... enfin démasqué » (1940) 5 Cahiers des Dix 231), alors que Jean-Baptiste Lebrun fit un usage assidu de la presse, notamment afin d’alimenter ses querelles avec Jean-Claude Panet (Roy, Notariat, supra note 30 aux pp 21-24).
-
[33]
Tel que le montre le certificat d’acceptation du notaire Roy en 1765, devant ses pairs :
Nous avons été d’avis unanime, que quoique le dit Sieur Roy ne soit point positivement expert dans les Loix et Coutume, suivies en cette Colonie, il a beaucoup de bon sens Et a assez bien répondu aux différentes questions que nous luy avons faites sur les Contrats usités en cette Colonie, et qu’il peut être reçu Notaire dans les campagnes où il n’y en a point d’Établi pur la facilité des habitants en lui fixant un district, sauf à luy augmenter lorsqu’il aura travaillé pendant quelques années avec approbation.
Certificat d’acceptation du notaire Roy, 29 mars 1765, Correspondance interne, Province de Québec, Commission des notaires, tel que cité dans Scott, supra note 3 aux pp 285-286 -
[34]
Voir Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France : Le régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France, 1759-1774, vol 10, Montréal, Fides, 1999 aux pp 90-113.
-
[35]
Sur l’application de ce droit criminel, voir André Morel, « La réception du droit criminel anglais au Québec (1760-1892) » (1978) 13 : 2-3 RJT 449 ; Douglas Hay, « The Meanings of the Criminal Law in Quebec, 1764-1774 » dans Louis A Knafla, dir, Crime and Criminal Justice in Europe and Canada, Waterloo (Ont), Wilfrid Laurier University Press, 1981, 77 ; Jean-Marie Fecteau, Un nouvel ordre des choses : la pauvreté, le crime, l’État au Québec, de la fin du XVIIIe siècle à 1840, Outremont (Qc), VLB éditeur, 1989 aux pp 88-97 ; Michel Morin, « Portalis c. Bentham ? Les objectifs assignés à la codification du droit civil et du droit pénal en France, en Angleterre et au Canada » dans La législation en question : Mémoires du concours Perspectives juridiques 1999, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2000, 139 aux pp 170-171 ; Donald Fyson, Magistrates, Police, and People: Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, 1764-1837, Toronto, University of Toronto Press, 2006 aux pp 15-52 [Fyson, Magistrates]. Cette recherche brillante et exhaustive démontre une grande continuité historique dans la pratique en matière criminelle, malgré les changements normatifs. À propos de l’application de la norme criminelle dans le contexte colonial britannique, voir GD Woods, A History of Criminal Law in New South Wales: The Colonial Period, 1788-1900, Sydney, Federation Press, 2002 aux pp 298-299.
-
[36]
Voir notamment les travaux d’Hilda M Neatby, The Administration of Justice under the Quebec Act, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1937 ; Hilda Neatby, Quebec: The Revolutionary Age, 1760-1791, Toronto, McClelland and Stewart, 1966 [Neatby, Revolutionary] ; Hilda Neatby, The Quebec Act: Protest and Policy, Scarborough (Ont), Prentice-Hall of Canada, 1972. Plus récemment, voir Evelyn Kolish, Nationalismes et conflits de droits : le débat du droit privé au Québec, 1760-1840, Ville LaSalle, Hurtubise, 1994 ; Michel Morin, « Les changements de régimes juridiques consécutifs à la Conquête de 1760 » (1997) 57 : 3 R du B 689 ; Garneau, Usages, supra note 19 aux pp 60-71 ; Garneau, « Conquête », supra note 17.
-
[37]
Voir William Stewart Wallace, « The Beginnings of British Rule in Canada » (1925) 6 : 3 Canadian Historical Review 208 ; Jean-Gabriel Castel, The Civil Law System of the Province of Quebec : Notes, Cases, and Materials, Toronto, Butterworths, 1962 à la p 21 ; Michel Brunet, Les Canadiens après la Conquête, 1759-1775 : De la Révolution canadienne à la Révolution américaine, Montréal, Fides, 1969 à la p 99 ; Morel, « Réaction », supra note 9. Sur la distinction entre droit privé et droit public à cette époque, voir Georges Chevrier, « Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du ‘‘jus privatum’’ et du ‘‘jus publicum’’ dans les oeuvres des anciens juristes français » (1952) 1 Archives de philosophie du droit 5 ; David Gilles, « Jean Domat et les fondements du droit public » (2006) 25-26 Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique 95.
-
[38]
Voir David Gilles, « Les acteurs de la norme coloniale face au droit métropolitain : de l’adaptation à l’appropriation (Canada XVIIe-XVIIIe s) », en ligne : (2011) 4 Clio@Thémis <www.cliothemis.com>.
-
[39]
William Smith, « The Struggle over the Laws of Canada, 1763-1783 » (1920) 1 Canadian Historical Review 166 à la p 171 ; Neatby, Revolutionary, supra note 36 aux pp 49, 53 ; Michel Brunet, « Premières réactions des vaincus de 1760 devant les vainqueurs » (1953) 6 : 4 Revue d’histoire de l’Amérique française 506 ; Brunet, « Résistance », supra note 10 ; André Morel, Les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960 ; Morel, « Réaction », supra note 9.
-
[40]
Selon Donald Fyson, il se serait établi « an unwieldy and largely unworkable amalgam of French law and English legal structures » (Fyson, « Auxiliaries », supra note 23 à la p 384).
-
[41]
Luc Huppé, Histoire des institutions judiciaires du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007 à la p 137.
-
[42]
Simon Sanguinet fut le premier notaire à obtenir une commission à Montréal sous la domination anglaise : Jean-Jacques Lefebvre, « Notes sur Simon Sanguinet » (1933) 39 : 2 Bulletin des recherches historiques 83 ; Jean-Jacques Lefebvre, « Les premiers notaires de Montréal sous le régime anglais, 1760—1800 » (1943) 45 : 8 R du N 293 à la p 306 [Lefebvre, « Notaires »].
-
[43]
Pour une étude sur la pratique de l’arbitrage conventionnel dans le contexte québécois, et l’utilisation des différents termes, voir Marquis, « Influence », supra note 26.
-
[44]
À propos de l’activité professionnelle des notaires, voir Common, supra note 23.
-
[45]
Voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 10 à la p 391 et s.
-
[46]
Voir Fredric L Cheyette, « Suum cuique tribuere » (1970) 6 : 3 French Historical Studies 287 ; Stephen D White, « “Pactum ... Legem Vincit et Amor Judicium”: The Settlement of Disputes by Compromise in Eleventh-Century Western France » (1978) 22 : 4 Am J Legal Hist 281 ; Patrick J Geary, « Vivre en conflit dans une France sans État : Typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) » (1986) 41 : 5 Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 1107 ; Yves Jeanclos, « La pratique de l’arbitrage du XIIe au XVe siècle : Éléments d’analyse » [1999] 3 Rev arb 417 ; Hubert Janeau, « L’arbitrage en Dauphiné au Moyen Age : Contribution à l’histoire des institutions de paix » (1946-1947) 24-25 : 4 Rev hist dr fr & étran 229 ; Marc Bouchat, « La justice privée par arbitrage dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle : Les arbitres » (1989) 95 : 3-4 Le Moyen-Age. Revue d’histoire et de philologie 439 ; Jean-François Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands au Moyen Âge : L’arbitrabilité et le juge-arbitre » [1999] 1 Rev arb 3.
-
[47]
Joseph Bry, « Arbitrages provençaux du XIIIe siècle : L’arbitrage en matière commerciale » [1951] 2 Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit 13 ; Carine Jallamion, L’arbitrage en matière civile du XVIIe au XIXe siècle : L’exemple de Montpellier, thèse de doctorat en histoire du droit, Université Montpellier I, 2004 aux pp 123-45.
-
[48]
Voir Yves Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne aux XIIe et XIVe siècle : Étude de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon, Centre de recherches historiques, 1977 ; Soman, supra note 24 ; Garnot, Infrajudiciaire, supra note 29 ; Serge Dauchy, « Les recours contre les sentences arbitrales au Parlement de Paris (XIIIe et XIVe siècles) : La doctrine et la législation à l’épreuve de la pratique judiciaire » (1999) 67 : 3-4 Rev hist dr 255 ; Garnot, « Bourgogne », supra note 29 ; Hayhoe, supra note 24 à la p 621 ; Ferrand, « Herméneutique », supra note 24 ; Anne Bonzon, « Conflits familiaux et médiation cléricale dans la France du XVIIe siècle » dans Serge Dauchy et al, dir, La résolution des conflits, Justice publique et justice privée : une frontière mouvante, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 2008, 116 ; Jérôme Ferrand, « Entre volontarisme législatif et jurisprudence réactionnaire : les vicissitudes de l’arbitrage dans la France Moderne (XVIe – XVIIIe siècle) » (2009) 77 Rev hist dr 103 [Ferrand, « Volontarisme »].
-
[49]
Voir Édit sur l’exécution des sentences arbitrales et sur la juridiction qui doit connaître de l’appel de ces sentences, août 1560, no 38, reproduit dans Isambert, Decrusy et Taillandier, dir, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, t 14, Paris, Belin-Leprieur, 1829, 49 ; Édit portant que tous différens entre marchands pour fait de leur commerce, les demandes de partage et les comptes de tutelle et administration seront renvoyés à des arbitres, août 1560, no 39, reproduit dans ibid, 51 [Édit portant sur les marchands] ; Ordonnance sur la réforme de la justice, février 1566, no 110, art 83, reproduit dans ibid, 189.
-
[50]
Ordonnance civile touchant la réformation de la justice, avril 1667, no 503, reproduit dans Isambert, Decrusy et Taillandier, supra note 49, t 18, 103 [Ordonnance de 1667], tel que cité dans Ferrand, « Volontarisme », supra note 48 aux pp 146-155. On y précise certaines modalités de l’arbitrage, notamment en précisant que le juge peut être récusé s’il a « connu auparavant du différend comme juge ou comme arbitre » (ibid à la p 146, titre 24, art 6) ; en autorisant les parties majeures à procéder à une reddition de comptes « devant des arbitres ou à l’amiable » (ibid, titre 29, art 22) ; enfin en obligeant les arbitres à « condamner indéfiniment aux dépens celui qui succombera[it] ; si ce n’est que par le compromis, il y eût clause expresse portant pouvoir de les remettre, modérer et liquider » (ibid, titre 31, art 2).
-
[51]
À ce sujet, l’article 1 du titre 21 prévoit que les juges « ne pourront faire descente sur les lieux dans les matières où il n’écheoit qu’un simple rapport d’experts, s’ils n’en sont requis par écrit par l’une ou l’autre des parties » (Ordonnance de 1667, supra note 50 à la p 140). Par ailleurs, l’article 8 du même titre offre cette précision :
Les jugements qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir par-devant le commissaire.
ibid à la p 141Le jour dit, les parties devront s’entendre sur le choix d’un expert ou en nommer chacun un, sans quoi le commissaire le fera pour celle qui s’y refuse (ibid, titre 21, art 9). En cas de désaccord entre les experts ainsi nommés, le juge en nomme d’office un troisième, afin qu’ils lui soumettent un ou plusieurs rapports (ibid à la p 142, titre 21, art 13).
-
[52]
Ainsi, dans la dernière édition de l’oeuvre de Denisart, on peut lire que les arbitres nommés selon les termes de l’Ordonnance du commerce de 1673 « exercent, pour ainsi dire, le ministère d’experts chargés d’examiner les actes, livres & opérations de la société, & de leur donner leur avis, lequel n’est pas toujours adopté par les consuls, lors même que ce sont eux qui ont nommé les arbitres » (Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t 2, Paris, Desaint, 1783 à la p 239). À Paris, au dix-huitième siècle, la juridiction consulaire nomme d’office un ou plusieurs « arbitres-rapporteurs » qui ne sont pas des juristes, sans être tenue de suivre leur avis : Jean Hilaire, « L’arbitrage dans la période moderne (XVIe-XVIIIe siècle) » [2000] 2 Rev arb 187 aux pp 221-25.
-
[53]
Projets de Réglemens qui semblent être utiles en Canada, proposés à Messieurs de Tracy et de Courcelles par M. Talon, janvier 1667, reproduit dans Arrêts et réglements du Conseil Supérieur de Québec, et ordonnances et jugements des intendants du Canada, t 2, Québec, ER Fréchette, 1855, 29 aux pp 29-30. Un arrêt du Conseil ordonne que ce projet sera enregistré « pour y avoir recours quand besoin sera » : Ordonnance du Conseil Supérieur au sujet des Réglemens concernant la Justice et Police, reproduit dans ibid, 28 à la p 29. Néanmoins, les dispositions prévoyant la nomination de juges dans les campagnes ne furent jamais appliquées : John Alexander Dickinson, Justice et justiciables : La procédure civile à la prévôté de Québec, 1667-1759, Québec, Presses de l’Université Laval, 1982 à la p 61 [Dickinson, Justice]. Celles concernant la nomination d’arbitres ont été remplacées par l’Ordonnance de 1667, supra note 50. Sur les pratiques sociales favorables à l’arbitrage en Nouvelle-France, voir Jacques Mathieu, « La vie à Québec au milieu du XVIIe siècle : étude des sources » (1969) 23 : 3 Revue historique de l’Amérique française 404 ; Dickinson, Justice, supra note 53 aux pp 60-65 ; Serge Dauchy, « Stratégies coloniales et instruments judiciaires en Nouvelle-France (1663-1703) » dans B Durand, La justice et le droit : Instruments d’une stratégie coloniale, Annexes, Montpellier, Dynamiques du droit, 2000, 1201.
-
[54]
Gaspard de Réal, La science du gouvernement, contenant le droit naturel ; qui traite de l’existence & de la connaissance de la vérité, de l’amour de Dieu, de l’amour de soi-même, de l’amour du prochain, de l’ordre & de la subordination des devoirs, t 3, Paris, Desaint & Saillant, 1761, ch 4 aux pp 336-337.
-
[55]
« Des Compromis » dans Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ;le droit public, et legum delectum, t 1, Paris, Bauche, 1756, livre 1, titre 14, 125 ; « Des Arbitres » dans Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ;le droit public, et legum delectum, t 2, Paris, Nyon, 1777, livre 2, titre 7, 266.
-
[56]
Voir David Gilles, La pensée juridique de Jean Domat (1625-1696) : Du Grand siècle au Code civil, thèse de doctorat en droit, Université Paul Cézanne, 2004 à la p 548.
-
[57]
« Procès » dans Louis Bouchel, La bibliothèque ou thresor du droict francois, t 2, Paris, Gesselin, 1615 à la p 534. Selon lui, la force symbolique remonterait à l’action du préteur romain, obligé de recevoir et d’approuver les transactions entre particuliers désirant transiger :
Nul n’est tenu d’agir ou d’accuser si bon ne luy semble, c’est-à-dire, il est permis à chacun de remettre son droict & sur iceluy transiger. [...] Car que fait autre chose le Préteur, sinon qu’il dirime & termine les différents des particuliers ? Desquels s’ils s’en départent volontairement, il le doit approuver. [...] Doncques ès délicts privé, sans doute il est loisible de pactiser & transiger, soit devant la contestation en cause, soit après [...].
« Transaction » dans ibid à la p 1190 -
[58]
Daniel Jousse, Traité de l’administration de la justice, t 2, Paris, Debure, 1771 à la p 692.
-
[59]
Couchot, Le praticien universel, ou le droit françois, et la pratique de toutes les jurisdictions du Royaume, t 1, 9e éd, Paris, Jacques Rolin, 1747 à la p 90. À propos des questions qui ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, Ferrière mentionne notamment les délits (sauf pour l’indemnité due à la victime), les legs d’aliments, les causes de mariage et les bénéfices : Claude-Joseph de Ferrière, La science parfaite des notaires ou le parfait notaire, t 2, Paris, Mouchet, 1752, livre 14, ch 1 à la p 426.
-
[60]
Bartholomé-Joseph Bretonnier, dir, Oeuvres de M Claude Henrys, t 1, 6e éd, Paris, Libraires associés, 1772 à la p 439.
-
[61]
L’édit d’août 1560 comportait déjà, en son article premier, des dispositions favorables à l’arbitrage « pour fait de marchandise » (Édit portant sur les marchands, supra note 49 à la p 51). L’article 9 du titre 4 de l’Ordonnance du commerce de 1673 renvoie quant à lui à l’arbitrage pour l’examen des différends entre associés.
-
[62]
Ainsi, dans un édit de 1673, le pouvoir royal souligne que, par cette procédure « si utile et si nécessaire au public [...] les procès les plus embarrassés sont terminés, et la paix et l’union conservée dans les familles » : Édit portant création de banquiers expéditionnaires en la Cour de Rome, de greffiers des arbitrages et compromis, syndicats et direction de créanciers, avec attribution de la qualité de notaire, mars 1673, no 729, reproduit dans Isambert, Decrusy et Taillandier, supra note 49, t 19, 107 à la p 109.
-
[63]
Voir Daniel E Murray, « Arbitration in the Anglo-Saxon and Early Norman Periods » (1961) 16 : 4 Arbitration Journal 193. Voir aussi Wendy Davies et Paul Fouracre, dir, The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 ; Edward Powell, « Arbitration and the Law in England in the Late Middle Ages: The Alexander Prize Essay » (1983) 33 Transactions of the Royal Historical Society 49 [Powell, « Middle Ages »] ; Simon J Payling, « Law and Arbitration in Nottinghamshire, 1399-1461 » dans Joel Rosenthal et Colin Richmond, dir, People, Politics and Community in the Later Middle Ages, New York, Gloucester (R-U) ; St Martin’s Press, Allan Sutton, 1987, 140 ; JB Post, « Equitable Resorts before 1450 » dans EW Ives et AH Manchester, Law, Litigants and the Legal Profession, Londres (R-U), Swift Printers pour la Royal Historical Society, 1983, 68 aux pp 74-77 ; Lorraine Attreed, « Arbitration and the Growth of Urban Liberties in Late Medieval England » (1992) 31 : 3 Journal of British Studies 205 ; Llinos Beverley Smith, « Disputes and Settlements in Medieval Wales: The Role of Arbitration » (1991) 106 : 421 English Historical Review 835 ; Edward Powell, « Settlement of Disputes by Arbitration in Fifteenth-Century England » (1984) 2 : 1 LHR 21 ; Joseph Biancalana, « The Legal Framework of Arbitration in Fifteenth-Century England » (2005) 47 : 4 Am J Legal Hist 347 ; JA Sharpe, « Such Disagreement betwyx Neighbours’ : Litigation and Human Relations in Early Modern England » dans John Bossy, dir, Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, 167. À la fin du dix-huitième siècle, Stewart Kyd relève que, souvent, des clauses de contrat prévoient le recours à l’arbitrage en cas de différends ultérieurs : Stewart Kyd, A Treatise on the Law of Awards, 2e éd, Philadelphia, William P Farrand, 1808 à la p 12 [Kyd, Awards].
-
[64]
Douglas Hurt Yarn, « Commercial Arbitration in Olde England (602-1698) » (1995) 50 : 1 Disp Resol J 68 à la p 68. Cette institution des lovedays, devenue largement obsolète au dix-septième siècle, se retrouve toutefois sous la plume de l’auteur de l’Arbitrium Redivivum. Il souligne qu’en saxon ou en anglais ancien, l’arbitrage était appelé Love-day « en raison du calme et de la tranquillité qui devraient suivre la fin de la controverse » [notre traduction], alors que le terme award trouve son origine dans l’ancien français Agarder : Auteur de Regula Placitandi, Arbitrium Redivivum : Or the Law of Arbitration, London, R et E Atkins, 1694 à la p 2 [Arbitrium Redivivum].
-
[65]
Yarn, supra note 64 à la p 69.
-
[66]
Powell, « Middle Ages », supra note 63 ; William C Jones, « An Inquiry into the History of the Adjudication of Mercantile Disputes in Great Britain and the United States » (1958) 25 : 3 U Chicago L Rev 445.
-
[67]
Voir Paul R Teetor, « England’s Earliest Treatise on the Law Merchant: The Essay on Lex Mercatoria from The Little Red Book of Bristol (circa AD 1280) » (1962) 6 : 2 Am J Legal Hist 178 ; Leon E Trakman, « From the Medieval Law Merchant to E-Merchant Law » (2003) 53 : 3 UTLJ 265.
-
[68]
JH Baker, « The Law Merchant and the Common Law before 1700 » (1979) 38 : 2 Cambridge LJ 295 à la p 303.
-
[69]
Sur cette institution, voir Charles A Banes, « From Holt and Mansfield to Story to Llewellyn and Mentschikoff: The Progressive Development of Commercial Law » (1983) 37 U Miami L Rev 351 à la p 353.
-
[70]
Yarn, supra note 64 à la p 70.
-
[71]
On trouve également, dans cette logique et pour un contentieux de nature davantage pénale ou civile, l’existence de « keepers of the peace » qui agissent largement sur les fondements de l’arbitrage et dont la fonction donnera naissance aux juges de paix, qui agiront eux aussi abondamment en matière arbitrale dans le contexte britannique et dans la province de Québec, après la Conquête : Bertha Haven Putnam, « The Transformation of the Keepers of the Peace into the Justices of the Peace 1327-1380 » (1929) 12 Transactions of the Royal Historical Society 19.
-
[72]
Douglas Hurt Yarn rapporte ainsi une affaire ayant eu lieu en 1389, opposant deux marchands, Costace v Forteneye (1389), pour un litige portant sur une importation de vins gascons. Une fois le procès ouvert, aucun juré ne s’est présenté et les parties, arguant de leur « désir libre et spontané » [notre traduction] (Yarn, supra note 64 à la p 70), souhaitent un arbitrage par quatre membres de la guilde des marchands de vin choisis par Robert Herry, un autre marchand de vin. Dans cette affaire, comme ce sera le cas dans nombre d’affaires pendantes devant la Cour des plaidoyers communs à Québec ou à Montréal, le tribunal donne un effet immédiat et exécutoire à la décision des arbitres, comme l’un de ses propres jugements. De plus, on observe déjà la difficulté de réunir un jury et l’utilité de l’arbitrage afin de pallier cette lacune : ibid aux pp 69-72.
-
[73]
L’arbitrage étant, dans ce contexte, largement le fait des juridictions mercantiles. Voir Mary Elizabeth Basile et al, dir, Lex Mercatoria and Legal Pluralism: A Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife, Cambridge, Ames Foundation, 1998.
-
[74]
Comme le souligne Michel Morin, il s’agit alors d’une clause pénale, résolue en cas d’exécution du compromis ou de la sentence par la partie perdante : « En général, dans un document de cette nature, les cours de common law refusent au débiteur le droit de contester l’existence ou le montant de la dette. Cette pratique est attestée dès le XIIIe siècle » : Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 1 à la p 81. Voir Joseph Biancalana, « Monetary Penalty Clauses in Thirteenth-Century England » (2005) 73 : 3-4 Revue hist dr 231 aux pp 255-256.
-
[75]
Kyd, Awards, supra note 63 à la p 21. Auteur de plusieurs ouvrages portant essentiellement sur les obligations et le droit commercial (il publia A Treatise on the Law of Bills of Exchange and Promissory Notes, Dublin, G Burnet, 1791 et A Treatise on the Law of Corporations, London (R-U), Butterworth, 1793), Stewart Kyd fut séduit par les principes de la Révolution française, ce qui lui valut d’être traîné devant l’Old Bailey pour haute trahison en 1794, accusation pour laquelle il obtint un acquittement. Il décéda en 1811 : John Hutchinson, A Catalogue of Notable Middle Templars, London, Butterworth pour l’Honourable Society of the Middle Temple, 1902 à la p 139.
-
[76]
John March, Actions for Slaunder, or, A Methodical Collection under certain Grounds and Heads: Awards or Arbitrements, London, M Walbank et R Best, 1647.
-
[77]
« To the Reader » dans Arbitrium Redivivum, supra note 64 à la p 1.
-
[78]
Henry Horwitz et James Oldham, « John Locke, Lord Mansfield and Arbitration during the Eighteenth Century » (1993) 36 : 1 Historical Journal 137 aux pp 141-142 [Horwitz et Oldham, « Locke »].
-
[79]
Arbitrium Redivivum, supra note 64 à la p 10.
-
[80]
Horwitz et Oldham, « Locke », supra note 78 à la p 141.
-
[81]
John Locke, membre du Board of Trade, fut chargé de proposer plusieurs projets de réformes sociales et économiques. Il aurait été mandaté pour jeter les bases d’une méthode permettant de résoudre les différends entre marchands par des arbitres nommés soit par les parties, soit suite à un renvoi par la cour (referees), afin que leurs décisions soient définitives et sans appel. Inspiré des exemples hollandais d’arbitrages, jugés toutefois trop complexes et éloignés des aspirations insulaires, le projet de législation s’appuiera néanmoins principalement sur la longue expérience anglaise, n’utilisant qu’avec parcimonie l’exemple batave : ibid à la p 139.
-
[82]
An Act for determining Differences by Arbitration, (R-U), 1698, 9 & 10 Will III, c 15 [Arbitration Act].
-
[83]
Horwitz et Oldham, « Locke », supra note 78 à la p 143 ; Yarn, supra note 64 à la p 72.
-
[84]
Arbitration Act, supra note 82.
-
[85]
Matthew Bacon définit le terme et la pratique de la manière suivante : « Arbitrament (Arbitrium, Laudum, Compromissium), or an Award, is the determination of two or more Persons, at the Request of two Parties at least, who are at Variance, for ending the Controversy without publick Authority » (The Compleat Arbitrator ; or the Law of Awards, 3e éd, Londres (R-U), J Worrall et B Tovey, 1770 à la p 1).
-
[86]
Selon Bacon, ibid à la p 1 :
[i]t is called an Arbitrament, because that the Parties have willingly submitted their Differences to others, to determine them arbitrarily, and according to their own Opinions and Judgments as honest and disinterested Men, and not according to the Law. It is called an Award from the French Word Agarder, which signifies to judge or decide ; an it is heretofore been called Love-Day, because of the Quiet and Tranquillity which usually followed the Ending of the Controversy.
-
[87]
Ibid aux pp 33-34.
-
[88]
William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, t 3, Oxford, Clarendon Press, 1768, ch 1 à la p 16.
-
[89]
Voir WF Leemans, « Juge ne peut accepter arbitrage : L’application de cette règle dans la Principauté d’Orange et une sentence arbitrale en langue provençale » (1978) 46 Rev hist dr 99.
-
[90]
Horwitz et Oldham, « Locke », supra note 78 à la p 146.
-
[91]
Les deux premières catégories l’emportent largement sur la troisième. Celle-ci comprend des arpenteurs et des marchands, mais aussi un petit nombre d’avocats (environ dix pour cent en 1775) (ibid aux pp 145-150).
-
[92]
James Oldham, « Arbitral Continuity: Part I. On the Constancy and Pedigree of the Arbitrator’s Heritage » dans Gladys W Gruenberg, dir, Arbitration 1994: Controversy and Continuity, Washington (DC), Bureau of National Affairs, 138 à la p 138.
-
[93]
Bruce H Mann, « The Formalization of Informal Law: Arbitration before the American Revolution » (1984) 59 : 3 NYUL Rev 443. Cet article fut réédité dans l’ouvrage suivant : Bruce H Mann, Neighbors and Strangers: Law and Community in Early Connecticut, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1987, ch 4 aux pp 101 et s [Mann, Neighbors].
-
[94]
James B Boskey, « A History of Commercial Arbitration in New-Jersey: Part 1 » (1976) 8 : 1 Rutgers-Camden LJ 1 ; Georges S Odiorne, « Arbitration Under Early New Jersey Law » (1953) 8 : 3 Arbitration Journal 117.
-
[95]
Eben Moglen, « Commercial Arbitration in the Eighteenth Century: Searching for the Transformation of American Law » (1983) 93 : 1 Yale LJ 135.
-
[96]
Edwin B Bronner, « Philadelphia County Court of Quarter Sessions and Common Pleas » (1957) 1 : 1 Am J Legal Hist 79 à la p 85 ; Georges S Odiorne, « Arbitration and Mediation Among Early Quakers » (1954) 9 : 3 Arbitration Journal 161.
-
[97]
Joseph H Smith, dir, Colonial Justice in Western Massachusetts, (1639-1702), Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1961 aux pp 180-188.
-
[98]
Elwyn L Page, Judicial Beginnings in New-Hampshire, 1640-1700, Concord (NH), Evans Printing pour la New Hampshire Historical Society, 1959 aux pp 5-54.
-
[99]
Ainsi, comme le souligne Michel Morin, l’article de Susan L Donegan, en exposant un large éventail de la pratique arbitrale et la résolution amiable des différends comme particularisme juridique colonial, met l’accent sur le lien entre la pratique et les aspirations de paix et d’harmonie qui guident les premiers colons, notamment les puritains : Susan L Donegan, « ADR in Colonial America: A Covenant for Survival » (1993) 48 : 2 Arbitration Journal 14 ; Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 1 à la p 91, n 342.
-
[100]
Herbert Alan Johnson, The Law Merchant and Negotiable Instruments in Colonial New York, 1664 to 1730, Chicago, Loyola University Press, 1963 aux pp 15-27 ; William H Loyd, The Early Courts of Pennsylvania, Boston, Boston Book Company, 1910 aux pp 15-16, 48-49 ; Susie M Ames, « Introduction » dans Susan M Ames, dir, County Court Records of Accomack-Northampton, Virginia, 1632-1640, Binghamton (NY), Vail-Ballou Press, 1954 aux pp lv-lix ; Page, supra note 98 à la p 5 ; David Thomas Konig, Law and Society in Puritan Massachusetts: Essex County, 1629-1692, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1979 aux pp 33, 108-116 (il recense vingt cas de renvois à l’arbitrage par les magistrats de Salem et d’Ipswich entre 1636 et 1643 dans des causes civiles) ; Kenneth A Lockridge, A New England Town, The First Hundred Years: Dedham, Massachusetts, 1636-1736, New York, Norton, 1985 à la p 6 ; Mann, Neighbors,supra note 95 aux pp 101-136 ; William E Nelson, The Common Law in Colonial America: The Chesapeake and New England, 1607-1660, vol 1, New York, Oxford University Press, 2008. Ce dernier donne des exemples de renvois à l’arbitrage par les juges de ces juridictions : Virginie (ibid à la p 29), Essex (ibid à la p 72) et Plymouth (ibid aux pp 177-178, nn 56-60).
-
[101]
John R Aiken, « New Netherlands Arbitration in the 17th Century » (1974) 29 Arbitration Journal 145.
-
[102]
Moglen, supra note 95 à la p 136.
-
[103]
On relate, devant la juridiction du Mayor’s Court, que « [a] vast quantity of litigation was referred ... to “good men” or arbitrators, appointed by the bench or selected by the litigants » : Richard B Morris, dir, Select cases of the Mayor’s Court of New York City, 1674-1784, Washington (DC), Millwood (NY) ; American Historical Society, Kraus Reprint, 1935 à la p 44.
-
[104]
Moglen, supra note 95 aux pp 139-141.
-
[105]
Décembre 1768, reproduit dans CZ Lincoln, WH Johnson et AJ Northrup, dir, Colonial Laws of New York from the Year 1664 to the Revolution, vol 4, Albany, James B Lyon, State Printer, 1894 à la p 1040, tel que cité dans Moglen, supra note 95 à la p 142.
-
[106]
Moglen, supra note 95 à la p 143.
-
[107]
Zephaniah Swift, A System of the Laws of the State of Connecticut, Windham (Conn), John Byrne, 1796, vol 2, livre 4, ch 1 à la p 7.
-
[108]
Ibid.
-
[109]
Mann, Neighbors, supra note 95 à la p 104.
-
[110]
James Oldham, English Common Law in the Age of Mansfield, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004 à la p 73 [Oldham, Mansfield].
-
[111]
Mann, Neighbors, supra note 95 à la p 111.
-
[112]
(7 janvier 1660), reproduit dans Bernard Christian Steiner, dir, Proceedings of the Provincial Court of Maryland, 1658-1662, vol 41, Baltimore, Maryland Historical Society, 1922 à la p 389 :
Whereas matters of difference debate and Controversy have rissen and happened betweene Mr Augustine Herman Marchant and Mr Symon Overzee deceased, and now is become of Concearnment into Mrs Elizabeth Overzee as Successour and Administratrix to the said Mr Overzee her deceased husband for pacifying ordering and ending whereof Mr John Bateman and Mr Henry Meese Marchants were mutually chossen by the aforesaid parties Mr Augustine Herman and Mrs Elizabeth Overzee to arbitrat and deside the Controversies aforesaid in Case they had agreed therein, but the said Arbitrators differing in their Judgments about the said buisnes the said Mr Augustine Herman and Mrs Elizabeth Overzee have bound themselves each to other in a Bond of One thowsand pounds sterling to stand also to the Umpiradge and award of Robert Slye aforesaid as by the said Obligations and Conditions doth and may at large appeare.
-
[113]
Reproduit dans ibid à la p 440.
-
[114]
Au sein de la première, on note plusieurs références à l’arbitrage. Une analyse succincte de ces archives publiées montre une utilisation relativement soutenue de la procédure arbitrale, dès le dix-septième siècle. Lors des audiences de la Provincial Court de 1658 à 1662, on trouve un peu moins d’une dizaine d’affaires où l’arbitrage est en cause. Ainsi, le 28 avril 1658 est renvoyée en arbitrage la cause Trueman v Stephenson, reproduite dans ibid à la p 70, au sujet d’une dette de trois livres de tabac.
-
[115]
Mr Tilghman’s Bond to Mr Packer, reproduit dans ibid à la p 94 [Tilghman].
-
[116]
Allso it is further agreed Betweene the parties abovesed, that if there shall happen any difference betwixt Mr Thomas Gerard, & Mr Henry Meese that shall rest unresolved on: then the parties abovesed doe ioyntly chuse Mr Robert Slye as an Umpyre to make a finall conclusion.
ibid -
[117]
Voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 1 à la p 52.
-
[118]
I Samuel Tilghman of Racliffe Maryner doe acknowledge my selfe indebted unto Edward Packer & Henry Parnel of the Province of Maryland Gentleman the summe of five hundred pownds sterl, to be payd uppon all demands. ... To whose judgment wee likewise referre or selves, uppon penalty of the sumsett above mentioned .
Tilghman, supra note 115 à la p 94 -
[119]
Ibid à la p 95 :
Wee award Mr Edward Packer to resigne over all his right, tytle, & interest, which doth belong to him of the said Plantation, goods & chattles, or of any of the Estate, thing or things, that is in Copartnership betweene Captain Samuel Tilghman, Henry Parnell & the said Edward Packer unto Mr Henry Parnell within fowrteene days.
Wee award Mr Henry Parnell to pay unto Mr Edward Packer fourteene thowsand pownds weight of good Tob[acco], & cask, (Viz) Sixe Thowsand weight of Tob[acco] & cask present, fowre Thowsand weight of Tob[acco], in November next & fowre thowsand weight of Tob[acco] in Ano (59). And that the said Mr Henry Parnell shall give the said Mr Edward Packer good security for the payment of the abouesed summe of Tob[acco].
Wee award Mr Henry Parnell for himselfe, & Captain Samuel Tilghman shall give the said Mr Edward Packer a generall release, concerning the whole busines, about the plantation & those things that did or doe belong thereunto. And allso the said Mr Edward Packer shall give a generall release to Mr Parnell for himselfe & Captain Tilghman. This is the finall determination & award of Vs, whose names are subscribed here untothe 6th day of March 1657.
-
[120]
Voir Mann, Neighbors, supra note 95.
-
[121]
Kyd, Awards, supra note 63 à la p 70.
-
[122]
Celui-ci figure, au moment de l’invasion américaine (1775-1776), parmi les principaux notables de la ville de Montréal. Il décrit d’ailleurs l’invasion américaine dans son journal, mentionné précédemment (Ouellet et Therrien, supra note 32). Proche de Guy Carleton, il n’a cessé de faire valoir ses positions loyalistes. Probablement en reconnaissance des services rendus aux autorités de la province, il est nommé juge de la Cour des plaidoyers communs dans le district de Montréal en décembre 1788 : Yves-Jean Tremblay, « Simon Sanguinet » dans Dictionnaire biographique du Canada, 1771 à 1800, vol 4, Québec, Presses de l’Université Laval, 1980, 755 [Dictionnaire biographique du Canada].
-
[123]
Il fut « coroner en 1764, avocat en 1765, greffier de la Paix en 1766, greffier de la Cour des plaidoyers communs en 1776, de nouveau notaire en 1783, protonotaire et greffier de la Cour du Banc du roi en 1794 » (Lefebvre, « Notaires », supra note 42 à la p 306).
-
[124]
Gray notamment, malgré une commission de 1765 qui s’étend en 1781 à toute la province, a fort peu instrumenté en tant que notaire et semble avoir essentiellement vécu de ses fonctions d’avocat et de fonctionnaire au sein de l’administration britannique (ibid à la p 311).
-
[125]
Ce dernier, avocat dans la colonie depuis 1768, fût commissionné par le général David Wooster, lors de l’occupation américaine de Montréal (ibid à la p 318).
-
[126]
Ibid aux pp 312-313.
-
[127]
Vente d’une maison de pièce sur pièce dans la ville de Montréal par Pierre Mézière et son épouse à Jean Billeton-Desbruyeres (Pierre Panet de Méru, 11 août 1764), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2734, minute 2179) ; Vente de terre située au coteau St Louis près de Montréal par Luc de Chapt de Lacorne de Saint Luc à Pierre Mézière et son épouse (Pierre Panet de Méru, 26 avril 1769), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2735, minute 3190) ; Vente de terre située au coteau St Louis près de Montréal par Louis Hubert dit Lacroix et son épouse à Pierre Mézière et son épouse (Pierre Panet de Méru, 26 février 1772), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2736, minute 3804) ; Sentence arbitrale (Pierre Panet de Méru, 07 juin 1766), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2734, minute 2582) ; Actes du notaire Claude Louet, Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879). Concernant le volume d’activité, il est très variable, mais un notaire urbain peut instrumenter jusqu’à 400 actes par an de manière exceptionnelle, une activité médiane se trouvant toutefois entre 150 et 200 actes par an (comme Pierre Panet de Méru (notaire), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2732 à 2738)).
-
[128]
David Gilles, « Le notariat canadien face à la Conquête anglaise : l’exemple des Panet » dans Vincent Bernaudeau et al, dir, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, 189.
-
[129]
Roy, Notariat, supra note 30 à la p 56 ; Acte de Québec de 1774 (R-U), 14 Geo III, c 83, reproduit dans Shortt et Doughty, supra note 12, 552 [Acte de Québec].
-
[130]
Ainsi Jean Delisle, accompagné de Jean-Baptiste Adhémar de St-Martin, appartenant à une famille de notaires, portèrent tous deux à la Cour de Saint James, en 1787, une supplique demandant pour les Canadiens les prérogatives de l’habeas corpus, qui leur sera accordée un an plus tard : Lefebvre, « Notaires », supra note 42 à la p 313.
-
[131]
Voir par ex la procuration confiée à Pierre Mézière de Jean Lees, négociant de Québec, pour lui et pour Alexandre Davison, son associé, enregistrée dans son greffe par Pierre Panet de Méru, 29 septembre 1777, Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2737, minute 4761).
-
[132]
Jean-Philippe Garneau a fait le même constat pour les avocats de la région de Québec dans les années 1780 : « Une culture de l’amalgame au prétoire : les avocats de Québec et l’élaboration d’un langage juridique commun au tournant des XVIIIe et XIXe siècles » (2007) 88 : 1 Canadian Historical Review 113 [Garneau, « Amalgame »]. Les anciens sujets, colons ou administrateurs d’origine britannique recourent fréquemment aux avocats-notaires d’origine française afin d’encadrer juridiquement leur implantation. Ainsi, Adam Mabane, juge à la Cour des plaidoyers communs, agit en 1772 comme fondé de procuration de John Lockhart, lieutenant du quinzième régiment, afin de vendre des rentes au notaire Jean-Antoine Panet, l’acte étant instrumenté par Jean-Antoine Saillant de Collégien, 18 juillet 1772, Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 11530, minute 2319). Après l’Acte de Québec, on retrouve ces mêmes types d’actes, comme la cession de bail conclue par James Park, l’un des marchands nouvellement installés à Québec, et Thimotée Devine, l’acte étant rédigé et enregistré par Jean-Antoine Panet, 25 janvier 1779, Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 1284, image 208). Les notaires Panet semblent participer ainsi, comme procureurs, à l’essor des transactions entre la colonie et la capitale londonienne. Il en est ainsi dans l’acte instrumenté par le notaire Sanguinet à Montréal, conservant l’obligation de Laurent Ermatinge, négociant rue Saint-Paul, peut-être d’origine anglophone, envers Pierre Panet, agissant pour Brook Watson et Robert Rashleigh, négociants à Londres : Obligation de Laurent Ermatinge à Brook Tawson et Robert Rashleigh (Simon Sanguinet (fils), 31 mars 1778), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2686, minute 1208).
-
[133]
C’est le cas notamment de Jean-Antoine Panet, qui enregistre dans son greffe des actes dans cette langue, pour des clients anglophones. Il en est ainsi d’une « Collation of a promissory note by Penelope Vassal, to Lewis Robicheau » rédigée le 14 mars 1772, (Jean-Antoine Panet, 9 juillet 1784), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 1286).
-
[134]
Cela est le cas essentiellement dans les fonds des Panet de la ville de Québec puisqu’il s’agit du premier lieu d’implantation des colons et surtout des marchands anglais. Ainsi est instrumenté au greffe de Jean-Antoine Panet, l’avis arbitral rendu entre deux négociants de la ville de Québec, Henry Boone et Edward Watts, où l’amiable compositeur est Antoine Vialard, négociant en la même ville : Sentence arbitrale (Jean-Antoine Panet, 21 mai 1777), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 1284, image 694).
-
[135]
Dans les fonds des notaires Panet, on note l’absence totale d’actes instrumentés sur la base du droit anglais, et cela antérieurement à l’Acte de Québec. La seule adaptation à la nouvelle pratique semble la conversion en livre sterling des amendes. On trouve, pour l’année 1779, 42 actes faisant intervenir au moins une partie anglophone — si l’on prend comme critère de nationalité la consonance du nom — sur un total de 217 actes au sein du greffe de Jean-Antoine Panet, 1779, Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilms 1284-85).
-
[136]
Dans cette sentence arbitrale de 1768, relative à un partage de succession des biens nobles de la famille Boucher entre les Boucher de Boucherville, Boucher de Grandpré, Boucher de Grandbois et les Boucher de Niverville, il est prévu le paiement de 150 livres sterling en cas de non-respect du compromis arbitral rédigé par Pierre Panet et Pierre Mézière : Partage de succession de ladite feue Louise Boucher (Pierre Panet de Méru, 30 juillet 1768), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2735, minute 3027).
-
[137]
Geneviève Postolec, « Le mariage dans la Coutume de Paris : normes et pratiques à Neuville aux XVIIe et XVIIIe siècles » dans Sylvie Dépatie et al, dir, Vingt ans après Habitants et marchands : lectures de l’histoire des XVIIeet XVIIIe siècles canadiens, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1998, 208 ; Garneau, « Amalgame », supra note 132.
-
[138]
Pour un aperçu de la pratique en matière de liberté testamentaire, voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 10 à la p 278, n 959.
-
[139]
Procuration de Jean-Claude Panet à son épouse (Simon Sanguinet (fils), 5 octobre 1765), disponible dans Parchemin, Archives nationales du Québec.
-
[140]
Sur cette question, voir David Gilles, « La condition juridique de la femme en Nouvelle-France : essai sur l’application de la Coutume de Paris dans un contexte colonial » (2002) 1 Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre-mer français 77. Voir aussi Contrat de mariage entre Jean-Pierre Amont et Marie-Thérèse Frâdet (Joseph-Barthelemy Richard, 11 novembre 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 6716, image 955).
-
[141]
Marie-Céline Blais, « Charles-François Tarieu de Lanaudière » dans Dictionnaire biographique du Canada, supra note 122 aux pp 791-92 :
En 1766, il signa, avec d’autres seigneurs du district de Québec, l’adresse destinée au gouverneur Murray à l’occasion de son départ. Lorsqu’en 1769 le gouverneur Guy Carleton demanda à Londres que les membres de la noblesse canadienne puissent entrer au Conseil de Québec, il suggérait, parmi 12 noms, celui de Tarieu de La Naudière. Effectivement, ce dernier devint membre du Conseil législatif créé en 1775 par l’Acte de Québec, pour la première fois ouvert aux catholiques.
-
[142]
Contrat de mariage (Pierre Panet de Méru, 8 avril 1769), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2735, minute 3186).
-
[143]
En février 1772, le notaire Leguay utilise une formulation similaire : « les dits futurs époux unis en communauté en tous biens meubles, conquêts, immeubles suivant audites fins la coutume anciennement suivies en ce païs conformément à laquelle leur dite communauté sera réglée, renonçant à ces effets à toutes coutume ou loix contraire » : Contrat de mariage entre André Poudret et Josèphe Robert, (François Leguay (père), 15 février 1772), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2143, minute 7).
-
[144]
Contrat de mariage entre Thomas Laramée et Charlotte Lafontaine, (François Leguay (père), 10 octobre 1772), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2143, minute 23).
-
[145]
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Piete et Marie-Josèphe Leroux (François Racicot, 6 novembre 1774), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 3189, minute 1251).
-
[146]
Le contrat se poursuit de la manière suivante : « Ledit futur époux apporte à [...] ladite future épouse de la somme de trois cent livres ou schillings actuels de la Province [à titre] de douaire ; ce douaire sera une fois payé à savoir et prendre dès que douaire aura lieu sur les plus claires et mieux apparent biens du dit futur époux dont elle sera saisie suivant ladite coutume » (ibid).
-
[147]
Comme en témoigne ce contrat de mariage instrumenté le 22 juillet 1775 par le notaire Rigaud : « [S]eront les dits époux en communauté en tous biens meubles et conquêts et immeubles du jour des épousailles suivant et aux fins de la Coutume de Paris suivie en cette province sous la quelle veulent que leur dite communauté soit régie et gouvernée [...] » : Contrat de mariage entre Antoine Deguir dit Derosier et Marie-Dorothée Lavalé (François-Pierre Rigaud, 22 juillet 1775), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 1479, image 1658).
-
[148]
Ainsi, dans un contrat de mariage instrumenté par Jean-Antoine Panet en 1777, on retrouve la formule idoine : « Seront les futurs époux communs en tous biens meubles et conquêts immeubles du jour de leurs épousailles conformément à la coutume de ce païs » : Contrat de mariage entre Louis Levreau et Marie-Rose Moreau (Jean-Antoine Panet, 1 juin 1777), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 1284, image 735).
-
[149]
Voir par ex André Genest (04 janvier 1772), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 749, image 94).
-
[150]
Garneau, Usages, supra note 19 aux pp 184-85, 188, 223, 264 ; Jean-Philippe Garneau, Justice et règlement des conflits dans le gouvernement de Montréal à la fin du Régime français, mémoire de maitrise en histoire, Université du Québec à Montréal, 1995 aux pp 166, 195.
-
[151]
Durant la période militaire (1760-1764), seuls dix actes d’arbitrage sont ainsi instrumentés dans les fonds notariés, soit une moyenne de 2,5 actes par an (toutefois sur une période aussi courte, une évolution est difficilement appréhendable). De 1765 à 1784, les 203 actes enregistrés dans les fonds notariés représentent une moyenne légèrement supérieure à dix actes. Le nombre d’actes d’arbitrage a donc été multiplié par dix de la période française étudiée à la période anglaise étudiée. Pour une analyse complète de cette évolution, voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 10 aux pp 413-15, 423-25.
-
[152]
Une autre sentence, datée du 2 août 1762, concerne l’estimation de biens relatifs à une succession, les arbitres agissant suite à l’ordre des capitaines de milice de Montréal : Contrat sous seing privé, avis arbitral concernant l’emplacement et la maison dépendant de la succession de feu Pascal Arel (Jean Péladeau, 2 août 1762), Montréal, Archives nationales du Québec, (TL313, S1, dossier 2/3.371). Voir aussi un acte sous seing privé qui établit le procès-verbal d’une estimation et d’une évaluation, fait par les arbitres Joseph Alard et François le Clerc de Mascouche, à la demande des capitaines de milice de ce lieu pour une terre acquise par Joseph Beauchamp : Contrat sous seing privé, avis arbitral concernant une terre appartenant à Joseph Beauchamp (François le Clerc et Joseph Alard (fils), 2 avril 1763), Montréal, Archives nationales du Québec, (TL313, S1, dossier 2/3.387).
-
[153]
Dans la collection Louis-François-Georges Baby, voir Jugement par les capitaines de milice, Jacques Aubuchon et autres, ordonnant l’arbitrage pour régler le différend entre Jacques Cottineau et Jean Hétier, pour la possession d’une partie de la terre (15 juillet 1762/Pointe-aux-Trembles), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/65, microfilm 1295) ; Ordre de Panet, capitaine de milice, de faire l’arpentage de la terre du demandeur, dans la cause de Toussaint Céré vs Marguerite LeDuc, veuve de Pierre Sarrazin (7 décembre 1762/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/66, microfilm 1295).
-
[154]
Ainsi, en 1761, on trouve une cause où l’arbitre est le capitaine de milice : « [Louis le Cavelier] de la paroisse de St Laurent, nommé par Son excellence Monseigneur de Gage gouverneur pour administrer la justice dans l’étendue de nos compagnies » : Sentence arbitrale (Pierre Panet de Méru, 29 janvier 1765, enregistrant une sentence du 15 juin 1761), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2734, minute 2294).
-
[155]
Ainsi, en vertu de l’ordonnance du gouverneur du Québec, James Murray, est instrumentée une sentence suite à une requête présentée le 26 octobre par Étienne Grondin : Procès-verbal d’arbitrage des terrains d’Étienne Grondin (Joseph Dionne, 25 novembre 1761), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 6669, image 758).
-
[156]
George R, Proclamation, 7 octobre 1763, reproduit dans Shortt et Doughty, supra note 12 à la p 138. Sur la mise en place des institutions judiciaires britanniques, voir Jacques L’Heureux, « L’organisation judiciaire au Québec de 1764 à 1774 » (1970) 1 RGD 266.
-
[157]
L’ordonnance du 17 septembre 1764 établit notamment une « cour de judicature inférieure, ou cour des plaids communs » chargée de juger tous les litiges dont la valeur dépasse un montant de dix louis (Cours civiles, supra note 12 à la p 181). Murray écrit que « [l]a cour des plaids communs est établie seulement pour les Canadiens : ne pas admettre une cour semblable jusqu’à ce qu’on puisse supposer qu’ils se soient familiarisés suffisamment avec nos lois et nos méthodes concernant l’administration de la justice dans nos cours, équivaudrait à lancer un navire sur une mer sans boussole » (ibid, tel que cité par Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec : Des origines à 1791, t 1, Sillery, Septentrion, 1995 à la p 354).
-
[158]
C’est également l’interprétation qu’en font un certain nombre d’habitants, qui constatent avec plaisir que, « dans la [d]écision de nos affaires de famille et autres, il seroit établi une [j]ustice inférieure, où toutes les [a]ffaires de François à François y seroient décidées » : Pétition des habitants français au Roi au sujet de l’administration de la justice, 7 janvier 1763, reproduit dans Shortt et Doughty, supra note 12, 195 à la p 196.
-
[159]
Cours civiles, supra note 12 à la p 181.
-
[160]
Ibid à la p 182.
-
[161]
Guy Carleton et William Hey, Rapport sur les lois et les cours de judicature de la province de Québec, 15 septembre 1769, reproduit dans WPM Kennedy et Gustave Lanctot, dir, Rapports sur les lois de Québec, 1767-1770, Ottawa, Imprimeur de sa très excellente majesté le Roi pour les Archives Publiques du Canada, 1931, 53 à la p 67.
-
[162]
Francis Masères, Brouillon d’un rapport préparé par l’honorable gouverneur en chef et le Conseil de la province de Québec, pour être présenté à Sa Très-Excellente Majesté le roi en son Conseil, au sujet des lois et de l’administration de la justice de cette province, 11 septembre 1769, reproduit dans Shortt et Doughty, supra note 12, 304 à la p 330.
-
[163]
En indiquant le fonds notarié des Archives nationales du Québec à Montréal, où se trouve l’acte, ainsi que la date, le microfilm et la minute (lorsque disponible), la composition des affaires instrumentées ou arbitrées par les notaires Panet est la suivante : Soit chronologiquement, en matière commerciale (Pierre Panet de Méru, 16 mars 1765, microfilm 2734, minute 2345), une reconnaissance de dette (Pierre Panet de Méru, 7 juin 1766, microfilm 2734, minute 2583), une quittance en matière successorale (Claude Louet, 24 février 1767, microfilm 10879, image 2531), un partage de créance (Jean-Claude Panet, 1 juin 1768, microfilm 1292, image 1310), de succession (Pierre Panet de Méru, 12 et 30 juillet 1768, microfilm 2735, minutes 3006 et 3027), de coupe de bois sur des terres contestées (Pierre Panet de Méru et François Simonnet, 27 juillet 1768, contrat sous seing privé, TL313, S1, dossier 2/4.554), un partage et des droits de succession (Pierre Panet de Méru, 08 août 1768, microfilm 2735, minute 3037), de paiement de dette (Pierre Panet de Méru, 07 septembre 1768, microfilm 2735, minute 3067), de compte de tutelle (Pierre Panet de Méru, 15 novembre 1768, microfilm 2735, minute 3120), de succession et de don mutuel (Pierre Panet de Méru, 21 décembre 1768, microfilm 2735, minute 3137), de succession (Pierre Panet de Péru, 22 mars 1769, microfilm 2735, minute 3179), de gestion de biens de communauté (Pierre Panet de Méru, 29 mai 1769, microfilm 2735, minute 3210), de succession et de rente viagère (Pierre Panet de Méru, 13 juillet 1769, microfilm 2735, minute 3264), une reddition de compte de communauté (Pierre Panet de Méru, 17 juillet 1769, microfilm 2735, minute 3268), d’une vente verbale d’une terre et de responsabilité contractuelle (Pierre Panet de Méru, 05 août 1769, microfilm 2735, minute 3286), de lots et vente (Pierre Panet de Méru, 15 septembre 1769, microfilm 2735, minute 3328), de lettres de créance (Pierre Panet de Méru, 19 septembre 1769, microfilm 2735, minute 3334), de paiement du prix de construction d’un moulin (Pierre Panet de Méru, 6 mai 1771, microfilm 2736, minute 3652), de séparation de deux terrains dans une affaire de succession (Jean-Claude Panet, 9 septembre 1771, microfilm 1293, image 1269), de paiement d’obligation (Pierre Panet de Méru, 30 octobre 1771, microfilm 2736, minute 3762), de succession (Jean-Antoine Panet, 9 mars 1773, microfilm 1283), d’une donation dans le cadre d’une succession (Pierre Panet de Méru, 20 novembre 1773, microfilm 2736, minute 4125), de succession à nouveau (Pierre Panet de Méru, 28 octobre 1776 ainsi que les actes du 6 mars 1777, du 18 août 1777 et du 10 septembre 1777, microfilm 2737, minutes (dans l’ordre) 4578, 4657, 4719, 4734), de comptes commerciaux (Jean-Antoine Panet, 21 mai 1777, microfilm 1284, image 694), de liquidation de succession (Pierre Panet de Méru, 30 janvier 1778, microfilm 2738, minute 4812), de contrat de concession de terres (Pierre Panet de Méru, 9 février 1778, microfilm 2738, minute 4820).
-
[164]
Roy c Chaboisseau (Jean-Antoine Saillant de Collégien, 4 octobre 1767), Québec, Archives nationales du Québec, (Cour des plaidoyers communs, TP5-S1-S11, dossier 269).
-
[165]
Gilles, « Arbitre », supra note 2.
-
[166]
Sur l’usage de la Coutume de Paris par les juridictions civiles britanniques, voir notamment Arnaud Decroix, « La controverse sur la nature du droit applicable après la conquête » (2011) 56 : 3 RD McGill 489 à la p 522.
-
[167]
Notre recherche pour les données des paragraphes suivants a été faite par mots-clés (arbitrage, sentence arbitrale, arbitration, arbitres) dans la base de données Parchemin : voir supra notes 28-29.
-
[168]
Alors que, durant la période française, aucune variation ne semble véritablement marquante (le nombre d’actes passant de zéro à cinq sans évolution stable), la période anglaise possède des traits spécifiques. Au cours de la fin de la période militaire et des premières années de la période civile, on observe une très forte augmentation du nombre d’actes d’arbitrage. Voir Gilles, « Arbitre », supra note 2.
-
[169]
Sentence arbitrale (Jean-Baptiste Daguilhe, 23 décembre 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10597, minute 2556).
-
[170]
Sentence arbitrale (Pierre Lalanne, 16 novembre 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 5974, image 1760).
-
[171]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 28 octobre 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 3048).
-
[172]
Contrat de vente (Antoine Foucher, 30 juin 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2124, minute 1917).
-
[173]
Sentence arbitrale (Antoine Foucher, 14 juillet 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2124, minute 1926).
-
[174]
Sentence arbitrale (Claude Hantraye, 25 juillet 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2696, image 2094).
-
[175]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 3 février 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 2496).
-
[176]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 14 mars 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 2559).
-
[177]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 4 août 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 2832).
-
[178]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 3 août 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 2830).
-
[179]
Sentence arbitrale (Claude Louet, 24 février 1767), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 10879, image 2531).
-
[180]
Alors que les décisions arbitrales initiées par les juges de paix sont relativement diversifiées, tant dans leur aire géographique que dans le choix des arbitres chargés de les mettre en oeuvre.
-
[181]
La situation constatée pendant les années 1770 à 1773 est difficilement explicable, aucun évènement ne venant donner la clé de cette interruption. Il est vrai que la Cour des plaidoyers communs a été réorganisée en 1770. Le district de Montréal a alors été officiellement constitué, un quatrième juge a été nommé et des séances hebdomadaires ont été instaurées pour les causes mineures, à la suite de l’abolition de la compétence des juges de paix en matière civile. Il est toutefois difficile de comprendre pourquoi ce changement aurait provoqué une disparition complète des renvois à l’arbitrage instrumentés par la suite dans les fonds notariés. Voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 6 à la p 242.
-
[182]
Oldham, Mansfield, supra note 110 aux pp 78-84.
-
[183]
Il s’agit de Loiseau, Badeau, Robin, Néron, Levrard, Leguay, Jehanne, Pelissier, Hertel, Olry, Pinguet, Crespin, Vuatier, Adhémar, Dailleboust de Crusy, McCarty et Simonnet.
-
[184]
Sentence arbitrale (Pierre Panet de Méru, 12 juillet 1768), Montréal, Archives nationales du Québec, (microfilm 2735, minute 3006).
-
[185]
De solides tendances se dégagent alors. Panet de Méru et Aumasson de Courville ont un rôle prépondérant tant dans l’instrumentation d’actes qu’en tant qu’arbitres, l’un approvisionnant l’autre et inversement. Certains notaires — ruraux essentiellement — instrumentent de nombreux actes, mais interviennent peu comme arbitres. En effet, les différends portent souvent sur des questions rurales, comme la délimitation d’un égout ou d’une terre, aisément arbitrables par les habitants, l’acte notarié constituant alors un simple élément de preuve. D’autres notaires actifs comme arbitres (vingt actes) — Mézière par exemple — n’instrumentent que très peu (un acte seulement). Il est alors victime des arbitrages binômes, les actes étant instrumentés dans les greffes de ses collègues arbitres, comme Panet de Méru ou Aumasson de Courville.
-
[186]
De plus, on peut remarquer une très forte dispersion des actes d’arbitrage instrumentés, bien plus fréquents en région que durant la période du régime français. Les notaires ont vraisemblablement remplacé les subdélégués de l’intendant dans la prise en compte de l’arbitrage.
-
[187]
Il existe toutefois un rapport fort intéressant entre les arbitrages confiés aux notaires et ceux déterminés par des habitants ou des membres de la famille. Concernant les matières soumises à l’arbitrage, les affaires de famille et les litiges de servitudes et de voisinage dominent. Pourtant, au vu de la pratique anglaise de l’arbitrage commercial, on aurait pu s’attendre à un développement de celui-ci. On peut supposer que les commerçants ont utilisé alors l’arbitrage sans passer par la voie notariée. Pour l’année 1777, on compte une affaire de succession, une dissolution de communauté, deux servitudes de cours d’eau et six redditions de comptes de tutelle tandis qu’une seule cause porte sur un litige commercial opposant des marchands anglophones.
-
[188]
Afin d’avoir une idée exacte d’un rapport de force entre arbitrages par les notaires et par les habitants, il est nécessaire de minorer le nombre d’arbitres habitants. En effet, on constate leur surreprésentation numérique dans les différends auxquels ils prennent part. De plus, on découvre, à la lecture de ces statistiques, une évolution temporelle assez marquée. Sur le système judiciaire établi en 1764, qui pourvoit à l’arbitrage des différends concernant les clôtures, voir Decroix, Gilles et Morin, supra note 14, ch 6 à la p 242.
-
[189]
En 1777, on comptabilise quatre arbitrages par des notaires, deux par des habitants et deux par des négociants. L’année suivante, on énumère deux arbitrages du fait de notaires alors que tous les autres différends (au nombre de onze) sont le fait d’habitants. On distingue clairement la forte part que prennent les notaires comme arbitres dans les premières années après l’instauration du régime civil. Ils s’imposent vraisemblablement comme les dépositaires du savoir juridique, le sommet de 1768 coïncidant avec l’augmentation du nombre d’arbitrages. Toutefois, dès 1772, les habitants interviennent majoritairement comme arbitres, se substituant aux notaires jusqu’en 1776.
-
[190]
Ainsi, aucune évolution marquante n’est la conséquence unique de l’arbitrage des notaires ou des habitants. Le pic des années 1767 à 1770 se retrouve dans les arbitrages extrajudiciaires, juridictionnels, faits par les notaires et tranchés par les habitants. Il en est de même pour les sommets des années 1777-1778, mais dans une moindre mesure pour les arbitrages du fait des notaires. Cette impression se renforce à partir de 1781, l’arbitrage du fait des notaires connaissant alors un lent déclin, tandis que les arbitrages extrajudiciaires, ceux initiés devant des juridictions et ceux faits par les habitants, tendent à augmenter. Dans la région de Beaupré, à partir des années 1780, Jean-Philippe Garneau a également observé un déclin prononcé du nombre d’inventaires confectionnés par des notaires, sans que ces données ne suggèrent une explication de ce phénomène (Garneau, Usages, supra note 19 aux pp 276-78, 284-85).
-
[191]
L’augmentation globale de 1784 pourrait s’expliquer par l’arrivée des Loyalistes, mais aucun acte ne semble étayer cette hypothèse. Il faut vraisemblablement mettre cet accroissement sur le compte des données utilisées pour la base Parchemin, qui prennent fin à cette date. Autre élément informatif, certains notaires décident, à partir de 1784, de renforcer leur activité d’avocat plutôt que leur greffe, expliquant une désaffection de leur participation à l’arbitrage, ou une moins grande disponibilité pour les différends locaux.
-
[192]
Cette dynamique s’explique facilement. Les parties ayant de leur propre fait la volonté de se porter vers l’arbitrage, les premières personnes se présentant à elles, surtout pour les contentieux de servitudes ou de famille, sont les voisins et les proches. Ces deux types d’arbitrage sont complémentaires et se développent à partir de 1772, avec un important niveau d’activité malgré les années de fort conflit en 1775-1776 et la diminution relative des actes. La diminution de l’année 1779 est, quant à elle, difficilement explicable.
-
[193]
Selon la formule de Brigitte Lefebvre, « L’évolution de la justice contractuelle en droit québécois : une influence marquée du droit français quoique non exclusive » dans Jean-Louis Navarro et Guy Lefebvre, dir, L’acculturation en droit des affaires, Montréal, Thémis, 2007, 197 à la p 200, n 6, citant André Morel, « La langue et l’acculturation juridique au Québec depuis 1760 » (1990) 24 RJT 99 [Morel, « Acculturation »].
-
[194]
Louis Marquis, « La compétence arbitrale : une place au soleil ou à l’ombre du pouvoir judiciaire » (1990) 21 : 1 RDUS 303.
-
[195]
Vachon, Histoire, supra note 2 à la p 62.
-
[196]
Le notaire public était, dans le droit britannique, une institution si insignifiante que Blackstone ne jugea pas à propos de lui consacrer une ligne (Scott, supra note 3 à la p 283).
-
[197]
Voir Evelyn Kolish, « Some Aspects of Civil Litigation in Lower Canada, 1785-1825: Towards the Use of Court Records for Canadian Social History » (1989) 70 : 3 Canadian Historical Review 337.
-
[198]
À l’exemple de James Murray, voir Antoine Maheux, « Les employés français de James Murray » (1941) 28 : 8 Canada français 765.
-
[199]
Voir F Murray Greenwood, Legacies of Fear: Law and Politics in Quebec in the Era of the French Revolution, Toronto, University of Toronto Press pour la Osgoode Society, 1993.
-
[200]
Fyson, Magistrates, supra note 35 aux pp 78-98.
-
[201]
Dans la collection Louis-François-Georges Baby, voir Abbé Chambon. Arbitrage au sujet d’une ferme et d’animaux acquis par Jacques Lalonde du sieur d’Argenteuil au Saut-du-Récollet (10 octobre 1753), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/43, microfilm 1288) ; Sentence arbitrale concernant l’égouttement des eaux des terres de Michel Marier et de Jean Ethier (8 août 1752/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/41, microfilm 1287) ; Sentence arbitrale par Joseph Raymond, concernant la délimitation d’une terre au fief Demuy, ordonnée par jugement des juges de paix, dans la cause de Joseph et Antoine Quentin vs Demuy (20 mai 1768/Varennes), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/80, microfilm 1299-300) ; Sentence arbitrale ordonnant à Paul Texier de remettre en place la clôture qui sépare sa terre de celle de Urbain Texier (15 juin 1768/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/81, microfilm 1300) ; Sentence arbitrale au sujet de l’égouttement des eaux sur certaines terres au faubourg St Joseph (31 octobre 1786/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/105, microfilm 1307-308) ; Nomination de MM de Montarville et de Laperrière pour régler le différend entre François et Étienne Le Riche au sujet des bornes de leurs terres (10 décembre 1789/Boucherville), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/113, microfilm 1310) ; Sentence arbitrale concernant un chemin de sortie des terres à la montagne, appartenant à mesdames veuves Raimbault et de La Corne St-Luc (29 octobre 1789 et 24 mars 1790/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/131 et 136, microfilm 1316) ; Conventions d’arbitrage entre Pierre Guy et Louis Cavilhe, au sujet de leur différend relatif à une muraille (20 janvier 1796/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/154, microfilm 1323-324) ; Sentence arbitrale dans la cause de Jean-Marie Hurtubise et Joseph Parent vs Eustache Leduc, au sujet d’égouttement des eaux (10 septembre 1796/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/158, microfilm 1325) ; Nomination de Joseph Papineau comme arbitre pour régler le différend entre David Alex Grant et Simon Watson, au sujet de bornage (2 août 1797/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/169, microfilm 1330) ; Sentence arbitrale dans la cause de Maurice Lagacé et al vs Louis Boudrias et al au sujet de fossés (10 septembre 1798/Montréal), Montréal, Université de Montréal, (P0058C3/175, microfilm 1332).
-
[202]
Michel Morin, « La perception de l’ancien droit et du nouveau droit français au Bas-Canada, 1774-1866 » dans H Patrick Glenn, dir, Droit québécois et droit français: communauté, autonomie, concordance, Cowansville, Yvon Blais, 1993, 1.
-
[203]
Voir notamment Jean-Gabriel Castel, « Le juge Mignault défenseur de l’intégrité du droit civil québécois » (1975) 53 R du B can 544 ; Sylvio Normand, « Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : La sauvegarde de l’intégrité du droit civil » (1987) 32 : 3 RD McGill 559 ; Michel Morin, « Des juristes sédentaires ? L’influence du droit anglais et du droit français sur l’interprétation du Code civil du Bas Canada » (2000) 60 R du B 247 ; Adrian Popovici, « Libre propos sur la culture juridique québécoise dans un monde qui rétrécit » (2009) 54 : 2 RD McGill 223.
-
[204]
Voir John EC Brierley, « Quebec’s Civil Law Codification: Viewed and Reviewed » (1968) 14 : 4 RD McGill 521 ; André Morel, « Acculturation », supra note 193.
-
[205]
Pierre du Calvet, Appel à la justice de l’État, Londres, 1784, reproduit dans Jean-Pierre Boyer, dir, Appel à la justice de l’État de Pierre du Calvet, Sillery, Septentrion, 2002 à la p 258.
Liste des figures
Nombre d'actes d'arbitrage notariés, 1740-1784
Pourcentage du nombre d'actes d'arbitrage notariés suite à un contentieux devant une juridiction britannique
Nombre d'actes arbitrés par chacun des notaires intervenant comme arbitres
Nombre d'actes relatifs à l'arbitrage instrumentés par chacun des notaires
Répartition des arbitres en fonction de leurs différentes qualités