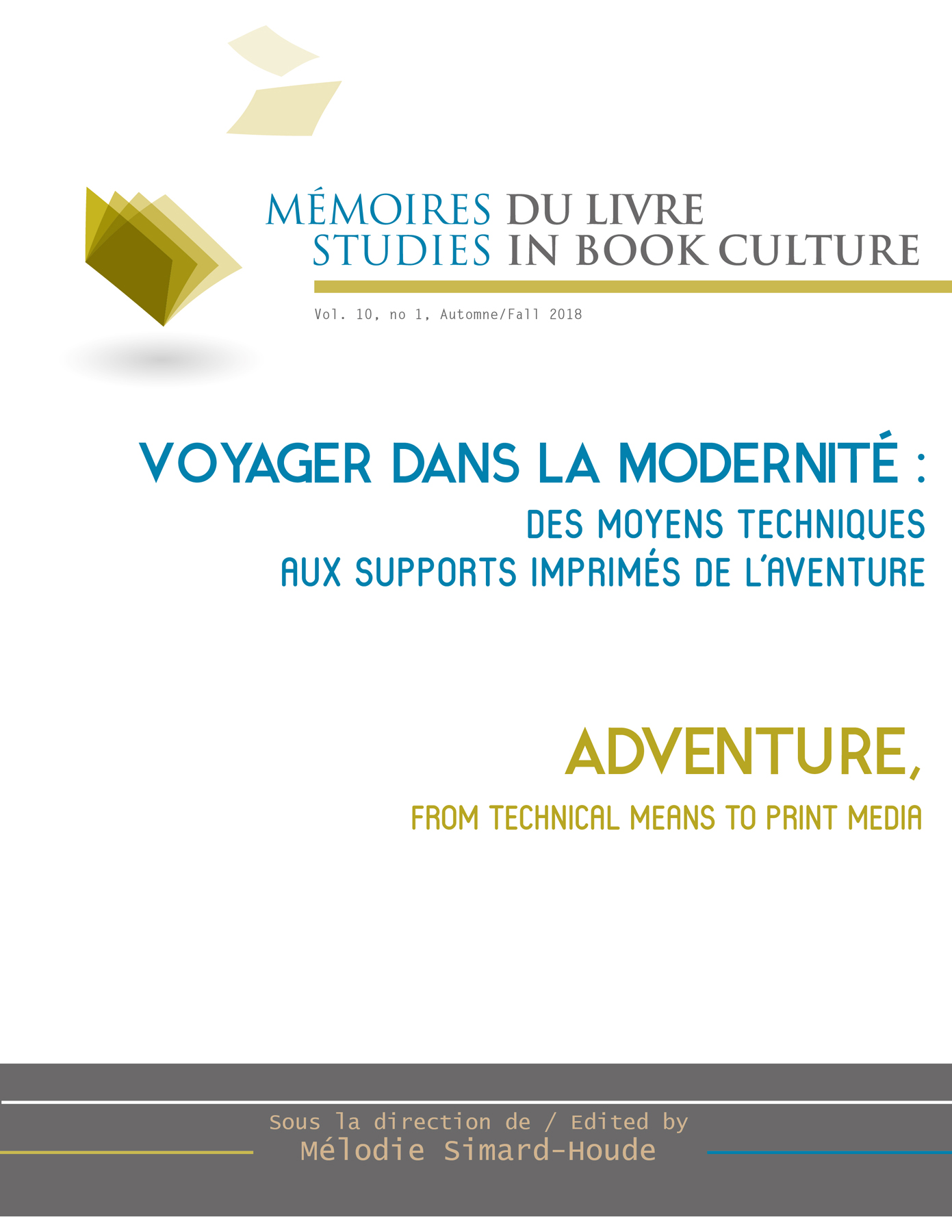Corps de l’article
« Un aventurier passif ne conservera sa qualité qu’en se nourrissant abondamment de la substance merveilleuse que l’on trouve dans les livres[1]. »
Que l’aventure entretienne un lien étroit avec le monde de l’imprimé, voilà l’évidence placée au coeur du Petit manuel du parfait aventurier (1920) de Pierre Mac Orlan. Le type que l’écrivain nomme l’« aventurier passif » est un lecteur et un romancier d’aventures; « c’est pour lui, pour lui seul, que cet ouvrage est écrit[2] », précise Mac Orlan. L’aventurier passif oppose son imagination et sa fréquentation livresque des équipées dangereuses à l’aventure réelle de « l’aventurier actif », moins désirable. Intervenant au lendemain de la Grande Guerre, cette définition de l’aventure, en tant qu’imaginaire infiniment plus séduisant que la discipline militaire et que la réalité des morts sur les champs de bataille, donne forme, intuitivement, à ce que Sylvain Venayre a depuis décrit comme une « mystique moderne[3] ». En effet, l’historien appuie son étude de l’aventure sur les sources imprimées qui l’ont « chantée[4] ». Un tel projet relève de l’histoire culturelle, de l’histoire des sensibilités et des représentations. Son objet réside dans le « désir d’aventure[5] » et repose sur les supports qui accompagnent son évolution.
C’est en s’inscrivant dans cette filiation que le présent dossier se propose d’étudier l’imaginaire de l’aventure et du voyage en lien avec l’histoire de l’imprimé. Ce faisant, il s’agit de déceler les traces discursives, narratives et poétiques de l’aventure et du voyage dans une multiplicité de supports et de genres, du roman vernien aux rubriques d’un pulp américain. Mais il est également question d’étudier la circulation réelle des voyageurs et des imprimés dans l’espace atlantique, colonial, européen ou mondial, au gré des réseaux de communication, de transport et de commerce. Les articles qui suivent convient ainsi à une histoire double, celle, immatérielle, d’aventuriers de papier, et celle, matérielle, des trajectoires réelles de voyageurs et d’imprimés. Tissant entre elles ces deux dimensions, l’approche en termes de poétique du support, soit l’interrogation de la manière dont un support détermine les caractéristiques poétiques et génériques des textes et discours qu’il véhicule[6], donne corps aux modulations de l’imaginaire de l’aventure et du voyage.
Au lien entre aventure et imprimé s’ajoute une seconde évidence, qui constitue le fil conducteur thématique de ce dossier : la prégnance du motif des moyens de transport dans l’imaginaire de l’aventure. Ceux-ci occupent une place de choix dans le roman d’aventures, laquelle s’accroît encore dans certaines de ses déclinaisons, comme le « roman de machines », où se croisent représentation des moyens de transport et anticipation technique[7]. De manière générale, toute aventure est ponctuée par l’intervention des moyens de transport. Ils en marquent souvent le seuil; parfois, par voies de ballon, avion, dirigeable, sous-marin, radeau, navire à vapeur, train, automobile, etc., ils relient les péripéties romanesques[8]. Pour les écrivains et médiateurs de l’aventure, que l’on pense aux romanciers populaires, aux voyageurs et reporters qui ont produit des récits de voyages, aux auteurs et éditeurs de guides et de périodiques destinés à accompagner les voyageurs, les moyens de transport constituent un motif attendu, un topos, un thème incontournable, voire l’emblème d’un monde fictionnel ou d’un média. Le moyen de transport forme même le noyau du fonctionnement discursif d’un imprimé comme le Journal de l’Atlantique, étudié par Joël Langonné : publié à bord d’un paquebot le temps de sa traversée, le journal est tout entier orienté par les conditions du voyage maritime qui en justifient l’existence. Parce qu’il conditionne le voyage, réel ou fictionnel, le moyen de transport est à la fois l’un des facteurs déterminant la production d’imprimés et l’un des motifs intervenant dans l’écriture de l’aventure. Il est lui aussi un objet double, matériel et immatériel.
Si les caractéristiques techniques des moyens de transport et des infrastructures qui leur sont associées évoluent dans le temps, il en va de même de leurs représentations, variables au gré des époques, des supports, des genres. Toute l’économie de la représentation de l’espace, du temps, du déplacement et, ultimement, de l’aventure elle-même, se trouve bouleversée par l’évolution des moyens de transports et de leurs usages. Christophe Studeny a montré que la notion de vitesse, comme celle de l’aventure, est un objet de l’histoire des représentations et des sensibilités. Sa naissance est permise par le perfectionnement de la route, au cours du xviiie siècle, et l’invention du chemin de fer au xixe siècle[9]. Dans une perspective semblable, Marc Desportes s’est penché sur l’évolution de la perception de l’espace en lien avec les médiations techniques du regard et les mutations dans les modalités du transport[10]. « [C]haque grande technique porte en soi un “paysage”[11] », écrit-il; « chaque grande technique porte en soi une “aventure” », ajouterais-je.
En outre, parce qu’ils relient des points éloignés dans l’espace, les moyens de transport présentent une analogie fonctionnelle avec les imprimés, les médias et les artéfacts de la communication médiatique (tel le télégraphe). Les uns et les autres ont pour rôle d’être un « véhicule » et d’opérer des liaisons entre territoires et populations, une parenté dont ce dossier cherche à déplier les implications.
Les contributions qui suivent envisagent en somme les représentations des moyens de transport, de l’aventure et du voyage en lien avec la poétique du support et l’histoire de l’imprimé, dans une perspective d’histoire culturelle. De plus, elles montrent la prégnance, pour ces imaginaires, de la poétique architextuelle et sérielle dans laquelle les textes s’inscrivent[12] : parce que les corpus analysés appartiennent tous à l’ère de la culture médiatique de masse ouverte avec le xixe siècle, ils sont structurés en des séries et des ensembles (périodiques, éditoriaux, génériques) qui orientent l’écriture et la lecture.
Présentation des articles
Les articles du dossier gravitent autour de trois grands axes d’étude. Le premier concerne le rôle de la culture imprimée dans la mise en place de médiations transnationales et d’un imaginaire du voyage globalisé. Les contributions d’Alberto Gabriele, de Nikol Dziub et de Laure Demougin interrogent les frontières entre territoires, métropole et colonies, entre pays européens, entre pays producteur de l’imprimé et territoires médiatisés. Leurs constats mettent en relief des transformations, depuis le début du xixe siècle jusqu’à l’aube du xxe siècle, dans le rapport entre ces espaces. Alberto Gabriele explique que le marché du livre paneuropéen se reconfigure au cours du siècle. Si le premier xixe siècle se caractérise par un marché de libre circulation des volumes, de réimpressions et de traductions, comme l’illustre l’exemple des foires du livre de Leipzig, la seconde moitié du siècle voit s’installer un protectionnisme du livre national sous la pression des premiers accords sur le copyright et de la constitution des États-nations. Paradoxalement, les frontières du marché du livre se referment au moment où le tourisme de masse prend son essor et où les voyageurs effectuent en nombre grandissant le parcours classique du Grand Tour. Nikol Dziub se penche pour sa part sur l’ensemble éditorial formé des Murray’s Handbooks for Travellers, guides de voyage britanniques parus entre 1836 et 1911. Elle montre que la représentation des pays étrangers, modulée par les intérêts des compagnies de transport et des hôteliers, en apprend autant sur la vision impérialiste britannique que sur les territoires décrits. Accompagnant le développement du tourisme, les guides de voyage marient visée pragmatique, intérêts commerciaux et médiation de l’expérience du voyage, formant et le regard du voyageur et les catégories d’appréhension du territoire visité. La contribution de Laure Demougin, quant à elle, explore de manière comparée le motif de l’arrivée en colonie. Le plus souvent effectué par la voie maritime, le franchissement de ce seuil constitue un topos du récit de voyage et du reportage en territoire colonial, mais qui, parce qu’il s’y module différemment, influence diversement le rythme du récit selon le support de sa parution, puis de sa réédition. Aborder la colonie est ainsi l’amorce d’une aventure fortement tributaire du média où cette action se trouve relatée.
Les deux articles suivants déplacent l’angle d’attaque pour interroger les caractéristiques de l’imaginaire de l’aventure moderne en relation étroite avec des genres fictionnels et factuels. Thomas Carrier-Lafleur étudie trois romans de Jules Verne mettant en scène le territoire américain. L’aventure vernienne peut être décrite, sur un plan narratif, par l’attraction de la « ligne droite ». Celle-ci, parfois déviée, parfois mise en danger, structure l’itinéraire idéal des voyageurs fictionnels et, de ce fait, la tension des intrigues romanesques. Matthieu Letourneux, pour sa part, analyse l’imaginaire de l’aventure à partir d’une autre forme d’unité, non plus générique et auctoriale, mais médiatique : le pulp américain Adventure, magazine bon marché paru entre 1910 et 1971, permet la mise en évidence d’une même représentation de l’aventure qui traverse les rubriques fictionnelles et non fictionnelles. L’étude des rubriques d’échange entre lecteurs et rédacteurs révèle l’image d’un lecteur qui se projette dans des voyages possibles sous l’influence des modèles de romans d’aventures qu’il tient entre ses mains.
Enfin, les deux derniers articles du dossier concernent des types d’imprimés directement issus du voyage et dont la production est tributaire de moyens de transport précis. Mon article aborde l’usage des aérostats comme véhicules promotionnels des quotidiens d’information, dans la France et le Canada des années 1890-1910. Les ballons tantôt permettent à des journalistes d’effectuer un voyage aventureux dans le ciel, tantôt supportent la réalisation d’expériences scientifiques, de sorties touristiques et d’épreuves sportives. Ce faisant, ils se constituent comme des médias modernes, miroirs du journal dont leur toile porte le nom, tout en générant une masse d’imprimés avant, pendant et après le voyage aérien. Ramenant des étendues du ciel à l’horizon de l’océan, l’étude de Joël Langonné considère un périodique, le Journal de l’Atlantique, publié à partir de 1906 par la Compagnie Générale Transatlantique à bord des paquebots reliant Le Havre et New York. Transmettant des nouvelles du bord et des dépêches d’actualité internationale reçues par service télégraphique, le Journal de l’Atlantique témoigne d’une volonté nouvelle du voyageur de l’ère médiatique, celle d’être connecté au reste du monde par la voie de l’imprimé. Le cas illustre que l’essor de nouveaux modes de transport a continuellement fait naître le besoin d’une « littérature de route[13] » adéquate, rassurante, capable d’accompagner l’expérience du voyageur.
Avant de laisser notre propre lecteur voyager, il apparaît pertinent, dans une volonté de synthèse, d’extraire les lignes de force de l’ensemble des études ici réunies. Ces constantes tracent les contours de la culture imprimée du voyage et de l’aventure, en marquent les fonctions et les évolutions, de l’aube du xixe siècle aux années 1930.
Guider le voyageur, construire le regard
En premier lieu s’impose le rôle des productions imprimées dans la formation de manières d’appréhender l’espace, le voyage, le déplacement et l’aventure. L’émergence des guides de voyages dès le xviie siècle a fait « [intervenir l’écrit] dans le monde du voyage[14] », permettant au livre ou au périodique d’accompagner le déplacement. Ce rôle se concrétise particulièrement avec la « littérature de route » destinée à médiatiser l’expérience d’un passager dans le temps même du voyage. Or, le cas du Journal de l’Atlantique, comparé aux périodiques distribués à bord des trains ou des avions, se distingue par une relation encore plus forte entre l’imprimé et le moyen de transport qui le génère : le Journal de l’Atlantique est produit à bord du paquebot, qui possède son imprimerie et reçoit par TSF les dépêches d’agence. Une réflexivité s’instaure entre le moyen de transport et, d’une part, la technique au service de la fabrique du journal, d’autre part, le contenu médiatisé, puisque la TSF comme les paquebots sont généralement eux-mêmes des objets représentés dans les pages du Journal, à titre d’artéfacts de la technique et de la communication modernes. Ces motifs participent d’un regard admiratif porté par le périodique sur le monde moderne, sillonné en tous sens jusque sur ses océans, nouveaux espaces conquis. L’imprimé convie ainsi le voyageur qui le manie à poser un certain regard sur le monde et sur son propre déplacement, pendant le déroulement de son voyage. Sans procéder d’une telle simultanéité, les incipit étudiés par Laure Demougin ont également contribué à orienter l’appréhension de l’espace mondial. Ils mettent en scène la liaison entre la métropole française et ses territoires outremer par la figure mobile du bateau, qui transporte les voyageurs et les imprimés à destination de la colonie. Dans ces seuils de la lecture et du voyage, le lecteur « arrive » au sens métaphorique du terme, accompagnant l’écrivain-voyageur, le personnage d’aventurier ou de touriste. L’incipit rejoue l’action d’appropriation de la culture coloniale, la colonie étant représentée au seuil du texte comme un espace à rejoindre, à connaître, par la voie maritime et imprimée. Il guide ainsi la manière dont le lecteur – mimant le voyageur de papier – se porte à la rencontre de la colonie.
Ce rôle de guide s’observe pareillement dans le corpus de volumes en circulation sur le marché européen du livre de la première moitié du xixe siècle, étudié par Alberto Gabriele. Nombre de ces publications, souvent multilingues, ont pour vocation d’opérer un transfert culturel et de fournir aux lecteurs des informations sur les villes et monuments du Grand Tour. Ce faisant, ces ouvrages forment un regard et nourrissent un désir du voyage, dans l’attente de son éventuelle réalisation. Le livre est alors intimement lié à des enjeux idéologiques, à des conceptions politiques et culturelles de l’espace, elles-mêmes en partie construites par la configuration du marché et des structures de production et de diffusion du livre. Alors que s’amorce la bataille du copyright dans la seconde moitié du siècle, le marché du livre, reconfiguré, appuie l’essor des nationalismes. Les nouvelles limites de ce marché, suivant les frontières nationales, se substituent à l’espace ouvert du début du siècle. Ces enjeux politiques et culturels confirment l’intérêt de sonder, comme le fait Nikol Dziub, les présupposés idéologiques qui président à la construction de la représentation des pays étrangers dans les productions nationales de la deuxième moitié du xixe siècle, comme les Murray’s Handbooks for Travellers.
L’imprimé qui guide voyageurs et lecteurs constitue ainsi un outil avec lequel, par lequel, on voyage, réellement ou métaphoriquement. C’est pourquoi les genres orientés vers le voyage réel, comme le guide de voyage, comportent une visée pratique qui module l’écriture et la représentation de l’ailleurs : les guides Murray, souligne Nikol Dziub, évitent les excès descriptifs, privilégient les informations utiles. Ils proposent des trajets, assortis des moyens de transport à utiliser. Ils offrent au voyageur des choix, des normes, en limitant les imprévus du voyage. En ce sens, l’essor des guides de voyage met à mal l’aventure en accompagnant le développement du tourisme et du voyage confortable. Le guide, par ailleurs, participe à l’épuisement de la cartographie mondiale. Il rend l’espace du globe intelligible, en expose les rouages, les trajectoires possibles, une fonction partagée par la fiction vernienne qui découpe la terre (voire l’espace interplanétaire) en « lignes droites » idéales. Phileas Fogg, rappelle Thomas Carrier-Lafleur, se comporte comme un voyageur réel le ferait de son temps : il se déplace autour du monde avec son Bradshaw’s Continental Railway Steam Transit and General Guide. Dans une mise en abyme de son propre rôle, le roman d’aventures représente les imprimés médiateurs du voyage, avant d’ajouter lui-même une couche de représentation au feuilleté qui se glisse entre le lecteur et l’expérience du monde.
Inventer les formes de l’aventure moderne
L’imprimé non seulement cartographie et représente l’espace, mais il contribue aussi à l’invention des formes du voyage et de l’aventure modernes. En les médiatisant, en leur donnant corps, il leur donne sens, et en fait notamment des entreprises publicitaires. Lorsque les quotidiens d’information s’emparent des voyages en ballon pour assurer leur autopromotion et que les reporters relatent leurs envols, ils médiatisent une expérience encore extraordinaire, peu accessible. Le vol en ballon est le loisir de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie à la fin du xixe siècle. En conséquence, le reportage a aussi pour rôle de rendre le voyage en ballon signifiant pour le lectorat de quotidiens à grand tirage comme Le Petit Journal ou Le Matin. Le récit de voyage en ballon, en tant que genre médiatique avec ses visées et son lectorat spécifiques, invente donc certaines des significations de l’aérostation. Il en génère des formes inédites, comme l’épreuve sportive et promotionnelle du rallye-ballon. Produire des imprimés sur le vol pour et par la presse revient à conférer sens à une expérience aventureuse nouvelle, suivant les intérêts journalistiques. L’une de ses significations les plus évidentes réside dans l’équation qui place en vis-à-vis le caractère extraordinaire et moderne du vol et celui du journal qui le commandite.
Cette dimension publicitaire imprègne non seulement les supports journalistiques de l’aventure ou du voyage, mais aussi, comme l’indique Nikol Dziub, le guide de voyage qui, « loin de se mettre au service du voyage, fait au contraire du voyage le support d’une entreprise publicitaire de grande ampleur », imbriquée dans le « développement de l’industrie du tourisme ». L’imprimé ou le média supposent et suscitent des intérêts autres que ceux des voyageurs ou des aventuriers, intérêts industriels et commerciaux notamment, qu’il s’agisse de ceux des patrons de presse ou des « pays auxquels Murray consacre un guide [et qui] deviennent des partenaires et des représentants de l’entreprise », auxquels s’ajoutent ceux des compagnies de transport, hôtels, librairies, agences touristiques publicisés dans les pages du guide. Ces formes de publicité entourant le voyage rappellent le double lectorat visé, constitué de voyageurs et de lecteurs (eux-mêmes voyageurs métaphoriques et potentiels), tous deux consommateurs possibles.
Tracer une poétique du déplacement
Si l’imprimé invente des formes neuves du voyage et de l’aventure modernes, le mouvement inverse se vérifie : l’imprimé absorbe l’imaginaire contemporain de l’aventure et des moyens de transport. Les mutations dans les modes de déplacement donnent en effet naissance à de nouveaux supports imprimés, telle la littérature de route. Mais l’influence des transports sur l’imprimé se décline aussi sur un plan métaphorique. Les représentations suivent les évolutions techniques et les transposent poétiquement pour dire quelque chose des conceptions contemporaines du voyage, de l’aventure et de la littérature elle-même.
Cette idée se traduit par le fait que les auteurs formalisent des mutations dans l’appréhension du monde liées aux évolutions des techniques et moyens de transport. La prégnance de la ligne droite que Thomas Carrier-Lafleur met en évidence dans la structure narrative des romans de Jules Verne peut se lire comme le déploiement poétique d’une grande mutation technique du xixe siècle, le passage du chemin à la route. Dès les années 1840, la rapidité de la malle-poste, qui annonce le rail, réduit le temps des déplacements et modifie la perception de l’espace : « la route, avant le rail, se présente comme une ligne où le voyageur, simple colis, passe mais ne chemine plus. Cette route semble fuir au loin, elle évoque une sortie possible du dédale boueux des chemins et du labyrinthe pierreux des rues[15]. » Signe de la vitesse conquise, la ligne droite est incorporée par le roman pour structurer l’imaginaire et la forme narrative de l’aventure moderne.
Plus généralement, les moyens de transport convoqués par l’imprimé ne sont jamais de purs objets réalistes, qui témoigneraient de façon immédiate des évolutions techniques et qui ne signifieraient que le déplacement dans l’espace. Véhicules métaphoriques, éditoriaux et narratifs, ils portent des implications métatextuelles en vertu d’une réflexivité entre le support (ou le média) et le moyen de transport représenté. Cette réflexivité joue pleinement dans le cas des voyages en ballon commandités par les quotidiens, au point où le ballon se constitue en média moderne, emblème volant du quotidien au compte duquel il se déploie. Elle se vérifie aussi dans le cas du Journal de l’Atlantique, où l’imprimé et le moyen de transport partagent une trajectoire, laquelle détermine un rapport au temps (de la traversée) et une représentation du voyage maritime. Joël Langonné exploite le parallèle entre la ligne éditoriale du journal et la ligne maritime du paquebot qui le transporte, l’une et l’autre étant interdépendantes. Le journal participe du hors-temps particulier de la traversée, qu’il s’emploie à connecter à l’actualité terrestre pendant le voyage, tout en laissant entrevoir la fin de la traversée (qui sera aussi celle du quotidien!) par la publication d’une carte indiquant la route accomplie.
Dans le même ordre d’idée, la représentation des moyens de transport dans les formes narratives est tributaire de choix de vitesse et de structures du récit (comme chez Jules Verne), de conventions génériques et de contraintes liées au support. L’étude des modulations dans la représentation des transports met en évidence ces choix et contraintes. Les incipit étudiés par Laure Demougin en fournissent un exemple : l’entrée dans la lecture (et dans le territoire colonial) subit des variations de rythme qui touchent la manière dont sont convoqués les moyens de transport. Dans le premier récit de voyage qu’elle étudie, l’image de la goélette est exploitée pour déployer la lenteur de l’étape initiale de l’entrée dans le territoire colonial, selon les conventions du récit de voyage colonial. « [Quand] les voyageurs quittent le bateau pour la pirogue, en revanche, la description se fait plus rapide » et l’aventure s’accélère. Les moyens de transport thématisent des étapes narratives, formalisent des variations de rythmes associées à des conventions génériques. Dès lors, l’imaginaire des moyens de transport varie à diverses échelles, à l’intérieur d’une poétique auctoriale spécifique, mais aussi dans l’histoire des genres.
Mettre en page l’aventure
Si les visées des producteurs d’imprimés modulent la représentation du voyage, et si les conditions techniques du voyage modifient l’imaginaire, une relation réciproque se noue également entre le support imprimé et l’imaginaire de l’aventure. Le pulp Adventure est représentatif de ces influences croisées. D’un côté, l’imaginaire de l’aventure détermine les formes de « la communication éditoriale » de ce magazine, sous-tendue par « un ensemble de valeurs caractéristiques de l’aventure romanesque » qui teintent tous les éléments du discours et toutes les rubriques, explique Matthieu Letourneux. Ces valeurs véhiculées par l’imaginaire du roman d’aventures, tels le désintéressement et la camaraderie, orientent le tissage et la représentation de la communauté de lecteurs d’Adventure. En retour, la cohabitation de rubriques variées, liées par l’unité générique de l’aventure, exacerbe la portée de cet imaginaire au sein du pulp. Les rubriques factuelles et le courrier des lecteurs subissent l’influence des fictions, tout en ouvrant ces dernières à des questions actuelles et générales sur les pays lointains et leur histoire, sur l’économie et la géopolitique. Les discours factuels au sein d’Adventure « ressaisissent le monde de l’aventure, habituellement pensé dans sa déliaison radicale, dans la complexité des échanges collectifs qui caractérisent notre expérience quotidienne », ajoute Letourneux. Exploitant à fond les éléments qui constituent l’unité de l’imaginaire de l’aventure – tels que le voyage, les pays étrangers, l’engagement dans l’inconnu, le refus du quotidien –, le pulp véhicule « une conception du genre qui dépasse le seul espace de la fiction pour caractériser un ensemble plus large de textes ». L’aventure serait ainsi « manière de considérer le monde », elle serait « culture de l’aventure ».
Par une boucle, cette définition rappelle celle de Pierre Mac Orlan. Qu’est-ce, au juste, que l’aventure? « Il est nécessaire d’établir comme une loi que l’aventure n’existe pas. Elle est dans l’esprit de celui qui la poursuit et, dès qu’il peut la toucher du doigt, elle s’évanouit, pour renaître bien plus loin, sous une autre forme, aux limites de l’imagination[16]. » Le constat de Matthieu Letourneux quant à la diffusion d’une « culture de l’aventure » par le biais des productions culturelles apparaît comme la complexification de l’intuition de Mac Orlan. Il s’applique non seulement au pulp mais également à tous les corpus considérés dans ce dossier. Les contributions qui suivent ne peuvent en effet que partiellement répondre à la question toujours ouverte de la nature de l’aventure. Parce qu’elle est culture, l’aventure comprend à la fois des genres discursifs, des supports imprimés, des pratiques, des motifs; elle fait interagir des communautés de lecteurs et une variété de médiateurs culturels. L’aventurier moderne serait celui qui participe à cette culture de l’aventure, lecteur et/ou producteur culturel, deux avatars de l’« aventurier passif » décrit par Mac Orlan. Son moyen de transport privilégié serait, bien sûr, l’imprimé.
De fait, au sein de la majorité des corpus envisagés ici, guides ou récits de voyage, les figures du voyageur et du lecteur se superposent. Dans Adventure, le lecteur implicite tout comme le lecteur réel sont des aventuriers potentiels. Les colonnes de la rubrique « Ask Adventure » sont investies par des lecteurs réels écrivant à des spécialistes pour solliciter des conseils en vue d’éventuels voyages. Or, ces lecteurs-voyageurs peu expérimentés paraissent inspirés (voire aveuglés) par les romans lus, par la culture de l’aventure qui s’immisce entre eux et la possibilité de l’aventure, pas toujours projetée de manière réaliste. Le périodique Adventure – mais nous pourrions sans doute étendre ce constat à bien d’autres exemples de la littérature de voyage et d’aventure – comporte ainsi une « dimension donquichottesque », par laquelle fiction et réalité de l’aventure se confondent souvent ludiquement, mais parfois aussi naïvement, quitte à se heurter.
Le triomphe de « l’aventurier passif »
Au bout du compte, une ultime question se pose : quelles mutations se dessinent derrière cette culture imprimée de l’aventure? quelle aventure subsiste au coeur de la modernité du xxe siècle? Indéniablement, la fin de l’aventure telle qu’on l’entendait au xixe siècle a sonné; ou, à tout le moins, de nouveaux questionnements ont alors commencé. Le xixe siècle arrivé à son terme marque pour elle un tournant, qui laisse entrevoir une mutation liée à l’évolution des pratiques et des moyens du voyage, du rapport à l’espace mondial. Les dernières phases de la conquête coloniale rétrécissent le potentiel imaginaire d’espaces jusque-là centraux dans le roman d’aventures[17]. Parallèlement, de grands imaginaires spatiaux déclinent, comme le mythe de l’Ouest américain, sous la pression de l’essor des sociétés industrielles et de la culture urbaine, ainsi que le signale Matthieu Letourneux. C’est pourtant à ce même moment, en raison précisément de cette « disparition » des lointains entre 1890 et 1920, que se cristallise pour Sylvain Venayre la « mystique de l’aventure » moderne, devenue « but en soi », objet d’accomplissement personnel et « dévoilement d’un sens caché du monde », forme de « réaction nostalgique » aussi, accompagnée d’un discours sur la « crainte de la fin de l’aventure[18] ».
En effet, l’essor du tourisme dans la deuxième moitié du xixe siècle de même que la structuration d’une « classe de loisir » internationale[19] entraînent l’émergence d’un voyage confortable de plus en plus accessible. Ils repoussent l’aventure dans les marges d’une expérience dominée désormais par l’ordinaire du tourisme, et la rejettent donc dans le domaine de l’imaginaire. Cette reconfiguration de l’association entre déplacement et aventure est nettement visible dans les contributions de Nikol Dziub et de Joël Langonné. Dans les Murray’s Handbooks for Travellers se lit une mise en valeur du voyage moderne, de la qualité des routes, du confort, du luxe et de la rapidité des compagnies de transport, des commodités des hôtels (telles que l’électricité, le téléphone). Tout comme le Journal de l’Atlantique, ces éléments vantent un voyage connecté, confortable, témoignant d’une conception nouvelle du déplacement lointain où l’aventure tient peu de place et où, au contraire, un succédané rassurant du pays d’origine accompagne le voyageur, réinjecte du familier dans le lointain. En dépit du luxe de la croisière que reflète le Journal de l’Atlantique, quelque chose du danger de l’aventure demeure dans ses pages, qui peignent la traversée comme une épreuve et l’océan comme un lieu où il est possible de faire naufrage. Si la médiatisation de ces inquiétudes surprend, elle n’est somme toute que le rappel fugitif d’angoisses que le Journal, plus largement, a pour fonction de calmer. L’aventure subsiste, ne serait-ce qu’à titre potentiel. Matthieu Letourneux signale une évolution semblable au sein d’Adventure, qui se révèle par la réorientation des projets de voyage des lecteurs au cours de l’entre-deux-guerres, depuis les expéditions sauvages vers le tourisme extrême, plus réaliste. Ce qui reste de l’aventure subit désormais le tropisme du tourisme et du temps de loisirs.
Deux autres facteurs entrent en jeu dans cette mise à mal de l’aventure, qui intervient non seulement dans les conditions réelles du voyage mais également sur le plan des imaginaires. Les représentations de l’aventure peuvent en effet se trouver entravées par un pessimisme qui souligne en quoi l’imaginaire des techniques (dont les moyens de transport) et les configurations narratives de l’aventure sont liés. C’est la conclusion de Thomas Carrier-Lafleur quant à la mutation de l’aventure dans les romans verniens à partir des années 1880 : la ligne droite s’y mue en spirale, dans un univers où les trajectoires spatiales et narratives sont en déroute, sous l’effet de l’émergence d’un pessimisme technique chez l’auteur. Laure Demougin remarque également dans Clovis Dardentor un essoufflement narratif de l’aventure, le personnage du touriste supplantant celui de l’aventurier. À la rapidité du voyage se substituent son ennui, son usure et un ralentissement du rythme narratif : « le voyageur moderne, de train en paquebot, n’est qu’un aventurier raté », écrit Demougin. La modernité pessimiste du voyage vernien se cristallise dans l’image d’un voyageur lisant un guide de voyage, geste qui signale l’épuisement de l’aventure et la redondance du voyage vécu en compagnie de son versant imprimé.
Pierre Mac Orlan, pour sa part, interprète de manière autrement optimiste la médiatisation fascinante que le livre offre, traversée de l’espace pour l’aventurier rêveur en son salon. C’est peut-être là le mode d’existence le plus fécond de l’aventure dans l’entre-deux-guerres, comme le souligne Matthieu Letourneux. Or, l’aventure déployée par la fiction, parce qu’elle réussit trop bien à séduire et à illusionner le lecteur, risque elle aussi de se fracasser contre la réalité du voyage. C’est ainsi que les intentions de voyage des lecteurs d’Adventure se laissent démonter par les considérations pragmatiques des experts consultés dans les pages du pulp. En ce sens, l’aventure moderne jouit d’autant de liberté que de limites; son champ est infini, pourvu qu’elle demeure dans les frontières de la page imprimée et de ses deux dimensions, dense de ses épaisseurs intertextuelles et architextuelles. Dans ce contexte, « [u]n roman d’aventures est toujours comme un vêtement un peu usé. L’étoffe n’en est pas neuve, ne peut être neuve, puisque l’aventure a disparu de nos conditions d’existence[20] », conclut Mac Orlan. Mais cette forme toute imaginaire, en dépit des mutations culturelles et techniques, ménage un espace de subsistance à l’aventure. Resteront toujours des supports médiatiques pour diffuser une « culture de l’aventure », rendant ainsi possible son histoire.
***
Notons que trois articles en « Varia » viennent enrichir le numéro. Marie-Claude Garneau s’intéresse d’abord à l’Agenda des femmes, publié par les Éditions du Remue-Ménage. L’analyse de cet objet original lui permet de saisir sous un angle inédit l’évolution du militantisme féministe au Québec. Suit l’article de Felicity Tayler, qui examine attentivement une étude de cas : dans les années 1970, la revue Mainmise publie une photographie de la rencontre, en Algérie, entre la figure de proue des Black Panthers, Eldridge Cleaver, et l’icône de la contre-culture étasunienne, Timothy Leary. S’appuyant sur cette image mythique, l’auteure met en lumière la reproduction, la représentation et la réception du « blackness » par Mainmise. Enfin, Jennifer J. Connor jette un regard neuf sur le circuit de distribution du livre, en retraçant les pérégrinations du livre médical The Woman’s Medical College of Pennsylvania au cours du xxe siècle. En incluant à la réflexion non seulement la distribution commerciale, mais également tout le système de don du livre, elle montre comment le livre franchit les frontières et, en somme, « voyage » lui aussi…
Parties annexes
Note biographique
Membre associée du centre RIRRA-21 (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Mélodie Simard-Houde est une chercheuse universitaire québécoise. Elle s’intéresse à la culture médiatique, aux poétiques journalistiques, aux échanges entre presse et littérature et à l’histoire des imaginaires. De 2015 à 2017, elle a été stagiaire postdoctorale (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) au Centre d’histoire du xixe siècle de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a soutenu en 2015 une thèse en cotutelle entre l’Université Laval (Québec) et l’Université de Montpellier 3, sous les directions de Guillaume Pinson et de Marie-Ève Thérenty. Son travail a été récemment publié sous le titre Le reporter et ses fictions. Poétique historique d’un imaginaire, aux Presses universitaires de Limoges. On trouve ses contributions notamment dans les revues COnTEXTES, Belphégor, Mémoires du livre, Sur le journalisme, Romantisme, Literary Journalism Studies, Études françaises, ainsi que sur la plateforme de recherche en ligne Médias19 (www.medias19.org).
Notes
-
[1]
Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier, Paris, Éditions de La Sirène, coll. « Les tracts », 1920, p. 39.
-
[2]
Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier, Paris, Éditions de La Sirène, coll. « Les tracts », 1920, p. 25.
-
[3]
Sylvain Venayre, La gloire de l’aventure : genèse d’une mystique moderne 1840-1950, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002.
-
[4]
Sylvain Venayre, La gloire de l’aventure : genèse d’une mystique moderne 1840-1950, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002, p. 11.
-
[5]
Sylvain Venayre, La gloire de l’aventure : genèse d’une mystique moderne 1840-1950, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002, pp. 13-14.
-
[6]
Marie-Ève Thérenty, « Pour une poétique historique du support », Romantisme, no 143, 2009, pp. 109-116.
-
[7]
Voir Jacques Noiray, Le romancier et la machine. L’image de la machine dans le roman français (1850-1900), tome ii, Jules Verne – Villiers de l’Isle-Adam, Paris, José Corti, 1982 et la section « Genres : Roman de machines : Machines extraordinaires » dans Matthieu Letourneux, Le roman d’aventures, http://mletourneux.free.fr/ (2 novembre 2018).
-
[8]
Mélodie Simard-Houde, « Voyages dans l’espace et avions électriques », COnTEXTES, no 21, 2018, paragr. 18, http://journals.openedition.org/contextes/6629.
-
[9]
Christophe Studeny, L’invention de la vitesse. France, xviiie-xxe siècle, Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995.
-
[10]
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace (xviiie-xxe siècle), Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2005.
-
[11]
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace (xviiie-xxe siècle), Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2005, p. 8.
-
[12]
Matthieu Letourneux, Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2017.
-
[13]
D’autres déclinaisons de la littérature de route ont été étudiées auparavant, soit les imprimés fournis aux voyageurs à bord des trains au xixe siècle, analysés par Sylvain Venayre, et le cas des revues aériennes à bord des appareils de lignes commerciales, abordé par Guillaume Pinson : Sylvain Venayre, « “MM. les voyageurs sont invités à replacer la planchette et le journal à l’endroit qui leur est assigné dans la voiture” : la littérature de la route et le journal gratuit », Médias 19, dans Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), Les journalistes : identités et modernités, mis à jour le 17 mars 2017, http://www.medias19.org/index.php?id=22702; Guillaume Pinson, « Milestones in the History of “Aerial Literature” : the Case of Air France Revue (1930-1970) », Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial, no 5, automne 2018 (à paraître), http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=88.
-
[14]
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace (xviiie-xxe siècle), Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2005, p. 51.
-
[15]
Christophe Studeny, L’invention de la vitesse. France, xviiie-xxe siècle, Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995, p. 190.
-
[16]
Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier, Paris, Éditions de La Sirène, coll. « Les tracts », 1920, p. 11.
-
[17]
Matthieu Letourneux évoque l’idéologie de la conquête coloniale qui domine dans un premier temps le roman d’aventures et « conduit les auteurs à proposer des récits de voyage et d’exploration ». « Mais au début du siècle, avec la disparition quasi totale des zones inconnues, et la colonisation de l’ensemble du globe, les régions lointaines vont cesser de représenter des espaces vierges où toutes les aventures paraissent possibles. » Un glissement survient alors d’une logique de conquête vers une logique de préservation de l’ordre, plus proche du roman d’aventures sociales; voir Matthieu Letourneux, Le roman d’aventures 1870-1930, Limoges, Presses universitaires de Limoges, coll. « Médiatextes », 2010, p. 108.
-
[18]
Sylvain Venayre, La gloire de l’aventure : genèse d’une mystique moderne 1840-1950, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002, p. 282.
-
[19]
Alain Corbin, « Du loisir cultivé à la classe de loisir », dans Alain Corbin (dir.), L’avènement des loisirs. 1850-1960, Paris, Aubier, coll. « Champs/histoire », 1995, p. 79.
-
[20]
Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier, Paris, Éditions de La Sirène, coll. « Les tracts », 1920, p. 65.
Bibliographie
- Alain Corbin (dir.), L’avènement des loisirs. 1850-1960, Paris, Aubier, coll. « Champs/histoire », 1995.
- Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace (xviiie-xxe siècle), Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2005.
- Matthieu Letourneux, Le roman d’aventures 1870-1930, Limoges, Presses universitaires de Limoges, coll. « Médiatextes », 2010.
- Matthieu Letourneux, Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2017.
- Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier, Paris, Éditions de La Sirène, coll. « Les tracts », 1920.
- Jacques Noiray, Le romancier et la machine. L’image de la machine dans le roman français (1850-1900), tome ii, Jules Verne – Villiers de l’Isle-Adam, Paris, José Corti, 1982.
- Guillaume Pinson, « Milestones in the History of “Aerial Literature”: the Case of Air France Revue (1930-1970) », Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial, no 5, automne 2018 (à paraître). http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=88.
- Mélodie Simard-Houde, « Voyages dans l’espace et avions électriques », COnTEXTES, no 21, 2018. http://journals.openedition.org/contextes/6629.
- Christophe Studeny, L’invention de la vitesse. France, xviiie-xxe siècle, Paris, Gallimard/NRF, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995.
- Marie-Ève Thérenty, « Pour une poétique historique du support », Romantisme, no 143, 2009, pp. 109-116.
- Sylvain Venayre, La gloire de l’aventure : genèse d’une mystique moderne 1840-1950, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002.
- Sylvain Venayre, Panorama du voyage. 1780-1920, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », 2012.
- Sylvain Venayre, « “MM. les voyageurs sont invités à replacer la planchette et le journal à l’endroit qui leur est assigné dans la voiture” : la littérature de la route et le journal gratuit », Médias 19, dans Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), Les journalistes : identités et modernités, mis à jour le 17 mars 2017. http://www.medias19.org/index.php?id=22702.
- Robert Wohl, A Passion for Wings: Aviation and the Western Imagination, 1908-1918, Yale University Press, New Haven, 1994.