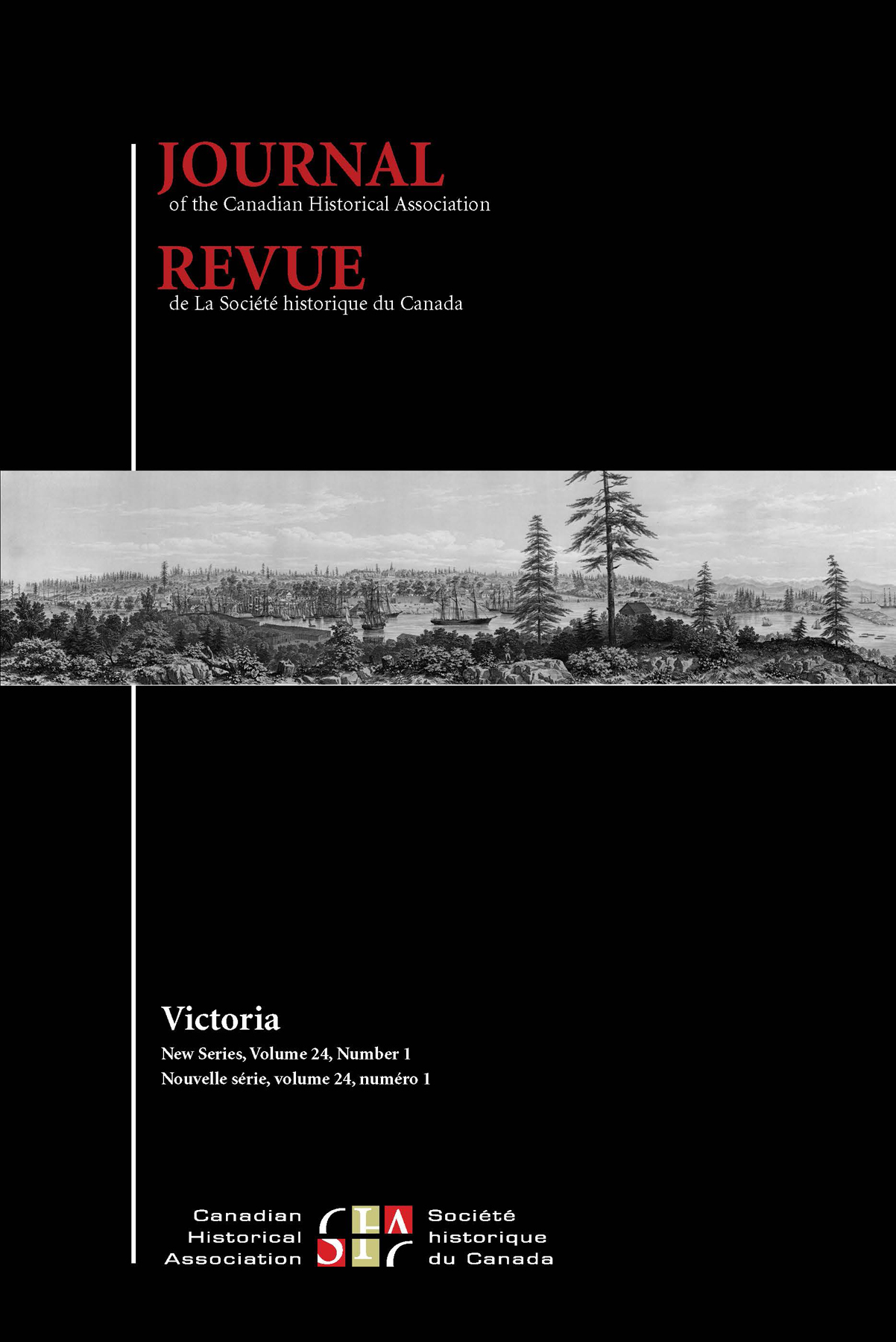Résumés
Abstract
This article considers two undervalued aspects of historical production — local history and local historical knowledge. It distinguishes between microhistory as carried out by professionals and local history as practised by vernacular historians, sometimes in collaboration with professionals. Relating his own experience with the genre of local history, the author highlights the importance of local historical knowledge as held and transmitted by community elders. His collaboration with the Elders of the Inuit community of Grise Fiord, Nunavut, is discussed as an illustration of its potential. The collaborative and dialogical character of local historical knowledge is further exemplified by folklorist Henry Glassie’s work with a small Northern Irish community. Noting current challenges of changing demographics, uprootedness and diaspora, the article considers how emerging communities and minorities are recreating new opportunities for local historical knowledge in Canada’s cities. Heeding the advice of senior Elders such as the late William Commanda of the Algonquin First Nation at Maniwaki, Quebec, the author asserts the importance of local historical knowledge to Canadians’ identities as members of communities with a common history, strengthening connections between people, past and present, and positioning us to better face the future.
Résumé
Le présent article porte sur deux aspects sous-estimés de la production historique : l’histoire locale et la connaissance locale du passé. L’auteur y fait la distinction entre la microhistoire telle que pratiquée par les professionnels et l’histoire locale telle que pratiquée par les historiens vernaculaires, parfois en collaboration avec les professionnels. À partir de sa propre expérience en matière d’histoire locale, l’auteur souligne l’importance de la connaissance locale du passé que détiennent et transmettent les aînés dans les collectivités. Sa collaboration avec les Aînés de la communauté inuite de Grise Fiord (Nunavut) sert d’exemple du potentiel de cette méthode. Les travaux du folkloriste Henry Glassie auprès d’une petite collectivité d’Irlande du Nord permettent aussi d’illustrer le caractère collaboratif et dialogal de la connaissance locale du passé. L’article, qui fait ressortir les enjeux liés aux changements démographiques, au déracinement et aux diasporas, s’intéresse à la façon dont les minorités et collectivités en devenir recréent de nouvelles occasions de connaître leur passé local dans les villes du Canada. Dans la foulée des conseils prodigués par de sages Aînés tels que le regretté William Commanda de la Première Nation algonquine de Maniwaki (Québec), l’auteur affirme l’importance de la connaissance locale du passé en lien avec l’identité des citoyens canadiens en tant que membres de collectivités ayant une histoire commune. Cette connaissance ne peut en définitive que resserrer les liens entre les personnes ainsi que le passé et le présent, en plus de nous armer pour l’avenir.
Corps de l’article
This address is dedicated to the memory of Professor Ed Rea, sixty- seventh President of the Canadian Historical Association — teacher, scholar, friend. I also want to acknowledge the contributions of Ron Frohwerk, Jean Barman, Valerie Korinek, Penny Bryden, and Ruth Sandwell, who kindly provided comments on earlier drafts, and my successor Dominique Marshall, whose thoughtful reflections in her introduction to this address were very helpful in framing the written version. My partner Ron has assisted me in countless ways throughout my career and should be credited for whatever we have accomplished together in public and academic history.
In keeping with the CHA conference theme of Intersections and Edges I will try to address two aspects of the study of the past that have preoccupied me intermittently for more than 35 years — local history and local historical knowledge — the latter an epistemological concept bearing upon who holds knowledge of the past, and which forms of knowledge have value. The presentation distinguishes between microhistory as carried out by professionals and local history as practised by both vernacular authors and professionals. I will attempt to define local history, outline some methods I have found useful, and suggest where it might enhance the general practice of history while making a distinctive contribution in its own right. Over time, greater collaboration between professional historians and Canada’s local communities offers the potential to help us transcend the boundaries that sometimes still persist between the national and the local, the professional and the vernacular.[1]
While embraced to a greater degree than a generation ago, local history still occupies a subordinate place in scholarly historical production in Canada and elsewhere. Several outstanding monographs have been prepared, but local studies are often passed over in survey textbooks and articles on Canadian historiography. Community studies and other so-termed particularist histories gained some brief notoriety during the so-called “history wars” of the 1990s when their authors were chided for undermining the nation-state.[2] However, our task is not to shore up patriotism but rather to discover and illuminate the past as accurately and fully as possible in its manifold diversity. If smaller-scale studies are sometimes better suited to addressing certain historical problems, we should not be reluctant to take that route. This is often the case with aspects of history that have been overlooked, and for which we lack the basic data or community comparisons to enable sound generalizations.
This fact became apparent to me while researching several studies on male same-sex sexuality in various localities across Western Canada during the region’s settlement era. The available evidence resides mostly in archived legal collections relating to criminal prosecutions, for which the testimonies and contextual evidence enable insights into the distinctive time and space relations of interactions of men animated by same-sex desire during this critical period. Beyond the specific cases, the better documented examples illuminate the larger history of the communities, provinces, region, and the country.[3] After examining more than 80 same-sex criminal court files from archives in the four western provinces and at Library and Archives Canada, I can report that every case was different, and the associated community dynamics within which these episodes occurred were also quite variable.[4] Of course there were cross-regional social, demographic, and cultural commonalities, and aggregate data from across the West are also of value in interpreting the specific cases. However, to properly understand the dynamics of these examples, we need to try to grasp the attitudes, motivations, and actions of individual participants interacting in a specific place at a moment in time. For the history of sexuality, as for several other fields in history, the development of sound generalizations will require the documentation of enough local studies in sufficient detail to enable meaningful comparisons and the discernment of patterns.
If there is anything to be gleaned from comparative studies of ostensibly similar localities, it is that, while they often share common characteristics, no two communities are the same. Each is the product of distinctive time and space relations between and among individuals. Further, every individual’s consciousness incorporates a unique set of time and space relations developed in dynamic interaction and dialogue with other people. Generalizations can become very tenuous when we stray very far from this central insight from the dialogical philosophy of the literary scholar Mikhail Bakhtin.[5] For me, the signpost in Resolute Bay, Nunavut is a fitting, tangible expression of local difference. It positions Resolute Bay geographically in relation to the North Pole, Tokyo, Moscow, Paris, Winnipeg, and Las Vegas, among other localities. No other community occupies exactly the same space or has the same history. Resolute Bay and all other communities are unique, and therefore worthy of historical study.
Much of the current professional production in local history is subsumed under the rubric of microhistory, which the Italian historians Carlo Ginzburg and Carlo Poni have justified for two reasons:
On the one side, by moving on a reduced scale, it permits in many cases a reconstitution of ‘real life’ unthinkable in other kinds of historiography. On the other side, it proposes to investigate the invisible structures within which that lived experience is articulated.[6]
The investigation of “invisible” social and economic structures connecting the local to the general has been a particular strength of several microhistories of communities carried out across Canada. For example, in her monograph on Salt Spring Island, British Columbia, Ruth Sandwell examined household structures in identifying important departures from the assumed commercial orientation of the agricultural economy.[7] The importance of family structure to farm economies was also central in Royden Loewen’s studies of Manitoba’s Mennonite communities, which emphasized adaptive strategies by immigrant farmers seeking to retain religious and cultural difference.[8] Gérard Bouchard’s classic treatment of Quebec’s Saguenay District included a comparative analysis of local family economies that placed its agricultural settlement into a continental context.[9] Beatrice Craig’s Backwoods Consumers and Homespun Capitalists traced the development of local market cultures in a formative era of Atlantic Canada, illuminating the relationship between hinterlands and regional and global economies.[10] These are just a few of the many excellent microhistories by professional historians that have increased our understanding of Canadian history on various levels. Each meets the criterion of Marc Bloch, co-founder of the French Annales School, that scholarly local histories should illuminate wider social and economic phenomena.[11]
Achieving the other goal of microhistory identified by Ginzburg and Poni — the reconstitution of so-called “real life” — is a different but no less challenging proposition, especially when reconstructing the history of places for which the evidence substantially resides within living historical memory. Here, oral history will come into play if we desire an accurate or comprehensive representation of past human experience. Depending on the availability of individuals with local historical knowledge, oral history will be relevant to addressing a wide range of issues but especially the reconstitution of real life, the repeatable everyday routines and activities at the heart of social history. For these kinds of projects, I prefer the term local history to microhistory as the local extends beyond academic archival research to direct engagement and dialogue with local residents within their own communities.
There are numerous definitions of local history available[12] but for this discussion I offer the following: local history is the study of individuals and groups interacting within a specific locality in the past, often with continuing and tangible connections to the present. The scale of what I term “local” varies considerably according to the context — it might encompass a village or rural community, an urban neighbourhood, or a cultural zone of human-environmental interaction. For local history, I prefer to work with small communities of people in recurrent interaction over an extended period. Typically, these are people who knew or at least were aware of one another, worked together or against each other but were nevertheless brought into regular contact by the structures and relationships of everyday life. The tracing of detailed intersections between people within a particular social and cultural environment is what gives local history its potential vitality and explanatory power.
Microhistories of communities could fall under the rubric of local history, but the latter term also comprises the work of local or vernacular historians not practising a scholarly discipline. While in some respects a branch of the discipline of history, I prefer to look at local history as a distinct genre in its own right. Sometimes its nearest counterparts are works of ethnography, folklore studies, or even literature. As documented in Malcolm Bradbury’s The Atlas of Literature, much of world literature, including notable Canadian novels, consists of stories set in particular localities, in which the detailed interplay between individual characters and specific environments is at the heart of the story.[13] So it is with local history.
In principle, the very lack of breadth of local history should enable greater depth in historical treatment than studies of larger units. When commencing research on the history of Ellesmere Island in 1989, I recall a discussion over lunch with my friend the late Professor Irene Spry at the now-defunct cafeteria at Library and Archives Canada in Ottawa. On hearing expressed doubts that I would be able to research every single source bearing upon the topic, she asked: “How can you be sure that your conclusions are right if you haven’t looked at everything?” I took this admonition from a learned elder as sage advice and thereafter sought to make my research on High Arctic history entirely comprehensive. We can sometimes do that with local history while it is often not feasible in studies of larger units.
Practising local history also enables, and often obliges us to draw upon elders. The term Elder is usually associated with Aboriginal communities but it also seems an appropriate designation for senior members of other communities who sometimes assume a similar role in their own milieux. To acknowledge the distinctive role of Aboriginal Elders, I propose to capitalize the term while applying a lower case spelling for elders in other contexts. Over the last 35 years my approaches to history have benefited from the advice and generosity of many elders of academic and public history. I have also been lucky enough to encounter and learn from elders of local communities, some of whom will be discussed in this address.
My own approach to local history has changed over time through experience with the genre and interactions with people in communities. It seldom starts with the big picture and instead begins with research on a specific person, place, or artifact. While I have long been interested in theory, I try to avoid applying historical models, at least not before the late stages of a project, and then only with great caution. After defining a study spatially and temporally, and carrying out a review of the secondary literature, I shelve the historiography and try to forget about it pending extensive primary data gathering and development of provisional hypotheses as a guide to further data collection. This process is repeated again and again until heuristic possibilities emerge, are tested, rejected, or revised, eventually congealing into provisional explanations. It only ends when all conclusions closely fit the evidence and other possible interpretations have been found wanting. Often enough, this approach has permitted me not only to generate different answers but to change the basic questions of these studies. And if evidence-centred “thick description”[14] and analysis at the local level indicates we should move in a different direction than current historiography or our own presuppositions, then as professional historians I think we need to be prepared to do that.
Where feasible, it is also important to try to experience directly the physical environments of the places and historical actors we are writing about. I would endorse the advice offered by David Hackett Fischer in his 2011 CHA keynote address, when he encouraged us to “go there, do it, write about it.” Direct experience of historic places better equips us to grasp both the spatial and temporal dimensions of a locality in establishing what has changed, and what has more or less stayed the same.
In approaching local history, I have long been guided by an approach pioneered by Marc Bloch, which he termed “understanding the past by the present.” Bloch rejected the notion that historical change, even in the modern world, has been so sweeping that most historical structures and cultural traditions disappeared after one or two generations. Rather, forces of inertia have ensured the persistence of many anterior forms into the present. Rather than commence historical enquiries at a fixed point in the past and reconstructing history forward in time, Bloch instead proposed beginning with the most vibrant and tangible evidence of earlier eras persisting in the here and now, and tracing it backwards in time to access the earlier historical eras being studied.[15] Bloch’s innovative approach had parallels in other such as geography, ethnography, and vernacular architecture studies, whose practitioners have made similar use of extant evidence of antecedent cultures surviving into the present to better understand the past.
My first significant engagement with the work of Bloch and the Annales School occurred during my first local history project in the late 1970s and early 1980s that eventually became the book Farmers “Making Good.”[16] Much of this study was an archivally-based settlement, social, economic, and political study of the farming community of Abernethy surrounding the Motherwell Homestead National Historic Site in southeastern Saskatchewan. The archival research and especially tabulations of aggregate data and statistical modelling of this community’s history documented a local example of the origins of rural prairie inequality, the emergence of socio- economic classes, and patterns of cross-generational inequality in Saskatchewan, among other issues of wider significance.
Yet there was something missing in the focus on quantitative data collection and measurement. While revealing of general economic trends, the statistics could not illuminate the material conditions of life, social interactions and relationships that make a community function. Accordingly I carried out an oral history with elders of the district, especially descendants of agricultural settlers still living in Abernethy or nearby communities, and who were knowledgeable about its history. Their detailed historical recollections, continuing presence and involvement in farm life and activities akin to their ancestors, enabled a much more complete and accurate reconstruction of work and daily life in the settlement era than would otherwise be feasible. Their local knowledge brought out the material conditions and interactions with people and the environment that historically defined much of prairie agricultural experience over successive generations. They had a deep understanding of agricultural processes and daily life of their own and earlier eras, demonstrating the practical value of Bloch’s advice about understanding the past by the present. Only with the passage of time did I realize that this study could have gone farther than the collection and synthesis of oral history interviews to the inclusion of the informants’ own voices and words in the text alongside my own as author.
A decade later I again found myself relying upon Marc Bloch’s “prudently retrogressive” approach while researching the study that became the book Muskox Land, although it did not start out that way.[17] My second large-scale local history project, it was initially intended to provide a context for interpreting the post-contact human history of for Ellesmere Island National Park Reserve, now Quttinirpaaq National Park of Canada, although my research obsessions carried it well beyond that mandate. The 1988 agreement to establish the park reserve established a basis for cooperation between Parks Canada and Grise Fiord, the only Inuit community on Ellesmere Island and Canada’s most northerly permanent settlement. We planned an extensive oral history with its residents and also former members of the community who had returned to Quebec to include their experience in the larger history.
In November 1989 I travelled to Grise Fiord to explain the project, seek the community’s input and approval, and to find local residents to help carry it out. I was notionally working with the theme of adaptation and developed an initial list of questions to address such issues as accommodations to modern technology in the first four decades following the establishment of Grise Fiord in the early 1950s. In the actual interviews, however, these questions proved tangential to the concerns of several Elders, especially those originally from northern Quebec who returned to their native community of Inukjuak in 1988. These individuals preferred to talk about the hardships of the relocation. The informants originally from Baffin Island who were still living in Grise Fiord discussed other topics, including the scarcity of game animals, the cost of gasoline, and the difficulties of hunting in such a challenging environment. It wasn’t what I expected and didn’t seem to fit in with the kind of narrative that seemed to be emerging from the archival research for this study. For a long time I was uncertain how to proceed and decided to shelve the project until a way forward could be found.
Coming back to the material a few years later, I started again almost from scratch, this time beginning with the oral histories we had assembled. Reconsidering the oral evidence dealing with the community’s recent history helped me see the history of Grise Fiord and earlier High Arctic eras with fresh eyes and it also prompted revisiting the textual evidence and the larger study’s themes. It helped me see that, even in the modern era, Inuit survival in the High Arctic owed more to the continuity of traditional knowledge and adaptive strategies developed over numerous generations than to externally- driven cultural change, such as the introduction of Western technology. Akin to Marc Bloch’s retrogressive method, I belatedly understood how Grise Fiord’s recent experience incorporated important elements of earlier High Arctic history, or in Braudellian terms, how the longue durée was embedded within the moyen durée of recent history.[18] The local data showed the importance of adaptation and adaptability to human survival in a very challenging environment, a universal theme built up from the specific to the general, and from the present into the past.
In the end, the oral history evidence did not require scrapping the theme of adaptation and survival, but the local historical knowledge of the Elders suggested a different path to reconstructing High Arctic history. Rather than impose an interpretive synthesis, I opted to lay out the evidence and quote extensive passages from the Elders so that they would speak for themselves on important issues alongside the voice of the author. Sometimes local history obliges interpretive restraint. Having shared the evidence with readers, authors appropriately should encourage them to evaluate it and draw their own conclusions. If such an approach stops short of definitiveness, it permits the inclusion, if not the integration, of differing perspectives and interpretations and a richer set of viewpoints than thesis-driven models.
In May 2001 I travelled back to Resolute Bay and Grise Fiord, the High Arctic communities whose history was treated in the manuscript, to make presentations on the book’s content to local residents. The presentations outlined the theme of 200 years of adaptation and survival in the High Arctic, including the more recent history beginning with the Inuit relocations of the 1950s. At the Resolute Bay meeting, Liza Ningiuk, who carried out several interviews for the oral history and was by then Mayor of Grise Fiord, stood and said to me in Inuktitut: “I believe every word you said is true.” Several other residents of Grise Fiord have commented that they appreciated the respectful way that the book discussed the role of their elders, the fact that individuals were identified by name, their words quoted and their contributions credited in the book. I feel that it helped generate trust that subsequently enabled the ecologist Dr. Micheline Manseau and me to secure the support of Grise Fiord hunters and trappers for our Parks Canada Species at Risk project focussing on the Peary caribou, which also drew upon the traditional knowledge of members of the community.[19]
Among the people attending my presentation in Grise Fiord in 2001 was Liza Ningiuk’s father, the late Abraham Pijamini, a seasoned hunter and respected Elder (Figure 1), who asserted his view that Inuit were able to survive in the High Arctic because of caching. He was referring to their need to hunt as many animals as possible when encountering game on the trail, and to cache the meat on the spot. The reason caching was so important was that the biomass in the High Arctic is very limited relative to more southerly ecosystems, and animals tend to be few and far between. Operating far from their communities, Inuit hunters could not immediately transport back all the meat from the kill sites but caching enabled them to continue hunting, maximizing their efforts to ensure the community’s survival.
Figure 1
I had included a section in the manuscript on caching but Pijamini’s comment warranted a fuller treatment, and the text was duly revised. Later, an archaeological colleague advised me that the eminent anthropologist Lewis Binford arrived at much the same conclusion as Pijamini in two books on archaeological theory, based on his work with the Nunamiut of the Western Arctic. Binford hypothesized that by distributing their practice of caching to a range of sites in their areas of land use, arctic hunters mitigated the effects of possible damage to any single storage site.[20] I find it fascinating that Binford and Pijamini came to similar conclusions regarding critical adaptations enabling arctic survival. But where Binford’s conclusions derived from ethnographic study and abstract reasoning, Pijamini’s insight came from his life experience. It reminds us that there is more than one pathway to knowledge, and our understanding is only strengthened when different knowledge systems corroborate one another.
This brings me to the second of my concerns today — local historical knowledge. I will not be discussing Traditional or Local Ecological Knowledge (TEK or LEK), which have become common in bureaucratic circles.[21] I prefer to listen instead to what vernacular historians themselves have said about local historical knowledge. Typically, they define it as an outgrowth of shared experience. When revising Donald Gunn’s “History of the Red River Settlement” in 1912, his grandson George placed the elder Gunn’s historical knowledge into the experiential contexts of his career in the fur trade and social and intellectual interactions with other elders.[22] In Stories of My People, a collection of historical vignettes on Vancouver’s Japanese Canadian community over its first century, Roy Ito similarly wrote that history “should be told from the inside, a history as seen and remembered by the people who have shared the experience.”[23] For both Gunn and Ito, local historical knowledge is not generated solipsistically by individuals but flows instead from the common, intersubjective experience of the members of a community.
Reliance on experience alongside historical evidence has been challenged by some practitioners, most notably by Joan Wallach Scott in her 1991 article “The Evidence of Experience.”[24] Martin Jay has further elaborated in his book Songs of Experience that experience is a complicated concept that has engaged numerous thinkers and definitive conclusions as to how to access and rely upon it continue to be elusive.[25] Yet, Scott acknowledges that we cannot dispense with experience, however problematic a concept it appears to be. Her article offers useful admonitions regarding the essentializing of experience but the sweeping critique of experiential knowledge seems excessive, especially if we are talking about the shared local knowledge elaborated by Donald Gunn, Roy Ito, and other elders. The evidence of experience can certainly be distorted by layers of subjectivity, and we are obliged to apply rules of verification to all forms of evidence. Further, oral, written, and indeed other sources should not be accorded a privileged status over other forms of evidence. But when it connects to material and intellectual interactions commonly experienced and independently corroborated by different members of a community, oral history as rooted in direct experience can contribute compelling historical knowledge.
Provisionally, I would define local historical knowledge as the shared understanding of the past produced by members of a locality in dialogical interaction in time and space. It springs from interconnections within a community in a specific cultural and natural environment. While abstract reasoning forms part of local knowledge, it is not usually oriented towards the abstract. It is knowledge put into action and applied in day-to-day living and problem solving. Its value for historiography can be greatly enhanced when outsiders with professional training and skills team up with local practitioners in collaborations drawing upon complementary but different strengths.
Throughout my career I have looked for ways to better connect history, a written abstraction, to the realities of past life. For me, an outstanding model has long been Fernand Braudel’s The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, the first major work to advance and extensively engage the diversity of historical time.[26] It is the quintessential example of macrohistory, taking the Mediterranean region of the sixteenth century as the world centre driving the global margins. Notwithstanding the many merits of this great work, I long felt we also needed an alternative model that might achieve the opposite, a history that, radiating out from the margins to the centre, and moving from the specific to the general, could inform macrohistory while respecting local difference.
Recently such a model unexpectedly turned up in the work of the American folklorist and material historian Henry Glassie. I first encountered Glassie’s work when researching my first local history that became the book Farmers “Making Good.”[27] His Folk Housing in Middle Virginia was then a vanguard work in the exciting new field of vernacular architecture studies illuminating American social and cultural history.[28] At the time I paid little attention to another of Glassie’s books, a monumental local history of a small rural community in Northern Ireland called Passing the Time in Ballymenone, published in 1982.[29] Returning to it last year, I belatedly realized that this book, and its companion volume The Stars of Ballymenone, published a quarter century later in 2006, are the breakthrough texts I had long been seeking.[30] While it may not have received the attention of Braudel’s Mediterranean among historians, Glassie’s Ballymenone is its equal — a completely different yet comprehensive and utterly compelling approach to reconstructing human history from the ground up, with local knowledge at its centre.
Passing the Time in Ballymenone was the culmination of ten years’ collaboration between its author and the elders of Ballymenone, a community riven by poverty and social conflict, yet amazingly rich in local culture and knowledge. Like much of Glassie’s work, it is difficult to categorize. Part history, part ethnography, part folklore, it is steeped in the storytelling practices of a traditional community nevertheless seeking to navigate its way through changing times and the often turbulent history of the island in which it is situated.
If there is a hero in Glassie’s book it is the group of men and women comprising the community’s elders. They are, or were, the stars of Ballymenone, individuals whose talents functioned as the glue holding the community together. These storytellers and musicians kept alive the spirits of their fellow citizens during the dark period of the 1970s and early 1980s, when exploding bombs were part of the social landscape. These extraordinary performers were not agents of escapism, but thoroughly engaged in local efforts to persist in the face of violence and sectarian strife. Every elder incorporated the knowledge of a mentor, in turn passing on what they knew to a designated successor. The chain of transmission encompassed centuries of struggle extending back to the invasions of Oliver Cromwell, the British appropriation of the island, and past conflicts with landlords to win back their land.[31] Yet, the elders’ keen powers of observation enabled them to find meaning also in the unremarkable practices of daily life, the manifold ways that Ballymenone’s residents passed the time through work at day and stories at night.
Glassie’s particular favourite is Hugh Nolan, the community’s philosopher, historian, and sage. He quotes several of Nolan’s stories in their entirety, revealing his remarkable grasp of historical process, and stature as an entertainer, educator, and poet. Nolan also has a gift for historical aphorism. In commenting on historical change, he observes cryptically: “Aye, the two things happen at the one time. Things get better. And they get worse.”[32] Only when you reflect on that seemingly innocuous statement do you realize how much knowledge is behind it. Rejecting the notion of patterns in history, Nolan observes simultaneous but different trajectories, that things are getting better and worse at the same time. The notion of concurrent progress and declension is at odds with historicist syntheses but seems a sophisticated approximation of the actual complexity of human events. Braudel discovered asynchronous time scales through the study of world civilizations at the macrohistorical level; Hugh Nolan came to a parallel perspective by closely observing local events and storytelling the history of his own community.
Glassie’s books are exemplars of dialogical writing. Rather than impose his own words, he shares the stage with the elders, and invites readers to join the conversation. In the manner of Dostoevsky as interpreted by Bakhtin, each of his characters is accorded their own voice, unfiltered and unsubordinated by the author’s.[33] As further elaborated in Bakhtin’s Art and Answerability, the author’s voice is always shaped in relation to other voices, to whom the author, and indeed their readers, are answerable.[34] Glassie’s focus on polyphony and dialogue represents a deeply ethical commitment to the people of this community with whom he has generated a work of genuine collaboration, a history of, for, and by the people.
Of course, Glassie’s Ballymenone is a quasi-traditional society where, notwithstanding the intrusion of the modern age, its history has changed relatively slowly, at least until the last few decades. The world of Ballymenone seems remote from present-day Canada, where few of us live in the communities where we were raised. Our current places of residence, whether urban or rural, are characterized by ever-accelerating social and economic change and high rates of mobility, continually uprooting us and weakening long-established connections in time and space.
And yet, we are not done with local history and local historical knowledge, and they are not done with us. There are still communities of longstanding duration in this country, both rural and urban, where local historical knowledge persists. Many have resident sages who with little outside assistance continue to patiently document their histories and tell their stories. Over the last decade, with the collaboration of Jean Barman in Vancouver, Lynn Cousins in Iqaluit, Michael Gates in Whitehorse, and Tom Andrews in Yellowknife, I was fortunate to meet a variety of community historians of Aboriginal and ethnocultural communities, as well as professional practitioners of women’s history connected to communities across the West and the North, at gatherings to encourage nominations of potential national historic significance for commemoration. These are people who have stayed close to the grass roots and to place, elders who carry both written and oral historical memory of their communities into the present.
They include such people as Joe Wai, a Vancouver architect with a vast knowledge of Chinese Canadian history and heritage and the leading advocate of Vancouver’s Chinatown for more than 40 years, which he was instrumental in nominating as a National Historic Site. Another was Grace Eiko Thomson, the former President of the National Association of Japanese Canadians and a respected elder of the Japanese Canadian community. Grace initiated nominations to commemorate Tomekichi Homma, an early advocate for disfranchised Japanese Canadians, and the Asahi Baseball Team, the remarkably successful Japanese Canadian team based at Oppenheimer Park in Japantown in Vancouver. Both have now been nationally commemorated. When I was with Parks Canada in Vancouver, Jean Barman helped us organize workshops with these individuals and many other elders connected to ethnocultural, First Nations, and women’s history communities, prompting more nominations and national designations of Canada’s diverse history. Jean is herself an example of an elder who has remained closely connected to both academic and local communities, effectively bridging the gap between professional and vernacular history.
In increasingly urban environments many Canadians are establishing new connections that over time may evolve into enduring local communities. A case in point is Canada’s Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people. Often obliged to move away from the negativity of traditional environments, LGBT people have established networks of several decades’ duration and particularly in urban neighbourhoods across Canada. The work of Valerie Korinek with LGBT elders and communities on the prairies offers a fine example of how the study of detailed interactions at the local level is helping us better understand Canada’s recent history, notwithstanding our contemporary condition of uprootedness and diaspora.[35] A similar process is evident among Canada’s Aboriginal peoples, ethnocultural communities, and all manner of other groups, whose members have also moved away from their original communities and been obliged to adapt to new environments. We cannot predict the future but as these newer communities evolve over time, they may well benefit from local historical knowledge produced every day by individuals in dialogue with others, both near and far.[36]
A sobering caveat is that the continued erosion of governmental support to local archives, including the recent cancellation of the National Archival Development Program, poses major challenges to the protection and stewardship of irreplaceable documents and the future practice of local history in Canada. Each of us concerned with protecting the legacy and possibility of local history has a responsibility to challenge unwise public policy decisions imperilling this heritage, while voicing our support for programs that will foster the continued viability of local historical research in the future.
I want to conclude with an anecdote and an image. In 1992 I had the good fortune to meet the late William Commanda, the senior Elder of the Algonquin People at Maniwaki, Quebec. The National Capital Region is within the Algonquin’s traditional territory. At that time I was coordinating Parks Canada’s strategic plan for new commemorations,[37] and we wanted him to formally preside at our first national workshop on the history of Aboriginal Peoples. A colleague and I drove to Maniwaki to meet with William, then in his late seventies, to extend the invitation. He politely received us but put off any discussion of our request for most of the day. He took us into the woods to inspect the birch trees, then withering from acid rain contamination. For Commanda, who had made 200 birch-bark canoes, many housed in royal and museum collections, this was a calamity. Returning to his house, he showed us the wampum belts, ancient artifacts on which the history of his people is written in coloured beads. After several hours’ instructing us on spiritual, environmental, and historical matters, he accepted our invitation to preside at our workshop.
At the workshop in the boardroom at the Canadian Museum of Civilization a few months later, Chief Commanda prayed to the Creator, burned sweet grass and brought it around the table to envelop each participant with the smoke, a cleansing ritual that also underscored the importance of harmony in our discussions. Later, he took a lively role in the exchange, sharing his expansive knowledge and speaking on both environmental and historical issues. He referred to the Royal Proclamation of 1763 as written on the sacred wampum belts, and its implications for the rights of Aboriginal Peoples. He also discussed the graves of members of his people on Victoria Island in the middle of the Ottawa River, and his First Nation’s efforts to set the island aside as an Aboriginal heritage site. For us it was a rare privilege to see this wise old man in action but perhaps it was just another day in the life of a great Elder. He passed away three years ago at the age of 97, three years after being awarded the Order of Canada.
Observing the Idle No More protests that took place on Victoria Island earlier this year following the movement’s beginnings in Saskatoon, I was reminded of those meetings 20 years ago with Chief Commanda, his close connections to his community, and the importance he attached to place in the history of his First Nation. For me, a photograph of a wigwam on Victoria Island, with Canada’s Parliament Buildings in the background, perfectly expresses the kind of perspective I think he might have wanted us to have on our country’s history (Figure 2). It’s a perspective that is aware of the nation state but ever mindful of the unique vantage points on history endowed by local historical perspective, appreciating what we have in common but never forgetting who we are or where we came from.
Local historical knowledge is all around us. It is inscribed in our memories of people, places, and shared experiences. It is integral to our identity as members of communities with a common history. It strengthens connections between people, past and present, and it better positions us to face the future. As long as we live in communities, local historical knowledge will continue to be generated as we interact with one another and adapt to our environments. As historians we have barely scratched the surface of the possibilities for documenting and interpreting local historical experience. The field is wide open for study and experimentation. Long live local history and local historical knowledge.
Figure 2
Wigwam at the Aboriginal Experiences village, Turtle Island Tourism Company, Victoria Island, Ottawa.
Je dédie mon discours à la mémoire du professeur Ed Rea, soixante-septième président de la Société historique du Canada, un enseignant, un chercheur, un ami. Je souhaite aussi souligner la contribution de Ron Frohwerk, Jean Barman, Valerie Korinek, Penny Bryden et Ruth Sandwell, qui ont bien voulu me livrer leurs observations sur les versions antérieures de mon message, ainsi que celle de ma successeure à la présidence, Dominique Marshall, dont les sages paroles d’introduction à mon discours message m’ont beaucoup aidé à préciser la version écrite. Mon partenaire Ron m’a aidé d’innombrables façons tout au long de ma carrière et mérite une part du crédit de ce que nous avons pu accomplir ensemble dans les domaines de l’histoire publique et universitaire.
En écho au thème du congrès de la SHC, « Intersections et limites », j’entends aborder deux aspects de l’étude du passé qui sont régulièrement venus me préoccuper pendant plus de 35 ans, soit l’histoire locale et la connaissance locale du passé, cette dernière étant une conception épistémologique qui pèse sur la personne ayant une connaissance du passé et dont les formes de savoir ont une valeur. Mon discours fait la distinction entre la microhistoire telle que pratiquée par les professionnels et l’histoire locale que font les auteurs et professionnels vernaculaires. Je tenterai de définir ce qu’est l’histoire locale, de présenter certaines méthodes que je trouve utile et de suggérer comment elle pourrait enrichir la pratique générale de l’histoire tout en apportant une contribution qui lui est propre. Au fil du temps, une collaboration accrue entre les historiens professionnels et les collectivités locales du Canada pourrait nous aider à aller au-delà des limites qui subsistent encore parfois entre le national et le local, le professionnel et le vernaculaire[1].
Bien qu’elle soit mieux acceptée qu’il y a une génération, l’histoire locale occupe encore une place de second rang dans les travaux savants en histoire au Canada et ailleurs. Plusieurs monographies remarquables ont été publiées, mais les manuels et les articles sur l’historiographie canadienne font souvent fi des études locales. Les études communautaires et autres histoires dites particularistes ont acquis une brève notoriété durant ce que l’on a appelé les « guerres de l’histoire » des années 1990 où l’on reprochait aux auteurs de miner l’État-nation[2]. Toutefois, nous n’avons pas pour tâche d’aviver le patriotisme, mais plutôt de découvrir et d’éclairer le passé avec autant de justesse et de profondeur que possible dans toute sa pluralité. Si les études à petite échelle conviennent parfois mieux pour aborder une question du passé, il ne faudrait pas avoir de réticences à s’engager dans cette voie. C’est souvent celle qui conviendrait à des aspects de l’histoire qui ont été négligés et pour lesquels il manque de données de base ou de comparaisons entre communautés pour faire des généralisations solides.
Je me suis rendu compte de cela en fouillant dans plusieurs études sur la sexualité homosexuelle masculine de divers endroits de l’Ouest du Canada à l’époque de la colonisation de cette région. Les sources disponibles se trouvaient surtout dans des fonds d’archives juridiques portant sur des poursuites pénales. Les témoignages et les sources contextuelles permettent d’ouvrir une fenêtre sur les relations dans le temps et l’espace entre des hommes animés par un désir homosexuel durant cette période critique. Au-delà des cas particuliers, les exemples les mieux documentés permettent d’éclairer l’histoire plus large des collectivités, des provinces, de la région et du pays[3]. Après avoir examiné les dossiers de plus de 80 poursuites pénales pour homosexualité dans les archives des quatre provinces de l’Ouest et de Bibliothèque et Archives Canada, je peux affirmer que chaque affaire était différente et que la dynamique qui prévalait dans chacune des collectivités touchées était aussi grandement variable[4]. Bien évidemment il y avait des points communs entre chaque affaire sur les plans régional, social, démographique et culturel, et l’agrégation de données pour tout l’Ouest est aussi utile pour interpréter des cas particuliers. Toutefois, pour bien comprendre la dynamique de ces exemples, il nous faut tenter de saisir les attitudes, motivations et actions de chaque acteur en un lieu précis et à un moment donné. Pour l’histoire de la sexualité, comme dans bien d’autres champs en histoire, la formulation de généralisations solides nécessitera la compilation de suffisamment d’histoires locales avec assez de détails pour permettre des comparaisons utiles et pour dégager des schémas.
Si l’on doit tirer quelque chose des études comparatives de localités sensiblement similaires, ce serait que, même si elles partagent souvent des caractéristiques communes, il n’y a pas deux collectivités pareilles. Chacune est le fruit d’une relation espace-temps distincte entre les habitants et parmi eux. Qui plus est, la conscience de chaque personne comprend une série unique d’articulations espace-temps qui découlent d’interactions dynamiques et du dialogue avec d’autres personnes. Les généralisations peuvent devenir très ténues si l’on s’éloigne beaucoup de cette perspective centrale selon le concept de dialogisme de l’homme de lettres Mikhaïl Bakhtine[5]. À mon avis, le poteau indicateur à Resolute Bay, au Nunavut, constitue une expression tangible et pertinente de particularisme local. Il situe géographiquement Resolute Bay par rapport au pôle Nord, à Tokyo, à Moscou, à Paris, à Winnipeg et à Las Vegas, entre autres. Aucune autre collectivité n’occupe exactement le même espace ni n’a la même histoire. Resolute Bay et toutes les autres collectivités sont uniques, et par conséquent dignes d’une étude historique.
Une bonne partie des écrits professionnels actuels en matière d’histoire locale est subsumée sous la rubrique de microhistoire, que les historiens italiens Carlo Ginzburg et Carlo Poni ont motivé par deux raisons :
Mise en oeuvre à petite échelle, [l’analyse microhistorique] autorise souvent une reconstitution du vécu inaccessible aux autres approches historiographiques. Elle se propose d’autre part de repérer les structures invisibles selon lesquelles ce vécu est articulé[6].
L’étude des structures sociales et économiques « invisibles » qui relient le local et le général a fait la force de plusieurs microhistoires de collectivités de partout au Canada. Par exemple, dans sa monographie sur l’île Salt Spring, en Colombie-Britannique, Ruth Sandwell a examiné la structure des ménages pour dégager d’importants écarts par rapport à l’orientation commerciale présumée de l’économie agricole[7]. L’importance de la structure familiale pour l’économie agricole est aussi au coeur des études des collectivités mennonites manitobaines menées par Royden Loewen, qui ont fait ressortir des stratégies d’adaptation chez les fermiers immigrants soucieux de conserver leur différence religieuse et culturelle[8]. Les travaux classiques de Gérard Bouchard sur le Saguenay ont compris une analyse comparative de l’économie familiale locale qui a replacé les peuplements agricoles dans un contexte continental[9]. Le livre Backwoods Consumers and Homespun Capitalists de Béatrice Craig s’est penché sur l’émergence d’une culture de marché locale dans le Canada atlantique alors en construction, mettant en lumière le lien entre l’arrière-pays et les économies régionales et mondiales[10]. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses excellentes microhistoires faites par des historiens professionnels qui nous ont permis de mieux comprendre l’histoire du Canada à bien des égards. Chacune respecte le critère de Marc Bloch, cofondateur de l’École des Annales, voulant que les histoires locales savantes doivent éclairer un phénomène social et économique plus vaste[11].
Atteindre l’autre objectif de la microhistoire défini par Ginzburg et Poni — la reconstitution du vécu inaccessible — constitue une tâche différente, mais tout aussi difficile, surtout quand il s’agit de reconstruire l’histoire de lieux pour lesquels les données résident en bonne partie dans la mémoire vivante du passé. Ici, l’histoire orale entrera en jeu si l’on souhaite avoir une représentation exacte et exhaustive du vécu humain. S’il y a des personnes connaissant l’histoire locale, l’histoire orale aura sa place pour aborder un vaste éventail d’enjeux, mais surtout pour reconstruire le vécu, soit les habitudes et activités routinières du quotidien qui sont au coeur de l’histoire sociale. Pour ce genre d’études, je préfère l’étiquette d’histoire locale à celui de microhistoire puisque la sphère locale dépasse la recherche universitaire dans les archives et fait plutôt directement appel au contact et au dialogue avec des résidents locaux dans leur propre collectivité.
Il existe de nombreuses définitions d’histoire locale[12], mais aux fins des présentes je propose la suivante : l’histoire locale est l’étude des personnes et des groupes qui interagissent avec un lieu précis dans le passé, souvent en ayant des liens continus et tangibles avec le présent. L’échelle de ce que j’appelle « locale » varie considérablement en fonction du contexte; il peut s’agir d’un village ou d’une collectivité rurale, d’un quartier ou d’une zone culturelle d’interaction entre les humains et l’environnement. Pour faire de l’histoire locale, je préfère travailler sur de petites communautés de personnes que je côtoie de manière récurrente sur la durée. D’ordinaire, ces personnes peuvent se connaître ou avoir entendu parler les unes des autres, avoir travaillé ensemble ou les unes contre les autres, mais quoi qu’il en soit elles sont entrées régulièrement en contact par les structures et les relations du quotidien. La reconstitution détaillée des intersections entre les personnes ainsi qu’un milieu social et culturel particulier permet de donner à l’histoire locale tout son dynamisme éventuel et son pouvoir explicatif.
Les microhistoires de collectivités pourraient figurer sous la rubrique de l’histoire locale, mais cette dernière étiquette comprend aussi le travail d’historiens locaux ou vernaculaires qui ne pratiquent pas une discipline savante. Même si à certains égards l’histoire locale se rattache à la discipline de l’histoire, je préfère l’envisager sous l’angle d’un genre distinct en soi. Ses équivalents les plus proches sont parfois les travaux en ethnographie, en études folkloriques ou même en littérature. Comme l’a montré Malcolm Bradbury dans The Atlas of Literature, une bonne partie de la littérature dans le monde, y compris de grands romans canadiens, se compose d’histoires sises en un lieu particulier et pour lesquelles les interactions détaillées entre des personnages et des milieux précis se trouvent au coeur du récit[13]. C’est la même chose pour l’histoire locale.
En principe, l’absence même d’envergure de l’histoire locale devrait permettre une profondeur accrue du traitement historique par rapport aux études de plus grandes dimensions. À l’époque où je commençais ma recherche sur l’histoire de l’île d’Ellesmere en 1989, je me rappelle une discussion un midi avec mon amie, la regrettée professeure Irene Spry, dans la cafétéria aujourd’hui disparue de Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. Quand elle m’a entendu exprimer des doutes sur ma capacité de pouvoir fouiller chacune des sources traitant du sujet, elle m’a dit : « Comment pourras-tu savoir que tes conclusions sont justes si tu n’as pas tout examiné? » J’ai pris la mise en garde de cette éminente mentor comme un sage conseil et j’ai par la suite cherché à rendre ma recherche sur l’histoire du Haut-Arctique complètement exhaustive. On peut parfois procéder de la sorte avec l’histoire locale, mais ce n’est souvent pas possible dans le cas des études de plus grande envergure.
La pratique de l’histoire locale nous permet aussi de faire appel aux aînés et souvent même nous y oblige. Le titre d’Aîné (ou « Elder » en anglais) est souvent associé aux communautés autochtones, mais il désigne aussi les aînés des autres communautés qui assument souvent un rôle semblable dans leur propre milieu. Pour reconnaître le rôle distinctif des Aînés autochtones, je propose de mettre une majuscule à leur nom, tandis que je mettrai une minuscule pour parler des aînés dans d’autres contextes. Au fil des 35 dernières années, ma démarche historique a profité des conseils et de la générosité de bien des aînés des sphères universitaire et publique. J’ai aussi eu la chance de rencontrer des aînés de collectivités locales et de profiter de leur savoir. J’en présenterai certains dans le présent discours.
Ma façon de faire l’histoire locale a changé au fil de l’expérience que j’ai acquise de ce genre d’étude et de mes interactions avec les gens dans les collectivités. Ma démarche commence rarement par une vue d’ensemble. Elle part plutôt d’une recherche sur une personne, un lieu ou un artéfact en particulier. Même si je m’intéresse depuis longtemps aux théories, j’essaie d’éviter d’appliquer des modèles historiques, du moins jusqu’à ce que j’arrive aux dernières étapes d’un effort de recherche, et même là j’use de beaucoup de prudence. Après avoir défini une étude dans l’espace et le temps et avoir recensé les documents secondaires, je mets de côté l’historiographie et j’essaie de l’oublier pendant que je recueille beaucoup de données primaires et que j’échafaude des hypothèses provisoires pour guider la suite de la collecte de données. Je reprends cette démarche jusqu’à ce que des hypothèses heuristiques surgissent, soient testées, rejetées ou révisées, et finissent par devenir des explications envisageables. Le tout prend fin seulement quand toutes les conclusions épousent parfaitement les données et que les autres interprétations possibles se révèlent insuffisantes. Bien souvent, cette démarche m’a permis non seulement d’arriver à des réponses différentes, mais m’a aussi amené à changer les questions de base de ces études. Si la « description dense[14] » axée sur des sources et l’analyse à l’échelle locale indiquent que nous devrions prendre une autre direction que celle de l’historiographie actuelle ou de nos propres présuppositions, alors à titre d’historiens professionnels, je crois que nous devons être prêts à le faire.
Dans la mesure du possible, il est aussi important d’essayer de voir de ses yeux le milieu physique des lieux et des acteurs de l’histoire sur lesquels nous écrivons. Je suivrais le conseil donné par David Hackett Fischer dans son discours-programme au congrès de 2011 de la SHC dans lequel il nous a tous encouragés « à y aller, à le faire et à écrire sur le sujet » [trad.]. L’expérience directe des lieux historiques nous prépare à mieux comprendre les dimensions spatiales et temporelles de la localité pour déterminer ce qui a changé et ce qui est resté plus ou moins identique.
Lorsque je fais de l’histoire locale, je me laisse toujours guider par une démarche originale élaborée par Marc Bloch, qu’il a nommée « Comprendre le passé par le présent ». Bloch rejetait l’idée que la marche de l’histoire, même dans le monde moderne, est si inexorable que la majorité des structures du passé et des traditions culturelles disparaissent après une ou deux générations. Au lieu, certaines forces d’inertie ont nécessairement permis la persistance de nombreuses formes historiques jusqu’à ce jour. Plutôt que de débuter l’enquête historique par un point fixe dans le passé pour ensuite reconstruire l’histoire en avançant dans le temps, Bloch a proposé de commencer par la preuve la plus vivante et tangible d’époques anciennes qui subsistent encore dans le moment présent et d’en rechercher les origines en reculant dans le temps pour appréhender les époques à l’étude[15]. La démarche novatrice de Bloch avait des parallèles dans d’autres sciences, telles que l’étude de la géographie, de l’ethnographie et de l’architecture vernaculaire, dont les spécialistes tournent aussi leur enquête vers des traces concrètes de cultures anciennes pour mieux comprendre le passé.
Mon premier contact substantiel avec l’oeuvre de Bloch et l’École des Annales s’est fait au moment d’un premier travail d’histoire locale à la fin des années 1970 et au début des années 1980 qui a finalement donné lieu au livre Farmers “Making Good”[16]. Cette étude, fondée sur des recherches en archives, portait en grande partie sur la colonisation et l’histoire sociale, économique et politique de la collectivité agricole d’Abertnethy entourant le Site historique national du Homestead-Motherwell, dans le sud-est de la Saskatchewan. La recherche archivistique et particulièrement les tableaux de données agrégées et les modèles statistiques concernant l’histoire de cette collectivité ont permis de construire un exemple local documentant les origines d’une inégalité dans les Prairies rurales, l’émergence de classes socioéconomiques et les formes d’une inégalité intergénérationnelle en Saskatchewan, parmi une panoplie d’autres enjeux ayant une portée plus vaste.
Pourtant, un élément faisait défaut dans la démarche mettant l’accent sur la collecte de données et les mesures quantitatives. Si elles permettaient de révéler les tendances économiques globales, les statistiques n’aidaient toutefois pas à éclairer les conditions de vie matérielle, les interactions sociales et les relations sur lesquelles la collectivité repose. J’ai donc entrepris un travail d’histoire orale auprès des aînés du district, notamment les descendants des colons agriculteurs qui habitaient toujours à Abernethy ou dans les environs et qui en connaissaient l’histoire. Leurs souvenirs détaillés, leur présence continue dans la région et leurs activités agricoles ou autres semblables à celles que pratiquaient leurs ancêtres représentaient des sources beaucoup plus complètes et précises sur le travail et la vie quotidienne à l’époque de la colonisation que tout ce que l’on aurait pu assembler autrement. Leurs connaissances locales ont permis de mettre au jour les conditions matérielles et les interactions entre les populations et l’environnement qui, dans une perspective historique, définissent dans une large mesure le vécu du milieu agricole des Prairies au fil des générations. Ces personnes avaient une profonde connaissance des pratiques agricoles et du quotidien à la fois de leur propre vie et des époques antérieures. Par le fait même, ils corroboraient le caractère pratique du conseil de Bloch au sujet de la connaissance du passé par le présent. Ce n’est qu’avec le passage du temps que je me suis rendu compte que cette étude aurait pu être poussée au-delà de la collecte et de la synthèse d’entrevues d’histoire orale pour inclure les propres mots et la propre voix des répondants dans le texte parallèlement aux miens en qualité d’auteur.
Une décennie plus tard, je me suis de nouveau trouvé à adopter la méthode régressive prudente de March Bloch pendant la recherche qui allait donner lieu à mon livre Muskox Land, même si tout n’a pas commencé de la sorte[17]. Mon deuxième projet d’histoire locale d’envergure devait au départ donner un contexte pour interpréter l’histoire humaine de la réserve de parc national de l’Île-d’Ellesmere (aujourd’hui le parc national du Canada Quttinirpaaq) après le contact avec les Blancs, même si mon obsession pour la recherche l’a finalement amené beaucoup plus loin. L’entente de 1988 visant à créer cette réserve de parc a jeté les bases d’une collaboration entre Parcs Canada et Grise Fiord, la seule communauté inuite sur l’île d’Ellesmere et la communauté permanente le plus au nord du Canada. Nous avons élaboré un vaste exercice d’histoire orale auprès des résidents, mais aussi d’anciens membres de la collectivité qui étaient retournés au Québec, afin de tenir compte de leur expérience dans l’histoire plus large.
En novembre 1989, je me suis rendu à Grise Fiord pour expliquer le projet, demander les observations et l’approbation de la collectivité, et recruter des résidents locaux pour aider à le mener à bien. Mon idée de départ tournait autour du thème de l’adaptation. J’ai élaboré une liste préliminaire de questions pour aborder des sujets comme l’adaptation à la technologie moderne au cours des quatre premières décennies après la colonisation du fjord Grise au début des années 1950. Quand est venu le temps des entrevues, cependant, ces questions se sont révélées tangentielles par rapport aux préoccupations de plusieurs Aînés, surtout ceux originaires du Nord du Québec qui étaient retournés à leur communauté natale d’Inukjuak en 1988. Ces personnes préféraient parler de l’épreuve de la réinstallation. Les répondants originaires de l’île de Baffin qui résidaient encore à Grise Fiord discutaient d’autres sujets, y compris de la rareté du gibier, du prix de l’essence et des difficultés de pratiquer la chasse dans un milieu si rude. Je ne m’attendais pas à ce genre de témoignages, qui ne semblaient pas correspondre aux sources archivistiques consultées pour cette recherche. Longtemps, je me suis demandé comment résoudre le problème et j’ai décidé de mettre le projet en veilleuse en attendant l’épiphanie.
En retournant à mes notes quelques années plus tard, j’ai presque fait table rase, cette fois en partant des histoires orales que nous avions recueillies. Le fait de réétudier les témoignages oraux en lien avec le passé récent de la collectivité m’a aidé à envisager l’histoire de Grise Fiord et d’époques antérieures dans le Haut-Arctique avec un regard nouveau, en plus de m’inciter à revoir les sources écrites et à repenser les grands thèmes de l’étude. Tout cela m’a aidé à comprendre que, même à l’ère moderne, la survie des Inuits dans le Haut-Arctique avait plus à voir avec la continuité du savoir ancestral et les stratégies d’adaptation sur de multiples générations qu’avec une transformation culturelle imposée de l’extérieur, comme l’introduction de la technologie occidentale. À la manière de Marc Bloch et de sa méthode régressive, j’avais compris, tardivement, les affinités entre l’expérience récente de Grise Fiord et d’autres volets importants de l’histoire du Haut-Arctique ou, en termes braudéliens, que la longue durée était ancrée dans la moyenne durée de l’histoire récente[18]. Les données locales révélaient l’importance de l’adaptation et de l’adaptabilité pour la survie humaine dans un environnement pour le moins difficile, thème universel échafaudé en partant du spécifique pour aller au général et du présent vers le passé.
Au final, les témoignages oraux n’appelaient pas à la mise de côté du thème de l’adaptation et de la survie, mais la connaissance locale du passé que possédaient les Aînés traçait un chemin différent pour reconstruire l’histoire du Haut-Arctique. Plutôt que d’imposer ma synthèse interprétative, j’ai choisi de présenter les sources recueillies et de citer de longs témoignages des Aînés pour les laisser parler de leur propre voix sur des questions importantes, aux côtés de la voix de l’auteur. Parfois, l’histoire locale incite à la modération au niveau de l’interprétation. Après avoir partagé leurs sources avec les lecteurs, les auteurs devraient encourager ces derniers à en faire eux-mêmes l’évaluation et à tirer leurs propres conclusions. Bien que loin de donner une apparence définitive à la recherche, cette façon de faire permet la prise en compte, si ce n’est l’intégration, de perspectives et d’interprétations divergentes ainsi que d’une série de points de vue plus riches que les modèles mus par une thèse.
En mai 2001, je suis retourné à Resolute Bay et à Grise Fiord, les collectivités dont j’avais évoqué l’histoire dans mon ouvrage, afin de parler de ce livre aux résidents. Mes exposés portaient sur le thème des 200 ans d’adaptation et de survie dans le Haut-Arctique, y compris l’histoire relativement récente à partir du déplacement des Inuits dans les années 1950. Lors de la réunion à Resolute Bay, Liza Ningiuk, qui avait mené plusieurs entretiens d’histoire orale et avait depuis été élue maire de Grise Fiord, s’est levée et m’a dit en inuktitut : « Je crois que tout ce que vous dites est vrai. » Plusieurs autres résidents de Grise Fiord ont dit apprécier le respect avec lequel le livre traitait du rôle de leurs aînés et le fait que les personnes interrogées étaient nommées, que leurs paroles étaient citées et que leurs contributions étaient reconnues explicitement. Je suis d’avis que cela a aidé à susciter un sentiment de confiance qui a par la suite permis à l’écologiste Micheline Manseau et à moi-même d’obtenir l’appui des chasseurs et trappeurs de Grise Fiord pour notre projet sur les espèces en péril de Parcs Canada portant sur le caribou de Peary, qui a aussi puisé au savoir traditionnel des membres de la collectivité[19].
Parmi les personnes présentes à ma conférence à Grise Fiod en 2001 se trouvait le père de Liza Ningiuk, Abraham Pijamini (aujourd’hui décédé), chasseur aguerri et Aîné respecté (voir Figure 1). Selon Pijamini, les Inuits ont pu survivre au Haut-Arctique grâce aux caches. Par cela, il faisait référence à leur besoin de chasser autant que possible quand il y avait du gibier et de mettre la viande dans des caches sans tarder. Cette façon de faire était extrêmement importante parce que la biomasse dans le Haut-Arctique est très restreinte par rapport aux écosystèmes des régions plus au sud et que les animaux se font rares. Loin de leur communauté, les chasseurs inuits ne pouvaient ramener tous les fruits de la chasse aisément; la mise en cache leur permettait donc de continuer à chasser et de maximiser leurs efforts pour assurer la survie de leur communauté.
J’avais inclus une section dans le livre sur la mise en cache, mais la remarque de Pijamini m’a incité à en parler davantage, et le texte a été dûment retravaillé. Plus tard, un collègue archéologue m’a informé que l’éminent anthropologue Lewis Binford en était arrivé à la même conclusion que Pijamini dans deux livres de théorie archéologique fondés sur ses travaux auprès des Nunamiuts de l’Arctique de l’Ouest. Binford a postulé qu’en disséminant leur pratique de mise en cache dans divers endroits à l’échelle de leur territoire, les chasseurs arctiques atténuaient ainsi le risque de dommage à une cache en particulier[20]. Je trouve fascinant que Binford et Pijamini en soient arrivés à des conclusions semblables au sujet de moyens d’adaptation essentiels qui ont permis la survie dans les régions nordiques. Si les conclusions de Binford découlaient de l’étude ethnographique et de réflexions abstraites, l’éclairage de Pijamini venait de sa propre expérience de vie. Cela nous rappelle qu’il existe plusieurs chemins vers la connaissance et que notre compréhension du monde est renforcée lorsque divers systèmes de connaissances se corroborent l’un l’autre.
J’en arrive maintenant à la deuxième de mes préoccupations : la connaissance locale du passé. Je n’aborderai pas les connaissances écologiques traditionnelles ou locales, qui sont des modèles maintenant courants dans les cercles bureaucratiques[21]. Je préfère plutôt écouter ce que les historiens vernaculaires eux-mêmes ont dit au sujet de la connaissance de l’histoire. Généralement, ils la définissent comme la conséquence d’une expérience commune. En révisant la « History of the Red River Settlement » de Donald Gunn en 1912, son petit-fils George a replacé la connaissance de l’histoire de son aïeul dans les contextes expérientiels de sa carrière dans la traite des fourrures et dans les interactions sociales et intellectuelles avec d’autres aînés[22]. Dans Stories of My People, un recueil de vignettes historiques sur le premier siècle de la communauté japonaise de Vancouver, Roy Ito a écrit dans le même esprit que l’histoire « devrait être racontée de l’intérieur, une histoire telle que les personnes qui l’ont vécue l’ont vue et en ont gardé le souvenir[23] » [trad.]. Pour Gunn et Ito, la connaissance locale du passé n’est pas créée par de façon solipsistique par les personnes, mais elle découle plutôt de l’expérience intersubjective commune des membres d’une communauté.
Figure 1
Le recours à l’expérience en parallèle aux sources historiques a été remis en question par certains historiens, notamment par Joan Wallach Scott dans son article « The Evidence of Experience[24] » paru en 1991. Martin Jay précise dans son livre Songs of Experience que l’expérience est un concept complexe qui a occupé de nombreux penseurs, mais il n’y a toujours pas de conclusion définitive sur la façon d’y accéder et de s’y fier[25]. Scott reconnaît pourtant que l’on ne peut pas faire fi de l’expérience, aussi problématique ce concept semble-t-il. Son article présente des mises en garde utiles au sujet de l’essentialisation de l’expérience, mais la critique sévère de la connaissance expérientielle semble excessive, surtout s’il s’agit de la connaissance locale partagée à laquelle font référence Donald Gunn, Roy Ito et d’autres aînés. Les données sur l’expérience peuvent certainement être faussées par des couches de subjectivité, et il faut appliquer des règles de vérification à toutes les formes de données. Qui plus est, les sources orales, écrites, voire autres, ne devraient pas avoir de statut privilégié par rapport aux autres types de sources. Mais elles ont un lien avec les interactions matérielles et intellectuelles qu’ont connues conjointement divers membres d’une communauté et que ceux-ci ont corroborées indépendamment, l’histoire orale qui est directement enracinée dans l’expérience peut contribuer à la connaissance du passé de manière convaincante.
Je vais provisoirement définir la connaissance locale du passé comme étant la compréhension commune du passé que partagent les membres d’une localité dans une interaction dialogique dans le temps et l’espace. Elle découle des interconnexions au sein d’une communauté dans un environnement culturel et naturel précis. Bien que le raisonnement abstrait fasse partie de la connaissance locale, cette dernière n’est généralement pas orientée vers l’abstrait. Il s’agit plutôt de savoir mis en application au quotidien et pour la résolution de problèmes. Sa valeur pour l’historiographie peut être grandement amplifiée quand des étrangers ayant une formation professionnelle et des compétences s’unissent avec les forces locales pour tirer profit des forces complémentaires, mais différentes.
Tout au long de ma carrière, j’ai cherché des moyens de mieux lier l’histoire, une abstraction écrite, aux réalités de la vie passée. Pour moi, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II de Fernand Braudel est depuis longtemps un modèle remarquable. Il s’agit de la première grande étude à aborder la diversité des temps de l’histoire et à faire avancer la réflexion à ce sujet[26]. Cette étude est l’exemple par excellence de macrohistoire, avec la région méditerranéenne du XVIe siècle au centre du monde qui définit les marges du monde. En dépit des nombreux mérites de cette grande étude, j’ai longtemps trouvé que nous avions aussi besoin d’un modèle de rechange qui pourrait accomplir l’inverse, une histoire qui partirait des marges pour aller vers le centre, qui irait du particulier au général, pour informer la macrohistoire tout en respectant la différence locale.
Récemment, un tel modèle est apparu inopinément dans les travaux du folkloriste américain et spécialiste de l’histoire de la culture matérielle Henry Glassie. J’ai découvert Glassie quand j’ai fait la recherche pour ma première histoire locale, qui a donné le livre Farmers “Making Good”[27]. Son livre Folk Housing in Middle Virginia était à l’avant-garde de ce qui se faisait dans le domaine de l’étude de l’architecture vernaculaire pour éclairer l’histoire sociale et culturelle américaine[28]. À ce moment-là, j’ai prêté peu d’attention à un autre livre de Glassie, l’histoire locale monumentale d’une petite collectivité rurale du Nord de l’Irlande intitulée Passing the Time in Ballymenone et parue en 1982[29]. En y revenant à la fin de l’année dernière, je me suis rendu compte tardivement que cet ouvrage et le volume qui l’accompagne, The Stars of Ballymenone, publié un quart de siècle plus tard en 2006, étaient les textes révolutionnaires que je cherchais depuis longtemps[30]. Même si les écrits de Glassie sur Ballymenone n’ont pas autant retenu l’attention des historiens que La Méditerranée de Braudel, ils en sont le pendant — une démarche différente, mais exhaustive et très convaincante pour reconstruire l’histoire humaine de bas en haut, avec le savoir local en son centre.
L’ouvrage Passing the Time in Ballymenone est le fruit d’une collaboration de dix ans entre son auteur et les aînés de Ballymenone, une collectivité minée par la pauvreté et les conflits sociaux, mais dotée d’une culture et d’un savoir locaux étonnement riches. À l’instar d’une bonne partie des travaux de Glassie, cet ouvrage est difficile à catégoriser. À la jonction de l’histoire, de l’ethnographie et du folklore, il est empreint des narrations d’une collectivité traditionnelle qui cherche néanmoins à trouver sa voie malgré les temps qui changent et l’histoire souvent agitée de l’île où elle se situe.
S’il y a un héros dans le livre de Glassie, c’est le groupe d’hommes et de femmes composés des aînés de la collectivité. Ils sont, ou étaient, les étoiles de Ballymenone, les personnes qui gardaient vivante la flamme de la collectivité. Ces narrateurs et musiciens gardaient l’esprit de leurs concitoyens bien vivant durant la période sombre des années 1970 et du début des années 1980 au cours de laquelle l’explosion de bombes faisait partie du paysage social. Les incroyables interprètes n’étaient pas des agents d’évasion. Ils étaient plutôt profondément engagés dans les efforts locaux de résistance contre la violence et les combats sectaires. En chaque aîné se trouvait le savoir d’un mentor, qui à son tour transmettait ses connaissances à un successeur désigné. La chaîne de transmission englobait des siècles de luttes qui remontaient jusqu’à l’invasion d’Oliver Cromwell, à l’appropriation britannique de l’île et aux conflits du passé avec les propriétaires terriens pour regagner l’île[31]. Le sens d’observation aigu des aînés leur a permis de trouver leur sens aussi dans les activités banales du quotidien, c’est-à-dire la multitude de façons par lesquelles les résidents de Ballymenone passaient le temps en travaillant le jour et en racontant des histoires le soir.
Le favori de Glassie est Hugh Nolan, le philosophe, historien et sage de la collectivité. Glassie cite plusieurs histoires de Nolan au complet, révélant ainsi sa maîtrise remarquable du processus historique et toute sa prestance à titre d’animateur, d’éducateur et de poète. Nolan a un don pour parler par aphorismes du passé. En livrant ses impressions des changements de l’histoire, il fait remarquer laconiquement : « Oui, les deux choses arrivent en même temps. Les choses s’améliorent. Et elles s’empirent[32] » [trad.]. Ce n’est qu’en réfléchissant à cette déclaration en apparence anodine qu’on se rend compte de tout le savoir qui la caractérise. En rejetant la notion de schémas en histoire, Nolan fait remarquer des trajectoires simultanées, mais différentes, que les choses s’améliorent et s’empirent en même temps. La notion de progrès et de déclin concomitants a maille à partir avec les synthèses historicistes, mais elle semble une approximation évoluée de la véritable complexité des événements humains. Braudel a découvert les temporalités asynchrones par l’étude des civilisations du monde à l’échelle macrohistorique; Hugh Nolan en est venu à une perspective parallèle en observant de près les événements locaux et en racontant l’histoire de sa propre collectivité.
Les livres de Glassie constituent des exemples d’écrits dialogiques. Au lieu d’imposer ses propres mots, il partage la tribune avec les aînés et invite les lecteurs à prendre part à la conversation. À la manière de Dostoïevski vu par Bakhtine, Glassie accorde à chacun de ses personnages sa propre voix, non filtrée par celle de l’auteur ni subordonnée à celle-ci[33]. Comme l’a précisé Bakhtine dans Art and Answerability, la voix de l’auteur est toujours modulée en fonction des autres voix, en regard desquelles l’auteur, et de fait les lecteurs, sont redevables[34]. L’accent placé par Glassie sur la polyphonie et le dialogue représente un profond engagement éthique envers les habitants de cette collectivité avec qui il a effectué un véritable travail de collaboration, une histoire des gens, pour eux et par eux.
Évidemment, le Ballymenone de Glassie est une société quasi-traditionnelle dont l’histoire, malgré l’intrusion de la modernité, a évolué relativement lentement, du moins jusqu’aux quelques dernières décennies. Le monde de Ballymenone semble bien éloigné du Canada d’aujourd’hui, où peu d’entre nous vivons dans les collectivités où nous avons grandi. Notre lieu de résidence actuel, qu’il soit urbain ou rural, est caractérisé par la frénésie croissante du changement social et économique et des taux de mobilité élevés, qui nous déracinent continuellement et qui affaiblissent les liens de longue date dans l’espace-temps.
Or, nous n’avons pas fini de nous intéresser à l’histoire locale et à la connaissance locale du passé, et celles-ci n’ont pas fini de nous en apprendre. Il reste encore de vieilles collectivités dans notre pays, tant en milieu rural qu’urbain, où perdure une connaissance locale du passé. Bon nombre d’entre elles comptent des résidents sages qui, avec peu d’aide de l’extérieur, continuent patiemment à documenter leur histoire et à la raconter. Au cours de la dernière décennie, avec la collaboration de Jean Barman de Vancouver, de Lynn Cousins d’Iqaluit, de Michael Gates de Whitehorse et de Tom Andrews de Yellowknife, j’ai eu la chance de rencontrer une série d’historiens communautaires issus de communautés autochtones et ethnoculturelles ainsi que des professionnels qui s’intéressent à l’histoire des femmes dans les communautés de l’Ouest et du Nord à l’occasion de rassemblements pour mousser des mises en candidature d’importance historique nationale à commémorer. Il s’agit de personnes qui sont demeurées près du terrain et des lieux, d’aînés qui portent jusqu’au présent la mémoire écrite et orale du passé de leur communauté.
Parmi ces personnes, il y a notamment Joe Wai, un architecte de Vancouver qui possède une vaste connaissance de l’histoire et du patrimoine sino-canadiens et qui est le grand défenseur du quartier chinois de sa ville depuis plus de 40 ans. Il a d’ailleurs joué un rôle clé dans la mise en candidature de ce quartier comme lieu historique national. Il y a aussi Grace Eiko Thomson, ancienne présidente de l’Association nationale des Canadiens d’origine japonaise. C’est elle qui a lancé les mises en candidature pour commémorer Tomekichi Homma, un des premiers défenseurs des Canadiens d’origine japonaise privés de leur droit de vote et des Asahi, une formidable équipe de baseball nippo-canadienne basée au parc Oppenheimer dans le quartier japonais de Vancouver. Tous deux ont fait l’objet d’une commémoration nationale. Quand je travaillais pour Parcs Canada à Vancouver, Jean Barman nous a aidés à organiser des ateliers avec ces personnes et bien d’autres aînés branchés aux communautés historiques ethnoculturelles, des Premières Nations et des femmes, ce qui a suscité d’autres mises en candidature et désignations nationales témoignant de la diversité de l’histoire du Canada. Jean est elle-même un exemple d’aînée qui est restée intimement liée aux communautés universitaires et locales, faisant ainsi efficacement la soudure entre l’histoire professionnelle et l’histoire vernaculaire.
Dans les milieux de plus en plus urbanisés, de nombreux Canadiens et Canadiennes sont en train d’établir de nouveaux rapports qui au fil du temps pourraient évoluer pour donner lieu à des communautés locales durables. La communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) du Canada est un tel exemple. Souvent obligés de s’éloigner de la négativité des milieux traditionnels, les personnes LGBT ont façonné des réseaux au cours de plusieurs décennies, notamment dans des quartiers urbains à l’échelle du pays. Les travaux de Valerie Korinek sur les aînés et les communautés LGBT des Prairies représentent un excellent exemple de la façon dont l’étude des interactions précises au niveau local nous aide à mieux comprendre l’histoire récente du Canada, sans oublier notre condition contemporaine de déracinement et de diaspora[35]. Une situation semblable se fait jour chez les peuples autochtones du Canada, les communautés ethnoculturelles et tous autres types de groupes dont les membres ont aussi quitté leur collectivité d’origine et été obligés de s’adapter à un nouvel environnement. Il est impossible de prédire l’avenir, mais à mesure que ces nouvelles communautés évoluent, elles pourraient bénéficier de la connaissance locale du passé construite au quotidien par les personnes qui dialoguent entre elles, de près et de loin[36].
Le seul problème, et non le moindre, a trait à ce que l’érosion continue du soutien gouvernemental aux archives locales, comme le confirme la récente annulation du Programme national de développement des archives, constitue un obstacle majeur à la protection et à la gestion adéquate de documents irremplaçables tout comme à la pratique future de l’histoire locale au Canada. Nous tous et toutes qui avons à coeur de protéger le legs de l’histoire locale et ses perspectives d’avenir avons la responsabilité d’attaquer les décisions de politique publique malavisées qui mettent en péril cet héritage, tout en exprimant notre soutien aux programmes qui assureront la viabilité ininterrompue de la recherche historique locale.
Je conclurai sur une anecdote et une image. En 1992, j’ai eu la chance de rencontrer le regretté William Commanda, le doyen des Aînés du Peuple algonquin à Maniwaki (Québec). La Région de la capitale nationale se trouve dans les limites du territoire traditionnel des Algonquins. J’étais alors responsable du plan stratégique de Parcs Canada pour les nouvelles commémorations[37] et nous voulions qu’il préside notre premier atelier national sur l’histoire des Peuples autochtones. Accompagné d’un collègue, je me suis rendu jusqu’à Maniwaki pour rencontrer William, qui était alors presque octogénaire, et lui présenter notre invitation. Son accueil a été poli, mais il a refusé d’aborder la question presque toute la journée. Il nous a amenés dans la forêt inspecter les bouleaux, en train de dépérir à cause des pluies acides. Pour Commanda, qui avait fabriqué plus de 200 canots d’écorce, nombre d’entre eux exposés dans des collections royales et muséales, c’était une calamité. De retour chez lui, il nous a montré les wampums, ces artéfacts anciens sur lesquels est consignée l’histoire de son peuple au moyen de perles de couleur. Après plusieurs heures de leçon sur une panoplie de sujets spirituels, environnementaux et historiques, il a accepté notre invitation à présider notre atelier.
Lors de l’atelier qui s’est tenu dans la salle de conférence du Musée canadien des civilisations quelques mois plus tard, le chef Commanda a prié le Créateur et fait brûler du foin d’odeur, avec lequel il a fait le tour de la table pour envelopper chaque participant de fumée selon un rituel qui soulignait aussi l’importance de l’harmonie dans nos discussions. Plus tard, il a participé de façon animée aux échanges, partageant sa grande érudition et évoquant des sujets à la fois environnementaux et historiques. Il a fait allusion à la Proclamation royale de 1763 telle que mentionnée sur les wampums sacrés ainsi que de ses conséquences pour les Peuples autochtones. Il a aussi parlé des tombes des membres de son peuple sur l’île Victoria, au milieu de la rivière des Outaouais, et des efforts de sa Première Nation pour faire déclarer l’île site patrimonial autochtone. C’était un rare privilège pour nous de voir ce vieux sage en action, mais pour lui c’était sans doute une journée comme les autres dans la vie d’un grand Aîné. Il est décédé il y a trois ans à l’âge de 97 ans, trois ans après avoir reçu l’Ordre du Canada.
À la vue des manifestations à l’île Victoria plus tôt cette année après les débuts du mouvement Idle No More à Saskatoon, je me suis rappelé mes rencontres vingt ans auparavant avec le chef Commanda, ses liens étroits avec sa communauté et l’importance qu’il attachait aux lieux dans l’histoire de sa Première Nation. Selon moi, la photo d’un wigwam à l’île Victoria, avec les édifices du Parlement en arrière-plan, illustrerait parfaitement le regard qu’il aurait sûrement souhaité que nous ayons sur l’histoire de notre pays (voir Figure 2). Ce regard, conscient de l’État-nation, mais aussi attentif au point de vue unique qu’apporte la perspective historique locale, nous permet d’apprécier ce que nous avons en partage sans jamais oublier qui nous sommes ou d’où nous venons.
Nous baignons dans la connaissance locale du passé, qui est gravée dans notre mémoire des gens, des endroits et de nos expériences communes. La connaissance locale du passé est la pierre de touche de notre identité à titre de membres de collectivités qui ont une histoire commune. Elle resserre les relations entre les gens et le passé et le présent, et elle nous arme pour l’avenir. Tant que nous vivons dans des collectivités, la connaissance locale du passé continuera d’être générée dès lors que nous entrons en contact les uns avec les autres et que nous nous adaptons à notre environnement. Nous, historiens, avons à peine effleuré la surface des possibilités qui se présentent à nous pour documenter et interpréter l’expérience du passé à l’échelle locale. Le champ est entièrement libre à l’étude et à l’expérimentation. Longue vie à l’histoire locale et à la connaissance locale du passé.
Figure 2
Wigwam sur le site d’Aboriginal Experiences Village. Turtle Island Tourism Company, île Victoria, Ottawa.
Parties annexes
Biographical note
Lyle Dick is the author of the books Muskox Land, winner of the Harold Adams Innis Prize in 2003, and Farmers “Making Good,” co-recipient of the CHA’s Clio Prize in 1990. In 2012 the Governor General awarded him a Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for service to Canada, and on 30 May 2014 he will receive an honorary Doctor of Laws degree from Brandon University.
Notes
-
[1]
On the practice of vernacular history in Canada, see Lyle Dick, “Vernacular Currents in Western Canadian Historiography: The Passion and Prose of Katherine Hughes, F.G. Roe, and Roy Ito,” in Sarah Carter, Alvin Finkel, and Peter Fortna, eds., The West and Beyond: New Perspectives on an Imagined “Region” (Athabasca: Athabasca University Press, 2010), 13-46; “Red River’s Vernacular Historians,” Manitoba History, Special Selkirk Settlement Bicentenary Issue, no. 71. (Winter 2013), 3-15; and “The Seven Oaks Incident and the Construction of a Historical Tradition, 1816 to 1970,” Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada 1991, New Series, Vol. 2 (1991), 91-113.
-
[2]
My responses to the homogenizing imperatives of nationalist pan-Canadian history are elaborated in the following publications: Lyle Dick, “Saving the Nation through National History: The Case of Canada: A People’s History,” in Nicole Neatby and Peter Hodgins, eds., Settling and Unsettling Memories (University of Toronto Press, 2012): 188-214; “Sergeant Masumi Mitsui and the Japanese Canadian War Memorial: Intersections of National, Cultural, and Personal Memory,” Canadian Historical Review 91, no. 3 (September 2010): 435-63; “A New History for the New Millennium: Canada A People’s History,” Canadian Historical Review 85, no. 1 (March 2004): 85-109; “Representing National History on Television: The Case of Canada: A People’s History,” in Zoe Druick and Patsy Kotspoulos, eds., Programming Reality: Perspectives on English-Canadian Television (Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2008), 31-49; “Nationalism and Visual Media in Canada: the Case of Thomas Scott’s Execution,” Manitoba History, no. 48 (Fall/Winter 2004): 1-18; “‘A Growing Necessity for Canada’: W.L. Morton’s Centenary Series and the Forms of National History, 1955-1980,” Canadian Historical Review 82, no.2. (June 2001): 223-52; and “Renegade in Archives: Peter C. Newman and the Writing of Canadian Popular History,” Archivaria 22 (Summer 1986): 168-81.
-
[3]
Lyle Dick, “Same-sex Intersections of the Prairie Settlement Era: The 1895 Case of Regina’s ‘Oscar Wilde, ‘” Histoire sociale / Social History 42, no. 83 (May 2009): 107-45; and “The 1942 Same-sex Trials in Edmonton: On the State’s Repression of Sexual Minorities, Archives, and Human Rights in Canada,” Archivaria 68 (Fall 2009: 183-217.
-
[4]
Lyle Dick, “The Queer Frontier: Male Same-sex Experience in Western Canada’s Settlement Era,” The Journal of Canadian Studies 48, no. 2 (2014), 1-38.
-
[5]
See Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World, 2nd Edition (New York: Routledge, 2004); and Gary Saul Morson and Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics (Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1990).
-
[6]
Carlo Ginzburg and Carlo Poni, “The Name of the Game,” in Edward Muir and Guido Ruggiero, eds., Microhistory and the Lost Peoples of Europe (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1991), 8.
-
[7]
Ruth Sandwell, Contesting Rural Space: Land Policy and the Practices of Resettlement on Saltspring Island, 1859-1891 (Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005).
-
[8]
Royden Loewen, Family, Church, and Market: A Mennonite Community in the Old and New Worlds, 1850-1930 (Toronto: University of Toronto Press, 1993).
-
[9]
Gérard Bouchard, Quelques Arpents d’Amérique: Population, économie, famille au Saquenay, 1838-1971 (Montréal: Boréal, 1996).
-
[10]
Beatrice Craig, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada (Toronto: University of Toronto Press, 2009).
-
[11]
Susan W. Friedman, Marc Bloch, Sociology and Geography (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996), 80.
-
[12]
See, for example, Carol Kammen, On Doing Local History: Reflections on What Local Historians Do, Why, and What it Means (Nashville, Tennessee: The American Association for State and Local History, 1986), 1-11; and the definitions by various authors in Carol Kammen, ed., The Pursuit of Local History: Readings on Theory and Practice (Walnut Creek, California: Walnut Creek Press, 1996).
-
[13]
Malcolm Bradbury, ed., The Atlas of World Literature (London: De Agostino, 1996). I want to thank Susan Buggey for drawing my attention to this book and its relevance to my address.
-
[14]
See Joseph G. Ponteretto, “Brief Note on the Origins, Evolution, and Meaning of the Qualitative Research Concept “`Thick Description,`” The Qualitative Report 11, no. 3 (September 2006): 538-49.
-
[15]
Marc Bloch, The Historian’s Craft (trans., Peter Putnam) (Manchester, UK: Manchester University Press, 1992), 36-39.
-
[16]
Lyle Dick, Farmers ‘Making Good:’ The Development of Abernethy District, Saskatchewan, 1880-1920. Revised edition (Calgary: University of Calgary Press, 2008).
-
[17]
Lyle Dick, Muskox Land: Ellesmere Island in the Age of Contact (Calgary: University of Calgary Press, 2001).
-
[18]
For a recent discussion of the relationships between Braudel’s temporal registers, see Dale Tomish, “The Order of Historical Time: The Longue Durée and Micro-History,” The Longue Durée and World-Systems Analysis Colloquium to Commemorate the 50th Anniversary of Fernand Braudel, “Histoire et sciences sociales: La longue durée,” Annales E.S.C. 13, no. 4 (1958), 28 October 2008. <www2.binghamton.edu/fbc/archive/tomich102508.pdf>
-
[19]
Micheline Manseau, Lyle Dick and Natasha Lyons, People, Caribou, and Muskoxen on Northern Ellesmere Island: Historical Interactions and Population Ecology, ca. 4300 BP to Present (Winnipeg: Parks Canada, 2005).
-
[20]
Lewis R. Binford, Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Ethnographic and Environmental Data Sets (Berkeley, Ca.: University of California Press, 2001), 39; and Nunamiut Ethnoarchaeology (New York: Academic Press, 1978), 55-59, 241-45, and passim. I would like to thank Marty Magne for drawing my attention to these references.
-
[21]
For a critique of these models, see Paul Nadasdy, Hunters and Bureaucrats: Power, Knowledge, and Aboriginal-State Relations in The Southwest Yukon (Vancouver: UBC Press, 2003).
-
[22]
Archives of Manitoba, MG9, A78-1, George Henry Gunn Fonds, Box 4, File 1: “Revised manuscript of the Donald Gunn chapters,” 7.
-
[23]
Roy Ito, Stories of My People: A Japanese Canadian Journal (Hamilton, Ontario: Promark Printing, 1994), 432, quoted in Lyle Dick, “Vernacular Currents in Western Canadian Historiography,” 32.
-
[24]
Joan Wallach Scott, “The Evidence of Experience,” Critical Inquiry 17, no. 4 (Summer 1991): 773-797.
-
[25]
Martin Jay, Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2006).
-
[26]
Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Vols. I and 2 (trans., Siân Reynolds) (New York and London: Harper Colophon Books, 1976).
-
[27]
Lyle Dick, Farmers “Making Good”: The Development of Àbernethy District, 1880-1920. Revised Edition (Calgary: University of Calgary Press, 2008), first published in 1989.
-
[28]
Henry Glassie, Folk Housing in Middle Virginia: A Structural Analysis of Historic Artifacts (Knoxville: University of Tennessee Press, 1975).
-
[29]
Henry Glassie, Passing the Time in Ballymenone (Bloomington, India: Indiana University Press, 1995), first published in 1982.
-
[30]
Henry Glassie, The Stars of Ballymenone (Bloomington and Indianapolis, Indiana: Indiana University Press, 2006).
-
[31]
Ibid., 280-81.
-
[32]
Ibid., 131; and Henry Glassie, “The Practice and Purpose of History,” Journal of American History 81, no. 3 (December 1994), 968.
-
[33]
Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky`s Poetics (ed. and trans., Caryl Emerson) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).
-
[34]
Mikhail Bakhtin, Art and Answerability: Early Philosophical Essays (ed., Michael Holquist and Vadim Liapunov; trans., Vadim Liapunov) (Austin: University of Texas Press, 1990).
-
[35]
See Valerie Korinek, “‘We’re the girls of the pansy parade’: Historicizing Winnipeg’s Queer Subcultures, 1930s-1970,” Histoire Sociale 45, no. 89 (May 2012): 117-55.
-
[36]
For an eloquent statement on the importance of history to building communities, see Robert R. Archibald, A Place to Remember: Using History to Build Community (Walnut Creek, California: Walnut Creek Press, 1999).
-
[37]
Parks Canada, National Historic Sites System Plan (Ottawa: Public Works and Government Services Canada, 2001).
Parties annexes
Note biographique
Lyle Dick est l’auteur des ouvrages Muskox Land, qui a remporté le Prix Harold-Adams-Innis en 2003, et Farmers “Making Good”, gagnant ex-aequo d’un prix Clio de la SHC en 1990. En 2012, le gouverneur général lui a décerné la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour service méritoire au Canada. Le 30 mai 2014, l’Université Brandon lui conférera un doctorat honorifique en droit.
Notes
-
[1]
Au sujet de la pratique de l’histoire vernaculaire au Canada, voir Lyle Dick, « Vernacular Currents in Western Canadian Historiography: The Passion and Prose of Katherine Hughes, F.G. Roe, and Roy Ito », dans Sarah Carter, Alvin Finkel et Peter Fortna, dir., The West and Beyond: New Perspectives on an Imagined “Region” (Athabasca, Athabasca University Press, 2010), 13–46; « Red River’s Vernacular Historians », Manitoba History, Special Selkirk Settlement Bicentenary Issue, 71 (hiver 2013), 3–15; et « The Seven Oaks Incident and the Construction of a Historical Tradition, 1816 to 1970 », Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada, Nouvelle série, 2 (1991), 91–113.
-
[2]
Mes réponses aux impératifs d’homogénéisation de l’histoire pancanadienne nationaliste sont décrites dans les publications suivantes : Lyle Dick, « Saving the Nation through National History: The Case of Canada, A People’s History », dans Nicole Neatby et Peter Hodgins, dir., Settling and Unsettling Memories (Toronto, University of Toronto Press, 2012), 188–214; « Sergeant Masumi Mitsui and the Japanese Canadian War Memorial: Intersections of National, Cultural, and Personal Memory », Canadian Historical Review, 91, 3 (septembre 2010), 435–463; « A New History for the New Millennium: Canada A People’s History », Canadian Historical Review, 85, 1 (mars 2004), 85–109; « Representing National History on Television: The Case of Canada: A People’s History », dans Zoe Druick et Patsy Kotspoulos, dir., Programming Reality: Perspectives on English-Canadian Television (Waterloo, Ontario, Wilfrid Laurier University Press, 2008), 31–49; « Nationalism and Visual Media in Canada: the Case of Thomas Scott’s Execution », Manitoba History, 48 (automne-hiver 2004), 1–18; « “A Growing Necessity for Canada”: W.L. Morton’s Centenary Series and the Forms of National History, 1955–80,” Canadian Historical Review, 82, 2 (juin 2001), 223–252; et « Renegade in Archives: Peter C. Newman and the Writing of Canadian Popular History », Archivaria 22 (été 1986), 168–181.
-
[3]
Lyle Dick, « Same-sex Intersections of the Prairie Settlement Era: The 1895 Case of Regina’s “Oscar Wilde”, Histoire sociale / Social History, 42, 83 (mai 2009), 107–145; et « The 1942 Same-sex Trials in Edmonton: On the State’s Repression of Sexual Minorities, Archives, and Human Rights in Canada », Archivaria, 68 (automne 2009), 183–217.
-
[4]
Lyle Dick, « The Queer Frontier: Male Same-sex Experience in Western Canada’s Settlement Era », The Journal of Canadian Studies, 48, 2 (2014), 1–38.
-
[5]
Voir Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World, 2e édition (New York, Routledge, 2004); et Gary Saul Morson et Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics (Stanford, Californie, Stanford University Press, 1990).
-
[6]
Carlo Ginzburg et Carlo Poni, « The Name of the Game », dans Edward Muir et Guido Ruggiero, dir., Microhistory and the Lost Peoples of Europe (Baltimore et London, Johns Hopkins University Press, 1991), 8. La version française est tirée de Carlo Ginzburg et Carlo Poni, « La micro-histoire », Le Débat, 17, 1981, 136.
-
[7]
Ruth Sandwell, Contesting Rural Space: Land Policy and the Practices of Resettlement on Saltspring Island, 1859–1891 (Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005).
-
[8]
Royden Loewen, Family, Church, and Market: A Mennonite Community in the Old and New Worlds, 1850–1930 (Toronto, University of Toronto Press, 1993).
-
[9]
Gérard Bouchard, Quelques Arpents d’Amérique : Population, économie, famille au Saquenay, 1838–1971 (Montréal, Boréal, 1996).
-
[10]
Beatrice Craig, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada (Toronto, University of Toronto Press, 2009).
-
[11]
Susan W. Friedman, Marc Bloch, Sociology and Geography (Cambridge, R.-U., Cambridge University Press, 1996), 80.
-
[12]
Voir, par exemple, Carol Kammen, On Doing Local History: Reflections on What Local Historians Do, Why, and What it Means (Nashville, Tennessee, The American Association for State and Local History, 1986), 1–11; et les définitions de divers auteurs de Carol Kammen, dir., The Pursuit of Local History: Readings on Theory and Practice (Walnut Creek, California, Walnut Creek Press, 1996).
-
[13]
Malcolm Bradbury, dir., The Atlas of World Literature (London, De Agostino, 1996). Je souhaite remercier Susan Buggey d’avoir attiré mon attention sur ce livre et sa pertinence pour mon discours.
-
[14]
Voir Joseph G. Ponteretto, « Brief Note on the Origins, Evolution, and Meaning of the Qualitative Research Concept “Thick Description” », The Qualitative Report, 11, 3 (septembre 2006), 538–549.
-
[15]
Marc Bloch, The Historian’s Craft (traduction d’Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, par Peter Putnam) (Manchester, Manchester University Press, 1992), 36–39.
-
[16]
Lyle Dick, Farmers “Making Good”: The Development of Abernethy District, Saskatchewan, 1880–1920. Édition révisée (Calgary, University of Calgary Press, 2008).
-
[17]
Lyle Dick, Muskox Land: Ellesmere Island in the Age of Contact (Calgary, University of Calgary Press, 2001).
-
[18]
Pour une réflexion récente sur les liens entre les temporalités de Braudel, voir Dale Tomish, « The Order of Historical Time: The Longue Durée and Micro-History », Colloque « The Longue Durée and World-Systems Analysis » à l’occasion du 50e anniversaire de la publication de l’article de Fernand Braudel, « Histoire et sciences sociales : La longue durée », Annales E.S.C., 13, 4 (1958), 28 octobre 2008, www2.binghamton.edu/fbc/archive/tomich102508.pdf [consulté le DATE].
-
[19]
Micheline Manseau, Lyle Dick et Natasha Lyons, People, Caribou, and Muskoxen on Northern Ellesmere Island: Historical Interactions and Population Ecology, ca. 4300 BP to Present (Winnipeg, Parcs Canada, 2005).
-
[20]
Lewis R. Binford, Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Ethnographic and Environmental Data Sets (Berkeley, University of California Press, 2001), 39; Nunamiut Ethnoarchaeology (New York, Academic Press, 1978), 55–59, 241–45 et passim. Je tiens à remercier Marty Magne d’avoir attiré mon attention sur ces études.
-
[21]
Pour une critique de ces modèles, voir Paul Nadasdy, Hunters and Bureaucrats: Power, Knowledge, and Aboriginal-State Relations in The Southwest Yukon (Vancouver, UBC Press, 2003).
-
[22]
Archives du Manitoba, MG9, A78-1, Fonds George Henry Gunn, boîte 4, dossier 1 : « Revised manuscript of the Donald Gunn chapters », 7.
-
[23]
Roy Ito, Stories of My People: A Japanese Canadian Journal (Hamilton, Ontario, Promark Printing, 1994), 432, cité dans Lyle Dick, « Vernacular Currents… », loc. cit., 32.
-
[24]
Joan Wallach Scott, « The Evidence of Experience », Critical Inquiry, 17, 4 (été 1991), 773–797.
-
[25]
Martin Jay, Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme (Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 2006).
-
[26]
Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, t. 1 et 2, Siân Reynolds, trad. (New York et London, Harper Colophon Books, 1976).
-
[27]
Lyle Dick, Farmers “Making Good”… op. cit.
-
[28]
Henry Glassie, Folk Housing in Middle Virginia: A Structural Analysis of Historic Artifacts (Knoxville, University of Tennessee Press, 1975).
-
[29]
Henry Glassie, Passing the Time in Ballymenone (Bloomington, Indie, Indiana University Press, 1995), paru d’abord en 1982.
-
[30]
Henry Glassie, The Stars of Ballymenone (Bloomington et Indianapolis, Indiana, Indiana University Press, 2006).
-
[31]
Ibid., 280–281.
-
[32]
Ibid., 131; et Henry Glassie, « The Practice and Purpose of History », Journal of American History, 81, 3 (décembre 1994), 968.
-
[33]
Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky`s Poetics (Caryl Emerson, dir. et trad.) (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984).
-
[34]
Mikhail Bakhtin, Art and Answerability: Early Philosophical Essays, Michael Holquist et Vadim Liapunov, dir., Vadim Liapunov, trad. (Austin, University of Texas Press, 1990).
-
[35]
Voir Valerie Korinek, « “We’re the girls of the pansy parade”: Historicizing Winnipeg’s Queer Subcultures, 1930s–1970 », Histoire sociale / Social History, 45, 89 (mai 2012), 117–155.
-
[36]
Pour une explication éloquente de l’importance de l’histoire dans la construction de collectivités, voir Robert R. Archibald, A Place to Remember: Using History to Build Community (Walnut Creek, California,Walnut Creek Press, 1999).
-
[37]
Parcs Canada, Plan du réseau des lieux historiques nationaux du Canada (Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001).
Liste des figures
Figure 1
Figure 2
Figure 1
Figure 2