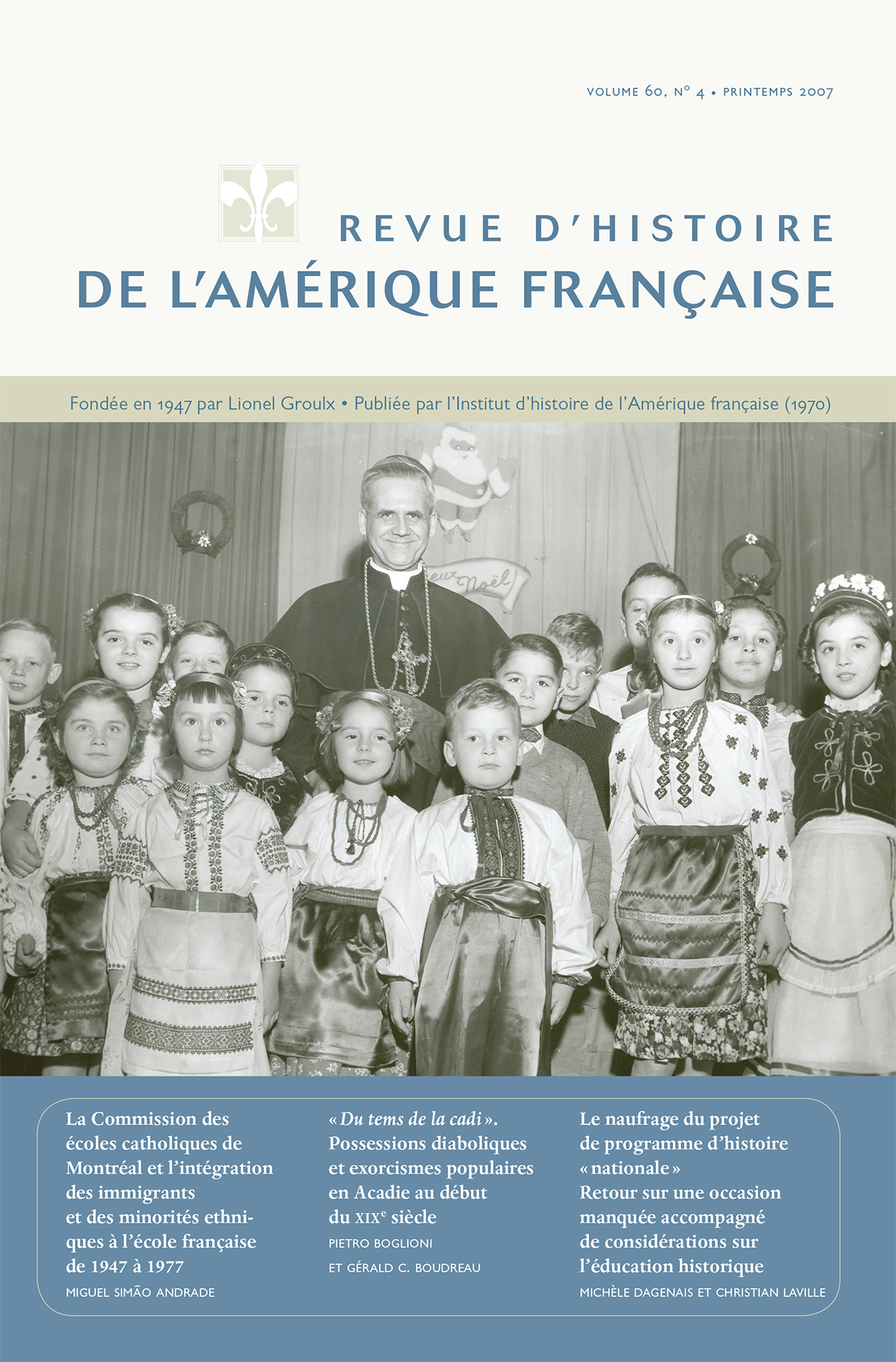Corps de l’article
La première phrase de l’introduction de Micheline Cambron donne le ton de cet ouvrage : « La vie culturelle du tournant du xxe siècle est loin de ressembler au désert que nous imaginons volontiers. Elle est au contraire effervescente… »
Et font fleurir ce désert les textes tirés du colloque du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) en 1999, année centenaire des Soirées du Château Ramezay, soit 18 articles, une introduction substantielle et deux annexes auxquels il faut ajouter une excellente bibliographie.
L’histoire littéraire, la sociologie de la littérature, la sociocritique sont des genres que les historiens et historiennes auraient intérêt à fréquenter plus souvent, car même si l’histoire culturelle, par son objet et par son approche, se distingue de l’histoire de la vie culturelle présentée ici, les travaux des membres du CRILCQ projettent sur le passé culturel et sur les élites « cultivées » un éclairage autre que celui de la science historique.
On ne peut rendre justice à chacun des textes réunis dans cet ouvrage. Mentionnons cependant ceux qui ont le plus de pertinence pour les historiens et les historiennes qui s’intéressent aux manifestations de la modernité au Québec, aux tensions sociales dans la société canadienne-française et aux moments de rupture qui ponctuent l’histoire du Québec. Les chapitres de la première partie de l’ouvrage, sur « l’état des lieux », sont de ceux-là.
Denis Saint-Jacques donne le coup d’envoi et explique le va-et-vient du centre de gravité littéraire canadien-français entre Montréal, Québec et Montréal par le détachement de la génération des Nelligan et des Louvigny de Montigny du pouvoir politique et de l’opinion publique. Suit l’article de Pierre Rajotte sur les Cercles littéraires, une exploration de la période de dépendance des auteurs envers les pouvoirs politique et religieux, de l’époque de la confrontation des libéraux et des ultramontains jusqu’à la formation d’institutions, de chapelles et de cénacles qui affirment l’autonomie d’un regroupement tel que l’École littéraire de Montréal.
L’article solide et magnifiquement illustré de Laurier Lacroix fait revivre un milieu artistique inféodé à « l’utile et [au] patriotique ». Lacroix fonde sa recherche sur les journaux de 1898 pour étudier un art moral et didactique à l’époque où la censure devient de plus en plus autocensure. Dans ce Montréal de fin de siècle, des artistes anglophones se réunissent à l’Art Association of Montreal, alors que les francophones oeuvrent au Monument national, mais on aimerait en savoir plus sur les rapports entre peintres des deux communautés linguistiques.
La chronique de la vie théâtrale, de Lucie Robert, à partir des données puisées dans le cinquième tome de La vie littéraire au Québec, fait revivre les producteurs, les dramaturges, les directeurs et les comédiens qui se produisent sur les scènes montréalaises. Au Monument national, au Théâtre National, au Théâtre des Nouveautés rivalisent dramaturges et acteurs français et canadiens-français, alors que le Her Majesty’s reçoit leurs homologues anglais et canadiens-anglais.
Il faut lire le texte de Marie-Thérèse Lefebvre qui ajoute un jalon à l’histoire de la musique au Québec et qui, heureusement, déborde des cadres stricts de son sujet : l’École littéraire de Montréal et la vie musicale. Période de contradiction, selon l’auteure, où francophones et anglophones poursuivent chacun leurs traditions musicales héritées du catholicisme et du protestantisme. C’est-à-dire, professionnalisme et élitisme des premiers et amateurisme, intimisme des seconds. Ce qui frappe dans cet article est la vitalité de la scène musicale et l’importance des musiciens et des compositeurs européens dans les programmes de concert.
Après une bonne mise en contexte, l’historienne Michèle Dagenais place le projet d’une bibliothèque municipale à Montréal au centre des enjeux culturels, religieux et politiques de l’époque et montre l’importance de cette institution dans « la reconquête de la vie culturelle » de la fin du xixe siècle. Le débat entre les libéraux tenants d’une bibliothèque publique, donc laïque, et le clergé, en particulier Mgr Bruchési, appuyé par les clérico-nationalistes, partisans d’un contrôle étroit des livres et des bibliothécaires par le clergé, reporte à celui sur l’éducation, qui devait être obligatoire et gratuite pour les uns, et demeurer sous la férule de l’Église au bon plaisir des parents pour les autres. Grâce à une recherche fouillée dans les archives municipales, Michèle Dagenais reconstruit chaque étape du projet de cette bibliothèque autour de laquelle s’affrontent politiciens et membres du clergé, Éva Circé-Côté et Victor Morin d’une part, Mgr Bruchési et Aegedius Fauteux de l’autre, pour enfin, après moult déménagements, arriver à l’édifice de la rue Sherbrooke en face du parc Lafontaine.
Dans la deuxième partie du livre « Entre le populaire et le savant », Mireille Barrière fait revivre un pan de la vie étudiante, Dominic Hardy présente Henri Julien et sa contribution à la mémoire collective et Jeanne Demers, dans un article d’une grande finesse, traite du conte écrit dans ce qu’elle appelle modestement des prolégomènes.
L’École littéraire de Montréal, « le plus important de tous les groupes littéraires et artistiques qui animaient alors Montréal » (Cambron, p. 15), occupe toute la troisième partie du livre et se retrouve aussi dans plusieurs autres chapitres. On trouve des études sur la « tentation symboliste » des membres de l’École (Martin), tentation qui frappe Albert Lozeau (Lemaire), Albert Ferland (Horban-Carynnik) et Nelligan (Brissette) ; sur le critique Eugène Seers/Louis Dantin (François Hébert, Pascal Brissette) ; sur la peinture de Charles Gill (Réginald Hamel) ; sur l’École comme réseau associatif (François Couture) ; que conclut un épilogue d’Yvan Lamonde. Pour Lamonde, la modernité au Québec se manifesterait par un apolitisme, une « sortie de l’idéologique ». L’assertion est discutable car « l’aspiration de liberté » ne signifie pas toujours un vide idéologique. Le lien est fort, et souvent avoué, entre l’idéologie libérale et la modernité et, parmi les littéraires de la belle Époque, c’est la politique partisane et le cléricalisme, plutôt que le libéralisme qui sont fustigés.
Le sujet, la vie culturelle autour de 1900, est si vaste et si riche, qu’on ne peut en couvrir toutes les manifestations dans un seul ouvrage. Ce qui nous est offert se limite en grande partie à la culture élitiste francophone et masculine montréalaise. Si plus du tiers du livre est consacré à l’École littéraire de Montréal qui, à son sommet, ne comptait que 8 membres actifs sur ses 18 membres, même si « grâce à ses séances publiques, elle est célébrée comme la manifestation culturelle montréalaise par excellence » (Couture, 301), qu’en est-il de ce qu’il convient d’appeler « le peuple » ? Les travailleurs et les travailleuses n’avaient-ils pas de vie culturelle ? Certes le parc Sohmer est mentionné et le Musée Eden figure sur une affiche (sans qu’on explique les horreurs de ce lieu couru par les amateurs de sensations fortes), mais sans plus. Les anglophones et ceux qu’on appelle aujourd’hui les allophones avaient sûrement aussi une vie culturelle, outre la musique classique dont traite M.-T. Lefebvre, les arts plastiques cités par L. Lacroix et le Her Majesty’s mentionné par L. Robert. L’École littéraire de Montréal est à cent lieues de la commercialisation d’une culture annoncée dans le texte de Dagenais (105).
Enfin, presque tous les auteurs font fi de la moitié du genre humain. Les femmes, il est vrai, n’étaient admises ni au collège classique ni à l’université, elles sont donc absentes d’un article sur les étudiants et l’activité musicale. L’École littéraire de Montréal n’admettait pas de femmes, pourtant nombreuses à écrire à cette époque. La seule qui, à notre connaissance, a demandé à y être admise, la journaliste Germaine de Montreuil (Georgina Bélanger Gill), essuya un refus inconditionnel. Cette exclusion aurait pu être problématisée, reconnue, au moins soulevée par un ou une des huit auteurs qui traitent de l’École. Le séparatisme des réseaux associatifs – sauf les salons – va de soi et n’appelle aucune explication ou contextualisation. L’excellent essai de Jeanne Demers montre les contes dominés par les narrations masculines, sauf une mention de « Mme Raoul Dandurand », soit Joséphine Marchand Dandurand (p. 187). Il faut féliciter Lucie Robert qui reconnaît très bien que des femmes et des hommes ont contribué au théâtre du tournant du xxe siècle, et Marie-Thérèse Lefebvre pour sa présentation du rôle des femmes dans l’interprétation et la diffusion de la musique.
L’indifférence de presque tous les auteurs aux classes sociales et aux rapports de genre n’altère pas la présentation d’un beau livre, agrémenté d’un CD de musique d’époque, qui rejoint plus qu’un lectorat universitaire. Un ouvrage qui ouvre des pistes, qui nous laisse sur notre appétit et qui appelle à de nouvelles recherches sur cette période « en pleine effervescence ».