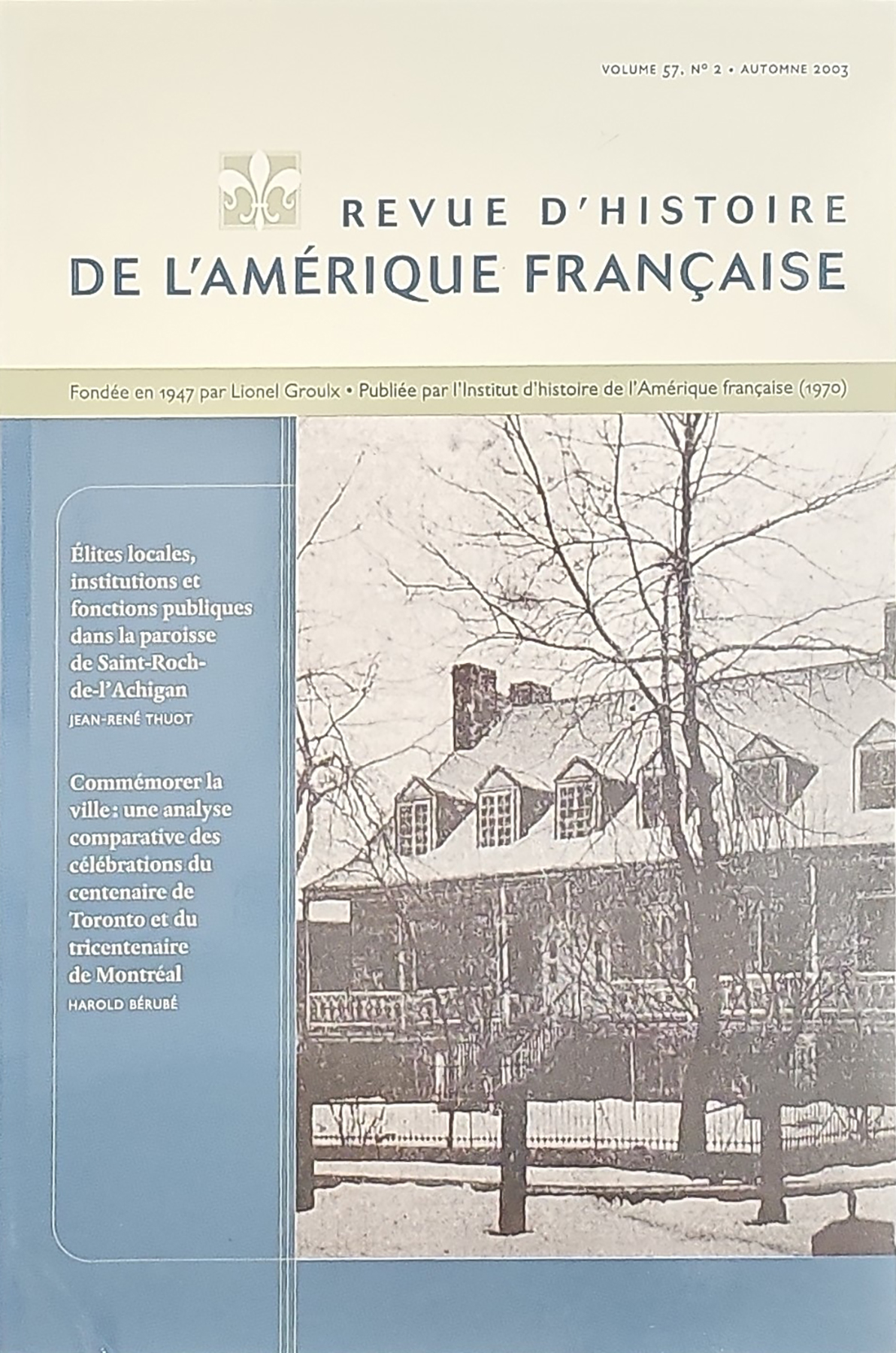Corps de l’article
Au centre-ouest de Montréal, près d’un marché de produits agricoles, à côté de vendeurs d’antiquités, un lieu de culte ultramoderne attire des milliers de personnes. Fabriqué en béton, plein d’espace éclairé au naturel et au néon, ce temple réunit des gens qui veulent à la fois se rencontrer et se disperser. Ils viennent de partout et ils s’en vont dans toutes les directions. Ils passent devant une sculpture en bois représentant la souche commune de l’humanité pour ensuite s’apercevoir eux-mêmes éclatés dans les reflets d’un mur modelé en acier inoxydable. Ici, ils obéissent aux directives en français et ils s’agenouillent devant le même mythe : que la conquête de l’espace et du temps est possible. C’est la station de métro Lionel-Groulx.
L’argument du beau livre de Gérard Bouchard, Les deux chanoines, est là tout entier. Groulx aurait été enchanté et horrifié en même temps par ce temple moderne, ce qui n’étonnerait en rien Bouchard qui répondrait tout simplement, « mais bien sûr », car Groulx n’est rien si ce n’est contradiction. Pour poursuivre l’analogie et dévoiler le but de l’auteur, Bouchard serait à la fois l’architecte de cet endroit et le vérificateur des billets de ceux qui le fréquentent. Il s’intéresse à la structure de la pensée de Groulx et il veut s’assurer que, dorénavant, l’accès à cette pensée sera rendu possible grâce à un ticket obligatoire marqué « contradiction ». D’une main assurée, et ayant lu toute l’oeuvre imprimée de Groulx (ce qui, comme chez Groulx lui-même, n’évite ni les répétitions ni les contradictions), Bouchard démontre, et nous convainc, que la contradiction constitue l’essence même (« l’architecture ») de la pensée de Groulx. Impossible, donc, de tirer Groulx d’un côté ou de l’autre, à l’appui d’une idéologie quelconque. Impossible de l’accuser de ceci ou de cela, car on trouve chez lui tout et son contraire. Son oeuvre contient des graines de tout. D’autres, avant Bouchard, l’avaient déjà souligné ; la nouveauté ici c’est qu’il en fait le fond même de la pensée de Groulx et, plus audacieux encore, essaye de l’expliquer.
Ce dont on peut accuser Groulx, d’après Bouchard, c’est de ne pas se rendre compte de ses contradictions, de ne jamais se repenser ni se repentir, et de n’avoir pas articulé un mythe rédempteur. Car, selon l’auteur, les contradictions inhérentes à toute pensée se rachètent au moyen de mythes : la raison, incapable de résoudre ou de tolérer les contradictions, démissionne et laisse la place à quelque chose d’irrationnel : le mythe. De tels mythes peuvent être « efficaces » ou pas, selon leur utilité à « énergiser » une société. Contrairement à d’autres sociétés, que de tels mythes ont « énergisées », cela n’aurait pas eu lieu dans la société canadienne-française du temps de Groulx, et il en serait partiellement responsable. Une certaine tristesse se dégage donc de ce livre : l’incapacité de Groulx à surmonter ses propres contradictions au moyen d’un mythe efficace aurait empêché le Québec de faire... quoi au juste ? Étant donné les constantes que Bouchard prête quand même à Groulx — la priorité à la nation, l’émancipation nationale, la responsabilité des élites et la grande destinée des Canadiens français en Amérique — on peut le deviner.
Dans ses trois chapitres explicatifs à la fin du livre, Bouchard essaie d’analyser l’échec de la pensée de Groulx à formuler une vision et des directives cohérentes pour guider les Canadiens français vers un but ultime. Délicatement, il met de côté tous les fragments d’explication qui surgissent dans la tête d’un lecteur historien le long des onze chapitres de la démonstration — questions autour de la chronologie, le contexte, le personnage (surtout la profession religieuse) ou les textes mêmes de Groulx — et nous renvoie aux hypothèses plutôt sociologiques de « mythe » et de « désarticulation ». Il essaie d’attacher un individu à une société, une pensée à une structure sociale pour mieux comprendre les deux. Bouchard admet que c’est « le passage le plus périlleux » de son étude et bien qu’il le traverse avec élégance, c’est ce passage qui mérite le plus d’être discuté.
D’abord, les mythes. Bouchard, qui ne cite qu’une étude sur les mythes (au sujet de la littérature américaine), en voit partout. Tout en ayant reproché à Groulx de ne pas avoir trouvé de mythe rédempteur, il trouve néanmoins beaucoup de mythes à l’intérieur de la pensée du chanoine. Une vingtaine de ces mythes sont énumérés au chapitre XV, mais au lieu de réconcilier ou de résoudre les contradictions, il en ajoute d’autres. D’ailleurs, dans bien des cas, ce qui était contradiction dans les chapitres antérieurs réapparaît ici comme mythe. Un mythe peut-il être à la fois contradiction et réconciliation de contradiction, détaché du réel et ancré dans le réel ? Bouchard semble le croire, distinguant mythe « inopérant », « médiateur » ou « correcteur ». Mais quoi faire quand les mythes eux-mêmes s’entremêlent et se contredisent ? Suffit-il alors d’un autre grand mythe, « efficace », à l’américaine par exemple, celui qui aurait donné toute l’énergie à nos voisins du Sud, mais qui nous laisse, n’ayant pas de tel mythe, dans une léthargie lamentable ? C’est ce que nous propose Bouchard. Les mythes se prêtent-ils à de tels standards utilitaires ? Par ailleurs, le mythe américain, tel qu’il est esquissé par Bouchard, n’est pas sorti d’une seule pensée et encore moins d’un seul individu, mais plutôt de toute une société. Pourquoi donc accuser Groulx d’avoir failli à la tâche ? Bouchard ne demande-t-il pas trop à son petit prêtre, professeur et poète, un peu perdu quand même en politique ?
Ici l’auteur fait intervenir sa deuxième explication de la pensée contradictoire, ambivalente, incohérente et finalement équivoque de Groulx. La société canadienne-française de son époque aurait été ainsi. La raison se trouve dans les « désarticulations » (concept emprunté au sociologue français Alain Touraine) qui la caractérisent. Quatre types extérieurs de pouvoir révèlent cette désarticulation : le capital étranger, la politique de Londres ou d’Ottawa, la culture de la France et la religion de Rome pèsent tous sur le Québec. Autour de chaque type de pouvoir et entre chacun d’eux gravitent des intérêts très divergents. D’où, paraît-il, une incohérence réciproque : société et individu, en l’occurrence Groulx, toujours tiraillés et incapables d’en sortir. À moins de faire des comparaisons avec d’autres sociétés, il est difficile de savoir si on est ici devant quelque chose de particulier ; ne serait-on pas, par hasard, en face de la vieille nostalgie d’une société dite « normale » ? D’ailleurs, qui dit que dans de telles circonstances de désarticulation, on pense nécessairement de travers ? Qu’en sait-on exactement ? On est loin d’avoir creusé le lien individu-société, encore moins le lien société-pensée. Parmi les belles pistes de recherche que suggère Bouchard à la toute fin du livre, il omet d’en mentionner une. Les quatre pouvoirs qui constituent la désarticulation de la société canadienne-française, ainsi que les intérêts qui gravitent autour, sont tous entre les mains d’hommes. Voilà une désarticulation majeure où les effets sociaux, individuels et de pensée sont beaucoup plus visibles et donc plus faciles à étudier. Dans bien des cas, Groulx présentait son petit peuple au féminin vis-à-vis d’un monde peint au masculin. Autre contradiction qu’un mythe efficace aurait résolu ? Autre mythe inopérant ? Ou partie intégrale et intégrante de cette « architecture » ?
Ce livre marie donc une démonstration lucide et convaincante de La Contradiction comme fondement de la pensée de Groulx à des explications élégantes mais floues du lien entre individu et société, entre la pensée d’une personne et l’imaginaire collectif. Si Bouchard entend faire ce qu’il annonce dans ce livre — utiliser ce jumelage contradictions-mythes pour saisir toute la pensée sociale du Québec francophone des deux derniers siècles — bien des clarifications s’imposent. Au contraire de Groulx, on peut compter sur Bouchard pour les faire. Et donc on peut attendre avec impatience son prochain livre.