Résumés
Résumé
Si l’oeuvre de Boris Vian fut souvent analysée à partir des notions de non-sens et d’étrangeté, comme au moyen de perspectives poétiques ou stylistiques en raison de sa prose inventive, l’onirisme demeure une voie moins explorée dans le paysage des études vianesques. Pourtant, les affinités des oeuvres avec les courants surréaliste, absurde et fantastique donnent à voir dans les textes des univers qui s’apparentent à des mondes rêvés, en ce qu’ils s’affichent comme des espaces de l’entre-deux. Cet article se propose, d’abord, de définir la notion d’espace onirique, puis d’observer son opérationnalité, de même que sa variété, au sein des pièces Les Bâtisseurs d’empire (1959) et L’Équarrissage pour tous (1950) ainsi que des romans L’Arrache-coeur (1953) et L’Herbe rouge (1950). Nous saisirons également l’occasion d’interroger l’oeuvre de Vian en regard de théories contemporaines sur l’onirisme en études littéraires et théâtrales, lesquelles nous jugeons plus que pertinentes pour « relire Vian, aujourd’hui ».
Abstract
Because of his creative prose, Boris Vian’s work has often been analyzed in terms of nonsense and oddity, or from a poetic or stylistic viewpoint, leaving its oneiric qualities a rather unexplored avenue in the realm of Vianesque studies. Yet, Vian’s work evokes surrealist, absurdist, and fantastic movements, and reveals in the texts universes that are similar to dreamed worlds, in that they are displayed as spaces of the in-between. This article first proposes to define the notion of oneiric space, then to observe its effectiveness as well as its diversity within the plays Les Bâtisseurs d’empire (1959) and L’Équarrissage pour tous (1950) as well as the novels L’Arrache-coeur (1953) and L’Herbe rouge (1950). We will also take this opportunity to examine Vian’s work in relation to contemporary onirism theories in literary and theatrical studies, which we consider more than relevant to “rereading Vian, today”.
Corps de l’article
Jean Starobinski emploie au sujet de textes qui ne miment, lui semble-t-il, ni pleinement le réel, ni tout à fait l’irréel, mais bien l’ambivalence onirique entre les deux, les mots suivants : « [I]l y a de ces oeuvres où nous croyons que le rêve s’est déposé : il nous semble le reconnaître. [Elles] ont le rêve derrière elles : elles en sont le récit pictural. Disons plus : elles nous paraissent en être l’imitation fidèle, comme d’autres images imitent fidèlement les apparences du monde réel[1]. » Si ces oeuvres dont parle Starobinski miment l’activité onirique, ce n’est donc peut-être pas tant qu’elles traitent du rêve, mais plutôt qu’elles en adoptent elles-mêmes la forme en se rapprochant et en s’éloignant incessamment du vraisemblable par le doute, l’hésitation ou les contradictions constantes qui sont le propre des univers atopiques. Ces derniers sont eux-mêmes localisés dans un écart, situés dans un espace de l’entre-étrange-et-familier pour le formuler ainsi. C’est en fait le sentiment de l’inquiétante étrangeté[2] de Freud qui est reconduit dans ces textes, celui-ci « [survenant] souvent […] chaque fois où les limites entre imagination et réalité s’effacent[3] ». Jacques Goimard dans sa Critique du fantastique et de l’insolite insiste aussi sur ces frontières floues propices aux représentations oniriques. Citant Aragon, il évoque l’état intermédiaire entre rêve et réalité, susceptible de donner lieu moins à une cohérence dans le récit qu’à cet éclatement de la vraisemblance, écart si typique de l’activité onirique telle qu’on l’expérimente dans le sommeil : « Il se fait comme ça, entre les rêves et la conscience éveillée, des échanges mal définis : une sorte d’osmose peut-être, on ne reconnaît pas que cette pensée vient du rêve […], elle a traversé la membrane[4]. »
Chez Vian, elles le sont sans cesse, effacées, déplacées, transgressées, dissoutes, ces limites entre étrange et familier ; ses oeuvres nous attirant presque sans relâche vers les échos d’un monde rêvé. Tant et si bien qu’on en vient à se demander à quoi, plus précisément, serait due cette impression d’un onirisme implicite dans les écrits vianesques, impression soulevée par bien des commentateurs, sans jamais qu’aucune étude n’approfondisse les manifestations concrètes, les contours théoriques ou les effets d’une telle parenté de l’oeuvre et de l’onirisme[5].
Des effets oniriques
Toute impression, toute latence, en littérature est d’abord ressentie par un lecteur. Produite, donc – cette impression –, pour reprendre les termes de Wolfgang Iser, par la « dynamique » de l’oeuvre littéraire telle que considérée à travers le « processus » de l’acte de lecture[6]. Ces effets de lecture se dénombrent en plusieurs termes chez les chercheurs qui se concentrent de près ou de loin sur le rêve en littérature. Pour certains, les textes implicitement oniriques, qui font « du rêve [la] structure même de l’oeuvre[7] » produisent du désordre, c’est-à-dire le sentiment d’une accumulation de détails hétérogènes. Par d’autres, les récits oniriques sont qualifiés d’inconséquents et seraient marqués par l’impression renouvelée d’une surprise, d’un bouleversement constamment répété de la fable qui prend « le lecteur à défaut par l’instauration d’un régime de lecture non indiciaire pour le moins inhabituel[8] ». Enfin, selon d’autres encore, un effet d’indétermination nourrit la sensation d’être dans un écart, dans cet entre-deux jamais tout à fait familier ni complètement étrange, comme prisonnier d’ « une hésitation sur la nature du moi et du monde, comme une perplexité sur la nature de l’oeuvre qui s’élabore[9] ». Ces trois effets, parfois répertoriés sous d’autres terminologies[10], tendent à rendre opératoire la notion d’un onirisme implicite et permettent déjà de l’observer concrètement chez notre auteur. Par exemple, les longues descriptions de la flore dans L’Arrache-coeur créent un décalage sous l’effet du désordre des éléments naturels qui s’accumulent et entraînent un fort sentiment de déambuler avec Jacquemort dans un espace indéterminé où la fantaisie contamine continuellement, mais jamais pleinement, le réel attendu :
Le jardin s’accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l’état de nature. Il y avait des calaïos, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, est vert tendre et nervuré de blanc à l’extérieur ; des ormades sauvages, aux tiges filiformes, bossuées de nodosités monstrueuses, qui s’épanouissaient en fleurs sèches comme des meringues de sang, des touffes de rêviole lustrée gris perle, de longue grappes de garillas crémeux accrochés aux basses branches des araucarias, des sirtes, des mayanges bleues, diverses espèces de bécabunga, dont l’épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, des haies de cormarin, de cannaïs, de sensiaires, mille fleurs pétulantes ou modestes terrées dans des angles de roc […][11].
Encore, l’absurdité des événements de L’Équarrissage pour tous, malgré un ancrage historique marqué, participe d’un effet d’inconséquence, d’un étonnement et de contradictions qui perturbent à répétition les attentes. Le pénible déchiffrage du bruit dans Les Bâtisseurs d’empire ou de certaines descriptions de L’Herbe rouge sont d’autres exemples de passages produisant du désordre, de l’inconséquence et de l’indétermination comme effets, laissant le lecteur pantois, l’abandonnant aux limites de la représentativité : « [D]evant lui se déroulait la carte sonore à quatre dimensions de son passé fictif[12]. » Cependant, partant du principe que l’onirisme se construit dans la forme et non dans le fond des oeuvres qui nous intéressent, il doit exister quelque chose dans les textes comme une structure plus large qui s’érige au fur et à mesure de la lecture. Plus que la simple somme des effets oniriques, il s’agirait alors d’opérations contribuant à une mise en forme particulière de l’espace et visant à déployer des schémas de lecture et d’écritures nouvelles. Car au fond une question demeure : pourquoi doter un univers romanesque ou dramatique d’une structure onirique ? À quoi bon chercher toujours le pas de côté, la déconstruction, le retournement ?
Cet article cherchera donc à reconnaître dans les espaces vianesques ces opérations attribuant aux structures spatiales des oeuvres diverses fonctions oniriques sur lesquelles se fonde la construction du sens. Ces fonctions constituent des choix esthétiques, narratifs, et donnent à voir un parcours alternatif, faisant emprunter au lecteur un trajet vers une destination qui, autrement, lui resterait inaccessible. Ce trajet de lecture ouvrirait la voie aux sens possibles, parce qu’il trace une carte[13] dans la géométrie de l’espace dont la configuration permet d’orienter l’analyse. En effet, observer « de quelle manière les itinéraires des personnages se croisent ou s’éloignent […] [,] incite à élaborer une carte intime, qui se complexifie à mesure de notre avancée dans le texte[14] ». Qu’en est-il donc de ces espaces oniriques parcourus par les personnages de Vian et quelles seraient leurs fonctions dans le processus de lecture des textes, c’est-à-dire dans l’atteinte d’une destination finale ou d’un dégagement de sens ? Plus précisément, le repérage et l’analyse de ces opérations fonctionnelles tenderont à vérifier si l’oeuvre dont l’architecture emprunte à celle du rêve permet d’accéder à une vision de la réalité jusqu’alors inexplorée ou en vient plutôt à matérialiser l’absurdité, la vacuité de tel ou tel aspect du réel. Autrement dit, l’espace onirique entraîne-t-il un détour ou bien révèle-t-il plutôt une aberration ? Nous commencerons par définir ces deux notions employées pour caractériser les fictions implicitement oniriques, c’est-à-dire de celles qui font du rêve non pas la chair, mais le squelette même de l’oeuvre. Pour ce faire, des exemples seront tirés des romans L’Arrache-coeur et L’Herbe rouge ainsi que des pièces Les Bâtisseurs d’empire et L’Équarrissage pour tous. Ensuite, nous proposerons d’opposer ces fonctions oniriques sur un continuum et examinerons comment certaines des oeuvres du corpus se positionnent sur ce dernier. Enfin, à partir des résultats de ces analyses des espaces oniriques vianesques, nous tenterons d’esquisser des conclusions qui puissent être fécondes pour une relecture globale de l’oeuvre.
Des fonctions oniriques
La notion de détour est empruntée à Jean-Pierre Sarrazac qui la définit dans Jeux de rêves et autres détours comme « un art […] qui rapproche tout en éloignant et éloigne tout en rapprochant, qui instaure de la distance au coeur même de la proximité[15] ». Plus précisément, les « formes-détours[16] », dont ce qu’il nomme « le jeu de rêve », sont l’objet d’ « une dramaturgie qui, plutôt que le recul dans le temps et l’espace, […], plutôt également que la promiscuité avec ce qu’on appelle réalité, choisit l’écart, le pas de côté[17] ». Ces dramaturgies autorisent donc une vision oblique, elle-même caractérisée par une distorsion, voire une défiguration de nature à dérouter le lecteur[18], et ce, notamment parce qu’ils produisent les effets de lecture oniriques déjà évoqués, mais non seulement cela, Sarrazac ajoute que « le détour permet le retour[19] ». Il insiste sur le fait que, bien que la forme mise entre autres sur la déformation, la fonction du détour s’illustre toujours dans une courbe qui le ramène à ce qu’il désigne comme un « réalisme heuristique[20] ». Autrement dit, le détour typique du jeu de rêve aurait comme finalité au sein des espaces oniriques
[non] pas d’engendrer un « autre monde » ou ce qu’on appelle un « univers alternatif ». Non, elle consiste à offrir un point de regard sur le monde – point d’éloignement et de tension (comme la flèche sur l’arc bandé) à partir duquel la fiction théâtrale peut viser, atteindre, pénétrer au coeur du réel[21].
La polyvalence étant bien cultivée chez l’inclassable Boris Vian, ce détour se manifeste dans les oeuvres de diverses manières. Parmi celles-ci, deux opérations semblent saillir : le signalement d’abord, puis le déplacement. D’une part, certains trajets empruntés tendent à annoncer l’onirisme, c’est-à-dire à servir de prétexte à l’histoire, le plus souvent pour permettre à une quête de sens d’être enclenchée et poursuivie. Dans Les Bâtisseurs d’empire, le personnage de Zénobie souligne au premier acte l’écart entre le passé et le présent et agit comme révélateur de la suite de la fable. Son discours, fortement appuyé sur des constats spatiaux, constitue l’annonce de la quête autour de laquelle s’orientera la fable : « Pourquoi est-ce qu’on s’en va chaque fois qu’on entend ce bruit[22] ? » La fonction de détour spatial a donc dans ce cas-ci valeur de signalement du rêve, de marqueur d’un questionnement plus large, qui concerne en l’occurrence le thème de la fuite. On remarque la même chose dans L’Arrache-coeur lors des premières promenades au village de Jacquemort qui remplissent aussi un rôle de prétexte à l’exposition de l’intrigue. C’est alors qu’est énoncée pour la première fois l’intention du personnage principal d’accomplir une psychanalyse intégrale : « Je dois vous expliquer pourquoi je suis venu ici, dit Jacquemort. Je cherchais un coin tranquille pour une expérience. Voilà : représentez-vous le petit Jacquemort comme une cavité vide. […] Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. […] Je veux faire une psychanalyse intégrale[23]. » La forme du détour spatial, responsable de cet espace décalé, désordonné, indéterminé, peut donc être comprise comme le signalement d’un premier pas de côté en ce que le personnage affirme prendre un détour en faisant escale dans un espace autre afin de répondre à une quête existentielle. D’autre part, la fonction de détour s’opère fréquemment par déplacement d’après un processus par lequel « [l]e rêve est autrement centré, son contenu […] rangé autour d’éléments autres que les pensées du rêve[24] ». Dans L’Équarrissage pour tous, « [d]es éléments chargés d’un intérêt intense [sont] traités comme s’ils n’avaient qu’une faible valeur, et d’autres, peu importants […], prennent leur place[25] ». La guerre, sujet tragique, et intouchable à l’époque de publication (rappelons que l’écriture de la première version date de 1947), est reléguée au second plan, transformée en jeu :
L’Américain : Regardez. (il lui montre son casque. Derrière, il y a un trou gros comme les deux poings.)
Le Père (admiratif) : Et vous n’êtes pas mort ?
L’Américain : C’est celui d’un camarade. Je lui ai donné le mien à la place. Celui-là est plus léger comme ça. (silence, il s’étire. On entend un coup de sifflet) Allez. On va y retourner. Ils viennent de siffler la mi-temps[26].
Un second exemple de l’opération de déplacement se retrouve dans L’Herbe rouge. Là encore, il y a bel et bien un pas de côté qui fait s’éloigner les représentations du roman des connaissances spatiales référentielles du lecteur, qui signale donc un détour. Or, le retour au sens s’opère par une autre mise à l’écart : celle entre les personnages et le lecteur potentiel. Dans L’Herbe rouge, la description de l’espace et la narration qui s’y rattache sont souvent à même de susciter la résistance de l’analyste tant l’univers romanesque rompt avec l’univers référentiel de tout récepteur potentiel. L’immense machine à voyager dans le passé, le mystérieux quartier des amoureuses, l’appartement de la reniflante ou encore les souterrains en sont des exemples frappants. En revanche, l’attention du lecteur est déplacée pour permettre à d’autres éléments « chargés d’un intérêt intense[27] » de prendre de l’importance, car, contrairement à Jacquemort dans L’Arrache-coeur ou encore aux familles des Bâtisseurs d’empire et de L’Équarrissage, les personnages principaux de L’Herbe rouge ne s’étonnent plus de l’étrangeté spatiale. Ce qui fait parfois sursauter le lecteur est connu et habituel pour les ingénieurs du roman. Le niveau de savoir qu’ont Wolf et Lazuli de la carte du territoire occasionne dans ce cas un déplacement qui résout toute hésitation. En d’autres mots, ce déplacement « ser[t] à échapper à la censure due à la résistance[28] » du récepteur vis-à-vis d’un univers qui contrevient aux normes communes, attendues. Les deux personnages ne sont, par exemple, en aucun cas surpris par l’espace qui les entoure, ils aident des marins qui errent dans le secteur depuis deux ans à s’orienter et ils connaissent la manière d’emprunter les raccourcis souterrains :
– Si on passait par les cavernes ? / – Oui, dit Lazuli. Ici, il y a trop de monde. […] Ils descendirent l’escalier de la cave vert de mousse, et parvinrent au couloir général qui desservait la rangée. De là sans effort on accédait aux cavernes. Il suffisait d’assommer le gardien, ce qui fut chose aisée, car il ne lui restait qu’une dent[29].
Ce déplacement de l’attention du lecteur figure l’espace comme onirique et opère progressivement un retour vers le sens. En fait, cette aisance des deux ingénieurs prépare le lecteur à ce retour, à la manière d’une suspension de l’incrédulité[30].
La notion d’aberration est quant à elle empruntée à Jacques Goimard qui l’emploie à décrire « les paradoxes fantastiques de l’espace et du temps[31] ». Les espaces qui manifestent une aberration sont plus précisément « des espaces où l’on se perd, où les paradoxes étouffent le sens, où la vitalité s’épuise dans d’incessants passages à la limite[32] ». Dès lors, la notion évoque-t-elle, elle aussi, des représentations de l’ailleurs, des formes labyrinthiques, une surabondance des détails hétérogènes, des perturbations spatiales inconséquentes, une mise en évidence du hasard, de l’errance, etc. Or, plutôt qu’un détour permettant éventuellement de rejoindre le réel, l’aberration s’illustre dans un mouvement d’écart persistant. Elle se matérialise et s’accomplit dans l’égarement, autant celui des personnages que celui du lecteur :
Les aberrations de l’espace ont plus d’une ressemblance avec les aberrations du temps. Elles parcourent la même trajectoire : au départ, on se libère d’une contrainte qui s’impose à nous dans notre vie quotidienne ; à l’arrivée, on s’égare dans un labyrinthe, on se prend au piège d’une malédiction plus radicale encore que celle à laquelle on avait cru échapper[33].
Au moins deux opérations permettent là encore d’observer les manifestations textuelles de cette fonction : la clôture et la déconstruction. D’une part, la fermeture de l’espace entraîne le dénouement symbolique des quêtes. Le rapetissement de l’appartement coïncide avec l’absence de réponses aux questions du père dans les Bâtisseurs, absence qui le mènera à sa chute finale :
Il y a là une fenêtre largement suffisante pour livrer passage à un homme de corpulence parfaitement normale, (Il va à la fenêtre) et lui permettre de (Il regarde en bas, se retourne, revient) se casser la gueule sur le pavé en tombant d’une hauteur de vingt-neuf mètres et des fractions[34].
Dans L’Arrache-coeur, la clôture progressive du pays autour de Jacquemort le confinera finalement à la barque de la Gloïre, le laissant, de plus, aussi vide qu’au commencement : « La Gloïre est mort hier, et je vais prendre sa place. Vide au départ, j’avais un handicap trop lourd. […] [P]ourquoi donc suis-je resté dans la maison de la falaise[35]. » Le besoin de liberté des trumeaux est pour sa part réprimé par le vide ambiant et les barreaux de leur cage dorée :
André s’élança à toutes jambes. Malgré son désir de voir le grand jardin, il ne put empêcher ses pieds de l’entraîner en ligne directe vers la maison. Il eut au passage la vision du vaste espace vide, inquiétant sans le soleil ; et il arrivait au perron. […] Se retournant il aperçut trois cages. […] Elles étaient juste assez hautes pour un homme pas très grand[36].
D’autre part, la déconstruction rend aberrante la structure spatiale des oeuvres en imposant l’autorité du territoire sur la carte. La violence de la guerre, jusqu’alors cantonnée à l’espace off, s’infiltre dans l’espace mimétique à la fin de L’Équarrissage par la représentation d’une bagarre à laquelle presque tous les personnages participent, faisant du décor un champ de ruines[37] :
Pendant toute la bagarre, les combattants échangent de temps en temps de brèves injures : Salaud ! Cannibale ! Fille de pute ! etc. […] Les combattant accrochent l’établi qui s’effondre. […] À ce moment, les combattants roulent sur eux-mêmes et la table s’effondre sur eux dans un vacarme indescriptible. […] Il [le capitaine] inspecte le désordre effarant[38].
L’explosion finale finira d’ailleurs de déconstruire l’espace scénique. Il semble donc que malgré la passivité des uns et l’engagement des autres, rien ne peut empêcher l’anéantissement complet qui menace la famille dès les premières lignes de la pièce. La déconstruction se fait aussi sentir dans la fin de L’Herbe rouge. Le constat d’échec de Wolf lui donne, de même qu’à l’espace, des tendances destructrices. Wolf tue l’une des projections de la machine sous prétexte que « rien n’est plus achevé qu’un cadavre[39] ». Il cherche à atteindre la même complétude en se jetant du haut d’une paroi vertigineuse. L’espace participe également de cette déconstruction, car c’est le vent qui agit lors de la mort de Wolf : « Le vent l’arracha de la cage et son corps tourbillonna dans l’air[40]. » C’est encore la nature qui fait « la grande machine d’acier se décompos[er] doucement au gré des orages du ciel[41] ». Ce qui prenait l’apparence d’une quête s’engouffre donc, dans chacun de ces quatre grands textes, tantôt dans un puits, tantôt dans un cul-de-sac.
Des espaces en mouvement
À ce point-ci de l’analyse, on en vient à considérer ces deux fonctions de détour et d’aberration, et les opérations qui les accompagnent, comme les pôles opposés d’un continuum, d’une droite typologique qui représente au fond notre question initiale et sur laquelle l’espace des oeuvres peut être situé.
Ce pari théorique se justifie, car il permet de penser notre classification davantage comme un système de tensions entre pôles qu’à travers des catégories fixes, allouant plus de flexibilité, mais aussi plus de finesse à l’analyse. Par conséquent, le recours au continuum, défini comme un « objet ou phénomène progressif dont on ne peut considérer une partie que par abstraction[42] », s’explique ici par sa représentation graduée et sa conciliation de l’homogène et de l’hétérogène qui apparaissent plus à même d’admettre de telles nuances. De surcroît, s’il y a bel et bien structure qui serait construite par le trajet de la lecture, il doit y avoir mouvement. Le trajet implique toujours une circulation ou une migration. Encore là, le continuum s’impose, autorisant, par définition, la fluidité des formes, car il regroupe des éléments de manière à transiter de l’un à l’autre de façon continue. Ainsi, plutôt que de chercher à fixer les divers espaces sur une échelle graduée, il est plus intéressant encore de remarquer que les espaces oniriques chez Vian ne sont pas que variés, mais bien variables ; leurs fonctions le sont aussi, suivant les contours des cartes tracées à même la chronologie des oeuvres. Prenons, par exemple, L’Arrache-coeur et Les Bâtisseurs d’empire. Toutes deux oeuvres tripartites, elles semblent dessiner des itinéraires absolument distincts.
Au début de ces deux fictions, les espaces matérialisent davantage leur appartenance à la fonction de détour. L’impression d’une défiguration du réel est présente : « Il ressentait une sorte d’inquiétude, l’impression de parler à quelqu’un d’une autre planète[43]. » L’étrange et le familier cohabitent et le brouillage des frontières entre le rêve et le réel est constant :
Zénobie. – Mais comment peux-tu être d’aussi mauvaise foi ? En bas, j’avais ma chambre… […]
Père, à la mère. – Elle avait sa chambre ?
Mère. – Je ne me rappelle pas très bien. (À Zénobie :) Tu avais ta chambre ?
Zénobie. – Oui, j’avais ma chambre ; à côté de la vôtre, en face du petit salon.
Mère. – Comment, du petit salon ?
Zénobie. – Le petit salon, avec les fauteuils rouge foncé et la glace de Venise, et les jolis rideaux en soie rouge. Le tapis rouge et le lustre doré.
Mère. – Zénobie, tu es sûre de ce que tu dis[44] ?
Ces indices prennent tous valeur de signalement d’un détour destiné, rappelons-le, à souligner la présence d’un sens caché par l’espace décalé du rêve que les personnages s’engagent à découvrir. L’incipit de L’Arrache-coeur, par les inventions lexicales et son décalage vis-à-vis du réalisme annoncé par la première phrase, signale d’emblée la prise de ce détour : « Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleur et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. Des insectes pointus avaient creusé le sol de mille petits trous ; sous les pieds, c’était comme de l’éponge morte de froid[45]. » Dans Les Bâtisseurs d’empire, c’est plutôt la nostalgie, opposée à l’incertitude vis-à-vis de l’avenir, qui révèle l’entre-deux dans lequel sont intriqués les personnages, intervalle avec lequel le lecteur, dès la didascalie d’ouverture[46], sait qu’il devra composer. Zénobie le confirme : « Ça va être comme avant, juste un peu moins bien. […O]n entendra le bruit, on montera l’escalier, on oubliera quelque chose… et on aura plus qu’une seule pièce… avec déjà quelqu’un. … Mais moi, là-dedans, qu’est-ce que je deviens[47] ? »
L’affaire est différente ensuite. Dans la deuxième partie de L’Arrache-coeur, les espaces décrits adhèrent tantôt à la forme détour, tantôt à la fonction d’aberration. C’est dans cette partie que l’on retrouve par exemple l’épisode de la crucifixion de l’étalon, vision aberrante, perturbation spatiale, qui pousse Jacquemort à fuir, lui à qui le narrateur conférait désormais plus d’aisance dans ses pérégrinations : « Il pressa le pas et le pouls. Des paysans, devant une haute porte de chêne fruste, crucifiaient un étalon. […] Jacquemort se détourna et s’enfuit. Les poings serrés sur les oreilles, il courait, maladroit d’avoir les avant-bras collés au cou, criant lui-même pour ne pas percevoir les clameurs désespérées du cheval[48]. » Puis, après avoir retrouvé son calme et reprenant peu à peu son errance, il relance sa quête d’une psychanalyse totale en opérant un déplacement des villageois vers un chat noir, ce qui lui permet de réinscrire sa recherche de sens dans le détour :
– Toujours personne à psychanalyser ?
– Personne…
– Essayez avec les animaux. Ça se fait maintenant. […]
Depuis une semaine qu’il avait absorbé l’intégralité de la substance mentale du chat noir, il passait de surprise en surprise et apprenait à grand-peine à se débrouiller dans ce monde complexe et violemment affectif[49].
Finalement, l’espace se clôt et l’errance du psychiatre est vouée aux sempiternelles répétitions qui matérialisent un univers où l’ennui est roi, où le sens est déconstruit : « Tant avait de fois Jacquemort pris le chemin du village qu’il lui était devenu aussi plat qu’un couloir[50]. » Le détour s’essouffle donc dans le labyrinthe que dessine l’étrange pays où s’empêtre le personnage. On observe alors le début d’un mouvement de va-et-vient de l’attention du lecteur entre les pôles fonctionnels du continuum, penchant parfois vers l’espoir d’un détour qui le ramènera avec Jacquemort vers une vérité et parfois vers l’absurdité grandissante d’un espace aberrant[51]. Au contraire, l’espace de l’acte II des Bâtisseurs d’empire s’inscrit pour sa part toujours dans la fonction de détour. Par exemple, Zénobie continue de mettre en tension le passé perdu au présent menaçant, signalant une fois de plus l’écart les séparant :
Zénobie. – Mais si on restait ? Si on était restés ?
Cruche. – Personne ne reste.
Zénobie. – Et maintenant, en dessous, qu’est-ce qu’il y a ? On n’entend rien… On n’entend jamais rien… Si on écoutait ce qu’il y a ? Si on redescendait[52] ?
Or, on note également une clôture et une déconstruction graduelle de l’espace, propices à faire tendre la fable vers le pôle opposé de l’aberration. L’acte se termine sur une perturbation grave de l’espace qui exclut définitivement le personnage de Zénobie de l’espace scénique :
Zénobie hausse les épaules. Elle retraverse le palier, cogne à la porte du voisin. Le Bruit commence à retentir très loin. Elle hésite, va lâcher le bouton de la porte du voisin. Doucement, puis très vite, la porte palière du père se referme et claque. On a entrevu Zénobie qui s’élançait pour revenir, mais trop tard[53].
Ainsi, le second acte des Bâtisseurs d’empire, malgré une coprésence des indices, opère plutôt un mouvement constant et progressif à partir de la fonction de détour vers le pôle de l’aberration.
Ces deux tendances, l’oscillation et la progression, se reproduisent à l’aube de la finale des oeuvres. D’un côté, la dernière partie de L’Arrache-coeur est incontestablement la plus ambivalente de toutes. Les indices de l’aberration sont de plus en plus nombreux et marqués. L’espace est tortueux : « Il tombait une pluie fine et pernicieuse, et on toussait. Le jardin coulait, gluant[54] » ; répétitif : « Il marchait, il marchait toujours[55] » ; ennuyeux : « Ah ! qu’elle est longue, cette route[56] ! » ; et il enferme : « Ce pays m’a eu. Quand je suis arrivé, j’étais un jeune psychiatre plein d’allant, et maintenant je suis un jeune psychiatre sans allant du tout. […] Et c’est à ce village pourri que je dois ça[57]. » Tel un labyrinthe, la campagne de L’Arrache-coeur continue de perdre en perturbations, en paradoxes et en absurdités le personnage pourtant en quête de sens. Or, l’assimilation de Jacquemort, comme la carte qu’il trace de l’univers du pays, sont parallèlement de plus en plus achevées, ce qui produit un brouillage des frontières fondé sur la relativisation de l’étrange. Plus le temps passe et plus Jacquemort est à son aise dans l’espace. Plus le temps passe également et plus les limites de ce qui est jugé comme acceptable sont repoussées : « Jacquemort connaissait maintenant tous les coins, détours et raccourcis[58]. » Ou encore : « Maintenant, je me moque apparemment de la foire aux vieux, je cogne à regret sur les apprentis et j’ai maltraité La Gloïre parce qu’autrement ça me faisait du tort[59]. » Ce faisant, les allers-retours sur le continuum entre détour et aberration se font plus insistants, mais ils sont également progressivement plus rapides, créant une structure globale particulièrement inconstante. De l’autre côté, la pièce poursuit sa progression vers le pôle de l’aberration. Les marques du détour sont de moins en moins présentes, et à l’inverse, la clôture est presque totale :
Une pièce plus petite que les précédentes. Mansardée. Une fenêtre praticable, d’un bleu lumineux, on la sentira très haute. Une porte bloquée, une arrivée d’escalier par où va émerger le père. Il fait sombre. Aucun confort. Un grabat. Une table. Une glace ébréchée. Un schmürz, pas éclairé au lever du rideau. Pas d’escalier qui monte au-dessus. D’ailleurs, pas de dessus[60].
Les paradoxes sont omniprésents : « (Il [le père] lève le revolver, tire sur le schmürz qui ne bronche pas. – Un temps. – Il reprend d’une voix un peu tremblante :) Autant qu’il m’en souvienne, ce revolver était chargé à blanc […] (Il tire dans la fenêtre, une vitre se brise avec fracas.) Chargé à blanc…[61] » La violence et le fantastique l’emportent sur tout réalisme : « Il s’approche du schmürz dans le silence, lentement, puis soudain il se jette sur lui, le terrasse et commence à l’étrangler, longtemps. […] Il se redresse, le schmürz gît, inerte, mais dans quelques minutes, il va se remettre à grouiller et se redresser[62]. » Aussi, le père, dorénavant seul avec le schmürz, éprouve des difficultés à rationaliser et à relativiser l’étrangeté manifeste de son univers. Le rôle de mise en tension entre le réel et le rêve, joué par Zénobie dans les deux premiers actes, qui permettait de déployer la fonction de détour en signalant l’écart onirique, peine désormais à s’actualiser pleinement. Le père oublie le passé, aussi proche soit-il : « J’avais donc une famille. (Il réfléchit.) …Par moment, c’est à croire que je me suis approprié les souvenirs de quelqu’un d’autre[63]. » Il s’applique à réfléchir, mais n’arrive qu’à verbaliser une logique insoutenable : « Le monde n’a pas de raison de s’étendre très au-delà des murs qui m’entourent ; ce qui est sûr, c’est que j’en suis le centre[64]. » Il n’a pour discours que des questions sans réponse : « Ce signal, qui le fait retentir ? […] Je monte un étage. Bon. Pourquoi ? Parce que j’entends le signal. […] Qui cela peut-il donc gêner que je reste ? (Il va cogner le schmürz.) Je me le demande et me le demanderai toujours[65]. » Les marques de la fonction d’aberration prennent donc définitivement le pas. Le père est perdu, seul, dans un espace perturbé, déconstruit et clos qui ne lui laisse aucune autre solution que la fuite définitive dans la mort.
Conséquemment, l’analyse chronologique des Bâtisseurs et de L’Arrache-coeur permet de distinguer deux structures spatiales, deux trajets sur le continuum des fonctions oniriques. Tandis que la pièce semble progresser à partir du pôle du détour vers une aberration de plus en plus grande, le roman dessine pour sa part une sorte de zigzag fonctionnel, oscillant sans relâche entre les deux pôles. La quête installée par Zénobie afin de comprendre la fuite effrénée des siens s’essouffle en effet à mesure que s’effrite l’espace scénique devant les yeux impuissants du père et du lecteur. À l’inverse, l’entendement semble toujours être à la portée de Jacquemort, apparaissant ici et là au rythme où s’ancrent les habitudes, mais lui échappant également chaque fois que le familier apparaît total, l’empêchant toujours d’assouvir son désir, de mettre un terme à sa recherche. L’hétérogénétié est donc répétée, continue, ce qui trace une voie interprétative sous le signe d’une ambivalence persistante et d’une indétermination irrésoluble.
(In)signifier
Que cela nous dit-il alors sur l’oeuvre de Vian ? Il semble qu’il faille considérer l’oeuvre vianesque comme un système fait d’innombrables influences réciproques qui forcent le constat d’une Oeuvre en tension, c’est-à-dire faite de lignes de forces opposées. En plus des constats de la variété et de la variabilité des fonctions oniriques au sein des espaces, on en vient à une autre découverte importante : celle d’un possible continuum entre un onirisme voilé (pôle typique des espaces dont les mécanismes dissimulent l’onirisme, camouflent le sens) et un onirisme dévoilé (pôle typique des espaces dont le fonctionnement révèle les sens possibles, lève le voile sur l’onirisme). L’Arrache-coeur, par son oscillation et son instabilité persistante, voile, dissimule les contours de l’espace onirique en ne l’effaçant pas complètement, mais en rendant ses limites diaphanes, vaporeuses, ce qui concourt à préserver l’hermétisme d’une lecture qui déroute. Au contraire, Les Bâtisseurs d’empire, par sa progression constante qui signale fortement l’écart avant de représenter l’aberration, tend à dévoiler (littéralement à lever le voile sur) l’onirisme de l’univers, donnant ainsi les clés de sa résolution. Si nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses fort préliminaires quant aux causes de ces deux traversées opposées, celles-ci méritent néanmoins d’être formulées. D’une part, il est possible qu’il existe une distinction d’ordre générique entre les espaces romanesques et dramatiques : les premiers semblent destinés à voiler, les deuxièmes à dévoiler l’onirisme. D’autre part, nous pourrions émettre la remarque selon laquelle cette différence entre les structures spatiales des oeuvres est en partie liée à la variété des espaces pouvant se déployer dans le roman, variété qui s’oppose à l’uniformité de ceux qu’offrent les pièces. En effet, les lieux comprennent, dans L’Arrache-coeur, la falaise, sentier escarpé et aride surplombant la mer ; la maison, tout près, où Jacquemort arrive par hasard pour accoucher Clémentine et où il restera le temps de son interminable séjour dans le pays ; le jardin merveilleux, à la flore extraordinaire, qui entoure la maison ; le chemin qui mène au village, poussiéreux, longé par l’étrange ruisseau rouge et dont la longueur paraît varier au rythme de l’ennui du personnage principal ; et le village, dont l’étrangeté et l’inquiétante cruauté surprennent à chaque visite. Inversement, les lieux dans LesBâtisseurs d’empire se limitent aux pièces communes des trois appartements représentés. La variété spatiale du roman, en élargissant les possibilités de représentation, rend l’horizon d’attente plus souple, plus permissif. A priori donc, tout peut arriver à condition d’être dans le bon cadre et à condition que ce cadre ait été préalablement défini comme ayant les propriétés physiques d’accueillir l’événement en question. Dès lors, le lecteur ne peut s’appuyer sur ses impressions qui sont constamment retournées et contredites. Le voile sur l’espace onirique s’en voit opacifié. Inversement, au sein de l’espace restreint d’un appartement « sans particularité[66] », tout événement s’inscrivant en dehors des possibles offerts par cet espace est nécessairement inconséquent et soulève un doute plus grand. C’est ce doute plus marqué qui serait à même de dévoiler davantage la structure onirique de l’oeuvre. Cette piste tend également à être confirmée par les deux autres oeuvres qui nous intéressent ici. L’espace de la pièce L’Équarrissage pour tous qui comporte deux décors – la salle commune et atelier de l’équarrisseur de même qu’un champ de ruines représenté en toile de fond – est, comme dans le cas des Bâtisseurs, fortement inconséquent, c’est-à-dire particulièrement propice à l’installation d’un doute persistant et révélateur. L’inverse est aussi vrai de L’Herbe rouge, dont les différentes zones comprennent la maison de Lil et de Wolf, l’appartement de Lazuli et de Folavril, le carré, le quartier des amoureuses et nombre de lieux situés de « l’autre côté[67] » et où les exemples que l’on peut recenser mènent, comme dans L’Arrache-coeur, à une plus forte concentration d’indétermination, admettant dès lors plus de souplesse, mais voilant par là même la structure onirique sous-jacente.
Du reste, si lire Vian c’est souvent se perdre, une question (une inquiétude) émerge. Que peut donc la littérature pour Vian ? Et par conséquent, que peut la littérature de Vian ? Si l’on peut risquer une réponse, ou à tout le moins une piste, peut-être celle-ci résiderait-elle dans l’attrait du nonsense[68] et de l’insignifiance[69]. Ces attirances qui, pour peu qu’elles soient inatteignables dès lors que traversées par l’écriture, sont apaisantes, voire salvatrices, pour qui est tenaillé par l’incertitude métaphysique d’être au monde et d’en parler. De fait, s’il est une tension qui puisse recouper toutes les autres dans cette oeuvre prolifique, c’est peut-être justement celle-là : celle de chercher à dire, à signifier, l’absurdité du monde naturel aussi bien que social. Cette opposition contient, tant par sa paradoxalité que par sa fécondité, ce qui apparaît comme deux invariants divergents, deux savoirs, deux certitudes contradictoires pour la satrape : une vision de l’humain comme un être sans limites et celle d’un monde autonome, intouchable et indicible. D’un côté, la littérature peut permettre de créer l’inédit, de tout savoir[70] même ce qui n’existe pas, d’étudier l’exceptionnel, de chercher du sens dans les babioles d’un « tiroir étiqueté “choses inclassables ailleurs”[71] », de « s’applique[r] volontiers à penser aux choses auxquelles […] les autres ne penseront pas[72] », de « fabriquer d’autres logiques auxquelles [un robot-poète] ne pigera rien[73] ». Tel serait le propre du génie humain pour Vian, être capable de tout, à condition bien sûr que ce tout dépasse les limites acceptées et habituelles du monde tel qu’on le conçoit[74]. D’un autre côté, la littérature est l’échec constant de ce désir de tout saisir : « Le cerveau humain est trop sensé pour perdre son temps à créer ce qui n’est pas biologiquement utile[75]. » Cette recherche de sens inutile (exceptionnel ?) ne s’accomplit donc pas sans douleur : « L’esprit humain a cela du scorpion qu’il peut s’enfoncer le scalpel de sa queue courbe, et si le venin se met dans la plaie, c’est bien cela qu’on appelle penser, non ? Si[76]. » Chaque oeuvre ravive donc l’angoisse métaphysique d’être tout petit face à un univers plus grand que soi, certes, mais également tout à fait autonome ; chaque quête échouée reconduit de même l’angoisse de ne posséder qu’un langage fini, arbitraire et insuffisant pour dire un monde souvent insensé et en constante métamorphose. Par conséquent, la littérature est une quête et une fuite tout à la fois. Les pôles du détour et de l’aberration l’illustrent bien, de même que ceux de l’onirisme voilé et dévoilé. Sous-entendue dans l’un et l’autre de ces gestes se révèle l’idée incontournable d’une destination. Plus précisément encore, c’est l’idée d’une destination autre que celle où l’on se trouve déjà que recèlent ces pôles. Vian et ses personnages cherchent sans cesse et partout le sens nouveau, le sens autre. Leur quête paraît cependant vouée à l’échec. Tous sont aux prises, finalement, avec les contraintes d’une conscience limitée qui se heurte à un univers toujours chargé de zones d’ombre, de mystères. Dès lors, la quête est elle-même une fuite, même non avouée, comme chez les auteurs dont le nonsense est le credo : « À s’évader dans un new-found-land de langage et de logique, Lear […] pouvait au moins faire semblant de maîtriser la réalité au lieu de ne faire que la fuir […] ou de la reproduire (dans les arts ou même les mathématiques)[77]. » Qui plus est, ces deux mouvements d’apparence contraire, la quête et la fuite, ont pour objet l’infinie réalité des choses. On retrouve d’ailleurs cet écartèlement à maintes reprises chez les personnages de nombreux textes dont la recherche d’absolu[78] et de perfection[79] mène la plupart du temps à l’échec et à un saut vers le vide, vers une fata-finalité complète, totale. Les suicides sont nombreux dans les fictions vianesques : les souris grises et Colin, désespérés, attendent la mort dans L’Écume des jours[80]. Lazuli dans L’Herbe rouge se poignarde dans la chambre de son amante, Folavril[81]. Le sénateur Dupont meurt à petit feu de l’hébétude d’avoir satisfait son plus grand désir[82]. Sans hasard, la mort est aussi souvent provoquée par une chute. La mort du père des Bâtisseurs, de même que celle de Wolf à la fin de L’Herbe rouge, tout comme les multiples disparitions des personnages dans la fosse de L’Équarrissage, en témoignent[83]. Le constat à tirer de ces itinéraires est donc celui que le monde (semblablement au rêve par ailleurs) préexiste à la signification qu’on lui donne, au sens que l’on y cherche : « J’ai laissé pousser ma barbe pour voir pourquoi on se laissait pousser la barbe. Et je n’ai rien trouvé qu’une barbe. La barbe est la raison de la barbe[84]. » Après tout, ne réside-t-il pas dans le geste d’écrire ce que l’on ne connaît pas encore une invitation à lire les choses du monde telles qu’elles ne le sont déjà, et ce, en dehors de tout espace-temps donné ? Au fond, à chercher un sens à tout, on ne trouve parfois que la chose elle-même pour toute réponse : « Quand vous me dites que j’invente des mots, vous noterez que ce sont toujours des mots que personne ne connaîtrait non plus si je mettais les vrais mots, car au fond personne ne sait le nom des fleurs qu’il y a dans le jardin le plus simple[85]. »
Parties annexes
Note biographique
Diplômée de la maîtrise en lettres de l’Université du Québec à Trois-Rivières (2020), Lydia Couette a interrogé, dans le cadre de son mémoire, les espaces oniriques dans l’oeuvre dramaturgique et romanesque de Boris Vian sous la direction du professeur et critique Hervé Guay, avec qui elle a aussi travaillé à observer les pratiques du théâtre documentaire contemporain au Québec. Sur ce chapitre, elle a contribué au collectif récemment paru chez Nota Bene : L’Interprétation du réel. Théâtres documentaires au Québec (2020) de même qu’au Colloque de L’ACFAS Les Mobilités du processus de création - Approche interdisciplinaire (2018). Elle s’implique aussi en culture, notamment en étant membre du Laboratoire de recherche sur les publics de la culture (LRPC) ainsi qu’en coordonnant des prix littéraires régionaux. Depuis 2021, elle enseigne également la littérature au collégial.
Notes
-
[1]
Jean Starobinski, « La vision de la dormeuse » (1972), cité par Frédéric Canovas, L’Écriture rêvée, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 30-31.
-
[2]
Cette parenté de l’oeuvre vianesque avec le concept freudien a été explorée par Marc Lapprand dans le chapitre « Unheimlich » de son ouvrage V comme Vian (Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, p. 193-201).
-
[3]
Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté », Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1933 [1919], p. 191.
-
[4]
Louis Aragon, Les Beaux Quartiers (1936), cité par Jacques Goimard, Univers sans limite. Critique du fantastique et de l’insolite, Paris, Pocket, 2003, t. 2, p. 190-191.
-
[5]
Ailleurs que dans V comme Vian, les notions de rêve, de cauchemar et d’écart avec le réel reviennent régulièrement lorsque l’on parcourt les études sur l’oeuvre de Vian, notamment chez Jean Clouzet, Boris Vian, Paris, Seghers, 1971 [1966] ; Émilien Carassus, « L’Arrache-coeur », dans Noël Arnaud et Henri Baudin (dir.), Boris Vian. Colloque de Cerisy, Paris, UGE, 1977, vol. 1, p. 407-425 ; Gilbert Pestureau, Boris Vian, les amerlauds et les godons, Paris, UGE, 1978 et chez les contributeurs du numéro d’Europe dédié à Vian (Audrey Camus [dir.], dossier « Boris Vians », Europe, n° 967-968 [2009]) dont Jacques Poirier, « La fantaisie et son double », p. 72-81, Audrey Camus, « L’enfance de l’écriture », p. 87-99 et Jean-Pierre Vidal, « La partition romanesque », p. 100-109.
-
[6]
Wolfgang Iser, L’Acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1985, p. 49.
-
[7]
Jean-Pierre Sarrazac, Jeux de rêves et autres détours, Belval, Circé, 2004, p. 65.
-
[8]
Audrey Camus, « Les contrées étranges de l’insignifiant. Retour sur la notion de fantastique moderne », Études françaises, vol. 45, n° 1 (2009), p. 95.
-
[9]
Jacques Goimard, op. cit., p. 511.
-
[10]
Par exemple, Jacques Goimard parle parfois d’indécidabilité, Tzvetan Todorov évoque la notion d’hésitation, Jean-Pierre Sarrazac, celle de déconstruction dramatique, etc.
-
[11]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962 [1953], p. 25.
-
[12]
Boris Vian, L’Herbe rouge, suivi de Les Lurettes fourrées, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962 [1950], p. 69.
-
[13]
La métaphore de la carte textuelle est invoquée par de nombreux chercheurs qui ont remarqué que l’écriture de même que la lecture peuvent être considérées comme des « activités cartographiques » (Robert T. Tally, Spatiality, London, Routledge, 2013, p. 45 ; nous traduisons) ou comme les déclencheurs d’une opération « au cours de laquelle se révèle la carte implicite du roman, ou du moins celle que la lecture a permis de construire » (Audrey Camus et Rachel Bouvet (dir.), Topographies romanesques, Rennes / Québec, Presses universitaires de Rennes / Presses de l’Université du Québec, 2011, p. 88).
-
[14]
Id.
-
[15]
Jean-Pierre Sarrazac, op. cit., p. 18.
-
[16]
Id.
-
[17]
Ibid., p. 14.
-
[18]
Ibid., p. 57-69.
-
[19]
Id.
-
[20]
Ibid., p. 19.
-
[21]
Ibid, p. 59.
-
[22]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz, Paris, L’Arche, 1959, p. 13.
-
[23]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 26-27.
-
[24]
Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, Paris, Presses universitaires de France, 1967 [1900], p. 263.
-
[25]
Ibid., p. 264.
-
[26]
Boris Vian, L’Équarrissage pour tous, Théâtre 1, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965 [1950], p. 66-67.
-
[27]
Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, op. cit., p. 264.
-
[28]
Ibid., p. 277.
-
[29]
Boris Vian, L’Herbe rouge, op. cit., p. 104-105.
-
[30]
Voir Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, Edimbourg, Edinburgh University Press, 2014 [1817].
-
[31]
Jacques Goimard, op. cit., p. 206.
-
[32]
Ibid., p. 230.
-
[33]
Ibid., p. 227.
-
[34]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, op. cit., p. 69-70.
-
[35]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 245.
-
[36]
Ibid., p. 254-255.
-
[37]
Boris Vian, L’Équarrissage pour tous, op. cit., p. 183.
-
[38]
Ibid., p. 173-181.
-
[39]
Boris Vian, L’Herbe rouge, op. cit., p. 189.
-
[40]
Ibid., p. 191.
-
[41]
Ibid., p. 194.
-
[42]
Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), Le Nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 2009, p. 524.
-
[43]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 54.
-
[44]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, op. cit., p. 10-11.
-
[45]
Ibid., p. 9.
-
[46]
« La scène se passe dans une pièce sans particularités, bourgeoisement meublée, avec un buffet Henri II au fond, une table de salle à manger et des chaises, le tout dans un coin, des fenêtres fermées, des portes qui mènent partout où il faut et dans le coin où il n’y a pas de table, l’arrivée d’un escalier censé partir d’une pièce supposée au-dessous, et qui enchaîne sur un escalier censé mener à une pièce qui serait au-dessus » (ibid., p. 5).
-
[47]
Ibid., p. 21.
-
[48]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 93-96.
-
[49]
Ibid., p. 103-107.
-
[50]
Ibid., p. 128.
-
[51]
D’ailleurs, c’est à la fin de cette deuxième partie qu’apparaissent maintes originalités : une couturière aux « faux yeux peints sur ses paupières fermées » (ibid., p. 131), le « merveilleux androïde de bronze et d’acier » (ibid., p. 139) répliquant les traits de Clémentine, le départ d’Angel à bord de son bateau mille-pattes (ibid., p. 124) et l’incendie de la rampe de lancement que Jacquemort contemple, interdit : « Le hangar craquait et ronflait. Des morceaux de bois carbonisé s’abattaient du toit. Devant la porte, Jacquemort, immobile, contemplait le brasier. Clémentine lui posa la main sur l’épaule. Il sursauta, mais il ne dit rien » (ibid., p. 147).
-
[52]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, op. cit., p. 41.
-
[53]
Ibid., p. 66.
-
[54]
Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 151.
-
[55]
Ibid., p. 156.
-
[56]
Ibid., p. 219.
-
[57]
Ibid., p. 156.
-
[58]
Ibid., p. 170.
-
[59]
Ibid., p. 156.
-
[60]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, op. cit., p. 67.
-
[61]
Ibid., p. 78-79.
-
[62]
Ibid., p. 73-74.
-
[63]
Ibid., p. 72.
-
[64]
Ibid., p. 76.
-
[65]
Ibid., p. 72-73.
-
[66]
Ibid., p. 5.
-
[67]
Boris Vian, L’Herbe rouge, op. cit., p. 69.
-
[68]
Les écrivains britanniques Edward Lear et Lewis Carroll sont reconnus comme deux des plus illustres représentants des écritures nonsensiques. L’influence de Carroll sur Vian est indéniable et fut d’ailleurs longuement discutée par Pestureau dans son ouvrage Boris Vian, les amerlauds et les godons (op. cit., p. 146, 198, 209). Le nonsense est défini, entre autres sous la plume de Wim Tigges, spécialiste de Lear et de Carroll, comme « un genre de la littérature narrative qui met en équilibre une multiplicité de significations avec une absence de sens simultanée » ; nous traduisons. « I would define nonsense, then, as a genre of narrative literature which balances a multiplicity of meaning with simultaneous absence of meaning » (Wim Tigges [dir.], « An Anatomy of Nonsense », Explorations in the Field of Nonsense, Amsterdam, Rodopi, 1987, p. 27). Chez Carroll comme dans les oeuvres vianesques, « [e]n créant et en maintenant une tension entre deux extrêmes (tels qu’illusion et réalité, ordre et désordre, forme et contenu, etc.), le nonsense peut explorer librement une large palette d’émotions, d’idées et d’attitudes » ; nous traduisons. « By creating and maintaining a tension between two extremes (as of illusion and reality, order and disorder, form and content and so on) nonsense can freely explore a wide range of emotions, ideas, and attitudes » (Wim Tigges, loc. cit., p. 26).
-
[69]
La notion est définie notamment par Jacques Poirier à propos des personnages de Fin de Partie : « [N]ous sommes tous partagés entre prétention à faire sens et acceptation de notre insignifiance. […] Si des personnages — donc une oeuvre — peuvent “exister” sans “signifier quelque chose”, alors le réel dans sa globalité se trouve affecté d’un soupçon. En pareille perspective, l’insignifiant ne se limiterait pas à quelque second rôle […], auquel s’opposerait, par contraste, un premier plan riche en signification. Bien au contraire, la présence, au sein du réel, d’une part d’“insignifiant” constitue toujours une menace » (« Malaise dans la signification », Études françaises, vol. 45, n° 1 [2009], p. 109-124).
-
[70]
« Le monde est aux mains d’une théorie de crapules qui veulent faire de nous des travailleurs, et des travailleurs spécialisés, encore : refusons […]. Sachons tout. Sachez ce qu’il y a dans le ventre de ce robot. Soyez un spécialiste de tout. L’avenir est à Pic de la Mirandole. Mirandolez, éclaboussez ce robot-poète de vos connaissances en cybernétique, expliquez-lui comment il marche et vous l’aurez tout humble à votre merci » (Boris Vian, « Un robot-poète ne nous fait pas peur », Je voudrais pas crever, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 99).
-
[71]
Boris Vian, Boris Vian en verve : mots, propos, aphorismes, édition, présentation et choix par Noël Arnaud (éd.), Paris, Horay (En verve), 2016 [1970], p. 26.
-
[72]
Gaston Arman de Caillavet, Robert de Flers et Étienne Rey, La Belle Aventure, Paris, Albin Michel, 1913, cité par Boris Vian, « Dix grandes revues littéraires », entretien avec Marc Bernard, France 3, 25 mai 1959, cité par Noël Arnaud, Les Vies parallèles de Boris Vian, Paris, UGE (10/18), 1970 [1966], p. 371.
-
[73]
Boris Vian, « Un robot-poète ne nous fait pas peur », loc. cit., p. 97.
-
[74]
« Car nous lui [Dieu] préférons le monde, et avant tout le Monde ’Pataphysique, le seul réglé dans des sens quelconques au choix, et qui, lui, tourne à la vitesse variable dont naissent les gravités dissemblables par la vertu desquelles nous pouvons, enfin, percevoir […] des entités diverses, fructueuses, favorables (s’il fait beau) et dignes, quoi qu’il arrive par la suite, d’être conservées dans la mémoire des hommes » (Boris Vian, « Lettre au Provéditeur-Éditeur sur la Sagesse des Nations », Je voudrais pas crever, op. cit., p. 63-64.)
-
[75]
Anthony Burgess, « Nonsense », dans Wim Tigges (dir.), op. cit., p. 20 ; nous traduisons. Texte original : « The human brain is too sensible to waste its time on generating what is not biologically useful. »
-
[76]
Boris Vian, cité par Noël Arnaud, Les Vies parallèles de Boris Vian, op. cit., p. 387.
-
[77]
Wim Tigges, loc. cit., p. 43 ; nous traduisons. Texte original : « Escaping into a new-found-land of language and logic, Lear […] could at least pretend to “master” reality rather than only escaping it […] or reproduce it (in art or even mathematics). »
-
[78]
« Certes, dit Jacquemort. J’ai le désir de cette expérience. De quelle expérience au fait ? Voilà. Je veux faire une psychanalyse intégrale. Je suis un illuminé » (Boris Vian, L’Arrache-coeur, op. cit., p. 27).
-
[79]
« On se débarrasse de ce qui vous gêne, premier point, dit-il, et on en fait un cadavre. Donc quelque chose de parfait, car rien n’est plus parfait, plus achevé qu’un cadavre » (Boris Vian, L’Herbe rouge, op. cit., p. 189).
-
[80]
Boris Vian, L’Écume des jours, Paris, Gallimard, 1947.
-
[81]
Ibid., p. 159.
-
[82]
Ibid., p. 50.
-
[83]
Un autre exemple est celui de la nouvelle « Le Rappel » qui narre au ralenti le suicide d’un homme se jetant du haut de l’Empire State Building (Boris Vian, L’Herbe rouge, suivi de Les Lurettes fourrées, op. cit., 197-213).
-
[84]
Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, op. cit., p. 77 ; l’auteur souligne.
-
[85]
Boris Vian, Boris Vian en verve, op. cit., p. 81.
Bibliographie
- Arnaud, Noël, Les Vies parallèles de Boris Vian, Paris, UGE (10/18), 1970 [1966].
- Arnaud, Noël et Henri Baudin (dir.), Boris Vian. Colloque de Cerisy, Paris, UGE, 1977, 2 vol.
- Camus, Audrey (dir.), dossier « Boris Vians », Europe, n° 967-968 (2009), 380 p.
- Camus, Audrey (dir.), « Les contrées étranges de l’insignifiant. Retour sur la notion de fantastique moderne », Études françaises, vol. 45, n° 1 (2009), p. 95.
- Camus, Audrey et Rachel Bouvet (dir.), Topographies romanesques, Rennes / Québec, Presses universitaires de Renne / Presses de l’Université du Québec, 2011.
- Canovas, Frédéric, L’Écriture rêvée, Paris, L’Harmattan, 2000.
- Clouzet, Jean, Boris Vian, Paris, Seghers, 1971 [1966].
- Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria, Edimbourg, Edinburgh University Press, 2014 [1817].
- Freud, Sigmund, « L’inquiétante étrangeté », Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1933 [1919], p. 163-210.
- Freud, Sigmund, L’Interprétation des rêves, Paris, Presses universitaires de France, 1967 [1900].
- Goimard, Jacques, Univers sans limite. Critique du fantastique et de l’insolite, Paris, Pocket, 2003, t. 2.
- Iser, Wolfgang, L’Acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1985, p. 49.
- Lapprand, Marc, V comme Vian, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006.
- Pestureau, Gilbert, Boris Vian, les amerlauds et les godons, Paris, UGE, 1978.
- Poirier, Jacques, « Malaise dans la signification », Études françaises, vol. 45, n° 1 (2009), p. 109-124.
- Rey-Debove, Josette et Alain Rey (dir.), Le Nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 2009.
- Sarrazac, Jean-Pierre, Jeux de rêves et autres détours, Belval, Circé, 2004, p. 65.
- Tally, Robert T., Spatiality, London, Routledge, 2013.
- Tigges, Wim (dir.), Explorations in the Field of Nonsense, Amsterdam, Rodopi, 1987.
- Vian, Boris, Boris Vian en verve : mots, propos, aphorismes, édition, présentation et choix par Noël Arnaud (éd.), Paris, Horay (En verve), 2016 [1970].
- Vian, Boris, « Lettre au Provéditeur-Éditeur sur la Sagesse des Nations », Je voudrais pas crever, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 63-64.
- Vian, Boris, « Un robot-poète ne nous fait pas peur », Je voudrais pas crever, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 93-100.
- Vian, Boris, Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz, Paris, L’Arche, 1959.
- Vian, Boris, L’Arrache-coeur, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962 [1953].
- Vian, Boris, L’Équarrissage pour tous, Théâtre 1, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965 [1950], p. 41-184.
- Vian, Boris, L’Herbe rouge, suivi de Les Lurettes fourrées, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962 [1950].
- Vian, Boris, L’Écume des jours, Paris, Gallimard, 1947.

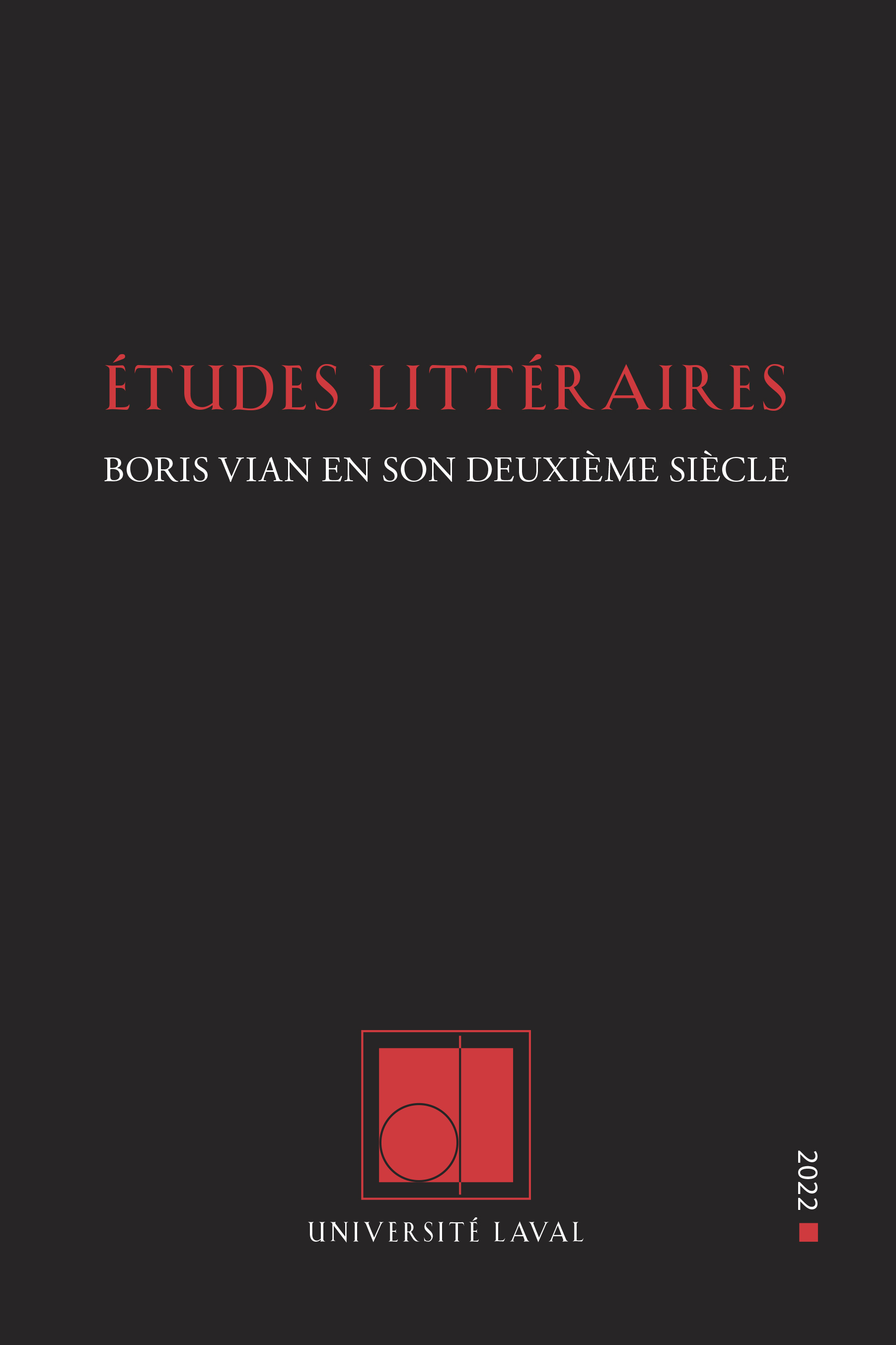
 10.7202/029841ar
10.7202/029841ar