Résumés
Résumé
Cet article analyse l’écopolitique mise de l’avant dans Bleuets et abricots (2016) de la poète innue Natasha Kanapé Fontaine. Cette oeuvre constitue un point d’entrée remarquable pour comprendre la dimension poétique et politique de l’engagement environnemental de l’auteure, qui s’exprime d’une part à travers une identification forte entre une femme autochtone et un territoire qu’elle revendique comme sien, et d’autre part par l’inscription du territoire comme un Autre avec qui une relation tendre est engagée. Cette relation prend tour à tour les contours d’un rapport de parenté, d’un rapport maternel et d’un rapport amoureux. Enracinée dans son territoire, la locutrice parvient à articuler sa lutte décoloniale en présentant les femmes et les territoires autochtones comme survivant(e)s et, ultimement, indestructibles.
Abstract
This article analyzes the ecopolitics put forward in Bleuets et abricots (2016) by Innu poet Natasha Kanapé Fontaine. This work constitutes a remarkable entry point to understand the poetic and political dimensions of the author’s environmental commitment, which is expressed on the one hand through a strong identification between an Indigenous woman and a territory that she claims as her own and, on the other hand through the inscription of the land as an Other with whom she engages in a tender relationship. This relationship takes in turn the form of a kinship relationship, a maternal relationship and a love relationship. Rooted in her territory, the speaker manages to articulate her decolonial struggle by presenting Indigenous women and territories as survivors and, ultimately, indestructible.
Corps de l’article
Si l’on conçoit l’écologie comme une approche mettant en lumière les façons multiples dont les éléments composant le monde naturel sont liés[1], force est de constater qu’elle ne saurait être pensée au singulier étant donné la grande diversité de conceptions de ces rapports selon les cultures. William Cronon a bien souligné la dimension culturelle de ce qu’on nomme « la nature », dimension obscurcie par le nom même de « nature », que l’on associe à une réalité ou une essence existant hors de l’humain[2]. Dans le contexte québécois, les conceptions du rapport au territoire, aux êtres vivants qui l’habitent et aux ressources qu’il contient sont multiples et leur incompatibilité ressort sous forme de tensions déchirant l’espace social à chaque nouveau projet de barrage hydroélectrique, de pipeline ou d’exploration pétrolière. L’une de ces visions écologiques est celle issue des Premières Nations, vision systématiquement convoquée dans les médias pour dénoncer la destruction du territoire mais dont la complexité demeure assez peu visible hors des milieux autochtones. Dans la littérature des Premières Nations d’aujourd’hui, toutefois, l’écologie politique occupe une place de choix, notamment chez les écrivaines innues : Natasha Kanapé Fontaine, Joséphine Bacon, Rita Mestokosho et Naomi Fontaine mettent toutes la question du rapport entre humains et territoire au coeur de leurs oeuvres.
Comme l’expliquent la chercheure zapotèque Isabel Altamirano-Jiménez et Nathalie Kermoal, les savoirs autochtones sont indissociables du territoire spécifique d’où ils sont issus et des relations interpersonnelles – notamment de parenté (kinship) – qui les ont constitués[3]. En introduction à leur ouvrage Living on the Land, elles insistent sur l’importance des relations dans la constitution, dans la transmission et dans la transformation des savoirs autochtones :
Indigenous knowledge systems have developed over millenia and are grounded in living relational schemas. Relationships not only highlight the strong attachment Indigenous peoples have to their homelands but also underline the ontological framework that land occupies in those relationships [...]. These relationships are reciprocal and develop among people as well as between people and non-human beings. The moral code, norms, and laws governing those relationships are based on the principles of respect, reciprocity and obligation [...]. [T]his knowledge is not fragmented into silos or categories ; rather, ontologies, epistemologies, and experiences are interwoven into this system[4].
De même, les écrivaines innues puisent leur savoir écologique de diverses sources interreliées et non-hiérarchisées, notamment de la pratique personnelle, familiale et ancestrale du territoire, des récits oraux et écrits, ainsi que des relations interpersonnelles dans lesquelles elles sont engagées – avec d’autres Innu(e)s, des Autochtones d’autres nations, des allochtones[5], et des êtres autres-qu’humains (j’y reviendrai). Le « territoire » est lui-même toujours spécifique, et les quatre auteures innues mentionnées viennent de communautés distinctes : Kanapé Fontaine et Bacon sont de Pessamit, tandis que Fontaine est de Uashat et Mestokosho, d’Ekuanitshit. Elles ont donc tissé des liens avec des territoires proches mais différents.
Bien qu’un souci pour les relations entre humains et territoire habite de façon profonde l’oeuvre de toutes ces auteures, cet article sera consacré à une seule d’entre elles, Natasha Kanapé Fontaine. Qui plus est, l’analyse portera uniquement sur Bleuetset abricots (2016)[6], bien que l’auteure ait placé l’engagement environnemental au coeur de son travail depuis le début. Dans ce livre, elle établit un rapprochement entre la femme innue et la terre, qui passe non seulement par le partage d’un corps brun[7] posé comme fertile, sexuel et sensuel, mais aussi par celui d’un corps souffrant des violences de la colonisation. Le troisième recueil de la poète innue possède une très forte cohérence interne ; il est composé de deux « mouvements » regroupant cinq longs poèmes évoquant le même univers et portés par une même voix : « La Marche », « La Chasse » et « La Cueillette » dans la première partie, puis « La Réserve » et « La Migration » dans la seconde. Pris ensemble, tous ces titres renvoient à une occupation du territoire, que ce soit dans le cadre d’activités traditionnelles qui permettent la survie du peuple (chasse et cueillette) ou dans celui d’un déplacement physique (la marche[8] et la migration, qui s’immobilisent de façon forcée entre les frontières de la réserve). Je me propose alors d’étudier l’identification ainsi que l’alliance poétiques et politiques entre la femme innue et le territoire dans Bleuets et abricots, en m’appuyant sur les études autochtones dans une perspective « écopoétique ».
En introduction à son essai écopoétique marquant, Pierre Schoentjes instaure une opposition divisant, selon lui, la littérature et la critique préoccupées par l’écologie : d’un côté se trouveraient engagement et militantisme, tandis que de l’autre se tiendrait le souci de la forme – un axe clairement valorisé par Schoentjes auquel il associe le terme d’écopoétique[9]. Or, en contexte autochtone, une scission entre poétique et politique ne semble pas pertinente, surtout si une hiérarchisation des domaines se glisse subrepticement dans les pôles contrastés. En effet, dans la littérature des Premières Nations, le rapport au monde naturel est éminemment politique en raison, entre autres, de la dépossession territoriale sans que la question du style ne passe pour autant au second plan. D’aucuns pourraient s’aventurer à créer un terme reflétant plus adéquatement les dimensions inextricables de la politique et de la poétique de l’écologie dans la littérature autochtone (« l’écopoélitique » ?), mais l’intérêt d’une telle entreprise me semble des plus limités. Dans le cadre de cet article, j’utiliserai de préférence le terme d’« écopolitique » afin de mettre en lumière l’importance de l’engagement du « je » lyrique de Kanapé Fontaine (il s’agit bien chez elle d’une parole qui marche, d’une parole qui fait). Soulignons cependant que, chez l’auteure innue, les dimensions politique et poétique ne sont pas placées en opposition ni hiérarchisées mais sont, au contraire, perçues comme enchevêtrées ou comme un continuum.
La connexion entre la femme et le territoire
Bleuets et abricots s’ouvre sur une longue citation du poète martiniquais Aimé Césaire qui commence par ces mots : « Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main maintenant dans son poing énorme [...] » (BA : 5 ; italiques dans l’original). En s’appropriant les mots de Césaire, Kanapé Fontaine place son propre sujet lyrique et son pays côte à côte, comme des alliés politiques dans une guerre de décolonisation. Pour être une « femme debout, femme puissance, femme résurgence » comme elle l’annonce en prologue (BA : 7), la poète s’appuie sur son corps, un corps marqué comme sensuel et fertile :
Je sais donner la vie. Je suis féconde. Le poème entre en moi comme un amant. L’univers entre en mon corps afin de continuer le mouvement du cycle vital. Tout est cercle. La terre. Les bleuets et les abricots. Le poème est le mouvement qui féconde.
BA : 7
La locutrice vient à l’écriture ouverte et désirante, accueillant dans son corps immense et généreux la poésie et la vie. Le motif de la rondeur – clairement associé au mouvement cyclique dans ce passage – est placé au coeur de l’oeuvre, unissant en cercles concentriques les fruits, le ventre rond de la femme enceinte et la terre, qui tous nourrissent et apportent la vie. Bien qu’elle dénonce aussi les violences qui portent atteinte à l’état de plénitude de la femme autochtone[10], Kanapé Fontaine attribue à Bleuets et abricots une autre fonction : « J’écris pour dire oui. À moi. Femme. Forcer les portes du silence. Assurer la trace. Redonner vie aux ombres, aux enfants brisés, à la parole qui ne sait plus dire oui » (BA : 7-8). Tandis que plusieurs oeuvres autochtones porteuses d’un discours de dénonciation politique pourraient être désignées comme des textes qui disent non – refusant l’appropriation territoriale, le racisme structurel, les pratiques d’annihilation culturelle, et toutes les autres formes qu’a pris et que prend encore le colonialisme au Canada et au Québec –, Bleuets et abricots veut « dire oui »[11]. Cela ne signifie bien sûr pas accepter le colonialisme ; au contraire, il s’agit pour la locutrice de Kanapé Fontaine de se réapproprier son corps (sexuel, maternel, créateur) en le réenracinant sur le territoire. Pour ce faire, elle élabore une lettre d’amour à son « pays », dit oui au désir ainsi qu’aux joies du corps, et retrouve son pouvoir dans la liberté de consentir. Par conséquent, plusieurs réseaux de liens entre femme et territoire investissent dans Bleuets et abricots des images d’étreintes sexuelles, inscrivant une écopolitique marquée par le désir et le plaisir.
Dès le premier poème, Kanapé Fontaine établit le lien fort entre la locutrice et le territoire par l’apostrophe « Pays mien » qui revient en leitmotiv du premier au dernier poème (BA : 14, 15, 18, etc.). En s’adressant à « son pays », la poète le personnifie et l’élit comme interlocuteur mais, surtout, elle revendique une relation d’appartenance fondamentale : ce pays lui appartient en tant que femme innue, et il n’appartient pas aux Québécois et aux Canadiens qui sont renvoyés dans la même strophe au statut de réfugiés et non de propriétaires :
Pays mien ô
je te nommerai par ton nom
aux enceintes Anticosti
aux enceintes Eeyou Istchee
ouvrir la porte
aux réfugiés
[...]
Si je te nommais mon ventre
si je te nommais mon visage
le nom de mes montagnes ma rivière
Utshuat Upessamiu Shipu
le nom de mon fleuve mon sable mon lichen
Uinipeku Nutshimit (BA : 14)
En se déclarant de façon non équivoque chez elle, elle redonne au pays son nom véritable à l’aide de toponymes autochtones. Les langues autochtones sont présentées comme non seulement celles des Premières Nations, mais comme celles du territoire ; de la sorte, les « réfugiés » qui s’adressent au pays en langues coloniales (le français et l’anglais) ne pourront développer de relations authentiques avec celui-ci. Le grand nombre de possessifs qui ponctuent le poème souligne le lien d’appartenance entre le territoire et la locutrice – puisque le pays, avec ses montagnes, ses rivières, son fleuve, son sable et son lichen, est à elle –, mais sert aussi à inscrire des rapports d’identification très forts. En effet, les trois premiers vers de la deuxième strophe citée établissent une superposition entre des parties du corps de la locutrice (le ventre et le visage) et des parties du corps du territoire (les montagnes et les rivières). De nombreux passages de Bleuets et abricots établissent de façon similaire une mise en parallèle du corps de la femme innue avec celui du territoire innu, afin qu’ils soient pensés en continuité plutôt que comme deux entités séparées.
Cette complicité entre locutrice et territoire s’exprime également dans des rapprochements entre leurs corps, dans des moments où la femme affiche clairement son appartenance au territoire autochtone :
Je me coifferai
pareille au renne arctique
à la mousse résineuse des épinettes
eau-de-vie des cueillettes (BA : 15)
La ressemblance entre la parure du renne et celle de la femme illustre leur provenance conjointe ; l’animal du pays, indigène jusque dans son nom (« renne arctique »), partage un même rapport au territoire que la femme autochtone : tous deux sont de la même « marche / circumpolaire » (BA : 13). De plus, ce passage estompe les différences entre les espèces – femme, renne, mousse et épinettes – au profit de la représentation d’un groupe de vivants interdépendants sur le territoire. Quelques pages plus loin, l’on retrouve cette identité transversale entre femme et territoire, qui passe cette fois-ci par le nom :
Je suis femme la terre
d’où l’on a tiré mon nom
[...]
les missionnaires me disaient Montagnaise
moi je dis femme-territoire
[...] (BA : 20)
Ici, la poète joue du nom longtemps attribué aux Innus par les étrangers[12] afin de se le réapproprier (oui, je suis de la montagne) et de l’élargir (je suis beaucoup plus que la montagne, je suis le territoire en entier). Dans la suite du passage, la femme-territoire se dresse dans un mouvement de défi qui inscrit sa résistance aux forces qui menacent les vies autochtones humaines et non-humaines :
Une femme se lèvera
vêtue de ses habits de lichen
vêtue de ses traditions
vêtue de son tambour intérieur
Elle sera debout
devant les machines
mystère territorial
[...] (BA : 20-21)
Chez Kanapé Fontaine, la lutte écologiste et celle pour la souveraineté des Premières Nations sont tissées ensemble, et vont de concert avec une affirmation féministe[13] de la valeur des femmes – associées dans son oeuvre à la force, à la résistance, au désir, à l’amour, à la résilience, à la générosité ainsi qu’à la fertilité. Dans la première strophe citée, l’on retrouve l’image d’une femme habillée par le territoire (la mousse qui la coiffait plus haut est devenue des vêtements de lichen) marquant la symbiose entre leurs corps. À cela s’ajoutent deux autres « vêtements » – ses traditions et son « tambour intérieur » (c’est-à-dire son coeur) –, qui inscrivent le corps de la femme et son territoire comme inséparables de la culture innue dont tous deux sont issus. La relation d’appartenance entre femme et territoire circule ainsi dans les deux sens : de façon circulaire, le territoire appartient à la locutrice autant qu’elle appartient au territoire.
La porosité entre les espèces animales et végétales permet aux êtres évoqués dans les poèmes de Kanapé Fontaine de se transformer ou d’adopter plusieurs formes à la fois, par exemple dans cet extrait de « La Chasse » :
[...]
Kanata pays mien
Imprégner la toundra de ton odeur
mes cheveux sur ta poitrine
se muteront en tiges
entre ciel et terre
arbres et racines (BA : 23)
Cette scène tendre où la locutrice et son pays sont lovés dans une étreinte d’où surgit la vie prête d’abord un corps semblable – humain – aux deux entités, qui possèdent respectivement des cheveux et une poitrine. De cette union entre une femme et un territoire naîtront des êtres végétaux – tiges, arbres, racines – joignant le ciel à la terre, ce qui crée une image d’harmonie.
Si l’expression « Terre-Mère » nous est familière, la complexité de ce qu’elle désigne l’est beaucoup moins. Rémi Savard dénonce l’ampleur de la « surdité culturelle[14] » des Occidentaux face à une notion qui nous échappe en raison de son incompatibilité fondamentale avec celle de propriété privée, que nous remettons rarement en question de façon profonde. Dans un article marquant, l’anthropologue Tim Ingold (2012) a démontré que le discours scientifique allochtone sur les Premières Nations tend à interpréter comme métaphoriques des représentations qui ne sont pas présentées comme telles par les Autochtones, notamment celle de la forêt en tant que parent (mère ou père de l’individu). Selon Ingold, la raison principale qui empêche les chercheurs allochtones de réellement entendre ce que disent leurs informateurs autochtones est que la plupart d’entre nous n’acceptons pas le fait que des entités non-humaines puissent être considérées comme des personnes : « [N]onhuman agencies and entities are supposed to have no business in the world of persons save as figures of the anthropomorphic imagination[15]. » Du point de vue dominant, la forêt ne peut réellement être un parent pour un individu parce qu’elle n’est pas un sujet social capable d’entretenir des relations interpersonnelles[16], mais plutôt un lieu ou un objet. Cependant, Ingold souligne bien que cette restriction du statut de personne aux humains ne se retrouve pas dans la majorité des cultures autochtones (il étudie notamment les Cris de Waswanipi). Dans ce contexte, il convient de se poser la question suivante :
[W]hen the hunter-gatherer addresses the forest as his or her parent, or speaks of accepting what it has to offer as one would from other people, on what grounds can we claim that the usage is metaphorical ? This is evidently not an interpretation that the people would make themselves[17].
Une telle réflexion apparaît des plus importantes pour les études littéraires portant sur des oeuvres autochtones menées par des chercheur(e)s allochtones – comme c’est le cas du présent travail. Jean-François Létourneau l’a d’ailleurs déjà remarqué dans un article portant sur les particularités de l’enseignement de la littérature autochtone, qu’il est utile de citer longuement ici :
Lorsque la poète innue Rita Mestokosho désigne la rivière Romaine comme sa « grande soeur aînée millénaire », on y lit, avec raison, une personnification. Par contre, pour la majorité des étudiants avec lesquels j’ai travaillé à Kiuna [un collège pour les personnes des Premières Nations], l’association entre un cours d’eau et une figure fraternelle est naturelle, véhiculée par la tradition orale. Elle n’a rien d’un effet stylistique. [...]
[A]fin de saisir la réelle portée du texte, il importe de se rappeler que la notion de personnification, malgré toute sa pertinence dans la pensée occidentale, reste peu significative pour un Autochtone. En réduisant l’expression « grande soeur aînée millénaire » à une figure de style, on désamorce sa puissance d’évocation, on la vide de sa signification la plus importante : la rivière est « réellement » un membre de la famille. En la ramenant à une simple personnification, on amenuise l’importance du lien entre les Innus et la rivière que véhicule la poésie de Mestokosho. On se coupe aussi de l’enseignement universel qu’une telle vision du monde sous-tend : l’interdépendance de tous les êtres vivants de la planète. Ce malentendu est de moindre importance tant que l’on reste dans le domaine de la poésie, mais qu’en est-il lorsque vient le temps de négocier le développement hydroélectrique de la rivière[18] ?
Ces questions ont un impact majeur sur l’analyse qui peut être faite de l’oeuvre de Kanapé Fontaine, chez qui plusieurs entités non-humaines agissent comme des personnes (que ce soit en posant des gestes, en ressentant des émotions, ou en ayant des opinions et des droits), avec qui la locutrice est posée en relation de parenté. Par exemple, dans un slam composé pour la marche des femmes innues en 2012 protestant le Plan Nord et les activités d’Hydro-Québec pour le « développement » de la rivière Romaine[19], Kanapé Fontaine inscrivait déjà la forêt comme sa mère : « Et encore, une photographie de moi enfant / les bras de ma mère / Dans l’étreinte verdure de la forêt reine éphémère[20]. » La « mère » désigne ici à la fois la mère humaine et la mère sylvestre de la locutrice, qui se superposent et se confondent dans un geste de tendresse et de protection (l’étreinte).
Dans Bleuets et abricots, la locutrice reconnaît sa « mère » dans plusieurs entités liées au territoire. Dans un passage au « nous » qui dessine une communauté autochtone pan-nationale, Kanapé Fontaine reprend le processus de superposition des corps humains et non-humains (ici autour des cheveux) vu précédemment, afin d’établir les Premières Nations comme les enfants de la terre :
Nous tressons à nouveau nos cheveux
plus personne pour les scalper
nous les arracher
Nous tressons le foin d’odeur
chevelure de notre mer
nous le brûlons pour le firmament
[...] (BA : 36)
Dans ce passage, les corps autochtones poussent à même le corps de leur mère-terre (évoquée par la mer d’herbe de la prairie), et l’image de la tresse vient figurer l’entremêlement (harmonieux et solide) des corps des diverses espèces en relation. Brûler les tresses de foin d’odeur de façon cérémonielle permet de surcroît de lier la terre au ciel, resserrant tous les éléments dans une étreinte marquée par le souci de l’autre.
En plus des liens de parenté que Kanapé Fontaine tisse entre sa locutrice et le territoire qu’elle habite, elle se place en héritière de sa prédécesseure, la poète innue Joséphine Bacon. Ayant confié à Maurizio Gatti[21] que Bâtons à message/ Tshissinuatshitakana (2009) l’a poussée à écrire, elle rend hommage à son aînée dans Bleuets et abricots avec ce passage : « [J]e me ferai belle pour le poème / de ma grand-mère » (BA : 14), qui fait écho à l’un des poèmes les plus connus de Bacon :
Je me suis faite belle
pour qu’on remarque
la moelle de mes os,
survivante d’un récit
qu’on ne raconte pas.[22]
Ce recours à l’intertextualité permet à Kanapé Fontaine de redessiner ses relations de parenté, s’inscrivant comme la petite-fille de la grande dame de la poésie innue et réattribuant le rôle de « mère » à une humaine. Pour atteindre ce qu’elle nomme « l’accouchement de moi-même » (BA : 13), Kanapé Fontaine s’attache donc à tisser une multitude de liens d’amour unissant la locutrice à un territoire, une langue et d’autres personnes autochtones – notamment une écrivaine – afin de réparer les liens brisés par le colonialisme.
Rapports humains et territoire
Dans un bel article portant sur Kuessipan de Naomi Fontaine (2011), Isabella Huberman propose d’appliquer à des oeuvres autochtones la notion d’« amour décolonial » (decolonial love) qu’elle retrouve chez l’écrivaine anishinabée Leanne Simpson (2013) aussi bien que chez la chercheure chicana Chela Sandoval (2000). Selon Huberman, l’amour décolonial « est fondamentalement ancré dans les relations[23] », soutenant une vision du monde qui place les rapports interpersonnels au coeur de la constitution de la subjectivité. Tandis que Simpson et Sandoval réfléchissaient aux possibilités ouvertes par la relation amoureuse de deux personnes douloureusement affectées par le colonialisme, Huberman étend la notion d’amour décolonial afin de l’appliquer à l’amour maternel ou familial, puis l’élargit encore pour « inclure d’autres genres de rapports, comme l’interaction entre un individu et les êtres inanimés, la transmission du savoir d’un enseignant à son élève, ou bien le partage entre un auteur et son lectorat[24] ». Comme Huberman l’explique avec des exemples tirés de Kuessipan, les relations marquées par l’affection et le soin envers l’autre forment des « nids de résistance[25] » contre la violence coloniale passée et présente. Cette notion d’amour décolonial paraît porteuse également pour étudier Bleuets et abricots, moins en ce qui a trait aux interactions interpersonnelles que pour aborder les relations entre la femme autochtone et le territoire, rapports représentés tour à tour ou simultanément comme maternels et sexuels.
Si la locutrice est à maintes reprises présentée comme fille du pays, plusieurs images la montrent également sous les traits de mère du pays, notamment en lien avec les motifs de la rondeur, du ventre, de la maternité, de l’accouchement et de l’allaitement. Dès le premier poème, la locutrice porte son pays dans son corps :
Pays mien ô
voici ton nom
lové entre mes entrailles
sables et plages
lune et pierres (BA : 15)
Enceinte de tout un territoire, la locutrice ne peut en être séparée puisqu’elle ne fait qu’un avec lui. À l’image de l’immensité du territoire qu’elle contient, son corps à elle prend des dimensions astronomiques, capable d’abriter l’ensemble de l’écosystème, du grain de sable à la lune. Plus loin, elle se représente dans un geste tendre où elle prend soin de son enfant-pays après sa (re)naissance : « [J]e cesserai de grincer de la mâchoire / je bercerai l’avenir / Kanata » (BA : 24). Non seulement berce-t-elle son nouveau-né Kanata (un nouveau « Canada » qui aurait repris son visage autochtone), mais elle lui susurre des mots doux à l’oreille en lui parlant dans sa langue : « [V]oici que je sais parler / voici que je connais ta langue / je chante tes syllabes » (BA : 24). On le voit, la relation entre la locutrice et son pays s’insère aisément dans le modèle de l’amour décolonial en adoptant la forme de la relation unissant une mère à son enfant.
Pour que Kanata puisse naître, une certaine conception du pays doit mourir. En ce sens, le passage suivant paraît capital, puisqu’il met en scène un accouchement qui est à la fois une ouverture (vers un ordre nouveau) et une fermeture (le rejet du modèle colonial) :
J’ouvrirai
la porte pays mien
la porte du Sud
j’ouvrirai la porte des Abricots
le Paradis des Indiens
Je crie
tout pousse
et surgit
Montréal
lève la tête
Montréal
souviens-toi de ton nom
Hochelaga
Moi
je suis venue fermer
les portes du Plan Nord
les portes de la mort (BA : 41)
Enfanter le pays constitue une responsabilité énorme, puisque cela implique de mener de front une lutte de décolonisation, figurée encore une fois par le recours à une image convoquant une partie du corps : la tête qu’on doit lever en signe de fierté retrouvée. À nouveau dans l’oeuvre de Kanapé Fontaine, la réparation passe par l’interpellation du pays-fils par son véritable nom (Hochelaga derrière Montréal, Kanata derrière Canada) et par l’affirmation d’un rapport intime entre la locutrice et le territoire (son pays, son enfant).
Comme nous l’avons vu, la poétique de Bleuets et abricots inscrit les diverses entités en continuité et en superposition[26] plutôt que comme des individus ou des objets séparés ; il n’est donc pas surprenant que dans la dyade femme-territoire, les rôles soient fluctuants. Lorsque la locutrice s’adresse à son pays en disant « toi mon fils mon mari » (BA : 32), l’on constate que les rôles de mère et d’amante, d’enfant et d’amant, ne sont pas contrastés ni même différenciés, mais plutôt accumulés dans une même relation fondamentale d’amour décolonial. Le genre masculin octroyé au territoire amène ainsi Kanapé Fontaine à représenter les rapports entre la femme autochtone et lui comme une relation amoureuse et sexuelle où la pénétration joue un rôle important :
[...]
tu te dis sauvage
tu t’insinues en ma chair
dedans
[...]
les plaques tectoniques
s’engouffrent en moi
la nature t’a si bien fait
le calcaire retentissant
sous mes robes
femelle première (BA : 15-16)
Ainsi, le ventre de la locutrice est un lieu à la fois maternel et érotique, intime et ouvert aux pénétrations du dehors. Dans le poème suivant, la femme-territoire est encore une fois pénétrée, cette fois-ci par des poissons qui arpentent les rivières fertiles de son corps : « [L]’orchestre symphonique / remonte mes cuisses en saumons rose / eau douce du retour » (BA : 22). L’imagerie sexuelle permet ici de présenter la locutrice – et par extension les femmes autochtones et le territoire – comme la source de la vie. Plutôt que d’investir les motifs interdépendants de la terre vierge et du viol en lien avec la colonisation[27], Kanapé Fontaine inscrit la terre des Amériques comme une mère et une amante, en possession de sa sexualité[28].
En effet, dans son oeuvre, les rapports entre femme et territoire sont tout entier marqués par la sensualité, qui occupe un domaine encore plus large que la sexualité. Dès le titre du recueil, la poète met l’accent sur les fruits et, à plusieurs reprises, elle évoque le plaisir de manger[29] ce qui est présenté comme une offrande du territoire et une occasion pour la locutrice de le découvrir dans sa diversité :
Le bout de mes doigts
le jus des grenades
goût oublié des mangues
je me tiens à la bouche des paradis
lèvres sucrées des abricots
enfin boire à la mer
la saveur de ta langue étrangère
Je marche vers le Sud
Je me nourris de bleuets et d’abricots
[...]
je dois concocter des confitures
je mangerai la peau bleue des baies
pour garder ma chaleur
j’offrirai des fruits
à la froidure
apprendre le nom
de mon pays (BA : 30-31)
Entrelacer les fruits d’ici (bleuets et abricots) aux fruits tropicaux (grenades et mangues) est une façon pour la femme-territoire de parcourir l’étendue des Amériques, entièrement reterritorialisées en terre autochtone unie et riche. Ce faisant, elle devient « Femme-terre » (BA : 75), une entité encore plus vaste que la « femme-territoire » (BA : 20) si l’on comprend le territoire comme spécifique à la nation (pour Kanapé Fontaine, cela correspondrait au territoire innu du Nitassinan) et la terre comme l’ensemble où se côtoient la multitude des territoires des différentes nations autochtones.
* * *
Bien que Bleuets et abricots place une femme en son centre, il ne constitue pas pour autant une entreprise anthropocentrique ; bien au contraire, Natasha Kanapé Fontaine élargit son personnage de femme au point qu’il contienne en lui tout l’univers : la femme-territoire et la Femme-terre sont humaines et non-humaines, vivantes et immortelles. En mettant l’accent sur les relations de parenté, d’identification, d’amour et de soin entre les différents êtres, la poète illustre la conclusion d’Ingold, selon qui « the relations that human beings have with one another form just one part of the total field of relations embracing all living things[30] » – et pas nécessairement la plus importante, puisque cette vision du monde n’octroie pas à l’humain une position privilégiée par rapport aux autres vivants.
En clôture du premier poème, Kanapé Fontaine place la vision d’un avenir enchanteur, marqué par la paix et la cohabitation libre des vivants :
Les chants de la paix éclateront
nous verrons les fleurs pays mien
sur les cheveux libérés de nos filles
Louis Riel reviendra rire
parmi les chevaux et les cerfs
les bisons courront à nouveau
sur les terres
Manito Ahbee
Aie pitié de moi
Nitassinan
je prie. (BA : 19)
Ici, le dieu à prier est « Nitassinan » – le territoire innu –, et il apporte des retrouvailles entre humains et autres animaux (l’adverbe parmi signalant une position indifférenciée de l’humain, aux antipodes de l’exceptionnalisme marquant toujours la pensée occidentale). L’on peut croire également que cette vision annonce une certaine réconciliation entre les peuples, avec la figure du Métis Riel qui rit plutôt que d’avoir à prendre les armes. Quoi qu’il en soit, il demeure que cette vision de la terre retrouvée (c’est-à-dire décolonisée, réappropriée par les Autochtones) va de pair avec le fait d’être repeuplée par les animaux et par les humains, à rebours d’un « Eden » dépeuplé fréquemment convoqué dans les représentations écologiques occidentales[31]. Le territoire en résurgence apparaît ainsi comme une sorte de maison pour tous : filles et fils du pays comme réfugié(e)s, personnes humaines et non-humaines.
Parties annexes
Note biographique
Joëlle Papillon est professeure à l’Université McMaster, où elle enseigne les littératures autochtone, franco-canadienne et québécoise. Elle s’intéresse particulièrement à la littérature actuelle des femmes (Nelly Arcan : trajectoires fulgurantes [codir.], Les Éditions du remue-ménage, 2017 ; Désir et insoumission chez Arcan, Millet et Ernaux, Presses de l’Université Laval, 2018) et des Premières Nations. Elle reconnaît qu’elle vit et travaille sur le territoire traditionnel et actuel des peuples Haudenosaunee et Anishinabé, qu’elle remercie pour leur hospitalité.
Notes
-
[1]
Voir par exemple Pierre Schoentjes, Ce qui a lieu : essai d’écopoétique, Marseille, Éditions Wildproject (Tête nue), 2015, p. 15.
-
[2]
William Cronon, « Introduction : In Search of Nature », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground : Rethinking the Human Place in Nature, New York / Londres, W.W. Norton & Company, 1996 [1995], p. 34-35.
-
[3]
Isabel Altamirano-Jiménez et Nathalie Kermoal, « Introduction : Indigenous Women and Knowledge », dans Isabel Altamirano-Jiménez et Nathalie Kermoal (dir.), Living on the Land : Indigenous Women’s Understanding of Place, Edmonton, Athabasca University Press, 2016, p. 3.
-
[4]
Ibid., p. 7-8.
-
[5]
Le terme « allochtone » désigne toute personne ou institution non-autochtone.
-
[6]
Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016. Afin d’alléger le texte, les renvois à cette oeuvre seront désignés par le sigle BA suivi du folio.
-
[7]
Dans leur étude des oeuvres de Leslie Marmon Silko (laguna pueblo) et de Gloria Anzaldúa (chicana/aztèque), M. Jimmie Killingsworth et Jacqueline S. Palmer soulignent elles aussi l’importance de la symétrie entre la peau brune des femmes autochtones et celle de la terre. La couleur brune inscrit la parenté entre les Premiers Peuples et la terre, une relation intime qui s’accompagne de la responsabilité de prendre soin les uns des autres (M. Jimmie Killingsworth et Jacqueline S. Palmer, « Ecopolitics and the Literature of the Borderlands : The Frontiers of Environmental Justice in Latina and Native American Writing », dans Richard Kerridge et Neil Sammells [dir.], Writing the Environment : Ecocriticism and Literature, Londres, Zed Books, 1998, p. 203).
-
[8]
La chercheure malécite Michèle Lacombe a souligné la récurrence du motif de la marche dans la littérature autochtone, notamment dans la poésie de l’auteure innue Joséphine Bacon. Selon elle, la marche renvoie non seulement au déplacement d’un corps sur un territoire, mais aussi à un mouvement poétique ; c’est ce qu’elle appelle « les mots qui marchent » (words that walk), créant un rythme associé en contexte autochtone aux battements de coeur, au souffle et à la danse (Michèle Lacombe, « “Pimuteuat / Ils marchent / They Walk” : A Few Observations on Indigenous Poetry and Poetics in French », dans Neal McLeod [dir.], Indigenous Poetics in Canada, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2014, p. 160).
-
[9]
Pierre Schoentjes, op. cit., p. 17 et p. 24.
-
[10]
Par exemple, dans le bref passage « le prêtre a caché sa main droite / sous ma jupe blanche / première communion » (BA : 27), la locutrice dénonce de front les abus sexuels et le rôle de la religion catholique dans les attaques contre les corps, les esprits et les âmes des personnes autochtones. Ce type de dénonciations demeure à l’arrière-plan dans la première partie de Bleuets et abricots, mais prend plus de place dans le deuxième mouvement, où la locutrice annonce « La guerre est en moi comme partout » (BA : 61). Il sera peu question du « Deuxième mouvement » dans cet article, mais signalons qu’il s’inscrit explicitement en réaction à l’occupation québécoise du territoire, notamment en détournant la devise « Je me souviens » (BA : 56, 62, 63, 64, 66, 73, 76). Dans le « Premier mouvement », les dénonciations principales de Kanapé Fontaine ont plutôt trait à l’exploitation du territoire et à la dévastation qui s’ensuit – notamment la déforestation (BA : 29) et l’extraction du pétrole (BA : 33).
-
[11]
À ce sujet, la chercheure métis Emma LaRocque remarque que la critique s’est jusqu’à maintenant beaucoup plus intéressée à la dépossession qu’à l’expression d’agentivités autochtones : « [M]uch has been written about women’s oppression and disempowerment. In effect, the emphasis has been on cultural discontinuity » (Emma LaRocque, « Reflections on Cultural Continuity through Aboriginal Women’s Writings », dans Gail Guthrie Valaskakis, Madeleine Dion Stout et Eric Guimond [dir.], Restoring the Balance : First Nations Women, Community, and Culture, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2009, p. 160). Pour cette raison, LaRocque cherche quant à elle à mettre en valeur la continuité (la transmission des savoirs ancestraux et la création de nouveaux savoirs ; le tissage de liens interpersonnels et communautaires ; la célébration des vies, des langues et des territoires autochtones) mise en scène dans les oeuvres des écrivaines autochtones. Bleuets et abricots appartient, à mon avis, à ce mouvement de régénération.
-
[12]
Rémi Savard a établi que l’appellation « Montagnais » circulait déjà parmi les voyageurs européens avant la venue de Champlain en 1603 (Rémi Savard, La Forêt vive : récits fondateurs du peuple innu, Montréal, Boréal, 2004, p. 19). Il cite le chasseur innu William Mathieu Mark d’Unaman-shipit, qui suppose que le terme vient probablement « des grosses montagnes qu’il y a à Sept-Îles » (ibid., p. 21). Le chasseur poursuit avec le commentaire critique suivant : « Ils [les étrangers] nous donnent tous ces noms selon leur volonté, sans jamais se soucier de notre vrai nom, qui est “Innu”. “Innu” c’est notre nom qui respecte notre façon de vivre » (id.).
-
[13]
Julie Perreault (« La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine », Recherches féministes, vol. 28, n° 2 [2015], p. 34) note d’ailleurs que les féminismes autochtones se démarquent par leur intersectionnalité, considérant la question du genre comme inextricable de celles de la race et du colonialisme. Il faudrait ajouter à ces préoccupations interreliées la question environnementale, inséparable de celle de la justice territoriale. Notons que la pertinence d’une approche féministe en contexte autochtone ne fait pas consensus, certain(e)s se méfiant d’un appareil critique et de théories issus d’un mode de pensée occidental, tandis que d’autres y voient des outils utiles pouvant être appropriés à la lutte pour la décolonisation ; à ce sujet, voir Joyce Green (dir.), Making Space for Indigenous Feminism, Black Point / Londres, Fernwood Publishing / Zed Books, 2007.
-
[14]
Rémi Savard, Le Sol américain : propriété privée ou Terre-Mère... L’en-deçà et l’au-delà des conflits territoriaux entre autochtones et blancs au Canada, Montréal, L’Hexagone, 1981, p. 16.
-
[15]
Tim Ingold, « Hunting and Gathering as Ways of Perceiving the Environment », dans Aaron Gross et Anne Vallely (dir.), Animals and the Human Imagination : A Companion to Animal Studies, New York, Columbia University Press, 2012, p. 38-39.
-
[16]
Ibid., p. 39.
-
[17]
Ibid., p. 37.
-
[18]
Jean-François Létourneau, « L’enseignement de la littérature autochtone », Littoral, n° 10 (printemps 2015), p. 53.
-
[19]
Pour une analyse de la résistance innue aux projets de « développement » sur leur territoire – notamment dans le cadre du projet de la Romaine –, on consultera avec profit l’article de Dalie Giroux (« La résistance innue au projet hydroélectrique de La Romaine [2009-2014] : limites légales, politiques et épistémologiques à la contestation politique », dans Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri [dir.], Au nom de la sécurité ! Criminalisation de la contestation et pathologisation des marges, Saint-Joseph-du-Lac, M éditeur [Mobilisations], 2016, p. 65-80). Elle démontre comment la résistance pacifique innue a été criminalisée afin de sauvegarder les intérêts économiques d’Hydro-Québec, assimilés dans le discours médiatique, populaire et juridique au « bien de tous » – tous désignant évidemment les Québécois et les Canadiens, et non les Innus. Giroux explique que « la criminalisation de la résistance s’inscrit dans un arsenal de tactiques qui appartient à une stratégie globale de capitalisation du territoire qui a une longue histoire au Canada » (ibid., p. 75), histoire que Giroux fait remonter à l’appropriation coloniale initiale, « justifiée » par la doctrine de la terra nullius (ibid., p. 77).
-
[20]
Natasha Kanapé Fontaine, « Les jours des feux, des tambours et des meutes », dans Laure Morali et Rodney Saint-Éloi (dir.), Les Bruits du monde, Montréal, Mémoire d’encrier, 2012, p. 31.
-
[21]
Maurizio Gatti, « Natasha Kanapé Fontaine : un nouvel exotisme innu », entrevue transcrite et éditée par Alice Lefilleul, Littoral, n° 10 (printemps 2015), p. 128.
-
[22]
Joséphine Bacon, Bâtons à message / Tshissinuatshitakana, Montréal, Mémoire d’encrier, 2009, p. 82.
-
[23]
Isabella Huberman, « Les possibles de l’amour décolonial : relations, transmissions et silences dans Kuessipan de Naomi Fontaine », Voix plurielles, vol. 13, n° 2 (2016), p. 113. La « décolonialité » renvoie aussi bien à une série de pratiques visant à mettre fin au colonialisme qu’à une école théorique originant des Amériques centrale et du Sud (notamment autour de Walter Mignolo et Aníbal Quijano). En contexte autochtone nord-américain, on parle plus volontiers de décolonialisme que de postcolonialisme pour souligner la persistance du colonialisme occidental envers les Premières Nations.
-
[24]
Ibid., p. 114.
-
[25]
Ibid., p. 112.
-
[26]
Rappelons à ce sujet l’affirmation d’Altamirano-Jiménez et Kermoal (op. cit., p. 8) citée en introduction, comme quoi les savoirs autochtones ne se construisent pas en catégories distinctes mais forment plutôt un enchevêtrement holistique.
-
[27]
La conceptualisation de l’Amérique en tant que « terre vierge » – fréquemment évoquée dans les textes occidentaux (explicitement hier et plus obliquement aujourd’hui) – la place dans un récit téléologique patriarcal menant de la virginité à la défloration par les colons ou les aventuriers. Dans Conquest (2005), Andrea Smith identifie le viol des femmes autochtones comme la manifestation principale du colonialisme. Selon elle, les femmes et les territoires autochtones sont considérés d’emblée « violables » (rapable) par les colonisateurs, autorisant par le fait même leur appropriation et leur destruction (Andrea Smith, Conquest : Sexual Violence and the American Indian Genocide, Cambridge, South End Press, 2005, p. 10 et p. 12). Sur la persistance des enjeux liés à la question de la « terre vierge », consulter Shiri Pasternak, « Terres inoccupées et semences brutes : des doctrines de la découverte aux brevets sur la vie » [en ligne], L’Observatoire de la génétique : cadrages, n° 33 (juin / août 2007) [http://www.omics-ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2007/c_no33_07/c_no33_07_01.html].
-
[28]
Dans son étude du roman érotique L’Amant du lac (2013) de l’auteure crie Virginia Pésémapéo Bordeleau, Sarah Henzi (2015) s’appuie sur l’oeuvre de Kateri Akiwenzie-Damm (anishinabée) pour souligner la dimension réparatrice de l’érotisme en contexte colonial : les corps morcelés, violés et dénaturés par le colonialisme sont réappropriés et guéris dans des oeuvres célébrant le plaisir et l’intégrité des corps (Sarah Henzi, « Bodies, Sovereignties, and Desire : Aboriginal Women’s Writing of Québec », Québec Studies, vol. 59 [2015], p. 85-106).
-
[29]
La dimension sensuelle et sexuelle des fruits ne fait aucun doute chez Kanapé Fontaine, comme en fait foi cet autre passage : « [Q]ue tu viennes y boire la volupté d’une baie / que tu viennes y boire la volupté d’une baise » (BA : 31-32). L’invitation à « goûter » son pays (BA : 32) entrelace constamment les registres de la nourriture et de la sexualité, qui se rencontrent dans le plaisir.
-
[30]
Tim Ingold, op. cit., p. 49.
-
[31]
Dans un article précédent, nous confrontons deux modèles de représentations de la nature idéale : le premier (prédominant dans le discours environnementaliste occidental) – qualifié d’édénique par des chercheurs qui le critiquent comme William Cronon (1995), Candace Slater (1995) et Carolyn Merchant (1995) – conçoit les humains comme interférant avec l’espace naturel de manière toujours négative, tandis que le second, favorisé dans les discours autochtones, présente la nature comme un endroit habité, et non séparé de l’humain. C’est ce que Tim Ingold (op. cit., p. 34) a nommé une « ontologie de l’habitation » (ontology of dwelling). Joëlle Papillon, « Repenser les rapports entre humains et nature : visions écopolitiques dans la littérature autochtone contemporaine », Québec Studies, vol. 63 (2017), p. 57-76 ; William Cronon, op. cit. ; Candace Slater, « Amazonia as Edenic Narrative », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground, op. cit., p. 114-131 ; Carolyn Merchant, « Reinventing Eden : Western Culture as Recovery Narrative », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground, op. cit., p. 132-159.
Références
- Altamirano-Jiménez, Isabel et Nathalie Kermoal, « Introduction : Indigenous Women and Knowledge », dans Isabel Altamirano-Jiménez et Nathalie Kermoal (dir.), Living on the Land : Indigenous Women’s Understanding of Place, Edmonton, Athabasca University Press, 2016, p. 3-17.
- Bacon, Joséphine, Bâtons à message / Tshissinuatshitakana, Montréal, Mémoire d’encrier, 2009.
- Cronon, William, « Introduction : In Search of Nature », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground : Rethinking the Human Place in Nature, New York / Londres, W.W. Norton & Company, 1996 [1995], p. 23-56.
- Gatti, Maurizio, « Natasha Kanapé Fontaine : un nouvel exotisme innu », entrevue transcrite et éditée par Alice Lefilleul, Littoral, n° 10 (printemps 2015), p. 128-131.
- Giroux, Dalie, « La résistance innue au projet hydroélectrique de La Romaine (2009-2014) : limites légales, politiques et épistémologiques à la contestation politique », dans Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri (dir.), Au nom de la sécurité ! Criminalisation de la contestation et pathologisation des marges, Saint-Joseph-du-Lac, M éditeur (Mobilisations), 2016, p. 65-80.
- Green, Joyce (dir.), Making Space for Indigenous Feminism, Black Point / Londres, Fernwood Publishing / Zed Books, 2007.
- Henzi, Sarah, « Bodies, Sovereignties, and Desire : Aboriginal Women’s Writing of Québec », Québec Studies, vol. 59 (2015), p. 85-106.
- Huberman, Isabella, « Les possibles de l’amour décolonial : relations, transmissions et silences dans Kuessipan de Naomi Fontaine », Voix plurielles, vol. 13, n° 2 (2016), p. 111-126.
- Ingold, Tim, « Hunting and Gathering as Ways of Perceiving the Environment », dans Aaron Gross et Anne Vallely (dir.), Animals and the Human Imagination : A Companion to Animal Studies, New York, Columbia University Press, 2012, p. 31-54.
- Kanapé Fontaine, Natasha, Bleuets et abricots, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016.
- Kanapé Fontaine, Natasha, « Les jours des feux, des tambours et des meutes », dans Laure Morali et Rodney Saint-Éloi (dir.), Les Bruits du monde, Montréal, Mémoire d’encrier, 2012, p. 29-33.
- Killingsworth, M. Jimmie et Jacqueline S. Palmer, « Ecopolitics and the Literature of the Borderlands : The Frontiers of Environmental Justice in Latina and Native American Writing », dans Richard Kerridge et Neil Sammells (dir.), Writing the Environment : Ecocriticism and Literature, Londres, Zed Books, 1998, p. 196-207.
- Lacombe, Michèle, « “Pimuteuat / Ils marchent / They Walk” : A Few Observations on Indigenous Poetry and Poetics in French », dans Neal McLeod (dir.), Indigenous Poetics in Canada, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2014, p. 159-182.
- Larocque, Emma, « Reflections on Cultural Continuity through Aboriginal Women’s Writings », dans Gail Guthrie Valaskakis, Madeleine Dion Stout et Eric Guimond (dir.), Restoring the Balance : First Nations Women, Community, and Culture, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2009, p. 149-174.
- Létourneau, Jean-François, « L’enseignement de la littérature autochtone », Littoral, n° 10 (printemps 2015), p. 52-56.
- Merchant, Carolyn, « Reinventing Eden : Western Culture as Recovery Narrative », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground : Rethinking the Human Place in Nature, New York / Londres, W.W. Norton & Company, 1996 [1995], p. 132-159.
- Papillon, Joëlle, « Repenser les rapports entre humains et nature : visions écopolitiques dans la littérature autochtone contemporaine », Québec Studies, vol. 63 (2017), p. 57-76.
- Pasternak, Shiri, « Terres inoccupées et semences brutes : des doctrines de la découverte aux brevets sur la vie » [en ligne], L’Observatoire de la génétique : cadrages, n° 33 (juin / août 2007) [http://www.omics-ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2007/c_no33_07/c_no33_07_01.html].
- Perrault, Julie, « La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine », Recherches féministes, vol. 28, n° 2 (2015), p. 33-52.
- Sandoval, Chela, Methodology of the Oppressed, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.
- Savard, Rémi, La Forêt vive : récits fondateurs du peuple innu, Montréal, Boréal, 2004.
- Savard, Rémi, Le Sol américain : propriété privée ou Terre-Mère... L’en-deçà et l’au-delà des conflits territoriaux entre autochtones et blancs au Canada, Montréal, L’Hexagone, 1981.
- Schoentjes, Pierre, Ce qui a lieu : essai d’écopoétique, Marseille, Éditions Wildproject (Tête nue), 2015.
- Simpson, Leanne, Islands of Decolonial Love, Winnipeg, Arp, 2013.
- Slater, Candace, « Amazonia as Edenic Narrative », dans William Cronon (dir.), Uncommon Ground : Rethinking the Human Place in Nature, New York / Londres, W.W. Norton & Company, 1996 [1995], p. 114-131.
- Smith, Andrea, Conquest : Sexual Violence and the American Indian Genocide, Cambridge, South End Press, 2005.

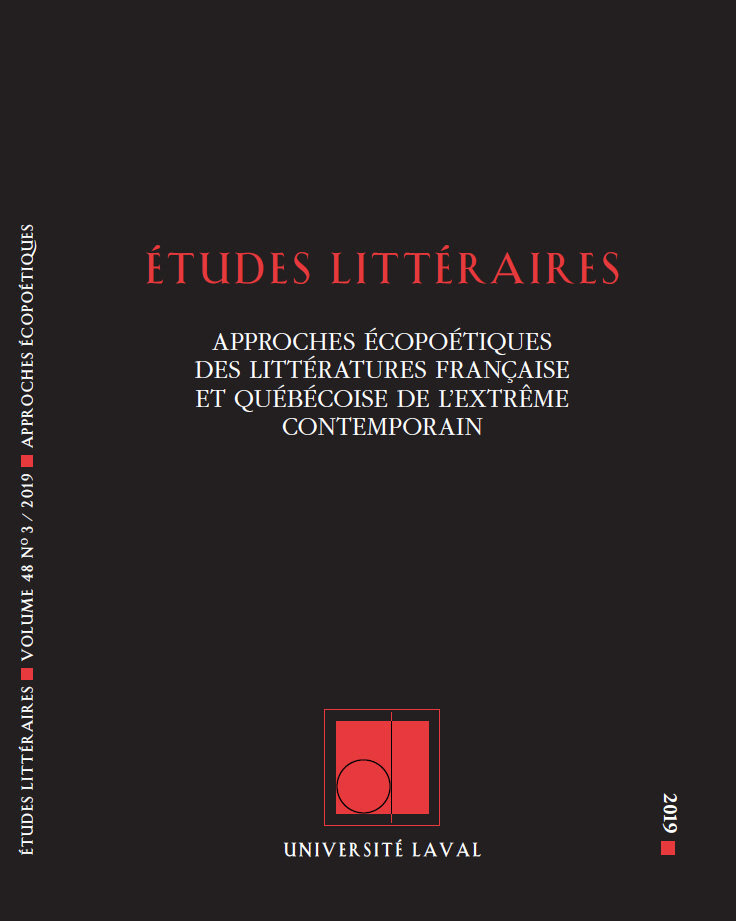
 10.7202/000975ar
10.7202/000975ar