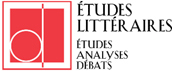Résumés
Résumé
Dans son autobiographie, vers la fin de sa vie, Heiner Müller (1929-1995) reproche à la civilisation occidentale d’être fondée sur les principes de la délégation et de la figuration symboliques. Comme ce sont aussi les principaux mécanismes de la représentation dans les démocraties modernes, on pourrait voir dans cette mise en cause l’équivalent d’une prise de position anarchiste, « un refus d’accorder quelque légitimité que ce soit à la représentation politique » (Uri Eisenzweig). Le principal écrivain de théâtre en RDA depuis la mort de Brecht serait-il donc un anarchiste dans le communisme ? C’est l’examen de ses pièces qui permet d’amorcer une réponse : elles partent souvent de situations d’urgence (guerre ou révolution) dans lesquelles un individu ou un groupe se voit (ou se croit) chargé de tuer d’autres hommes au nom d’une cause, d’un parti ou d’un camp. La « représentation » de l’Autre, la possibilité d’être son mandataire, est alors mise à la question : déléguée à un homme ou à un groupe par un acteur collectif, la violence peut-elle s’exercer d’une manière équilibrée et contrôlée en même temps qu’efficace ? N’a-t-elle pas plutôt immanquablement partie liée à l’aveuglement, à la brutalité, voire à la barbarie ? Et quelles « fins de partie » s’offrent à ceux qui refusent cette délégation : l’« asocialité » ? la trahison ? le sacrifice ? Toutefois, ces textes ne se réduisent pas à illustrer, de façon didactique ou tragique, une casuistique révolutionnaire : la figure de l’auteur y est aussi mise en jeu. Elle tente de se soustraire à la fonction de « porte-parole », de représentant, d’une classe ou d’une cause, mais sans personnifier pour autant un pouvoir propre à la littérature, qui permettrait à celle-ci de redessiner le monde à sa fantaisie. L’auteur est toujours impliqué dans — et divisé par — cette critique de la « représentation », qui a finalement plus à voir avec la dimension totalitaire de la politique qu’avec l’idéologie anarchiste.
Abstract
Towards the end of his life, Heiner Müller (1929-1995) complained in his autobiography about the reliance of Occidental civilisation on the principles of delegation and symbolic figuration. Since these principles are also the main underpinning of the concept of representation in modern democracies, one could construe Müller’s complaint as the expression of an anarchistic viewpoint, “the refusal to acknowledge any legitimacy whatsoever to political representation” (Uri Eisenzweig). Was the DDR’s foremost playwright since Brecht’s demise a communist anarchist? A study of his plays gives a glimpse of an answer: often set in emergency situations (be it a war or a revolution), they showcase a (self delusional) person or group tasked with killing others in the name of a cause, a movement or a side. One can therefore question the validity of “depicting” another or acting on his behalf: can violence, whether delegated to a person or a group by a collective source, be inflicted in a way that is all the while balanced, controlled and efficient? Instead, is violence not always synonymous with blindness, brutality or even barbarism? And would he who declines such a mission end up being cast away from society, branded a traitor or forced to sacrifice himself? However, those writings are not merely didactically or tragically illustrative of a revolutionary case mix, for they also compromise the author’s representation. While this mix may skirt its obligation to speak on behalf of a representative, a class or a cause, it does not embody literature’s particular power to redraw our world according to its own whim. The author is always part of – and torn by – this criticism of “representation”, which ends up dealing more with the totalitarian aspect of politics than with anarchistic ideology.
Corps de l’article
Vers la fin de son autobiographie, Guerre sans bataille, achevée en avril 1992, le dramaturge allemand Heiner Müller (1929-1995) écrit :
Nous vivons dans une civilisation de la substitution [Stellvertretung], la civilisation chrétienne est la civilisation de la substitution, de la délégation [Delegierung], un pour tous, un seul homme est pendu sur la croix pour les autres[1].
Et quelques paragraphes plus loin : « Notre civilisation est une civilisation de la substitution [Stellvertretung]. Et la représentation [Repräsentation] entraîne nécessairement la sélection, Auschwitz et Hiroshima sont des produits finaux de la pensée sélective[2] ». Nous voudrions réfléchir à la signification de ces propos en partant du livre d’Uri Eisenszweig sur l’anarchisme. Rappelons que, pour lui, « la distinction véritablement fondatrice, c’est-à-dire fonctionnelle » de l’anarchisme consiste en « un refus d’accorder quelque légitimité que ce soit à la représentation politique[3] ».
N’est-ce pas ce que fait Müller dans ce discours surprenant ? Il remet en cause, pour les effets catastrophiques qu’il leur attribue lors de la Seconde Guerre mondiale, les mécanismes fondamentaux de la représentation dans les démocraties modernes : le mandat ou la délégation (die Stellvertretung, die Delegierung) et la figuration symbolique (die Repräsentation), trois mots qu’il n’a pas choisis au hasard[4]. Laissons de côté le fait qu’il les inscrive sans discussion dans l’héritage du christianisme et de la relation qui, par le mystère de la Rédemption, unit le Christ et les pécheurs, comme si, avec l’avènement de la démocratie moderne, les sociétés occidentales ne sortaient pas irrévocablement de l’ordre chrétien. Ignorons la manière presque subreptice dont il déduit le principe de sélection des deux autres. Négligeons même qu’en jumelant comme il le fait — et il est loin d’être le seul, Brecht l’a fait avant lui — les noms d’Auschwitz et d’Hiroshima, il semble laisser de côté le régime politique et social sous lequel il a passé la plus grande partie de sa vie : le communisme, la deuxième des deux dictatures mentionnées dans le titre complet de son autobiographie, Vie sous deux dictatures. Ne regardons que l’argument choisi. D’habitude, la pensée socialiste (dont Müller pourrait se sentir proche) accuse la démocratie de nourrir l’illusion de l’égalité et de rendre ses partisans aveugles aux inégalités qu’elle entretient. Mais ici, la critique va beaucoup plus loin : c’est un rejet massif de la médiation dans l’ordre du politique — et davantage : de la politique comme facteur essentiel de médiation dans les affaires humaines. Si bien qu’on peut se demander si Müller ne se réclame pas, sans le dire, d’une inspiration anarchiste. Et si son oeuvre, qui a lié avec tant de force littérature, esthétique et politique, ne devrait pas être finalement située à la suite de Proudhon, de Stirner et de Malatesta. Au XIXe siècle, certains anarchistes ont d’ailleurs, en raison de leur rejet virulent de la représentation démocratique et de la médiation politique, été attirés par des idéologies ultraréactionnaires ; on pourrait dès lors, en songeant à leur cas, s’expliquer pourquoi Müller a pu, lui aussi, se voir parfois reprocher une idéologie dangereusement proche de celle de l’extrême droite. De toute manière, c’est une position assez incommode pour un écrivain qui a passé — volontairement — l’essentiel de sa vie (entre sa vingtième et sa soixantième année) sous un régime comme celui de l’Allemagne de l’Est.
A-t-on le droit, cependant, de choisir les deux phrases citées et de faire comme si elles résumaient sa pensée politique, sous prétexte qu’elles sont à la fin d’un livre dans lequel, trois ans avant sa mort, il fait le bilan de son expérience d’écrivain et de ses rapports avec l’ex-RDA ? Pour répondre, notons d’abord que, bien qu’elles partent de La chute de l’égoïste Johann Fatzer, une pièce de Brecht datant de 1930, ces thèses ne sont pas de pure circonstance ; elles sont reliées à d’autres moments de sa réflexion auxquels il serait trop long de renvoyer ici. En tout cas, dans cette pièce restée inachevée et qu’il a lui-même tenté d’adapter en 1978, Müller voit l’apparition de trois des figures politiques majeures du XXe siècle et de sa propre oeuvre : « Koch le terroriste, Fatzer l’anarchiste, Koch / Keuner : l’association de la discipline et de la terreur[5] » (c’est-à-dire le bolchevisme, tout particulièrement dans son avatar stalinien). Et c’est à propos des deux premiers — Koch fait exécuter Fatzer — qu’il en vient à écrire la phrase par laquelle on a commencé. Résumons le raisonnement de Müller : s’il a tenté d’adapter Fatzer, en 1978, c’est en pensant à la Fraction Armée Rouge, dont l’histoire s’était achevée l’année précédente.
Mon point de référence à ce moment-là était la RAF. La partie finale se lit comme un commentaire de l’histoire de la RAF, le rapport du collectif, de la discipline, aux déviants. Il y a eu sans cesse dans l’histoire de la RAF des situations dans lesquelles un déviant était exécuté. Cela fait partie de l’aspect tragique des groupes militants qui n’ont pas la possibilité d’agir : la violence se tourne vers l’intérieur[6].
Toutefois, les gens du groupe de Baader n’ont pas tué que des leurs. Müller, un peu plus loin, élargit donc le propos en citant ce que dit Koch chez Brecht (dans la partie du texte intitulée « Chapitre de la mort ») : « Ne soyez pas hautains, frères / mais humbles et ne tuez pas / hautainement, mais : inhumainement[7] ». Il le commente ainsi : « Cette association de l’humilité et du meurtre est un point central du texte de Fatzer et, à l’origine, de l’idéologie de la RAF. Des gens qui doivent se forcer à tuer[8] ». Mais pourquoi doivent-ils se forcer à tuer ? Réponse : « En fait, la violence politique est discréditée par le fait que c’est l’État qui a pris en charge le meurtre, l’a bureaucratisé par le monopole étatique de la violence[9] ». Et c’est tout de suite après qu’apparaît la phrase sur la civilisation (qui serait la nôtre) de la délégation et de la représentation. On comprend alors que les membres de la Fraction Armée Rouge ont agi comme ils l’ont fait parce qu’ils refusaient de déléguer à l’État (ou à toute autre forme d’organisation politique) l’exercice de la violence extrême : « Le coeur du problème est que l’on puisse penser le meurtre. Quand on le considère comme nécessaire, on n’a pas le droit de ne pas le faire soi-même : ce n’est que déléguer ses pouvoirs, ce serait immoral[10]. »
Or il se trouve que Fatzer n’est pas isolé, Müller prend soin de le préciser : « Des gens qui doivent se forcer à tuer. C’est de cela aussi qu’il est question dans Mauser et dans La décision[11] ». Il s’agit de deux pièces, la sienne, Mauser (1970), et celle de Brecht, La décision (1930), où des exécutions, massives ou individuelles, sont ordonnées ou approuvées par un choeur communiste. En dehors de Mauser, on sait que ce thème — tuer pour des raisons politiques — se retrouve chez lui dans Ciment (1972), La bataille (1975) ou La mission (1980), pour ne citer que des titres très connus. Au chapitre suivant de son autobiographie, Müller revient sur un texte antérieur, Philoctète (1965), qu’il baptise « une traduction de Sophocle en romain, une version plus étatique », pour dire qu’Ulysse y exerce la violence politique au nom d’un collectif plus large, l’armée grecque. Dans ce texte, dit-il, « la machine tranche plus profondément dans le vif et tient même les morts en main[12] ». C’est donc une bonne partie de son théâtre, et notamment celle qui conduit à s’interroger sur la place du tragique, qui est concernée par cette critique de la délégation et de la figuration politiques.
On pourrait ajouter, toujours pour répondre à l’objection faite plus haut, que la réflexion de Müller sur ce point ne date pas des dernières pages de son autobiographie. Une autre idée importante, celle de la sélection, aboutissement catastrophique, selon lui, de la conception moderne de la politique (c’est-à-dire de la « démocratie représentative »), a pris forme antérieurement. Dans un entretien, peu après la chute du Mur, en juillet 1990, il fait du héros de Crime et châtiment, Raskolnikov, l’un des premiers grands représentants de cette idée funeste. Pour lui, Crime et châtiment a été « écrit contre le principe Auschwitz » et Auschwitz symbolise « le stade ultime des Lumières[13] ». L’oeuvre de Kafka et celle de Faulkner sont pour lui des tentatives, succédant à celle de Dostoïevski, pour résister à l’emprise de cette idée. Pendant cette période du « Tournant » (die Wende) — alors qu’il substitue progressivement à ses références antérieures, généralement marxistes, une forme de radicalité philosophique puisée à diverses sources —, il souligne aussi un principe qu’il a commencé d’évoquer vers 1982 : le refus de parler au nom d’autrui, d’exercer un mandat, réel ou imaginaire, qui lui serait confié par une catégorie sociale ou une cause collective déterminées[14]. Et donc, bien entendu, le rejet de toute écriture engagée ou militante.
Enfin, cette critique de la délégation et de la figuration n’est pas réservée à la politique. Il arrive parfois que Müller intente un procès, qu’on peut trouver bizarre chez un écrivain, aux nécessités littéraires de la composition ou de la recherche formelle. À la médiation des formes qui aident à capter et à déchiffrer le monde sensible, il préfère parfois le fantasme d’une saisie immédiate de ce dernier. Comme il le reconnaît à la fin de son autobiographie, « écrire à la vitesse de la pensée reste un rêve d’écrivain[15] ». Ce texte en porte d’autres traces. C’est notamment Shakespeare, lu à travers Gertrude Stein, qui personnifie cet idéal de vitesse et de mouvement qu’il poursuit souvent[16] ; Brecht, lui, reste en arrière ; du reste, Shakespeare est un antidote à la simplification qui a parfois tenté Brecht et ses successeurs[17]. Une autre ressource est le rêve, phénomène qui n’est pas lié par une logique temporelle et causale et qui se caractérise notamment par la vitesse où défilent les événements :
La structure narrative des rêves m’a toujours intéressé, l’absence de lien, la neutralisation des rapports de causalité. Les contrastes créent une accélération. Toute la difficulté de l’écriture, c’est d’atteindre la qualité de ses propres rêves, et aussi l’indépendance [vis-à-vis] de l’interprétation.
Et Müller ajoute : « Les meilleurs textes de Faulkner ont cette qualité. […] Quand on lit Faulkner, on lit un fleuve. Ses hommes sont des paysages[18]. » Le rêve — l’élément apparemment anarchique de la vie psychique — et le paysage, du moins tel que Müller le conçoit à partir de son premier voyage aux États-Unis en 1975, c’est-à-dire l’élément anarchique de l’établissement humain, sont deux phénomènes dont l’écriture devrait s’efforcer d’atteindre la qualité. L’impulsion anarchiste qui se donne libre cours dans la critique de la médiation politique porte donc parfois aussi contre l’élaboration consciente et contrôlée des oeuvres : « Quand on écrit, c’est le texte qui prend la direction[19] ».
⁂
En fait, l’objection véritable à cette idée de la délégation et de la figuration, qui seraient, avec la sélection, les trois sources du mal politique moderne, c’est-à-dire la démocratie, c’est l’oeuvre de Müller qui la formule. Tout d’abord, le mandat et la figuration symbolique n’y sont pas rejetés par principe, notamment dans les situations d’extrême urgence, mais mis en question. Dans Horace (1968), Rome y recourt dans la guerre contre Albe, en choisissant un seul combattant pour la représenter, et le fait que celui-ci tue ensuite sa propre soeur ne remet pas en cause ce choix initial. De même, issu de la délibération du peuple, le verdict contre Horace, sauveur de sa patrie et auteur d’un parricide, constitue un exemple qui doit empêcher la cité de sombrer dans le « méconnaissable (das Unkenntliche)[20] » : le peuple dit le droit, au moins provisoirement, sur les relations qu’il veut avoir avec le combattant qui le représente.
Faire un exemple est aussi le but poursuivi, en pleine guerre contre les Allemands, fin 1941, par deux officiers subalternes de l’armée soviétique qui, dans Ouverture russe (1983-84) puis Forêt de Moscou (1984), prennent seuls une responsabilité grave : le premier de faire fusiller un soldat qui s’est mutilé au moment d’une attaque simulée, l’autre de dégrader un médecin qui a abandonné les blessés dont il avait la charge, mais qui est son supérieur. Le second de ces deux protagonistes agit d’ailleurs, beaucoup plus nettement que le premier, au nom d’un mandat qu’il estime avoir reçu de sa patrie soviétique, dont sa compagnie, décimée par la bataille, est peut-être le dernier représentant. Et le médecin auquel il s’affronte n’est pas seul en cause ; la véritable cible de l’officier-narrateur est Staline, responsable du désastre militaire que le pays subit alors : c’est la capacité à représenter le socialisme — ou, au contraire, à en usurper et à en confisquer la représentation — qui est en cause, non la médiation comme telle. Non seulement les choix militaires de Staline apparaissent erronés, mais ils se révèlent étroitement liés à la terreur qu’il a fait régner avant l’invasion allemande, à la « guerre de paperasses » qu’il a menée contre le peuple russe à partir des bureaux ; cette guerre visait à incorporer toute la société à un système constrictif et c’était une « guerre par procuration », ou « de substitution » (Stellvertreterkrieg), qui se trompait délibérément d’ennemi[21]. La même dénonciation est reprise dans deux autres pièces de la même série, Le duel (1986) et L’enfant trouvé (1987), où le pouvoir communiste, en RDA cette fois et dans les années 1950 et 1960, est accusé de démoraliser ses vieux militants et de traiter la jeunesse non embrigadée en ennemie du régime.
Toutefois, ce que veut le protagoniste de Forêt de Moscou — distinguer entre une délégation abusive et nuisible et une représentation légitime, voire désirable, car il ne s’agit pas seulement pour lui de sens du devoir, mais d’un véritable transport d’amour, et d’amour désespéré, à l’égard de sa patrie menacée —, d’autres personnages le refusent par principe. L’un des principaux foyers du drame chez Müller se trouve là où les représentants (au sens large) d’un parti, d’un camp, d’un groupe social se heurtent, quels que soient leurs arguments, à un adversaire qui se révèle et s’affirme imperméable à leurs raisons aussi bien qu’à leurs moyens ; à la parole oratoire qui cherche à le persuader, cet adversaire oppose une « asocialité » extrême : haine de toute forme d’organisation et de commandement, souci exclusif de la survie individuelle, instrumentalisation des outrages subis pour dérégler toute relation politique. Tel est Philoctète, héros de la pièce qui contient sans doute les dialogues les plus vigoureux et les plus désespérés du théâtre de Müller ; abandonné dix ans plus tôt par Ulysse sur l’île inhospitalière de Lemnos, il refuse de le suivre à Troie pour l’aider à faire tomber la ville : sa haine d’Ulysse s’est étendue à tout ce qui est grec et il souhaite la défaite du camp qui devrait être le sien[22]. Dans Ciment, par son refus de continuer la vie conjugale comme avant la révolution, Dacha, militante bolchevique, introduit dans la reconstruction du pays, à la fin de la guerre civile, une forme d’émancipation libertaire (et apparemment sans issue), qui dérègle un autre système de représentations : celui non d’une cité en guerre, mais du mariage. Après de vifs affrontements, elle quitte son mari, bien qu’ils soient tous deux des militants d’un même parti. Dacha, comme Philoctète, refuse d’endosser le rôle (politique ou social) qu’on veut lui faire jouer — sans savoir, pour autant, vers quoi elle s’oriente. On pourrait ajouter, dans Hamlet-machine (1977), le personnage principal qui ne veut plus jouer le rôle du vengeur et celui de l’interprète d’Hamlet qui ne veut plus jouer le rôle du tout. On retrouve ainsi la question, déjà soulevée, du créateur qui, sur le plan esthétique, refuse de représenter quiconque et rêve même d’inventions qui réduiraient ou élimineraient la part de sa subjectivité dans la création ; de façon significative, le passage d’Hamlet-machine où apparaît le refus de jouer plus longtemps le rôle du prince de Danemark est aussi celui où se trouve exposée sur la scène, puis « mise en pièces », la photographie de l’auteur.
Un second foyer de tension dramatique vient des personnages qui, au contraire, jouent si bien leur rôle, c’est-à-dire s’identifient (ou s’incorporent) si étroitement au camp, au groupe ou à l’institution qu’ils représentent, que les mécanismes de la délégation et de la figuration sont gravement déformés. Dans Philoctète, Ulysse et Néoptolème, les deux envoyés des Grecs auprès du héros éponyme, sont prêts à user envers celui-ci de la ruse et, éventuellement, de la force, alors qu’il est en principe un des leurs et qu’ils ont terriblement besoin de lui contre les Troyens ; finalement, au nom des intérêts de son camp, Néoptolème devra tuer Philoctète, qu’il estime, pour défendre Ulysse, qu’il hait. Dans La mission, les trois personnages principaux, émissaires clandestins de la Convention à la Jamaïque, doivent endosser un rôle social, qui heurte leurs convictions et qui restaure entre eux — au nom des intérêts de la Révolution — des relations propres à l’Ancien Régime qu’ils ont abattu en France.
Encore Ulysse et Néoptolème sont-ils seuls sur l’île de Lemnos et ont-ils le temps de forger, pour les autres Grecs, une version de la mort violente de Philoctète qui les blanchira complètement ; de même, loin de Paris, les trois émissaires peuvent débattre librement pour savoir s’ils doivent poursuivre ou non leur mission. La pression dramatique est en revanche beaucoup plus forte là où la relation des délégués à leur organisation est celle des membres d’un grand corps qui doit obéir à la même tête ou des pièces d’une machinerie qui ne tolère pas de jeu. Ainsi, dans Mauser, le personnage nommé A est-il le bras armé du parti, l’espace de sa délégation est juste celui qui sépare son doigt de la détente de son pistolet ; dans Forêt de Moscou, l’officier n’est qu’ « une petite roue et une vis / Dans notre ordre soviétique[23] ». Les personnages de La mission et de Philoctète dont nous parlions plus haut s’exposaient à devenir méconnaissables à eux-mêmes et aux autres : ainsi Néoptolème, de « fils d’Achille » devenu au vers suivant « fils de personne[24] » (c’est-à-dire aussi d’Ulysse, qu’il déteste cependant), ou Debuisson se détournant de la vision de l’ange de la résurrection en disant : « Je ne veux plus savoir tout cela[25] ». En revanche, les personnages attachés à une organisation où domine la discipline la plus stricte n’ont, pour la plupart, pas d’issue ; leur défaillance a lieu sous l’oeil d’un parti très présent : l’exécuteur A outrepasse sa mission par excès de cruauté, alors que son prédécesseur B l’a enfreinte par compassion, l’un et l’autre doivent être liquidés ; car si A n’a pas montré de faiblesse personnelle, il personnifie, par sa violence, la faiblesse du dispositif collectif. Et il faudrait envisager un cas supplémentaire : les personnages des deux grands récits qui se trouvent interpolés, sans transition ni commentaire, dans Ciment et La mission : « Héraclès 2 », le chasseur de l’hydre découvrant qu’il est lui-même le monstre qu’il poursuivait, ce qui ruine le « travail » dont on l’avait chargé (tuer la bête) ; et l’employé de ministère, empêché, par un ascenseur devenu fou, de recevoir une mission précise de son supérieur et jeté ensuite dans un pays du tiers monde, où, faute de perspective, il est enfermé dans l’inaction, le silence et la peur. Ce dernier récit est sans doute la plus belle version que Müller ait donnée des impasses de la médiation politique.
Impasse, pourtant, ne veut pas dire pour Müller refus de toute médiation. On en trouve plus d’un indice dans ses réflexions, ses entretiens et ses pièces (même si tous ces textes ne peuvent être abordés de la même façon). Par exemple dans Anatomie Titus (1983-1984), une réécriture de Titus Andronicus de Shakespeare, Müller dit avoir voulu montrer l’affrontement d’une politique européenne et d’une politique tropicale, celle-ci étant définie ainsi : « une politique concrète au sens le plus sanglant du mot, qui s’inscrit dans les corps sans traduction par des institutions ou des appareils[26] ». Ce refus sanglant de la médiation et cette inscription directe de la politique à même la chair éveillent irrésistiblement le souvenir de l’instrument de supplice du récit de Kafka, Dans la colonie pénitentiaire, dont Müller a donné, en 1992, une version destinée au théâtre[27]. Dans ce cas, toutefois, la « politique tropicale » est une politique coloniale, et celui qui l’a conçue et celui qui l’applique, l’ancien commandant et l’officier, sont des Européens. En revanche, dans Anatomie Titus, et dans un entretien fait en RFA au début de 1980, le refus de médiation caractérise pour lui des mouvements qui ont succédé aux messianismes révolutionnaires dans les pays du tiers monde ; pour cette raison, il les appelle parfois « anarchistes » ; ainsi, dans l’une des rares références qu’il fasse à la révolution iranienne, il parle de « mouvements de libération qui, vus par nous, sont complètement anarchistes ou absurdes, Khomeini ou quoi que ce soit d’autre… (die von uns aus gesehen völlig anarchischen oder absurden Befreiungsbewegungen. Khomeini oder was immer…)[28] ».
Cette remarque nous permet de revenir sur son intérêt passionné, dans les années 1970, comme on l’a vu plus haut à propos de Fatzer, pour les groupes qui, en Europe occidentale ou aux États-Unis, recouraient en leur propre nom à la violence, et notamment à l’assassinat politique, refusant de déléguer celui-ci ou d’attendre la Révolution pour agir. La proximité qu’ils ont voulu avoir avec leurs victimes, c’est ce qui le fascine dans l’évolution du petit groupe de déserteurs qui s’est formé autour de Fatzer, chez Brecht, et dans l’appel final du personnage qu’on a déjà cité : « Ne soyez pas hautains, frères / mais humbles et ne tuez pas / hautainement, mais : inhumainement[29] ». Dans une formule saisissante, Müller commente en 1992 : « Tuer, avec humilité, est le noyau théologique incandescent du terrorisme[30]. » Ainsi, après avoir repéré des formes d’anarchisme dans des mouvements politiques qui se veulent d’inspiration religieuse, comme la révolution iranienne, il en vient, douze ans plus tard (dans son autobiographie) à déceler une dimension religieuse dans un mouvement au départ anarchiste, comme celui de Fatzer. Le vrai point commun de ces deux mécanismes, terrorisme et « politique tropicale », est toutefois qu’ils cherchent à lier les individus sans passer par des lois, des institutions, des formes de « traduction par les institutions et les appareils » ; et que, dans les deux cas, les conséquences sont sanglantes. Müller a beau trouver hypocrite, dans son autobiographie, qu’on s’indigne du terrorisme en Europe, il ne s’en est pas moins fixé à son égard un but déterminé : « Arracher l’utopie au terrorisme », selon le titre d’un entretien fait peu après la chute du Mur. En effet : « Le terrorisme est le seul ordre monastique qui procède pour le moment de l’utopie et, en même temps, la consume[31]. » Force est alors de constater que sa dénonciation du christianisme et de la démocratie ne lui a pas inspiré de sympathie politique pour le terrorisme ou l’islamisme radical.
Pourtant, c’est à l’époque même de sa réflexion sur Fatzer et sur le groupe Baader-Ensslin-Meinhof qu’il invente deux personnages qui incarnent avec une extrême rigueur le refus apparent de toute médiation. Dans Hamlet-machine, Ophélie appelle au déchaînement d’une violence généralisée : « Vive la haine, le mépris, le soulèvement, la mort[32] ». À la fin de La mission, l’ancien esclave Sasportas choisit de mourir dans un soulèvement sans espoir et dit : « Je vais au combat armé des humiliations de ma vie[33] » (l’humiliation armait déjà le bras de Koch dans Fatzer). Toutefois, l’un et l’autre font encore comme s’ils étaient des porte-paroles : Sasportas en appelle à deux sortes de complices, « les nègres de toutes races, dont le nombre croît à chaque minute[34] » et les morts qui ressusciteront pour combattre à la place des vivants ; Ophélie s’adresse « aux métropoles du monde » et s’exprime « au nom des victimes (im Namen der Opfer)[35] ». Même dans leur extrémisme, ces deux personnages ne sont pas tout à fait étrangers à la médiation politique et à la politique comme médiation.
⁂
Encore faut-il dire un mot de cet anarchisme extrême. Sasportas et Ophélie ont en commun avec la plupart des personnages de Müller qu’on a cités jusqu’à présent d’avoir été marqués dans leur corps par la politique ou la guerre ; du guerrier grec aux officiers et aux soldats de l’armée soviétique en 1941, de l’esclave affranchi par la Révolution à l’exécuteur du tribunal révolutionnaire de Vitebsk (dans Mauser) ou à la bolchevique Dacha, violée dans un cachot par les Blancs, tous portent à même la chair les plaies ouvertes, les cicatrices ou la mémoire douloureuse de la politique et ou de la guerre, quel que soit le camp ou la cause qu’ils représentent, quel que soit le mandat qu’ils ont accepté ou qu’on leur a imposé — et les blessures et les cicatrices ne leur ont pas toujours été infligées par l’adversaire. Aussi quand Ophélie parle « sous le soleil de la torture » ou que Sasportas veut s’inscrire dans « le soulèvement des morts » et « la guerre des paysages », c’est d’abord pour tenter de se défaire des idées auxquelles on a voulu les lier, dans leur corps plus encore que dans leur esprit. (En ce sens, et même s’il exècre l’exil, auquel il pourrait mettre un terme en acceptant le plan d’Ulysse, Philoctète apparaît, dans sa tentative forcenée de refuser tout mandat des Grecs, comme parfaitement emblématique de l’oeuvre de Müller). On est tenté de dire de ces personnages qu’ils choisissent, dans un contexte fictionnel, ce que Jacques Rancière appelle une « identification impossible », située elle-même dans un processus plus large de « subjectivation politique[36] ». Opérer un tel choix, c’est d’abord refuser une identité imposée par la parole des autres ; en ce sens, Ophélie rejette aussi bien le féminisme que la suprématie masculine contre laquelle elle n’a cessé de se révolter, et Sasportas aussi bien les changements de cap de la Révolution, qui l’a pourtant affranchi, que le retour à la société coloniale d’avant 1789.
Prendre en compte une telle identification permet de voir que d’autres personnages, réputés pour leur part « défaillants » (Versager) ou traîtres, ont cherché aussi cette subjectivation politique et ont échoué. Et ils ont pu mettre dans cette recherche autant de passion que pour un objet érotique. Le personnage féminin de PremierAmour ne s’y trompe pas, qui révèle la désillusion amoureuse de Debuisson à l’égard de la révolution, après toutes les années où il s’est trouvé passionnément uni à elle. Les Noirs, quant à eux, dit Sasportas, partagent encore cette passion à l’heure où les Blancs la rejettent pour se jeter dans les bras de Bonaparte. Ainsi Debuisson peut être conduit à la trahison, Sasportas au suicide, d’autres au dégoût (l’interprète d’Hamlet[37]). C’est pourquoi, si l’on ne réduit pas la démocratie à la mise au point des mécanismes qui assurent la représentation légitime et égalitaire des divers groupes de la société, mais qu’on s’intéresse à l’ouverture qu’elle offre aux formes de la subjectivation, telle que l’entend Rancière, les personnages de l’oeuvre de Müller sont des enfants de l’âge démocratique. Et même si leur auteur, comme on l’a vu, condamne celui-ci avec véhémence.
Toutefois, cette interprétation est insuffisante. Si l’identification impossible est aussi une façon d’en appeler à une communauté plus vaste, où faire entrer ceux qui étaient exclus jusque-là de la société visible, on ne voit nullement chez Müller la figure que pourrait prendre un collectif nouveau de ce genre. D’où le destin funeste des personnages de La mission, comme on vient de le voir. D’où aussi l’embarras de certains commentateurs : pour eux, si Ophélie ou Sasportas parlent au nom d’un groupe plus large, il convient d’identifier, à travers celui-ci, un acteur historique réel, groupe social ou mouvement politique. On essaie alors d’ajuster Sasportas aux Black Panthers ou à un courant du tiers-mondisme révolutionnaire et Ophélie à une forme extrême de féminisme, voire, puisque le dispositif de citations et d’allusions construit par Müller y incite, aux disciples de Frantz Fanon, aux membres de la Fraction Armée Rouge, ou aux complices de Charles Manson. Ces efforts sont voués à l’échec. L’« identification impossible » est bien un moment du drame, un élément de la fiction conçue par Müller, mais son horizon n’est pas celui de la « subjectivation politique ». Les corps individuels tentent de se soustraire à ce qui les marque, non de s’insérer dans de nouveaux corps collectifs, dans lesquels les formes anciennes de représentation et de mandat seraient transformées ou éliminées.
Cela ne veut pas dire que l’oeuvre littéraire serait complètement étrangère aux opinions politiques de l’auteur : on ne peut que croire Müller quand il dit avoir réécrit Fatzer en pensant à la place que la Fraction Armée Rouge avait alors dans l’actualité. Et il serait risqué d’affirmer que l’effet de ses pièces est étranger au choix de ses sujets : chez un auteur comme lui, la politique est le premier des matériaux et l’on ne peut s’en abstraire. En revanche, il est clair que le mouvement par lequel son écriture tend à attirer, parfois à happer, les lecteurs et les spectateurs compte plus d’un trait surprenant par rapport aux formules déjà connues et éprouvées. Ainsi, pour évoquer la Révolution russe ou la Révolution française, Ciment et La mission confrontent, sans transition ni explication, les faits de l’action à des événements d’autres époques, contemporains et bureaucratiques dans la seconde des deux pièces (un employé de ministère prend l’ascenseur pour se rendre à une convocation de son chef et s’aperçoit que l’espace et le temps se dérèglent irrémédiablement), antiques et mythologiques dans Ciment (Héraclès marchant sur les traces de l’hydre de Lerne pour affronter celle-ci) ; chacun de ces segments anachroniques imbriqués dans le temps de l’action a de plus un registre propre : ici une transposition sérieuse d’Homère ou d’Eschyle, là un pastiche de Kafka ou d’un récit de science-fiction. Du coup, la scène de l’écriture affirme sa primauté sur celle de la représentation et le spectateur ne peut plus s’immerger commodément dans un monde inventé dont la cohérence et la stabilité sont ouvertement ébranlées.
Une autre tradition littéraire remise en cause est celle de la « disparition » de l’auteur dans le drame, comme Müller l’appelle, et qui, selon lui, « conduit facilement à la routine, à la répétition mécanique[38] » ; plusieurs de ses pièces tentent de la dénoncer en mettant — de façon claire ou allusive — leur propre action en rapport avec des moments de sa propre vie (ainsi l’apparition de sa propre photographie) ; en accueillant des commentaires à la première personne sur l’action ou sur l’écriture dramatique ; ou encore en composant les épisodes secondaires enchâssés dans l’action (l’hydre de Lerne ou l’homme de l’ascenseur) de manière qu’ils puissent être lus aussi comme des « paraboles » du travail de l’écrivain ou de l’oeuvre.
Par là, Müller évite de prendre place dans un réseau de communication déjà déterminé, il se cherche des spectateurs encore inconnus : « en 1977 je connais mon destinataire moins qu’autrefois[39] », déclare-t-il dans une lettre devenue célèbre. Son écriture ressemble à la trajectoire de l’homme de l’ascenseur, qui ne peut plus se réclamer de l’ordre d’un supérieur pour accréditer sa mission et se plaint comiquement d’avoir été entraîné sur de mauvais chemins par des lectures néfastes : « Pourquoi n’ai-je pas écouté à l’école. Pourquoi ai-je lu les mauvais livres : poésie au lieu de physique[40] ». Là où l’ascenseur fou le dépose, au Pérou, il ne sait ni à qui s’adresser ni comment, son sort semble suspendu à l’attention qu’il pourra ou non capter. Cet égarement est déjà celui du chasseur de l’hydre dans Ciment : son plan initial est contrarié, puis détruit, par ce qui lui arrive en route, alors qu’il tente de conserver aux choses « un nom tiré d’un vieux livre[41] ». On songe à cette dimension de la littérature moderne que Jacques Rancière a étudiée dans ses derniers livres : « l’écriture nue, la parole muette et bavarde qui s’en va rouler de droite et de gauche, au hasard de l’attention flottante que portent à la page écrite des lecteurs sans qualités[42] ». Mouvement déjà dénoncé comme anarchique par Platon et qui resurgirait dans la littérature au moment où celle-ci se détache du régime poétique et représentatif qui l’a régie durant des siècles. Mouvement qui s’identifie aussi, sur un autre plan, à celui de la lutte pour l’émancipation : par des détours qui ne sont pas étrangers l’un à l’autre, politique et littérature redessinent le monde sensible.
S’ils ne sont pas étrangers l’un à l’autre, ils ne coïncident pas pour autant. Dans Ciment, l’errance du chasseur, l’incertitude de ses contacts avec le sol et la confusion finale de son corps avec celui du monstre s’écartent nettement de la trajectoire très finalisée de tous les autres personnages de la pièce, tendus vers la victoire militaire, la reconstruction de la cimenterie (et l’abattage préalable de la forêt) et le changement de leur vie privée. Dans La mission, le voyage imprévu de l’homme de l’ascenseur et ses épisodes mi-fantastiques mi-burlesques altèrent aussi l’image de la mission révolutionnaire montrée en parallèle, image qui donne plus d’importance à l’origine et à la destination symboliques de la mission (la représentation) qu’à leur contrepartie réelle (la simple délégation). Dans la nouvelle d’Anna Seghers dont Müller s’est inspiré, cette image prévaut encore. Du fait que leur histoire est reconstituée et transmise, les représentants de la République (le traître mis à part) rejoignent, une fois morts, le cercle des révolutionnaires qui ont sacrifié leur vie ; et, grâce au souvenir qu’en gardent les vivants, leur échec peut faire signe vers l’avenir : la révolution de 1917.
Tel n’est plus le cas chez Müller. Cette communauté des morts et des vivants, dont rêve aussi dans Ciment le personnage de Tchoumalov : « Nous aussi les communistes / Il faudra encore que nous libérions nos morts[43] », l’écrivain a dit lui-même, dans son autobiographie, quelle forme elle avait prise en RDA : un culte officiel que la société devait rendre aux victimes du nazisme et qui la rendait « prisonnière de ses morts[44] ». Sur ce point, une fois encore, sa création n’est pas étrangère à ses vues politiques personnelles, notamment sa conviction que ni le marxisme ni le communisme n’ont été capables de concevoir ce qu’avait été le nazisme. Mais ce sont les détours insolites de l’action dans Ciment et La mission ou, dans d’autres pièces, la figure de la suicidée qui montrent combien il est difficile de respecter à la fois les vivants et les morts, à plus forte raison quand ces derniers ont connu un sort inhumain.
On comprend que Müller ait encouru la méfiance des fonctionnaires et des idéologues, parfois même la surveillance policière. Ses inventions d’écriture se soustrayaient aux tracés officiels pour ouvrir des voies apparemment capricieuses, vagabondes, risquées. L’action de ses pièces ne donnait pas l’image attendue, d’apparence unanimiste, des luttes révolutionnaires ou des grands travaux de construction du socialisme. Là est le véritable « anarchisme » de Müller, bien plus que dans sa critique de la délégation ou de la représentation. Car il ne suffit pas de condamner d’un trait de plume la médiation démocratique pour échapper à l’aventure de la démocratie, qui ne se sépare pas ici de celle de la forme dramatique ; l’une et l’autre sont liées chez Müller, comme chez tout écrivain moderne, au mouvement qui ébranle le partage du monde commun et cherche à l’ouvrir à de nouveaux possibles.
Parties annexes
Note biographique
Jean-Pierre Morel a publié Le roman insupportable (Paris, Gallimard, 1985), Heiner Müller. L’hydre et l’ascenseur (Strasbourg, Circé, 1996), Dos Passos. Multiplicité et solitude (Paris, Belin, 1998), trois livres consacrés aux rapports entre littérature et révolution au XXe siècle. Il a coédité, avec Jascha David, Le siècle de Kafka (Paris, Centre G. Pompidou, 1984), présenté Le procès et Le château de Kafka (Gallimard, Foliothèque, 1998 et 2007) et il a co-organisé le colloque Kafka de Cerisy (juillet 2010). Il a traduit des textes de Brecht (L’Arche), Marina Tsvetaeva (Actes Sud) et Heiner Müller (Éditions de Minuit, Christian Bourgois Éditeur, L’Arche, Théâtrales). Récemment, il a participé au Dictionnaire Albert Camus (Paris, Robert Laffont, 2009), coédité Dans le dehors du monde : exils d’écrivains et d’artistes au XXe siècle (Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2010) et préfacé Varia de Danilo Kiš (Paris, Fayard, 2010). Il est professeur émérite de littérature comparée à la Sorbonne nouvelle — Paris 3.
Notes
-
[1]
Heiner Müller, Werke 9 : Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiographie, 2005 [1992], p. 244 ; Guerre sans bataille. Vie sous deux dictatures. Une autobiographie, 1996, p. 265. Pour chaque texte cité, référence sera faite, pour le texte allemand, à l’édition Suhrkamp en 12 volumes et, pour le français, aux traductions existantes.
-
[2]
Ibid., p. 246 ; p. 267.
-
[3]
Uri Eisenzweig, Fictions de l’anarchisme, 2001, p. 84 (souligné par lui). Cette définition est développée p. 83-91 et p. 110-120.
-
[4]
À ce sujet, Uri Eisenzweig (ibid., p. 84, note 1) cite le texte suivant : « On peut souligner que la langue allemande, contrairement au français, dispose de deux termes distincts, Repräsentation (figuration symbolique) et Stellvertretung (mandat) pour désigner chacune de ces notions » (Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 2002, p. 13, note 1). Rosanvallon donne, quant à lui, la référence suivante : Olivier Beaud, « Repräsentation und Stellvertretung : sur une distinction de Carl Schmitt », Droits, n° 6 (1987). Müller, qui a dit plus d’une fois son intérêt pour Carl Schmitt, peut lui avoir emprunté la distinction faite plus haut.
-
[5]
Heiner Müller, Werke 9, op. cit., p. 243 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 263.
-
[6]
Ibid., p. 243 ; p. 263-264 (traduction légèrement modifiée).
-
[7]
Ibid., p. 244 ; p. 264-265 (pour le texte de Fatzer, voir Heiner Müller, Werke 6 : Die Stücke 4, 2004, p. 133 ; Bertolt Brecht, Fatzer, fragment. Montage de Heiner Müller, 1992, p. 101).
-
[8]
Ibid., p. 244 ; p. 265.
-
[9]
Id.
-
[10]
Ibid., p. 245 ; p. 266.
-
[11]
Ibid., p. 244 ; p. 265.
-
[12]
Ibid., p. 251 ; p. 271 (traduction légèrement modifiée).
-
[13]
Heiner Müller, Werke 11 : Die Gespräche, 2008, p. 677 et 684 ; Fautes d’impression, 1991, p. 196 et 203.
-
[14]
Heiner Müller, Werke 10 : Die Gespräche, 2008, p. 244-245 ; Erreurs choisies, 1988, p. 96-97.
-
[15]
Heiner Müller, Werke 9, op. cit., p. 286 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 311. Il ajoute : « Il n’y a que l’ordinateur qui libère des contraintes de l’art, en raccourcissant le chemin qui mène aux clichés, trouble substitut des formules poétiques du rhapsode du royaume des Mères » (id., traduction légèrement modifiée).
-
[16]
« Pasternak disait que Shakespeare a écrit en vers, parce que ça va plus vite. Et, c’est vrai, à partir d’un certain degré de température, ça va plus vite. Ça s’écrit automatiquement, c’est le rythme qui contraint le texte » (ibid., p. 205 ; p. 223). Voir aussi le fait qu’on ne puisse redonner vie au vers blanc allemand qu’en passant par Shakespeare et qu’à cet égard Brecht ne représente qu’« un stade intermédiaire » (ibid., p. 177 ; p. 192). « Ce qui intéresse les Américains dans mes textes, c’est peut-être la rapidité, la vitesse de changement de tempo, sans transition » (ibid., p. 224 ; p. 242).
-
[17]
Ibid., p. 208 ; p. 226. Pour Müller, Hamlet est une pièce où Shakespeare « essaie de formuler quelque chose qu’il ne maîtrise pas, une expérience qu’il n’arrive pas à saisir » (ibid., p. 209 ; p. 227).
-
[18]
Ibid., p. 233-234 ; p. 253.
-
[19]
Ibid., p. 227 ; p. 247.
-
[20]
Heiner Müller, Werke 4 : Die Stücke 2, 2001, p. 84 ; Hamlet-machine, Horace, Mauser, Héraclès 5 et autres pièces, 1985, p. 41-42.
-
[21]
Heiner Müller, Werke 5 : Die Stücke 3, 2002, p. 202 ; La bataille et autres textes, 1988, p. 83. « Guerre de papier » : c’est le terme dont Müller se sert pour désigner la polémique qui a entouré son Macbeth en RDA en 1972-73 : Werke 9, op. cit., p. 205 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 223.
-
[22]
Sur Philoctète, je me permets de renvoyer à mon article, « Ulysse cas-limite », Frictions. Théâtres écritures, n° 15 (2009), p. 83-108.
-
[23]
Heiner Müller, Werke 5, op. cit., p. 202 ; La bataille et autres textes, op. cit., p. 83.
-
[24]
Heiner Müller, Werke 3 : Die Stücke 1, 2000, p. 310 ; Philoctète, 2009, p. 56.
-
[25]
Heiner Müller, Werke 5, op. cit., p. 39 ; Quartett, La mission, Prométhée, Vie de Gundling, 1982, p. 39.
-
[26]
Heiner Müller, Werke 10, op. cit., p. 279 ; Erreurs choisies, op. cit., p. 116-117 (traduction légèrement modifiée).
-
[27]
Heiner Müller, Werke 2 : Die Prosa, 1999, p. 132-135 ; ce texte, publié pour la première fois en octobre 1992, n’a pas été traduit en français.
-
[28]
Heiner Müller, Werke 10, op. cit., p. 148 ; non traduit en français. Pour un exemple d’actes de cruauté dans « l’inscription » sur les corps en Afghanistan, voir Werke 9, op. cit., p. 255 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 275 ; le texte allemand contient une phrase de plus : « Il y va du rapport entre écriture et sang, alphabet et terreur. »
-
[29]
Voir supra, note 7.
-
[30]
Heiner Müller, Werke 9, op. cit., p. 247 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 268 (traduction légèrement modifiée : « noyau incandescent » remplace « ferment »).
-
[31]
Heiner Müller, Werke 11, op. cit., p. 520 ; Fautes d’impression, op. cit., p. 154 (entretien de janvier 1990).
-
[32]
Heiner Müller, Werke 4, op. cit., p. 554 ; Manuscrits de Hamlet-machine, 2003, p. 157.
-
[33]
Heiner Müller, Werke 5, op. cit., p. 40 ; Quartett, La mission, op. cit., p. 40.
-
[34]
Id.
-
[35]
Heiner Müller, Werke 4, op. cit., p. 554 ; Manuscrits de Hamlet-Machine, op. cit., p. 157.
-
[36]
Jacques Rancière, Les noms de l’histoire. Essai de poétique du savoir, 1992, p. 196-197 ; Aux bords du politique, 1998, p. 87-92 et p. 148-151 (où Rancière commente notamment l’expression de Sartre, « l’aveuglant soleil de la torture », qui est citée dans la dernière scène d’Hamlet-machine).
-
[37]
Jacques Rancière, Aux bords du politique, op. cit., p. 114.
-
[38]
Heiner Müller, Werke 9, op. cit., p. 254-255 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 275.
-
[39]
Heiner Müller, Werke 8 : Die Schriften, 2005, p. 187 ; Hamlet-machine, op. cit., p. 67.>
-
[40]
Heiner Müller, Werke 5, op. cit., p. 29-30 ; Quartett, La mission, op. cit., p. 28.
-
[41]
Heiner Müller, Werke 4, op. cit., p. 426 ; Ciment (d’après Gladkov), suivi de La correction, 1991, p. 59.
-
[42]
Jacques Rancière, La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, 1998, p. 172.
-
[43]
Heiner Müller, Werke 4, op. cit., p. 430 ; Ciment (d’après Gladkov), suivi de La mission, op. cit., p. 64.
-
[44]
Heiner Müller, Werke 9, op. cit., p. 285 ; Guerre sans bataille, op. cit., p. 309.
Bibliographie
- Eisenzweig, Uri, Fictions de l’anarchisme, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2001.
- Müller, Heiner, Werke 2 : Die Prosa, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999.
- Müller, Heiner, Werke 3 : Die Stücke 1, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000 ; Philoctète, Paris, Éditions de Minuit, 2009 (trad. Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil).
- Müller, Heiner, Werke 4 : Die Stücke 2, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001 ; Hamlet-machine, Horace, Mauser, Héraclès 5 et autres pièces, Paris, Éditions de Minuit, 1985 ; Manuscrits de Hamlet-Machine, Paris, Éditions de Minuit, 2003 (trad. Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger) ; Ciment (d’après Gladkov), suivi de La correction, Paris, Éditions de Minuit, 1991 (trad. Jean-Pierre Morel).
- Müller, Heiner, Werke 5 : Die Stücke 3, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002 ; La bataille et autres textes, Paris, Éditions de Minuit, 1988 (trad. Jean-Pierre Morel) ; Quartett, La mission, Prométhée, Vie de Gundling, Paris, Éditions de Minuit, 1982 (trad. Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger).
- Müller, Heiner, Werke 6 : Die Stücke 4, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004 ; Bertolt Brecht, Fatzer, fragment. Montage de Heiner Müller, Paris, L’Arche, 1992 (trad. François Rey).
- Müller, Heiner, Werke 9 : Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiographie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005 [1992] ; Guerre sans bataille. Vie sous deux dictatures. Une autobiographie, Paris, L’Arche, 1996 (trad. Michel Deutsch).
- Müller, Heiner, Werke 10 : Die Gespräche, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008 ; Erreurs choisies, Paris, L’Arche, 1988 (trad. Jean Jourdheuil et al.).
- Müller, Heiner, Werke 11 : Die Gespräche, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008 ; Fautes d’impression, Paris, L’Arche, 1991 (trad. Jean Jourdheuil et al.).
- Rancière, Jacques, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 1998.
- Rancière, Jacques, Les noms de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Éditions du Seuil, 1992.
- Rancière, Jacques, La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, Paris, Hachette Littératures, 1998.