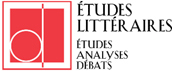Résumés
Résumé
Cette étude du lyrisme et de ses procédés énonciatifs dans les chansons de Quatre saisons dans le désordre (1996) vise à montrer en quoi les sujets marginaux dans les récits que fait Daniel Bélanger sont confrontés à un désir d’émancipation entravé par un désir contradictoire de repli sur soi. Suivant la définition de « l’énoncé lyrique » formulée par Karlheinz Stierle (1977), l’article se penche sur les trajectoires du sujet isolé, notamment à travers l’analyse du rapport conflictuel au corps et de la thématique amoureuse, ainsi que l’étude du caractère transgressif du discours de l’auteur-compositeur-interprète.
Abstract
This study of lyricism and its mecanisms in songs of Quatre saisons dans le désordre (1996) aims to show how marginal characters in Daniel Bélanger’s stories are torn between their will of emancipation and the inconflicting desire of withdrawal into themselves. According to the meaning of ‘‘lyric statement’’ defined by Karlheinz Stierle (1977), the article looks into the path of the isolated protagonist, notably through an analysis of the conflicting connection to the body and the theme of love relationships, along with a study of the transgressive nature of the singer/songwriter’s discourse.
Corps de l’article
La chanson constitue aujourd’hui un objet culturel de plus en plus étudié dans les secteurs universitaires, impliquant à la fois critiques littéraires, musicologues, sociologues, linguistes ou encore théoriciens de la communication. Genre pluridimensionnel s’il en est, la chanson pose quantité d’obstacles à qui veut l’appréhender et décrypter les signes qui la composent, en l’occurrence paroles, musiques et interprétation, mais également performance scénique et vidéographie[1]. Mais c’est bien parce qu’elle fait appel à différents champs de compétence que la chanson peut être envisagée et étudiée selon plusieurs angles, et qu’elle constitue un univers aussi fertile pour le chercheur qui s’y intéresse.
Depuis les travaux qu’ont menés Robert Giroux et ses collaborateurs dans les années 1980, quelques ouvrages critiques ont été consacrés à l’étude de la chanson, questionnant différents aspects du genre, allant de la sociologie du champ de production aux liens que la chanson entretient avec la poésie[2], en passant par les cas de censure, les traités d’historiographie et les anthologies (celle de Roger Chamberland et d’André Gaulin, par exemple). Les musicologues, au fil des ans, se sont eux aussi intéressés à la culture populaire, assurant une légitimité au genre dans les milieux universitaires où on enseignait plus volontiers la musique classique. Les réalisations de Serge Lacasse et de Philip Tagg, respectivement chercheurs à l’Université Laval et à l’Université de Montréal, ont contribué au développement des études en musique populaire au Québec. Il en va de même en France, où l’intérêt pour la recherche sur la chanson en tant que genre se fait grandissant. Mentionnons, à cet égard, les travaux de Louis-Jean Calvet, pionnier des analyses pluridisciplinaires en musique populaire, ceux de Paul Zumthor sur la poésie orale, de Stéphane Hirschi sur la cantologie[3], de Cécile Prévost-Thomas sur les modes de diffusion de la chanson ou encore ceux de Colette Beaumont-James sur le français chanté.
Aussi poursuivons-nous dans cette voie, en proposant ici une étude interne du deuxième album de Daniel Bélanger, Quatre saisons dans le désordre[4], paru en 1996. Mais comment étudier la chanson aujourd’hui, sans tomber dans les pièges de l’illusion biographique ? Y a-t-il moyen de discuter de l’oeuvre d’un auteur-compositeur-interprète en tenant compte à la fois de son texte versifié et des composantes musicales qui s’y trouvent modulées ? C’est dans le prolongement des travaux récents sur la chanson reçue — c’est-à-dire écoutée, par opposition à la chanson lue, où seul le texte constitue le matériau d’analyse — et des recherches sur le sujet lyrique moderne qu’il nous paraît intéressant d’étudier la poétique d’un chansonnier tel que Daniel Bélanger. Explorant tantôt l’univers du songe, tantôt celui d’un quotidien urbain plus cauchemardesque, cet auteur-compositeur-interprète s’éloigne des discours dominants ou contre-discours revendicateurs pour mieux rendre la vulnérabilité de sujets marginalisés, dans des chansons intimistes où la quête d’équilibre est privilégiée, mais où les rapports à l’autre se font constamment instables et problématiques. C’est spécifiquement cette présence d’êtres qui tombent, qui luttent contre les intempéries ou qui se retranchent du monde extérieur pour se replier dans le rêve — trajectoires qui se disent aussi par l’introduction de bris sémantiques dans le discours, ce qui caractérise l’énoncé lyrique moderne selon Karlheinz Stierle (1977) — qui a motivé la présente étude. Bien que ce lyrisme particulier anime toute la production de Daniel Bélanger, les prochaines lignes porteront exclusivement sur Quatre saisons dans le désordre, album où les tensions entre réclusion du sujet et désir d’ouverture sur le monde extérieur nous apparaissent les plus probantes.
Aussi ne désignerons-nous pas le sujet énonciateur par les termes de « locuteur » ou de « narrateur », tel qu’on les utilise pour l’analyse des poèmes et des récits, mais plutôt par la notion plus dynamique de « canteur », néologisme introduit par Stéphane Hirschi en 1995[5] pour désigner le sujet chantant d’une chanson. Et c’est précisément parce que l’oeuvre de Daniel Bélanger trouve sa spécificité ailleurs que dans un discours univoque (politique, environnemental, etc.) que la notion de « canteur » gagne ici à être précisée. Plutôt que de contester un ordre dominant, ou de prescrire un engagement social, les chansons de Quatre saisons dans le désordre énoncent la quête problématique d’un sujet marginal et isolé.
En ce sens, la notion de sujet lyrique[6], telle que définie par Karlheinz Stierle dans « Identité du discours et transgression lyrique[7] », s’accorde à toutes les chansons étudiées. Portant à la fois la marque biographique du sujet empirique (celle de l’énonciateur) et celle construite par un sujet fictif au moyen de récits qui le problématisent, ce sujet est, comme l’énoncé dans lequel il tient un rôle, « à la fois complexe et précaire[8] ». Son identité, qu’il tente de ressaisir, se fait tout aussi instable que son énonciation, dans la mesure où celle-ci constitue « une manière spécifique de transgresser un schème générique, c’est-à-dire discursif[9] ». L’énonciation lyrique prend ainsi l’allure d’un « anti-discours », parce que rendue par un sujet qui cherche à dire « autre chose » que ce que véhiculent les discours ambiants, par l’introduction de distorsions de sens, de lignes brisées et de tensions spécifiques à son discours. En interférant dans le récit par une énonciation qui va du particulier au général, comme l’a montré Dominique Combe en 1989[10], le sujet lyrique déstabilise par l’imprévisibilité de son discours et les tensions qu’il introduit entre celui-ci et l’histoire racontée. Les énoncés métaphoriques, l’adresse lyrique et les jeux spatio-temporels constituent autant de procédés de déliaison pour rendre sur le plan discursif cette transgression.
Dans la foulée des travaux menés en Allemagne sur le sujet lyrique, les dernières années ont vu s’actualiser en France et au Québec des études sur le lyrisme et l’énonciation lyrique. Les recherches conduites par des spécialistes de la poésie moderne ont récemment donné lieu à la publication de trois ouvrages phares[11]. C’est donc à partir du modèle proposé par Stierle sur le schème lyrique, relevant de l’expérience privée du sujet isolé (l’amour, la mélancolie, le paysage, l’expérience de l’autre et la mort), ainsi qu’à partir des plus récentes études proposées par les spécialistes du lyrisme ou de l’énonciation lyrique, tels Dominique Rabaté, Michel Collot, Joëlle de Sermet, Laurent Jenny et Jean-Michel Maulpoix, que nous souhaitons étudier la trajectoire du sujet isolé dans sept chansons[12] tirées de Quatre saisons dans le désordre, de même que le caractère transgressif du discours de Bélanger. Nous tâcherons également de montrer, à travers l’analyse des rapports textes-musiques, en quoi les êtres présents dans les récits qu’il fait adoptent une position marginale tout en aspirant à une liberté, plus précisément à un état d’équilibre qui serait rendu possible entre repli sur soi et ouverture à l’autre.
Dans un premier temps, nous traiterons de la précarité du sujet en nous intéressant au rapport conflictuel que les êtres entretiennent avec leur corps, puis nous insisterons sur la quête amoureuse problématique qui parfois accentue la position marginale des sujets. Au plan textuel, un relevé d’indices syntaxiques et grammaticaux, comme la déliaison et la pluralité dans l’adresse lyrique, permettra d’illustrer l’aspect transgressif du discours, alors qu’au plan musical, nous soulignerons les textures de la voix, le choix de l’instrumentation de même que les progressions harmoniques afin de rendre l’effet lyrique que procure la réception auditive des chansons de Bélanger.
« Libre dans un corps »
Les chansons de Quatre saisons dans le désordre de Daniel Bélanger présentent des êtres rêveurs[13] désincarnés, pour qui le corps apparaît comme un obstacle à une possible fusion avec l’environnement extérieur. Comme l’observe Jean-Michel Maulpoix[14], « le sujet lyrique s’effectue, mais il n’existe pas. Si désireux soit-il, son propre corps lui manque[15] ». Cette frontière physique a pour première conséquence de miner les relations avec les autres et le dehors. Elle se pose aussi comme une impossibilité de s’atteindre soi-même et place le sujet dans une position instable. Très sollicité dans cette quête identitaire caractéristique du discours lyrique, le sujet n’appartient pas au monde réel qui l’entoure, pas plus qu’il n’habite confortablement son corps, situation allant parfois jusqu’à lui procurer un sentiment d’imposture lorsqu’il se retrouve parmi les siens. De cette position de déséquilibre se dégage la fragilité d’un être qui se sent étranger à lui-même, tel qu’on le perçoit dans les textes par les manifestations d’un inconfort physique, d’une sensation d’étouffement provoquée par une enveloppe charnelle rendant difficile l’ouverture à l’autre. À ce sujet, Michel Collot suggère, dans « Le sujet hors de soi[16] », que la seule possibilité d’observation ou d’objectivation du sujet lyrique se situe à l’extérieur de soi :
le sujet incarné ne saurait complètement s’appartenir. La tache aveugle du corps et de l’horizon l’empêche d’accéder à une pleine et entière conscience de lui-même. […] Sa vérité la plus intime, il ne peut donc la ressaisir par les voies de la réflexion et de l’introspection. C’est hors de soi qu’il peut la trouver[17].
Le sujet doit se déporter à l’extérieur de son enveloppe corporelle pour être en mesure de s’observer, d’aller « à la rencontre de ce qui le déborde au dedans comme au-dehors[18] », et ultimement d’atteindre une autre vérité.
Certaines chansons de Quatre saisons dans le désordre mettent en scène un canteur captif, incapable de communiquer avec l’autre, isolé du reste du monde. Dans « Sortez-moi de moi », par exemple, le dédoublement du corps est illustré par le regard posé seulement sur le sujet, de l’intérieur comme de l’extérieur, et qui s’exprime à l’imparfait :
Et moi j’étais sur moi alors
J’écoutais couler dans mes veines
Mes vaisseaux et mes anticorps
Depuis des mois, des années même
J’observais battre mes paupières
Mon corps prendre et rendre l’air[19].
Absorbé qu’il est par les mouvements de son corps, le canteur égocentrique n’a pas eu conscience de « La vie des autres, la vie surtout / De ceux qui meurent faute de nous ». Ce statisme est d’autant plus ressenti par l’auditeur qu’il est rendu, dans les couplets, par une ligne vocale monotone, soutenue par les valeurs longues de la basse sur une note de pédale et par les accords de fa dièse majeur répétés en boucle. Ceux-ci se font d’ailleurs légèrement dissonants quand, toutes les deux mesures, le cinquième degré est augmenté (on entend un ré dans l’accord, plutôt que le do dièse auquel on s’attend).
L’état léthargique du sujet ne saurait toutefois prendre fin qu’à la rencontre d’un inconnu lui rappelant « que tout autour / De [s]on nombril se trouve la vie ». Dès lors conscient de son apathie, il affirme au présent un désir de s’ouvrir au monde, mais accuse son corps de se détacher de lui, d’entraver ses gestes, comme un obstacle à la rencontre possible : « Mais moi j’ai des yeux qui refusent de voir / Des mains qui frôlent sans toucher ». L’emploi métonymique des « yeux » et des « mains », organes sensoriels privilégiés pour entrer en contact avec l’environnement, donne à voir un sujet enfermé[20], d’autant plus aliéné qu’il se dit habité par quelque intrus et fait de zones d’ombre : « Chacun ses envahisseurs / Chacun ses zones sinistrées ». L’affirmation d’une telle vulnérabilité, conjuguée à un appel à l’aide itératif, dynamise la situation auparavant statique. À cet égard, soulignons la scission entre le rythme et la mélodie du refrain par rapport à ceux des couplets.
L’éveil du « je » cantologique à son égocentrisme est ainsi chanté (contrairement au couplets qui étaient davantage parlés) sur une succession d’accords purs dans la tonalité de si majeur (la, mi, si et ré). Les cymbales et le hi-hat, plus brillants dans le mixage, se joignent aux mouvements amples de la basse pour modifier l’atmosphère musicale, maintenant moins synthétique et mécanique, appuyant ainsi la prise de parole et de conscience du sujet. Dans le refrain, la voix réverbérée de Bélanger se déploie non seulement en puissance, mais encore elle se superpose à elle-même. L’interprétation vocale laisse poindre l’impasse du canteur qui exprime, captif, le détachement du corps et l’incapacité à être « un », tout autant que la volonté de se sortir de ce carcan. On pourrait ainsi comparer le sujet de « Sortez-moi de moi » à celui que décrit plus globalement Laurent Jenny[21] : « [L]e sujet lyrique ne domine pas sa parole, il est clivé entre désir d’élévation […] et constat d’impuissance[22] ».
Cette lucidité restera toutefois vaine, puisque, à défaut d’un « incendie » ou de « l’amour le plus fol », le sujet ne parvient à quitter « l’alvéole / Où [il] veille et où [il] dort ». De ce rapport problématique au corps se dégage une incapacité du sujet à se projeter dans le monde tangible, confinant le « je » lyrique à son isolement, posture dont il ne parvient à s’extraire qu’en accédant à un univers irréel, alternatif.
Confronté au réel, le sujet se montre en effet en conflit avec son propre corps alors que, dans un monde onirique, il sent enfin la possibilité de l’accepter pleinement et de s’y sentir bien. Selon Isabelle Boisclair et Carolyne Tellier[23],
[c]ette inertie du corps dans l’ici et maintenant valorise la quête spirituelle ou onirique au détriment des initiatives charnelles. Le je du poète préfère anticiper des gestes en se projetant dans un univers atemporel et idéalisé, où l’absolu est encore possible plutôt que de risquer des échanges avec les humains peuplant le monde qui l’entoure[24].
C’est ce que l’on constate dans « Respirer dans l’eau », alors que le sujet s’évade dans un rêve (introduit par le passage du mode mineur au mode majeur) où il peut explorer et exploiter les multiples capacités offertes par son corps, cette fois en parfaite symbiose avec les éléments naturels :
Le temps est blanc
Le jour fléchit
Belle et douce nuit
La lune est bleue
Je m’assoupis
Je pars le coeur dans l’étui
Voilà que je respire dans l’eau
Je vole même sans plumeau
Je suis enfin moi,
Enfin moi.
Les fonctions vitales, telle la respiration, se voient renforcées, comme le marque le titre, dans un environnement où le sujet n’est plus restreint par ses limites physiologiques. Il ne ressent plus la sensation d’étouffement caractéristique de son quotidien, mais semble plutôt trouver, à l’issue de son expérience singulière du rêve, un confort qui n’est pas sans rappeler l’état foetal, le retour à la matrice originaire. Notons aussi que l’introduction musicale renforce la signification[25] des paroles, plongeant l’auditeur dans un univers sonore dominé par des guitares et des claviers aux textures organiques, voire aquatiques, tandis que la descente diatonique jouée par la basse donne l’impression d’atteindre les profondeurs marines.
L’exploration du dehors est ici exploitée comme la seule possibilité d’échapper au repli sur soi, faisant du paysage — grand thème lyrique s’il en est — un élément de catharsis[26]. Le sujet de « Respirer dans l’eau » peut désormais s’affirmer et sortir de sa « prison intérieure », comme le montre à l’évidence le lexique du refrain :
Moi qui jaillis
Des souterrains
De cent siècles de taule
Libre à mourir de rire.
Loin d’une réalité biographique, cette métaphore évoque dix mille ans d’emprisonnement, ce qui a pour effet non seulement de surmarquer l’isolement du sujet, mais encore d’accentuer son sentiment de libération, suggéré déjà par l’emploi du verbe « jaillir ». Le sostenuto sur la première occurrence du déictique « moi » (« Je suis enfin moi / Enfin moi ») annonce ainsi une prise de parole actualisée. Celle-ci se prolonge par le mouvement dans l’espace, autant suggéré par l’emploi de
Moi qui souris
Qui marche enfin
La tête hors des épaules
que par la modulation de tonalité de mi bémol mineur à mi bémol majeur et par la rythmique plus saccadée des phrases. Le déictique « enfin » ancre quant à lui l’énonciation dans le présent, et crée une assise au désir d’émancipation exprimé par le sujet.
Il est d’ailleurs intéressant de souligner que les mots en début de mesure sont volontairement, selon l’interprétation vocale, plus « sonores », plus « claquants », d’autant qu’ils sont accentués par la hauteur du sol, ici 3e degré de la tonalité. Selon Stéphane Venne, dans son récent ouvrage intitulé Le frissons des chansons[27], cette note donne « facilement l’impression d’ouverture, d’éclat[28] ». Dès le verset suivant, toutefois, la distorsion dans les temps de verbes, caractéristique de la transgression lyrique, vient briser la linéarité du discours et déconstruire la symbiose entre le corps et l’environnement : « Il reste moi qui volais / Qui respirais dans l’eau ». L’état de plénitude, rendu au passé, n’était donc qu’éphémère, chassé par le retour du jour qui « défait le dormeur satisfait ». Le sujet use du rêve comme d’un exutoire quotidien ; détaché du monde réel, il peut enfin s’appartenir, être « lui, enfin lui », pour le paraphraser. Libre, certes, mais à quel prix ? À cet effet, n’entendons-nous pas, dans le vibrato subitement resserré de Bélanger, toute l’ironie du canteur lucide lorsqu’il soutient qu’il est « libre à mourir… de rire », juste avant le retour au mode mineur, celui qui évoque l’environnement réel ? Ainsi, bien qu’il ait assouvi, dans un espace onirique, le désir qu’il a de s’incarner, le sujet de « Respirer dans l’eau » demeure inévitablement, dans l’univers tangible et quotidien, un être contraint au repli sur soi dans le rêve pour atteindre un état de bien-être.
« Toujours tout seul, pas à demi »
Aux côtés des rêveurs isolés et désincarnés, Quatre saisons dans le désordre présente également des sujets souhaitant interagir avec les êtres qui composent leur environnement immédiat. Cette ouverture à l’autre, particulièrement à travers la quête amoureuse, demeure foncièrement problématique. Le sujet qui se révèle dans le monde pour conquérir l’autre se retrouve parfois projeté dans un environnement sclérosé et menaçant qui, loin de le conforter, risque de le replonger dans un grand isolement. Selon l’expérience qu’il fait de l’amour, il peut se refermer sur l’univers restreint et fusionnel du couple ou, à l’opposé, regretter sa solitude d’amant déchu.
L’amour ne se dit jamais sur un ton mièvre ou complaisant sur cet album, mais traduit plutôt un intimisme particulier. « Les deux printemps », sorte d’ode à l’être aimé, demeure la seule chanson où le récit amoureux est positif, où la fusion du couple est rendue possible dans l’espace et dans le temps. Dès l’incipit, on note un rapprochement physique entre le sujet et la femme aimée, dans une étreinte où les corps se fondent l’un dans l’autre, et où l’on sent, selon le vocabulaire employé, une heureuse complicité :
Ses yeux sont deux printemps
Qui me font sourire et ça me fait rire
Ses joues sont des torrents
Les miennes s’y baignent mais encore pire
Son coeur est une fête
Le mien ne veut plus en sortir.
Le rythme ternaire entraîné par une division des mesures en 6/8[29], que l’on entend particulièrement dans le motif de la guitare acoustique, suggère, au même titre que le lexique du premier couplet, la valse des amants qui se courtisent. La mélodie complexe de cette chanson contribue de même à l’effet de mouvement et de balancement en ce qu’elle constitue « un beau collier bien rond de 60 notes joliment enfilées le long de 20 mesures[30] », comportant de fréquents écarts de notes dans les phrasés (surtout en début de vers). C’est dans une ambiance musicale chaude, installée par les congas et les accents gitans de la guitare électrique, que les « deux corps amphibies » des amants nagent dans le « liquide clair » de l’amour, alors qu’à l’extérieur pèse une potentielle menace sur leur bonheur : « La terre est un brasier / Mais pour un moment l’oublier ».
Même si le sujet prétend que l’objet de son amour ne plaît à personne « ni du visage ni de l’esprit », cela n’empêche toutefois pas la « bande de jaloux » de vouloir miner son bien-être :
Y a toujours des noirceurs
Pour assombrir quelques beautés
Des êtres qui ont peur
Qui veulent vous en contaminer.
Proie naïve et vulnérable pour les prédateurs qui rôdent autour, le sujet choisit de se replier sur la « plus belle saison de [s]a vie », la femme aimée, laissant à ses détracteurs leur univers gris et triste : « Restez en votre automne / L’été tout l’an me fait plus envie ». Le canteur semble ici s’adresser, par le biais d’un « vous » implicite du fait de l’impératif, à ceux qui l’entourent, comme pour savourer la chance inouïe qu’il a de pouvoir s’éloigner de leur quotidien morose.
La deuxième personne du pluriel n’étant pas le seul allocutaire du sujet, il est intéressant, afin de rendre compte de l’évolution de la relation amoureuse, de se pencher sur le rôle de l’adresse lyrique[31] et des jeux de pronoms personnels dans « Les deux printemps ». L’absence d’introduction musicale à cette chanson a pour effet d’abord de propulser l’auditeur, au même titre que le canteur, en plein coeur du récit, comme s’il ne fallait rien perdre du précieux temps alloué aux amants. Le sujet fait une description de la femme qu’il aime, désignée à la troisième personne du singulier, ce qui révèle par le fait même qu’elle ne se trouve pas à ses côtés. Cette solitude initiale est représentée, au plan musical, par un accompagnement simple à la guitare acoustique. L’instrumentation se complexifie momentanément pendant le pont musical entre le deuxième et le troisième couplets, dans une séquence de huit mesures en mi majeur, dont se dégage une atmosphère arabisante, chaude et suave. Sitôt cette variation sur un même accord terminée, les guitares électriques et les congas s’éteignent, pour de nouveau laisser seule la guitare acoustique. Presque seule, à dire vrai, car une basse fretless[32] fait sont entrée en début de troisième couplet, au moment même où le sujet emploie le déterminant possessif « nos », comme si l’instrument à la sensualité caractéristique représentait l’être féminin. Ce « nous » pour la première fois verbalisé vient « amalgame[r] le je du locuteur et le tu de la femme aimée[33] », comme pour cristalliser l’union des amants enfin réunis dans l’espace.
Le sujet a ensuite de nouveau recours au « vous » pour indiquer aux jaloux qu’il les prend à témoin quand vient le temps d’assurer son amour aveugle au « tu » féminin, qu’il interpelle directement pour la première fois :
Persuadez-vous de mes deux yeux fermés
J’affirme en toute cécité
T’es la plus belle saison de ma vie.
Est-ce par hasard si, dans ces quatrième et cinquième couplets, on entend s’ajouter une nouvelle guitare et des percussions à l’instrumentation de base ? Ou serait-ce pour illustrer l’arrivée d’une menace potentielle à la relation fragile des amants ? C’est ce que tend à confirmer le tout dernier couplet, où l’on retourne à la solitude des amants et au simple accompagnement de la guitare et de la basse. Si la deuxième personne du pluriel ne constitue plus un allocutaire présent dans le dernier couplet, les jeux de pronoms restent encore une fois très suggestifs. Comme l’ont remarqué Isabelle Boisclair et Carolyne Tellier, le sujet a en effet « de nouveau recours au nous, cette fois pour anticiper un futur où la relation devient incertaine[34] », effritée par les années. Le contraste entre le temps présent employé tout au long du texte et le temps futur du dernier couplet confirme ce doute posé sur la durée ou l’aboutissement de l’amour dont il est question :
Nous serons vieux et frêles
Peut-être même séparés
Nos têtes pêle-mêle
Incapables et usées.
Comme pour prolonger l’incertitude des amants, la basse fretless émet maintenant un contre-chant aussi voluptueux que larmoyant, rendu par une montée arpégée, qui est jouée plus haut sur le manche de l’instrument.
Dès le cinquième vers toutefois, le retour au temps présent ainsi qu’à l’énonciation au « je », destinée au « tu » de la femme, vient déconstruire la menace éventuelle et décupler la passion qui anime le sujet au moment où la fusion amoureuse est possible :
Mais aujourd’hui je t’aime
Aujourd’hui pour l’éternité
T’es la plus belle saison de ma vie.
L’emploi curieux du déictique « aujourd’hui pour l’éternité », alors que l’on a dit craindre l’avenir, est caractéristique de cette dualité entre fragilité et puissance intrinsèque à la relation amoureuse, et va dans le sens des propos de Dominique Rabaté[35], lorsqu’il soutient que « [l]a parole lyrique, adressée à l’être aimé, se déploie dans cet espace temporel menacé et euphorique[36] ». Cette frénésie est d’autant plus évidente qu’elle est soutenue par le retour en puissance des tambours et par l’explosion du sentiment amoureux ressenti dans la voix propulsée de Bélanger sur les plus hautes et les plus fortes notes de la chanson. Invincible, le canteur s’élance dans la valse des amants et se laisse emporter dans son tourbillon, tel que le suggèrent les nombreuses mesures d’improvisation vocale pendant la reprise du motif en mi majeur, où tous les instruments (congas, guitares électriques et acoustiques, basse) se déploient.
Si l’espace-temps est propice aux amoureux dans « Les deux printemps », il en va tout autrement dans « Les temps fous », où règne, comme l’indique le titre, un climat apocalyptique empêchant la fusion des amants, ceux-ci étant à la merci d’un environnement qui se déchaîne[37]. L’introduction musicale participe d’emblée à la mise en scène de cette atmosphère déstabilisante et étourdissante, avec ses tambours répétés en boucle et sa succession d’accords de septième majeure[38] (sol et mi). Dans cet univers où le sujet paraît dépourvu de repères spatio-temporels et où le temps fuit comme « des années liquides », l’étreinte physique avec l’être aimé, souvent partielle, est sans cesse compromise. Un frôlement, un souffle, un regard, comme uniques possibilités de contacts entre les amants, illustrent à eux seuls les gestes constamment entravés du sujet. Luttant contre ce tourbillon, métaphore d’une société démente, celui-ci lance un ultime appel à la femme, craignant d’être séparé d’elle par une rafale de vent :
Sentir ta main sur ma joue
Ne pas la perdre comme on perd tout
Les temps sont fous
Aide-moi
Pour que demain s’empare de nous […].
Que vents emportent les temps fous ». La voix de Bélanger, plus crispée, plus nerveuse dans les couplets, devient puissante et dramatique dans le refrain, formulant de telle sorte l’imminence de la menace climatique. Le crescendo vocal et instrumental ainsi que la projection du mot « fou » sur le si, plus haute note de la partition, insistent sur la détresse du personnage qui tente de rejoindre sa bien-aimée en dépit de la tempête. Le rapprochement des amants illustré dans le refrain ne durera qu’un temps puisque, comme le montrent les vers 11 et 12, l’être désiré, en mouvement, devient hors d’atteinte du sujet, statique dans l’espace : « Tu habites un projectile / Qui s’éloigne et moi je suis immobile ». La fusion amoureuse n’aura été que brève, entravée par la distance entre les corps, conséquence d’un climat apocalyptique.
La solitude découlant de cette impossibilité à entrer en contact avec l’être aimé est encore plus soutenue dans la chanson intitulée « Imparfait », où le sujet est complètement désillusionné. L’isolement se ressent dès l’introduction musicale, construite sur un lent fade in instrumental, où les percussions et la basse rappellent les battements réguliers du coeur, alors que les guitares steel, froides et métalliques, suggèrent une douleur lancinante, celle de la distance entre les amants. Comme une lointaine complainte, l’interprète fredonne un « ooh » continu, mais difficilement perceptible au travers des instruments, comme si le sujet ne parvenait pas à se faire entendre. Se comparant à « du bois d’allumette / Qui se consume », celui-ci semble anticiper une fatalité et subir son quotidien, en appréhendant la mort. La voix chuchotée[39] de Bélanger, tout au long ajoutée à la ligne vocale dominante, insiste non seulement sur l’atonie du sujet, mais également sur l’impression de dédoublement, de morcellement des corps. Éloigné au quotidien de la femme qu’il aime, le sujet prend en effet des allures d’automate :
Or que tout est bête
Tout est vain et inutile
Lorsqu’épuisé, fatigué
Le corps n’est plus qu’un autre projectile
Propulsé depuis matin
Jusqu’au soir en bus, en train
Je sais qu’un coeur peut s’arrêter pour moins.
Un léger apaisement se dit néanmoins dans le deuxième couplet, alors qu’il s’adresse au présent à la femme aimée :
Le vent est si tendre sur midi
Tu es septembre sur Paris
Je pense à toi, ça fait du bien.
Son désir amoureux n’est toutefois pas fécond, étant donnée la distance géographique le séparant d’elle :
Toi dans ta ville et moi transsibérien
Qui t’aime et qui t’adore
Puis qui se hait d’aimer si fort
L’amour est comme je le redoutais
Imparfait.
La colère permet de ressaisir, chez le sujet, une négation de ses sentiments envers la femme aimée, comme si l’aveu révélait une faiblesse, une trop grande vulnérabilité. Alors que la femme est imaginée comme un vent chaud, le canteur se dit « transsibérien »[40], habitant un univers silencieux et glacé. Dans une telle perspective, ressentir la passion amoureuse n’est guère souhaitable. Dès lors, le sujet se ferme à l’autre et, ne parvenant pas à exprimer son désir, se retranche dans un isolement à l’image des autres amoureux déchus de Quatre saisons dans le désordre.
La solitude atteint son comble dans la chanson « Projection dans le bleu », où le froid est d’emblée suggéré par le titre. Selon Jean Désy, dans son ouvrage intitulé La rêverie du froid[41], rêver le bleu surpasse le rêve de la beauté des mers ou du ciel sans nuage : « Cette profondeur bleue, rêvée au-delà de l’image plane, sous le songe d’un ciel bleu, n’est-elle pas ce froid mortel qui prépare à un au-delà pur, sans en-deçà ?[42] ». Le canteur s’adresse dès l’incipit à son interlocuteur ; l’auditeur, ainsi sollicité par l’emploi de l’impératif à la deuxième personne du singulier, semble alors correspondre à l’ultime ressource du sujet au désespoir :
Sois mon ami je t’en supplie
Plus rien ni personne pour moi ne sonne
Toujours tout seul, pas à demi
Trois jours sans que mots ne soit sortis.
On peut dès lors affirmer que le refrain de la chanson, résolution en majeur de la tension oppressante des couplets en mode mineur, propose une alternative à la solitude, à l’angoisse de l’enfermement, celle de se « projeter dans le bleu », d’aller soi-même vers la mort. L’ouverture dans le ciel constitue l’instant ultime de libération, que l’instrumentation rend à l’auditeur grâce aux synthétiseurs, aux guitares planantes et à une pulsation rythmique plus retenue :
Le ciel ouvert fait de lui un repère
Mes yeux font d’eux un reflet
Qui projettent moi défait
Si le ciel fait une éclaircie
Je te jure à faire des envieux
Je me lance dans le bleu.
Enfin, cette impression de vide et de solitude immense culmine dans la toute dernière pièce de l’album, « Primate électrique ». Au sommet d’un édifice dont la hauteur est « inquiétante pour qui ne sait voler », le sujet, « fatigué » et « esseulé » après un « seul et cuisant chagrin d’amour » se prépare à se « projeter dans le bleu ». Les accords simples de guitare suggèrent le dénuement, sensation qui sera d’autant amplifiée par l’interprétation a capella du premier couplet. Le passage de la voix à l’octave supérieure dans le quatrième couplet insiste non seulement sur la position du sujet dans l’espace, mais ajoute également à la sensation étouffante d’une mort imminente :
Les joues en rivière, les deux mains glacées
Tout le quartier au parterre pariant sur ma chute
« Tombera-t-il au sol ou sur le cabriolet ? »
Qu’importe mais quitter ce monde laid[43].
Le dernier couplet marque le retour à l’interprétation a capella. Dans le vide, la voix se répercute, tel l’écho dans une église. Cette analogie n’est pas gratuite : elle illustre la quête spirituelle d’un désespéré qui, avant de commettre le geste ultime, ressent un peu d’espoir, et attend l’arrivée du printemps comme signe de recommencement, de résurrection naturelle mystique. Le passage à l’accord de la bémol majeur dans la tonalité mineure souligne d’ailleurs cette possibilité de rédemption et de salut :
Je ne dois à personne mon coeur encore qui bat
Qu’à une flamme bonne qui scintilla
Cet instant fatidique avant le saut mortel
Depuis Dieu m’intrigue et j’attends le printemps.
⁂
Ces fragments d’analyse, qui couvrent sept chansons de l’album Quatre saisons dans le désordre, visaient ainsi à proposer une réflexion cantologique sur la précarité dans l’oeuvre de Daniel Bélanger. Insistons donc, pour conclure, sur ces êtres solitaires qui parcourent les chansons et dont la trajectoire n’est certes pas sans embûches. Dans les espaces fantasmagoriques révélés par les textes et les musiques s’enracinent des identités troubles et fragilisées, que nous croyons lyriques dans la mesure où elles s’isolent, se situent en marge d’un monde jugé imparfait, où « il fait froid, où on gèle[44] » préférant un univers où l’on peut « respirer dans l’eau[45] », se projeter « dans le bleu[46] » et où l’été dure « tout l’an[47] ».
Les sujets de « Sortez-moi de moi » et de « Respirer dans l’eau » rapportent au monde tangible leur difficulté à s’incarner dans un corps, qui apparaît ainsi comme une frontière, un obstacle au désir d’entrer en contact avec l’extérieur. Captifs au quotidien, ils ne parviennent pas à l’état de liberté auquel ils aspirent pourtant, celle-ci n’étant rendue possible que par un équilibre fragile entre le repli sur soi et l’ouverture à l’autre. De cette impossibilité à s’atteindre, et du coup à habiter leur environnement, les sujets choisissent de se retrancher dans un monde alternatif, en l’occurrence onirique, où tout est possible.
À son tour, si la fusion du couple semble possible dans « Les deux printemps », elle suppose néanmoins le retranchement du sujet et de l’être aimé pour éviter les « jaloux » qui menacent leur bonheur. Aussi pure et belle semble-t-elle, la félicité amoureuse est précarisée par le temps qui passe et qui risque de séparer les amants, ainsi que le révèle l’étude des temps des verbes et des indicateurs spatio-temporels. Le récit amoureux présenté dans « Les temps fous » et « Imparfait » actualise la séparation des amants dans le temps et l’espace, sorte de dépossession qui contribue au maintien de l’isolement des sujets. « Projection dans le bleu » et « Primate électrique », à leur tour, donnent à entendre le cri d’urgence d’un sujet au bord du gouffre, pour qui l’attente du printemps se révèle signe d’une renaissance ou d’une rédemption prochaine.
Contraints, en somme, à vivre en marge de leurs contemporains qui ne sauraient les comprendre, les sujets étudiés explorent l’espace de l’intime, en quête d’un soulagement lucide. Tout autant que la fragilité s’exprime alors un désir sincère d’ouverture à l’autre, faisant ainsi de ces canteurs de Quatre saisons dans le désordre des sujets certes claustrés, mais non narcissiques, au même titre que ceux des autres chansons de l’album, pour lesquelles une telle réflexion s’avère aussi probante.
Parties annexes
Note biographique
Noémi Doyon
Étudiante au doctorat en études françaises à l’Université de Sherbrooke (C.R.S.H. 2008-2011), Noémi Doyon s’intéresse aux poétiques de la chanson francophone contemporaine. Elle a déposé en 2007, sous la direction de Nathalie Watteyne, son mémoire de maîtrise intitulé Attendre le printemps : équilibres instables dans les chansons de Daniel Bélanger (C.R.S.H. et F.Q.R.S.C. 2005-2006). Elle agit à titre d’assistante de recherche pour le Groupe de recherche sur l’oeuvre d’Anne Hébert.
Notes
-
[1]
Dans sa thèse de doctorat intitulée Les mécanismes de l’interprétation de la chanson populaire : proposition d’une méthode d’analyse (sous la direction de Roger Chamberland, Sherbrooke, 1999), Johanne Melançon livre une analyse exhaustive de l’album D’instinct de Richard Séguin, où elle discute tant de la forme et du contenu de l’oeuvre que de l’épitexte entourant sa parution (discours de presse, communiqués, lancement médiatique, etc.), montrant de façon efficace que l’oeuvre d’un auteur-compositeur-interprète s’insère dans un réseau de production et de performance complexe où s’entrecroisent divers discours auxquels le chercheur se retrouve confronté.
-
[2]
Robert Giroux et al., En avant la chanson, 1993.
-
[3]
Discipline récente qui pose la chanson comme objet d’étude complexe, pour autant qu’elle soit appréhendée sous sa forme aboutie, c’est-à-dire sonore.
-
[4]
Daniel Bélanger, Quatre saisons dans le désordre ; disque compact (Audiogram ADCD10090, 1996).
-
[5]
Voir Stéphane Hirschi, Jacques Brel : chant contre silence, 1995.
-
[6]
La notion de sujet lyrique a été introduite en Allemagne en 1910 par la critique Margerete Susman, précisément pour marquer une différence entre le sujet de l’énonciation et celui de l’énoncé. C’est l’idée de vérité en poésie qui s’est dès lors trouvée mise à mal, de même que celle d’une transparence à soi du poète qui livrerait ses émotions et sentiments personnels.
-
[7]
Karlheinz Stierle, « Identité du discours et transgression lyrique »,1977.
-
[8]
Ibid., p. 439.
-
[9]
Ibid., p. 431.
-
[10]
Voir Dominique Combe, Poésie et récit, une rhétorique des genres, 1989.
-
[11]
Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, 1996 ; Jean-Michel Maulpoix, Du lyrisme, 2000 et Nathalie Watteyne (dir.), Lyrisme et énonciation lyrique, 2006
-
[12]
Soit « Sortez-moi de moi », « Respirer dans l’eau », « Les deux printemps », « Les temps fous », « Imparfait », « Projection dans le bleu » et « Primate électrique ».
-
[13]
Notons, dans le même sens, le graphisme nettement plus dépouillé de la pochette de Quatre saisons dans le désordre : on y voit une représentation fantasmagorique de l’artiste, incarnant un « Pierrot lunaire » seul dans son espace, à l’image des êtres mis en scène dans les chansons.
-
[14]
Jean-Michel Maulpoix, « La quatrième personne du singulier », 1996.
-
[15]
Ibid., p. 153.
-
[16]
Michel Collot, « Le sujet hors de soi », 1996.
-
[17]
Ibid., p. 115.
-
[18]
Ibid., p. 114.
-
[19]
Toutes les paroles citées sont tirées du livret accompagnant l’album.
-
[20]
Il y aurait un parallèle à tracer ici entre l’oeuvre de Bélanger et celles de poètes comme Anne Hébert ou Saint-Denys Garneau, où la claustration et les déséquilibres du corps sont récurrents. Une sensation d’inconfort, semblable à celle exprimée dans la chanson étudiée, se dit en effet dès les premiers vers du liminaire de Regards et jeux dans l’espace :
Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise
Et mon pire malaise est un fauteuil où l’on reste
Immanquablement je m’endors et j’y meurs.
(Saint-Denys Garneau, 1993, p. 19)
Cette idée du geste entravé et de la lutte constante pour briser l’état statique est ainsi commune aux poèmes de Saint-Denys Garneau et aux chansons de Bélanger. Par ailleurs, dans son Journal, le poète fait état de son « besoin pour [s]a guérison de sortir de [lui]-même » (Saint-Denys Garneau, 1996 [1954], p. 22), ce qui ne va pas sans rappeler le titre de la chanson de Bélanger.
-
[21]
Laurent Jenny, « La vulgarisation du sujet lyrique », 2006.
-
[22]
Ibid., p. 62
-
[23]
Isabelle Boisclair et Carolyne Tellier, « Modèles identitaires sexués et rapports amoureux chez Daniel Bélanger », à paraître.
-
[24]
Id.
-
[25]
Les notions de renfort et d’apport de signification en lien avec l’introduction musicale d’une chanson sont empruntées à Jean-Louis Dufays, François Grégoire et Alain Maingain, auteurs de La chanson : vade-mecum du professeur de français, 1994.
-
[26]
Ce qui apparaît également dans les autres albums de Daniel Bélanger, notamment Les insomniaques s’amusent (1992) et Rêver mieux (2002).
-
[27]
Stéphane Venne, Le frisson des chansons : essai de définition d’une bonne chanson, des conditions nécessaires pour mieux l’écouter et des conditions utiles pour en écrire, 2006.
-
[28]
Ibid., p. 155.
-
[29]
Dont la figure de temps de base est la croche, contrairement, par exemple, à une mesure en 4/4, où la figure de temps de base est la noire.
-
[30]
Ibid., p. 366.
-
[31]
Nous renvoyons ici à Joëlle De Sermet, « L’adresse lyrique » ainsi qu’à Jean-Michel Maulpoix, « La quatrième personne du singulier », 1996.
-
[32]
La basse fretless ne comprend pas les petites barres métalliques (frettes) que l’on retrouve sur le manche des basses classiques. Cet instrument émet un son plus chaud, plus rond et plus riche, puisque les cordes sont en contact direct avec le bois. L’absence de frettes permet également d’atteindre une infinité de notes difficilement accessibles sur une basse frettée, en plus de favoriser la continuité et la vibration du son. Par sa nature même qui offre la possibilité de glisser les doigts sur le manche (glissando), la basse fretless rend les sons plus « coulants » et suggère, comme le dénote son usage extensif dans les ballades, la langueur et la sensualité.
-
[33]
Isabelle Boisclair et Carolyne Tellier, « Modèles identitaires et sexués et rapports amoureux chez Daniel Bélanger », art. cit., p. 12.
-
[34]
Id.
-
[35]
Dominique Rabaté, « Énonciation poétique, énonciation lyrique », 1996.
-
[36]
Ibid., p. 72.
-
[37]
Parmi les influences qu’il livre en entrevue (voir Georges-Hébert Germain, « Le poète du palmarès », 1994, p. 61), Bélanger mentionne celle de Réjean Ducharme. Sans doute y aurait-t-il ici un lien à tracer entre le destin des amoureux des « Temps fous » et ceux de L’hiver de force, personnages en marge de leur société, qui se cloîtrent pour échapper à « la saison où on reste enfermé dans sa chambre parce qu’on est vieux et qu’on a peur d’attraper du mal dehors […] » (Réjean Ducharme, L’hiver de force, 1973, p. 274).
-
[38]
Un accord de septième majeur est un accord de base (tonique, médiante et dominante) auquel on a ajouté la septième note de la gamme, haussée d’un demi-ton. La seconde mineure ainsi créée et insérée dans l’accord rend ce dernier instable et légèrement dissonant.
-
[39]
Ce chuchotement caractéristique à « Imparfait » nous rappelle le commentaire de Jean-Michel Maulpoix, lorsqu’il observe que « [l]e sujet lyrique est un sujet plein de voix tues qui sont comme les dépouilles de ses chimères et de ses potentialités. Car le lyrisme est une affaire qui tourne mal. Ce sujet en puissance, mobile et déplacé, devient vers après vers, poème après poème, un sujet crypte, un sujet crypté, un rêve de sujet, un reposoir du sujet […] » (Du lyrisme, op. cit., p. 159).
-
[40]
Dans l’entrevue précédemment citée, Bélanger exprime sa fascination pour La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Cet emploi inusité du mot « transsibérien » constitue un intertexte explicite du poème de cet écrivain marginal.
-
[41]
Jean Désy, La rêverie du froid, 1991 [1988].
-
[42]
Ibid., p. 137.
-
[43]
Un tel refus du monde qui, par hasard objectif, met en perspective du suicide d’Anna Karénine, sous un train au départ dans le roman de Tolstoï, se dit aussi dans « Le voyage » de Baudelaire, dernier poème des Fleurs du mal :
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !
Faut-il partir ? Rester ?
Ou encore : « Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons ! […] ». Au même titre que « Primate électrique », ce poème est le dernier du recueil. Si le désespoir, le spleen baudelairien teinte bon nombre de chansons de Bélanger, une lumière ne se révèle pas moins dans celles-ci, notamment dans « Primate électrique », qui vient ouvrir la voie à une renaissance prochaine, rappelant alors le désir d’élévation, qui est spécifique de la poésie de Saint-Denys Garneau.
-
[44]
Tiré de la chanson « Cruel (il fait froid, on gèle) ».
-
[45]
Tiré de la chanson du même nom.
-
[46]
Tiré de la chanson « Projection dans le bleu ».
-
[47]
Tiré de la chanson « Les deux printemps ».
Références
- Bélanger, Daniel, Quatre saisons dans le désordre ; disque compact (Audiogram ADCD10090, 1996).
- Isabelle Boisclair et Carolyne Tellier, « Modèles identitaires sexués et rapports amoureux chez Daniel Bélanger », dans Lucie Joubert (dir.), Archives des lettres canadiennes, Ottawa, C.R.C.C.F., 26 feuillets. [à paraître]
- Collot, Michel, « Le sujet hors de soi », dans Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives littéraires), 1996, p. 113-125.
- Combe, Dominique, Poésie et récit, une rhétorique des genres, Paris, José Corti, 1989.
- De Sermet, Joëlle, « L’adresse lyrique », dans Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives littéraires), 1996, p. 81-97.
- Désy, Jean. La rêverie du froid, Paris, Le Palindrome, 1991 [1988].
- Ducharme, Réjean, L’hiver de force, Paris, Gallimard (Folio), 1973.
- Dufays, Jean-Louis, François Grégoire et Alain Maingain, La chanson : vade-mecum du professeur de français, Bruxelles, Didier Hatier (Séquences), 1994.
- Germain, Georges-Hébert, « Le poète du palmarès », dans L’actualité, vol. XIX, n° 1 (1994), p. 61.
- Hirschi, Stéphane, Jacques Brel : chant contre silence, Paris, A.-G. Nizet (Chanteurs – Poètes), 1995.
- Jenny, Laurent, « La vulgarisation du sujet lyrique », dans Nathalie Watteyne (dir.), Lyrisme et énonciation lyrique, Québec — Bordeaux, Nota Bene — Presses universitaires de Bordeaux, 2006, p. 53-73.
- Maulpoix, Jean-Michel, Du lyrisme, Paris, José Corti, 2000.
- Maulpoix, Jean-Michel, « La quatrième personne du singulier », dans Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives littéraires), 1996, p. 147-160.
- Melançon, Johanne, « Les mécanismes de l’interprétation de la chanson populaire : proposition d’une méthode d’analyse », thèse de doctorat, sous la direction de Roger Giroux, Université de Sherbrooke, 1999.
- Rabaté, Dominique, « Énonciation poétique, énonciation lyrique », dans Dominique Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives littéraires), 1996, p. 65-79.
- Saint-Denys Garneau, Hector de, Journal, Montréal, Bibliothèque québécoise (Littérature), 1996 [1954] (éd. de G. Huot).
- Saint-Denys Garneau, Hector de, Regards et jeux dans l’espace, Saint-Laurent, Bibliothèque Québécoise (Littérature), 1993 [1937] (éd. de M.-A. Lamontagne).
- Stierle, Karlheinz, « Identité du discours et transgression lyrique », dans Poétique, n°32 (1977), p. 422-441.
- Venne, Stéphane, Le frisson des chansons : essai de définition d’une bonne chanson, des conditions nécessaires pour mieux l’écouter et des conditions utiles pour en écrire, Montréal, Stanké, 2006.
- Watteyne, Nathalie (dir.), Lyrisme et énonciation lyrique, Québec — Bordeaux, Nota Bene — Presses universitaires de Bordeaux, 2006.