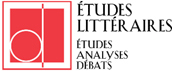Corps de l’article
C’était d’une telle évidence, elle s’était laissé convaincre facilement. Ils avaient trouvé les mots, ils avaient une telle assurance quand ils s’étaient présentés au lendemain des funérailles qu’elle n’avait pas hésité très longtemps.
Ils prétendaient avoir besoin de la maison. Pour la démolir. À bien y penser, ce n’était qu’une vieille maison délabrée, usée par des années sans entretien. Si petite qu’aucune famille d’aujourd’hui ne pourrait y tenir, et toutes ces réparations à envisager, non, ce serait vraiment insensé. En plus, au bout d’un rang perdu… Avait-elle pensé à tout cela dès lors qu’elle se retrouvait seule ? lui répétaient-ils en appuyant sur le mot seule. Elle avait bien eu un geste de recul quand ils avaient parlé de démolir la demeure, mais on n’arrête pas le progrès, ma petite dame, avaient-ils dit en riant, l’achat de la maison et surtout sa disparition leur permettrait de construire cette porcherie dont l’économie locale ne pouvait se passer.
Marché conclu. La somme qu’elle avait retirée de la vente, bien que dérisoire, lui semblait exorbitante. Elle n’avait jamais possédé autant d’argent. En fait, elle n’avait jamais rien possédé. Et pour ajouter à l’impression d’abondance, comme elle venait d’atteindre soixante-cinq ans, elle reçut un premier chèque de la Sécurité de la vieillesse. Une sorte de vertige s’empara d’elle. La vie s’ouvrait. Trop tard, bien sûr, mais elle s’ouvrait tout de même. Elle ne savait que faire de ce cadeau.
Fille unique d’un couple asocial, elle était née dans cette maison et ne l’avait jamais quittée. Son père était mort, foudroyé par le cancer alors qu’elle était adolescente. Elle avait cessé de fréquenter l’école pour rester avec sa mère. Ce qui l’avait déchargée d’un grand poids ; sa timidité maladive, son physique ingrat, sa pauvreté attiraient les regards et les commentaires. Avait alors commencé une longue routine, un long chemin droit et sans chaos : sa vie.
Elle était de ces êtres qui portent en eux la résignation dès leur naissance, qui ne connaissent ni l’attente ni le désir ou l’espoir. Elle était née pour vivre dans cette maison avec sa mère. Le temps passerait, les années s’écouleraient, toutes deux seraient à l’abri du vent, du froid et de la pluie. C’est bien pour cela que les maisons existent. Un jour, sa mère deviendrait vieille et malade. La maison les protégerait. Il n’y a rien à craindre de la vie quand on possède une maison.
Et la vie était passée. Les époques s’étaient succédé, le monde avait changé. La maison se délabrait, mais tenait bon, comme hors d’atteinte. Un jour, la route avait été élargie et asphaltée. Les rares camions qui passaient faisaient vibrer les carreaux des fenêtres. C’était chaque fois un événement.
Maintenant, elle n’en revient pas comme il est simple de changer de vie. La voilà assise devant la télé, dans le salon d’un appartement minuscule. Son appartement. Le sien. À elle. Juste à elle. Inouï.
Elle a choisi de venir vivre en ville. Pas dans ces villes monstrueuses qui vous avalent, vous rapetissent comme des fourmis, non, dans une ville moyenne, sans histoire, avec des autobus et des épiceries où vous entrez sans que personne ne vous remarque, ne vous connaisse. Elle change constamment d’épicerie. Elle veut toutes les essayer, les comparer. L’alimentation est sa grande révolution depuis son arrivée. Elle peut choisir ce qui lui plaît, même des aliments dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Comme elle est seule et mange peu, elle parvient même à se payer des extravagances. Des fraises en janvier, des mangues, des tartes à la noix de coco surgelées. Ses folies, comme elle aime à les appeler, l’exaltent. Chaque fois qu’elle entre dans une épicerie, il y a cette chose inconnue à débusquer, qui n’attend qu’elle. Une seule ombre au tableau : les saucisses de Francfort. Elle n’en mange plus, mais demeure incapable de ne pas en acheter. Quand sa mère était morte, au moment même de son dernier souffle, elle avait pensé aux saucisses. La libération. Terminée l’odeur du gras dans la maison à l’heure des repas, terminé le goût de la moutarde pour masquer celui des saucisses, jour après jour. Durant les dernières années de sa vie, sa mère n’avait voulu que des saucisses de Francfort. Au début, elle avait risqué la stratégie de la diversion en lui demandant chaque jour ce qu’elle avait envie de manger, tout en suggérant des choix : pâté chinois ? macaroni ? sandwich aux oeufs ? Invariablement, la réponse fusait de la bouche à moitié édentée de sa mère : des saucisses ! Elle avait tout de même tenté de lui préparer d’autres mets. Peine perdue, tout s’était mis à goûter la saucisse de Francfort : le pâté chinois, le macaroni, les sandwiches aux oeufs. Une fatalité, une maladie incurable. L’épicière du village lui adressait un sourire condescendant quand, chaque semaine, elle venait chercher sa ration de protéines bon marché.
C’est à cette époque qu’elle avait trouvé, un matin, sur la galerie, un vieux chien maigre sans race et sans collier, trempé et grelottant. Il l’avait dévisagée en la suppliant : un abri au sec et de la nourriture. Elle l’avait installé dans le hangar attenant à la maison et le nourrissait aux saucisses qu’elle découpait minutieusement en très petits morceaux pour qu’il ait l’impression d’en avoir davantage. Elle n’en avait soufflé mot à sa mère qui, de toute façon, ne sortait plus ni ne regardait par les fenêtres.
Dans les semaines qui suivirent l’arrivée du chien, ses achats de saucisses doublèrent, le sourire de l’épicière vira carrément au mépris. Elle s’attacha au chien. Les saucisses justifiaient enfin leur propre existence, et sa vie devenait moins absurde. Un beau matin, le chien ne vint pas à sa rencontre quand elle sortit le nourrir. Lui aussi en avait eu assez des saucisses.
Les paquets de saucisses s’accumulent dans le congélateur du frigo. Bien alignés, empilés les uns sur les autres. Ils lui disent qu’une vie ne se reprend pas, que la paix ou même le bonheur, ça ne s’attrape pas sur le tard. Qu’ils seront toujours là, bien sages et bien gelés pour lui rappeler qu’elle portera jusqu’à la fin ses chaînes et son boulet en forme de petite maison au fond d’un rang. La nuit, parfois, elle entend la voix de sa mère : des saucisses ! des saucisses ! Elle en perd l’appétit.
Il y a tout près de chez elle un cimetière immense. De sa fenêtre, elle en voit le toit : le feuillage de centaines d’érables se rejoint et forme un couvercle opaque. Un après-midi de soleil, elle brave sa peur des morts et s’y rend, poussée par une irrésistible envie de se fondre au vert des arbres.
Dès qu’elle passe les clôtures de fer ouvragé, elle se retrouve dans un autre monde. Elle est étonnée. Il fait bon. Quelques personnes, çà et là, se promènent nonchalamment, deux garçons d’une dizaine d’années, revêtus de vieilles couvertures en guise de capes, s’affrontent à coups de deux par quatre qui leur tiennent lieu d’épées. Elle entend leurs rires se répandre entre les arbres. Ailleurs, un chien court, s’en donne à coeur joie, suivi de loin par sa maîtresse.
Elle frissonne. La vie lui fait un signe. Elle ne peut en douter.
Elle y retourne le lendemain et le surlendemain. Puis tous les jours. Les habitués se mettent à la saluer : bienvenue dans la confrérie. Il arrive qu’on lui parle de la pluie et du beau temps. Elle connaît les chiens par leur nom.
Quand elle rentre, elle a l’impression que l’appartement a rapetissé, que les murs se sont rapprochés. La seule chose qui demeure intacte, c’est le frigo, et encore, la porte du congélateur semble prendre de l’expansion. Un beau matin, le congélateur est plein à craquer. Elle tente de replacer les paquets de saucisses pour gagner un peu d’espace, mais rien n’y fait.
La vie lui fait signe de nouveau : elle sort un paquet et le dépose sur le comptoir. Le grand dégel vient de commencer.
À la fin de l’après-midi, à l’heure où la lumière se change en caresse, à l’heure aussi où les gens, rentrés du travail, emmènent leurs chiens courir, elle met les saucisses dans son sac à main et prend la direction du cimetière pour sa promenade journalière.
Assise sur un muret de pierre entourant un tombeau, elle attend. Le premier qui apparaît dans son champ de vision est un setter irlandais, jeune et fou, qu’elle aime bien. Elle l’appelle. Il vient immdiatement. Son maître au loin lui envoie un grand geste amical de la main. Les familiers du cimetière ont craqué pour la petite dame timide et toujours seule.
Le setter se régale. Et après lui, deux labradors, un colley, un épagneul, un boxer et quelques autres. Après deux jours de ce manège, plus besoin de les appeler, dès qu’ils l’aperçoivent assise toute droite et menue sur le muret, ils accourent.
Pendant que le congélateur se dégarnit, pendant que les saucisses s’engouffrent dans des gueules baveuses et ravies, et que des mains s’agitent pour saluer, au fond d’un rang, sur les lieux mêmes où a existé une minuscule maison, s’érige le plus gros complexe porcin de la région, au bonheur de tous les amateurs de saucisses de Francfort.
Parties annexes
Note biographique
Christiane Frenette
Poète, romancière et nouvelliste, Christiane Frenette est née à Québec. Elle enseigne la littérature au collégial. Elle a publié une dizaine de titres qui lui ont valu plusieurs prix et distinctions. Elle a signé des recueils de poésie dont Indigo nuit (Montréal, Éditions Leméac, 1986), Prix Octave Crémazie, et Les fatigues du dimanche (Québec, Éditions du Noroît, 1997). Son premier roman s’est mérité le Prix littéraire du gouverneur général du Canada en 1998. Après une décennie de publications consacrées à la fiction narrative, elle marquait son retour à la poésie en 2007 avec la parution du recueil Territoires occupés (Québec, Éditions Le lézard amoureux, 2007).