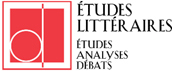Corps de l’article
Il ne savait plus si c’était l’aube ou le crépuscule. Une lumière indécise, d’un gris opaque, avait remplacé le bleu liquide et l’air transparent de la montagne. Il avança jusqu’au bord de la falaise, regarda, hébété, l’étendue de l’eau, cette nouvelle mer couleur de plomb, sans mouvement, sans le cri d’un oiseau. Les premiers jours, d’énormes bulles d’air en avaient crevé la surface, projetant des débris, des troncs d’arbres calcinés qui sombraient aussitôt comme s’ils avaient été en pierre. Maintenant, plus rien. Le sentier qu’il avait emprunté deux fois par cycle lunaire pour se rendre à la ville, au pied de la montagne, avait disparu dans des crevasses. Les cyprès lui servant autrefois de repères, plantés à chaque courbe du chemin sinueux et taillés à leur cime en forme de trident, avaient péri dans cette interminable nuit de pluie bouillante mêlée de cailloux chauffés à blanc. Son rocher, un immense cône de granit entre le bleu et le vert, autrefois lisse comme un cristal poli, avait été secoué dans un grondement sourd montant de la vallée, brisant les murs de sa maison, les terrasses. Ce bruit avait été son dernier souvenir avant qu’il ne perde connaissance. Un éclat avait dû se détacher du rocher et l’assommer ; à son réveil, il s’était dégagé de la poutre qui lui avait sauvé la vie. Il avait trouvé refuge sous les colonnes du portique de sa maison, tombées pêle-mêle, formant un abri de fortune. Il s’était protégé la bouche et le nez pour ne pas étouffer dans l’air poisseux, chargé d’une insupportable odeur de soufre, de bois et de chair brûlés.
L’événement s’était produit il y avait quelques jours, une semaine peut-être. Depuis, plus de soleil, plus d’astres, plus de bruits annonçant un réveil après la nuit. Il regarda à nouveau le rocher, comme s’il pouvait y trouver un signe envoyé par le dieu de la mer. Mais rien ; le sommet du bloc, autrefois étincelant au soleil, couvert de neige dès l’automne, se perdait dans la brume.
C’était justement l’emplacement de la propriété qui l’avait séduit, loin au-dessus de la vie grouillante dans la vallée, avec les rayons du soleil qui baignaient la vaste maison une heure avant de toucher la ville au pied du sentier. Le général de l’armée orientale, le plus important contingent militaire de l’empire, lui en avait vanté les avantages et raconté, avec des clins d’oeil vulgaires, combien de fêtes inoubliables y avaient eu lieu. À l’époque, le petit palais lui avait semblé une forteresse ; maintenant, les ruines étaient tout ce qui restait de son existence antérieure.
Rien de ce qu’il avait fait pour se rendre autonome ne subsistait. À plus de deux mille pas au-dessus du niveau de la mer, seules certaines plantes résistaient au froid. Il avait consulté des spécialistes afin de composer des jardins en terrasses, arrachées au roc par le labeur de centaines d’esclaves, pour choisir leur orientation, pour agencer des vergers aux arbres fruitiers nains. Il avait fallu transporter la terre grasse de la vallée, seau par seau, à dos d’âne. À la fin, ses jardins accrochés aux flancs du cône en épousaient harmonieusement la forme. Leur création lui avait coûté une fortune. Les ouvriers, pour la plupart des prisonniers capturés lors d’expéditions dans des contrées rebelles au-delà du détroit, à l’est, avaient créé l’illusion d’une oasis en plein désert de granit. Un système complexe de gouttières recueillait la rosée du matin, abondante à cause des vents d’ouest, suffisante pour les cuisines et ses bains rituels.
⁂
Depuis qu’il avait abandonné la carrière militaire, il suivait strictement les lois du culte, voué au dieu de la mer et à sa famille, dont les empereurs se disaient les descendants. Mais la religion s’était vidée de son sens. Dans les monastères, les théologiens passaient leurs journées à se quereller au sujet de tel ou tel passage des écritures sacrées. Ils écrivaient de longues dissertations traitant de sujets sans importance, ne rendant hommage au dieu, le père, leur maître, que du bout des lèvres.
Certains d’entre eux avaient prédit l’événement. Les éruptions volcaniques dans le nord du continent, le ciel assombri, les cités des lagunes noyées dans une tempête effroyable, la migration hâtive des oiseaux, les entrailles des bêtes qu’ils venaient de sacrifier et l’examen des viscères des suppliciés, tout indiquait un bouleversement, un changement brutal dans le destin de l’empire. Ils n’étaient pas certains de l’heure et les circonstances restaient obscures, mais ils affirmaient que la catastrophe serait imminente et qu’elle viendrait de la mer. Quelques-uns avaient abandonné temples et monastères pour avertir le peuple en prêchant sur les marchés, les grandes places avec leurs boutiques de luxe cachées sous les colonnades, les auberges, les bordels, devant les vendeurs de toutes sortes de choses, d’amulettes et de talismans, de remèdes fabriqués à l’étranger, de potions aphrodisiaques, de rafraîchissements. Mais personne ne les écoutait ; on les traitait de fous, d’illuminés, de reliques du passé. Des religions venant de l’est avaient supplanté les croyances vieilles de dix mille ans. Depuis quelques générations, on écoutait avec plaisir ces faux prophètes, ces charlatans venus des deux continents au-delà du détroit, leurs discours mielleux. C’étaient des gens à la peau noire ou bistre, parlant avec un accent guttural, incultes, crasseux, aux moeurs libres. Ils s’accouplaient avec les femmes blondes du continent et engendraient des bâtards aux cheveux noirs, crépus, aux yeux de charbon. Ils racontaient des histoires séduisantes mettant en scène des divinités qui enseignaient aux mortels comment mieux profiter du court moment d’une vie. Les règles établies par le père des dieux, prescrivant une existence austère, vouée au service de la communauté et à la domination du monde connu, on les oubliait volontiers, on s’en moquait ouvertement.
Sans doute, l’événement avait été une punition. Dans sa colère contre son peuple, le père avait remué les fonds de la mer avec son trident pour mettre fin à leur désobéissance.
⁂
Dès le lendemain de la pluie de feu, il avait cherché à boire. Mais les cailloux chauds et gluants bouchaient les gouttières, il n’y avait pas de rosée. L’homme avait faim. De ses vergers, de ses jardins, il ne restait même plus une pelletée de terre.
Il avait donné des ordres pour que les serviteurs préparent tout pour la saison froide puisque la descente en ville s’avérait alors pénible, sinon impossible, soit à cause des pluies abondantes, soit en raison de la neige. Il se fit des reproches de ne pas mieux connaître les quartiers du personnel, tous des esclaves assez vieux, rachetés parce que leurs maîtres n’en voulaient plus.
Vivant en ascète, il avait fait aménager quatre pièces seulement à son usage exclusif : la serre, un chef-d’oeuvre de cristal fin captant le maximum de lumière, lui livrait les substances pour ses remèdes qu’il préparait dans un laboratoire situé entre la serre et la bibliothèque. On lui servait ses repas, frugaux, dans une petite salle à manger. Il faisait la sieste et dormait, la nuit, quelques heures dans une chambre presque vide, avec comme seul mobilier un lit, une table et une chaise. Il passait la plus grande partie de sa vie dans la bibliothèque, une vaste salle carrée, sans le moindre ornement, blanchie à la chaux comme les autres pièces, et contenant surtout des oeuvres savantes. Il chérissait l’ordre des rouleaux, chacun bien identifié. Rarement, il visitait certaines sections, comme l’histoire militaire, sans intérêt désormais. Poèmes, récits de voyage, romans occupaient un mur entier ; le soir, il avait l’habitude d’y choisir une lecture le berçant jusqu’à la venue du sommeil. Les ouvrages de médecine étaient sa grande passion.
Lors de ses expéditions de guerre contre les deux continents, à l’est du détroit, il avait admiré l’habileté des médecins, tous des prêtres, formés dans les grandes écoles des temples. D’un tas de chair sanguinolente, ils réussissaient à reconstruire un être humain, aussi blanc, aussi blond qu’avant, avec des membres déliés et prêt à reprendre le combat après quelques semaines de convalescence. Leur connaissance du corps humain le stupéfiait ainsi que la rapidité de leur diagnostic : d’un regard, ils sauvaient ou abandonnaient le blessé à sa mort. Rarement, ils se trompaient, ils réussissaient les opérations les plus délicates. Aidés par les pharmaciens, ils s’acharnaient là où il ne voyait que désespoir. Mais ils dirigeaient également les mises à mort des prisonniers de guerre haut gradés qui refusaient de soumettre leur pays à l’empire. Ces hommes subissaient des supplices d’une extrême cruauté ; leurs bourreaux étaient les meilleurs médecins-prêtres qui les ramenaient jour après jour à la vie, ne les abandonnaient qu’au moment où le peuple s’ennuyait et réclamait qu’on en finisse.
Au zénith de sa carrière militaire, il prit en horreur les mutilations, le sang et la guerre. Trop d’hommes perdaient la vie pour la gloire ou l’ambition de l’empire. Alors il avait présenté à l’empereur une demande jugée avilissante par ses parents, ses frères et soeurs. Même sa femme l’avait quitté à la suite de sa démarche : entrer comme élève au temple le plus renommé de l’empire, et apprendre la médecine des prêtres, dans le but explicite qu’on ne lui demande jamais autre chose que de guérir les malades, sans recourir à la chirurgie, et d’être libéré de sa charge lors des supplices publics. En se faisant prêtre et médecin, il abandonna la voie tracée par sa famille qui avait fourni à la cour impériale des générations de ministres, conseillers, diplomates. Il ne céda à aucune pression. Déjà avant le début de ses études, il suivait la loi du dieu, mettait sa vie au service des autres.
Devenu un homme d’âge mûr, il retira des coffres familiaux ce qu’il lui fallait pour s’installer sur le rocher. Conforme à son voeu, il n’opérait jamais, se spécialisait dans les remèdes, s’associait aux meilleurs connaisseurs des plantes, guérissait presque sans intervenir, écoutait les malades. Quand il descendait dans l’hospice au fond de la vallée, il était reçu comme un sage ou un bienfaiteur qui pouvait tout. Sa renommée fut si grande que les malades, venus en grand nombre et dont plusieurs avaient abandonné leur place dans un temple, accueillaient l’arrivée de sa litière à grands cris de joie.
Une fois de retour sur le rocher, il poursuivait ses lectures et les expériences avec les plantes rares dans la serre. Il en tirait des sucs aux qualités médicinales puissantes, se procurait les oeuvres scientifiques les plus récentes. À l’occasion, et de façon distraite, il adressait la parole aux serviteurs qui s’occupaient de lui avec adoration et gratitude. Les animaux le laissaient indifférent ; par égard pour les esclaves, il avait permis la présence d’un chat, une des rares bêtes qu’il fallait vénérer selon le culte.
Il ne recevait jamais de visites. Se mêler à la foule de ses patients lui suffisait.
⁂
Après l’événement, il avait tenté de repérer les pics d’autres montagnes aussi hautes que son rocher. Mais la brume empêchait de voir au loin. Pour la première fois, les oiseaux lui manquaient ; auparavant, il avait ressenti de l’impatience en entendant leurs cris qui le dérangeaient. Il en avait trouvé des cadavres sur le sol, les ailes brûlées, le bec ouvert.
Dès le troisième jour, comme aucune embarcation ne venait à sa rescousse, il se dit que toute vie sur le continent avait été effacée. Alors il s’était mis à la recherche des réserves de nourriture dont il savait l’existence. La maison comptait jadis trois étages, collés au flanc du rocher. Au deuxième, où logeaient les esclaves, quelques murs tenaient encore debout, dont les fresques, représentant des fleurs aux couleurs vives, lui rappelaient douloureusement ce qu’il appelait déjà le passé. En peinant, il enleva des décombres afin de dégager l’entrée du dernier étage. Il cherchait les cuisines et les trois cubicules, creusés dans le roc et contenant les réserves pour l’hiver prochain. En soulevant une poutre, il découvrit les cadavres d’un homme et d’une femme, puis, à son étonnement, celui d’un enfant. Il avait tout ignoré de son existence, ne l’ayant jamais vu ni entendu. Il traîna les corps cireux et gonflés jusqu’au bord de la falaise, les fit basculer dans le vide.
Lorsqu’il trouva l’entrée des réserves de nourriture, il ne put réprimer un soupir de soulagement. Là étaient entreposés les tonneaux en terre cuite contenant des céréales, des légumes séchés, des viandes salées et des amphores remplies d’un vin qu’il affectionnait beaucoup, un blanc fruité et trop faible pour l’enivrer. En déplaçant des planches du plafond effondré et des meubles à moitié brûlés, il toucha à un corps chaud et doux, sortit le chat tout engourdi qu’il caressa lentement jusqu’à ce qu’il commençât à s’étirer. L’animal flaira la longue robe jaune et les sandales de l’homme. Bien qu’il l’eût souvent aperçu avant l’événement, et observé avec bienveillance selon la loi, jamais encore la vue de cet animal ne lui avait causé une si vive émotion. La bête était belle, de longues pattes, le pelage dru, brun, des yeux d’ambre. Bientôt, elle frôla ses jambes et émit un miaulement. C’était le seul être vivant à qui parler. Au début, l’homme trouvait ridicule ce dialogue, l’un parlant à l’autre dans une langue étrangère. Puis il s’y fit, éprouvant du plaisir à ce que l’animal le suivît partout.
Il dégagea encore deux cadavres. Il ne pouvait deviner ce qu’étaient devenus les autres serviteurs ; dès les premières secousses, ils avaient peut-être fui en empruntant le sentier pour y rencontrer leur mort.
Le cuir avec lequel les esclaves avaient couvert le haut des tonneaux était déchiré, mais le contenu était resté intact, de même que la cire qui bouchait les amphores. Il y avait beaucoup de provisions, assez pour que la douzaine de personnes vivant habituellement sur le rocher puisse passer confortablement l’hiver. Il se félicita d’avoir agi en maître prévoyant. Quand il pénétra dans le second cubicule où se trouvaient les amphores, il crut entendre de faibles appels, comme des pépiements, venant de l’autre côté de la porte menant au troisième entrepôt dont il ignorait le contenu. Il la poussa de toutes ses forces, ne réussit pas à l’ouvrir : quelque chose la bloquait de l’autre côté. Il supposa que c’était un objet lourd, une poutre du plafond écroulé, des détritus, ou les corps de serviteurs blessés. Le lendemain, il entendit un long sifflement aigu qui n’avait rien d’humain ; il fit une nouvelle tentative pour ouvrir la porte, en vain. Il pensa que, s’il allait trouver un survivant, ses réserves de nourriture seraient réduites de moitié et qu’il valait mieux le laisser mourir. Sa conscience le tortura deux jours durant. Quand il abandonna ses tentatives de sauvetage, il se justifia en se disant qu’il ne pouvait plus guérir personne puisqu’il ne lui restait rien de ses instruments de laboratoire, des teintures, poudres, onguents, sauf quelques lourdes fioles en verre épais, soigneusement scellées et qui avaient résisté aux chocs lors de l’effondrement de son étage. Il n’y avait rien d’écrit dessus ; ce genre de contenant ne renfermait que les poisons les plus puissants. Il les entassa dans un coin de ce qui avait été la terrasse d’où il aimait contempler la vallée et, au loin, les plaines aux couleurs changeantes selon les saisons. En même temps il sourit : ces flacons ne pouvaient plus tomber entre des mains profanes.
Le lendemain, les bruits venant du sous-sol avaient cessé.
⁂
Le chat ne mangeait rien de ce qu’il lui offrait. Il ne touchait pas à l’eau putride que l’homme avait filtrée à l’aide d’un bout de tissu arraché de sa robe, légère et chaude, un mélange de laine et de lin. En pressant la boue des gouttières, il réussit à faire couler dans le tesson d’une amphore un liquide jaunâtre, puant le soufre. Il y goûta, cracha, craignant de s’empoisonner. À la brunante, le chat filait vers l’escalier menant aux cubicules, disparaissait jusqu’au lendemain, puis lui tenait compagnie pendant le jour.
La mer restait calme. Toujours le brouillard formait un mur que le regard ne perçait pas. À quelque mille pas de la maison se trouvait un pic semblable au sien, à l’ouest. Autrefois, à l’aide d’un miroir il avait échangé quelques politesses avec son voisin, un riche marchand. Dès l’enfance, tout le monde apprenait cette façon simple et efficace de communiquer à distance, en même temps que lire, écrire et faire des calculs. C’est ainsi qu’il avait su ce qui s’était produit dans le nord du continent, avant ce qu’il appelait l’ « événement », détruisant son monde : l’océan et les volcans qu’on disait morts avaient englouti les grandes cités des lagunes. Mais il ne trouvait pas un morceau de verre poli, un miroir ou un bout de métal. De toute façon, le soleil ne perçant pas la brume, toute tentative d’envoyer des signaux était vaine.
⁂
Un jour, vers ce qu’il croyait être le milieu de l’après-midi, le chat émit un grognement, fixant la première marche de l’escalier menant à l’étage des vivres. Les oreilles dressées, les pattes tendues, la queue fouettant la plaque de granit, il ne bougea pourtant pas. D’abord, le médecin ne remarqua rien, sauf un léger mouvement, un bout de planche qui tremblait, puis la tête d’un rat qui l’observait. Il y avait dans ces yeux noirs, brillants, vifs, autant de peur que de prudence : l’homme s’était penché pour saisir un caillou qu’il lança à toute volée sur la planche. Mais le rat avait disparu.
L’homme se leva et courut au bord de la falaise, appuya les mains sur ce qui restait d’un mur soutenant une plate-bande détruite. Il vomit. Depuis toujours, les rats étaient considérés comme les pires ennemis de l’empire. On savait qu’ils répandaient le malheur, toutes sortes de maladies, dont la peste, et qu’il fallait les exterminer dès leur apparition. Les navires des marchands étaient fouillés par des équipes spécialisées avant de pouvoir décharger leur cargaison. Quand les bâtiments de guerre accostaient, ils étaient soumis aux mêmes inspections. Mais les rats devançaient les mesures prises contre eux. Ils survivaient dans les égoûts, se cachaient dans les recoins des charniers, sous les montagnes d’ordures loin des villes, à la campagne. Dans les ports, on en apercevait qui disparaissaient dans les caves. C’étaient de longues ombres rapides, brunes ou noires. Les villes dans les lagunes étaient plus vulnérables que d’autres, à cause de la difficulté de les y traquer. Là, même les chats les plus téméraires n’osaient plus les approcher, tant les rats étaient énormes.
Il était secoué par un dégoût héréditaire devant ces bêtes. Une fois, pendant une expédition, il en avait vu un, écrasé sous les roues d’un char de guerre. Ses pattes griffées étaient comme des mains, fermées dans un dernier spasme, le corps trapu et musclé, le pelage noir, luisant, la gueule ouverte, les incisives jaunes. Déjà, de grosses mouches s’étaient posées sur le cadavre. Tous avaient reculé, comme s’ils craignaient qu’elles ne les contaminent. La queue, nue, grise, couverte d’écailles, lui avait semblé particulièrement répugnante. Être en présence de ce qu’on lui avait toujours décrit comme l’incarnation de l’immonde l’avait ébranlé si fortement qu’il avait dû se rappeler à l’ordre : devant un rat mort, il avait tremblé comme une vierge offensée, s’était sauvé comme les autres, lui, un homme fort, le soldat habitué à toutes les horreurs de la guerre et de la misère humaine, riche, appartenant à l’une des meilleures familles de l’empire.
Et maintenant, il venait de voir le symbole même du mal, sur son rocher, son refuge devant tout ce qu’il abhorrait en ce monde. Cela vivait sous sa maison, depuis longtemps, peut-être. Le rat s’était glissé chez lui, il était une autre punition envoyée par le dieu : pour le moment, le père épargnait sa vie, mais il lui rappelait que rien ne lui échappe, qu’il rattrappe même l’homme le plus probe.
Frottant vigoureusement ses mains glacées, il remarqua que les ongles avaient poussé, mais l’esclave responsable des soins de son corps avait disparu, et avec lui ses instruments, huiles, sels vivifiants, lotions pour la peau. Chaque jour qui passait, il semblait faire plus froid, le soleil ne perçant toujours pas le brouillard.
Tout à coup il comprit pourquoi le chat ne mangeait rien de ce qu’il lui offrait. Il y avait plusieurs rats. L’animal en avait tué et mangé, il était devenu impur. Le médecin se souvint des leçons de ses maîtres : tout ce qui a été en contact avec les rats devait être détruit, tué, brûlé. Mais il se sentait incapable de supprimer cette bête attachante, la seule qui pût le protéger. Le chat était assis à côté de lui, le fixait de ses yeux d’ambre pendant que ses oreilles pointaient tantôt en avant, tantôt en arrière, afin de capter la présence de l’ennemi. Mais l’homme évita de le caresser comme il avait pris l’habitude de le faire.
Pire encore, il comprit que le cuir fermant les tonneaux n’avait pas été déchiré par le chat comme il l’avait espéré, mais que c’était l’oeuvre des rats qui s’étaient nourris de ses réserves. Ils avaient déféqué sur ce qu’il allait manger, l’empoisonnaient depuis qu’ils avaient découvert la nourriture.
Cette nuit, le sommeil de l’homme fut agité ; il se réveilla souvent, se recroquevilla, sortit ses bras des manches qu’il entortilla autour de la tête et du cou, rentra ses pieds dans la robe, semblable maintenant aux sacs dans lesquels les pauvres enterraient leurs morts. Jamais la présence du feu ne lui avait manqué aussi douloureusement. Quand le chat se blottit contre lui, en quête de chaleur, il donna des coups de poing dans son vêtement, l’éloigna. Aussitôt, il regretta son geste.
Le lendemain, le chat gisait sur son flanc, non loin de lui. Un mince filet de sang avait coulé de son cou. Sur l’amas de planches, deux rats copulaient. Pendant qu’il s’agitait sur la femelle, le mâle l’observait. L’homme se disait que l’ardeur avec laquelle la bête fécondait sa compagne était un triomphe sur sa propre solitude. Du fond de la mer, loin au-dessous de la falaise, venaient des sons épars lui rappelant les coups que les prêtres donnaient sur les gongs en bronze, comme si les temples étaient devenus, eux aussi, le jouet des courants de la mer que le dieu avait transformée en immense tombeau.
⁂
Il ne descendait plus l’escalier : là-bas, les rats avaient établi leur règne, souillant tout pour le faire mourir de faim. Restaient les amphores remplies de vin, mais il n’osait aller en chercher une. La faim et la soif le torturaient. Maintenant, les rats se montraient partout, effrontément : ils sortaient de la cave, grimpaient sur les débris des murs, les planches des plafonds écroulés, escaladaient les parois autrefois lisses du rocher. À l’aide d’un bout de bois, il avait roulé le cadavre du chat jusqu’au bord de la falaise. En suivant du regard la chute du corps dans le vide, son coeur se serra. Pendant un moment, il se dit qu’il ferait mieux de le suivre, se laisser tomber et offrir sa vie au père. Mais il craignit d’agir hâtivement. Il regagna sa place habituelle, en face de l’escalier.
L’homme récapitula sa situation : la brume ne se levait pas, elle semblait permanente. Il n’y avait pas de survivants, personne n’étant venu à son secours. Les serviteurs étaient morts ou l’avaient déserté. La bibliothèque, la serre, le laboratoire n’existaient plus. L’accès aux vivres lui était désormais interdit. Les rats avaient tué le chat. Ils se multiplieraient. Bientôt, le rocher grouillerait de ces bêtes. Après avoir épuisé les réserves dans les tonneaux, ils se jetteraient sur lui, ensuite ils se dévoreraient mutuellement. Mais ils le tueraient avant. Ils l’attaqueraient dans son sommeil, s’acharneraient sur lui par douzaines. Et il serait trop faible pour se défendre. Il s’imagina sous un grouillement de corps bruns, les incisives rouges de son sang, arrachant des bouts de son visage, crevant les yeux, ouvrant son abdomen, le vidant comme une carcasse à l’abattoir.
Alors il se prépara à mourir, aussi dignement que possible.
Quand il vit la brume s’assombrir pour la nuit, il choisit un des flacons en verre épais qui avaient résisté lors de l’événement, le mit dans sa poche. Il ouvrit les autres, en vida le contenu au-dessus de l’escalier. Puis, il escalada le rocher. À cause des fissures, l’ascension fut facile. Il chercha un plateau où s’allonger, le trouva. Il se prépara comme s’il allait dormir, transforma sa robe en sac mortuaire. En buvant le liquide, un puissant somnifère dont il administrait jadis quelques gouttes aux malades pour calmer leur douleur, il se réjouit de son goût sucré. Avec cette dose massive, son coeur s’arrêterait bientôt, il glisserait dans l’oubli.
⁂
Le corps gisait sur le plateau. Les rats avaient déchiré le tissu, mais reculé devant l’odeur du cadavre, comme ils avaient reniflé puis évité les taches des liquides répandus au-dessus de l’escalier et sur la place où s’était tenu le maître des lieux.
⁂
Après quelques lunes, la brume s’étant dissipée, le soleil illuminait l’étendue immense de la mer calme, d’un bleu lumineux, autrefois tant chanté par les poètes, d’où émergeaient, ça et là, des îles pointues. De la plus proche, celle à mille pas du rocher, venaient des éclairs par brefs intervalles. Les signaux ne cessèrent qu’au coucher du soleil.
La bonne douzaine de rats alignés sur le bord de la falaise furent intrigués par ces feux en plein jour. Déjà, le grand mâle montrait des signes d’impatience. En s’agrippant aux aspérités du rocher, il descendit lentement, fut bientôt au bord de l’eau. Puis il émit son signal, un sifflement aigu. D’autres le suivirent. Bons nageurs, ils allaient atteindre l’autre île en peu de temps.
Parties annexes
Note biographique
Hans-Jürgen Greif
Hans-Jürgen Greif est né à Völkingen (Sarre, Allemagne). Après des études en langues et littératures romanes, en littérature allemande, en littérature comparée ainsi qu’en philosophie et en pédagogie, il a obtenu un doctorat en littérature italienne. Il a été engagé comme professeur à l’Université Laval (ville de Québec) en 1969 où il a enseigné pendant 35 ans les littératures allemande et française (surtout le XIXe siècle). En novembre 2007, il a été nommé professeur émérite de l’Université Laval. Parallèlement à son enseignement universitaire, il travaille depuis 1970 avec les chanteurs du Conservatoire de musique de Québec. Il y a deux ans, il a créé la Fondation Hans-Jürgen-Greif qui octroie chaque année une importante bourse d’excellence au meilleur étudiant du Conservatoire.
Il est l’auteur d’une centaine d’articles universitaires ; ses nombreuses critiques littéraires sont publiées dans plusieurs revues. De plus, il a publié, tant en allemand qu’en français, des essais, des recueils de nouvelles, des romans. Plusieurs de ses textes ont été traduits en anglais, espagnol et allemand.
Livres publiés :
Das Thema des Todes in der Dichtung Ugo Foscolos, Thèse de doctorat, Université de la Sarre, Saarbrücken, 1967.
Huysmans A Rebours und die Dekadenz, essai, Bonn, Bouvier, 1971.
Zum modernen Drama, essai, Bonn, Bouvier, 1973 (2e édition, 1975).
Siegfried Lenz : Das szenische Werk, essai, Bern, Francke, 1974 (en collaboration avec W. J. Schwarz).
Christa Wolf : Wie sind wir so geworden wie wir heute sind ?, essai, Bern, Lang, 1978.
Kein Schlüssel zum Süden, récits, réflexions, St-Michael (Autriche), Bläschke, 1984.
Von Katzen und Menschen, nouvelle, Frankfurt/Main, Frankfurter Verlagsanstalt, 1990 (collaboration : « Die eifersüchtigen Liebehaber »).
L’Autre Pandore, roman, Montréal, Leméac, 1990.
Das Buch der geheimen Leidenschaften, nouvelle, Frankfurt/Main, Frankfurter Verlagsanstalt, 1991 (collaboration : « Kleider machen Bücher »).
Berbera, récits, réflexions, Montréal, Éditions du Boréal, 1993 (traduction de Kein Schlüssel zum Süden).
Solistes, nouvelles, Québec, L’instant même, 1997.
Literatur in Québec/Littérature québécoise, 1960–2000, anthologie, Heidelberg, Synchron Wissenschaftsverlag, 2000 (en collaboration avec François Ouellet).
Orfeo, roman, Québec, L’instant même, 2003.
La littérature québécoise, 1960-2000, essai, Québec, L’instant même, 2004 (avec François Ouellet).
La bonbonnière, roman, Québec, L’instant même, 2007 (en collaboration avec Guy Boivin).
Le jugement, roman, Québec, L’instant même, 2008.
La traduction anglaise d’Orfeo a été publiée en avril 2008 chez Véhicule Press, à Montréal. Elle est finaliste pour le prix du Gouverneur Général, section traduction.