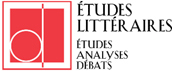Résumés
Résumé
Représentatif, par son caractère hybride, d’une tendance essayiste dans la prose narrative contemporaine, Un an de Jean Echenoz propose un discours double : d’une part, la fiction ou la représentation du monde, de l’autre, l’investigation ethnologique et la réflexion sociologique. Inspiré par les effets sociaux des arrêtés anti-mendicité de 1996, le roman déplace l’accent du récit d’événements vers le récit de pensées et le commentaire. Le regard « en négatif » qu’adopte le narrateur dissipe l’illusion romanesque et étend l’espace qui entoure le discours de la fiction, transformant l’oeuvre en un « essai romanesque ».
Abstract
The hybrid form espoused by Jean Echenoz’ Un an represents a major trend in contemporary French fiction. Its narrative offers a twofold discourse : both a plot-driven story seeking a realistic representation of the world and an ethnological inquiry fueled by social commentary. The novel, initially inspired by the 1996 anti-mendicity laws, gradually shifts the emphasis from the depiction of events to the presentation of the characters’ thoughts and narrator’s comments. The narrator operates from a « negative » perspective, which demystifies the illusion of reality while expanding the space around the fictional world ultimately transforming it into a « novelistic essay ».
Corps de l’article
«Mode d’énonciation errante », « ruine de toute économie stable de l’énonciation fictionnelle[1] », l’histoire du roman semble traversée par deux tendances divergentes : d’une part, le désir, avoué ou dissimulé, de mesurer ses forces à l’aune du réel, d’autre part, la volonté d’abolir les contraintes qui rattachent le genre à son objet. Malgré l’hétérogénéité d’un corpus que l’étiquette « roman » a du mal à faire tenir ensemble, la tradition critique et les pratiques d’écriture s’accordent sur l’existence d’une sphère générique qui, à l’origine, héberge les laissés-pour-compte de la poétique classique. Aux définitions normatives et prescriptives qui se proposent de dégager une matrice générique « en postulant un texte idéal dont les textes réels ne seraient que des dérivés plus ou moins conformes[2] » s’opposent les approches transtextuelles, qui envisagent la généricité à travers les époques[3].
Terme moyen de l’équation, la notion de représentation désigne une constante de la réflexion littéraire dans l’intervalle séparant le domaine du représentable de son actualisation romanesque. L’analyse du statut argumentatif des textes littéraires fournit un cadre conceptuel pour sortir de la logique binaire du réalisme logique et de l’intransitivité esthétique, sans toutefois sombrer dans l’aléatoire qui entrave parfois les approches pragmatiques. Le traitement discursif des textes romanesques, qui ne raisonne pas « en termes stricts d’histoire des genres, mais en termes de typologie des textes[4] », permet au contraire de respecter leur littérarité sans faire l’impasse sur les dimensions ontologique et cognitive de la fiction. L’articulation du dispositif argumentatif sur la configuration narrative se réalise dans la thématisation par laquelle le roman conduit une réflexion sur le monde et s’engage dans une critique interne de ses valeurs et de ses techniques. Caractérisée par une « fonctionnalité oblique[5] », elle représente un terme médian, une propriété grâce à laquelle le texte peut renvoyer à la fois à l’échafaudage imaginaire (fabula) et au fond réflexif et axiologique dont le texte se fait le vecteur (doxa). En essayant d’échapper à la pétition de principe fictionnelle, le roman réinvente continuellement son identité générique en même temps qu’il revêt des formes hybrides issues du mélange entre narration et digression, récit et commentaire, fiction et essai. C’est sur la proximité et l’interaction de ces deux formes d’écriture que se concentrera la présente analyse, tout d’abord par un bref aperçu théorique du binôme roman-essai, qui sera suivi d’une lecture critique de ce que nous appelons « l’essai romanesque » de Jean Echenoz, Un an.
Roman, essai — le lien réfléchissant
Les définitions de l’essai convoquent les mêmes concepts de dialogisme et de polyphonie, les mêmes notions de liberté énonciative et de souplesse formelle qui forment la monnaie courante des débats sur le roman. La « forme ductile », protéiforme « modulable à l’infini[6] », de l’essai, selon Pierre Glaudes, trouve dans le genre fictionnel à la fois son reflet expressif et son complément discursif. Cependant, la relation de l’un à l’autre ne peut être qualifiée ni d’univoque, ainsi que l’autoriserait la présence de la digression dans le récit de fiction, ni d’exogène, malgré leur appartenance à deux catégories distinctes du discours. Car le propre de l’essai réside dans la valeur de son argument tout autant que dans la posture du sujet réfléchissant, c’est-à-dire dans son dispositif énonciatif. À l’instar du roman, à qui il emprunte « ses techniques de garantie de la validité du dire, c’est-à-dire de camouflage de la fiction[7] », l’essai recourt aux procédés narratifs (mise en scène de la parole, présent du récit, propositions hypothétiques) et propose une vérité subjective, infléchie de connotations biographiques et historiques, autrement dit une vérité sous condition[8] proche de la vérité exemplaire posée par la fiction. D’autre part, le roman se ménage dans la pratique de l’essai un espace de réflexion dans les marges de la fiction, qu’il soit excentré, embrayeur de la narration (l’essai inaugural sur « le bourgeoisisme » dans le Loup des steppes) ou source du récit, pensée irriguant le tissu imaginaire (Les faux-monnayeurs), inséré dans la diégèse (l’essai sur le délabrement des valeurs attribué au personnage du docteur Bertrand Muller dans Les somnambules) ou encore extradiégétique (l’essai « sur l’argot, les filles et les voleurs » dans Splendeurs et misères des courtisanes).
La forte éclosion des textes narratifs à statut générique et énonciatif hybride étant une propriété saillante de la littérature actuelle, les recherches autour de la diction littéraire sont souvent infléchies par le recours à l’essai, ce « genre qui se prête le mieux aux grands changements de paradigme, quand les représentations établies sont mises en question, sans qu’un nouveau cadre de référence soit constitué[9] ». La complexité des rapports entre l’invention fictive et l’écriture essayiste infléchit également la terminologie critique. Il en est ainsi d’un concept tel que l’« essai-fiction[10] » qui présente une double visée : premièrement, il désigne une situation historique, à savoir l’émergence récente d’une prose narrative à tendance biographique, deuxièmement, il renvoie au décloisonnement générique diversement illustré par cette prose nouvelle. Dans l’écriture de Richard Millet, de Pierre Michon ou de Gérard Macé, l’essai-fiction se distingue néanmoins par la relation tensionnelle que la narration, fictive ou biographique, entretient avec la réflexion, présente sous les instances de l’écriture de soi et de la glose érudite. Plus qu’une simple parenthèse dans la fiction, l’essai représente à la fois un sursis de l’imagination et une mise en demeure de la tentation du romanesque dont les écueils — illusion référentielle, dilution stylistique — sont évités par une pratique des formes brèves et de la narration fragmentaire.
Cependant, sous la plume de Marie Redonnet, de Jean Echenoz, de Jean-Philippe Toussaint ou de Antoine Volodine, sont apparus des récits, des romans, des « narrats[11] » dont certains pourraient s’accommoder de l’appellation d’« essais romanesques ». Ces oeuvres poursuivent un travail d’hybridation générique et stylistique semblable à celui qui engendre les « essais-fictions ». Mais elles s’en distinguent aussi, tout d’abord par leur thématique en phase avec le contexte contemporain — ses fractures identitaires, son vertige médiatique, son aléatoire quotidien —, ensuite par leur attachement, à la fois profond et critique, à des formes codifiées bien que marginales de la tradition romanesque : récit d’aventures, polar, roman noir, littérature d’anticipation. On y découvre une écriture à double entrée : la première est celle de la fiction, des histoires banales ou captivantes, réalistes ou fantastiques, bref de la présentation du monde, la seconde, celle de l’observation et de la réflexion, d’un examen de la réalité proche de l’investigation ethnologique. Dans ces textes qui réinventent le romanesque en le faisant passer au crible de l’ironie métafictionnelle, l’ethos romanesque en quête d’identité et de pertinence nouvelles fusionne souvent avec l’espace réfléchissant de l’essai, transformé en véritable laboratoire de la fiction.
Paraxialité
Le roman Un an[12]de Jean Echenoz forme, avec Je m’en vais[13], un diptyque narratif dont les volets communiquent grâce à un réseau commun de personnages et d’actions. Si l’ordre de parution place Un an, dont le sujet s’inspire des arrêtés anti-mendicités de 1996, avant Je m’en vais, l’intrigue de celui-là semble pourtant dériver d’un événement secondaire, voire d’un lapsus de la mémoire narrative de celui-ci, en l’occurrence la disparition de Victoire, la maîtresse du protagoniste Félix Ferrer. Dans l’économie diégétique de l’ensemble, Un an occupe une place secondaire, excentrée, remplissant une lacune mineure de l’histoire principale. Ce roman dont l’intrigue se tisse autour de la dérive géographique, sociale et identitaire du personnage principal, Victoire, déplace l’accent du récit d’événements, qui dans les autres romans du même auteur abonde en rebondissements fréquents et en renversements de situation, vers le récit de pensées et le commentaire. Mais la réflexion n’est ni le résultat d’un subterfuge diégétique, par la mise en scène du personnage de l’écrivain (comme chez Robert Musil), ni celui d’une actualisation programmatique dans la diégèse des théories d’un auteur implicite (comme chez Milan Kundera). Le point spéculaire du récit se trouve dans l’intériorité évidée du personnage central, Victoire, absente à soi-même et qu’il est difficile de situer. Le foyer spéculaire du récit, lui, est fourni par un narrateur qui troque volontiers son talent de conteur pour l’esprit observateur et le génie analytique de l’essayiste. Savant et curieux, ironique et sceptique, il aime à conjecturer, mais se méfie de conclure, en jouant plutôt le rôle de médiateur entre la subjectivité de l’héroïne et les données du monde objectif.
L’incorporation graduelle de la réalité sociale dans la conscience du personnage étant racontée dans une perspective narrative liminaire, obtenue par l’association du discours indirect libre avec l’emploi fréquent du conditionnel, les pérégrinations de l’héroïne nous font percevoir le monde fictionnel sous un angle paraxial, dans lequel l’image et l’objet semblent se confondre sans que l’une ou l’autre ne soit là. Cette vue paraxiale est le propre d’une écriture subversive, que caractérisent aussi une énonciation narratoriale cultivant l’incertitude et une intrigue entravée par des techniques de bruitage[14] (parenthèses digressives, arrêt sur le détail, métalepses et prolepses, déplacements de focalisation).
Le texte est régi par la simultanéité des contraires ; la prolifération d’hypothèses et d’opinions opposées aboutit systématiquement au dilemme ou au paralogisme. Plutôt que d’être appelé indécidable, ce qui par ailleurs implique l’association subreptice du projet echenozien au paradigme théorique poststructuraliste ou déconstructiviste, ce récit pourrait être qualifié de dilemmatique. Du fonctionnalisme documentaire qui soutient l’action le récit dérive vers une réflexion épistémologique qui jette le doute sur la transitivité de l’acte cognitif, quel que soit son objet — le monde, les autres ou le soi.
Fiction dérivée
D’entrée de jeu, la décision que prend le personnage principal de quitter Paris, gommant toute trace de son existence, est due à un oubli, une défaillance de la mémoire inaugurale. Se réveillant un matin à côté de son amant inanimé, Victoire comprend aussitôt qu’elle sera soupçonnée d’être impliquée dans cette disparition soudaine :
Or n’ayant nul souvenir des heures qui avaient précédé la mort de Félix, elle craignait qu’on la suspectât de l’avoir provoquée. Mais d’abord elle ne désirait pas avoir à s’expliquer, ensuite elle en eût été incapable, n’étant même pas sûre enfin de n’y être pour rien[15].
De façon plutôt surprenante, elle se rend à l’évidence d’un présent somme toute peu clair, sans chercher à percer davantage l’obscurité d’un passé ressemblant à une parenthèse vide dans sa vie.
Cette esquive devant l’effort de mémoire — moitié impuissance, moitié refus — déclenche une fuite. À l’instar de Gloire Abgrall alias Gloria Stella que l’instabilité psychique avérée pousse à l’errance dans Les grandes blondes[16], Victoire, victime de son imagination ou d’un complot bien réel — le récit ne validant ni ne discréditant l’une ou l’autre hypothèse —, prend la route non pas tant pour effacer les traces d’un crime peu certain que pour échapper au contact humain qu’exigerait une enquête. Dans le train qui l’emmène à Bordeaux, elle déporte son attention sur le paysage quotidien, retardant indéfiniment un effort de remémoration pourtant nécessaire. Le spectacle de la vie, mais une vie évidée de contenu, morne et monotone, s’offre à l’attention de l’héroïne :
Les événements lui reviendraient tôt ou tard en mémoire, sans doute, autant ne pas insister, autant considérer par la fenêtre une zone rurale vaguement industrielle et peu différenciée, sans le moindre hameçon pour accrocher le regard quand elle n’était pas masquée par le remblai[17].
« Vaguement » est le mot-clé de ce passage, qui annonce et résume le destin narratif de l’héroïne : portée par son vague à l’âme, Victoire poussera le vagabondage jusqu’à ne devenir qu’un vague souvenir d’elle-même.
Si l’absence de mémoire à court terme constitue l’embrayeur de l’intrigue, le transfert d’intérêt vers l’extérieur commande la tonalité psychique du roman. Cela n’est pas inhabituel dans l’oeuvre d’Echenoz dont les personnages fréquentent des lieux encombrés d’objets, des plus banals aux plus insolites, et accompagnent leur errance de quantité de bricoles et de gadgets. Cependant, Un an propose une évolution de ce motif différente du retour au même qui caractérisait Cherokee, Lac et Nous trois[18]. À la fin de son parcours fictionnel, Victoire, obligée de faire l’expérience de la pauvreté, se dégage comme d’une gangue inutile des choses qui gouvernent le quotidien de la société de consommation. Le recyclage et la réutilisation deviennent les mots-clés de l’existence marginale, gardienne ad hoc d’une mémoire concrète, organique :
Par prudence, donc par principe, rare était le recours à l’appropriation, strictement réservé aux biens dont on a besoin neufs, ceux qu’on ne peut pas remplacer par leur double usage — somme toute assez peu de choses quand on y pense, moins qu’on croirait. Les ingrédients alimentaires de base, les lames de rasoir, les bougies, à l’occasion le savon. Pour tout le reste on pouvait s’arranger dans le récupéré. Même les chaussures dont le monde se débarrasse souvent à moitié neuves, voire neuves de temps en temps, quoique ce ne soit pas forcément la bonne pointure ; même les piles à peine vierges dans les télécommandes jetées[19].
Bien qu’il soit motivé au début par le désir d’oublier et par la relative indifférence à ses congénères dont l’héroïne fait preuve en première partie du récit, le déplacement de l’attention vers les alentours, les environs, le cadre en somme, n’est pas sans ricocher, en la renvoyant directement à elle-même. Aussi, dans le pavillon loué à Saint-Jean-de-Luz, le ciel que son regard parcourt telle « une page blanche, grise, bleue » n’arrive-t-il pas à apaiser son angoisse :
Les premiers jours elle demeura souvent ainsi, allongée sur son lit, soit qu’elle essayât de penser à sa vie, mais en vain, soit qu’elle s’efforçât aussi vainement de ne point y penser. Régnant en maître autour du pavillon, le silence général ne favorisait pas ces tentatives[20].
Qui plus est, l’exercice de mémoire s’avère pénible dans un sens comme dans l’autre. Suspendue entre le souvenir qui se dérobe, d’une part, et le flux spontané des réminiscences involontaires, de l’autre, la nouvelle vie de Victoire se déroule dans le présent intemporel de la mémoire personnelle abolie.
D’étranges rapports s’établissent alors entre la mémoire individuelle, précaire sinon définitivement perdue, et la mémoire collective aux embranchements multiples, sociaux et culturels. Aussi les clichés, les images stéréotypées, les lieux communs de notre imaginaire viennent-ils colmater la brèche d’un récit deux fois amnésique. Car Un an présente non seulement une mise en récit des effets tant soit peu exagérés, romanesques, d’une perte de mémoire temporaire — se réveillant à côté d’un homme qui vient de décéder inexplicablement, l’héroïne conclut un peu hâtivement qu’elle y est pour quelque chose ou qu’elle pourrait en être suspectée, décide de prendre le large et, victime du nomadisme, finit en mendiante —, mais également une narration d’événements qui reproduit cette étrange abrogation de la mémoire, voire du raisonnement critique.
Ce qui pourrait paraître étonnant dans une fiction à instance narrative marquée, est toutefois en concordance avec sa composition en miroir dont Rainer Rochlitz livre une analyse très fouillée[21]. En recensant les thèmes associés à cette structure, ceux du miroir, de l’oubli, de l’aveuglement, le critique insiste également sur le fait qu’elle « articule l’information “ethnographique” : sur le tourisme hors saison, d’un côté du miroir social ; sur la vie sans domicile fixe, de l’autre[22] ». Mais il nous semble que cette lecture, qui rend pourtant justice tant au projet formel qu’à l’enjeu éthique du roman, méconnaît l’importance de la thématique mémorielle. Sans cela, cette fiction risque de rester un hapax dans l’oeuvre de Jean Echenoz, étrange hybride d’écriture objectale et de récit engagé. Il est par ailleurs difficile de suivre la logique d’une argumentation qui oscille entre, d’une part, l’idée d’un formalisme mis en échec par le sujet traité et, de l’autre, celle d’un choix délibéré à valeur politique auquel l’écrivain sacrifie ses prouesses techniques : « [P]our la première fois peut-être dans un de ses livres, la réalité fictionalisée est trop lourde pour se volatiliser en jeu littéraire. D’où l’ancrage dans l’actualité politique que représentent les arrêtés anti-mendicité[23]. » Au lieu d’envisager l’écriture d’Un an comme une alternative conflictuelle qui opposerait la tentation d’une littérature réflexive, prisonnière bien malgré elle d’un jeu spéculaire[24], et celle d’une écriture accordée aux graves problèmes du monde contemporain, la lecture critique gagnerait à se pencher sur la nouvelle cohérence que le texte propose en faisant coexister une narration fragmentaire, nerveuse, laconique et une réflexion critique soutenue. En effet, ce récit qui convoque les thèmes de la mort, de la fuite, de l’errance, de la déchéance sociale nous met néanmoins devant une interrogation continue sur les modalités de construction de la réalité psychique et sociale.
La connaissance des faits, qu’elle soit gérée par le narrateur ou filtrée par la conscience de Victoire, est très irrégulière, hésitant entre la profusion des détails, d’un côté, et la retenue lorsqu’il s’agit de fournir des renseignements importants, de l’autre. Les relations entre les personnages sont à peine expliquées ; l’essentiel de la vie de Victoire jusqu’à son départ inopiné semble s’être déroulé au Central à Paris dans un cercle d’amis qui, à part Félix, Louis-Philippe et Louise, appelés uniquement par leurs prénoms, se contentent de rester anonymes. De surcroît, à l’exception de Louise retrouvée à la gare Saint-Lazare à la fin du roman, on ne saura jamais ce qu’ils font dans la vie ni ce que l’héroïne ressent pour eux. Tout au plus nous apprend-on, par une comparaison entre le regard que porte Victoire sur le pavillon loué à Saint-Jean-de-Luz et son attitude envers les hommes, suivie d’une généralisation rapide, que l’une des qualités de la jeune femme est la méfiance[25] :
Victoire le regarda comme si c’était quelqu’un, non sans méfiance, prête à se défendre comme elle se tenait souvent avec les hommes quand même rien ne pouvait la menacer, mais suggérant ainsi qu’on le pût lorsqu’on ne pensait rien de tel. Sans doute ce regard avait-il joué son rôle dans la brièveté des emplois occupés jusqu’ici par Victoire, dans le non-renouvellement de ses contrats à durée déterminée[26].
Les états d’âme de Victoire sont confinés au présent de ses voyages et, plus tard, de sa survie malgré les difficultés pécuniaires. Ni la tristesse ni l’angoisse ne font partie des émotions que manifeste la jeune femme ; celles-ci ont plutôt à voir avec les réflexes de survie (peur, tension, soulagement, détente) et les réactions épidermiques (désir, dégoût, irritation, colère). Le portrait sommaire que l’on trouve d’elle dans Je m’en vais renforce l’idée d’une présence à la fois glaciale et hostile :
Pupille ponctuelle sur un iris vert électrique comme l’oeil des vieux postes de radio, sourire froid mais sourire quand même […]. Elle semblait toujours sur ses gardes, même quand nulle menace extérieure ne le justifiait quoique cet air méfiant, parfois, risquât précisément de faire naître des idées agressives[27].
L’écart évident entre la gravité des épreuves que Victoire doit affronter et la relative insensibilité par laquelle elle y répond est colmaté par la quantification des gestes, l’inventaire des objets et la comptabilisation des ressources. À chaque étape de son parcours, l’héroïne accomplit les gestes d’ajustement nécessaires à la nouvelle situation. Cela semble d’autant plus étrange que le narrateur a tôt fait de nous mettre au courant de son esprit peu pratique, favorisé en partie par sa situation de femme entretenue « comptant moins pour vivre sur ses économies contenues à présent dans son sac que sur Félix qui s’était occupé, jusqu’à la veille, de tout[28] ». D’abord à Saint-Jean-de-Luz, après une nuit à l’hôtel, elle prend des dispositions pour louer une maison adaptée à ses ressources dont « le loyer s’élevait à trois mille six cents francs » où elle « passerait trois mois[29] ». Quelques mois plus tard, après la disparition mystérieuse de l’argent caché dans la maison, Victoire fait ses comptes, qui s’élèvent à « dix mille francs et des poussières », tout en décidant de déménager dans un endroit moins coûteux.
Pour ce qui est de la mémoire relationnelle et affective, Un an ne fournit guère plus d’éléments autres que la réticence de son personnage principal à l’égard des hommes et, par extension, du monde en général ainsi qu’une certaine inertie à renoncer au confort matériel qui caractérisait sa vie passée. Consciente de l’exiguïté de ses moyens, après la disparition de ses économies, Victoire « préfère croire que les choses s’arrangeraient », car elle « aimait mieux ne pas ralentir trop brutalement son train de vie[30] ». Bien que la narration soit focalisée sur un personnage mis à l’épreuve de la mort d’un proche, de l’éloignement et qui doit affronter les dangers émotionnels et physiques de l’exclusion sociale, tout cela tend à être dédramatisé par la quasi-absence des réactions.
Comme dans les autres ouvrages de Jean Echenoz, le narrateur se met dans une position paradoxale. D’une part, il n’hésite pas à faire sentir pesamment sa présence, de l’autre, il fait preuve d’une étrange réserve lorsque l’on s’attendrait à ce qu’il fournisse l’information nécessaire à la compréhension des situations narratives. Non seulement il pratique la rétention d’information, mais on pourrait même l’accuser de mauvaise foi tant ses attitudes et ses humeurs à l’égard de son héroïne varient, mélangeant sympathie et médisance, compassion et ironie. Le commentaire équivaut à un gommage discret des données fournies par l’histoire ; si Victoire ne livre presque rien de sa vie intérieure et préfère cultiver la discrétion dans les rencontres avec les autres, le narrateur n’hésite pas à commettre des indiscrétions qui modifient complètement notre perception du personnage :
Mais Victoire est ainsi : comme il faut bien quand on rencontre du monde, elle s’en sort en posant des questions. Pendant que le monde répond, elle se repose en préparant une autre question. C’est toujours ainsi qu’elle procède, elle croit que le monde ne s’en aperçoit pas[31].
Ou encore, lorsque l’appauvrissement de l’héroïne l’oblige à chercher des solutions pour subvenir à ses besoins, c’est par l’étrange fusion des consciences du narrateur et du personnage que s’ouvre l’univers des pensées de celui-ci :
Préférant croire que les choses s’arrangeraient, Victoire se mit en quête d’un hôtel correct où passer le temps de voir venir. Ensuite elle aviserait. Au pire elle finirait toujours par décrocher quelque emploi de vendeuse et de caissière, trouver quelque amant moins indélicat que Gérard, faire même en dernière extrémité la pute à l’occasion, nous verrions. Nous n’étions pas pressée. Nous n’envisagerions ce point vraiment qu’en toute dernière extrémité. En attendant, nous prîmes une chambre à l’hôtel Albizzia[32].
Un an se distingue des autres textes du même auteur par la concentration diégétique et le découpage thématique précis. Grâce au télescopage de l’expérience individuelle, quasi anonyme, parasite et marginale, et de la mémoire objectale, hors conscience, demeurant dans les choses et les lieux, ce roman rend compte de la pulvérisation du collectif dans l’infini petit des êtres solitaires qui n’ont en commun que la mémoire de leur isolement. Le récit nous fait assister à l’invention d’une mémoire en réseau dont la logique discontinue, composite, hétérogène déborde les frontières de la fiction.
Dans l’absence à soi-même qui caractérise le début du voyage de Victoire, une voix s’installe dont la marque distinctive est le conditionnel dont la valeur n’est pas proleptique, mais projective. C’est la voix d’un narrateur qui accompagne le récit de ses réflexions, et surtout de ses divagations — parenthèses, hypothèses sans rapport direct à la diégèse. Ni moraliste ni raisonneur, dans les romans de Jean Echenoz, ce narrateur joue souvent le rôle d’essayiste chargé d’examiner les manières d’être d’une humanité irréfléchie.
Un essai romanesque
Descente dans les bas-fonds de la société, le voyage de Victoire s’achève en boucle avec le retour à Paris. Si l’héroïne a su tirer la leçon de cette expérience, le roman ne le dit pas de manière conclusive, préférant à l’édification le doute — retrouvant celui qu’elle croyait mort, elle apprend la disparition d’un autre personnage qu’elle se rappelait bien vivant, car pendant sa fuite il avait été le seul contact entre elle et sa vie d’avant. La fin de l’histoire ne nous livre pas la vérité ; presque toutes les hypothèses diégétiques restent intactes ; le plaisir de la narration triomphe. Quel est alors l’intérêt cognitif du roman ?
Il réside dans l’exercice de réflexion fictionnelle, dans la pratique d’un roman construit sur le mode de l’essai. Un an explore les différents niveaux du regard « en négatif », pourrrait-on dire en empruntant un syntagme à l’intertexte echenozien.
En tant que thème romanesque, le regard « en négatif » renvoie à la figure du personnage-observateur dont le regard fixe et intense est censé découper sur le fond chaotique une parcelle de réalité compréhensible : figure humaine, objet ou ensemble d’objets. D’un côté, s’attachant à examiner les objets et les êtres du point de vue technique, ce regard est désensibilisé, déshumanisé. Sa présence ne réalise pas, comme l’aurait souhaité Maurice Merleau-Ponty, « l’étrange adhérence du voyant et du visible ». Malgré l’abondance des objets d’art et les stratégies esthétisantes de l’écriture, le contact rétinien n’émerge pas d’une pensée de la visibilité esthétique qui repose sur l’interpénétration du sujet et de l’objet[33]. Le roman déjoue systématiquement l’idée de vision bâtie sur la perception qui est, pour le philosophe, « regard sans prunelle, glace sans tain des choses[34] » ; chez Echenoz, la vision n’est plus que regard, lequel se réduit à son tour à l’organe anatomique et à sa mécanique, tandis que les objets déchoient à l’état de choses. La relation métonymique entre l’oeil et le regard souvent se dégrade jusqu’à la simple élimination de celui-ci par celui-là. Comme dans le Portait de Dora Maar, les figures sont dévorées par cet organe changeant : on rencontre ainsi l’oeil courroucé, l’oeil distrait, l’oeil jaloux ou envieux, mais aussi l’oeil scrutateur et espion. De l’autre côté, permettant au sujet de mimer la compréhension et, par là, d’occulter toute manifestation psychique provoquée par la présence de l’objet, le regard conserve l’intégrité du sujet dans son isolement spéculatif. Mais dans les deux cas le regard abdique sa valeur intersubjective, relationnelle, limité qu’il est à la connaissance technique et à sa mise en scène.
D’un point de vue générique, le regard « en négatif » représente la mise à distance de l’illusion romanesque, le décentrement de la perspective dirigeant l’attention vers l’espace liminaire de la fiction : d’abord ses marges objectales, ensuite ses marges conceptuelles. Car, en nous faisant parcourir l’objectalité du monde, l’écriture de Jean Echenoz s’interroge sur la possibilité d’une différence interne par laquelle le monde échapperait à la pure répétition du même. Parodique, l’essai romanesque introduit la discontinuité et la différence, en mettant clichés narratifs et discursifs en regard de leur image déformée. Paradoxal, pour emprunter les termes de Jean-Luc Marion au sujet de la peinture, il « pose un visible qui contredit le visible[35] ».
Justifiant la conclusion de Rainer Rochlitz selon qui, dans Un an, le débat « tend à dépasser les propriétés purement esthétiques ou artistiques au sens étroit » allant « jusqu’à des questions d’éthique littéraire »[36], la forme de l’essai romanesque complique d’un cran la relation entre diction fictionnelle et posture argumentative. Ni juxtaposition ni insertion, elle est de l’ordre de l’imbrication, du tissage intime et inextricable par où le roman échappe au dilemme de l’engagement et de la spécularité littéraire pour devenir une réflexion en acte.
Parties annexes
Note biographique
Oana Panaïté
Oana Panaïté est Assistant Professor of French à Indiana University — Bloomington. Ses articles portent sur le comparatisme littéraire, la poétique du personnage romanesque, la question du style et le statut de la fiction chez différents auteurs français et francophones (Patrick Chamoiseau, Maryse Condé, Pierre Michon, Jean Echenoz). Elle prépare une étude sur la prose narrative contemporaine qui examine la relation entre le renouveau esthétique et les enjeux éthiques de l’écriture.
Notes
-
[1]
Jacques Rancière, La parole muette. Essai sur la contradiction de la littérature, 1998, p. 87.
-
[2]
Voir Jean-Marie Schaeffer, « Du texte au genre. Notes sur la problématique générique », 1986, p. 190 et 186.
-
[3]
« Dans le cas de la composante générique […] on doit dire que tout texte modifie “son” genre : la composante générique d’un texte n’est jamais (sauf exceptions rarissimes) la simple réduplication du modèle générique constitué par la classe de textes dans la lignée desquels il se situe. Au contraire, pour tout texte en gestation le modèle générique est un “matériel” parmi d’autres sur lequel il travaille » (ibid., p. 197).
-
[4]
Gilles Philippe, « Notes sur le statut argumentatif des textes romanesques », 2002, p. 13.
-
[5]
Marie-Laure Ryan, « À la recherche du thème narratif », 1988, p. 26.
-
[6]
Pierre Glaudes, « Introduction », dans Pierre Glaudes (dir.), L’essai : métamorphoses d’un genre, 2002, p. x.
-
[7]
Gilles Philippe, « Fiction et argumentation dans l’essai », dans Pierre Glaudes (dir.), L’essai, op. cit., p. 82.
-
[8]
L’expression de « véridicité conditionnelle » est introduite par Pierre Glaudes et Jean-François Louette dans leur ouvrage L’essai, 1999, p. 140.
-
[9]
Pierre Glaudes, « Introduction, loc. cit. », p. ix.
-
[10]
Dominique Viart, « Essais-fictions : les biographies (ré)inventées », 2000.
-
[11]
Terme appartenant à Volodine, illustré par son ouvrage Des anges mineurs, 1999.
-
[12]
Paru aux Éditions de Minuit en 1997.
-
[13]
Éditions de Minuit, 1999.
-
[14]
Voir Rosemary Jackson, Fantasy : The Literature of Subversion, 1981.
-
[15]
Jean Echenoz, Un an, 1997, p. 8.
-
[16]
Éditions de Minuit, 1995.
-
[17]
Jean Echenoz, Un an, op. cit., p. 10.
-
[18]
Respectivement publiés aux Éditions de Minuit en 1983, 1989 et 1992.
-
[19]
Jean Echenoz, Un an, op. cit., p. 91.
-
[20]
Ibid., p. 23.
-
[21]
Rainer Rochlitz, L’art au banc d’essai. Esthétique et critique, 1998, p. 323.
-
[22]
Ibid., p. 325.
-
[23]
Ibid., p. 340.
-
[24]
C’est d’ailleurs l’hypothèse de travail de Bruno Blanckeman qui distingue dans la fiction echenozienne un romanesque de conformité d’un romanesque alternatif. Voir Les récits indécidables : Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, 2000.
-
[25]
On pourrait appeler cet état « réticence », dont Jean-Philippe Toussaint fait la figure centrale de son roman éponyme paru aux Éditions de Minuit, en 1991.
-
[26]
Jean Echenoz, Un an, op. cit., p. 20.
-
[27]
Jean Echenoz, Je m’en vais, 1999, p. 38-39.
-
[28]
Jean Echenoz, Un an, op. cit., p. 20.
-
[29]
Ibid., p. 14.
-
[30]
Ibid., p. 45-46.
-
[31]
Ibid., p. 19.
-
[32]
Ibid., p. 46.
-
[33]
Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, 1964, p. 183.
-
[34]
Ibid., p. 188.
-
[35]
« Le regard en perspective creuse le visible pour y instaurer la distance invisible qui le rend vivable, et d’abord, simplement, visible. […] D’où le premier paradoxe de la perspective considérée avant tout tableau : le visible croît en proportion directe de l’invisible. Plus augmente l’invisible, plus s’approfondit le visible » (Alain Bonfand, Gérard Labrot et Jean-Luc Marion, Trois essais sur la perspective, 1985, p. 20).
-
[36]
Rainer Rochlitz, L’art au banc d’essai, op. cit., p. 347.
Références
- Blanckeman, Bruno, Les récits indécidables : Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000.
- Bonfand, Alain, Gérard Labrot et Jean-Luc Marion, Trois essais sur la perspective, Paris, Éditions de la Différence, 1985.
- Echenoz, Jean, Je m’en vais, Paris, Éditions de Minuit, 1999.
- — — —, Un an, Paris, Éditions de Minuit, 1997.
- Glaudes, Pierre (dir.), L’essai : métamorphoses d’un genre, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2002, p. i-xxvi.
- — — — et Jean-François Louette, L’essai, Paris, Hachette Supérieur (Contours littéraires), 1999.
- Jackson, Rosemary, Fantasy : The Literature of Subversion, Londres, Routledge, 1981.
- Merleau-Ponty, Maurice, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard (Tel), 1964.
- Philippe, Gilles, « Notes sur le statut argumentatif des textes romanesques », dans Gilles Philippe (dir.), Récits de la pensée. Études sur le roman et l’essai, Paris, S.E.D.E.S., 2002, p. 13-22.
- Rancière, Jacques, La parole muette. Essai sur la contradiction de la littérature, Paris, Hachette, 1998.
- Rochlitz, Rainer, L’art au banc d’essai. Esthétique et critique, Paris, Gallimard (Essais), 1998.
- Ryan, Marie-Laure, « À la recherche du thème narratif », Communications, n° 47 (1988), p. 23-39.
- Schaeffer, Jean-Marie, « Du texte au genre. Notes sur la problématique générique », dans Gérard Genette et al., Théorie des genres, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 179-205.
- Viart, Dominique, « Essais-fictions : les biographies (ré)inventées », dans Marc Dambre et Monique Gosselin (dir.), L’éclatement des genres au XXe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000, p. 331-345.
- Volodine, Antoine, Des anges mineurs, Paris, Éditions du Seuil, 1999.