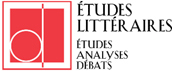Résumés
Résumé
Le présent article tente de montrer que Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, réactualise le Moyen Âge par un travail sur la signifiance et la présence. Nous établissons d’abord que l’écrivain romantique cherche à retracer une « geste » médiévale conservée par les monuments qu’il fréquente et crée ainsi un lien entre l’art architectural et la littérature. Nous cherchons à voir comment l’écrivain, fort du lien entre ces deux espaces, construit la vérité de son discours sur le Moyen Âge, par un ancrage dans son présent et son lieu. Nous voulons ainsi montrer que Hugo superpose les moments de l’histoire afin de révéler un âge de transition.
Abstract
This article attempts to show that Victor Hugo, in Notre-Dame de Paris, actualizes the Middle Ages by reworking the significance of the historical dynamic. First, we explain that the romantic writer tries to revive the medieval past preserved by ancient monuments and to create thereby a link between Architecture and Literacy. Afterwards, we’ll see how Hugo gives a convincing form to his Middle Ages, by rooting it a contemporary discourse. We want to show how the romantic poet superimposes historical moments in order to represent an age of transition.
Corps de l’article
À Raymond Joly
Ce soir, […] je suis rentré par la rue Notre-Dame-aux-Neiges. Vers minuit et demi, comme je venais de me coucher et comme j’allais m’endormir, on sonne. J’écoute. On sonne. Je me lève, je passe mon caban. Je vais à la fenêtre et je l’ouvre, encore à demi endormi. « — Qui est là ? » — Une voix répond :
« — Dombrowsky. » Je pense ou je rêve : Est-ce qu’il ne serait pas mort, aurait-il lu ma lettre, et vient-il me demander asile ? Comme j’allais descendre pour ouvrir, une grosse pierre frappe le mur, et je vois une foule d’hommes dans la place. Je comprends que c’est un guet-apens.
Victor Hugo, Choses vues, 27 mai 1871.
Le propre de ce qui est éternel est de pouvoir se poser à tout moment ; l’éternel possède cette qualité d’omniscience. Or la cathédrale est une pierre qui contient une idée : durer toujours, dépasser l’homme, tout voir et tout regarder ; symbole essentiel de l’éternel, elle se veut de tout temps, et croit en sa qualité, par accord commun. Pourtant, Hugo précise d’emblée, par le titre et le sous-titre donnés à son roman : Notre-Dame de Paris, c’est en 1482, précisément. La conciliation provient du fait que 1482 est, pour Hugo, une date de transition, qu’elle nous mène, certes au Moyen Âge, mais aussi à l’aube du XVIe siècle, c’est-à-dire au point où l’art se transforme. La cathédrale suggère comme d’elle-même cet entre-deux, elle qui est « romane » et « gothique » tout ensemble et qui contient donc ce passage. Pour la même époque, dans un autre lieu, Hugo voit une autre transition, qui fondera sa poétique : « comme pour finir dignement, la poésie épique expire dans ce dernier enfantement[1] », le grotesque ; ceci tue cela, le « Moyen Âge est enté sur le bas empire[2] ». Et comme le rappelle Paul Zumthor, ces deux découvertes vont de pair et imprègnent fortement la poétique hugolienne : « [L]a mise au point de cette notion de grotesque (telle que la définira la Préface de Cromwell) accompagne chronologiquement la découverte de l’art gothique[3]. »
Hugo poursuit ainsi une double quête — celle du moment et du lieu —, pour aussitôt quitter ces conceptions statiques et privilégier le dynamisme d’un geste ; non plus « moment », mais plutôt « point de vue sur le temps » ; non plus « lieu », mais plutôt « façon d’investir un lieu ». Ce qu’il recherche le dirige vers l’art, quête à la fois de la signifiance et de la présence, c’est-à-dire : perception, dans l’espace littéraire et architectural conjointement, de la trace humaine qui fonde un lieu, et partant, découverte du passé sous le présent, afin de fonder une période de transition qu’on nommera peu après la « vie moderne ».
Signifiance
Dans ses récits de voyage, Hugo note fréquemment le style des portiques qu’il rencontre ; geste banal, qu’il accomplit, en toute conscience, par respect pour le temps qui passe et qui fournit la circonstance et le lieu. Il apprécie particulièrement la ruine, même si c’est pour la regretter, le portique l’intéresse souvent plus que la façade ; mais rapidement, il cherche le « vol d’oiseau » dans les montagnes, le promontoire sur l’infini, le point de vue surplombant que lui offrent les sommets. Nous savons que si Hugo a élu nommément Notre-Dame de Paris, c’est essentiellement parce que ce lieu, qui est un temple, porte à un bout un portique sculpté et à l’autre une cloche dans une tour, comme un oiseau dans le ciel. Nous savons que l’entreprise du roman fut, entre autres, de montrer le chemin allant de cette entrée à cette sortie.
La structure que je viens d’esquisser doit être, pour Hugo, médiévale[4] — puisque c’est dans les pierres du XVe siècle qu’il l’a inscrite, en 1482. Pour Hugo, pour l’archéologue, l’historien et le poète de la légende, le Moyen Âge était ainsi fait qu’il entraînait l’homme dans sa fatalité. Hugo donne à lire Notre-Dame comme un symbole qui permet de déchiffrer la réalité historique, « légende » au double sens du terme, comme explication qui complète le sens d’une image, et comme fiction qui doit corriger les lacunes de l’Histoire[5]. Par son art, Hugo exprime la vérité plutôt que la réalité et prétend être plus attentif au temps qui passe, lui qui est poète plutôt qu’historien. Le poète se sent plus près du passé parce qu’il perçoit d’abord la signifiance de ses signes, leur relief plus que leur sens.
Dans Le plaisir du texte, Roland Barthes définit la « signifiance », à la suite de Julia Kristeva, comme « le sens en ce qu’il est produit sensuellement », comme « lieu de la jouissance [qui affirme] la valeur à la fois érotique et critique de la pratique textuelle[6] ». Il établit que la signifiance comme la jouissance se trouvent exclues par la linguistique, en dehors d’une relation de signifiant à signifié, en dehors même du dicible, selon la psychanalyse. Fort de cette nuance, il rapproche le texte du tissu, pour marquer la matérialité des mots et de la phrase, qui sont pour l’écrivain un corps avec lequel il entre en relation, qu’il peut toucher dans une immédiateté à la fois grisante et terrifiante. Hugo est un de ceux que Barthes nomme lorsqu’il veut exemplifier ce dépassement du signifié par la matérialité des mots, la signifiance :
« Darmès, un frotteur qu’on juge en ce moment pour avoir tiré sur le roi, rédige ses idées politiques… ; ce qui revient le plus souvent sous la plume de Darmès, c’est l’aristocratie, qu’il écrit haristaukrassie. Le mot, écrit de cette façon, est assez terrible… » Hugo (Pierres) apprécie vivement l’extravagance du signifiant ; il sait aussi que ce petit orgasme orthographique vient des « idées » de Darmès : ses idées, c’est-à-dire ses valeurs, sa foi politique, l’évaluation qui le fait d’un même mouvement : écrire, nommer, désorthographier et vomir[7].
Dans sa préface à Notre-Dame de Paris, Zumthor note, quant à lui :
Les éléments décoratifs les plus nombreux sont les noms propres, de personnes ou de lieux, dont Hugo, en vertu sans doute d’une vénérable tradition rhétorique, aime dérouler de longues énumérations : effet de truculence et comme de grotesque onomastique[8].
Cette onomastique du lieu qu’on rencontre couramment chez Hugo — autre effet de jouissance aurait dit Barthes —, ne doit pas nous éloigner du livre mais au contraire nous en rapprocher et montrer le lien qui unit l’architecture et la littérature. Trois mots — un nom, une date et une inscription — portent en eux les plus longs développements pour qui sait les déchiffrer : Notre-Dame de Paris est une dédicace[9], un index, un titre comme on dit, qui fournit son identité au signe, qu’il soit livre ou cathédrale ; 1482 est un moment, un fondement, un second titre comme l’homme détient un second nom, qu’il soit habitat ou famille ; anankè est une trace, un symbole, un argument à lui seul, qui dit comment l’Histoire se construit et comment l’histoire qui en découle se file et se tisse fatalement au temps qui passe. Relisons la note en tête de Notre-Dame de Paris, qui installe d’emblée la conception du roman dans la reconnaissance d’un geste d’écriture, où la signifiance accompagne sinon précède le sens :
Il y a quelques années qu’en visitant, ou, pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l’auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l’une des tours ce mot gravé sur le mur :
’ANAΓKH
Ces majuscules grecques, noires de vétusté et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique empreints dans leurs formes et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c’était une main du moyen âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu’elles renferment, frappèrent vivement l’auteur[10].
L’anankè n’est pas le défi de Hugo, son idéal, mais plutôt l’aveu qu’une force supérieure maîtrise la plume avant que l’écrivain ne la reconduise. Par un retournement vertigineux, le troisième terme lié au signe qu’est le livre nous ramène en-deçà de sa création, avant le roman et avant la cathédrale, à ce point d’origine où tout a commencé. Une part importante de cette quête du passé consiste à éliminer les entraves qui défigurent et dénaturent l’origine afin de retrouver, sous le badigeon que Hugo fustige, l’édifice à neuf. Autrement dit, Hugo annonce en ouverture qu’il n’a pas tout écrit de sa main et qu’au moins un mot était déjà inscrit[11], qu’il développe ce mot sans le quitter complètement. Au point d’équilibre, on ne sait plus qui, de la cathédrale ou du roman, inspire le plus l’autre ; les deux valeurs s’équivalent, le mot façonne la pierre comme la tour produit du discours[12]. Demander à la fatalité de parrainer son roman, c’est se donner les moyens d’atteindre, à date précise, un état idéal de comparaison. Il advient un jour où, comme dirait Barthes, Notre-Dame de Paris, c’est cela[13] — et le doigt désigne simultanément la cathédrale et le roman[14]. Pour Hugo le monde est un livre, dans sa complexité, sa diversité et sa richesse. Il entend que presque toutes les « créations » se comportent comme un livre, grand comparé du monde. En 1830, il a cru bon rappeler que l’architecture, elle aussi, était un livre quand elle devenait le support de mots historiques. Anankè est le premier de ceux-ci, qu’Hugo découvre près des quais.
La trilogie de l’anankè[15] — Notre-Dame de Paris, Les misérables et Les travailleurs de la mer — révèle trois formes d’inscription du lieu : la forme médiévale, centrée, fondée et statique ; la forme révolutionnaire, marginale, spéculative et transitoire ; et la forme moderne, circulaire, progressive et mobile. La cathédrale, la barricade, le steamer. Non seulement la trilogie étudie des époques différentes, mais c’est aussi la distance critique des oeuvres qui change, selon l’objet décrit par le narrateur. Alors que la cathédrale atteint un état idéal dans Notre-Dame, et que la rue à défendre et les égouts dans Les misérables révèlent toute son ingéniosité, Hugo se trouve pour ainsi dire pris de court devant le steamer, terrifié lui aussi par l’écueil et surtout la pieuvre, symbole à ses yeux d’un mal déchaîné.
La véracité des personnages leur vient, entre autres, du vertige qui les prend devant la cathédrale. Même lorsqu’ils ne l’observent pas, c’est-à-dire la plupart du temps, ils éprouvent la hauteur de la façade à ce sentiment constant chez eux d’être regardés par un oeil céleste. La foule se trouve constamment en représentation, rejouant de diverses façons la pièce qui ouvre le roman et qui est vue, malgré le brouhaha, par un spectateur qu’on devine même si on ne le voit pas. Quasimodo, Frollo et la cathédrale elle-même forment cet oeil omniscient, ce point de vue surélevé hugolien devant lequel le personnage produit son « geste » : « Le Moyen Âge, depuis le IXe siècle au moins, fut une civilisation du geste. […] Le geste est représentation ; comme tel, à la fois image et symbole[16]. » Avec l’inscription sur la pierre, le geste représentatif est une autre façon de révéler que la cathédrale est l’écran sur lequel se projettent les images et les symboles, qu’elle est le témoin d’un discours public.
Il est une considération à propos de laquelle Hugo demeure discret, sinon silencieux, dans le chapitre où il annonce la victoire de l’imprimé, intitulé « Ceci tuera cela ». Évoqué à plusieurs reprises dans le roman sans que la lecture semble devoir en tenir compte, c’est un des aspects les plus communs et les plus triviaux de l’histoire : il s’agit de la valeur monétaire. Avec l’imprimé, la monnaie fiduciaire tuera la pièce sonnante, sans manquer d’affecter considérablement l’avenir du patrimoine architectural, dont la valeur est désormais soumise aux enchères, à la spéculation et aux pourparlers. Le marché aussi connaît son âge critique, lorsqu’il fait un retour sur soi pour évaluer son crédit. L’imprimé devient alors le discours qu’on superpose au monument pour en établir la qualité. Il advient un moment où le papier a préséance sur la chose et en dit mieux la vérité chiffrée, où le crédit remplace la valeur réelle, par accord tacite ; et alors le prix d’une cathédrale subit une inflation, pendant qu’une figure récolte sa valeur fiduciaire. Hugo, en 1830, choisit de remplacer cette valeur ajoutée, qu’il craint, par de la signifiance; il change la donne et interroge la valeur esthétique plutôt que de chercher à établir un prix. Son défi est de faire en sorte que ceci tue cela, que la matérialité du signe esthétique suffise à sa jouissance, sans passer par la propriété, qui demanderait l’établissement d’un prix. Car ces choses que sont les cathédrales n’ont pas de prix.
À côté des ravages subis par la cathédrale, il y a la marque inscrite dans son portique, cette agression de la pierre qu’Hugo ne pense même pas condamner tant elle lui semble précieuse : la main inconnue qui a creusé la pierre n’y a pas attenté, bien au contraire ; elle lui a donné son sens, l’interprétant premier de son symbole. L’inscription à l’entrée d’un édifice intéresse toujours Hugo, et il l’inscrit régulièrement. Nous en trouvons deux exemples dans ses Voyages, qui sont peut-être le pendant architectural de Notre-Dame de Paris — non pas des brouillons, puisqu’ils sont subséquents au roman, mais une poursuite dans la conviction que le texte sauvegarde l’essentiel en montrant la signifiance de l’art architectural. Le hasard — Hugo disait la fatalité — veut que le poète ait été confronté à l’art spatial par excellence à l’un des moments charnières de sa vie, à l’une de ces dates qui l’ont singulièrement marqué, c’est-à-dire en 1843, année de la mort de sa fille Léopoldine. Hugo, nous le savons, est en voyage dans les Pyrénées à ce moment, et il vient de quitter Pasages, qui lui a laissé une impression profonde. Déjà avant la disparition de sa fille, Hugo note ces mots confiés à la mort. Dans les montagnes près de Pasages, il inscrit :
Me voici à la pointe même d’une autre montagne sur le sommet le plus élevé que j’ai atteint dans la journée. Là encore il m’a fallu escalader avec les mains et les genoux. Je découvre un immense horizon. Toutes les montagnes jusqu’à Bilbao à gauche, jusqu’à Bayonne à droite. J’écris ceci accoudé sur un bloc en forme de crête de coq qui fait l’arrête extrême de la montagne. Sur ce rocher on a gravé profondément avec le pic trois lettres à gauche :
L.R.H.
et deux lettres à droite :
W. H.[17]
Plus loin, dans un village qu’il nomme Leso, il commente :
Cependant, dans une place, j’ai distingué une lueur. Je m’y suis dirigé. Un volet était entrebâillé à un rez-de-chaussée, et j’ai vu dans une chambre basse une vieille femme accroupie, immobile, adossée à un mur fraîchement blanchi. Au dessus de sa tête brûlait une lampe attachée à un clou, la vieille lampe espagnole qui a la forme d’une lampe sépulcrale. J’ai cru voir rêver lady Macbeth.
La réverbération de cette lampe m’a permis de lire sur la porte de la maison d’en face cette inscription :
POSADA
LHABIT.
Je m’attendais à tout, excepté à trouver là une auberge[18].
Chaque fois, on le voit, Hugo demande à l’imprimé de lui fournir une graphie particulière, qui corresponde au mieux au geste d’écriture qu’il tente de reproduire, plutôt que de le décrire. S’il tente cette description, comme dans la note liminaire de Notre-Dame de Paris, il demeure comme frappé d’interdit devant ces « je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique », la « main du moyen âge » marquant sa supériorité sur l’écrivain, tout comme la fatalité qu’elle a su rendre par des traits si « vivement » lugubres. Comme le peintre qui montre sans expliquer, comme la vie elle-même qui s’impose par sa présence et dépasse les concepts, la sensualité du signe demeure inaliénable, fatalement irremplaçable par une représentation qui lui permettrait d’entrer dans le cours des échanges. Hugo reproduit ce qu’il a vu, produit sa figure avec la même immédiateté que le monument. Le miracle de la signifiance est qu’elle abolit le temps et montre l’identité ; un geste, à un certain moment et depuis, est posé. Le mot tracé a un sens, certes, mais cette « main du moyen âge » que l’on voit toujours, et toujours en mouvement malgré le temps, porte en elle ce qu’Yves Bonnefoy appelle une présence[19] — à la fois fondement et modernité.
Présence
Si la « Préface » à Cromwell réclame un retour à l’inspiration médiévale, ce n’est pas pour se libérer mais pour comprendre le présent, délimité par Hugo en quelques dates : 1789, 1793, 1802 — quand le « siècle avait deux ans », 1831 — à la barricade, 1843 — entre « Autrefois » et « Aujourd’hui », 1851 — au début des Châtiments, 1871 — Année terrible, et même 1885 — triomphe du grand-père. Hugo note dans ses carnets, comme pour donner leur juste dimension aux événements, qu’il a pu poursuivre le chantier de Notre-Dame de Paris, autrement dit 1482, après la révolution de Juillet et la naissance de sa fille Adèle. Ce falsificateur qui antidate presque systématiquement ses poèmes, cet historien qui croit que le « XIXe siècle ne relève que de lui-même[20] », ce sage épique qui voit s’élever les siècles sur un « mur[21] », semble plus apte à dénaturer le temps qu’à en donner une juste vue. Hugo, dans un certain sens, est toujours décentré : il se trouve à côté de 1792, de 1830, du début du siècle et du règne napoléonien — dates historiques et que l’écrivain choisit de contourner — pour les ramener à soi, à son présent, surtout peut-être, à sa présence.
Lorsque Baudelaire veut tracer le portrait critique de Hugo, à l’entrée de ses Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, c’est d’abord sous la forme d’un souvenir que la figure hugolienne lui apparaît :
Depuis bien des années déjà Victor Hugo n’est plus parmi nous. Je me souviens d’un temps où sa figure était une des plus rencontrées parmi la foule ; et bien des fois je me suis demandé en le voyant si souvent apparaître dans la turbulence des fêtes ou dans le silence des lieux solitaires, comment il pouvait concilier les nécessités de son travail assidu avec ce goût sublime, mais dangereux, des promenades et des rêveries[22].
C’est la présence de Hugo, plus que son actualité, qui fascine Baudelaire dans cette observation qui reprend une formule nécrologique (« n’est plus »), c’est cette faculté d’ubiquité et d’omniscience que le mage romantique possède. Dix ans après son exil, Baudelaire note l’absence de l’homme, pour lui concéder aussitôt que son oeuvre demeure, « répare [les] cathédrales et consolide [les] vieux souvenirs de pierre[23] ». Ce battement de la présence à l’absence sera pour Baudelaire toute la vie moderne, « éternelle et fugitive ». Quelque cent ans plus tard, Barthes notera la présence de Hugo d’une manière toute différente, par une appropriation qui ressemble à un lapsus. Sondant, scrutant le vide de La Tour Eiffel, Barthes se remémore Notre-Dame de Paris, plus précisément le « Paris à vol d’oiseau » décrit du haut des tours. Barthes, continuant Hugo, produit un subtil anachronisme lorsqu’il prête au poète-mage une « vision » qui aurait les attributs de la lecture. Mais cette vision du Paris médiéval à vol d’oiseau n’a jamais pu être que littéraire, un savoir de seconde main avec lequel le romancier tente de créer du vraisemblable. Mais Barthes croit tellement à cette vision impossible qu’il compare le regard qui devrait l’orchestrer à un livre[24]. On le voit, le critique prête à Hugo plus de présence qu’il n’en eut — à moins qu’il n’ait jamais cru que le Paris décrit était autre que celui du XIXe siècle débutant. Par deux fois donc, un critique profond et avisé semble émettre une proposition délirante et schizophrène : Hugo est toujours là, malgré l’exil, malgré les siècles, au Moyen Âge comme au XIXe siècle, à Guernesey comme à Paris.
Le XIXe siècle, après la rupture de la Révolution, croyait pouvoir mieux lire le Moyen Âge car il s’était dégagé d’un temps cyclique pour accéder au temps des ruptures historiques, et se jugeait en mesure alors de mieux comprendre ce qui le précédait. Il découvrait par ailleurs chez le peuple des valeurs qui définissaient selon lui l’époque médiévale (la nature, le sauvage, Dieu, l’amour, l’analogie) :
Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse moderne verra les choses d’un coup d’oeil plus haut et plus large. Elle sentira que tout dans la création n’est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la lumière[25].
Mais pour nous, si le XIXe siècle, et particulièrement celui de Hugo, est « essentiellement Moyen Âge », pour reprendre le terme de Barbey d’Aurevilly[26], ce n’est pas tant parce qu’il fut un siècle révolutionnaire, ou religieux, ou sombre ; c’est surtout parce qu’il fut un siècle voyageur, à la fois exotique et technique, un siècle producteur de mouvement, et qui repose de mille façons une question cruciale au Moyen Âge, comme l’a montré Zumthor : comment transporter le lieu, ou mieux, comment tenir en un lieu qui ne soit pas physique. Le XIXe siècle a créé Paris une deuxième fois, non parce qu’il l’a assis dans ses forteresses et ses portes, mais parce qu’il a exporté un modèle parisien, de l’Égypte napoléonienne au New York de la Statue de la Liberté. Hugo en exil, en ce sens, demeure parisien. Le Moyen Âge n’apparaît pas à Hugo comme un analogon du XIXe siècle dont il est le fils, mais bien plutôt comme une des marques de son identité. Regardant tout autour, évaluant la figure que semble dessiner le siècle révolutionnaire, Hugo considère que le XIXe siècle contient beaucoup du XVIe et du XVe. Ce n’est qu’une marque, qu’un trait dans le tableau, mais dans sa folie d’exhaustivité, le romantisme aime à débusquer des ténèbres tout potentiel de lumière. Les voyages cherchent l’incroyable dans le présent, l’inconnu souvent loin qui témoigne encore d’une époque ancienne, indélébile. Le présent, pour Hugo, se définit aussi par ce qui demeure depuis des siècles.
Peu de mots, chez Hugo, sont plus connotés que le mot « sérieux » : sérieux le grand-père débonnaire qui fait la leçon en riant ; sérieux le petit enfant qui découvre une fleur, candide et ébloui ; sérieux surtout le coeur humain, dans ses vices, dans ses naïvetés, dans ses chimères. On a pu pendant deux siècles relever toutes les lubies, toutes les erreurs, tous les anachronismes du mage romantique, il est à parier qu’il n’en désavoue aucun et qu’il entend toujours être pris au sérieux. Combien d’études commencent par un « malgré tout », pour indiquer une adhésion a priori à la légende hugolienne comme principe même de sa compréhension, de son entendement, de son écoute. Baudelaire croyait que la critique devait être « partiale », Hugo dira qu’elle doit être « sympathique ». La première instance qui permet l’intellection du texte hugolien est le « coeur humain », anankè suprême, siège de la métaphore. Selon le coeur, le Moyen Âge de Hugo prend tout son sens, si on accepte de prendre les mots dans leur double sens sans pour autant sacrifier le référent, mais seulement en écoutant des résonances affectives, signes d’une immédiateté possible à la parole. Hugo n’entrave pas la course de l’histoire et doit accepter la vérité pragmatique d’une tour élevée en telle année plutôt qu’en 1482 ; mais il persiste à croire qu’il fut, jadis, une « année idéale » où la cathédrale a pu atteindre un plateau, où sa présence fantasmée s’est imprégnée dans l’imaginaire collectif plus profondément que sa présence réelle. Le poète suppute que Notre-Dame est en mouvement vers le haut, et qu’il fût un moment où elle touchait presque le ciel divin, issue d’une imperfection, condamnée à y retourner, fatalement. Hugo n’a pas fait « le tour » de la cathédrale, nous le savons ; il est entré par le portique, a monté les escaliers pour prendre le point de vue des cloches. Chaque avancée dans le « corps » de la cathédrale, sur son axe horizontal plutôt que vertical, est perçue comme une exploration, un écart par rapport à l’axe primordial de l’élévation[27]. De même pour la chronologie, le romancier n’a pas marqué un cercle autour de 1482, par exemple en situant l’histoire des origines (319 ans plus tôt, en 1163) à son présent (348 ans plus tard, en 1830). Il n’a conservé que la seconde portion, comme si 1482 « ne relevait que de lui-même », car ainsi il circonscrit la cathédrale entre deux sommets, son état idéal ancien et son état idéal moderne, projeté, que son roman progressif appelle, et que la restauration de Viollet-le-Duc accomplira peut-être en 1845. La circonférence horizontale ne convient pas à Hugo car elle marque une fondation, un enracinement qui nie le progrès ; il atteint néanmoins une complétude, une unité, on l’a suffisamment souligné, que la spirale du temps rend mieux, l’anankè qui marque le retour du même dans la différence. Avec Notre-Dame de Paris, Hugo avertit son temps qu’un tour de cycle va bientôt se compléter : « Ceci tuera cela », le « mur des siècles » s’apprête à se lever et l’on doit pouvoir le traverser, pour en construire l’envers. Ces métaphores de la pierre et du mur sont un geste autoritaire, une action combattive qui saisit d’instinct son but, par-delà la mort à venir.
Il n’est pas vrai que la cathédrale ou le Moyen Âge forment chez Hugo une trame de fond. En face de l’Éternel, Hugo prend sa mesure et travaille dans l’ordre de la signifiance et de la présence. La cathédrale et le Moyen Âge sont chez lui ponctuels, comme un battement à intervalles prolongés. Ils sont comme un frisson ancien, comme une mère qu’on retrouve, parfois, pour se soulager d’exister. Le Moyen Âge, c’est aussi manquer de mots et s’en tenir aux fondements. Mais précisément, cette éclipse dans la perception du Moyen Âge en donne la figure, son image mémorable. Il semble que, même dans le noir, il est de ces visions qu’on ne peut jamais oublier ; elles sont prégnantes, elles sont présentes, on les touche, on les connaît par coeur.
Parties annexes
Note biographique
Nelson Charest
Nelson Charest détient un doctorat de l’Université Laval, où il a présenté une thèse sur « La figure du “vaisseau” dans la poésie moderne ». Il a effectué un stage postdoctoral au sein du groupe de recherche « Écritures de la modernité », à l’Université Paris III. Il est présentement chargé de cours à l’Université Laval. Ses plus récents travaux portent sur la dédicace chez Hugo, sur l’adresse dans le signe peircien et sur le paysage dans la poésie québécoise. Il poursuit en parallèle des recherches sur le verset.
Notes
-
[1]
Victor Hugo, « Préface » à Cromwell, 1968, p. 65.
-
[2]
Ibid., p. 68.
-
[3]
Paul Zumthor, « Le Moyen Âge de Victor Hugo », dans Victor Hugo, Oeuvres complètes, 1967, vol. IV, p. ix.
-
[4]
« En dépit de ces variations, deux traits du bâtiment composent, durant six ou sept siècles, l’image-force que l’homme en a : verticalité et dureté » (Paul Zumthor, La mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, 1993, p. 95).
-
[5]
Je rappelle que c’est dans un souci de vérité que Hugo croit devoir compléter l’histoire par la légende : « Le genre humain, considéré comme un grand individu collectif accomplissant d’époque en époque une série d’actes sur la terre, a deux aspects : l’aspect historique et l’aspect légendaire. Le second n’est pas moins vrai que le premier ; le premier n’est pas moins conjectural que le second » (La légende des siècles, 1950, p. 4) ; « La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l’histoire ; il faut l’histoire pour l’ensemble et la légende pour le détail » (Quatre-vingt-treize, 1979, p. 232).
-
[6]
Roland Barthes, Le plaisir du texte, dans Oeuvres complètes, 2002, vol. IV, p. 257 et 259.
-
[7]
Ibid., p. 260.
-
[8]
Paul Zumthor, « Le Moyen Âge de Victor Hugo, loc. cit. », p. xxv.
-
[9]
Je rappelle que la dédicace est historiquement « l’action de placer une église sous l’invocation d’un saint », et par extension, « l’inscription qui la relate » (Le Petit Robert) ; ainsi Notre-Dame dédiée à la Vierge Marie.
-
[10]
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, 2002, p. 29.
-
[11]
On retrouvera ce mot à l’origine du roman, d’un autre point de vue : en août 1830, pendant la pause dans l’écriture du roman, avec les Trois Glorieuses et la naissance d’Adèle, Hugo écrit : « La fatalité, que les anciens disaient aveugle, y voit clair et raisonne. Les événements se suivent, s’enchaînent et se déduisent dans l’histoire avec une logique qui effraie. En se plaçant un peu à distance, on peut saisir toutes leurs démonstrations dans leurs rigoureuses et colossales proportions ; et la raison humaine brise sa courte mesure devant ces grands syllogismes du destin » (Choses vues, 1972, vol. I « 1830-1846 », p. 105-106).
-
[12]
Dans ses dessins, Hugo montre comment la graphie des lettres peut représenter des choses, en prolongeant les arabesques des lettres pour figurer des objets divers.
-
[13]
« C’est cela ! Ce cri ne doit pas être entendu comme une illumination de l’intelligence, mais comme la limite même de la nomination, de l’imagination. Il y aurait en somme deux réalismes : […] le second dit la “réalité” (ce qui se voit mais ne se démontre pas) » (Roland Barthes, Le plaisir du texte, op. cit., p. 247).
-
[14]
Pour la même époque, Hugo perçoit qu’un autre événement capital marquera une transition dans l’ordre du monde, où l’on retrouve ce même « geste du mot » : « Sur ce globe [datant du XVe siècle, que Hugo a vu à Nuremberg] est vaguement indiquée, au vingt-quatrième degré de latitude, sous le signe de l’Écrevisse, une espèce d’île nommée Antilia, qui fixa un jour l’attention de deux hommes ; l’un, qui avait construit le globe et dessiné Antilia, montra cette île à l’autre, posa le doigt dessus, et lui dit : C’est là. L’homme qui regardait s’appelait Christophe Colomb, l’homme qui disait : c’est là, se nommait Martin Behaïm » (William Shakespeare, 2003, p. 336-337).
-
[15]
« La religion, la société, la nature ; telles sont les trois luttes de l’homme. Ces trois luttes sont en même temps ses trois besoins ; il faut qu’il croie, de là le temple ; il faut qu’il crée, de là la cité; il faut qu’il vive, de là la charrue et le navire. […] Un triple anankè pèse sur nous, l’anankè des dogmes, l’anankè des lois, l’anankè des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l’auteur a dénoncé le premier ; dans Les Misérables, il a signalé le second ; dans ce livre, il indique le troisième.
À ces trois fatalités qui enveloppent l’homme se mêle la fatalité intérieure, l’anankè suprême, le coeur humain » (Les travailleurs de la mer, 1980, p. 89).
-
[16]
Paul Zumthor, La mesure du monde, op. cit., p. 38.
-
[17]
Victor Hugo, Alpes et Pyrénées, dans Oeuvres complètes, 1987, vol. XIV, p. 811.
-
[18]
Ibid., p. 819.
-
[19]
« Et sous le signe de cette unité, que j’aime nommer présence, j’ai en esprit ce qui est peut-être en nous un désir encore, mais si profond celui-là qu’on peut l’estimer d’un autre ordre que les faims qui tenaillent la vie quotidienne, ou que perçoit la psychanalyse : désir élémentaire de vivre, de survivre, c’est-à-dire de faire corps avec le monde dès avant toute interprétation de ce que le monde peut être — de faire corps de par tout notre corps, précisément, qui déborde en nous la pensée. Du point de vue de ce désir-là, qui est de participer de l’être du monde, la chose que l’on rencontre au-delà de tous les concepts, c’est cela même qui vaut, et c’est cela seul, puisque là seulement il y a la compacité ontologique, dirai-je, l’évidence, la profondeur substantielle qui apaise le besoin d’être, ou nous incite à nous ressaisir quand l’abstraction dans les mots a troublé l’approche de l’immédiat » (Yves Bonnefoy, « Poésie et Vérité », dans Entretiens sur la poésie (1972-1990), 1990, p. 260).
-
[20]
Hugo, William Shakespeare, op. cit., p. 312.
-
[21]
Victor Hugo, « La vision d’où est sorti ce livre », dans La légende des siècles, op. cit., p. 8 : « J’eus un rêve : le mur des siècles m’apparut. »
-
[22]
Charles Baudelaire, « Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains. Victor Hugo », dans Oeuvres complètes, 1976, vol. II, p. 129.
-
[23]
Ibid., p. 131.
-
[24]
« Or ce qu’il y a d’admirable […], c’est que Hugo [a] très bien compris qu’au merveilleux allègement de l’altitude, la vision panoramique ajoutait un pouvoir incomparable d’intellection : le vol d’oiseau, que tout visiteur de la Tour peut prendre un instant à son compte, donne le monde à lire, et non seulement à percevoir » (Roland Barthes, La Tour Eiffel, dans Oeuvres complètes, op. cit., vol. II, p. 537).
-
[25]
Victor Hugo, « Préface, loc. cit. », p. 69. Il ajoute plus loin que le grotesque « imprime surtout son caractère à cette merveilleuse architecture qui, dans le Moyen Âge, tient la place de tous les arts. Il attache son stigmate au front des cathédrales, encadre ses enfers et ses purgatoires sous l’ogive des portails, les fait flamboyer sur les vitraux, déroule ses monstres, ses dogues, ses démons autour des chapiteaux, le long des frises, au bord des toits » (ibid., p. 74).
-
[26]
« Malhabile à mâcher les langues déliées et molles des époques subtiles et énervées, il n’a de naturel, de sonorité, de mordant dans l’étendue de sa voix, que quand il recule de son temps en ces temps que l’insolence des Civilisations appelle barbares. Pour ces raisons, il est essentiellement moyen âge […]. » (Jules Barbey d’Aurevilly, « La Légende des siècles par Victor Hugo » (1859), dans Le XIXe siècle des oeuvres et des hommes, 1964, vol. I, p. 252).
-
[27]
On trouvera, parmi d’autres, un exemple de cet axe primordial chez Hugo dans son commentaire de la cathédrale de Strasbourg : « L’église vue, je suis monté sur le clocher. Vous connaissez mon goût pour le voyage perpendiculaire. Je n’aurais eu garde de manquer la plus haute flèche du monde. […] C’est une chose admirable de circuler dans cette monstrueuse masse de pierre toute pénétrée d’air et de lumière, évidée comme un joujou de Dieppe, lanterne aussi bien que pyramide, qui vibre et qui palpite à tous les souffles du vent. Je suis monté jusqu’au haut des escaliers verticaux » (Le Rhin, dans Oeuvres complètes, op. cit., vol. XIV, p. 317). J’y vois pour ma part une des raisons de sa fascination pour les ruines, qui deviennent en ce sens des formes phalliques, « toujours debout » malgré le temps, dont on a évidé le corps : « La cabane ruinée, la maison ruinée, le couvent ruiné, ce ciel d’où le jour s’en va, cette plage d’où la mer se retire, n’était-ce pas un symbole complet ? » (Alpes et Pyrénées, op. cit., p. 818).
Références
- Barbey d’Aurevilly, Jules, Le XIXe siècle des oeuvres et des hommes, Paris, Mercure de France, 2 vol., 1964 (éd. de J. Petit).
- Barthes, Roland, Oeuvres complètes, Paris, Éditions du Seuil, 5 vol., 2002 (éd. d’É. Marty).
- Baudelaire, Charles, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2 vol., 1976 (éd. de C. Pichois).
- Bonnefoy, Yves, Entretiens sur la poésie (1972-1990), Paris, Mercure de France, 1990.
- Hugo, Victor, Choses vues, Paris, Gallimard (Folio), 4 vol., 1972, (éd. d’H. Juin).
- — — —, Cromwell, Paris, Garnier-Flammarion, 1968 (éd. d’A. Ubersfeld).
- — — —, La légende des siècles, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1950 (éd. de J. Truchet).
- — — —, Les travailleurs de la mer, Paris, Gallimard (Folio), 1980 (éd. d’Y. Gohin).
- — — —, Notre-Dame de Paris. 1482, Paris, Gallimard, (Folio Classique), 2002 (éd. de S. S. de Sacy, préf. de L. Chevalier).
- — — —, Oeuvres complètes, Paris, Club français du livre, 1967, vol. IV (éd. de J. Massin et al.).
- — — —, Oeuvres complètes, Paris, Robert Laffont (Bouquins), 1987, vol. XIV.
- — — —, Quatre-vingt-treize, Paris, Gallimard (Folio classique), 1979 (éd. d’Y. Gohin).
- — — —, William Shakespeare, Paris, Flammarion, 2003 (éd. de D. Peyrache-Leborgne).
- Zumthor, Paul, La mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, Éditions du Seuil (Poétique), 1993.