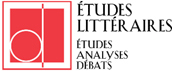Corps de l’article
Dans un article de 1957 intitulé « Où va le roman ? », Jacques-Stéphen Alexis prônait l’enracinement dans la culture populaire comme démarche pour garantir le renouvellement de l’esthétique du roman et la création d’une littérature véritablement haïtienne. Il concluait, naturellement, que ceux qui abandonnaient leur pays pour aller s’installer en Occident ou ailleurs étaient condamnés à l’échec, en tant qu’écrivains, convaincu qu’il était que ces migrants deviendraient des « écrivains occidentaux, à moitié occidentaux, ni chair ni poisson ; [ne pouvant] développer leurs moyens, voire s’épanouir, leur talent, et leur art, devient chaque jour moins original, moins authentique[1] ». Si peu après ces prédictions guère rassurantes, de nombreux écrivains, dont Émile Ollivier, ont dû s’exiler, cette diaspora fort productive a, depuis, largement démenti les propos pessimistes d’Alexis. Loin de perdre leurs racines, cette génération d’écrivains nomades s’est forgé une identité-banian, selon l’expression de René Depestre[2]. Tout en conservant leurs liens avec l’imaginaire du pays natal, ces écrivains ont plongé de nouvelles racines dans leurs pays d’accueil, et leur art s’en est enrichi et n’en est devenu que plus original, contrairement à ce qu’avait prévu Alexis. L’oeuvre d’Ollivier, à cet égard, est à la fois exemplaire et unique.
Auteur de quatre romans, deux recueils de nouvelles, un récit autobiographique et de nombreux essais, Ollivier est aujourd’hui parmi les plus primés des auteurs haïtiens (Prix Jacques Roumain en 1985, Grand Prix du livre de la ville de Montréal en 1991, Prix Carbet en 1996, Chevalier de l’Ordre des arts et lettres de France en 2000, etc.), mais son oeuvre demeure paradoxalement largement méconnue par la critique. Si ses lecteurs sont nombreux, la critique ne semble pas savoir sur quel pied danser devant cette « écriture métisse » et, jusqu’à présent, a plutôt opté pour le silence[3]. Les articles réunis dans ce dossier cherchent à briser ce malheureux mutisme de la critique en faisant ressortir la spécificité esthétique de l’écriture d’Ollivier tout en situant l’oeuvre dans l’histoire littéraire québécoise et haïtienne.
Parmi les souvenirs d’enfance consignés dans Mille eaux, Ollivier note à plusieurs reprises l’impression de vivre dans un univers dont il ne connaît pas le code secret. « J’avais devant moi le réel et je supputais ce qui serait ou ne serait pas, et je m’épuisais à faire le tour du champ trop mouvant des possibles[4]. » Le lecteur de l’oeuvre d’Ollivier ne peut manquer de constater que c’est aussi cette même démarche que poursuit son écriture, en quête, inlassablement, des mots justes pour dire l’infini des possibles[5]. Traversant l’histoire haïtienne, les eaux et les océans, le continent américain, des vies et des espaces urbains labyrinthiques, cette « écriture métisse » s’élabore à partir d’une esthétique du questionnement qui se refuse à toute affirmation illusoirement rassurante… identitaire ou autre (d’où la déroute, sans doute, de la critique). Engageant le dialogue avec les modes multiples du dire et de l’être, des contrées enneigées du Nord comme de l’espace clos de l’île accablée de chaleur, les textes d’Ollivier invitent le lecteur à se méfier des certitudes et du déjà dit. Tout reste toujours à dire et à redire, à lire et à relire[6].
Les lectures réunies ici ne prétendent pas révéler le code secret de l’univers d’Ollivier ; elles s’attachent plutôt à situer cette oeuvre remarquable dans son contexte littéraire et à faire ressortir certaines des caractéristiques marquantes de cette écriture-banian aux déracinements et enracinements multiples. Par ailleurs, aucune étude ne pouvant embrasser l’ensemble des oeuvres d’Ollivier et les multiples problématiques soulevées par celles-ci, chaque essai porte sur un aspect particulier tel qu’appréhendé dans un ou plusieurs textes, si bien que ce n’est pas chacune des contributions mais toutes les réflexions critiques proposées ici qui visent à présenter un premier tour d’horizon de cette esthétique des possibles que présente l’écriture d’Ollivier — en espérant que d’autres études plus approfondies viendront bientôt enrichir cette réception critique encore embryonnaire. Ainsi Thomas Spear et Éloïse Brière s’intéressent à la « traduction des codes » interculturelle et la « narration déterritorialisée ». Spear démontre comment l’oeuvre de fiction et les essais d’Ollivier s’éclairent mutuellement, rappelant au lecteur que l’existence est faite « de choses pour lesquelles il n’existe pas de mots » et qu’il faut néanmoins trouver le moyen de comprendre (l’Autre) et de communiquer. À partir du plus récent texte de fiction d’Ollivier, Regarde, regarde les lions, Éloïse Brière examine les modes d’inscription de cette écriture « transculturelle » dans la littérature québécoise dont la toile est en voie d’être retissée à l’heure où « l’enracinement n’est plus ». Yves Chemla s’interroge aussi sur les procédés permettant à Ollivier de « se situer dans un entre-deux du langage et de la culture », mais en mettant Mille eaux et Haïti au centre de son propos. Relevant la récurrence de la figure de la faille (la fissure), dans ce récit autobiographique, Chemla l’interprète comme la métaphore d’une rupture fondatrice, à la fois individuelle et collective, donnant lieu à une écriture de l’émancipation. Les réflexions de Joëlle Vitiello partent également de cette « rupture fondatrice » pour démontrer comment elle génère une multiplicité de représentations du pays natal. Distance, mémoire, histoires et Histoire, nostalgie, rejet, désir de retour, déception du retour : autant « d’effets d’exil » qui modulent les différentes visions d’Haïti qui traversent l’oeuvre d’Ollivier.
Les lectures de Joubert Satyre et de Christiane Ndiaye portent sur les filiations esthétiques des oeuvres d’Ollivier par rapport à l’histoire littéraire haïtienne. L’étude de Ndiaye souligne les caractéristiques des romans d’Ollivier (Mère-Solitude et Les urnesscellées, notamment) qui marquent la rupture qui se manifeste chez plusieurs écrivains de la diaspora haïtienne, avec les conventions du réalisme merveilleux, longtemps perçues comme essentielles à la spécificité de la littérature caraïbéenne. La question se pose alors de savoir si l’oeuvre d’Ollivier ne serait pas exemplaire d’une nouvelle tendance esthétique du roman haïtien et si on peut nommer celle-ci. Satyre répond par l’affirmative : il s’agirait d’un néo-baroque dont les traits distinctifs apparaissent abondamment dans les romans d’Ollivier. Si le monde n’est pas porteur de sens en lui-même, le baroque serait « une attitude théâtrale devant la vie », où l’ostentation tente de faire échec à l’angoisse suscitée par l’inconstance de l’existence humaine. Masques, mises en scènes, parades et trompe-l’oeil, tout est mis en oeuvre pour compenser le vide. Les mots et les images se multiplient… parce qu’on n’aura jamais fini de décrire la mouvance du réel[7], ou parce qu’il faut constamment réinventer le langage pour ne pas se faire happer par un univers sans code secret ?
Ollivier lui-même répond : parce que « le nomadisme a repris ». S’interrogeant sur la mondialisation culturelle et le rôle que peut y jouer la littérature et en particulier l’écriture migrante, Ollivier constate : « loin d’appauvrir l’invention culturelle, d’uniformiser la création, d’abêtir les peuples, la mondialisation permet le déploiement inédit de signes, de symboles et d’images ». Ainsi la communauté des écrivains participe-t-elle à la « quête de nouvelles intelligibilités » et d’images qui migrent pour déjouer les stéréotypes, la quête « d’une écriture qui permet aux identités de se jouer et de se déjouer les unes des autres ». Si les romans et les nouvelles d’Ollivier nous convient à lire le déploiement inédit des signes dans le monde actuel, cet essai magistral nous invite, sur un autre mode, à mieux penser l’infini des possibles.
Écriture métisse ? écriture baroque ? écriture banian ? écriture nomade ? S’il est difficile de trouver un qualificatif adéquat pour l’oeuvre d’Ollivier, cette difficulté témoigne en soi de ce que l’inventivité de l’oeuvre n’a rien de conventionnel. Nous n’avons pas fini de découvrir les stratégies « détotalisantes » de cet écrivain à la parole ouverte sur le monde des possibles.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Jacques-Stéphen Alexis, « Où va le roman ? », 1957, p. 84.
-
[2]
Voir René Depestre, « Une « identité-banian » », 1996, p. 22-23.
-
[3]
Si, à la parution d’une nouvelle oeuvre d’Ollivier, le dossier de presse est fourni, les articles de fond et ouvrages sont rares. Un outil de recherche aussi « sophistiqué » que le site de l’U.N.E.Q. (« l’île ») n’en recense que deux, mais une recherche plus poussée peut en retracer une dizaine et un ouvrage, mais vu l’ampleur et la qualité de l’oeuvre, cette récolte est maigre.
-
[4]
Émile Ollivier, Mille eaux, 1999, p. 155.
-
[5]
Ibid., p. 123.
-
[6]
Voir Émile Ollivier, « Améliorer la lisibilité du monde », 1995, p. 223-235.
-
[7]
Voir cette remarque répétée trois fois par le narrateur de Mère-Solitude, 1994 : « Cette ville, on n’aura jamais fini de la décrire ! »
Références
- Alexis, Jacques-Stéphen, « Où va le roman ? », Présence africaine, n° 13 (avril-mai 1957), p. 81-101.
- Depestre, René, « Une “ identité-banian ” », Courrier de l’U.N.E.S.C.O. (octobre 1996), p. 22-23.
- Ollivier, Émile, « Améliorer la lisibilité du monde », dans Maryse Condé et Madeleine Cottenet-Hage (dirs.), Penser la créolité, Paris, Karthala, 1995, p. 223-235.
- — — —, Mère-Solitude, Paris, Le serpent à plumes, 1994 [1989].
- — — —, Mille eaux, Paris, Gallimard, 1999.