Résumés
Résumé
Durant la pandémie de COVID-19, des mesures exceptionnelles restreignant les libertés ont été appliquées avec pour mot d’ordre : « Restez chez vous ! » Si la prison est devenue métaphore du confinement, peu de choses sont connues sur la façon dont la période a été vécue par les personnes détenues. À partir d’une enquête sociologique réalisée dans cinq prisons françaises durant la pandémie (2020-2021), associant observations et entretiens, cet article interroge les effets des politiques de confinement sur l’expérience carcérale. Nous montrons que l’altération ou la suspension des principales « activités » dans lesquelles les détenus sont tenus de s’impliquer durant l’incarcération (l’école et la formation professionnelle, le travail, les soins), et dont l’engagement est récompensé en temps ordinaire par des réductions et des aménagements de peine, a exacerbé l’un des paradoxes majeurs d’une institution enjoignant son public à l’« activité » tout en le contraignant à l’immobilité. Nous soutenons qu’au-delà d’un quotidien bouleversé, c’est le sens même de la peine de prison, construite autour du thème de la « réinsertion », qui a été troublé dans une institution à l’arrêt et une société confinée.
Mots-clés :
- Prison,
- COVID-19,
- confinement,
- expérience carcérale,
- ethnographie
Abstract
During the COVID-19 pandemic, exceptional measures that restricted freedoms were applied using the motto : “Stay home ! ” If the prison became a metaphor for confinement, little is known about how this period was experienced by actual detainees. Based on an ethnographic field study conducted in five French prisons during the pandemic in 2020 and 2021, and combining observations and interviews, the present article questions the impacts of confinement policies on the penitentiary experience. We show that the alteration or suspension of the major activities that inmates are required to partake in during their time in prison (school and training, work, healthcare)–and whose commitment is rewarded in ordinary times by sentence reductions and accommodations–has exacerbated one of the main paradoxes of an institution that pushes its population towards “activity,” while forcing them into immobility. We suggest that it is the very meaning of the prison sentence, built around the theme of “reintegration,” which has been disturbed in the context of a standstill institution and a confined society.
Keywords:
- Prison,
- covid-19,
- lockdown,
- prison experience,
- ethnography
Resumen
Durante la pandemia de Covid-19, se aplicaron medidas excepcionales de restricción de libertad, bajo el lema de « ¡Quedaos en casa ! ». Si la cárcel se volvió una metáfora del confinamiento, poco se sabe sobre cómo las personas detenidas vivieron dicho periodo. Partiendo de una investigación sociológica llevada a cabo en cinco cárceles francesas durante la pandemia (2020-2021), asociando observaciones y entrevistas, este artículo se interesa por los efectos de las políticas de confinamiento sobre la experiencia carcelaria Los autores muestran que la alteración o la suspensión de las principales « actividades » en las que los detenidos pueden implicarse durante su encarcelamiento (escuela y formación profesional, trabajo, cuidados de salud), y cuya implicación se recompensa en tiempo ordinario con reducciones de pena y beneficios penitenciarios, ha venido a exacerbar una de las mayores paradojas de una institución que exhorta su público a la « actividad » mientras lo obliga al mismo tiempo a la inmovilidad. El artículo sostiene que, más allá de la vida cotidiana en prisión, es el propio significado de la pena de prisión, construido alrededor del tema de la « reinserción », el que ha sido puesto en cuestión en una institución paralizada y una sociedad confinada.
Palabras clave:
- prisión,
- Covid-19,
- confinamiento,
- experiencia carcelaria,
- etnografía
Corps de l’article
Introduction
Le 16 mars 2020 au journal télévisé de 20 heures, le président de la République française annonce le confinement du pays en lien à la pandémie de COVID-19. Un mot d’ordre : « Restez chez vous ! » Dans les jours qui suivent, la presse relaie les témoignages de personnes assimilant leur nouvelle vie retranchée à domicile à un quotidien derrière les barreaux (« Rester enfermé chez soi, c’est comme être en prison », « On est vraiment presque comme en prison maintenant ») ou comparant d’autres types d’établissements à des prisons (« On ne va pas transformer les directeurs d’Ehpad[3] en gardiens de prison », « Ce que l’on est en train d’aménager va ressembler quelque part à des parloirs de prison ») (Le Télégramme, 27 mars 2020 ; Le Figaro, 30 mars 2020 ; Le Figaro, 20 avril 2020 ; Centre Presse Aveyron, 21 avril 2020). La prison est devenue métaphore, mais peu de choses sont connues sur les conséquences, pour les personnes détenues, des politiques de confinement et la façon dont elles les ont vécues.
Dès le début de la pandémie en effet, de nombreux billets d’opinion, articles scientifiques, postface à des rééditions ou tribunes ont été publiés sur la situation en prison, mais ceux-ci se sont centrés sur les risques que les établissements pénitentiaires deviennent d’importants foyers de contamination surexposant les détenus à une infection par le virus (Akiyama, Spaulding et Rich, 2020 ; Fassin, 2020 ; Lancelevée et Fovet, 2020 ; Nelson et Kaminsky, 2020 ; Robinson, Heyman-Kantor et Angelotta, 2020), ou ont interrogé la nécessaire réorganisation des services de santé en milieu pénitentiaire dans ce contexte de « crise sanitaire » (di Giacomo, Clerici, Peschi et Fazei, 2020 ; Fovet et al., 2020 ; Hewson, Robinson, Khalifa, Hard et Shaw, 2021 ; Le Marcis, 2020). Les effets spécifiques des politiques de confinement en prison n’ont en revanche pas été décrits. Publiées dans un contexte d’urgence afin de peser dans le débat public, rares sont de plus ces réflexions s’appuyant sur des données empiriques[4] et, à l’exception d’une enquête réalisée par téléphone auprès de 31 hommes détenus dans une prison de haute sécurité étatsunienne à propos de leur perception des risques d’infection par le SARS-CoV-2 (Pyrooz, Labrecque, Tostlebe et Useem, 2020), les points de vue des détenus n’ont pas été étudiés.
Cet article vise à combler un manque dans les connaissances in situ dont on dispose sur la façon dont les politiques de confinement ont affecté l’« expérience carcérale » (Chantraine, 2004 ; Rostaing, 1997 ; Rostaing, 2006 ; Touraut, 2009, 2019). Notre propos repose sur une enquête de terrain réalisée dans cinq prisons françaises pendant la pandémie de COVID-19, entre décembre 2020 et mars 2021[5]. Les établissements pénitentiaires ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques distinctives, qui permettent d’appréhender une situation d’ensemble à la fois en termes de types de structure (maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale, quartier de semi-liberté…), de taille (de 150 à plus de 1000 personnes détenues), de population (hommes ou femmes ; prévenus ou condamnés ; durée de la peine) et de situation sanitaire : certaines de ces prisons comptaient plusieurs foyers de contamination parmi leur population détenue lors de notre enquête, quand d’autres n’avaient encore identifié aucun cas.
Nous avons conduit 55 journées et une nuit d’observation dans ces prisons[6] en variant autant que possible nos postes d’observation, passant par exemple une matinée en salle de soins avec les infirmières et leurs patients, puis déjeunant au mess avec des conseillères pénitentiaires, avant d’accompagner des détenus travaillant comme « auxiliaires-COVID[7] » dans le nettoyage des traces potentielles du virus dans les parloirs, puis de rejoindre des surveillants à leur étage. Les observations ont été complétées par 60 entretiens réalisés avec 67 personnes : 34 détenus (8 femmes et 26 hommes) et 33 professionnels occupant diverses fonctions (surveillants, infirmières, médecins, directeurs d’établissement, juges de l’application des peines…). Ces entretiens enregistrés, d’une durée variable allant de trente minutes à deux heures, ont été conduits dans les établissements (bureaux, parloirs, boxes en détention…), puis intégralement retranscrits[8]. Leur consigne initiale invitait à revenir sur l’annonce à la télévision, un an plus tôt, du premier confinement national.
Cette annonce constitue aussi le point de départ de notre propos, qui examine l’application d’une politique de confinement en prison, marquée par l’altération ou la suspension de l’ensemble des « activités » dans lesquelles les détenus sont tenus de s’impliquer en temps ordinaire durant l’incarcération. À partir de l’analyse des plus valorisées d’entre elles par l’institution judiciaire, qui les récompense par des réductions et des aménagements de peine, puis d’audiences de juges de l’application des peines où sont prises ces décisions, nous montrons que la politique de confinement a exacerbé l’un des paradoxes majeurs (Bouagga, 2015, p. 124) de l’institution carcérale qui impose à son public d’être « actif » et de « se mobiliser », tout en le contraignant à l’inactivité et l’immobilité. Nous concluons que c’est le sens même de la peine de prison, construite autour du thème de la « réinsertion », qui a été troublé dans une institution à l’arrêt et un monde confiné.
Faire sa peine au temps de la COVID : un accès compromis aux dispositifs de « réinsertion »
Dès l’entrée en prison puis tout au long de l’incarcération, les détenus sont soumis à l’injonction permanente de se saisir de l’enfermement comme d’une « opportunité » ; ils sont enjoints d’être « actifs » et « faire quelque chose » de la peine, comme l’illustre l’échange suivant entre un officier et une personne venant d’être incarcérée à la maison d’arrêt pour hommes de Clonnay[9], qui est incitée à se sevrer du crack et à s’engager dans des soins durant ses deux mois et dix jours à passer dans l’établissement :
L’officier pénitentiaire demande au détenu assis face à lui dans le bureau : « On vous a pas remis la pochette ? » Ce dernier fait non de la tête. « Par contre, on vous a bien remis les kits ? » Il répond que oui. L’officier quitte la pièce, et, depuis la coursive, il demande à ce qu’on lui apporte « dix pochettes arrivants ». Se rasseyant à son bureau, il s’adresse à moi : « Ce monsieur fait une petite peine, il est dans une situation particulière, parce qu’il est SDF[10] et il a des addictions lourdes. » Se tournant vers lui, il poursuit : « Vous allez aller au CSAPA[11], ils vont vous donner quelque chose pour les addictions. Là ça va, vous n’allez pas être en manque ? » Le détenu lui répond que « ça va ». L’officier lui tend une feuille (…), en disant : « Là, c’est le planning aux arrivants, et c’est pareil, on est en période de COVID, donc il n’y a pas tout, il y a juste les promenades et la bibliothèque. » (…)
Notes d’observation, audiences des arrivants à la maison d’arrêt de Clonnay, 12 janvier 2021
L’officier reprend son audience, parcourant sur l’ordinateur ses informations pénales : « Alors vous, vous avez pris trois mois, donc vous êtes là jusqu’au 10 avril… » Il s’interrompt, saisit un bloc-notes et calcule ses crédits de réduction de peine (CRP), automatiquement déduits de la peine restant à effectuer : « Ça fait trois mois, moins sept fois trois vingt et un, donc : moins vingt et un jours », puis il précise que sa peine pourra aussi être réduite sous d’autres conditions : « Même si c’est une petite peine, vous pouvez aussi avoir des RPS[12]. Donc vous par exemple, si vous vous engagez à bénéficier de soins pour les addictions – surtout que c’est le crack, donc c’est une drogue dure -, vous pourrez peut-être avoir des RPS. Par contre les RPS, c’est pas systématique ; c’est pas comme les CRP, c’est le magistrat qui décide : je peux pas dire si vous en aurez. »
Cette injonction à l’« activité » revêt un caractère obligatoire pour les détenus qui, comme lui, ont été condamnés pénalement[13], mais elle s’impose à tous quel que soit le statut pénal, pesant aussi sur les prévenus. Se soigner. Aller à l’école ou suivre une formation. Travailler. À partir du cas de ces trois formes d’engagement fortement valorisées par l’institution, qui les perçoit comme des indices d’« efforts sérieux de réinsertion »[14] et les récompense sur le plan judiciaire par des réductions et des aménagements de peine, nous allons voir dans un premier temps que la politique de confinement a fortement contraint la possibilité, pour les détenus, de répondre à cette attente institutionnelle.
L’enseignement et la formation professionnelle
Les enseignants de l’Éducation nationale ont quitté leurs élèves le 13 mars 2020 pour le week-end, et ils ne les ont pas retrouvés le lundi suivant. Il en a été de même en prison : les « quartiers scolaires » ont fermé leurs portes à l’annonce d’un confinement national. « On fonctionne comme à l’extérieur : si effectivement le gouvernement demande que l’école soit suspendue, c’est suspendu », indique un surveillant pénitentiaire pour souligner que les mesures appliquées en prison durant la pandémie ont été calquées sur celles mises en oeuvre à l’échelle nationale. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, alors que les enseignants en milieu scolaire ordinaire ont ajusté leurs pratiques pour permettre une « continuité pédagogique », usant pour ce faire d’outils numériques (Bonnéry et Douat, 2020), les élèves détenus n’ont quant à eux connu ni les cours en visioconférence, ni les discussions et examens sur des plateformes numériques. Privés d’accès à internet et aux technologies de l’information et de la communication (Salane, 2008), c’est par courrier et de façon sporadique qu’ils ont pu bénéficier de quelques leçons et exercices préparés par leurs enseignants.
Cette situation a duré dans le temps. Les détenus n’ont pas été autorisés à retourner en cours dans le creux des trois vagues épidémiques, contrairement aux publics des établissements ordinaires : les quartiers scolaires étaient toujours fermés un an après le début de l’épidémie. En janvier 2021, tandis qu’une directive ministérielle prévoyait le retour des étudiants identifiés comme « vulnérables » sur les bancs des universités, une enseignante exerçant en maison d’arrêt s’étonnait que les détenus n’aient pas fait l’objet d’une directive similaire :
Par rapport à nos collègues à l’extérieur, qui fonctionnent, vous voyez on se dit : « Pourquoi nous on peut pas ? » Alors qu’on a quand même un public hyper vulnérable. (…) C’est quand même très ingrat, et c’est vrai que les enseignants en milieu pénitentiaire le vivent d’autant plus mal en ce moment qu’à l’extérieur nos collègues sont devant leurs élèves, et qu’en ce moment – depuis une semaine, je crois –, il a été décidé pour les facs de reprendre avec le public dit « vulnérable », c’est-à-dire ceux qui n’ont pas accès à internet de chez eux, qui n’ont pas… Si nos élèves ici ne sont pas vulnérables, je sais pas qui l’est.
Josiane T., responsable locale de l’enseignement dans une maison d’arrêt, professeure de français, le 21 janvier 2021
À bien des égards, les détenus apparaissaient pourtant particulièrement « vulnérables » : leurs conditions matérielles sont difficiles (Durand, 2014 ; Marchetti, 1997) et 10 % d’entre eux sont en situation d’illettrisme (Combessie, 2018, p. 38). Si l’on sait que le distanciel a renforcé les inégalités scolaires en milieu ordinaire (Bonnéry et Douat, 2020 ; Busquet, 2021 ; Lambert et Cayouette-Remblière, 2021 ; Penna, 2020 ; Poullaouec, 2021), il a de plus d’autres implications en prison. Pour nombre de détenus, aller à l’école constituait l’une des rares occasions de quitter pour un temps la cellule et « s’occuper » :
Moi j’allais à l’art plastique, ça a été arrêté. On n’y est pas retourné. Depuis, il y a pas. Par contre, c’est pareil, j’allais plutôt pour m’occuper : histoire-géo, français, tout ça bon, de toute façon… (…) Selon ce qu’on faisait, ça nous occupait quand même des matinées. Bon, c’est vrai qu’on allait à l’histoire-géo, c’était le matin. Moi, j’allais aussi à la revue de presse le vendredi après-midi. Ça nous occupait et… Qu’au lieu d’être enfermées tout le temps.
Mireille G., 74 ans, détenue depuis 8 ans, en centre de détention, le 5 mars 2021
Les cours à distance ont aussi accru leur dépendance vis-à-vis des agents pénitentiaires, chargés de remettre aux élèves détenus les courriers préparés par l’équipe enseignante :
C’est plus difficile [les cours à distance], parce que du coup on dépend de la prison : c’est eux qui reçoivent les trucs. Des fois on leur demande : « Non » ; ils ont pas reçu. Mais en fait c’est quelqu’un d’autre qui a reçu, c’est un peu compliqué. Enfin, c’est pas évident.
Assa H., 25 ans, détenue depuis 4 mois en maison d’arrêt, le 8 février 2021
Enfin, tous ceux suivant des formations diplômantes ont tout bonnement été privés de la possibilité de se présenter aux épreuves et obtenir leur diplôme au printemps 2020. « Les formations se sont arrêtées du jour au lendemain, beaucoup sont sortis et n’ont pas reçu leur CAP[15] », explique un formateur professionnel en mécanique[16] ; d’autres ont redoublé leur année et étaient toujours dans l’attente de la reprise des enseignements un an plus tard :
[Je fais des études] en sciences. J’étudie les sciences physiques. (…) C’est une licence. Donc là j’ai passé la Licence niveau 2. Je devais passer la Licence niveau 3, mais à cause du COVID justement je peux pas, donc c’est reporté à l’année prochaine.
Paulo D., 57 ans, détenu depuis 4 ans, en maison d’arrêt, le 10 février 2021
Les détenus n’ont ainsi plus eu accès à ce dispositif de « réinsertion » durant la pandémie.
Le travail rémunéré
Les secteurs des ateliers, où les détenus ont la possibilité de travailler en échange d’une rémunération à la pièce, ont également fermé leurs portes à l’annonce du confinement. Auparavant, Thierry F., 47 ans, y travaillait chaque jour de la semaine comme contrôleur : il avait pour mission de s’assurer que des pièces automobiles avaient bien été nettoyées par d’autres travailleurs détenus. Il se souvient de la soudaineté de la fermeture des ateliers : « On nous a appris à dix heures qu’on arrêtait de travailler à 11 h 30 et qu’on ne reprendrait pas l’après-midi. » Il s’est subitement retrouvé enfermé 24 heures sur 24 en cellule : « Ça a été un peu la douche froide parce que du coup ça a été l’enfermement. Je l’ai pris assez mal parce que c’était la seule activité[17] que j’avais. » Du jour au lendemain, Thierry F. s’est trouvé sans ressources : « Quand on travaille pas, si on n’a pas d’argent qui vient de l’extérieur, on n’a plus de ressources. C’est assez difficile à vivre. J’ai toujours été autonome depuis mes vingt ans, donc c’est vrai que forcément ça rajoute, on va dire, une charge émotionnelle négative. »
La fermeture des ateliers, comme celle des quartiers scolaires, a accru l’isolement et l’oisiveté des détenus, mais elle a aussi occasionné une perte brutale de revenus. Les établissements pénitentiaires ont certes suspendu des prélèvements sur le pécule (coût du frigidaire, de la télévision) et donné à titre gracieux quelques biens et assuré des services habituellement « cantinables » à l’épicerie de la prison (sachets de lessive, crédit téléphonique…), mais la perte de revenus occasionnée par la fermeture des ateliers n’a pas été compensée par le versement d’aide sociale– les « mesures exceptionnelles » accordées aux personnes subissant des pertes économiques du fait de l’arrêt de leur activité en milieu « libre » n’ayant pas été reproduites en prison. Une partie des détenus a pu compter sur l’aide de proches non détenus, qui ont envoyé des mandats :
Ça tout stoppé : on a arrêté de travailler, on ne touchait plus de salaire. Ouais… Parce que moi dès que j’ai commencé à travailler, bon, je disais à ma famille ça sert à rien qu’ils m’envoient des mandats parce que je travaille, c’est mieux qu’ils gardent les sous pour eux qu’ils me les envoient. Je travaillais et en fait, dès qu’ils ont stoppé, dès qu’ils ont vu arriver le COVID, on a arrêté de travailler et… J’ai plus de sous. (…) Et après, ma famille m’ont envoyé des mandats par derrière.
Boubacar M., 28 ans, détenu depuis 5 ans, en maison d’arrêt, le 2 février 2021
D’autres en revanche, ne pouvant compter sur ce type d’aide, sont devenus « indigents »[18] :
À un moment, il y a des filles qui travaillaient à l’atelier, il y avait plus d’atelier et elles se sont retrouvées en indigentes. Ça veut dire que si tu n’as personne dehors qui peut envoyer de l’argent, déjà c’est dur. Bah, tu te retrouves ici sans rien parce que, là, il y a même pas « SDF » : tu n’as pas d’aide dehors, tu es SDF, tu vas aller vers des associations. Ici, on n’y a pas le droit. Donc vraiment quand tu n’as rien, tu n’as rien.
Maïté B., 49 ans, détenue depuis 14 ans, en centre de détention, le 5 mars 2021
Mais que signifie ne plus avoir de revenus quand on est détenu ? C’est d’abord être dans l’impossibilité d’améliorer son quotidien en « cantinant » des produits à l’épicerie de la prison (sauces et condiments, tabac, produits d’hygiène…) et perdre la possibilité de cuisiner et manger selon ses goûts. C’est aussi ne plus pouvoir, par exemple, contribuer au coût d’un logement conservé à l’extérieur ou apporter de l’aide à ses proches (parents, enfants…). C’est, enfin, ne plus être en mesure de payer ses frais fixes de procédure, d’éventuelles amendes et de dédommager des victimes – et ainsi répondre à une attente de l’institution judiciaire :
[Sociologue : Ça a quand même une incidence de ne pas avoir ce salaire, parce que vous, vous avez des dépenses, je ne me rends pas compte ?] C’est… Alors oui, comme j’ai été condamné, j’ai une amende à payer, donc tous les mois j’ai une partie… J’ai des parties civiles. Donc c’est le remboursement de cette amende, qui est de quarante euros : j’ai mis en place moi-même un prélèvement de quarante euros. Voilà. Donc tous les mois, j’ai quarante euros qui sont prélevés automatiquement sur mon pécule.
Fabien V., 32 ans, détenu depuis 2 ans et 9 mois en maison d’arrêt, le 2 février 2021
La fermeture des ateliers a ainsi accentué la dépendance financière de détenus envers leurs proches, elle a aggravé les conditions de vie de celles et ceux ne bénéficiant pas de soutien à l’extérieur, et elle a entravé la possibilité de répondre à des attentes judiciaires de dédommagement de victimes, de règlement d’amendes et de paiement de frais de procédure.
L’accès aux soins
Contrairement aux quartiers scolaires et aux ateliers, les infirmeries des établissements pénitentiaires n’ont à aucun moment fermé leurs portes durant la crise sanitaire. L’accès aux espaces de soins a cependant été rendu plus difficile. Pour aller à l’infirmerie, les détenus doivent en effet en temps ordinaire déjà rédiger un courrier justifiant la nécessité de recevoir des soins ou consulter un médecin, puis le déposer dans l’une des boîtes à lettres situées dans les coursives et divers espaces des établissements (Bessin et Lechien, 2000 ; Chassagne, 2015 ; Mahi, 2015). Or, l’arrêt de la plupart des « activités » et l’annulation de leurs « mouvements » associés – c’est-à-dire, dans le langage pénitentiaire, les déplacements jusqu’aux ateliers, aux parloirs, à l’école, au sport… – a complexifié l’accès à ces boîtes :
Nous [à l’infirmerie], on a eu beaucoup moins de courriers qu’avant, forcément, puisqu’ils avaient moins d’activités, moins de sorties. (…) Vu qu’ils ne sortaient pas de leur cellule, ils pouvaient pas… En fait, on a une boîte aux lettres sur les coursives, donc ils ne pouvaient pas accéder à la boîte aux lettres tout simplement.
Christiane G., infirmière dans une maison d’arrêt pour femmes et une maison d’arrêt pour hommes, le 18 janvier 2021
Les boîtes à lettres sont restées vides. Cependant, pour les équipes médicales, la baisse des demandes de soins ne s’explique pas seulement par les difficultés d’accès à ces boîtes :
[Lors du confinement national], ils avaient peur, ils voulaient pas descendre [à l’infirmerie]. (…) Partout, dans toutes les divisions, ils écrivaient plus les mecs. Ouais. Ouais. Ils avaient peur. (…) Ils le mettent justement [sur le bon de convocation], ils mettent : « Non. À cause du Corona, je veux pas attendre en salle d’attente. » Après, ça s’entend.
Julie L., 34 ans, infirmière dans une maison d’arrêt pour hommes depuis 3 ans, le 28 janvier 2021
L’injonction gouvernementale à « rester chez soi » et l’état de sidération générale qui a suivi l’annonce du premier confinement national ont engendré des formes de retranchements volontaires en cellule. Nombre de détenus ont évité d’en sortir, et par conséquent aussi de se rendre à des convocations médicales, par peur d’être infectés par le virus. Les infirmeries des prisons ont été, de surcroît, tout particulièrement perçues par les détenus comme des lieux à haut risque d’infection par le coronavirus. Cela est d’autant plus vrai dans les prisons où des membres des équipes médicales avaient été infectées par le virus :
Déjà il faut savoir qu’ici, nous, ça a débuté en mars quelque chose comme ça, et ça a été compliqué parce qu’en fait c’est deux infirmières qui l’ont eu en premier. Donc en fait c’était la panique totale parce qu’on nous voyait limite comme des pestiférées du coup…
Lucie N., 32 ans, infirmière dans une maison d’arrêt, le 14 janvier 2021
La peur d’être infecté par le virus en se rendant à l’infirmerie a aussi été prégnante chez les personnes y faisant habituellement l’objet d’une surveillance médicale rapprochée et appelées à s’y rendre plusieurs fois par jour. Christine M., médecin-chef au centre pénitentiaire de Clonnay, a observé que « les diabétiques » (qui se savaient à risque de développer une forme grave de la COVID-19) n’« aimaient pas trop venir à l’infirmerie » durant la première vague épidémique. Il en a été de même pour les détenus s’automutilant, dont les soins apportés à leurs blessures constituent une activité routinière en temps ordinaire pour les infirmières, et qui les ont moins souvent sollicitées : « Ils ont un truc de survie. (…) On va pas se couper parce qu’on n’a pas envie de passer à l’infirmerie pour aller se faire suturer », poursuit la médecin-chef. Ainsi, si les urgences des hôpitaux ont vu s’éclipser une partie de leur patientèle, les soignants des prisons ont observé de même une baisse du volume des demandes de soins exprimées par des détenus craignant d’être infectés par le virus s’ils se rendaient à l’infirmerie.
Les détenus ont donc moins exprimé de demandes de soins durant le premier confinement, mais certaines de leurs demandes n’auraient de toute manière pas été entendues, car l’offre de soins a par ailleurs été réduite. « En mars-avril, l’hôpital s’est arrêté », résume la médecin-chef de Clonnay, expliquant : « Tout ce qui n’était pas COVID était supprimé. Toutes les interventions non urgentes, toutes les consult’ spécialisées : tout a été arrêté. » La transformation de l’offre de soins, focalisée sur le virus – c’est-à-dire sur la prévention, les dépistages massifs puis les vaccinations, et la surveillance des cas positifs –, s’est effectuée au détriment d’autres problèmes de santé. Des missions centrales des équipes médicales sont devenues non « urgentes » dans ce nouveau contexte. Groupes de parole sur les usages de drogues, consultations de tabacologie, soins dentaires ou encore vaccinations contre l’hépatite B ont été suspendus. Le « retard » pris concernant certaines de ces missions est ensuite apparu considérable aux équipes médicales des établissements les plus touchés par le virus ; un an après le début de la pandémie, les soignantes d’une prison présentant plusieurs foyers de contamination observaient que des vaccinations qui auraient dû être réalisées l’année précédente ne l’avaient pas encore été :
[Dans le bâtiment où ont été regroupées les personnes infectées par le COVID-19, les infirmières], elles avaient arrêté carrément de faire les vaccinations contre les hépatites et ce genre de truc. Nous [dans notre bâtiment], on avait continué. Du coup, nous, quand on a recommencé à travailler normalement on n’avait rien à rattraper.
Gabriela C., 32 ans, infirmière dans une maison d’arrêt pour hommes depuis 4 ans, le 28 janvier 2021
Quelques professionnels de santé ont de plus cessé pour un temps de se rendre en prison. C’est le cas des éducateurs spécialisés des Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), ainsi que des assistantes sociales hospitalières, qui ont vu leurs autorisations d’accès suspendues en périodes de confinement :
La seule personne qui n’avait pas le droit de venir [en période de confinement], c’est Fabrice [l’éducateur du CSAPA, qui intervient habituellement une demi-journée par semaine]. On n’a pas très bien compris pourquoi. Parce qu’il dépend pas de l’UCSA[19] lui, donc il avait pas d’autorisation pour venir physiquement.
Ambre V., 30 ans, psychologue en maison d’arrêt depuis 3 ans, le 19 janvier 2021
L’assistante sociale était absente, car jugée non essentielle. (…) On faisait essentiellement des urgences, les arrivants et quelques suivis compliqués. Il y avait plus de séances de groupes. Plus d’accompagnement du CSAPA dans les murs non plus.
Hélène D., psychiatre en maison d’arrêt depuis 2 ans, notes d’observation, le 1er février 2021
De leur côté, des médecins spécialistes, parmi lesquels plusieurs psychiatres et dentistes dans les prisons étudiées, se sont pour leur part confinés à domicile pour leur propre sécurité :
Les seuls qui étaient chez eux [et ne venaient plus à la prison], c’était la dentiste et les psychiatres. Après, les psychiatres venaient un peu sur les urgences, mais très peu en fait.
Noëlle T., 59 ans, médecin-chef dans un centre pénitentiaire depuis 7 ans, le 2 février 2021
On pouvait pas voir le dentiste [pendant le premier confinement].
Shana T., 27 ans, détenue depuis 2½ ans, en centre de détention, le 12 février 2021
Nombre de détenus ont ainsi été privés de soins. Thomas D., détenu de 41 ans, voyait par exemple un psychologue deux fois par mois depuis quatre ans dans le cadre d’un accompagnement en addictologie et il n’a – sans explication – plus été convoqué à l’infirmerie à partir du premier confinement. Ce n’est qu’à la levée de celui-ci que son psychologue lui a expliqué avoir priorisé « les cas qui étaient les plus difficiles »[20]. Pour Max A., détenu de 26 ans, la situation est un peu différente : hospitalisé depuis plusieurs mois dans un hôpital-prison pour une rééducation à la suite d’un grave accident, il a dû retourner en prison au début de la pandémie car « il fallait faire de la place à l’hôpital ». Par conséquent, il n’a pas bénéficié des soins de rééducation initialement prévus – et il raconte ne pas pouvoir non plus les réaliser seul, comme il le voudrait, faute d’accès à la salle de musculation de l’établissement, qui est fermée dans le cadre de la politique de confinement :
En fait comme il y a eu le COVID, (…) il fallait libérer. Il fallait faire de la place à l’hôpital[-prison]. Et moi, comme j’étais en mode rééducation ça y est, j’étais plus en mode fauteuil roulant en gros, il n’y avait pas de rééducation à ce moment-là et ils ont préféré m’envoyer ici en attendant (…). Je boite encore un peu, j’ai encore mal, parce que j’ai pas de rééducation. J’ai pas de rééducation. Et là il y a le COVID, tout est fermé. Ma seule rééducation ici en prison, c’est moi-même : je m’entraîne en promenade, ou bien je suis inscrit à la musculation – à la salle de musculation – mais là, c’est fermé. [Sociologue : Ah oui, c’est vrai, il n’y a pas de muscu’ en ce moment.] Ça fait un petit moment que c’est fermé. (…) Je vais faire en sorte de m’entraîner tout seul même si c’est compliqué. J’ai quand même besoin de rééducation. Mais je peux rien faire.
Max A., 26 ans, détenu depuis 1 an et 3 mois, en maison d’arrêt, le 10 février 2021
Les détenus ont ainsi été privés d’accès à des soins, notamment spécialisés, durant plusieurs mois et cela sans possibilité de se tourner vers d’autres professionnels ou services de santé.
Durant la pandémie de COVID-19, les prisons n’ont donc pas tout à fait fonctionné « comme à l’extérieur », soit parce que les mesures nationales n’y ont pas été appliquées similairement, soit parce qu’elles y ont eu des effets spécifiques. La fermeture des quartiers scolaires, des ateliers de travail et la réduction de l’offre de soins ont bouleversé le quotidien des détenus – accentuant leur dépendance et aggravant leur situation économique, sanitaire et sociale –, mais cette politique de confinement a également compromis leur possibilité de fournir la preuve d’une capacité de « réinsertion », en les empêchant de se plier à l’injonction institutionnelle à s’engager dans des « activités ».
Sortir de prison ? Face aux juges de l’application des peines, justifier le temps de la peine
Plus d’école, plus de travail, un accès réduit aux soins : les directives visant à contenir la propagation de la COVID-19 ont placé les prisons comme l’ensemble du pays à l’arrêt. Comment, dans ce contexte encore plus qu’en temps ordinaire, répondre à l’injonction de l’institution de ne pas être oisif mais bien « actif » et ainsi prouver sa capacité à se « réinsérer » ? L’exacerbation de ce paradoxe est particulièrement palpable lorsque se pose la question de l’octroi (ou non) d’un aménagement de peine ; nous l’aborderons à partir de débats contradictoires observés à la maison d’arrêt pour hommes de Clonnay, où des juges de l’application des peines examinent chaque semaine les demandes de libération formulées par les personnes qui y sont emprisonnées.
Des salles de classe vacantes transformées en salles d’audience
À la maison d’arrêt pour hommes de Clonnay, les salles de classe n’ont pas tout à fait fermé leurs portes le 13 mars 2020. Elles ont changé de fonction. Les enseignants n’ayant plus accès à la prison et les détenus ne pouvant plus quitter leurs bâtiments – confinés – pour se rendre à la salle où se tiennent ordinairement les audiences d’application des peines, c’est dans ces salles de classe devenues vacantes qu’ont temporairement eu lieu les « débats contradictoires ». Ici se décide désormais l’octroi (ou le refus) d’aménagements de peine. Les juges de l’application des peines prennent place devant le tableau noir. Les détenus s’installent face à eux, à des pupitres en bois d’écolier. Aux murs, un planisphère et des règles de grammaire.
Avant l’entrée du premier détenu inscrit au rôle de l’audience du jour, Marianne L., juge de l’application des peines, anticipe une commission qui aura lieu la semaine suivante en faisant remarquer au substitut du procureur assis à sa droite : « J’ai des doutes sur sa demande de permission de sortir pour aller à la mission locale, vu les conditions actuelles… » Les directives nationales imposent alors un couvre-feu à 20 heures, la fermeture de lieux de sociabilité (bars, cafés, restaurants…) et l’interdiction des rassemblements et des déplacements interrégionaux. Nous, sociologues, faisons chaque jour nos trajets hôtel-prison avec en notre possession une attestation dérogatoire tamponnée par nos tutelles et le contrat de cette recherche à présenter en cas de contrôle policier.
Aussitôt installé à l’un des petits bureaux, le premier détenu dont la demande de libération anticipée est étudiée aujourd’hui explique à la juge de l’application des peines : « Je devais aller à l’école de la deuxième chance à [ville], mais c’est tombé à l’eau à cause de la situation sanitaire, ça n’a pas pu être traité. » Sa demande renvoyée, il restera quelques semaines de plus, au moins, en prison. Face au détenu suivant, la juge constate : « Vous bénéficiez d’une promesse d’embauche en cuisine, mais le gérant s’est désisté. » Il répond en rappelant que les bars et les restaurants ont fermé depuis : « À cause du COVID, c’est compliqué, c’est pas possible. » Rejetant une autre demande d’aménagement de peine, la magistrate constate : « Vous n’avez investi aucun parcours d’exécution des peines. » Un magistrat assumant une fonction similaire dans un autre établissement résume ainsi les conséquences des doctrines sanitaires sur leurs décisions :
Le fait que les personnes ne puissent plus faire d’activité en détention, cela réduit le nombre d’aménagements. (…) Donc le nombre d’aménagements a diminué du fait de l’absence d’activité, en l’absence d’éléments pour constater.
Solal M., juge de l’application dans une maison d’arrêt pour femmes depuis 2 ans, le 23 mars 2021
Les magistrats ont en fait vu leurs possibilités d’individualisation des peines réduites, du fait des politiques de confinement qui ont participé à réduire l’individualisation des « parcours d’exécution des peines » – c’est-à-dire le fait, pour les détenus, d’investir la peine en allant à l’école, en obtenant un diplôme, en travaillant aux ateliers, en étant accompagné par le CSAPA, etc.
L’audience de Malik D., libérable, mais sans « projet »
L’audience de Malik D., détenu depuis six mois à Clonnay, illustre la façon dont la combinaison de plusieurs facteurs a restreint les possibilités de bénéficier d’un aménagement de peine : suspension de l’ensemble des activités, retranchement volontaire en cellule par peur d’être infecté par le virus, politique de couvre-feu en vigueur à l’extérieur de la prison. Une fois rappelée sa situation, la magistrate indique :
Marianne L., juge de l’application des peines : Vous avez demandé à participer à toutes les activités, vous écrivez, vous avez dit…
Malik D., détenu : J’ai écrit. Ils ont confiné, reconfiné, alors il y a pas d’activité. Là ça fait une semaine qu’on est reconfiné. J’essaie de pas sortir.
Marianne L., juge de l’application des peines : Par peur d’être contaminé ?
Malik D., détenu : Oui.
Après que le substitut du procureur, surpris par les multiples demandes de libération déposées, a mis en doute son projet de sortie, Malik D. insiste sur sa peur du virus :
Aurélien D., procureur : Le projet professionnel change, maintenant on a une demande de semi-liberté. Il y a pas de projet, vous voulez juste sortir à tout prix. C’est quoi cette formation, c’est un organisme, ils donnent une certification ?
Malik D., détenu : C’est pour apprendre à changer les robinets, comprendre les circuits de… Je vais vous dire, c’est à cause du COVID, j’ai peur de rester ici.
Mais ses arguments ne convainquent pas : sollicités pour donner leur avis, le substitut du procureur et une conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation se disent défavorables à toute mesure d’aménagement de peine. La parole est alors donnée à son avocate pour sa plaidoirie :
Je vais d’abord répondre à monsieur le procureur, concernant les changements de projets professionnels : la pizzeria qui devait engager Monsieur D. ne veut finalement pas s’engager vis-à-vis de la justice dans le contexte incertain du COVID. Ensuite, quand il parle de « formation » monsieur D., il s’est arrêté au CM2, c’est pas d’un diplôme qu’il parle, c’est d’apprendre sur le tas. Monsieur D., il va essayer de s’en sortir avec le peu d’éléments qu’on lui donne ici. Il est arrivé en septembre [2020], tenez, je vous remets trois demandes qu’il a formulées pour aller à l’école [les déposant sur les bureaux d’écoliers où sont installés les magistrats et la conseillère pénitentiaire]. Mais on lui a dit qu’il n’y avait plus d’école. Il est enfermé dans sa cellule et on sait que pendant deux semaines encore ce sera comme ça. Ils sont tous confinés. Il ne peut rien faire au sein de la détention. Beaucoup de personnes se retrouvent sans emploi, beaucoup de gens se retrouvent isolés, donc imaginez eux ! Et encore pire quand on est au [bâtiment où sont réunis les cas de COVID-19] : c’est les confinés, alors on ne veut pas d’eux en activité !
Aussitôt après la plaidoirie, la juge de l’application des peines annonce rejeter la demande, rappelant au requérant ses limites d’action : « En tant que juge, pour que je vous laisse sortir, il me faut un projet. La loi me donne le droit de vous libérer si vous fournissez une preuve ». À cette annonce, Malik D. fond en larmes. Il quitte la salle de classe tenant désormais lieu de salle d’audience et n’ayant pas accueilli un seul élève depuis maintenant plus d’un an.
Conclusion
« Déjà que de base on est confiné, donc c’est déjà très compliqué, donc confiné dans un confinement c’est encore plus compliqué. » C’est avec ces mots qu’Olivier G., détenu depuis plus d’un an lors du confinement du pays, tente de traduire comment il a vécu cette période. En croisant des récits comme le sien, recueillis dans cinq prisons françaises durant la pandémie, cet article s’est donné pour objectif de rendre compte des effets des politiques de confinement sur l’expérience carcérale. Ces récits font état d’un quotidien bouleversé : perte d’emploi, impossibilité de suivre un cursus scolaire, interruption de soins, peur du virus, etc. Le confinement a produit un surenfermement caractérisé par un isolement, une oisiveté et une dépendance accrue vis-à-vis du personnel de la prison et des proches non détenus. Il a aggravé les conditions de détention, anéanti les ultimes formes de liberté dont bénéficiaient les personnes emprisonnées et limité leurs possibilités de projection à la sortie. Privés de la possibilité de fournir des preuves de leurs efforts de « réinsertion », les détenus ont aussi été privés de la possibilité d’être libérés de prison par le bénéfice d’un aménagement de peine. Au-delà de ces effets sur la vie quotidienne, la politique de confinement a ainsi exacerbé un paradoxe majeur de l’institution carcérale, qui contraint à l’immobilité sa population tout en l’enjoignant à se montrer « active », et elle a ébranlé l’un des principes forts de l’institution judiciaire : l’individualisation de la peine.
Parties annexes
Annexe
Notes
-
[1]
Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie, Centre Max Weber, Bat. D, Étage : 1, Bureau : 15.1.1, Lara Mahi, 6 rue Basse des Rives 42000 Saint-Étienne, France.
-
[2]
Cette recherche a bénéficié d’un financement par la Direction de l’administration pénitentiaire (ministère de la Justice). Elle a reçu un avis favorable sur le plan éthique du Comité d’évaluation éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CEE Inserm) : n°IRB00003888.
Nous remercions les évaluatrices et évaluateurs anonymes pour leurs commentaires critiques, ainsi que Virginie Gautron et Bastien Quirion pour l’accompagnement de cet article, Caroline Touraut et Michel Daccache pour avoir soutenu la recherche à la Direction de l’administration pénitentiaire, et Jacques Dutrieux et Camille Martin pour leurs précieuses relectures. Le contenu de l’article n’engage que son autrice.
-
[3]
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
-
[4]
C’est également ce qu’observent Johnson, Gutridge, Parkes, Roy et Plugged (2021), à partir d’une méta-analyse des centaines de publications parues sur la santé mentale des personnes détenues dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notant que parmi les 647 articles examinés sur le sujet, la quasi-totalité relevait du « billet d’opinion » : les auteurs concluent à un état de la recherche limité et de « mauvaise qualité ».
-
[5]
L’objectif initial de notre enquête était d’étudier l’acceptabilité sociale par la population carcérale d’une campagne de dépistage massive réalisée en détention, sous la coordination d’un médecin infectiologue, dans le cadre d’une recherche clinique visant à y établir la séroprévalence du SARS-CoV-2 (Mahi, Rubio et Farcy-Callon, 2022 ; Mellon et al., 2022).
-
[6]
Nous avons réalisé tous trois ces observations, de façon simultanée, dans les cinq établissements. Notre présence s’est déclinée comme suit dans chacun d’eux : 6 journées ; 7 journées ; 10 journées ; 13 journées ; 18 journées et une nuit. Les scènes observées ont été consignées dans des carnets de terrain, puis retranscrites numériquement après chaque journée d’observation.
-
[7]
Les auxiliaires (dits « auxi ») sont des détenus employés au service général des prisons ; ils sont chargés des tâches de maintenance : distribution de repas, entretien des locaux, réparations, gestion de la bibliothèque…
-
[8]
La retranscription a été assurée par Isabelle Kerneve, que nous remercions vivement. Une fois achevé le recueil des données, nous avons analysé les retranscriptions de façon transversale et thématique, sans emploi de logiciel d’analyse qualitative. Nous avons lu le corpus de 60 entretiens – soit environ 1200 pages –, dégagé 49 thématiques abordées dans ces entretiens, plus classé leurs verbatims selon ces thématiques dans deux documents de traitement de texte (l’un réunissant les entretiens avec les professionnels, l’autre avec les détenus). Une analyse a ensuite été conduite au sein de chacune de ces thématiques afin de tirer des résultats généraux (compréhension globale du contexte, succession des événements et chronologie d’ensemble, etc.) – par triangulation des sources et des méthodes (entretiens, observations, archives, statistiques publiques) – et pour comprendre et expliquer les éventuelles variations de perception, expérience, jugement émis, etc., parmi les discours recueillis.
-
[9]
Les noms des établissements étudiés et des personnes ont fait l’objet d’une pseudonymisation conformément aux engagements pris lors de l’enquête.
-
[10]
Sans domicile fixe.
-
[11]
Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
-
[12]
Réductions de peine supplémentaires.
-
[13]
La loi pénitentiaire de 2009 impose l’exercice d’au moins l’une des « activités » suivantes aux personnes condamnées : « travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques ».
-
[14]
Le Code de procédure pénale stipule que « Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu’ils justifient : 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ; 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion » (article 729). En ce qui concerne ensuite l’attribution de réductions de peine supplémentaires (RPS), il précise : « Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public » (article 721). Pour une analyse de la valorisation de l’engagement des détenus dans ces activités, en temps ordinaire, par l’attribution de réductions et d’aménagements de peine, voir les travaux de Yasmine Bouagga (2015), Camille Lancelevée (2016, p. 180-192) et Lara Mahi (2018, p. 197-201).
-
[15]
Certificat d’aptitude professionnelle.
-
[16]
Notes d’observation, secteur des ateliers d’un établissement pénitentiaire, le 29 janvier 2021.
-
[17]
Le terme d’« activité » est souvent employé par les détenus, comme le montre cet extrait d’entretien, et il peut désigner tout à la fois le fait d’aller à l’école, au culte, recevoir des soins à l’infirmerie, travailler aux ateliers, etc. (Béraud, de Galembert et Rostaing, 2016, p. 153-154 ; Bessin et Lechien, 2000 ; Mahi, 2018, p. 241 ; Rostaing, 2009, p. 96) ; ces actions ont un point commun : elles rompent la monotonie des journées et permettent d’échapper pour un temps à l’environnement clos de la cellule.
-
[18]
Les « indigents » sont une catégorie administrative utilisée dans les établissements pénitentiaires français afin de désigner des détenus n’ayant aucune ressource financière. L’administration pénitentiaire leur verse une vingtaine d’euros par mois et, en temps ordinaire déjà, elle ne leur prélève pas d’argent pour la location du frigidaire et de la télévision de la cellule.
-
[19]
Unité de consultations et de soins ambulatoires. Il s’agit de l’ancien nom donné aux espaces de soins des prisons françaises, aujourd’hui appelés « unités de soins en milieu pénitentiaire » (USMP).
-
[20]
Pour une analyse des effets des politiques de confinement sur la santé mentale et les conduites addictives en France, voir les travaux de Marie Jauffre-Roustide et al. (2021) et Delphine Traber et al. (2020).
Références
- Akiyama, M. J., Spaulding, A. C. et Rich, J. D. (2020). Flattening the curve for incarcerated populations – Covid-19 in jails and prisons. New England Journal of Medicine, 382(22), 2075-2077.
- Béraud, C., de Galembert, C. et Rostaing, C. (2016). De la religion en prison. Rennes, France : Presses universitaires de Rennes.
- Bessin, M. et Lechien, M.-H. (2000). Soignants et malades incarcérés. Conditions, pratiques et usages des soins en prison. France, Paris : CEMS, CSE, EHESS. Repéré à http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/soignants-et-malades-incarcrs-conditions-pratiques-et-usages-de-soins-en-prison/
- Bonnéry, S. et Douat, É. (dir.) (2020). L’éducation au temps du coronavirus. Paris, France : La Dispute.
- Bouagga, Y. (2016). Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt. Rennes, France : Presses universitaires de Rennes.
- Busquet, G. (2021). Perdre ses repères : les inquiétudes d’une lycéenne de banlieue. Dans A. Lambert et J. Cayouette-Remblière (dir.), L’explosion des inégalités. Classes, genre et générations face à la crise sanitaire (p. 343-355). Paris, France : Éditions de l’Aube.
- Chantraine, G. (2004). Par-delà les murs. Expérience et trajectoire en maison d’arrêt. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Chassagne, A. (2015). Le soin enfermé. La porte comme frontière en maison d’arrêt. Espaces et sociétés, 162(3), 63-77.
- Combessie, P. (2018). Sociologie de la prison (4e éd.). Paris, France : La Découverte.
- di Giacomo, E., Clerici, M., Peschi, G. et Fazei, S. (2020). Italian prisons during the COVID-19 outbreak. American Journal of Public Health, 110(11), 1646-1647.
- Durand, C. (2014). Construire sa légitimité à énoncer le droit. Étude de doléances de prisonniers. Droit et société, 2(87), 328-348.
- Fassin, D. (2020). À l’épreuve de la pandémie. Dans D. Fassin, Punir. Une passion contemporaine (p. 149-161). France, Paris : Point.
- Fovet, T., Lancelevée, C., Eck, M., Scouflaire, T., Bécache, E., Dandelot, D., Giravalli, P., Guillard, A., Horrach, P., Lacambre, M., Lefebvre, T., Moncany, A. H., Touitou, D., David, M. et Thomas, P. (2020). Prisons confinées : quelles conséquences pour les soins psychiatriques et la santé mentale des personnes détenues en France ? Encéphale, 46(3), 60-65.
- Hewson, T., Robinson, L., Khalifa, N., Hard, J. et Shaw, J. (2021). Remote consultations in prison mental healthcare in England : impacts of COVID-19. BJPsych Open, 7(2).
- Jauffret-Roustide, M., Coulaud, P., Jesson, J., Filipe, E., Bolduc, N. et Knight, R. (2021). Les oubliés de la pandémie : Santé mentale et bien-être social des jeunes adultes. Esprit, 6, 57-65.
- Johnson, L., Gutridge, K., Parkes, J., Roy, A. et Plugged, E. (2021). Scoping review of mental health in prisons through the COVID-19 pandemic. BMJ Open, 11(5).
- Lancelevée, C. (2016). Quand la prison prend soin. Enquête sur les pratiques professionnelles de santé mentale en milieu carcéral en France et en Allemagne (thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, France). Repéré à https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01395632
- Lancelevée, C. et Fovet, T. (2020). Coronavirus : la prison en état critique. The Conversation. Repéré à https://theconversation.com/coronavirus-la-prison-en- etat-critique-134359
- Le Marcis, F. (2020). Épidémies et Covid-19 dans les prisons africaines : l’occasion d’une approche de la santé vraiment globale. Santé Publique, 32, 583-587.
- Mahi, L. (2015). De(s) patients détenus. Se soigner dans un environnement contraignant. Anthropologie & Santé, 10. https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.1607
- Mahi, L. (2018). La discipline médicale. Ethnographique des usages de normes de santé et de savoirs médicaux dans les dispositifs de la pénalité (thèse de doctorat, Université Paris Nanterre, France). Repéré à https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02370381
- Mahi, L., Rubio, V. et Farcy-Callon, L. (à paraître). Des détenus « sujets » de recherche : l’engagement dans une étude clinique sur le covid-19 en prison. L’administration pénitentiaire au défi de la crise de Covid-19. Paris, France : Ministère de la Justice.
- Marchetti, A.-M. (1997). Pauvretés en prison. Ramonville-Sainte-Agne, France : Érès.
- Mellon, G., Rouquette, A., Fac, C., Carton, B., Cordonnier, F., David, E., ... Roque-Afonso, A. M. (2022). SARS-CoV-2 seroprevalence in the adult detainees of the Paris area in 2021 : A multicenter cross-sectional study. Journal of Infection, 85(2), e40-e43.
- Nelson, B. et Kaminsky, D. B. (2020). A COVID-19 crisis in US jails and prisons. Cancer cytopathology, 128(8), 513-514.
- Poullaouec, T. (2021). La « continuité pédagogique » a-t-elle fonctionné ? Dans N. Mariot, P. Mercklé et A. Perdoncin (dir.), Personne ne bouge. Une enquête sur le confinement du printemps 2020 (p. 117-123). Grenoble, France : UGA Éditions.
- Pyrooz, D. C., Labrecque, R. M., Tostlebe, J. J. et Useem, B. (2020). Views on COVID-19 from inside prison : Perspectives of high-security prisoners. Justice Evaluation Journal, 3(2), 294-306.
- Robinson, L. K., Heyman-Kantor, R. et Angelotta, C. (2020). Strategies mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on incarcerated populations. American journal of public health, 110(8), 1135-1136.
- Rostaing, C. (1997). La relation carcérale. Identités et rapports sociaux dans les prisons de femmes. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Rostaing, C. (2006). La compréhension sociologique de l’expérience carcérale. Revue européenne des sciences sociales, 44(135), 29-43. https://doi.org/10.4000/ress.249
- Salane, F. (2008). L’enseignement à distance en milieu carcéral, droit à l’éducation ou privilège ? Le cas des « détenus-étudiants ». Distances et savoirs, 6(3), 413-436.
- Touraut, C. (2009). Entre détenu figé et proches en mouvement. « L’expérience carcérale élargie » : une épreuve de mobilité. Recherches familiales, 6, 81-88.
- Touraut, C. (2019). L’expérience carcérale élargie : une peine sociale invisible. Criminologie, 52(1), 19-36.
- Traber, D., Jauffret-Roustide, M., Roumian, J., Morgiève, M., Vellut, N., Briffault, X. et Clot, C. (2020). L’impact du confinement sur la santé mentale, l’importance des signaux faibles et des indicateurs fins. Résultats préliminaires de l’enquête Covadapt. L’information psychiatrique, 96, 632-638.

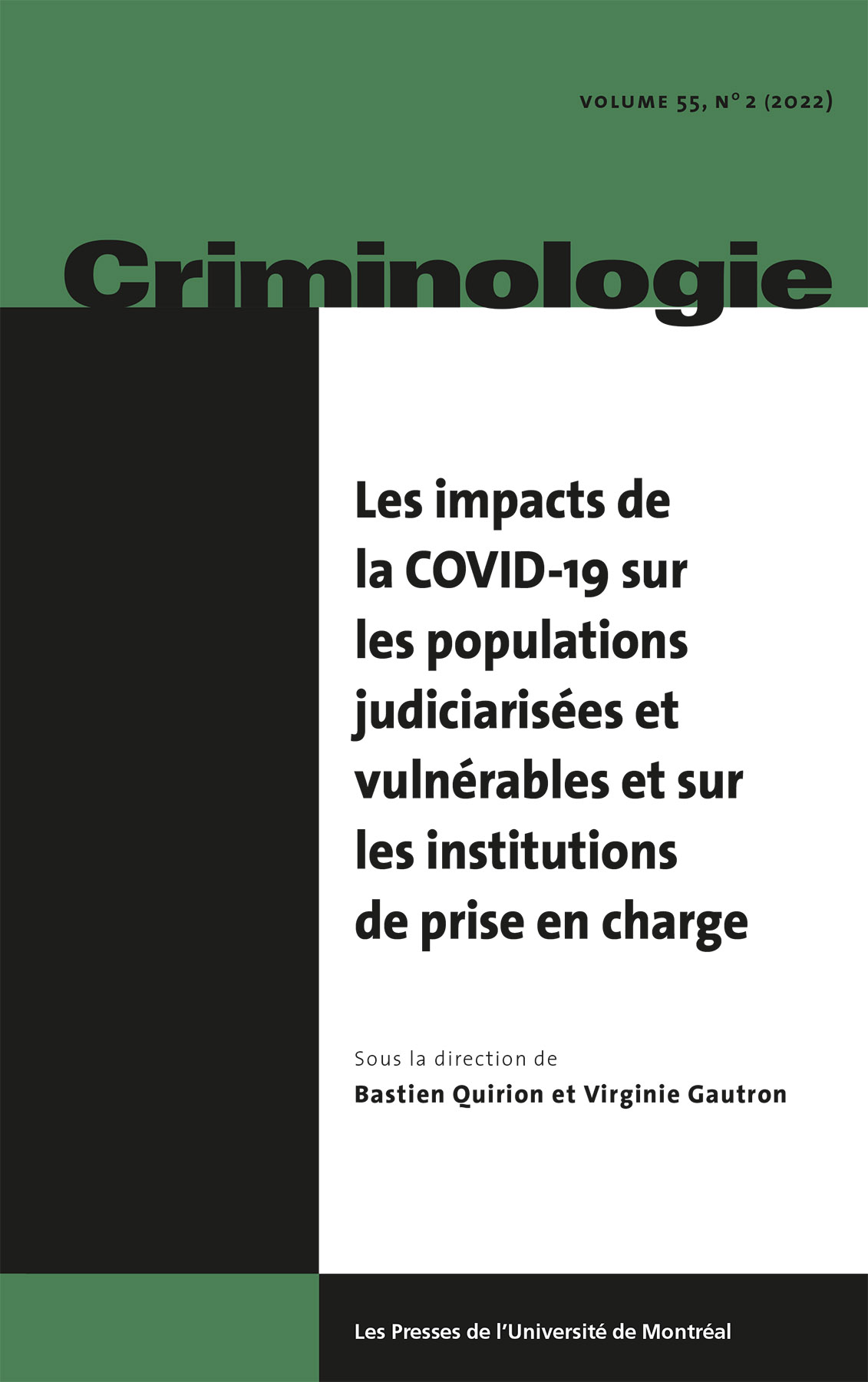

 10.7202/1059537ar
10.7202/1059537ar