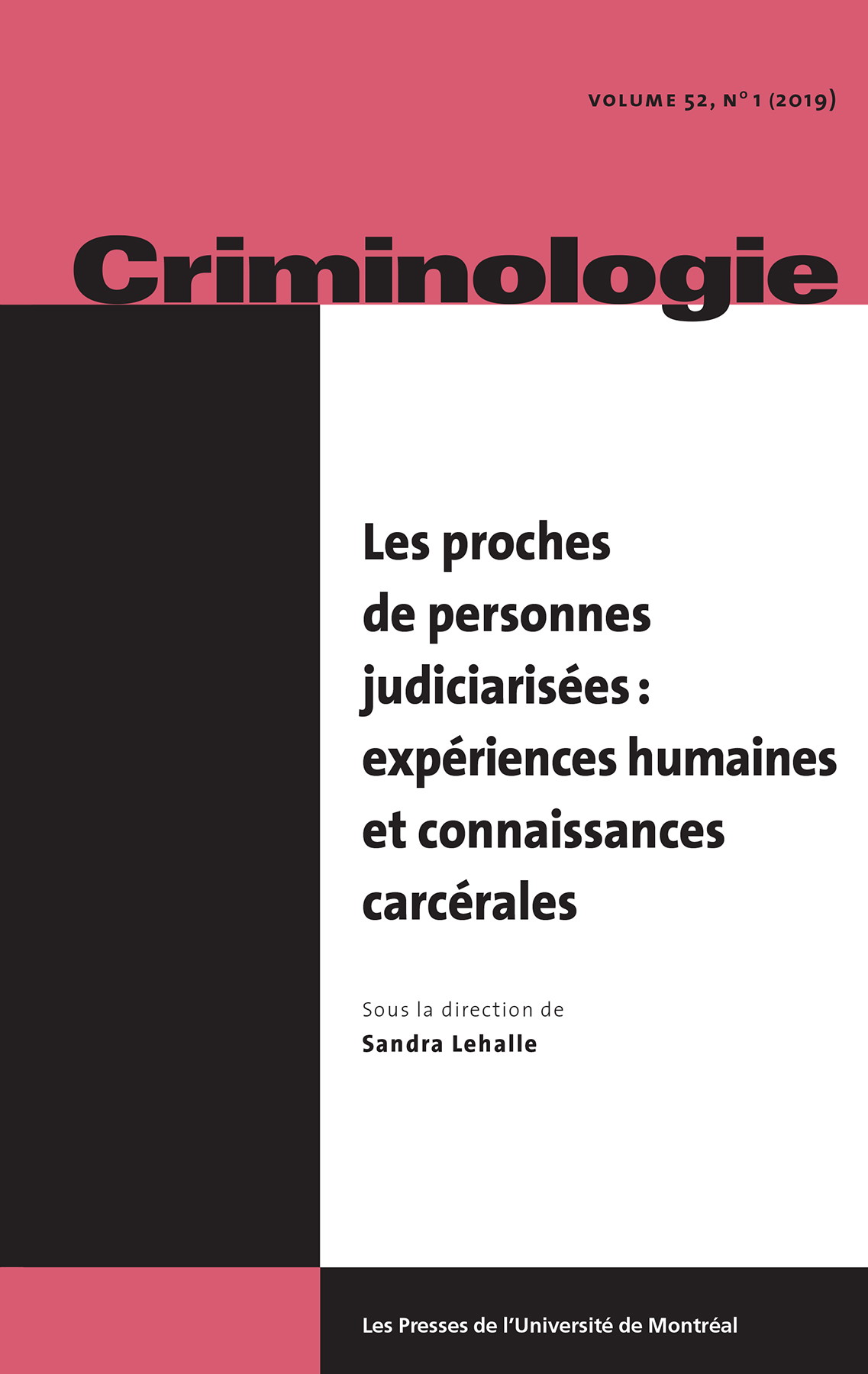Résumés
Résumé
Cet article porte sur une population croissante et peu explorée dans le paysage argentin : les proches des personnes détenues. À partir d’un travail ethnographique auquel participèrent des personnes détenues et des proches de ces dernières dans des prisons pour hommes et femmes de la province de Santa Fe, en Argentine, nous présentons les multiples aspects qui caractérisent cette population. Une première partie s’intéresse à l’insistance avec laquelle les proches se définissent comme étant « invisibles », non seulement auprès du gouvernement et de ses politiques de soutien, mais aussi auprès du service d’intervention des établissements de détention. La deuxième partie aborde la difficulté pour les proches de se réunir en associations, à cause, d’une part, de la distinction entre les familles qui collaborent avec l’ordre carcéral et les familles cachivaches et, d’autre part, de la violence en prison, qui constitue, à l’extérieur, un frein aux relations entre les proches. La troisième partie se penche sur un mécanisme de protection que doivent adopter de nombreuses femmes au moment de subir la fouille corporelle, soit le déni (Cohen, 2008). La dernière partie aborde la (nouvelle) centralité de la famille comme facteur de différenciation entre les détenus et, par conséquent, leur redéfinition pénitentiaire. Bref, nous montrons qu’il existe une relation bidirectionnelle qui fait en sorte que les proches sont à la fois partie intégrante de l’ordre carcéral et soumis à la gouvernance des logiques pénitentiaires, même en étant « hors » de la prison.
Mots-clés :
- Proches de détenus,
- effets de l’incarcération,
- relations familiales
Abstract
This article describes the characteristics of a growing – and paradoxically little explored – population in Argentina – prisoners’ families. This population has many aspects, as we discovered during ethnographic work with family members and detainees in male and female prisons in the province of Santa Fe, Argentina. We first deal with the way in which relatives define themselves as “invisible”, not only in terms of the state and its welfare policies but also in relation to prison services. The second part explores the difficulty of creating associations for families, caused in part by the distinction between families that collaborate or not with the penitentiary system, as well as by prison violence, which affects relationships outside prison. The third part describes the state of denial (Cohen, 2008) adopted by many women as a way to deal with body search. Finally, the last part illuminates the (new) centrality of the family as a category used to differentiate between inmates and, consequently, its redefinition in terms of prisons. In short, we show the existence of a bi-directional relationship that makes the family, while “outside” prison, both an integral part of the prison system and affected by the prison logics.
Keywords:
- Prisoners’ families,
- effect of imprisonment,
- family relationships
Resumen
Este texto se ocupa de una población creciente y poco explorada en el paisaje argentino : los familiares de personas detenidas. Para esto y en base a un trabajo etnográfico del que participaron familiares y personas detenidas en prisiones masculinas y femeninas de la provincia de Santa Fe, Argentina, se presentan múltiples aspectos que caracterizan a esta población. La primera parte se ocupa de la insistencia con que los familiares se definen como “invisibles” no sólo frente al Estado y sus políticas asistenciales sino también frente al cuerpo tratamental de las prisiones. La segunda parte explora la dificultad para la asociatividad en el universo de familiares, generada, en parte por la diferenciación entre familias colaboradoras con el orden carcelario y familias “cachivaches” y, en parte, por la violencia intra-carcelaria que opera, en el exterior, como bloqueador de las relaciones entre los familiares. La tercera parte describe el estado de negación (Cohen, 2008) adoptado por muchas mujeres, como mecanismo necesario para afrontar el registro corporal. Finalmente, la última parte ilumina la (nueva ?) centralidad de la familia como categoría de diferenciación entre los reclusos y, en consecuencia, su redefinición penitenciaria. En síntesis, se muestra la existencia de una relación bi-direccional que vuelve a los familiares partícipes indiscutibles del orden carcelario y, a su vez, los somete al gobierno de las lógicas carcelarias aun estando “afuera” de la prisión.
Palabras clave:
- Familiares de detenidos,
- efectos del encarcelamiento,
- relaciones familiares
Corps de l’article
Introduction
La zone périphérique des prisons est envahie chaque semaine par une foule toujours plus nombreuse de personnes qui, sans être détenues, maintiennent de forts liens avec les personnes qui se trouvent derrière les murs, ce qui montre bien à quel point l’expérience de l’emprisonnement va au-delà des limites physiques de la prison, les dépasse et colonise le quotidien d’autres personnes.
Ces personnes, principalement des femmes, sont là, chaque semaine, prêtes pour les visites. Il y a peu d’hommes, et ils restent généralement sur leurs vélos ou leurs motos, ayant accompagné une femme de leur famille. Elles apportent des sacs pleins d’aliments et de vêtements. Plusieurs d’entre elles viennent avec leurs enfants, et lorsque l’on en sait plus sur elles[3], on peut en déduire qu’elles sont pauvres. Pour ceux qui ne font pas la file chaque semaine, c’est-à-dire les chercheurs ou les auteurs de chroniques ou de rapports d’organismes gouvernementaux, ces personnes sont des « proches de détenus ». Mais la recherche ethnographique révèle à quel point cette définition qui vise à les identifier et à les décrire leur est étrangère et peu concrète. Ces femmes, qui partagent plusieurs points en commun, ne se perçoivent pas comme un groupe collectif ni ne se constituent comme tel. Elles acceptent avec réticence la notion de « proches de détenus », mais connaissent très bien par contre les différences existant entre elles.
L’emprisonnement, selon le point de vue de ces proches, se vivrait plutôt de façon bidirectionnelle. Outre le fait que les conséquences de l’emprisonnement s’étendent aux proches et que les logiques pénitentiaires peuvent coloniser les histoires familiales des détenus, la conduite des proches en général et de la « famille » en particulier a également des répercussions au sein de l’ordre carcéral – un aspect encore peu étudié.
Une littérature abondante (Bouchard, 2007 ; Braman, 2004 ; Hagan et Coleman, 2001 ; Mauer et Chesney-Lind, 2002 ; Observatoire du système pénal et des droits humains de l’Université de Barcelone [OSPDH], 2006) décrit les conséquences destructrices de l’emprisonnement d’une personne sur ses proches, comme la baisse du revenu familial, la surcharge de travail pour les femmes, la création d’une génération de familles monoparentales et la détérioration progressive des liens familiaux lorsque l’emprisonnement se prolonge.
Plusieurs recherches (Arditti et Lambert-Shute, 2003 ; Fritsch et Burkhead, 1981 ; Murray, 2005 ; Shaw, 1987) ayant abordé les perturbations subjectives que l’emprisonnement des parents pouvait avoir sur leurs enfants forment un corpus d’études sur les déficits cognitifs, les difficultés relationnelles et les conduites adaptatives de ces enfants, et les présentent comme étant à risque de développer des comportements nocifs et nuisibles pour la société. On observe une tension entre la préoccupation pour le bien-être des enfants des personnes détenues – observable aussi dans les organismes créés pour « améliorer » les conditions de visite des enfants –, les recherches sur les modes d’adaptation des enfants à l’emprisonnement de leur parent et l’identification du risque potentiel que représenterait ce groupe pour la société, compte tenu du contexte de leur socialisation. L’emprisonnement est donc envisagé, même si ce n’est qu’à des fins d’analyse, comme un espace fixe et bien défini qui contribuerait à causer des torts. Mais cette conception empêche de saisir la complexité des logiques pénitentiaires au sein des relations familiales et de comprendre à quel point l’appartenance à la famille devient un facteur de protection et donne de la valeur aux biens matériels qu’elle apporte à l’intérieur de l’espace carcéral[4]. Cette analyse statique déforme la compréhension de l’extension de l’expérience de l’emprisonnement et omet l’importance du rôle des proches dans la production de l’ordre carcéral.
Sur l’invisibilité
Même si, de l’extérieur, les personnes qui attendent pour visiter les membres de leur famille détenus semblent pouvoir être regroupées sous la définition commune de « proches de détenus », pour elles, ce qui les unit, ce n’est pas l’emprisonnement d’un membre de leur famille, mais leur condition d’invisibilité. L’invisibilité est présente dans le discours des femmes qui ont participé à cette recherche. Elles mentionnent d’une part l’invisibilité en référence à leur relation avec les politiques d’aide gouvernementale. L’État ignore la vulnérabilité et les inconvénients engendrés par le fait d’avoir un membre de la famille détenu, et malgré le taux d’emprisonnement qui ne cesse d’augmenter[5], aucune mesure n’est prise pour soulager leur situation financière (généralement déjà précaire avant la détention et aggravée par la suite). D’autre part, certaines femmes, ayant une longue socialisation carcérale[6] (Ferreccio, 2017), se plaignent de leur invisibilité vis-à-vis des intervenants en milieu carcéral et réclament qu’on les reconnaisse pour leur collaboration, afin de différencier les proches qui collaborent (relativement à la resocialisation comme objectif déclaré de l’emprisonnement en Argentine) des proches cachivaches [7](qui ne collaborent pas).
Parler aujourd’hui ici avec toi est l’une des choses que j’ai demandées à Dieu pour que l’extérieur connaisse le vécu de la personne et ça aussi (l’entrevue), je pense que ça fait partie de Dieu, pour qu’on sache qu’il y a un monde que, parfois, les personnes (du dehors) ne savent même pas qu’il existe… La souffrance que nous vivons (…), nous ne sommes pas quelque chose qui n’existe pas ! Nous sommes invisibles, mais nous existons et nous souffrons beaucoup.
Luciana[8], 33 ans, vendeuse ambulante. Avec ses filles, elle visite son mari détenu depuis sept ans
Malgré l’empreinte religieuse du témoignage de cette femme (sa participation à la recherche étant entendue être l’objet d’une volonté divine), son récit correspond à celui des autres femmes qui, au cours de l’entrevue, ont parlé d’elles, de leur situation et de celle de leurs enfants, ainsi que des conditions inhumaines dans lesquelles ont lieu les visites. Elles se sentent non visibles, inconnues, voire inexistantes, aux yeux de l’État en général et de l’administration carcérale en particulier.
Ce sentiment d’invisibilité concerne principalement le ministère du Travail qui, d’une part, n’offre pas de soutien social aux proches des personnes détenues et qui, d’autre part, ne considère pas l’employabilité des détenus à leur sortie de prison, ignorant la situation de vulnérabilité (caractérisée par des besoins économiques accrus et des possibilités d’emploi réduites) dans laquelle ils se retrouvent. Les proches mentionnent deux moments cruciaux où l’État ne les considère pas. D’abord, lors de l’incarcération même, qui entraîne une diminution soudaine du revenu familial et ses effets collatéraux, les familles ne reçoivent aucun type d’assistance. Ensuite, au moment de la sortie de prison et du retour à la maison, le détenu ne trouve pas de travail. Comme il a été soustrait du monde social, son réseau de contacts qui lui permettrait de trouver un travail, même précaire, s’est vraiment réduit. C’est l’un des principaux problèmes rapportés par les femmes, car malgré le retour à la maison de l’ex-détenu, ce sont encore elles qui continuent à être la source unique ou principale du revenu familial.
Le problème est que maintenant (après la prison), nous avons[9] comme une sorte d’étiquette qui freine la confiance des personnes qui pourraient te donner un travail (…) si tu y vas, ils te diront : « Qu’est-ce que tu as fait pendant ces huit ans ? », et « Qu’est-ce que tu vas leur répondre ? » Ou s’ils te disent : « As-tu fait quelque chose pendant ces années ? » ou « Qu’est-ce que tu sais faire ou comment peux-tu démontrer que tu as fait ce travail ? »
Angela, 32 ans, femme de ménage. Visite avec ses jeunes enfants son mari détenu depuis 8 ans et qui sera bientôt libéré
Devant ces difficultés, les femmes ayant participé à la recherche ont recours à au moins deux types de stratégies pour aider leur proche à trouver un travail au moment de leur sortie de prison et améliorer leur situation économique. Elles envoient des dizaines de lettres à des fonctionnaires pour tenter de les sensibiliser à leur situation de « femme de prisonnier et mère de famille ». Une autre stratégie consiste à se faire passer pour leur conjoint, mari ou petit ami, et à répondre à des appels d’offres organisés par la province pour des personnes en liberté, trichant ainsi avec la bureaucratie. Dans leur discours, les participantes fusionnent les stéréotypes qui existent à l’intérieur et hors des murs de la prison, et établissent entre les deux un lien fonctionnel. D’abord, elles utilisent le stéréotype du « bon pauvre » (Castel, 1997), qui fait un effort pour subsister et qui mérite une collaboration de la part de l’État. Ensuite, de manière complémentaire, mais en parlant plus de soutien matériel, ces proches s’instrumentalisent en soulignant « l’utilité » d’une famille – ou d’une femme – qui, en adoptant le discours correctionnel (discours abandonné par l’institution même), fait valoir qu’elle met tous ses efforts à « faire du détenu un travailleur ». Ce sont les familles « collaboratrices », qui essaient de se distinguer des autres, c’est-à-dire les familles cachivaches (qui sont en conflit permanent, comme les détenus qu’elles visitent). La section suivante portera sur la distinction entre ces deux types de familles et ses effets sur la difficile association des proches.
L’absence d’une dimension associative
Il existe une seule association de proches de détenus en Argentine et elle concerne uniquement les prisons fédérales[10], ce qui signifie que les très nombreux proches de détenus dans les prisons provinciales n’ont pas du tout d’ancrage associatif[11]. Mais pour quelle raison les proches sont-ils peu tentés de créer des associations de défense de leurs droits ou des associations de soutien aux familles de détenus ?
Familles collaboratrices et familles cachivaches
La recherche ethnographique a permis de relever que c’est la division entre les familles qui empêche de créer une vie associative, et ce, en termes strictement pénitentiaires. Cette distinction nette que les proches établissent – et les agents correctionnels également – entre les familles « bonnes et collaboratrices » et les familles cachivaches montre bien l’étendue des logiques carcérales. Le fait que la conduite des proches collaborateurs n’est pas valorisée par les agents correctionnels est interprété par eux-mêmes comme faisant partie des principes d’organisation des prisons qui découragent leur participation à la réhabilitation du détenu.
L’expérience de l’emprisonnement, surtout à long terme, d’un membre de la famille, qui fait en sorte que le détenu est socialisé dans le cadre de l’économie morale de la prison (Fassin, 2009), contribue à coloniser et à redéfinir le rapport de ses proches avec l’institution. En effet, le système de récompenses et de punitions ainsi que l’observation professionnelle des progrès ou des régressions dans le traitement – déclaré ou fictif – du détenu sont réappropriés et réutilisés par les proches pour soutenir et donner un sens à l’effort familial. En ce sens, le traitement indifférencié de la part de l’administration pénitentiaire envers les familles collaboratrices et cachivaches crée, d’après les familles collaboratrices, une distorsion dans le principe d’égalité, qui les prive de récompenses.
Même lorsque s’active la spirale du contrôle (Cohen, 1988), allant de l’institution carcérale jusqu’au milieu familial, l’effort des familles n’a aucun effet. C’est cette distinction entre les deux types de proches qui empêche toute possibilité d’association entre elles. Au cours de l’entrevue, Luciana explique et réclame :
la prison, pour les proches du détenu, est une humiliation (…) on t’humilie, car dans la prison ils les mettent tous ensemble : tout type de personne et tout type de famille. Il y a celle qui y va car elle souhaite réellement contenir le prisonnier et l’autre… il y a beaucoup de cas différents. Je pense que chaque personne est différente, mais la police (les pénitenciers), que fait-elle ? Elle nous traite tous de la même manière, sans faire de différence. Ils nous mettent tous dans le même panier.
Moi, l’autre fois, j’ai vu qu’ils avaient libéré un mec qui n’avait pas de famille. Il n’avait rien. On lui avait donné les sorties (transitoires). Il est sorti deux fois et il n’est plus revenu… Mais c’était évident ! Pourquoi il l’aurait fait s’il n’avait aucune raison de le faire ? C’est-à-dire qu’il n’avait aucune obligation. Il n’avait pas de proches, tu comprends ? C’est pour cette raison que je te disais que ce serait une bonne idée que quelqu’un du service pénitencier aide et évalue notre « conduite ».
De cette manière, la demande de visibilité dans une situation, dans ce cas définie comme « ce que vivent les familles des détenus », n’est pas la prétention à une visibilité générale, mais à une visibilité qui tienne compte de récompenses que seules certaines familles mériteraient, et les critères ne font rien d’autre que d’étendre la logique carcérale aux relations qui ont lieu hors du dispositif carcéral.
Il faut aider ceux qui acceptent de se faire aider et ceux qui montrent qu’ils souhaitent changer, car il y en a plusieurs qui se sentent quand même bien là, car ils sont nourris et logés.
Carolina, 27 ans, employée temporaire d’un supermarché. Avec sa mère et sa fille, elle visite depuis 14 ans son frère détenu
Cette raison, en plus de la perception extérieure de la violence en prison, est fréquemment signalée par les proches de détenus pour expliquer le fait que ce soit difficile de se lier entre eux.
La violence comme agent régulateur
Ce qui vient d’être mentionné n’est pas le seul motif évoqué par les proches pour expliquer leurs difficultés à se lier entre eux. L’autre facteur, la violence en prison, a été relevé à l’unanimité par les femmes pour expliquer l’impossibilité de se lier aux autres proches. En effet, elles ont chaque fois réagi avec un sourire amer ou un rire ironique à l’idée d’établir des liens d’amitié, par hasard, ou en dehors des ranchos[12] de leurs proches détenus (qu’il s’agisse des enfants, des maris ou des frères).
Luciana : Ce système t’autolimite. Il y a un système de respect. Tu ne peux pas parler avec n’importe qui. Tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses qui te freinent (…).
Angela : (…) ta question me fait rire… c’est toute une affaire ! Car un jour tu es bien et le lendemain si tu as discuté avec celui-là, tu ne peux plus parler avec sa femme.
Ces récits mettent en évidence à quel point la prison va au-delà des limites physiques et acquiert, hors de celle-ci, un potentiel de régulation des contacts avec les personnes qui ne sont pas détenues. Les règles de sociabilité extracarcérale, à la différence des normes intracarcérales typiques d’un régime despotique (Chauvenet, 2006), où elles sont faibles et mouvantes, se présentent à l’opposé de manière plus inflexible de ce que l’on pourrait imaginer. Les descriptions faites par les femmes interviewées sur leurs possibilités de contact à l’extérieur – pas seulement lorsqu’elles sont dans la file d’attente à l’entrée de la prison, mais aussi dans leurs quartiers –, laissent entrevoir une sorte de réactivation du « code du reclus », postulé par les ethnographies classiques (Sykes, 1958), comme mécanisme de réponse aux privations ou malheurs de l’emprisonnement. Ce mécanisme est ici transposé dans les rues de la ville, hors de l’espace circonscrit de la prison, comme un code des reclus et de leurs proches, qui vise à réduire les possibilités de conflit au sein de la prison, c’est-à-dire à garantir un minimum d’intégrité physique pour le détenu.
La violence carcérale, même si elle semble être circonscrite entre les murs de la prison, déplace donc ses effets au-delà de ceux-ci. Ce sont les disputes internes qui définissent pour les proches la seule option de maintenir ou de rompre tout lien. Mais, comme il est difficile d’être au courant de tout ce qui se passe au quotidien dans la prison, la mesure de protection par excellence est d’éviter par anticipation tout contact risqué ou hors des ranchos.
Par conséquent, non seulement la violence, mais aussi cette mini-communauté relationnelle (Ferreccio, 2019) qu’est le rancho, étendent les frontières au-delà de la prison, incluant les proches des détenus qui en font partie. Le devoir de protection en son sein est réciproque, mais il ne se limite donc pas aux codétenus : il inclut aussi les proches. Comme par un effet de miroir de la vie en détention, les seules possibilités interrelationnelles hors de la détention se situent entre les membres de ce « rancho étendu », formé par les familles des membres du rancho.
Le déni
La fouille corporelle des visiteurs est appliquée par l’administration pénitentiaire en Argentine. Les femmes ayant participé à cette recherche n’ont pas d’emblée mentionné la fouille, mais lorsque la question leur a été posée directement, leurs réponses se sont accompagnées de pleurs inconsolables. Comment affronter chaque semaine une pratique qualifiée de manière unanime comme étant « humiliante, dégradante et terrible » ?
Delia a 60 ans et visite depuis quatre ans son fils détenu. Il a 29 ans, souffre de problèmes psychiatriques et d’un léger handicap mental. Delia est analphabète, épileptique et reçoit une pension d’invalidité de l’État. Elle arrondit ses fins de mois en surveillant des voitures dans la rue.
Delia : Vous ne savez pas ce que c’est, la fouille, mademoiselle. Vous n’en avez aucune idée !
Vanina : Et en quoi ça consiste ?
Delia (en baissant la voix) : Ils ouvrent tout, ils te font t’accroupir, complètement ! Et ils le font à chaque visite, eh, à chacune des visites. Elles (les employées) te font enlever tous tes vêtements, t’accroupir comme ça, comme si tu étais un animal, à quatre pattes, et ensuite ils t’ouvrent derrière (à ce moment, sa voix devient inaudible, honteuse).
Vanina : Et vous n’avez pas porté plainte ?
Delia : Non.
Vanina : L’avez-vous raconté à quelqu’un pour dénoncer cette situation ?
Delia : Non, ma chère, à qui est-ce que je raconterais ça ?
Des descriptions comme celle-là ont été courantes au cours des entrevues. Les sentiments des femmes oscillaient invariablement entre la honte, provoquée par la suspicion représentée par le corps ainsi investigué, et l’impuissance, dérivée de l’inaction postérieure à l’acte.
La thèse de Cohen (2008) sur le triangle composé par les acteurs de la violence (les coupables), ceux qui la subissent (les victimes) et ceux qui observent la situation (les témoins) dans des cas de violence méthodique et systématique sur des groupes spécifiques de personnes – dans ce cas, les proches de détenus – constitue une approche interprétative valide et productive dans la mesure où l’on considère la prison comme un dispositif guerrier défensif dont le principe d’organisation est la peur (Chauvenet, 2006). La thèse de Cohen (2008) permet d’expliquer comment une pratique systématique de torture est apparemment neutralisée à l’intérieur d’une institution par les acteurs qui la vivent, la subissent, l’observent ou l’accomplissent chaque semaine. De fait, au sens large, la catégorie des observateurs (témoins) est formée non seulement du personnel qui observe le déroulement de la fouille, mais aussi des détenus et détenues qui connaissent son déroulement et ne dénoncent que sporadiquement les excès au lieu de remettre en question la pratique en soi. Suivant Cohen (2008), les positions du « triangle » ne sont pas fixes, mais plutôt interchangeables, de sorte que l’observateur peut, dans une autre situation, devenir une victime et il est même possible que la victime et le coupable partagent la même culture du déni. Ce mécanisme est fréquent dans les récits sur les fouilles des femmes et des enfants, la mère, en tant que parent, devant être obligatoirement présente lors de la fouille d’un mineur. La mère joue donc le rôle de témoin et d’observatrice de la violence envers sa fille ou son fils et l’incite à l’accepter sans contester. Mais comment ces mères peuvent-elles tolérer et « s’unir » aux employées qui font les fouilles pour inciter leurs adolescents ou adolescentes à ne pas refuser de subir cette pratique invasive ? La crainte de représailles pour le détenu, facilement attribuable à la protestation de ses proches, est très forte et contribue à renforcer le déni d’origine.
Le déni, tel qu’il est théorisé par Cohen (2008), n’est pas une action instantanée, il se construit : « tant les témoins que les coupables sont graduellement poussés à accepter comme étant normales les actions qui originairement se percevaient comme répugnantes : ils nient la signification de ce qu’ils voient, évitant ou minimisant les informations sur la souffrance des victimes » (p. 40, notre traduction). Par ailleurs, même lorsque la situation n’est pas niée et que la douleur est reconnue, cela ne donnera pas nécessairement lieu à une intervention, ce qui peut engendrer ambivalence et malaise chez les femmes. Néanmoins, l’interprétation de cette chaîne déni–reconnaissance–non-intervention nous force à lier la proposition de Cohen (2008) à la conception de la prison comme un espace régulé par la peur (sous forme de silence qui évite, à l’avance, les représailles pour les détenus).
Pour leur part, les rapports des organismes de contrôle, les chroniques journalistiques et les recherches universitaires, qui pourraient mener à des interventions visant l’élimination de cette pratique, sont tombés dans le piège du carcélaro-centrisme (Salle, 2003), qui est axé sur la violence vécue par les détenus ou le personnel correctionnel, et n’ont pas su englober les « alentours » de la prison ni aborder les espaces liminaires (Bosio, 2017 ; Moran, 2013) qui ne sont ni dans la prison, ni dans l’espace public, comme les salles de fouille. En effet, pour les organismes de contrôle, la violence carcérale est exclusivement intramuros, ignorant celle qui se déroule autour.
La (nouvelle ?) centralité de la famille
La recherche ethnographique à la base de cet article est de type multisitué, c’est-à-dire qu’elle s’est développée à des points divers de l’espace carcéral diffus (Ferreccio, 2018). Malgré l’accent mis sur les proches des détenus, d’autres sujets ont été interviewés, notamment des personnes détenues dans des prisons pour hommes et pour femmes. La décision au départ d’introduire ces récits se fondait sur la possibilité de « reconstruire » les histoires des familles de part et d’autre du mur de la prison. Toutefois, au fil de l’avancement de la recherche, les entrevues avec les détenus ont permis de relever des aspects préalablement méconnus sur la centralité acquise par les familles (biologique ou celle construite par les visiteurs) au sein des relations carcérales. En effet, la participation des proches est devenue centrale pour comprendre la construction de l’ordre carcéral. Leur participation est doublement représentée : par les objets qu’ils apportent aux détenus et par le temps qu’ils consacrent à ces derniers.
Les études carcéralo-centrées (Salle, 2003) tentent d’expliquer les problèmes de l’emprisonnement en observant ce qui arrive à l’intérieur de la prison dans les dynamiques instaurées entre ses acteurs. Cependant, l’espace carcéral est diffus et ne se restreint pas à ses limites physiques. C’est pourquoi les actions qui se déroulent au-delà de ses limites, même lorsqu’elles sont réalisées par des personnes qui apparemment n’y appartiennent pas, peuvent être utiles pour comprendre des dynamiques qui, autrement, demeureraient obscures en raison de la force des canaux communicants (Foucault, 1975).
En ce sens, les entrevues avec les personnes détenues ont permis de dégager l’importance de la famille en tant que catégorie structurante et structurée (Bourdieu, 1994), qui donne aux détenus différentes possibilités d’actions qui auront des impacts, mineurs ou majeurs, sur les conflits en prison.
D’abord, sur le plan des objets matériels, ce qu’apportent les proches permet aux détenus d’entrer dans des groupes de protection, les ranchos. L’appartenance à ces groupes est sujette à la possibilité d’apporter des biens, dont la possession est appréciée à l’intérieur de la population recluse. Même s’il y a d’autres moyens de faire partie de ces groupes, le capital représenté par les biens que les proches apportent chaque semaine est la principale façon. Leo, qui a 30 ans, est détenu depuis neuf ans. Il a été transféré de prison à de nombreuses reprises, mais maintenant que l’administration pénitentiaire a cessé de le transférer, il a pu renouer avec sa famille ces dernières années.
Ici [en prison], il y a beaucoup d’intérêt pour les choses, car certains reçoivent des visites et d’autres pas, et cela crée de la jalousie… nous le ressentons comme de la jalousie, nous. Car celui qui a des visites va avoir des choses et celui qui n’a pas de visites n’a rien.
Il est manifeste que l’importance acquise par ces biens à l’intérieur de la prison, en particulier l’accès aux ranchos, met de la pression, exercée sous différentes formes, sur les proches afin qu’ils fournissent les biens nécessaires à l’accès à ces groupes. La tension surgit entre les familles et les détenus[13] quant à la quantité ou à la vitesse à laquelle les biens apportés sont consommés. Les proches sont surpris quand le détenu leur apprend qu’il ne reste plus rien peu de jours après leur visite. Ils ne savent pas que ces biens ne vont pas seulement aux ranchos, mais qu’ils servent de monnaie d’échange avec les autres détenus et le personnel carcéral pour l’obtention de positions (Castro et Silva, 2008) ou de permissions qui requièrent un « paiement », ou simplement pour s’assurer d’un bon traitement de la part des gardiens. Même si les proches qui ont une longue expérience de la socialisation carcérale disent connaître la pratique de l’échange de biens à des finalités diverses, ils méconnaissent leur traduction symbolique en termes de protection.
« Celui qui n’a pas de visite n’a rien », répété par les détenus, acquiert alors un nouveau sens. Soumis à l’arbitraire carcéral, le détenu ne sera pas en mesure d’obtenir des améliorations à ses conditions de détention ou des biens recherchés ni d’assurer son intégrité physique. C’est la figure du paria dans les prisons argentines : un détenu qui, par manque de contacts avec l’extérieur, est dans l’impossibilité de faire partie d’un groupe qui lui offrirait une protection et, par conséquent, la possibilité d’avoir une existence.
Enfin, et même si ce n’est pas explicite, les contacts extracarcéraux sont porteurs d’une aura de non-contamination (voir Chantraine, 2004, p. 230), ce qui donne une certaine valeur dans les relations carcérales. Le fait pour le détenu de montrer qu’il a des liens familiaux continus et qui subsistent au fil du temps le met en position de supériorité au même titre que la capacité à faire circuler la violence (Bourgeois, Montero Castillo, Hart et Karandinos, 2013) à l’intérieur du marché des biens en prison. La famille est donc importante dans l’image projetée aux autres, et contribue à la représentation d’une « personne fiable ». En ce sens, il est fréquent d’entendre les travailleurs sociaux de la prison faire référence à une famille qui accompagne le détenu, s’occupe de ses besoins et le visite régulièrement, comme étant un indicateur de socialisation et de « réinsertion » acceptable.
Par ailleurs, et en relation avec les autres détenus, l’évocation de la famille peut constituer une ressource efficace pour se créer une sphère d’autonomie à l’intérieur d’un espace qui impose la coexistence forcée (ou qui fait de la promiscuité une norme). Certains gestes d’autonomie « tolérés » ne peuvent se réaliser qu’en recourant à la famille, comme gérer les « comportements », produire durant toute la journée des objets pouvant être vendus par la famille pour augmenter ses revenus, maintenir un poste de travail peu envié par le reste de la population recluse sans pour autant être méprisé, limiter la part de ce qui est partagé avec le rancho et même le fait de ne pas participer à certains actes de violence collectifs, comme lorsqu’il est décidé de « faire sortir » quelqu’un du pavillon ou d’intimider d’autres détenus.
La redéfinition carcérale de la famille
La famille, en tant que catégorie normative qui ordonne le monde social « dehors » et qui, bien que le produit d’un processus de socialisation, nous est présentée comme étant une donnée quasi naturelle de division sociale (Bourdieu, 1994), acquiert une valeur symbolique beaucoup plus grande en prison de sorte que les détenus « sans famille » sont perçus, selon la recherche citée par Bourdieu (1994), de la même façon que les femmes seules : êtres sociaux incomplets, inachevés et presque mutilés ou « peu fiables » selon la perspective carcérale.
L’autre facette de cette centralité est le modèle de famille diffusé dans les prisons, ou celui qui a été « appris » à montrer par les détenus et leurs proches à l’institution carcérale et celui qui est pris en compte par les agents au moment d’évaluer les possibilités de libération anticipée ou de sorties temporaires.
Cette famille type n’existe pas uniquement pour être montrée aux agents carcéraux. Ses normes morales et ses principes d’organisation sont assumés par plusieurs des femmes participant à cette recherche. Une partie de leur visite est consacrée à la « rééducation » de leurs proches détenus à ces nouvelles valeurs qui correspondent au modèle de famille dominant. On obtient ainsi une redéfinition carcérale de la famille : une famille qui sera produite par le système pénal, où les membres ne vont pas tenter de recréer la famille qu’ils formaient avant l’intervention pénale (et qui avait été sanctionnée de différentes façons), et dans le cadre de laquelle les figures familiales et les dynamiques intrafamiliales seront adaptées à une sorte de modèle généralement accepté et socialement validé comme étant correct et utile aux yeux des instances correctionnelles.
Ce modèle représente un virage vers la retraditionalisation de la famille fondée sur : a) la crise d’identité avec laquelle les familles affrontent le processus pénal et l’emprisonnement ; b) le sentiment de culpabilité que la détention crée chez certains proches, spécialement chez les mères ; et c) la concordance avec les représentations que le système pénal in totum, de manière curieusement homogène, offre aux proches relativement aux types de familles idéales pour collaborer à la réadaptation du sujet déviant.
Conclusion
L’emprisonnement contemporain, à la différence de l’emprisonnement exploré dans les ethnographies classiques (Clemmer, 1940 ; Irwin et Cressey, 2014 ; Sykes, 1958), présente des limites diffuses. Ces limites diffuses, jumelées à la multiplicité des canaux de communication entre la prison et l’extérieur, entraînent un prolongement marqué de ses effets, et implique un nombre plus important de personnes que juste les personnes incarcérées.
L’institution carcérale a vu ses caractéristiques changer : son caractère total (tel qu’il est théorisé par Goffman [1961]) est remis en question et les récits des proches de détenus, marqués et redéfinis par l’expérience de l’emprisonnement, remettent aussi en question le caractère fermé de la prison. Il existe en effet des « points de fuite » de plus en plus forts qui permettent de faire communiquer l’intérieur et l’extérieur, et dans certains cas, se confondent même. Toutefois, d’autres aspects traditionnels de l’emprisonnement demeurent inamovibles. En premier lieu, il y a la séparation forcée du noyau familial avec qui la personne habitait, obligeant ceux qui « restent dehors » à une mobilité forcée (Touraut, 2014). En deuxième lieu, l’insuffisance constante des ressources en prison et la dégradation des conditions de vie génèrent une forte dépendance financière envers des proches. En outre, la fouille des visiteurs, comme mesure de sécurité pour éviter l’entrée de substances prohibées, continue à s’appliquer de manière systématique et fait partie du rituel historique de l’accès aux prisons[14] en Argentine.
La recherche effectuée à Santa Fe a permis de considérer « l’invisibilité », omniprésente dans le discours des proches, comme une condition descriptive composée de divers niveaux. L’invisibilité devant l’État naît d’une position où la culpabilité de la famille et même son caractère dysfonctionnel s’effacent pour affirmer le droit au soutien social en situation d’impuissance. La « solitude » des proches, constamment mentionnée, a comme interlocuteur l’État – absent –, qui ignore la (perte de) valeur ajoutée de l’emprisonnement sur les proches, qui sont déjà appauvris.
Quant à l’invisibilité sur le plan associatif, son analyse est inséparable des conflits internes en prison dont la porosité des murs carcéraux détermine les possibilités de contact des proches entre eux. Les femmes des détenus sont dans l’impossibilité d’établir des liens amicaux au-delà des ranchos de leurs maris, de leurs fils ou de leurs frères détenus, car les liens des hommes en prison sont considérés comme habilitants (ou non) et ont priorité sur les liens que leurs femmes peuvent établir à l’extérieur. Le potentiel d’extension des logiques carcérales est évident à cet égard. À cela s’ajoute la traditionalisation des liens comme produit de l’action des proches qui adoptent la perspective carcérale, reproduisant à l’intérieur du groupe de proches la distinction constitutive de l’emprisonnement entre les détenus qui sont de bons collaborateurs et les mauvais, qui font obstacle. Cette distinction, loin d’être circonscrite à la prison, étend sa portée et divise « les eaux » entre les uns et les autres proches qui réclameront, en conséquence, un traitement différencié suivant la notion de récompense et punition préconisée par l’institution carcérale.
Ainsi, comme nous avons tenté de le montrer dans cet article, malgré leur invisibilité sur divers plans, les proches participent directement et immédiatement à la construction de l’ordre carcéral. Cette participation suppose, comme il est énoncé en deuxième partie, une classification et une différenciation importante entre les proches qui collaborent et ceux qui, « aussi cachivaches que les détenus qu’ils visitent », sont un frein à la réhabilitation de la personne détenue. Comme nous l’avons vu, de la part des femmes qui visitent, au moins deux types d’action sont nécessaires : d’une part, le déni, qui tend à faiblir l’aspect dégradant de la fouille et, d’autre part, l’acceptation de la violence intracarcérale comme étant régulatrice des contacts entre les femmes. Et cette participation se caractérise, comme nous l’avons vu en partie, par la centralité accordée par les divers acteurs au modèle traditionnel de la famille[15], faisant en sorte de transformer le travail d’ajustement en un devoir de la famille durant la visite.
La recherche ethnographique a donc pu montrer non seulement la nécessité d’inclure les proches comme participants à la création d’une prison tranquille, mais aussi le potentiel d’extension des logiques carcérales qui, véhiculées par les proches, redéfinissent en termes carcéraux leurs propres relations et dynamiques familiales.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral – IHUCSO –, Cándido Pujato 2751, Ala Este, CP 3000, Santa Fe, Argentine.
-
[2]
Je remercie vivement Gaston Bosio pour sa lecture riche et attentive de cet article, la responsabilité finale de cet article me revenant entièrement.
-
[3]
Ce travail se fonde sur une ethnographie approfondie, réalisée à Santa Fe, de 2012 à 2014, qui a étudié des personnes détenues (unité 4 des femmes et unité 2 des hommes) ainsi que leurs proches, dans le but de reconstruire, en les croisant, les expériences de l’emprisonnement de l’un et l’autre groupe et d’en analyser l’impact sur les proches à partir de la perspective des détenus. Dans la plupart des cas, il a été possible de tracer le fil de l’histoire de part et d’autre du mur de la prison. Dans certains cas, lorsque les familles sont brisées, cela n’a pas été possible. Au total, 52 entretiens en profondeur ont été réalisés. Les entretiens avec les détenus ont été menés en prison et ont été limités à une heure en raison de la réglementation en vigueur. Pour les proches, il n’y a pas eu de limite de temps et la plupart des entretiens ont été réalisés à leur domicile, ce qui a permis d’obtenir des récits de groupe de plusieurs membres des familles, des photos et même des lettres. Certains entretiens ont été menés sur les lieux de travail des femmes et d’autres directement dans les files d’entrée aux prisons.
-
[4]
Pour en savoir plus sur la façon dont les détenus évoquent leur famille pour se soustraire de conflits ou rester neutres, voir Ferreccio, 2017.
-
[5]
Les statistiques officielles sur la population carcérale (Système national de statistiques sur l’exécution des peines, 2016) montrent une augmentation constante et soutenue de 2007 à aujourd’hui, passant de 52 457 personnes détenues à 76 281 en 2016 ; une augmentation de la population incarcérée de 45 % en 10 ans.
-
[6]
Nous nommons ainsi le processus traversé par les femmes – et les proches des détenus en général – qui intériorisent le fonctionnement de l’espace carcéral et se l’approprient.
-
[7]
C’est un terme du milieu carcéral pour désigner les détenus qui n’emploient pas de manière « utile » le temps en prison et qui sont une source fréquente de conflits.
-
[8]
Tous les noms ont été modifiés afin de protéger la confidentialité des participants à la recherche.
-
[9]
Les femmes utilisent régulièrement la première personne du pluriel pour parler de leur situation relative à l’emprisonnement, illustrant ainsi la réelle difficulté à dissocier les expériences de l’emprisonnement, vécues de l’intérieur comme de l’extérieur.
-
[10]
Le système carcéral argentin est organisé en prisons fédérales pour les délits de juridiction fédérale (la majorité de ces délits sont liés au trafic de drogues) et en prisons provinciales pour les délits relevant du droit commun (justicia ordinaria) ou de juridiction provinciale. Dans les faits, il règne une confusion totale entre les deux types de détenus, car, comme les prisons fédérales n’arrivent pas à accueillir tous ses détenus, ces derniers sont transférés dans des prisons provinciales.
-
[11]
Il faut distinguer entre une associativité « forte », caractérisée par une activité juridique et un dialogue constant avec l’État et une autre associativité « faible », dont le statut précaire, conjoncturel, sans force juridique ni leadership formel, fait en sorte qu’elle ne s’active que dans des situations de crise, comme des émeutes ou des restrictions du service pénitentiaire.
-
[12]
Les « ranchos » sont des espaces de sociabilité réduits au sein de la prison qui assurent un rôle de protection. Pour en savoir plus sur le sujet, voir Ferreccio (2015, 2019).
-
[13]
Cela n’est pas le cas chez les femmes détenues. Au contraire, l’apport obtenu au moyen de leurs travaux en prison est valorisé et sollicité par leurs proches pour le maintien de leurs enfants.
-
[14]
La technologie a mis à la disposition des pénitenciers des détecteurs de métaux électroniques, fixes et manuels, qui réduiraient au minimum le caractère invasif de la fouille. Cependant, en raison de motifs qui ne peuvent pas être explorés ici, la plupart de ces instruments sont inactifs, inopérationnels ou brisés. Ils sont utilisés arbitrairement dans certains cas et pas dans d’autres. Ainsi, malgré l’investissement financier, la fouille classique est toujours pratiquée, ce qui montre sa nature disciplinante et juste résiduellement sécuritaire, comme prétendu par l’administration carcérale.
-
[15]
Ce modèle correspond à une idée de la famille, qui, d’une part, est institutionalisée dans la prison et, d’autre part, se détache des exigences bureaucratiques de l’État au moment d’articuler les politiques de soutien : les pauvres sélectionnés par le système pénal doivent ajuster leurs conduites à ce modèle s’ils souhaitent prouver leur « réhabilitation » et progresser en regard du régime d’exécution de la peine.
Références
- Arditti, J. et Lambert-Shute, J. (2003). Saturday morning at the jail. Implications of incarcerations for families and children. Family Relations, 52(3), 195-204.
- Bosio, G. (2017). Nuevas configuraciones del Estado : la religión en la gestión post-carcelaria. Actas del XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociologia. Repéré à http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/5511_gaston_bosio.pdf
- Bouchard, G. (2007). Vivre avec la prison. Des familles face à l’incarcération d’un proche. Paris, France : Éditions L’Harmattan.
- Bourdieu, P. (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris, France : Éditions du Seuil.
- Bourgeois, P., Montero Castrillo, F., Hart, L. et Karandinos G. (2013). Habitus furibundo en el gueto estadounidense. Espacio abierto, 22(2), 201-220.
- Braman, D. (2004). Doing time on the outside : Incarceration and family life in urban America. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press.
- Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires, Argentine : Paidós.
- Castro e Silva, A. M. (2008). Nos bracos da lei : O uso da violencia negociada no interior das prisoes. Rio de Janeiro, Brésil : e+ a.
- Chantraine, G. (2004). Par-delà les murs. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Chauvenet, A. (2006). Privation de liberté et violence : le despotisme ordinaire en prison. Déviance et Société, 30(3), 373-388.
- Clemmer, D. (1941). The prison community. Boston, MA : The Christopher Publishing House.
- Cohen, S. (1988). Visiones del control social. Barcelone, Espagne : PPU.
- Cohen S. (2008). Stati di negazione. La rimozione del dolore nella societá contemporanea. Rome, Italie : Carocci.
- Fassin, D. (2009). Les économies morales revisitées. Annales. Histoire, sciences sociales, 64(6), 1235-1266.
- Ferreccio, V. (2015). Familiares de detenidos. Exploraciones en torno a prácticas de equilibrio institucional en prisiones de Santa Fe, Argentina. Espacio Abierto, 24(1), 113-144. Repéré à http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/19714/19665
- Ferreccio, V. (2017). La larga sombra de la prisión. Una etnografía de los efectos extendidos del encarcelamiento. Buenos Aires, Argentine : Prometeo.
- Ferreccio, V. (2019). La prisión héterodeterminada. La importancia del afuera en la construcción del orden carcelario. Communication présentée au Coloquio en Investigaciones Sociales en Cárceles, Buenos Aires, Argentine.
- Foucault, M. (1975). Introducción. Dans B. Jackson, Leurs prisons (p. I-VIII). Paris, France : Terre Humaine Plon.
- Fritsch T. et Burkhead, J. (1981). Behavioral reaction of children to parental absence due to imprisonment. Family Relations, 30(1), 83-88.
- Goffman, E. (1961). Asylums. Le istituzioni totali : i meccanismi dell’esclusione e della violenza. Turin, Italie : Einaudi.
- Hagan, J. et Coleman J. P. (2001). Retourning captives of the American war on drugs : Issues of community and family re-entry. Crime & Delinquency, 47(3), 352-367.
- Irwin, J. et Cressey, D. (2014). Ladrones, presos y la cultura carcelaria. Delito y Sociedad, 1(37), 135-152.
- Mauer, M. et Chesney-Lind, M (2002). Invisible punishment : The collateral consequences of mass imprisonment. New York, NY : The New Press.
- Moran, D. (2013). Carceral geography and the spatialities of prison visiting : Visitation, recidivism and hyperincarceration. Environment and Planning D : Society and Space, 31(1), 174-190.
- Murray, J. (2005). The effects of imprisonment on families and children of prisoners. Dans A. Liebling et S. Maruna (dir.), The effects of imprisonment (p. 442-462). Devon, Royaume-Uni : Willian Publishing.
- Observatoire du système pénal et des droits humains de l’Université de Barcelone. (2006). La cárcel en el entorno familiar. Barcelone, Espagne : Université de Barcelone.
- Salle, G. (2003). Situation(s) carcéral(es) en Allemagne. Prison et politique. Déviance et Société, 27(4), 389-411.
- Shaw, R. (1987). Children of imprisoned fathers. Londres, Royaume-Uni : Hodder and Stoughton.
- Sykes, G. (1958). The society of captives. A study of a maximum security prison. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
- Système national de statistiques sur l’exécution des peines. (2016) Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena correspondiente al año 2016. Buenos Aires, Argentine : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Touraut, C. (2012). La famille à l’épreuve de la prison. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Touraut, C. (2014). Entre détenu figé et proches en mouvement. L’expérience carcérale élargie : une épreuve de mobilité. Recherches familiales, 1(6), 81-88.