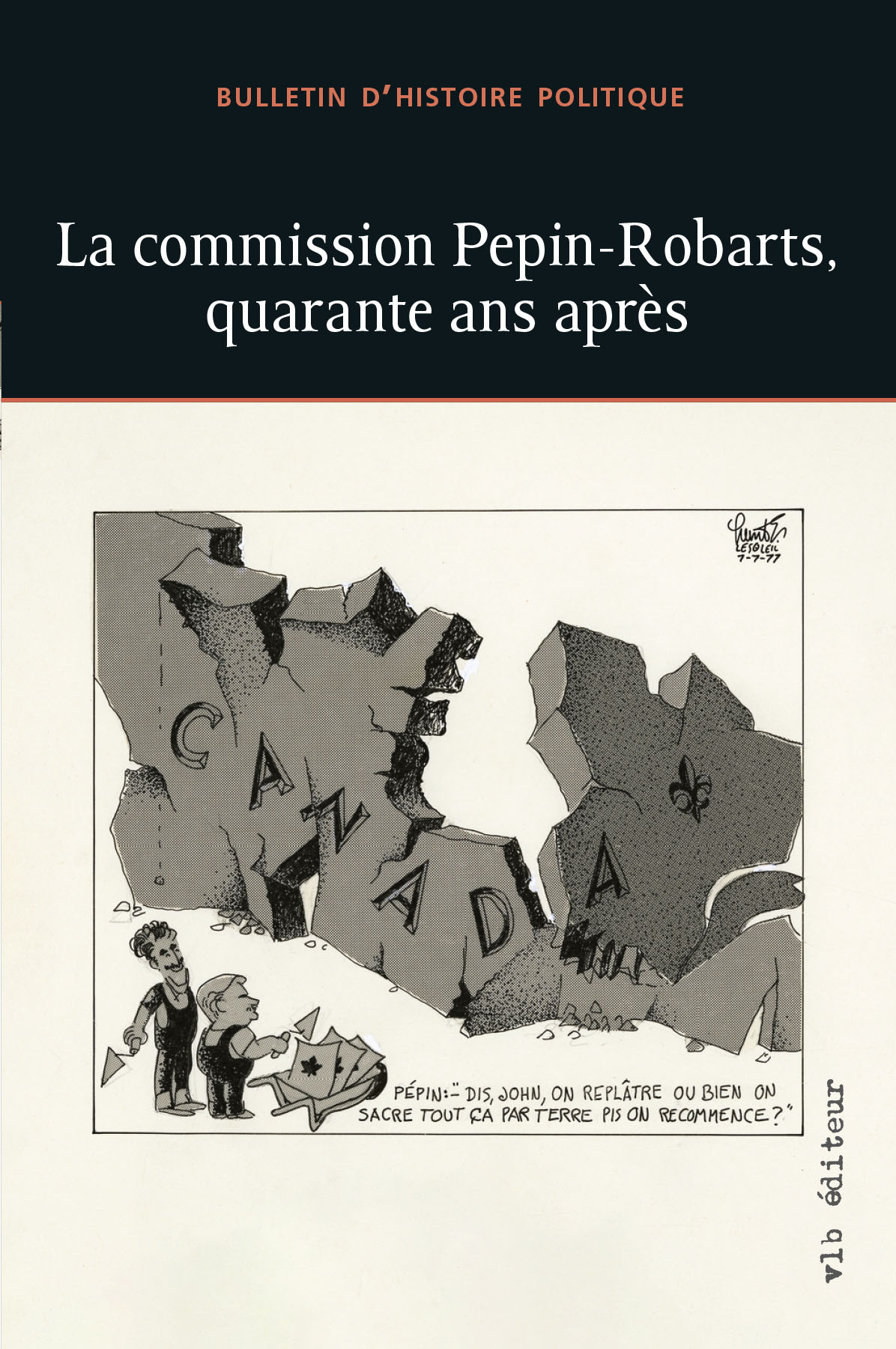Corps de l’article
Alexandre Dumas publie ici sa thèse de doctorat, soutenue en 2016 à l’université McGill sous la direction de John Zucchi, L’Église face à Duplessis : le clergé catholique face à la politique québécoise de 1930 à 1960. On peut décrire Alexandre Dumas comme un chercheur modèle, fonceur, qui aime bien prendre à rebours les idées reçues.
Après un mémoire de maîtrise soutenu en 2012 à l’UQTR sous la direction de Pierre Lanthier, L’abbé Pierre Gravel : comment concilier le syndicalisme avec le nationalisme d’extrême-droite (1924-1949), publié sous le titre L’abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste (Septentrion, 2014), personnage important du présent ouvrage, il élargit son sujet pour aborder les relations entre l’Église catholique et l’État, entendons les gouvernements successifs du Québec, Taschereau, Duplessis et Godbout.
Tout au long de ses études doctorales, il publie maints articles (j’en ai relevé sept, entre 2014 et 2016), dont deux dans cette revue, qui touchent des points centraux du livre : la question de l’ « influence indue » lors des élections québécoises de 1935 (2014) et celle du droit de vote des femmes, de 1922 à 1940 (2016). Le plus récent de ces articles porte sur le fameux « Les évêques mangent dans ma main » (RHAF, 2016) et analyse les relations Église-État sous Duplessis, deuxième mouture (1944-1959). Toutes questions fort controversées, et Dumas prend plaisir à dénoncer les mythes, sources à l’appui.
Et quelles sources ! La quantité de documents dépouillés laisse pantois. D’abord, les archives de dix évêchés, notamment ceux de Québec et de Montréal, fort riches sur le sujet, puis les fonds d’une douzaine d’hommes politiques, sans compter la consultation de trente journaux et périodiques, dont on ne nous fournit malheureusement que le titre, sans indiquer ni le lieu, ni la périodicité, ni l’étendue du dépouillement. Ce n’est pas tout de lire les sources, encore faut-il les mettre en relation les unes avec les autres, ce que Dumas fait avec un sens critique remarquable.
Les dix chapitres étudient, en ordre chronologique, les régimes de Taschereau, Duplessis en 1936, Godbout et Duplessis depuis 1944. Plusieurs conclusions s’en dégagent. D’abord, la continuité entre les régimes. Oublions que les libéraux auraient été anticléricaux et l’Union nationale liée aux évêques et au clergé : c’est quasiment le contraire. Le premier ministre L.-A. Taschereau et son secrétaire Athanase David consultent régulièrement les archevêques de Québec et de Montréal avant d’adopter des mesures qui peuvent toucher le clergé ; il suffit que les évêques émettent un désir pour que les autorités y accèdent. Au contraire, Maurice Duplessis ne consulte pas l’épiscopat et, malgré ses belles paroles, n’en fait qu’à sa tête et résiste souvent aux demandes du clergé. Un exemple : à l’occasion de l’année sainte de 1950, le délégué apostolique, au nom du pape, demande au gouvernement d’amnistier les grévistes d’Asbestos traduits devant les tribunaux. Duplessis se refuse à une amnistie générale, puisque cette grève était « une révolution anarchique contre la loi, contre les tribunaux et contre l’autorité légitimement constituée ». Le délégué revient à la charge : en vain.
Évidemment, le lecteur a à l’esprit la photo qui figure en couverture du volume et qui nous montre Duplessis baisant l’anneau du cardinal Villeneuve lors du congrès eucharistique de Québec en 1938. Le cardinal apprécie le geste, « qui symbolise l’union chez nous de l’autorité civile et de l’autorité religieuse ». On a fait aussi grand cas du crucifix installé à l’Assemblée législative à l’ouverture de la session 1936. À l’époque, ce crucifix a plus été perçu comme « un simple élément du décor » ; Dumas rappelle qu’en 1929, Taschereau avait fait installer des crucifix dans les palais de justice et que, lorsqu’un juge fit enlever celui du palais de justice de Montréal, il le fit remettre, en précisant que la mesure avait été appuyée par plusieurs autorités, dont le cardinal Rouleau.
Dumas analyse avec beaucoup d’attention l’attitude de l’Église catholique (entendez ici les évêques, le clergé et les communautés religieuses, car, oui, plusieurs religieuses écrivent aux leaders politiques…) envers les différents partis et hommes politiques. Ce qui ressort le plus, c’est la diversité des opinions. Aux élections de 1935, les plus contestées, les abbés Lavergne et Gravel, de Québec, dénoncent avec vigueur le régime libéral ; le cardinal Villeneuve est loin de goûter ces prises de position. La plus grande partie du clergé semble gagnée à l’Action libérale nationale (ALN), surtout du fait qu’elle appuie le Programme de restauration sociale lancé par l’Église. Un homme comme l’abbé Lionel Groulx n’a jamais apprécié Maurice Duplessis. Les archevêques Villeneuve et Gauthier sont insatisfaits de sa politique sociale ; il appert aussi que, contrairement à ce que plusieurs ont écrit, Villeneuve n’est pas à l’origine de la loi du cadenas de 1937, une autre des rumeurs que Dumas prend plaisir à démentir.
Comme celle d’ailleurs de la menace de démission du premier ministre Godbout au sujet du droit de vote des femmes en 1940. On ne retrouve trace de cette menace que dans les mémoires de Thérèse Casgrain, en 1971 ; la correspondance de Villeneuve montre bien qu’il n’a voulu en rien embarrasser le gouvernement. Il interdit même à l’abbé Gravel de lancer une campagne contre le suffrage : « Les Évêques n’ont nullement l’intention de mettre la Province sens dessus dessous à propos du suffragisme féminin », lui écrit-il le 8 mars 1940. On voit par ces quelques citations à quel point le recours à ces correspondances est précieux et permet de remettre plusieurs pendules à l’heure.
Le parti qui a le plus attiré la sympathie du clergé est le Parti national, créé en 1937 et qui regroupait les dissidents de l’Union nationale, les Hamel, Grégoire, Chaloult, Drouin et Marcoux. L’ALN a aussi beaucoup de partisans : 60 prêtres ou religieux sont abonnés à son journal La Province. L’abbé Groulx appuie fortement Philippe Hamel, de même que Mgr Eugène Lapointe, de Chicoutimi. L’abbé Gravel invite les députés nationaux à partager la tribune de ses conférences. Hamel aimerait beaucoup recevoir l’appui de l’épiscopat. Le cardinal Villeneuve lui explique qu’il ne peut appuyer ouvertement son parti : « Jamais vous ne verrez [l’Église] rompre avec l’autorité établie, lui manquer de respect, lui retirer sa collaboration, sous le motif que ceux qui sont en autorité n’ont pas toute la lumière ou toute la droiture qui seraient à souhaiter. » (p. 131)
L’index, très bien fait, confirme la perception que le personnage central de ce livre est le cardinal Rodrigue Villeneuve, qui occupe le siège de Québec de 1932 à sa mort en 1947. Il est très intéressant de le suivre, en particulier sous le régime Godbout (1939-1944), alors qu’il est « la figure dominante de l’Église québécoise ». Son appui à l’effort de guerre est bien connu (on se souvient de sa photo sur un char d’assaut en 1941), mais ses collègues sont loin d’être unanimes sur la question. Si Comtois (Trois-Rivières), Forget (Saint-Jean), Labrie (Golfe Saint-Laurent) et Melançon (Chicoutimi) le suivent, d’autres, les Charbonneau, Desranleau, Ross, Courchesne ou Langlois, sont beaucoup plus modérés, voire réfractaires. La division est telle que Villeneuve ne réussira pas à faire approuver un projet de lettre collective. Le ministre fédéral de la justice, Ernest Lapointe, avertit le cardinal que trois de ses prêtres, dénoncés pour leur opposition publique à la conscription, sont menacés par la GRC du camp de concentration. Le prélat réagit : c’est alors que le fameux curé Édouard-Valmore Lavergne perd sa cure de Notre-Dame-de-Grâce, à Québec. Il est vrai qu’on avait alors bien d’autres griefs contre lui…
Le clergé n’intervient nullement dans la campagne provinciale de 1944. Dumas estime qu’au total, sur le plan des relations entre l’Église et l’État, le gouvernement Godbout « s’inscrit en continuité » avec ceux de Taschereau et de Duplessis. « Tout comme ses prédécesseurs, écrit-il, Adélard Godbout était un chef d’État catholique et était fier de se présenter comme tel. » (p. 188). Il est vrai par contre qu’en général, le clergé appuya surtout le Bloc populaire canadien, pour son nationalisme.
Les deux derniers chapitres portent sur le deuxième règne de Duplessis (1944-1959). Encore là, Dumas constate beaucoup de continuité. Comme avant, le clergé est bien divisé dans ses allégeances politiques. Si Duplessis a ses thuriféraires (Mgr Desmarais, d’Amos, bat la marche, suivi par Mgr Langlois, de Valleyfield, qui a obtenu le pont qui porte son nom, et par des clercs comme les chanoines Panneton ou Labrecque), il y a aussi des opposants connus, comme le père Georges-Henri Lévesque, ou les abbés Dion et O’Neill, et plusieurs évêques fort réservés, comme Mgr Desranleau ou Mgr Labrie.
En conclusion, l’auteur constate d’abord que de 1930 à 1960, l’influence de l’Église catholique a constamment diminué, face au gouvernement de la province. C’est sous Taschereau qu’elle était la plus forte, et sous le Duplessis de la fin des années 1950 qu’elle l’était le moins. Cela coïncide bien avec ce que l’historiographie montre depuis des années, sur l’érosion de la puissance de l’Église tout au long de cette période, malgré des apparences trompeuses. Deuxième conclusion : il n’y a jamais eu d’unanimité dans le clergé en ces matières. Ce n’est pas l’image qu’on en projette habituellement. Le conservatisme social domine la société, mais la modernité progresse, dans tous les secteurs. La force d’Alexandre Dumas est d’appuyer ses conclusions sur des pièces d’archives, interprétées avec rigueur. Un modèle à suivre.