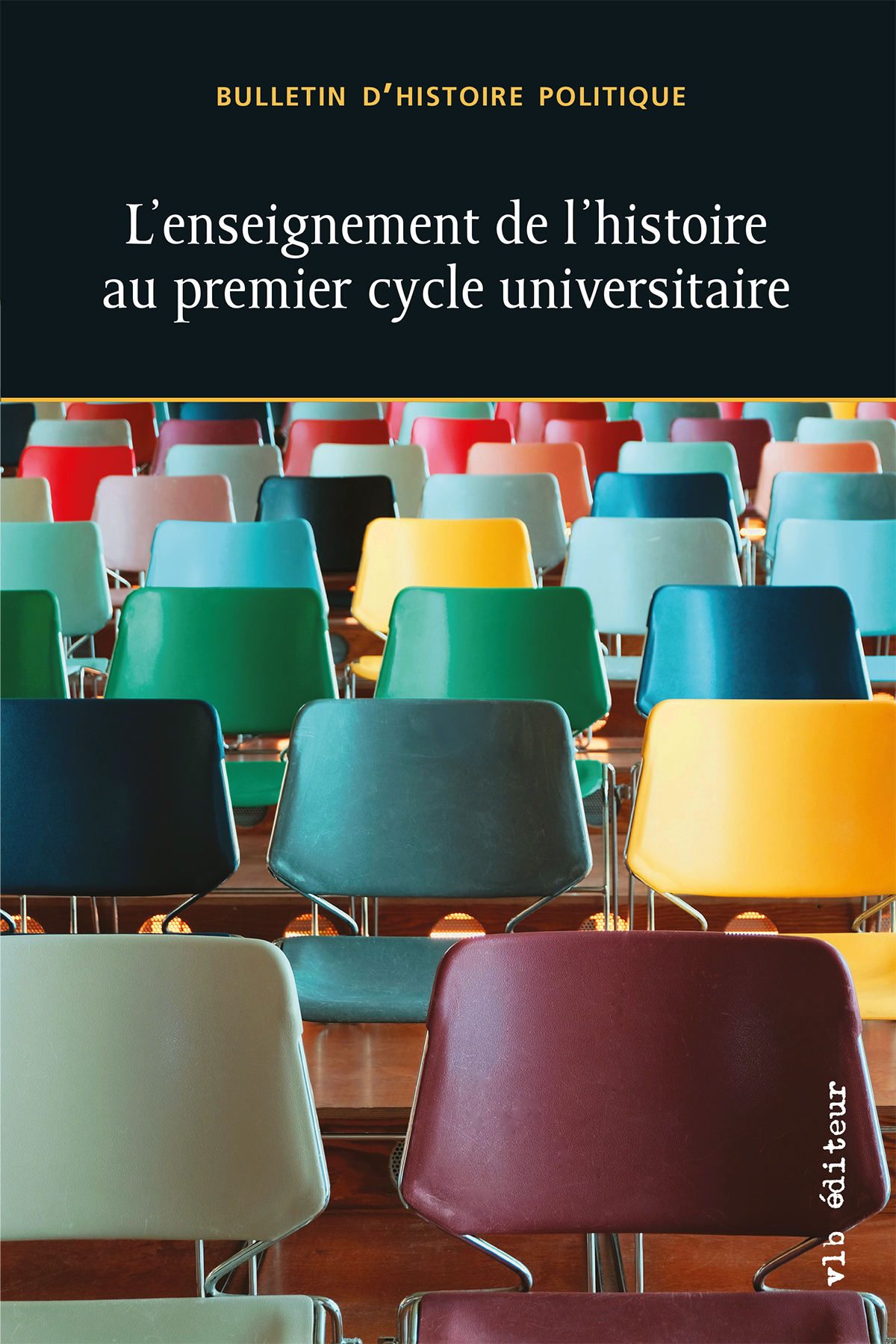Corps de l’article
Il en va d’abord de la lucidité du constat : l’enseignement de l’histoire au 1er cycle universitaire se porte mal au Québec. Comme l’étude de François Guérard nous le montre en ouverture du présent dossier, de toutes les disciplines des sciences humaines enseignées dans les universités québécoises, c’est bien l’histoire qui a connu les baisses de recrutement les plus significatives ces dernières années. Depuis 1992-1993, année record pour les nouvelles inscriptions dans les programmes de 1er cycle, 1210 étudiant.e.s entamaient un baccalauréat en histoire au Québec ; ils et elles sont 600 en 2017-2018, ce qui représente une diminution de moitié au chapitre du recrutement. À divers degrés et à différents rythmes selon les établissements, les taux d’inscriptions sont globalement en déclin de 39 % depuis 2011. Ces données trahissent une diminution effective de l’attractivité des programmes d’histoire à l’université. Elles trahissent sans doute aussi une remise en cause de leur pertinence en regard d’une culture universitaire qui, tendanciellement indexée aux lois du marché, valorise de plus en plus la formation technique et le retour immédiat sur investissement. Enfin, il y a peut-être lieu de se demander si elles ne trahissent pas certains défis internes à notre discipline. À l’heure du régime de l’opinion, de la relativisation de l’expertise scientifique, de la diversification des accès à la connaissance historique par le numérique et de la remise en cause des grands récits dominants, l’histoire universitaire n’est peut-être plus à même d’incarner, aussi aisément qu’avant, une parole d’autorité et de vérité.
Nous le savons, le problème n’est pas propre au Québec. Au cours de la dernière décennie, il y a une tendance générale à la baisse des inscriptions dans les programmes d’histoire à l’échelle nord-américaine, alors pourtant que les taux de fréquentation des universités ne cessent, eux, d’augmenter. Aux États-Unis, les reculs sont significatifs : entre 2008 et 2017, la fréquentation des « majeures » en histoire est passée de 34 642 à 24 266 étudiant.e.s. Ces reculs ont particulièrement accéléré depuis l’année universitaire 2011-2012, avec une tendance accentuée dans le Midwest[1]. Il en va de même pour le Canada anglophone, où les effectifs étudiants dans les départements d’histoire n’ont cessé de diminuer pendant la même période. Des témoignages récents de professeur.e.s des départements d’histoire des universités York, Waterloo et Trent confirmaient que leurs cohortes étudiantes au baccalauréat ont fondu de plus de la moitié dans les dix dernières années[2]. Bien que l’évolution de la fréquentation des programmes soit soumise à des fluctuations cycliques – personne n’a oublié les creux inquiétants des années 1980 et ceux de la période 1992-1997[3] –, le fléchissement actuel, que plusieurs attribuent aux effets de la crise économique de 2008, n’en représente pas moins une tendance lourde et préoccupante. D’autant que, là encore, elle semble frapper plus durement l’histoire que toutes les autres disciplines des sciences humaines et sociales[4].
Il y a matière à s’interroger. À l’intérieur de la crise généralisée des humanités qui frappe le monde universitaire depuis plusieurs décennies, l’histoire connaîtrait ainsi un sort particulièrement préoccupant. D’aucuns s’étonneront peut-être de ce constat, alors que l’engouement public pour l’histoire ne démord pas, que la concurrence des mémoires s’exacerbe dans l’espace public, que les polémiques entourant la gestion du patrimoine et de la commémoration fusent, que l’édition historique se porte plutôt bien et que le rendement professionnel des diplômé.e.s en sciences humaines et sociales au Canada est plutôt bon[5]. Constat d’autant plus surprenant que la gravité des problèmes de notre époque – ceux des changements climatiques, du défi de la gouvernance démocratique, du choc démographique, de la fragilité des ancrages historiques face à la mondialisation et de la montée des inégalités – appelle une profondeur de champ analytique à la fois spatiale et temporelle[6]. Enjeu du présent, l’histoire ne devrait-elle pas être autrement à même de répondre aux questionnements et aux grandes inquiétudes de notre temps ?
Au surplus, faut-il rappeler combien le métier d’historien.ne possède une pertinence cruciale pour la société québécoise, ne serait-ce qu’en interrogeant son rapport au temps, en fournissant une perspective temporelle aux questionnements sociaux et en situant l’expérience humaine dans son historicité ? Pendant longtemps, les historien.ne.s se sont donné un mandat implicite d’habilitation civique et de transmission de la culture, en rappelant aux contemporains les raisons fortes de leur existence collective dans l’espace et le temps. Si leur métier s’est depuis disciplinarisé, il n’en reste pas moins que, par-delà l’érudition et l’avancement des connaissances scientifiques sur le passé, qui sont essentielles, les praticien.ne.s de l’histoire nous permettent de comprendre notre monde et de lui insuffler du sens dans l’épaisseur de la durée. En cela, ils et elles participent pleinement à la vie de la collectivité : leur métier constitue un service public au sens fort du terme. Ce service public s’exprime en répondant aux demandes sociales précises, telles que l’entretien d’un patrimoine, le développement d’une culture et la définition d’une appartenance commune. Les réponses historiennes à ces demandes sociales alimentent un dialogue constructif et pluriel sur ce que nous sommes comme individus et comme collectivité. Par leurs questionnements, les praticien.ne.s de l’histoire habilitent les citoyen.ne.s, contribuant ainsi à leur participation active dans la vie civique.
Pourtant, force est de reconnaître que l’histoire universitaire a « un problème de réputation[7] ». Sans céder à la panique, nous n’avons plus le loisir de nous le cacher, par déni ou par pudeur. Nous avons surtout le devoir de rendre le travail historique conscient, à l’image de Lucien Febvre qui, sur les ruines encore fumantes de la Grande Guerre, défendait son droit de pratiquer son métier et de l’enseigner, en dépit des incessantes clameurs contre les « disciplines mortes » et autres « vanités littéraires » que ceux et celles d’aujourd’hui qualifieraient pompeusement d’ « inutiles[8] ». En effet, il n’y a là rien de très nouveau, puisque la « crise de l’histoire » apparaît comme une constante de son évolution depuis près de deux siècles[9]. Cette réflexivité inquiète sur son identité, sa légitimité, et son avenir est même, pourrait-on dire, une condition essentielle à son existence. Au reste, la place de l’histoire dans l’enseignement sera toujours un intéressant baromètre sociologique, par lequel on en vient à jauger notre rapport social au temps, ou même encore la santé de l’université contemporaine, dont la conversion au paradigme néo-libéral de l’économie du savoir n’est certainement pas indifférente au problème qui nous occupe ici. Dans le cas spécifique du Québec, sachant combien l’histoire a été mise en relation avec des grands projets émancipateurs, qu’ils soient « nationaux », « modernistes » ou « sociaux », il y a lieu de se demander si cette tendance à la désaffection de l’histoire au 1er cycle universitaire n’est pas le signe, parmi d’autres, d’une discipline aujourd’hui en mal d’horizons et de projets (voir l’article de Julien Goyette dans le présent dossier). Plus précisément, cette tendance semble témoigner du problème de l’arrimage entre une discipline, l’histoire, et un sentiment d’appartenance, la mémoire. Ces difficultés d’arrimage sont autant plus grandes que des mémoires multiples sont en concurrence dans l’espace public. À quelle (s) mémoire (s) l’histoire peut-elle contribuer en insufflant du sens au présent et en permettant la compréhension du passé ? Est-ce à dire qu’aux yeux des contemporains, la discipline historique ne serait plus en mesure de montrer le sens de notre expérience collective par-delà les fractures, les rivalités et les soupçons qui la traversent ? Est-ce là même, peut-on se demander, un rôle qui doit encore lui échoir aujourd’hui ?
Ainsi, c’est avec l’intention d’approfondir ces enjeux au regard de la situation préoccupante des inscriptions en histoire au 1er cycle universitaire québécois que nous avons préparé le présent dossier thématique. Les articles qui s’y trouvent constituent des versions rehaussées de conférences tenues dans le cadre d’une demi-journée d’étude organisée au Monastère des Augustines de Québec, le 15 novembre 2019, sous les auspices de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) et de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN)[10]. L’activité avait réuni une dizaine de conférencier.ière.s, issu.e.s à la fois des milieux universitaires et extra-universitaires[11].
Loin de prétendre faire le tour de la question, nous avions plutôt comme objectif, avec cette activité, d’ouvrir et d’entamer une discussion collective sur l’enjeu des baisses de recrutement en histoire au regard des spécificités du Québec francophone. En effet, il nous avait semblé, d’une part, que l’abondance de la littérature scientifique et médiatique sur la question avait très peu tenu compte des réalités propres aux milieux universitaires et historiens du Québec. D’autre part, l’importance prise au cours de ces dernières années par les débats concernant l’enseignement de l’histoire au secondaire et au collégial semble avoir relégué à l’arrière-plan la situation de l’enseignement de l’histoire à l’université, une thématique qui lui est pourtant directement liée. Surtout, il nous paraissait indispensable de ne pas laisser cette question, et l’esquisse d’éventuels leviers d’intervention, entre les mains d’autres instances extérieures à la société historienne elle-même. Conçue comme un service public, l’histoire se constitue par un dialogue qui engendre la réflexion. Nous sommes convaincus que, pour trouver des solutions, ce dialogue doit d’abord émaner à même des historien.ne.s, en symbiose avec les communautés étudiantes et professionnelles concernées, puis avec l’ensemble de la société québécoise.
Dans cet esprit, le présent numéro vise d’abord à offrir un premier portrait statistique de la situation des inscriptions au 1er cycle universitaire en histoire au Québec. À cet égard, la contribution de François Guérard, qui propose une analyse détaillée de l’évolution du recrutement en histoire à partir des données officielles du système de gestion des données sur l’effectif universitaire (GDEU) et du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), est indispensable à toute réflexion éclairée sur l’enjeu qui nous préoccupe. Pour sa part, Magda Fahrni rehausse la valeur de ce portrait en livrant un témoignage sur ses années passées à la direction du Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) de 2016 à 2019. Ensuite, les contributions de Julien Goyette, Louise Bienvenue et Julien Prud’homme approfondissent, chacune à leur manière, une réflexion sur les raisons profondes du désaveu de l’histoire à l’université, un phénomène dont les ressorts sont multifactoriels et relèvent de causes tant endogènes qu’exogènes à la discipline. Enfin, Karine Hébert nous montre en quoi cette désaffection a des conséquences tout particulièrement sur les universités en milieu régional, où les diagnostics et les mesures de redressement sont à envisager différemment.
* * *
Avec ce dossier thématique, nous espérons vivement que notre réflexion encore embryonnaire suscitera des réactions, de nouvelles questions et, éventuellement, des voies d’action. À ce compte, certain.e.s auteur.e.s avancent déjà quelques pistes de solutions concrètes qui nous semblent prometteuses. Nous nous proposons de les reprendre ici, en précisant qu’elles n’engagent que les deux auteurs du présent texte.
Dans un premier temps, le récent débat engagé par l’Institut d’histoire de l’Amérique française[12] sur la diversification des voies de formation en enseignement secondaire nous paraît important non seulement pour répondre à l’enjeu de la pénurie de main-d’oeuvre dans nos écoles, mais aussi pour l’avenir des programmes de 1er cycle en histoire. Cette discussion a plus particulièrement soulevé l’insuffisance des passerelles de formation complémentaires en pédagogie pour les diplômé.e.s de nos baccalauréats disciplinaires qui aspirent à poursuivre une carrière en enseignement au secondaire. Implantées surtout à la faveur des facultés d’éducation, qui maintiennent depuis les années 1990 un contrôle très serré sur l’accès au permis d’enseignement, ces passerelles sont trop contraignantes et tendent à dévaloriser les formations disciplinaires. La formation professionnalisante en pédagogie au 2e cycle mériterait d’être revue de manière à donner un accès plus aisé aux diplômé.e.s universitaires des programmes d’histoire et des autres disciplines universitaires. Il va sans dire qu’une telle réflexion, pour être menée efficacement et dans le respect des diverses expertises du monde de l’éducation, ne pourra s’accommoder des corporatismes de chapelles. L’enseignement est une profession qui se complexifie, nous en convenons volontiers, mais cette complexification ne devrait pas être un sauf-conduit pour une spécialisation technique à outrance. À l’instar de Louise Bienvenue et de Karine Hébert, nous estimons aussi que c’est de la diversité de leurs profils et de leurs formations que les équipes enseignantes sauront tirer leur force[13].
Dans un deuxième temps, la perspective d’une meilleure coordination entre les départements d’histoire, les cégeps et les milieux historiens extra-universitaires nous paraît être une autre avenue féconde. À ce titre, il faut saluer la mise en place récente de pôles régionaux de l’enseignement supérieur par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Ayant pour objectif de renforcer la concertation entre les divers cycles d’enseignement dans les régions du Québec, cette initiative a ouvert de nouvelles avenues de collaboration pour mieux arrimer les besoins et les attentes de la société aux programmes de formation, pour repenser les stratégies de recrutement, mais aussi pour faciliter la rétention des étudiant.e.s et la continuité des parcours de formation. C’est dans cette logique, par exemple, que l’équipe historienne de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a organisé une journée de rencontre avec différents acteurs soucieux de l’enseignement de l’histoire dans l’Est du Québec, et ce, afin de briser l’isolement entre ces derniers et de consolider certaines aspirations communes[14]. Dans cette même foulée, le Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke a récemment mis en place une passerelle « DEC-BAC » avec le programme d’Histoire et civilisation du Cégep de Sherbrooke, une première à l’échelle du Québec. Ce projet de passerelle a d’ailleurs récemment incité l’UQAM et l’UQAC à entreprendre des démarches pour conclure des ententes similaires entre leur baccalauréat en histoire et les cégeps environnants. D’autres initiatives pourraient être envisagées à l’instar de la création d’une « journée carrière » dans le cadre du congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. Idée portée notamment par l’historien Frédéric Lemieux de l’Assemblée nationale du Québec, cette initiative viserait à multiplier les ponts entre les étudiant.e.s de 2e et 3e cycles et les milieux de l’emploi en histoire à l’extérieur de l’université.
Dans un troisième temps, il nous paraît important de mettre en place un comité de réflexion permanent sur l’enseignement de l’histoire à l’université au Québec. Agissant à la fois comme foyer de discussions et d’échanges et comme instance de veille statistique et informationnelle, ce comité pourrait prendre en charge l’organisation d’une école d’été en enseignement de l’histoire à l’université, ou encore l’élaboration d’un rapport de recherche sur le développement des programmes universitaires en histoire dont l’ensemble des départements d’histoire au Québec pourraient se prévaloir dans le cadre de leurs réformes de programmes.
En dernière instance, nous tenons à préciser que le présent dossier a été préparé avant la crise du coronavirus, qui a d’ailleurs forcé le report de sa publication. Bien que les effets à long terme de cette crise sur le monde universitaire soient encore difficiles à prédire, il y a néanmoins fort à parier qu’elle risque d’accentuer certaines des tendances lourdes susmentionnées, donnant ainsi une résonance autrement actuelle – et urgente – aux propos rassemblés dans les pages de ce numéro. En effet, les temps sociaux et économiques difficiles que nous vivons sont susceptibles de devenir autant de motifs pour une accélération du même phénomène, en pressant encore davantage les universités de répondre aux demandes sociales et économiques et de se muter en écoles pratiques de « problem-solving ». À ce titre, la réflexion sur la discipline historique, ses finalités et ses modalités de transmission à l’université recouvre une réflexion plus large sur le sens que l’institution universitaire devra prendre dans les années à venir. Aux nécessaires savoirs pratiques et techniques qu’elle doit continuer de développer et de transmettre s’ajoute la tâche qui lui revient de s’élever au-delà des nécessités du moment, et celle de continuer d’oeuvrer à l’édification et à la permanence des cultures et des sociétés[15]. Cette nécessité est autrement cruciale à l’heure des grandes incertitudes. C’est peut-être moins d’une adaptation précipitée au changement que l’université de demain aura besoin que d’un réapprivoisement de ses finalités critique et culturelle. Ainsi, elle pourrait mieux entrevoir, avec tout le recul que cela commande, les modalités et les limites de ce changement. À ce compte, l’histoire sera toujours une précieuse boussole.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Benjamin M. Schmidt, « The History BA since the Great Recession », Perspectives on history (AHA), décembre 2018, historians.org. À l’inverse, certaines universités de la « Ivy League » ont su maintenir l’histoire dans le rang des disciplines privilégiées. C’est le cas notamment des universités Yale, Brown, Princeton et Columbia, où elle figure parmi les programmes les plus populaires, en partie grâce à la renommée du corps professoral, mais aussi grâce à l’aura de prestige dont bénéficient plus largement ces universités. À ce propos, voir Elizabeth Elliott, « Yale History’s Major Comeback », Perspectives on history (AHA), mai 2017, historians.org.
-
[2]
The Agenda with Steve Paikin, 8 janvier 2020, The Undoing of History, youtube.com.
-
[3]
Association des universités et collèges du Canada, Tendances dans le milieu universitaire, vol. 1, Effectifs, Ottawa, Association des universités et collèges du Canada, 2011, p. 9.
-
[4]
Benjamin M. Schmidt, loc. cit.
-
[5]
« Liberal arts degrees are a good investment », Universities Canada, 8 mars 2016, univcan.ca. Article cité dans Carl Bouchard, « Une alternative à l’attrition : une stratégie pour favoriser la rétention des étudiant.e.s en histoire », Bulletin de la Société historique du Canada, vol. 43, no 3, 2017, p. 14..
-
[6]
Voir notamment le History Manifesto, co-rédigé en 2017 par Jo Guildi et David Armitage, qui appelle à une revalorisation de la « longue durée ».
-
[7]
Thomas Peace, « History’s Reputation Problem », Active History, 13 janvier 2020, activehistory.ca.
-
[8]
Lucien Febvre, « L’histoire dans le monde en ruines », Revue de synthèse historique, t. 30, 1920.
-
[9]
Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Édition Berlin, 1996.
-
[10]
L’activité a été enregistrée et est disponible sur la chaîne YouTube de la CEFAN.
-
[11]
Voici la liste, dans leur ordre d’intervention : François Guérard (UQAC), Magda Fahrni (UQAM), Julien Goyette (UQAR), Julien Prud’homme (UQTR), Louise Bienvenue (U. de Sherbrooke), Pierre-Luc Brisson (UQAM), Luc Laliberté (Cégep Garneau), Benoît Grenier (U. de Sherbrooke), Karine Hébert (UQAR) et Marie-Ève Ouellet (ministère de la Culture et des Communications).
-
[12]
« Valorisons nos diplômé.e.s ! Pour un accès élargi à la profession enseignante. Pétition initiée par l’Institut d’histoire de l’Amérique française et destinée au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Jean-François Roberge », février 2020, ihaf.qc.ca.
-
[13]
Louise Bienvenue et Karine Hébert, « Les solutions actuelles pour la formation des enseignants ne suffisent pas », Le Devoir, 1er mars 2020.
-
[14]
Voir le texte de Karine Hébert dans le présent dossier.
-
[15]
Voir François-Olivier Dorais, Julien Goyette et Karine Hébert, « Après la COVID-19, l’université québécoise à l’épreuve d’elle-même », L’Action nationale, vol. 110, nos 2-5, avril-mai 2020, p. 237-257.