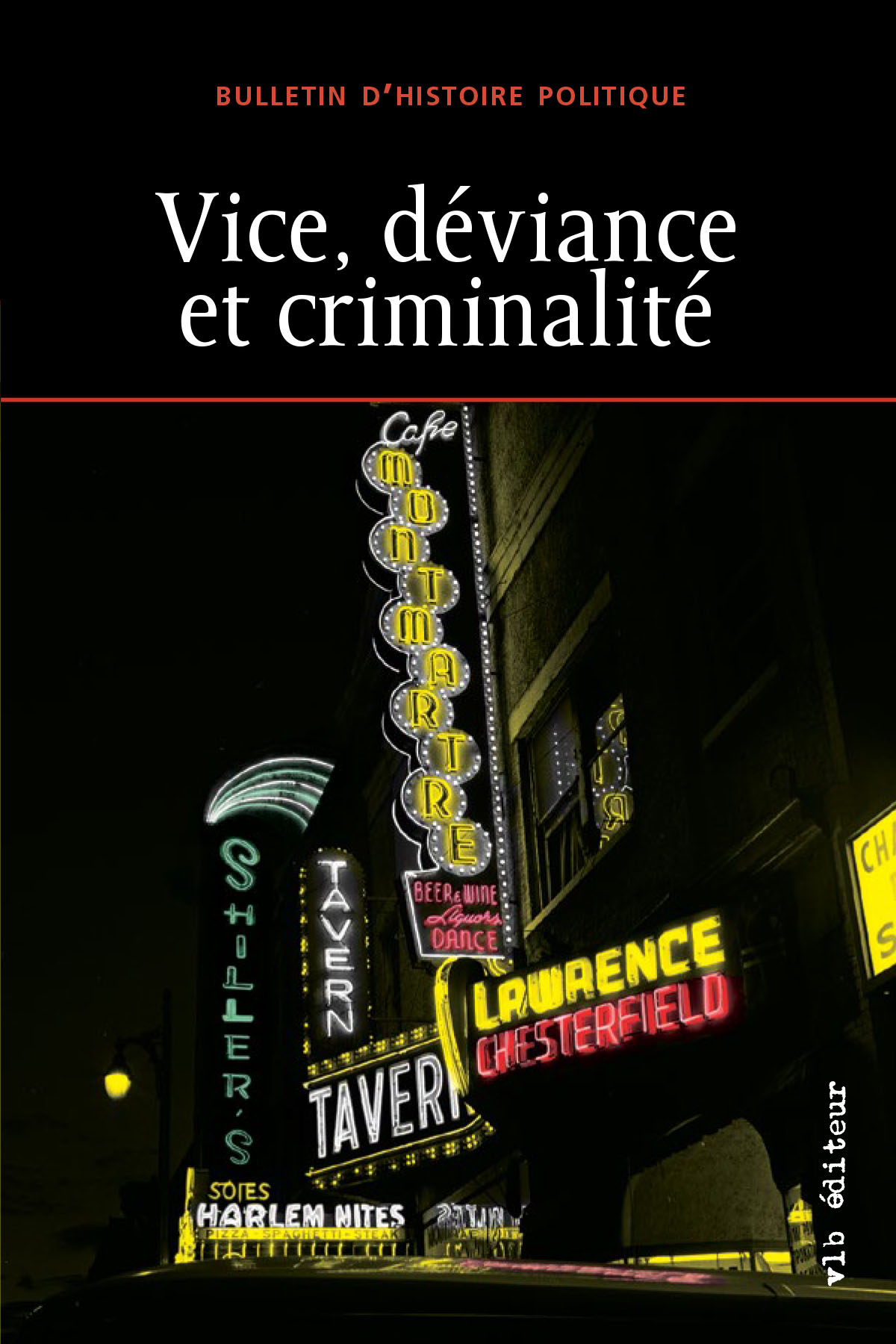Résumés
Résumé
Cet article s’intéresse aux interventions de la Chambre de commerce du district de Montréal (CCDM), la principale association d’hommes d’affaires canadiens-français du Canada, lors des commissions Massey et Tremblay afin de faire ressortir ses attentes envers l’université. Nous montrons que la classe d’affaires canadienne-française de Montréal a une conception fondamentalement nationaliste de l’institution universitaire, considérée comme une des pièces maîtresses de l’épanouissement culturel des Canadiens français. En tant qu’organisation, la CCDM rejoint ainsi une lignée de penseurs – comme Errol Bouchette et Marie Victorin – , qui théorisent la fonction nationale des institutions universitaires du Canada français.
Mots-clés :
- Université,
- commission Massey,
- commission Tremblay,
- hommes d’affaires,
- science,
- fédéralisme,
- nation,
- autonomisme
Corps de l’article
Au cours des années 1950, deux commissions d’enquête mobilisent particulièrement la communauté universitaire québécoise et les acteurs intéressés à l’enseignement supérieur : ce sont la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences (commission Massey) et la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (commission Tremblay)[2].
Mise en place en 1949 par le gouvernement fédéral, la première est chargée « d’enquêter et de formuler au gouvernement du Canada des recommandations au sujet de son rôle dans les domaines des arts, des lettres et des sciences[3] ». Si elle n’est pas mandatée pour étudier le développement des universités – car l’éducation est une compétence provinciale –, les trois domaines étudiés par les commissaires sont intrinsèquement liés au champ universitaire et les universités canadiennes font pression sur la commission et sur le gouvernement fédéral pour stabiliser leur situation financière[4]. Ainsi, dans leur rapport déposé en 1951, les commissaires recommandent que le « gouvernement fédéral apporte annuellement des contributions financières à l’oeuvre des universités » afin que celles-ci poursuivent « leur oeuvre conformément aux besoins de la nation[5] ». Acquiesçant à cette recommandation, Ottawa accorde 7,1 millions de dollars annuellement aux universités canadiennes dès 1951[6].
En réponse à la commission Massey et à ce qui est considéré comme une intrusion dans un domaine de compétence provinciale, Québec institue la commission Tremblay le 22 janvier 1953[7]. Celle-ci ne s’intéresse pas exclusivement à la question universitaire, mais l’Union nationale réclame tout de même que les commissaires fassent des recommandations sur le « pouvoir central » et les corporations scolaires – en faisant référence au financement universitaire[8]. Les universités font donc partie des nombreux sujets traités. Ces dernières remettent d’ailleurs plusieurs mémoires pour faire valoir leurs besoins financiers auprès du gouvernement québécois[9].
Ayant lieu dans l’après-guerre, une période marquée par le nation building canadien et les tendances centralisatrices du gouvernement fédéral[10], ces deux commissions sont des moments charnières pour comprendre l’histoire intellectuelle du Québec et du Canada[11]. La commission Massey participe en effet à un nationalisme canadien centralisateur, qui passe par la culture pour établir les bases d’une conscience nationale unifiée et pour s’émanciper de la Grande-Bretagne[12]. Comme le mentionne avec justesse Ryan Edwardson, cette commission « was a spectacular moment of cultural articulation and planning, a bureaucratic orchestration offering nationalists a chance to secure state backing in the task of using culture in the quest for nationhood[13] ». La commission Tremblay fait quant à elle ressortir les positions autonomistes et biculturelles des élites canadiennes-françaises, qui, comme André Laurendeau, s’opposent à l’unification de la culture nationale canadienne, considérée comme « un mythe, un fantôme, l’ombre d’une ombre », car il « n’y a pas de culture nationale canadienne. Il y en a deux : l’Anglaise et la Française[14] ».
C’est donc dans le cadre d’un débat plus large sur la culture nationale au Canada et la place du gouvernement central dans la Confédération que s’insère le débat sur le financement fédéral des universités québécoises occasionné par la commission Massey. Comme illustré par un numéro spécial de L’Action nationale publié en 1957, qui se veut « un appel aux armes[15] », plusieurs intellectuels canadiens-français participent à ce débat et s’opposent aux interventions fédérales en éducation[16]. Selon eux, comme le soutient Esdras Minville, « derrière une façade fédérative s’édifie rapidement un État unitaire[17] ».
Puisque le financement fédéral des universités du Québec est le point de discorde principal de ce débat, les commissions Massey et Tremblay constituent deux des événements les plus riches pour comprendre comment les élites canadiennes-françaises conçoivent la fonction des institutions universitaires au Québec dans la période qui précède la Révolution tranquille[18]. En effet, non seulement est-il possible de faire ressortir les positions nationalistes et autonomistes des différents intervenants, comme plusieurs chercheurs l’ont déjà fait[19], il est également possible de dépeindre ce que les différents intervenants considèrent comme la fonction sociale des universités de langue française, car c’est entre autres parce qu’ils pensent que ces institutions ont une mission nationale particulière qu’ils s’opposent aux interventions fédérales. Afin de faire ressortir cette fonction sociale, nous analyserons les interventions publiques et privées de la Chambre de commerce du district de Montréal (CCDM) lors du débat sur l’intervention fédérale dans le champ universitaire québécois.
La CCDM est une organisation intéressante pour notre analyse pour trois raisons principales : 1) elle est, à ce moment, constituée de l’élite nationaliste du Canada français, comme Esdras Minville et François Albert-Angers, et de la petite bourgeoisie francophone de la métropole. Elle représente donc une classe d’affaires et d’intellectuels qui est directement intéressée par les institutions universitaires en raison de ses apports économiques[20], sociaux et culturels[21] ; 2) elle est une des organisations les plus actives lors des commissions Massey et Tremblay – Michel Sarra-Bournet lui attribue même la paternité de la seconde[22] – et s’oppose de front aux fonds fédéraux dans le champ universitaire québécois ; 3) elle est active à la fois publiquement et en coulisse lors de ce débat et a une influence considérable sur son dénouement, puisqu’elle provoque une correspondance soutenue entre Louis St-Laurent et Maurice Duplessis, lors de laquelle les deux premiers ministres échangent pour déterminer une alternative aux investissements fédéraux.
À partir des mémoires déposés aux commissions Massey et Tremblay, de la correspondance privée de la CCDM – notamment avec les premiers ministres canadien et québécois – et de documents confidentiels jamais publiés, nous montrerons qu’en plus de s’objecter d’emblée aux tendances centralisatrices du gouvernement fédéral, la CCDM s’oppose aux fonds fédéraux dans le champ universitaire. En effet, elle considère que l’université et les enseignements qu’elle dispense sont des piliers fondamentaux de l’épanouissement culturel et de la survie nationale du Canada français. Selon elle, puisque les universités de langue française doivent avant tout servir le Canada français, l’intervention fédérale doit être combattue. La Chambre réclame plutôt que Québec, en tant que représentant national des Canadiens français, assure lui-même le financement des institutions. Cet idéal national de l’université rejoint une série de penseurs canadiens-français – de Errol Bouchette à Marie-Victorin et ses prédécesseurs – qui lient entre elles la science, les institutions universitaires, la culture et l’épanouissement national[23].
La CCDM et quelques membres influents
Pendant les années 1950, la Chambre de commerce du district de Montréal est essentiellement constituée de commerçants et de petits manufacturiers de langue française. Fondée en 1887, lorsque les Canadiens français du Montreal Board of Trade claquent la porte de cette organisation anglophone pour former leur propre organisation d’hommes d’affaires[24], elle est intrinsèquement liée au fait français. Dirigée par Gilbert La Tour de 1940 à 1966, elle est envisagée par celui-ci comme un moyen de promouvoir les hommes d’affaires canadiens-français et de participer à l’avancement économique des francophones, dont ses 3000 membres en premier lieu. Selon Gilbert La Tour, si elle existe en plus du Montreal Board of Trade, « c’est pour les Canadiens français, c’est tout[25] ! »
Cette particularité explique pourquoi, contrairement à d’autres organisations d’hommes d’affaires comme l’Association professionnelle des industriels, la CCDM n’est pas uniquement dirigée par des propriétaires d’entreprises. Ses membres les plus influents proviennent en fait de l’École des hautes études commerciales (HEC), école qui lui doit d’ailleurs sa création[26]. C’est le cas du directeur général La Tour, diplômé de HEC, mais aussi de trois des dix membres de son conseil d’orientation, soit Esdras Minville, directeur de HEC, Gérard Parizeau, professeur d’histoire économique, et François-Albert Angers, économiste et rédacteur de plusieurs documents publics pour le compte de la Chambre[27]. Parmi les autres membres du conseil d’orientation, organe qui rédige les positions officielles de la Chambre, se trouvent des ingénieurs, des comptables, des cadres et des propriétaires d’entreprises.
En plus de s’intéresser aux questions économiques, la CCDM prend part aux débats constitutionnels. C’est l’autonomisme qui structure l’ensemble de ses discours sur cette question. On y reconnaît les positions d’Angers et du constitutionnaliste Paul Gérin-Lajoie, qui défendent la souveraineté des provinces – principalement la province de Québec – dans leurs champs de compétences[28]. Gérin-Lajoie siège d’ailleurs aux « comités qui ont orienté la position de la Chambre sur la constitution et les relations fédérales-provinciales[29] ». C’est l’idéal fédératif d’Angers et Gérin-Lajoie qui est défendu par la Chambre au cours des commissions Massey et Tremblay et c’est leur conception de la fédération canadienne – pacte entre deux nations et souveraineté des provinces dans leurs champs de compétences – qui prédomine lorsque la Chambre traite des institutions universitaires pendant les années 1950.
La commission Massey et la culture nationale : la guerre aux subsides
Même s’il est indéniable que la Chambre de commerce du district de Montréal est un organisme de défense des intérêts de la classe d’affaires[30], c’est davantage en tant qu’organisation nationaliste qu’elle intervient à la commission Massey. À la manière de plusieurs autres associations nationales de l’époque, son nationalisme est traditionnel, c’est-à-dire qu’il repose sur la chrétienté, la famille et le fait français et qu’il estime que c’est pour défendre ces valeurs que Québec doit conserver ses prérogatives constitutionnelles[31].
C’est la défense de ces valeurs qui pousse la CCDM à mettre en garde les commissaires de la commission Massey contre une intervention fédérale dans le domaine de l’éducation. Ce sont également celles-ci qui sont sous-entendues lorsque la CCDM évoque la fonction nationale des institutions universitaires. Ainsi, en anticipant la recommandation d’aide financière aux universités du rapport Massey, la Chambre dépose un mémoire dans lequel elle rappelle que « la constitution réserve expressément aux provinces l’autorité législative et administrative en tout ce qui touche, d’une façon générale, la vie et les affaires privées du citoyen, d’une façon particulière, l’éducation et l’enseignement[32] ». Cette caractéristique constitutionnelle est fondamentale pour la Chambre, car le Canada est formé « de deux éléments d’origine, de culture et de croyance différentes ».
Bien que l’université ne soit pas mentionnée explicitement dans le mémoire, elle est sous-entendue dans l’entièreté du document. La CCDM sait que les éléments étudiés par les commissaires – arts, lettres et sciences – touchent nécessairement l’université et elle consulte plusieurs mémoires avant de produire le sien. Elle se procure notamment le mémoire du recteur de l’Université Laval, Mgr Ferdinand Vandry, qui, bien qu’il s’oppose aux « subsides directs du gouvernement fédéral à nos universités », propose à Ottawa de consulter les provinces et, si nécessaire, de former un comité fédéral-provincial pour distribuer les fonds[33]. La CCDM voit alors venir les recommandations du rapport sur les universités. Son mémoire est en quelque sorte une entreprise de dissuasion. Dissuasion des commissaires, mais aussi du premier ministre Louis St-Laurent : elle passe outre la commission et envoie son mémoire directement au premier ministre canadien pour lui faire part de sa conception « de la culture au Canada » et des dangers que représente l’intervention fédérale dans le champ universitaire[34].
C’est donc en pensant aux universités qu’elle met en garde contre les investissements fédéraux en matière d’éducation. Dans un exposé sociologique qui résume bien sa pensée en ce qui a trait à la Confédération, à la place des Canadiens français dans celle-ci et à la fonction des universités québécoises, elle affirme qu’en :
attribuant aux provinces la juridiction en matière privée et éducationnelle les auteurs de la constitution, mandataires des deux grands groupements ethniques, ont voulu assurer à ces groupements la faculté d’organiser selon leurs conceptions propres la vie collective dans les provinces où ils forment la majorité. Cela implique beaucoup plus que la dispensation de l’enseignement. C’est tout l’ordre social qui est en cause, par conséquent la pensée dont il procède, en définitive, la culture elle-même aux deux sens où l’expression peut être entendue. En effet : a) la culture personnelle est le fruit de l’éducation et de l’enseignement ; elle s’appuie sur la culture nationale et se développe selon son esprit : b) la culture nationale est un don du milieu ethnique repris, explicité et affiné par l’éducation[35].
À la lumière de cet exposé sur l’éducation, l’université et ses enseignements doivent voir à la diffusion et à l’enrichissement de la culture nationale du Canada français ; elle-même garante de la culture personnelle des Canadiens français. Il est donc essentiel que le gouvernement québécois conserve l’exclusivité des compétences constitutionnelles en matière d’université, car « une nation n’est assurée de son destin que si elle parvient à régir elle-même et à organiser dans son esprit les diverses fonctions de la vie collective[36] ». C’est cette conception de l’université qui structure l’ensemble des interventions de la Chambre dans le débat sur les subsides fédéraux accordés aux universités canadiennes à la suite de la commission Massey.
Indifférents à l’exposé sociologique de la CCDM, les membres de la commission Massey recommandent au gouvernement fédéral de financer directement les universités. Ottawa réagit officiellement le 30 juin 1951, lorsque les libéraux de Louis St-Laurent votent le crédit 690 « [to] provide grants to universities and equivalent institutions of higher learning in amounts not exceeding in total for each province 50 cents per head of population of that province ». Même si le premier ministre canadien se défend bien de vouloir interférer « with the responsibilities of the provincial governments[37] », ce crédit provoque une levée de boucliers au Québec et la CCDM est une des organisations qui se mobilisent le plus vigoureusement.
À la suite du dépôt du rapport Massey et du vote du crédit 690, la CCDM demande à son conseil d’orientation d’étudier explicitement le problème des subsides fédéraux. Les travaux du conseil d’orientation se concrétisent entre autres dans un mémoire envoyé au premier ministre fédéral dans lequel la Chambre affirme qu’il y a « urgence à régler le problème financier des universités », mais qu’en raison du rôle essentiel de l’enseignement universitaire pour la culture nationale, « le gouvernement du Canada ne peut pas prêter son assistance financière aux universités[38] ». Si les autres provinces peuvent très bien abandonner la plupart de leurs prérogatives puisque « la majorité de leurs ressortissants est de nationalité et d’inspiration identiques à la majorité des éléments qui constituent le parlement, le gouvernement et l’administration d’Ottawa », il en va autrement du Québec. Les universités y ont un rôle particulier à jouer étant donné la culture distincte des Canadiens français, et seul Québec, « protecteur du groupe ethnique de langue française au Canada », peut s’assurer qu’elles répondent à cette fonction[39].
La Chambre envoie aussi un mémoire au premier ministre Duplessis pour lui faire valoir sa conception de l’université et lui demander d’agir pour répondre aux besoins des institutions universitaires. Selon elle, les besoins financiers des universités sont urgents et le manque de fonds a notamment des répercussions sur les salaires des professeurs, trop faiblement payés pour « les services qu’ils rendent à la nation[40] ». Pour garantir « la sauvegarde de la culture française au Canada », Québec doit prendre ses responsabilités et financer lui-même les universités sur son territoire. En reprenant une demande datant au moins de 1947[41], la Chambre recommande à Duplessis de revoir l’assiette fiscale avec Ottawa. En vertu de l’article 32 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle soutient que le premier ministre pourrait rapatrier 5 % de l’impôt sur le revenu au provincial et utiliser le produit de cet impôt afin de régler le « problème universitaire[42] ». Montrant tout le poids de la CCDM dans ce débat, les mesures qu’elle propose reçoivent l’appui de plusieurs associations à vocation nationale : la Chambre de commerce de la province de Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, l’Union catholique des cultivateurs, l’Association générale des étudiants de l’Université de Montréal et autres[43].
Outre ce grand nombre d’appuis, ces mémoires provoquent une série d’échanges entre le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec et la CCDM. Même si St-Laurent affirme que la « contribution peut se faire par l’autorité fédérale sans plus empiéter sur la juridiction provinciale que ne le font les individus qui souscrivent volontairement aux oeuvres universitaires[44] », Duplessis se dit convaincu que le financement d’Ottawa « constitue une dangereuse usurpation de pouvoir, par le fédéral, dans un domaine fondamental, exclusivement réservé aux provinces[45] ». C’est à travers cette correspondance que Duplessis se range pour la première fois derrière la recommandation de la Chambre en matière d’impôt. Dans sa première lettre à St-Laurent, il mentionne que « la délimitation, précise et définitive, des sources de revenus de chaque administration, fédérale, provinciale, municipale et scolaire, s’impose plus que jamais » et qu’en attendant une solution définitive, Québec envisage la possibilité d’imposer lui-même 5 % de l’impôt sur le revenu et de le déduire de l’impôt fédéral en vertu de l’article 32 de la loi 11-12 George VI, chapitre 52 des Statuts du Canada[46].
En s’abstenant de répondre directement à la question de l’assiette fiscale, St-Laurent propose plutôt à son homologue de mettre en place une « procédure provisoire que vous pourriez accepter avec toutes les réserves voulues sans aucun préjudice pour l’avenir à une solution plus adéquate et plus définitive de nos relations constitutionnelles[47] ». Duplessis attrape la balle au bond. Comme le proposait Mgr Vandry dans son mémoire à la commission Massey, il suggère à St-Laurent, qui accepte[48], la création d’un comité Ottawa-Québec dont la mission « serait d’étudier et de recommander la répartition du crédit fédéral en question » en plus de contresigner les chèques destinés à chaque institution[49]. Devant les nécessités financières des universités québécoises, Duplessis parvient donc à accepter les fonds fédéraux provisoirement tout en les présentant comme le résultat d’une coopération fédérale-provinciale et en gardant un certain contrôle sur l’argent en provenance d’Ottawa.
Presque simultanément à ces échanges, le conseil d’orientation de la Chambre produit un document détaillé qui a pour objectif de trouver « une solution à ce problème que pose l’assistance financière aux universités du pays et plus spécifiquement aux universités canadiennes-françaises[50] ». Étant au courant de la correspondance entre les deux premiers ministres, le conseil se range derrière Québec et appuie l’acceptation temporaire des subsides fédéraux selon la formule proposée par Duplessis. Cela dit, la CCDM tient à rappeler au gouvernement que cette formule est une mesure d’exception qui ne peut en aucun cas faire jurisprudence.
Sa ferme opposition rappelle l’importance nationale de l’université pour l’association d’hommes d’affaires francophones. En distinguant les universités francophones des universités anglophones, la Chambre se fait claire : les deux groupes ethnolinguistiques majoritaires qui forment le Canada doivent avoir des universités qui correspondent à leurs besoins nationaux particuliers. À la manière des commissaires de la commission Massey, qui craignaient l’influence de la culture américaine sur le Canada – notamment en raison de l’omniprésence des États-Unis dans les secteurs de la radiodiffusion et de la télévision[51] –, la CCDM mentionne que l’ingérence fédérale pourrait « comporter pour elles [les universités] un danger aussi grand que l’américanisme dont parlent les commissaires [commission Massey] dans leur rapport. Il est nécessaire qu’elles demeurent entièrement autonomes si l’on désire sincèrement qu’elles remplissent leur rôle dans la nation[52] ». Pour la Chambre, alors que le Canada est à la merci de l’américanisme, le Canada français doit résister à la fois aux pressions culturelles du Canada anglais et des États-Unis. La fonction nationale de l’université requiert donc une autonomie complète face au fédéral, majoritairement constitué d’éléments anglophones.
D’autant plus que, selon elle, en finançant les universités, Ottawa pourrait voir à « l’orientation de l’enseignement » puisque « celui qui donne peut dicter les conditions[53] ». Ainsi, bien que l’intervention du fédéral prenne les apparences d’une simple mesure comptable, la CCDM craint que les subsides en viennent, à terme, « à l’uniformisation des programmes, des diplômes, des examens, etc.[54]». On aura compris qu’elle considère que cette brèche dans une institution culturelle de l’importance de l’université risquerait d’affaiblir les fondations de l’édifice national du Canada français. S’ils peuvent être acceptés selon de strictes conditions pour l’année 1951, les fonds fédéraux doivent être rejetés par la suite au profit de l’impôt provincial sur le revenu afin de préserver la fonction nationale des universités canadiennes-françaises.
L’impôt sur le revenu pour préserver le caractère national des universités
L’impôt sur le revenu devient ainsi le principal cheval de bataille de la Chambre. Au moment où Duplessis s’apprête à interdire définitivement l’accès aux fonds fédéraux en 1952[55], elle réitère son appui à l’imposition provinciale sur le revenu des particuliers à hauteur de 5 %. Plus précisément, elle demande que Québec « n’exige pas plus d’impôt sur le revenu provincial que ne représentent 5 % de l’impôt sur le revenu fédéral, de façon à ce qu’en pratique le contribuable ne paie pas un seul sou de plus[56] ». De cette manière, Québec n’aurait qu’à imposer lui-même le revenu et le déduire de l’impôt fédéral. Pour la CCDM, cette méthode est la plus propice à régler le problème du financement universitaire rapidement, car le nouvel impôt provincial serait « personnel, déterminé, défini, directement exécutable et exécutoire, sans que soit le moindrement nécessaire le concours d’Ottawa[57] ». Nul besoin d’entrer dans de périlleuses négociations constitutionnelles avec Ottawa, Québec pourrait régler lui-même le manque de fonds des universités grâce à un revenu additionnel estimé à 12 000 000 $ annuellement[58].
Le lien entre l’impôt provincial et l’université est davantage mis en lumière dans un document confidentiel qui est en quelque sorte la version préliminaire du mémoire de la CCDM remis à la commission Tremblay. Aucun autre document n’est aussi explicite sur ce qui motive les têtes dirigeantes de la Chambre dans leur lutte contre les subsides fédéraux. Selon les membres du conseil d’orientation :
les dirigeants de la nationalité canadienne-française doivent prendre une décision : continuer une politique inconsciente d’assimilation graduelle au Canada anglais ou créer les cadres politiques et économiques essentiels à la survivance et à l’épanouissement de tout peuple qui ne veut pas disparaître. Il faut rejeter toute illusion. L’assimilation graduelle a commencé dès la première génération après la Conquête. Depuis la révolution industrielle, le processus d’assimilation s’est accéléré. Tout annonce qu’il ira en s’accélérant[59].
Si l’impôt sur le revenu n’est pas mis en place pour régler les problèmes financiers des institutions, c’est le rôle central de l’université dans la survie de la nation qui est en jeu. L’institution est bien plus qu’un simple lieu d’apprentissage scientifique, c’est un des piliers du Canada français. Il est alors indispensable que « l’enseignement universitaire canadien-français [soit] mis au service du Canada français » et qu’il veille à la « formation méthodique des spécialistes dont le Canada français a besoin[60] ». Pour parvenir à une telle politique en matière d’université, Québec et les dirigeants du Canada français doivent nécessairement tenir tête à Ottawa, sans quoi ils devront renoncer « à parler survivance, avenir, autonomie[61] ».
C’est d’ailleurs ce que fait le gouvernement québécois en 1954. Au moment même où circule le document confidentiel de la Chambre, au mois de janvier, le ministre des Finances, Onésime Gagnon, présente à l’Assemblée législative du Québec le projet de loi 43 « assurant à la province les revenus nécessités par ses développements[62] ». Avec ce projet de loi, le gouvernement entend imposer lui-même 5 % de l’impôt sur le revenu. Duplessis adopte essentiellement la formule mise de l’avant par la CCDM. Il soutient que la constitution permet « aux contribuables de la province de Québec de déduire leur cotisation à l’impôt fédéral sur le revenu s’ils paient déjà cette quote-part au fisc provincial[63] » et que, par conséquent, Québec va de l’avant avec l’imposition directe du revenu.
Même si Duplessis fait le lien avec les universités en présentant le projet de loi, la survie de la nation nécessite de meilleures garanties en ce qui a trait au financement universitaire selon la Chambre. Elle envoie donc un document directement au premier ministre et réclame que le nouvel impôt élimine pour de bon les octrois fédéraux aux universités et que « son produit soit versé intégralement à un ou des fonds spéciaux destinés à pourvoir, selon des normes définies et proclamées, aux besoins de l’enseignement universitaire et secondaire, d’une part, de l’enseignement en général, d’autre part, aux réalisations des nécessités sociales, enfin[64] ». Il est impossible de prouver que cette intervention auprès du premier ministre est ce qui le convainc d’intégrer explicitement l’éducation – donc implicitement l’université – à la loi, mais les demandes de la CCDM semblent bel et bien avoir été écoutées, car le projet de loi est modifié en faveur des aspirations de la Chambre. Selon l’article 168 de la Loi créant un impôt provincial sur le revenu, « l’objet de la présente loi est de pourvoir aux dépenses nécessitées par les besoins et les développements de la province dans les domaines de l’éducation, de la santé publique et de la législation sociale, et tous les revenus qui en découlent seront employés à ces fins[65] ».
Ces garanties expliquent peut-être pourquoi la CCDM calme ses ardeurs dans le dossier des fonds fédéraux. Même si elle revient sur ce sujet sporadiquement tout au long des années 1950, le mémoire qu’elle remet à la commission Tremblay en septembre 1955, quelque temps après l’adoption de la loi de l’impôt provincial sur le revenu, marque la fin de son insistant lobbyisme en matière d’université et de culture nationale. Ce mémoire est d’ailleurs moins radical que le document préliminaire qui circulait dans les hautes instances de la CCDM quelques mois auparavant : lorsqu’il est question d’université, l’assimilation n’est pas explicitement mentionnée et l’urgence d’agir en matière « [d’] enseignement universitaire canadien-français mis au service du Canada français[66] » est passée sous silence.
Cela dit, l’esprit reste le même. En ce qui a trait aux universités, la Chambre reprend essentiellement ce qu’elle avance depuis six ans déjà : « aux provinces seules reviennent […] les responsabilités de l’État en matière d’éducation et de culture. À elles de doter la population des institutions d’enseignement, d’éducation et de culture qu’exigent leur propre prospérité et celle du pays tout entier[67] ». L’impôt sur le revenu reste donc la solution la plus efficace pour assurer le financement universitaire et, par le fait même, l’épanouissement de la nation. Signe que la Chambre est plutôt satisfaite du dénouement, elle note que ses pressions ont été entendues par Québec et Ottawa, et souligne l’importante correspondance des deux premiers ministres sur les fonds fédéraux, la procédure provisoire d’acceptation pour l’année 1951 et le rejet complet du financement d’Ottawa par Duplessis en 1952[68].
La nation et les institutions scientifiques au Canada français
Dans l’ensemble du débat sur les fonds fédéraux, c’est la fonction nationale de l’université qui est mise de l’avant par la CCDM. Selon elle, une nation forte passe par des institutions universitaires au service du Canada français. Ottawa n’étant pas le représentant des Canadiens français, les prérogatives de Québec en matière d’éducation universitaire devraient être préservées à tout prix, ou presque. Cette conception de l’université n’est pas exceptionnelle dans le Québec pré-Révolution tranquille. Tel que mentionné plus haut, l’idéal universitaire de la Chambre reçoit l’appui de plusieurs organisations à vocation nationale et correspond essentiellement à la position du gouvernement Duplessis à ce moment. Cet idéal est le même au Canada anglais, qui accorde lui aussi à ses universités un rôle national[69], comme l’a bien montré le rapport de la commission Massey.
De plus, déjà en 1906, Errol Bouchette avait relié les universités, la science et la nation. Dans son essai sur L’Indépendance économique du Canada français, il réclamait que les institutions universitaires s’intéressent aux sciences et aux enseignements industriels dans l’optique de faire progresser la situation socio-économique des Canadiens français. C’est pour cette raison qu’il considérait que « nos universités sont le siège tout indiqué des chaires de science applicable aux recherches industrielles. Les faire régner plus grandes dans une patrie agrandie, comme dirait Thiers, telle devrait être notre ambition, comme c’est notre devoir[70] ». Bouchette était en effet persuadé que « l’immobilité […] est pour une race l’indice précurseur d’une décadence certaine[71] » et considérait l’université comme une force progressiste par laquelle le Canada français devait se mettre en mouvement et s’approprier les connaissances et les ressources – comme les forêts – permettant d’assurer sa « survivance[72] ».
Si Bouchette n’était pas un universitaire, son idéal national trouvait aussi ses défenseurs au sein même des institutions supérieures d’éducation[73]. Dans son article sur le débat entre les économistes de HEC, adeptes de l’économie appliquée, et deux économistes de l’Université de Montréal, adeptes de l’économie théorique, Jonathan Fournier souligne la présence d’une économie nationaliste à HEC tout au long des années 1950-1960. Pour les économistes comme Esdras Minville, François-Albert Angers et Gérard Parizeau, tous membres du comité d’orientation de la CCDM et à l’emploi de HEC, l’essentiel était de « mettre leur savoir au service de la nation[74] ». Une littérature abondante traite de cette question, notamment en ce qui a trait au nationalisme économique de Esdras Minville[75]. Celle-ci fait ressortir le lien étroit que tissent les économistes entre leur savoir universitaire et l’avenir de la collectivité. En citant Minville, Angers soutenait dans un texte publié en 1996 que l’important pour l’ancien directeur de HEC était de voir au développement de « la province de Québec, foyer principal de la nationalité canadienne-française[76] ». Par son savoir sur l’économie, Minville espérait en effet participer au redressement économique des Canadiens français et favoriser leur « épanouissement » national[77].
Angers, quant à lui, a souvent pris la parole en son nom pour défendre la fonction nationale des universités et leurs savoirs scientifiques. Dans un texte de L’Action nationale publié en 1951, il reproche au père Georges-Henri Lévesque, figure importante de l’institutionnalisation des sciences sociales à l’Université Laval[78] et commissaire de la commission Massey, de mettre l’université à la merci de la majorité anglophone du Canada étant donné son appui – et sa participation – aux recommandations de la commission Massey :
Apercevrons-nous à temps derrière l’écran de cette commission soi-disant « humanisante » et sous la dialectique subtile de ce dominicain par trop séduisant, la nuée des corbeaux antifrançais et anticatholiques, tout prêts à s’introduire dans notre plus puissant château fort et à s’y jeter à la curée de ce que nous avons de plus précieux ? Sommes-nous, en effet, tellement désireux de mettre notre enseignement universitaire à la portée des nombreux Chisholm du monde universitaire ou gouvernemental anglo-canadien[79] ?
L’université est alors bien plus qu’un lieu d’apprentissage scientifique pour ces universitaires : c’est une institution qui, par la science et ses enseignements, assure l’épanouissement de la nation canadienne-française en Amérique.
Outre Bouchette, Minville et les économistes nationalistes, le frère et professeur Marie-Victorin aussi faisait le lien entre « science, culture et nation[80] ». La pensée du frère est certainement une des plus élaborées sur cette question. Membre fondateur de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS)[81], Marie-Victorin était perçu « comme l’incarnation du mouvement scientifique » francophone au cours de l’entre-deux-guerres[82]. Selon lui, c’était par la culture scientifique que les Canadiens français pourraient réellement s’accomplir en tant que nation. Il revenait fréquemment sur cette question dans des « textes de combats » publiés dans les pages du journal Le Devoir entre 1917 et 1944. Pour le frère, « nous ne serons une véritable nation […] qu’à l’heure où nous serons maîtres par la connaissance d’abord, par la possession physique ensuite de ressources de notre sol, de sa faune et de sa flore[83] ». Or, de véritables connaissances scientifiques nécessitent des universités adaptées à l’enseignement scientifique et à la recherche. C’est cette conception humboldtienne de l’université – recherche et enseignement[84] – qui animait le frère. Au cours des années 1920, il mena par exemple une offensive réussie pour intégrer des programmes de recherche (M. Sc. et Ph. D.) à l’Université de Montréal[85].
À la manière de Marie-Victorin, la CCDM a donc une pensée nationaliste. Cela dit, elle ne parle que de culture et de nation lors des commissions Massey et Tremblay : le rôle de l’université dans le développement scientifique et dans l’essor économique n’est en effet jamais traité de front. Cette particularité s’explique tout simplement par le contexte de production des documents étudiés jusqu’ici. De fait, la CCDM mentionne les fonctions scientifiques et économiques de l’université à plusieurs reprises dans des contextes différents des commissions Massey et Tremblay pendant les années 1950.
C’est par exemple le cas lorsqu’elle se positionne en faveur du programme de Bourses d’étude du Commonwealth à la fin de l’année 1959. Selon elle, ce programme de bourses, qui permet aux étudiants universitaires d’étudier dans un autre pays du Commonwealth, est essentiel, car « le développement économique demande, non seulement des capitaux et des techniciens, mais aussi une éducation, au sens le plus large du mot, qui assure l’ampleur nécessaire au développement économique et social[86] ». Si elle ne mentionne pas l’apport économique des universités lors du débat sur les subsides fédéraux, c’est parce qu’elle considère que c’est le caractère binational du Canada, la fonction culturelle des universités et le partage des pouvoirs prévu par la Constitution qui justifient sa résistance à Ottawa, et non le strict développement économique du Québec.
Conclusion
Pendant les années 1950, deux commissions d’enquête se sont intéressées au développement des universités et ont eu des répercussions profondes sur celles-ci. La première enjoint au gouvernement fédéral d’intervenir dans le financement des universités canadiennes, y compris celles du Québec, alors que la seconde rejette cette intervention d’Ottawa et réaffirme la légitimité de l’impôt provincial sur le revenu pour voir au financement universitaire. Ces deux commissions mobilisent la Chambre de commerce du district de Montréal, qui profite de l’occasion pour faire valoir sa conception de l’université. Dans l’ensemble des documents que l’association d’hommes d’affaires canadiens-français produit en lien avec ces commissions d’enquête – qu’ils soient publics, privés ou confidentiels – le rôle moteur de l’université dans la survie et l’épanouissement national du Canada français est affirmé avec vigueur. Cette fonction nationale conjuguée à des positions autonomistes justifie son opposition catégorique aux subsides fédéraux. Pour la CCDM, Ottawa ne peut intervenir directement dans les universités de la province, car le gouvernement fédéral représente les intérêts nationaux et économiques des Canadiens anglais du pays. Seul Québec, foyer de la nation canadienne-française, est en mesure de comprendre les aspirations du Canada français et d’assurer que les universités de la province conservent l’autonomie essentielle à leur fonction de pilier national.
Aux yeux de la CCDM, l’université est alors intrinsèquement liée à la nation. Cette association entre nation et institutions universitaires ne lui est d’ailleurs pas propre. Depuis plusieurs décennies déjà, des intellectuels considéraient que les sciences, donc les universités par association, devaient participer à l’épanouissement national du Canada français. Déjà en 1930, Marie-Victorin soutenait que « nos problèmes économiques et les problèmes économiques en général sont avant tout des problèmes scientifiques[87] ».
Si plusieurs travaux historiques, dont ceux de Robert Gagnon sur les ingénieurs francophones, d’Yves Gingras sur l’ACFAS, et de Claude Corbo sur L’idée d’université[88], ont déjà montré que les scientifiques et quelques figures nationalistes théorisaient l’idéal national de l’université depuis la deuxième moitié du XIXe siècle et exerçaient des pressions sur Québec pour favoriser le développement des universités québécoises, notre étude montre que les hommes d’affaires canadiens-français de Montréal, réunis au sein de la CCDM, participent également à ce mouvement. C’est entre autres cette conception de l’université qui les pousse à intervenir directement auprès des différents gouvernements dans la première moitié des années 1950 afin de réclamer et d’obtenir l’interdiction des subsides fédéraux au profit d’un impôt provincial en faveur des institutions universitaires.
Parties annexes
Notes
-
[1]
CCDM, Projet d’un mémoire à la Commission Tremblay, janvier 1954, p. 14, Fonds Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après CCMM), (P003/I3,0070), Archives-HEC Montréal.
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[2]
Jules Racine St-Jacques, « Une fragile union : les universités québécoises et le financement fédéral de l’éducation supérieure, 1949-1956 », dans Stéphane Savard et Jérôme Boivin (dir.), De la représentation à la manifestation : Groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XXe siècle, Québec, Septentrion, 2014, p. 388-426.
-
[3]
Ibid., p. 395-396 ; Paul Litt, The Muses, the Masses and the Massey Commission, Toronto, University of Toronto Press, 1992, 331p.
-
[4]
Gwendoline Pilkington, A History of the National Conference of Canadian Universities, 1911-1961, thèse de doctorat (histoire), Toronto, University of Toronto, 1974, p. 505-558.
-
[5]
Dominion du Canada, Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, lettres et sciences au Canada, Ottawa, imprimeur de sa très excellente majesté le roi, 1951, p. 158.
-
[6]
David Stager, « Federal Government Grants to Canadian Universities, 1951-1966 », Canadian Historical Review, vol. 54, no 3, 1973, p. 287-288.
-
[7]
Gaston Bernier, « La commission Tremblay (1953-1956) : leg documentaire », Bulletin d’histoire politique, vol.16, no 1, automne 2007, p. 141.
-
[8]
Gouvernement du Québec, « chapitre 4 : Loi instituant une commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels », 1-2 Élizabeth 11, sanctionnée le 12 février 1953, p. 31.
-
[9]
Jules Racine Saint-Jacques, loc. cit., p. 419-425.
-
[10]
Kenneth McRobert, Un pays à refaire. L’échec des politiques constitutionnelles canadiennes, Montréal, Boréal, 1999, p. 49 ; Jose Igartua, The Other Quiet Revolution : National Identities in English Canada, 1946-1971, Vancouver, UBC Press, 2006.
-
[11]
Zoe Druick, « Remedy and Remediation : The Cultural Theory of the Massey Commission », Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, no. 29, 2004, p. 159-174 ; David Kwavnick, The Tremblay Report, Toronto, McClelland and Stewart, 1973.
-
[12]
Mireille McLaughlin, « Par la brèche de la culture : le Canada français et le virage culturel de l’État canadien, 1949-1963 », Francophonies, Interculturality, Cultures and Strategies, no 45-46, 2012, p. 142-143.
-
[13]
Ryan Edwardson, cité dans ibid. Voir Ryan Edwardson, Canadian Content : Culture and the Quest for Nationhood, Toronto, UTP, 2008, p. 56.
-
[14]
André Laurendeau, « Tant de clairvoyance et tant d’aveuglement », Le Devoir, 6 juillet 1951, p. 4.
-
[15]
L’Action nationale, « Éditorial : c’est le temps ou jamais de prendre l’initiative », L’Action nationale, vol. XLVI, no 5-6, 1957, p. 339.
-
[16]
John Meisel et al, Si je me souviens bien – As I Recall : regards sur l’histoire, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, 1999, p. 145-146 ; Jules Racine Saint-Jacques, loc. cit., p. 389.
-
[17]
Esdras Minville, « Les universités en face des octrois fédéraux », L’Action nationale, vol. XLVI, no 5-6, 1957, p. 359.
-
[18]
Jules Racine St-Jacques et Martin Maltais, « Faire l’économie du savoir. Usages et représentations du financement public des universités du Québec, de l’après-guerre à la Révolution tranquille (1950-1968) », Globe, Revue internationale d’études québécoises, vol. 17, no 2, 2014, p. 117-142.
-
[19]
Voir notamment David Stager, loc. cit. ; John Meisel et al, op. cit. ; Ryan Edwardson, op. cit. ; et Jules Racine Saint-Jacques, loc. cit.
-
[20]
Les ingénieurs de l’École Polytechnique entretiennent par exemple des liens étroits avec les petites et moyennes entreprises détenues par la petite bourgeoisie francophone du Québec. Voir Robert Gagnon, Histoire de l’École Polytechnique de Montréal : la montée des ingénieurs francophones, Montréal, Boréal, 1991, p. 339.
-
[21]
Voir par exemple Dominique Foisy-Geoffroy, Esdras Minville : nationalisme économique, et catholicisme social au Québec durant l’entre-deux-guerres, Québec, Septentrion, 2004.
-
[22]
Michel Sarra-Bournet, Entre le corporatisme et le libéralisme : les groupes d’affaires francophones et l’organisation sociopolitique du Québec de 1943 à 1969, thèse de doctorat (histoire), Université d’Ottawa, 1995.
-
[23]
Yves Gingras, Pour l’avancement des sciences : histoire de l’ACFAS, 1923-1993, Montréal, Boréal, 1994, 263 p. ; Errol Bouchette, L’indépendance économique du Canada français, Montréal, les éditions La Presse, 1977 [1906], p. 189.
-
[24]
Fernande Roy, Progrès, harmonie, liberté : le libéralisme des milieux d’affaires francophones à Montréal au tournant du siècle, Montréal, Boréal, 1988.
-
[25]
Cité dans Michel Sarra-Bournet, op. cit.
-
[26]
Voir par exemple l’étude de Rumilly : Robert Rumilly, Histoire de l’École des hautes études commerciales de Montréal, 1907-1967, Montréal, Beauchemin, 1966, 214 p.
-
[27]
Michel Sarra-Bournet, op. cit.
-
[28]
Paul Gérin-Lajoie, Constitutional Amendment in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1950, p. 256-282. ; François-Albert Angers, « Où est le byzantinisme ? », L’Action nationale, vol. XLVIII, no 7, mars 1959, p. 272-286.
-
[29]
Michel Sarra-Bournet, op. cit.
-
[30]
Ibid. Voir aussi Pierre Fournier, Le patronat québécois au pouvoir : 1970-1976, Montréal, Hurtubise, 1979, p. 73-74.
-
[31]
Jean-Philippe Carlos, « “Exprimer la conscience d’un peuple” : le réseau des revues intellectuelles de droite et la question de l’indépendance nationale du Québec (1957-1968) », MENS, vol. 15, no 2, 2015, p. 10 ; Xavier Gélinas, La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, p. 27-30 ; Louis Balthazar, Nouveau bilan du nationalisme au Québec, Montréal, VLB éditeur, 2013, p. 117-118 ; Léon Dion, Nationalisme et politique au Québec, Montréal, Hurtubise, 1975, p. 29-35 ; et Jacques Beauchemin, « Politisation d’un nationalisme dans le Québec duplessiste », dans Michel Sarra-Bournet et Jocelyn Saint-Pierre (dir.), Les nationalismes au Québec du XIXe au XXIe siècle, Québec, PUQ, 2001, p. 121-126.
-
[32]
CCDM, Mémoire de la Chambre de commerce du district de Montréal soumis à La Commission royale d’Enquête sur l’avancement des Arts, des Lettres et des Sciences au Canada, 13 mars 1950, p. 9, Fonds de la CCMM (P003/G04,0027), Archives-HEC Montréal.
-
[33]
Mgr. Ferdinand Vandry, Mémoire à la Commission Massey : les besoins des Universités de langue française dans le domaine des Sciences, des Arts et des Lettres, janvier 1950, p. 1-3, Fonds CCMM (P003/C2,0086), Archives-HEC Montréal.
-
[34]
Lettre de Jean-Guy Décarie, directeur du service d’orientation économique de la Chambre de commerce du district de Montréal, au premier ministre Louis-S. St-Laurent concernant le mémoire remis à la Commission Massey par la Chambre, 1er mai 1950, p. 1, Fonds CCMM (P003/I3,0035), Archives-HEC Montréal.
-
[35]
CCDM, Mémoire de la Chambre de commerce du district de Montréal soumis à La Commission royale d’enquête…, op. cit., p. 21.
-
[36]
Ibid., p. 16.
-
[37]
Louis Saint-Laurent dans House of Commons Debates, 21e législature, 4e session, vol. 5, 30 juin 1951, p. 5020.
-
[38]
Au très honorable Louis St-Laurent, premier ministre du Canada : l’opinion officielle de la Chambre de commerce du district de Montréal concernant l’assistance financière qui semble vouloir apporter le gouvernement fédéral aux universités canadiennes en vertu du crédit no 690 voté par le parlement en juin 1951, 19 décembre 1951, p. 5, Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal.
-
[39]
Ibid.
-
[40]
CCDM, À l’honorable Maurice Duplessis, premier ministre de la Province de Québec, l’opinion officielle de la Chambre de commerce du district de Montréal concernant l’Assistance financière que semble vouloir apporter le gouvernement fédéral aux universités canadiennes en vertu du crédit no 690 voté par le Parlement en juin 1951, 26 septembre 1951, p. 1, Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal.
-
[41]
Gérard Boismenu, loc. cit., p. 154.
-
[42]
CCDM, À l’honorable Maurice Duplessis…, op. cit., p. 3.
-
[43]
CCDM, À l’honorable Maurice Duplessis, premier ministre de la Province de Québec, l’opinion officielle de la Chambre de commerce de la province de Québec concernant l’Assistance financière que semble vouloir apporter le gouvernement fédéral aux universités canadiennes en vertu du crédit No 690 voté par le Parlement en juin 1951 et l’assistance financière que devrait apporter le gouvernement provincial aux universités de la province de Québec, 1er octobre 1951, 7 p. ; Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal ; La société Saint-Jean-Baptiste et le mémoire de la Chambre de commerce du district de Montréal, 17 octobre 1951, 1 p, ; Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal ; Lettre de L’Union catholique des cultivateurs à Maurice Duplessis : appui au document À l’honorable Maurice Duplessis, premier ministre de la Province de Québec, l’opinion officielle de la Chambre de commerce du district de Montréal concernant l’Assistance financière que semble vouloir apporter le gouvernement fédéral aux universités canadiennes en vertu du crédit no 690 voté par le Parlement en juin 1951, 2 novembre 1951, 1 p. ; Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal ; Lettre de l’Association Générale des Étudiants de l’Université de Montréal à Jean Guy Décarie, directeur du Service d’orientation économique de la Chambre de commerce du district de Montréal : appui au document à l’honorable Maurice Duplessis, 10 décembre 1951, 1 p. ; Fonds CCMM (P003/I3,0037), Archives-HEC Montréal.
-
[44]
Louis St-Laurent, Lettre de Louis Saint-Laurent, premier ministre du Canada, à Gilbert Latour de la Chambre de commerce du district de Montréal concernant le mémoire que la Chambre a remis au premier ministre, 24 septembre 1951, p. 38, Fonds CCMM (P003/T4,0076), Archives-HEC Montréal.
-
[45]
Maurice Duplessis, Lettre de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, à Louis St-Laurent, premier ministre du Canada, au sujet de l’aide financière fédérale aux universités canadiennes, 17 novembre 1951, p. 2, Fonds CCMM (P003/T4,0076), Archives-HEC Montréal.
-
[46]
Ibid., p. 3.
-
[47]
Louis St-Laurent, Lettre de Louis St-Laurent, premier ministre du Canada, à Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, en réponse à une lettre de M. Duplessis en lien avec l’aide financière fédérale aux universités canadiennes, 26 novembre 1951, p. 2, Fonds CCMM (P003/T4,0076), Archives-HEC Montréal.
-
[48]
Louis St-Laurent, Lettre de Louis St-Laurent, premier ministre du Canada, à Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, en réponse à une lettre de M. Duplessis en lien avec la formation d’un comité intergouvernemental, 15 décembre 1951, 2 p., Fonds CCMM (P003/T4,0076), Archives-HEC Montréal.
-
[49]
Maurice Duplessis, Lettre de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, à Louis Saint-Laurent premier ministre du Canada, en réponse à une lettre de M. St-Laurent en lien avec l’aide financière fédérale aux universités canadiennes, 30 novembre 1951, p. 2, Fonds CCMM (P003/T4,0076), Archives-HEC Montréal.
-
[50]
CCDM, Mémoire sur l’aide financière du gouvernement fédéral aux universités, 1952, p. 3, Fonds CCMM (P003/I1,0021), Archives-HEC Montréal.
-
[51]
Dominion du Canada, Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, lettres et sciences au Canada, Ottawa, imprimeur de sa très excellente majesté le roi, 1951, p. 30-50.
-
[52]
CCDM, Mémoire sur l’aide financière…, op. cit., p. 3-4.
-
[53]
Ibid., p. 32.
-
[54]
Ibid., p. 33.
-
[55]
Jules Racine St-Jacques, loc. cit., p. 389.
-
[56]
CCDM, « Douze millions disponibles pour les universités et les collèges classiques du Québec », Commerce-Montréal, 26 mai 1952, p. 2.
-
[57]
Ibid., p. 3.
-
[58]
Ibid.
-
[59]
CCDM, Projet d’un mémoire à la Commission Tremblay, janvier 1954, p. 14, Fonds CCMM (P003/I3,0070), Archives-HEC Montréal.
-
[60]
Ibid., p. 15-16.
-
[61]
Ibid., p. 15.
-
[62]
Onésime Gagnon, dans Débats reconstitués de l’Assemblée législative du Québec, 24e législature, 2e session, 14 janvier 1954, p. 363.
-
[63]
Maurice Duplessis, dans Ibid., p. 364.
-
[64]
CCDM, À l’honorable Premier ministre de la Province de Québec, Monsieur Maurice-L. Duplessis, C. R. : l’opinion respectueuse de la Chambre de commerce du district de Montréal concernant l’impôt provincial sur le revenu (Bill no.43), février 1954, p. 5, Fonds CCMM (P003/G04,0085), Archives-HEC Montréal.
-
[65]
« Loi de l’impôt provincial sur le revenu », Débats reconstitués de l’Assemblée législative du Québec, 24e législature, 2e session, 24 février 1954, p. 872.
-
[66]
CCDM, Projet d’un mémoire…, op. cit., p. 15-16.
-
[67]
CCDM, Mémoire à la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, vol. 2, septembre 1955, p. 32, Fonds CCMM (P003/G04,0095), Archives-HEC Montréal.
-
[68]
Ibid., p. 44.
-
[69]
Voir par exemple la question du techno-nationalisme canadien traité dans Creso Sá, Andrew Kretz et Kristjan Sigurdson, « Techno-Nationalism and the Construction of University Technology Transfer », Minerva, vol. 51, no 4, 2013, p. 443-464.
-
[70]
Errol Bouchette, op. cit., p. 189.
-
[71]
Ibid., p. 130.
-
[72]
Ibid., p. 131.
-
[73]
Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, Histoire des sciences au Québec de la Nouvelle-France à nos jours, Montréal, Boréal, 2008, p. 278-279.
-
[74]
Jonathan Fournier, « L’instrumentalisation du savoir économique en milieu universitaire québécois : controverses autour de l’utilité d’une discipline (1950-1975) », Scientia Canadensis, vol. 30 no 2, 2007, p. 26. Voir aussi Jonathan Fournier, « Les économistes canadiens-français pendant l’entre-deux-guerres : entre la science et l’engagement », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 58, no 3, 2005, p. 389-414.
-
[75]
Voir entre autres Dominique Foisy-Geoffroy, op. cit.
-
[76]
Esdras Minville, cité dans François-Albert Angers, « La pensée économique d’Esdras Minville », L’Actualité économique, vol. 72, no 4, 1996, p. 380.
-
[77]
Dominique Foisy-Geoffroy, « Esdras Minville et le nationalisme économique, 1923-1939 », Mens, vol. 1, no 1, 2000, p. 52.
-
[78]
Jules Racine Saint-Jacques, L’engagement du père Georges-Henri Lévesque dans la modernité canadienne-française, 1932-1962. Contribution à l’histoire intellectuelle du catholicisme et de la modernité au Canada français, thèse de doctorat (histoire), Université Laval, 2015, p. 265-301.
-
[79]
François Albert-Angers, « Deux modèles d’inconscience : le Premier Saint-Laurent et le Commissaire Lévesque », L’Action nationale, vol. 38, no 3, novembre 1951, p. 183. Voir aussi François-Albert Angers, « Les raisonnements fallacieux du rapport Massey, le fédéral et les universités », L’Action nationale, vol. 39, no 1, janvier-février 1952, p. 7-29 ; et Stéphane Saint-Pierre, François-Albert Angers et la nation confessionnelle (1937-1960), mémoire de M.A. (histoire), Université de Montréal, mai 2006, p. 66-67.
-
[80]
Cette citation est le titre de l’anthologie des textes de Marie-Victorin produite par Yves Gingras. Marie-Victorin, Science culture et nation, textes choisis et présentés par Yves Gingras, Montréal, Boréal, 1996, 179 p.
-
[81]
Yves Gingras, Pour l’avancement des sciences : histoire de l’ACFAS, 1923-1993, Montréal Boréal, 1994.
-
[82]
Yves Gingras, « Marie-Victorin intellectuel », dans Marie-Victorin, op. cit., p. 11.
-
[83]
Marie-Victorin, « La province de Québec, pays à découvrir et à conquérir : à propos de culture scientifique et de libération économique », dans ibid., p. 67.
-
[84]
Wilhelm Von Humboldt, « Sur l’organisation interne et externe des établissements scientifiques supérieurs à Berlin », dans Luc Ferry, J.-P. Person et Alain Renault (dir.), Philosophie de l’université : L’idéalisme allemand et la question de l’Université, Paris, Payot, 1979, p. 320-329.
-
[85]
Yves Gingras et Julie Sarault, « Entre la France et l’Amérique : la transformation des grades à l’Université de Montréal, 1920-1945 », dans Yves Gingras et Lyse Roy (dir.), Les universités nouvelles : Enjeux et perspectives, Québec, PUQ, 2012, p. 157-173.
-
[86]
« Les bourses d’étude du Commonwealth », Commerce-Montréal, vol. 15, no 7, 14 septembre 1959, p. 5.
-
[87]
Marie-Victorin, cité dans Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, op. cit., p. 278-279.
-
[88]
Robert Gagnon, op. cit. ; Idem, « Les discours sur l’enseignement pratique au Canada français, 1850-1900 », dans Marcel Fournier et al. (dir.), Sciences et médecine au Québec : perspectives sociohistoriques, Montréal, IQRC, 1987, p. 19-39 ; Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, « La naissance d’un mouvement scientifique canadien-français », dans Histoire des sciences…, op. cit., p. 249-280 ; Claude Corbo, L’idée d’université, Montréal, PUM, 2001 ; Yves Gingras, Pour l’avancement des sciences…, op. cit.