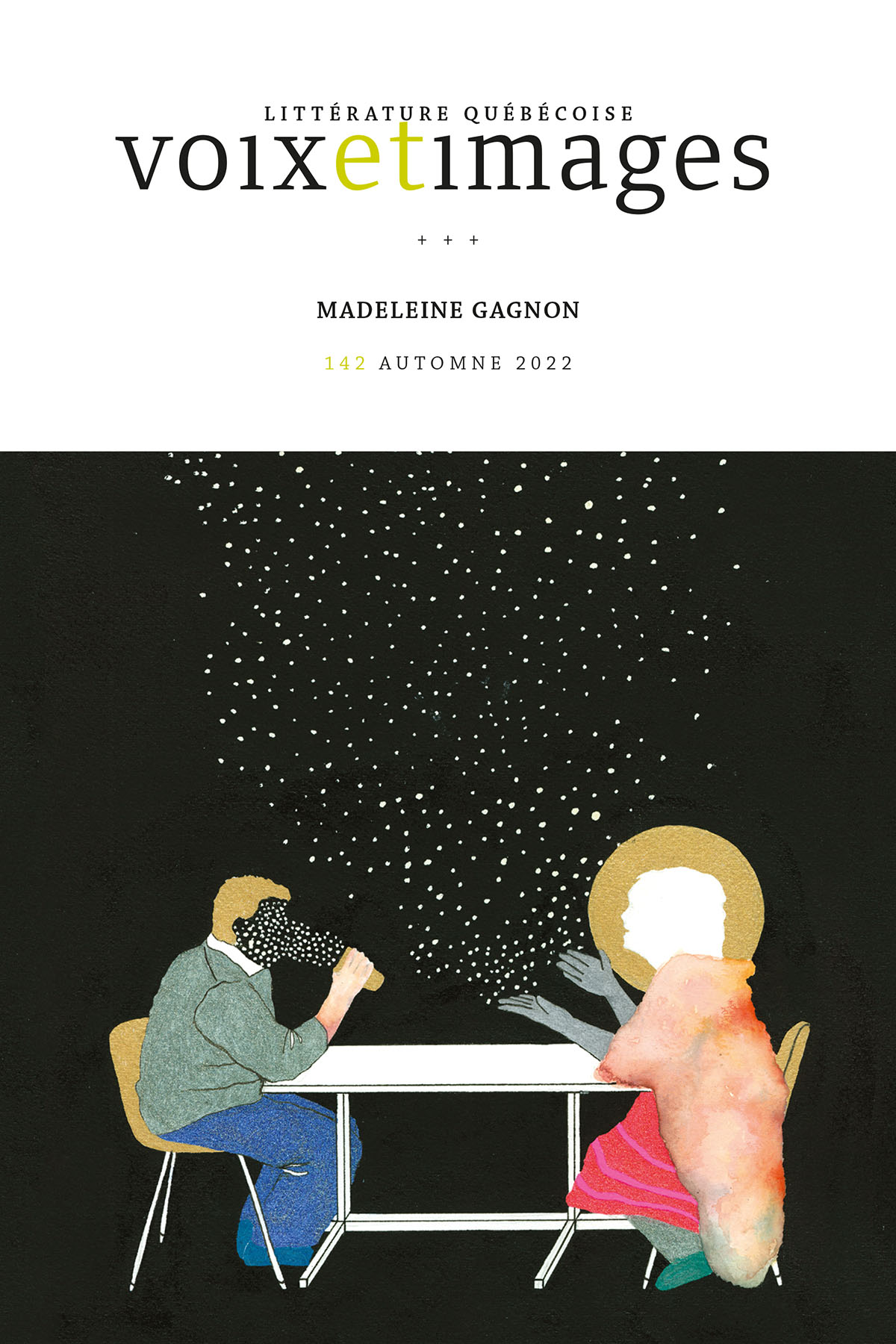Article body
On le constatera ici : j’ai parfois l’esprit digressif. J’ose toutefois espérer que j’ai de la suite dans les idées. Ma chronique précédente portait sur de récentes parutions de (ou à propos de) Micheline Cambron et de Régine Robin[1]. L’actualisation de leur travail des années 1980 me semblait (tristement) aisée : la persistance de récits nationaux et le fonctionnement de l’hégémonie chez Cambron, les rapports idéologiquement complexes entre histoire et mémoire chez Robin – tout cela me semble évoluer à pas de tortue. L’hiver est long. La parution de Géographies du pays proche. Poète et citoyen dans un Québec pluriel[2] de Pierre Nepveu me permet ici de continuer ma recension de ces territoires de la pensée (notez comment je file la métaphore spatiale) tout en précisant la nature des conflits de récits qui ont récemment alimenté les débats politiques, et par extension, les débats intellectuels.
En 2019, Pierre Nepveu nous accordait, à Stéphane Inkel et moi, un entretien dans le cadre d’un dossier sur l’« Espace démocratique de la littérature québécoise contemporaine » pour Voix et Images. Peut-être en raison de notre position géographique (nous enseignons tous les deux en Ontario, notre perspective sur la littérature québécoise est anecdotiquement décentrée), nous l’avions d’emblée interrogé sur l’importance de François Paré dans son parcours, influence qu’il revendique par ailleurs explicitement dans Lectures des lieux (2004). Il nous répondait avoir été, depuis les années 1970 et son Miron dépaysé, « mû par la critique de notions comme l’hégémonie, la centralité, l’identité, l’homogénéité[3] ». Les littératures de l’exiguïté (1992) de Paré lui avait « ouvert le territoire des littératures francophones du Canada, mais le renversement qu’il a suscité chez [lui] concernait plutôt la littérature québécoise[4] », l’aidant à « “dé-monumentaliser” la référence québécoise, [à] en faire sentir l’instabilité et la précarité fondamentales[5] » et à « [donner] à voir que le discours de la fragilité et de l’hétérogène pouvait être en réalité l’affirmation d’un pouvoir, le luxe d’une culture forte, capable de composer avec ses fissures et ses discordances, se nourrissant de l’altérité même qui la déstabilise[6] ». Il partagerait avec Paré un « même souci éthique qui [lui] fait contester le grand récit national et l’hégémonie d’une identité pleine et consensuelle sans qu’[il] idéalise pour autant la différence et l’altérité[7] ». Géographies du pays proche. Poète et citoyen dans un Québec pluriel vient prolonger cette exploration des géographies imaginaires du Québec. Il s’agit d’un livre ambitieux qui parvient à formuler une synthèse globale de ses travaux antérieurs, à esquisser en creux une autobiographie intellectuelle (en fait, une autobiographie tout court ; nombreuses sont les anecdotes sur son enfance, sur son milieu d’origine), et à inscrire ces considérations dans l’histoire des idées au Québec ; en somme, à objectiver l’histoire de ses idées. Ce regard rétrospectif est doublé d’interventions ciblées dans des débats publics contemporains. Rares sont les intellectuel·le·s qui sont parvenu·e·s à ce haut degré de conceptualisation de la culture en faisant se croiser l’analyse littéraire et les sciences sociales.
Je tenterai dans cette chronique de suivre les enseignements de la riche leçon de méthode proposée par Nepveu et que l’on pourrait désigner ainsi : comment lire le politique avec les outils de la littérature ? Nous ferons entrer cet important ouvrage en dialogue avec un récent livre de François Paré, mais aussi avec le travail d’intellectuel·le·s de ma génération (les X ? les Z ? qu’en sais-je ?), Dalie Giroux et Philippe Néméh-Nombré, afin de cerner les traits d’une filiation possible.
+
« Poète et citoyen dans un Québec pluriel » dit le sous-titre chargé du livre de Nepveu. Les politiques du poème ont en effet une histoire longue au Québec, de Chamberland à Miron en passant par Van Schendel et Lalonde, qui furent souvent une affirmation du pays. Nepveu, pour sa part, déplace cette tradition et place sa politique du poème sous les auspices d’un territoire qui est un lieu de rencontres d’identités et de langues mouvantes. C’est depuis ce lieu qu’il interprète la culture et intervient dans les débats publics. Juste une petite parenthèse avant de continuer : il est de coutume dans l’histoire culturelle de définir l’action des intellectuel·le·s comme une sortie du culturel et une entrée dans le politique. C’est le modèle classique en France, depuis longtemps entré en désuétude. Il me semble que la posture intellectuelle de Nepveu repose sur un équilibre radicalement différent, à la fois en regard de la tradition française, mais également de l’histoire (moins foisonnante) des intellectuel·le·s au Québec. Sa méthode de lecture du réel est une attention aux signes du politique interprétés par les écrivain·e·s, ce qui le rapproche à mon avis de Jacques Rancière. Souvenons-nous que Martin Jalbert avait proposé dans Le sursis littéraire. Politique de Gauvreau, Miron, Aquin[8] une interprétation ranciérienne de la littérature québécoise à l’aune d’une émancipation politique rendue possible par le langage, par l’identification d’un tort proprement politique dans le poème ou le roman. Mais nous restions dans le domaine disons « restreint » de l’analyse littéraire. Nepveu, pour sa part, reste toujours ancré dans la littérature, dans la poésie, dans les mots, dans le langage, mais il s’invite de plus en plus franchement dans des débats politiques. Il ne sort toutefois jamais du culturel, et n’utilise pas la littérature comme un signe de distinction symbolique afin d’asseoir la crédibilité d’une intervention publique. Il parle depuis la littérature. Fin de la parenthèse.
Ainsi, si intervention dans le politique il y a dans Géographies du pays proche, c’est directement sur les débats identitaires qui gangrènent les débats publics depuis Hérouxville, et qui ont fini par contaminer l’ensemble des débats intellectuels, traçant de révélatrices lignes de fractures, y compris dans les études littéraires, où se jouent encore, comme au temps des exotiques et des régionalistes, des conflits de valeurs sur l’interprétation des textes. Il est un pluralisme affiché chez Nepveu, qui lui vient à la fois d’une grande connaissance de la Renaissance et des littératures anglo-montréalaises et migrantes. Ceux et celles qui ont eu Nepveu comme professeur, ceux et celles qui le lisent depuis L’écologie du réel (1988) et Intérieurs du Nouveau Monde (1992) savent qu’il a toujours su conjuguer une fréquentation intime du canon québécois aux littératures étrangères et aux traditions philosophiques exogènes.
L’ouvrage de Nepveu s’ouvre sur quelques considérations où il place d’emblée sa réflexion à la croisée des chemins. S’il est venu pour lui le temps de prendre un pas de recul et de revenir sur son parcours intellectuel, c’est aussi parce que nous vivons à une époque où la notion de nation est soumise à d’importants conflits de définition et à des pressions idéologiques. D’un côté, dit-il, les cosmopolites tendent à représenter la référence nationale comme désuète ; de l’autre, certains font preuve d’une rigidité identitaire qui serait garante de la cohésion du Québec. Cet essai vise avant tout à montrer un attachement au Québec et à sa culture : « Comment en suis-je arrivé à ma manière de penser le Québec, sa culture, son devenir ? » (11) Raconter l’identité différemment ne revient donc pas, nous dit Nepveu, à en nier l’importance dans la fondation de l’espace commun. Mais, dois-je le préciser, l’identité n’est jamais fétichisée chez Nepveu : il s’agit de reconnaître le caractère minoritaire du Québec sans « provincialisme défensif et régressif » (12). La table est mise. Mais son intervention n’est pas strictement polémique (il est notoire que Nepveu n’a pas la plume d’un pamphlétaire), elle a aussi des vertus méthodologiques plus larges :
Mon discours n’est pas celui d’un historien, d’un sociologue, d’un politologue, ni même d’un philosophe, bien que toutes ces disciplines me nourrissent et qu’elles occupent une large place dans ma bibliothèque. Mon point de vue sur le monde est celui d’un littéraire et donc d’un généraliste ou, mieux encore, d’un « écologiste du réel », une expression que j’emprunte à un livre que j’ai publié dans les années 1980 et qui considère que le monde que nous habitons est, à portée de langage, une totalité concrète, complexe, diversifiée, qui se maintient dans des interrelations, qui vit et se recrée sans cesse dans des échanges, et dont nos discours ont le devoir de faire entendre la polyphonie, les discordances autant que les harmonies.
12
Ce qui est frappant ici, c’est le caractère totalisant de l’entreprise de Nepveu ; caractère qui apparaissait, certes, depuis L’écologie du réel et les grands essais l’ayant suivi, mais qui, à la lumière du regard rétrospectif caractérisant Géographies du pays proche, est encore plus net. Non seulement Nepveu puise à différentes sources pour alimenter son argumentaire qui concerne d’abord le symbolique et l’imaginaire (à la manière de ses essais antérieurs), mais ici il renverse le miroir et confronte sa conceptualisation à des récits concurrents contre et avec lesquels il s’est formé. « Dans cet essai, je vais à l’école de ce que j’ai perdu, je cherche à réapprendre ce que je ne suis plus, en cherchant ce que nous sommes devenus. » (53) Le passage du « je » au « nous » dans les deux citations précédentes montre bien à quel type d’objectivation de soi procède constamment Nepveu dans ce texte. Fidèle au genre de l’autobiographie intellectuelle, Nepveu tente de rendre compte de l’environnement dans lequel ses idées ont circulé, et précise à quelles communautés il s’adresse.
La généralisation à laquelle Nepveu aspire n’est pas pour autant un système clos parfaitement lisse. Cet ouvrage est en fait l’apologie d’un équilibre instable, comme en témoigne l’attention portée à la diversité des langues, et à la traduction. On entend bien sûr dans ce lexique l’influence d’Édouard Glissant et de sa pensée archipélique de la relation. De plus, Nepveu situe bien l’émergence d’une pensée pluraliste chez lui (on peut parler d’une graduelle prise de conscience), contemporaine de la création de la revue Dérives par Jean Jonassaint (1975-1987) et de la revue Vice Versa (1983-1997). Depuis ses séjours en Ontario au tournant des années 1970 jusqu’à sa fréquentation de Sherbrooke et de North Hatley (et son implication dans la revue de traduction Ellipses), en passant par ses années à Vancouver et ses longues errances dans divers quartiers de Montréal, son parcours est indissociable de la traduction et de multiples décentrements de la culture québécoise. Nepveu évoque également sa découverte de Parti pris à l’adolescence (il a une demi-génération de différence avec Piotte et Cie) ; toutefois, son parcours l’a amené à ne pas reproduire indûment le cadre d’analyse de la situation dite coloniale du Québec, dont l’historien Sean Mills a brillamment montré les angles morts et les écueils dans The Empire Within[9]. Les solidarités avec les peuples opprimés ne sauraient gommer les récits parallèles des dominations dont les Québécois ont pu être complices ; et la méfiance à l’égard d’un nationalisme identitaire n’est pas pour autant un aveuglement en ce qui concerne les failles du nationalisme canadien. Le récit de Nepveu nous permet en quelque sorte de bricoler du sens avec ces morceaux épars et difficiles à concilier, et de penser une reconnaissance de la précarité du français qui s’inscrit dans une logique de diversité des langues.
Le rapport de Nepveu à la pluralité des langues se développe au contact de la philologie, dont il retient qu’elles sont « des organismes vivants qui évoluent à travers des influences » (116). La découverte de Rabelais, qu’il partage avec André Belleau comme en témoigne un texte éclairant publié dans Voix et Images en 2015[10], rappelle que les études québécoises se sont beaucoup développées dans les années 1970 et 1980 sous l’impulsion d’une multiplicité bakhtinienne. Comment parvenir à importer cet héritage dans le présent ? La filiation entre Belleau et Nepveu n’est pas une évidence sur le plan de l’histoire des idées, et pourtant, cette espèce de « matrice » rabelaisienne/bakhtinienne partagée constitue une piste à suivre si on veut comprendre l’« esthétique du non » chez Belleau, la géographie de la proximité chez Nepveu, et l’équilibre précaire chez l’un comme chez l’autre entre l’unité et le multiple :
C’est un corollaire obligé de la question nationale et, en fait, de toute entité politique : comment concilier l’unité et le pluralisme, l’identité et la discordance, la permanence et le surgissement créateur, ou encore la conservation du sens et de la mémoire, d’une part, et l’invention de l’inouï, de l’imprévisible, d’autre part ?
120
Les travaux de Nepveu sur le Montréal juif, ses réflexions sur la littérature migrante (l’appellation a mal vieilli, mais pas son impulsion première) sont autant de tentatives de permettre la rencontre des cultures et des langues sur un territoire partagé. Commentant le vers de Miron « Je suis sur la place publique avec les miens », Nepveu écrit :
Ce qui est en cause est beaucoup plus large que la poésie, à laquelle je suis arrivé en sortant peu à peu de ma petite patrie pour en habiter une plus grande – c’est plutôt l’acte humain et citoyen d’habiter quelque part, dans un monde peuplé d’êtres et de choses qui ne sont pas uniquement à mon usage et à mon service, et qui ne sont pas réductibles à leur marque ou à leur identité.
24-25
Dans la première partie de cette courte citation, la citoyenneté semble en effet se résumer à un état civique, et à une coïncidence, celle d’habiter le même territoire. Cela renvoie au sous-titre du livre de Nepveu, « Poète et citoyen dans un Québec pluriel », qui a quelque chose de tranchant (que j’aime) et d’oecuménique (que j’aime peut-être un peu moins). Ce qui me plaît assurément, c’est qu’ici Nepveu rend visible, peut-être plus clairement que jamais, un agencement singulier entre politique et littérature, qu’il place sous les auspices du pluralisme. Ce qui me plaît moins dans le sous-titre est que l’on sent poindre le danger d’une dilution du politique dans la notion de citoyenneté, qui a certes une belle histoire, mais est malheureusement souvent récupérée par la droite identitaire. Or Nepveu définit plus précisément cette citoyenneté – en partant de la poésie, je le rappelle – comme un devoir, celui d’être lié aux siens par une responsabilité partagée. Et ce sens commun est atteignable par les lieux et les mots partagés dans et par la poésie, car celle-ci, si l’on suit le raisonnement de Nepveu, ne réduit pas les gens et les choses à leur utilité ; elle rend visibles les relations, montre le détail, fait un zoom pour dire que « rien n’est réductible à ce qu’il est » (26). Nos raisons communes ne se développent donc pas uniquement dans et par les systèmes, dans les institutions d’où émanent les idéologies, mais aussi dans les détails et dans les activités improductives et secrètes, à la manière du marranisme : la marche, la contemplation de la nature, les rituels familiaux, la littérature. On bricole du sens comme on peut – Nepveu le fait avec les mots des poètes. Nous l’avons toujours su, mais cet ouvrage nous montre comment il peut s’agir d’un socle solide pour être dans la place publique avec les siens.
Cette attention aux détails qui serait le propre de la poésie est aussi, profondément, une conception de la démocratie – et du droit, j’y reviens dans un instant –, et c’est sans surprise que la littérature se retrouve solidaire des mouvements sociaux ; il remarque une sorte de convergence de pensée entre ce qu’il désigne comme les mouvements les plus influents de notre temps (« l’écologisme, le féminisme, le mouvement des droits des minorités et celui de la participation citoyenne » [88]) et la littérature, qui préfère l’exception à la règle, l’imprévisible et l’aléatoire. La littérature obéit à une éthique de la proximité, conclut-il, ce qui la confine bien au moralisme ou à la bienveillance.
Nepveu reconnaît d’abord la relation spatiale de proximité comme une appartenance première à une culture (celle du Québec des années 1940 à 1960 dans son cas), avant d’aborder son ancrage dans un quartier (La Petite-Patrie : le livre contient de très belles scènes d’enfance), puis les décentrements successifs qui ont marqué sa vie. C’est ainsi qu’il intervient dans les débats identitaires en définissant l’identité comme « un rapport à l’espace plus qu’au temps et une relation d’altérité plutôt que d’identité plus ou moins fusionnelle » (81). Qu’est-ce donc qui définit ce qui nous est proche ? Nepveu propose un changement complet de paradigme, auquel participent d’autres intellectuels (Gérard Bouchard, qu’il cite, et d’autres que je convoquerai) : « Peut-être sommes-nous surtout fatigués du temps et de l’Histoire elle-même. Il se pourrait que nous soyons allés au bout, jusqu’à plus faim, d’une explication historique de ce que nous sommes. » (158) Comprendre notre géographie, nous dit Nepveu, ce serait aussi aller au coeur même de l’ambiguïté de notre appropriation du territoire (c’est là la thèse de Dalie Giroux, sur laquelle je reviendrai). Nepveu dit que les représentations des Autochtones sont encore « à dénouer », et qu’un peuple dépossédé qui veut mettre fin à son infériorité en devenant lui-même colonisateur ne sait pas véritablement écrire l’histoire dans une perspective géographique. Sur cette question, c’est comme si Nepveu passait la puck aux plus jeunes afin qu’ils parachèvent sa lecture de l’écologie du réel et prennent pleinement la mesure des conséquences et des possibles ayant suivi le mélange des signes qui a marqué les années post-référendaires. Le partage du territoire rejoint donc la question de la diversité (au sens politique – le partage des espaces communs, et par extension du droit de parole) :
La diversité n’a pas été chez moi un concept intellectuel associé à une « religion » multiculturaliste, elle a été une expérience de terrain, une aventure quotidienne qui me faisait traverser les cultures et observer les styles d’habitations, les manières de se vêtir et toute l’échelle des conditions sociales.
181-182
Revenons un instant à François Paré, que nous croisions en ouverture de cette chronique. Chez l’éditeur français Double Ponctuation, qui se spécialise notamment dans les ouvrages sur le milieu éditorial, et par des collaborations avec l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, François Paré a fait paraître en 2021 Faire exister les littératures de l’exiguïté. Instituer, légitimer et pérenniser un champ littéraire dans un contexte de domination culturelle, un entretien qu’il accorde à Nathalie Carré. Le titre montre bien qu’il s’agit d’une suite à son ouvrage fondateur Les littératures de l’exiguïté[11], qui constituait un plaidoyer pour la vitalité des cultures minoritaires, le propos étant ici directement centré sur ce que Marie-Pier Luneau et Josée Vincent nomment intelligemment un système-livre[12] (meilleure expression que chaîne du livre, car elle souligne son caractère holistique plutôt que mécanique). François Paré y insiste sur l’importance de l’objet-livre pour la vitalité des langues minorées :
Même si on dit que le livre est en perte de vitesse, qu’il va disparaître, je ne pense pas qu’il ait perdu sa valeur symbolique et politique, surtout dans les « petites » cultures. Je dirais donc que l’oeuvre imprimée reste un standard d’excellence, un gage de pérennité. Au Canada, il me semble assez facile de produire un livre. Ce qui est difficile, c’est de le distribuer, de le faire connaître, de trouver des lecteurs, de le vendre. […] Malgré tout, l’accès au livre doit rester un objectif majeur pour toutes les collectivités marginalisées.
39
Paré s’avance sur le terrain très vivant des recherches sur la bibliodiversité (un réseau complexe de narrations où les écrivains et les artisans du livre sont vus comme les habitants d’un écosystème ; la bibliodiversité désigne la participation active à la vie de la culture dans un système écosocial sain) et sur la découvrabilité (soit la visibilité des produits culturels non hégémoniques sur les plateformes de vente). Au premier abord, on pourrait se croire loin de Nepveu, mais en fait, on est au plus près, me semble-t-il, du propos de Géographies du pays proche. Paré rejoint d’abord son contemporain sur le nouage entre art et politique, et la manière dont les revendications minoritaires et la littérature partagent un même souci de contestation de l’hégémonie :
[Je tiens] à montrer que l’existence des sociétés minoritaires, où qu’elles se trouvent, dépen[d] de leur capacité à négocier au jour le jour leur place et leur pertinence aux yeux de la majorité. […] Nous sommes traversés chaque jour par de vastes courants hégémoniques qui se nourrissent des injustices et inégalités du passé et du présent. Mais je suis un homme des interstices et des espaces inaperçus. Je crois en une approche archipélique. Nous avons les moyens aujourd’hui de pénétrer les cultures majoritaires et de démonter les mécanismes uniformisants qu’elles mettent en oeuvre.
53
Comme Nepveu, Paré est un disciple d’Édouard Glissant, et c’est la relation comme mode de reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique qui guide sa réflexion. Je note au passage l’importance de l’ouvrage Le défi de la fragilité. Autour des essais de François Paré, collectif dirigé par Guy Poirier, Élise Lepage et Tara Collington[13] qui dit bien toute la richesse du parcours de Paré, son importance dans l’étude des minorités linguistiques au Canada. Sa contribution demeure essentielle à la compréhension des relations entre les cultures minoritaires du Canada (francophones, puis autochtones francophones et anglophones), et rappelle, de manière plus générale, que la diversité culturelle et linguistique passe « par la promotion d’un espace équitable pour la parole orale et écrite des écrivains » au sein d’une « écologie des langues et des cultures qui s’appuierait sur la reconnaissance mutuelle » (88). Aussi la protection des cultures minorées – et de la culture livresque en général – peut-elle constituer un puissant levier pour l’équité dans une société démocratique, sachant que les livres sont au coeur même de la liberté d’expression.
La lecture parallèle de Paré et de Nepveu nous permet de reformuler à nouveaux frais la question de la liberté d’expression, trop souvent invoquée à l’aune de censures présumées, ou de guerres culturelles fantasmées – autant d’épouvantails souvent peu informés sur les plans théoriques et historiques. Paré met le livre (autant la poésie que le livre jeunesse) au coeur d’un partage. Chez Nepveu également, le livre est au coeur d’une intelligence partagée, d’une profonde égalité. La liberté d’expression s’inscrit chez Paré et Nepveu dans des dynamiques de pouvoir, d’asymétrie de la parole, d’accès à la publication, de poids dans le débat public, de ressources disponibles pour faire valoir ses droits. C’est ce qui justifie le passionnant chapitre que Nepveu réserve à la question du droit dans les sociétés pluralistes. Ainsi, lorsque nous l’interrogions, Inkel et moi, sur la démocratie, c’est sans surprise qu’il nous ramenait vers le dialogisme du roman et la polyphonie de la poésie (encore Bakthtine). Il nous enjoint donc de faire entendre des voix, tout comme Paré qui en appelle à la préservation des lieux institutionnels et de médiations qui rendent possible l’audibilité des voix minoritaires. Et il me semble qu’il s’agit d’une puissante manière de proposer des narrations contre-hégémoniques. Ce respect de la voix de chacun dans une démocratie chorale est peut-être ce qui fait que Nepveu donne la parole dans son essai à des voix adverses (Jacques Beauchemin ou Mathieu Bock-Côté), refusant de les juger. Il ménage ses adversaires par esprit dialectique (ou dialogique). C’est un choix discutable, mais respectable.
Paré et Nepveu, chacun à leur manière, réitèrent l’importance de ménager des espaces pour les narrations alternatives, qu’elles soient historiques, fictives ou poétiques, afin de préserver la pluralité des voix démocratiques. Le livre Seize temps noirs pour apprendre à dire kuei[14] de Philippe Néméh-Nombré me semble pour sa part prolonger la méthode de Nepveu, en ce sens qu’il montre que le militantisme politique radical n’existe qu’en vertu de déplacements et de recompositions du réel rendus possibles par l’imagination. Cela entre en écho à mon avis avec une oeuvre importante, Rimbaud, la Commune et l’invention de l’histoire spatiale[15] de Kristin Ross, qui avance que lire Rimbaud nous permet de mieux comprendre la Commune de Paris, non pas parce qu’il la représente, mais bien parce qu’il rend compte des utopies, slogans et autres formes artistiques populaires circulant durant la révolte de 1871, et nous permet ainsi d’accéder aux futurs du passé. Il n’est pas anodin que Ross ait vu ses travaux sur Rimbaud, élaborés en parallèle de ses travaux sur le marxisme de Henri Lefebvre et la vie quotidienne, comme un éloignement du close reading et de la déconstruction de Paul de Man et de Jacques Derrida, deux tendances hégémoniques dans l’université américaine d’alors, et auxquelles elle reprochait de proposer des lectures dépolitisantes de la littérature. Le livre de Néméh-Nombré, qui se lit comme une improvisation jazz, tente à sa manière d’ouvrir de nouvelles perspectives sur l’histoire des Noirs au Québec, notamment en montrant comment la poésie rend sensibles les utopies difficilement formulables dans l’espace social. Dès le début du livre, il cite la poète Lorrie Jean-Louis :
Quatre femmes
laide
insultée
oubliée
Yvette
quatre femmes
innommée
violée
invisible
Idrissa
j’ai quatre noms
quatre coeurs
je ne demande rien
je fais pipi debout
je bois la nuit d’une seule traite
cul sec
je suis sommes
nous marchons de mes huit pieds[16].
Ce bref poème lui permet d’identifier un « je » hétérogène, une première personne qui « accueille [et] transforme la multiplicité de la violence » (18), de nommer une subjectivation politique qui conjugue une subjectivité au pluriel, qui nomme à la fois « la violence qui nous occupe » et les possibilités pensées « en excès de ce qui nous occupe » (19). Belle formule qui rappelle que le politique concerne la manière dont les hommes et les femmes deviennent sujets politiques lorsqu’ils parviennent à agir en excès de leurs activités quotidiennes. Évoquant en sourdine les travaux de Saidiya Hartman sur la capacité à revisiter le passé et à chercher, enfouies dans les archives, ses lignes de fuite, Néméh-Nombre traque les rencontres ratées qui auraient pu ne pas l’être au conditionnel passé, beau temps de verbe lorsque vient le temps de créer des narrations alternatives, des « écologies fugitives », comme celle de Nemo et Cash, ces esclaves qui s’enfuient de la ville de Québec en 1779 et dont il est fait mention dans la Gazette de Québec. Que sont-ils devenus ? Et surtout, où sont-ils allés ? Néméh-Nombre imagine dans un très beau chapitre leur fuite dans une temporalité du danger à travers les territoires autochtones, à travers un tissu de relations (Glissant hante ces pages) qui nous permettent d’imaginer différemment l’histoire. À sa manière, Néméh-Nombre propose lui aussi une géographie alternative de notre histoire, une spéculation narrative, une reconnaissance du caractère imaginatif de l’histoire, perspective ouverte par les archives, par l’absence de récit constitué. Si Nepveu propose une méthode d’analyse du politique sensible à la polyphonie des voix se situant à la jonction entre poésie et politique, Néméh-Nombre ouvre pour sa part la possibilité à une écriture de l’histoire du Québec qui soit aussi contre-archivistique. Il ne s’agit pas de nier les méthodes historiennes, mais plutôt d’en reconnaître les failles et d’« imaginer les chuchotements, ce qui se dérobe, de ce qui déroberait » (91), afin d’inventer, voire d’improviser, un futur décolonisé.
Ces rencontres ratées de l’histoire constituent également le coeur du propos de L’oeil du maître de Dalie Giroux, dont je ne dirai qu’un bref mot ici, mais qu’il me fallait évoquer puisqu’il s’agit d’un projet solidaire de ceux qui font l’objet de la présente chronique, en ceci qu’il tente de voir comment à la naissance même du mythe du « maître chez nous » se trouvent des impensés en ce qui concerne une relation au territoire et aux Premières Nations. Giroux, dans une plume acide et drôle dont je ne saurais ici suffisamment louer l’absolue intelligence, tente elle aussi de penser un avenir décolonial, un autre mode de relation au territoire qui permet une convergence de l’antiracisme, du féminisme et de l’écologisme. Il faudra revenir longuement sur cet essai, assurément. Disons simplement ceci : la manière dont Giroux s’empare d’un ensemble épars et disparate de représentations artistiques (filmiques, littéraires), de discours politiques, de textes issus des sciences humaines et sociales ne me semble pas du tout étrangère aux travaux de Pierre Nepveu. Les deux auteurs appliquent une même rigueur à comprendre l’imaginaire québécois en étant sensibles aux déshéritages (le mot est de Réjean Ducharme) et aux bricolages de symboles.
Le livre de Nepveu, et les rapports souterrains avec d’autres livres qu’il me permet de déceler, me redonne foi dans les études littéraires comme discipline ayant la capacité non seulement de saisir l’histoire des formes textuelles, mais d’inscrire ces dernières dans les débats publics, de réélaborer le passé, le présent et le futur depuis la culture, vers le politique. Ma remarque a l’air candide, mais il me semble crucial d’affirmer, dans la foulée de Paré, l’importance de la littérature dans les débats sur la liberté d’expression comme une pièce indispensable à une démocratie polyphonique. Et l’oeuvre de Nepveu fait la démonstration éloquente que la littérature a la capacité de constituer d’autres récits, des voies politiques parallèles qui ne sont pas uniquement compensatoires, mais témoignent d’un besoin quasi anthropologique de nommer le monde et de dessiner des lignes de fuite pour l’avenir.
Appendices
Note biographique
JULIEN LEFORT-FAVREAU est professeur agrégé au Département d’études françaises de l’Université Queen’s. Ses principales publications sont : Henri Deluy, ici et ailleurs, avec Saskia Deluy (Le Temps des cerises, 2017) ; Politique de l’autobiographie. Engagements et subjectivités, avec Jean‐François Hamel et Barbara Havercroft (Nota Bene, 2017) ; Pierre Guyotat politique (Lux éditeur, 2018) ; Le luxe de l’indépendance. Réflexions sur le monde du livre (Lux éditeur, 2021).
Notes
-
[1]
Julien Lefort-Favreau, « Ciel, mon récit ! », Voix et Images, vol. XLVII, no 2, hiver 2022, p. 117-124.
-
[2]
Pierre Nepveu, Géographies du pays proche. Poète et citoyen dans un Québec pluriel, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2022, 249 p.
-
[3]
Stéphane Inkel et Julien Lefort-Favreau, « Entretien avec Pierre Nepveu », Voix et Images, vol. XLVI, no 1, automne 2020, p. 14.
-
[4]
Ibid., p. 15.
-
[5]
Ibid.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Martin Jalbert, Le sursis littéraire. Politique de Gauvreau, Miron, Aquin, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », 2011, 203 p.
-
[9]
Sean Mills, The Empire Within. Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties Montreal, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, coll. « Studies on the History of Quebec/Études d’histoire du Québec », 2010, 311 p.
-
[10]
Pierre Nepveu, « Rabelais au pluriel. André Belleau et l’unité perdue », Voix et Images, vol. XLII, no 2, hiver 2017, p. 95-102.
-
[11]
François Paré, Les littératures de l’exiguïté, Hearst, Le Nordir, coll. « Essai », 1992, 175 p.
-
[12]
Marie-Pier Luneau et Josée Vincent (dir.), Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2022, 755 p.
-
[13]
Guy Poirier, Élise Lepage et Tara Collington (dir.), Le défi de la fragilité. Autour des essais de François Paré, Ottawa, David, coll. « Voix savantes », 2020, 400 p.
-
[14]
Philippe Néméh-Nombré, Seize temps noirs pour apprendre à dire kuei, Montréal, Mémoire d’encrier, coll. « Cadastres », 2022, 109 p.
-
[15]
Kristin Ross, Rimbaud, la Commune et l’invention de l’histoire spatiale, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Singulières modernités », 2013, 233 p. Traduction de The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune, Minneapolis, University of Minnesota Press, coll. « Theory and history of literature », 1988, 170 p.
-
[16]
Lorrie Jean-Louis, La femme cent couleurs, Montréal, Mémoire d’encrier, coll. « Poésie », 2020, p. 75, citée dans Philippe Néméh-Nombré, Seize temps noirs pour apprendre à dire kuei, p. 17.