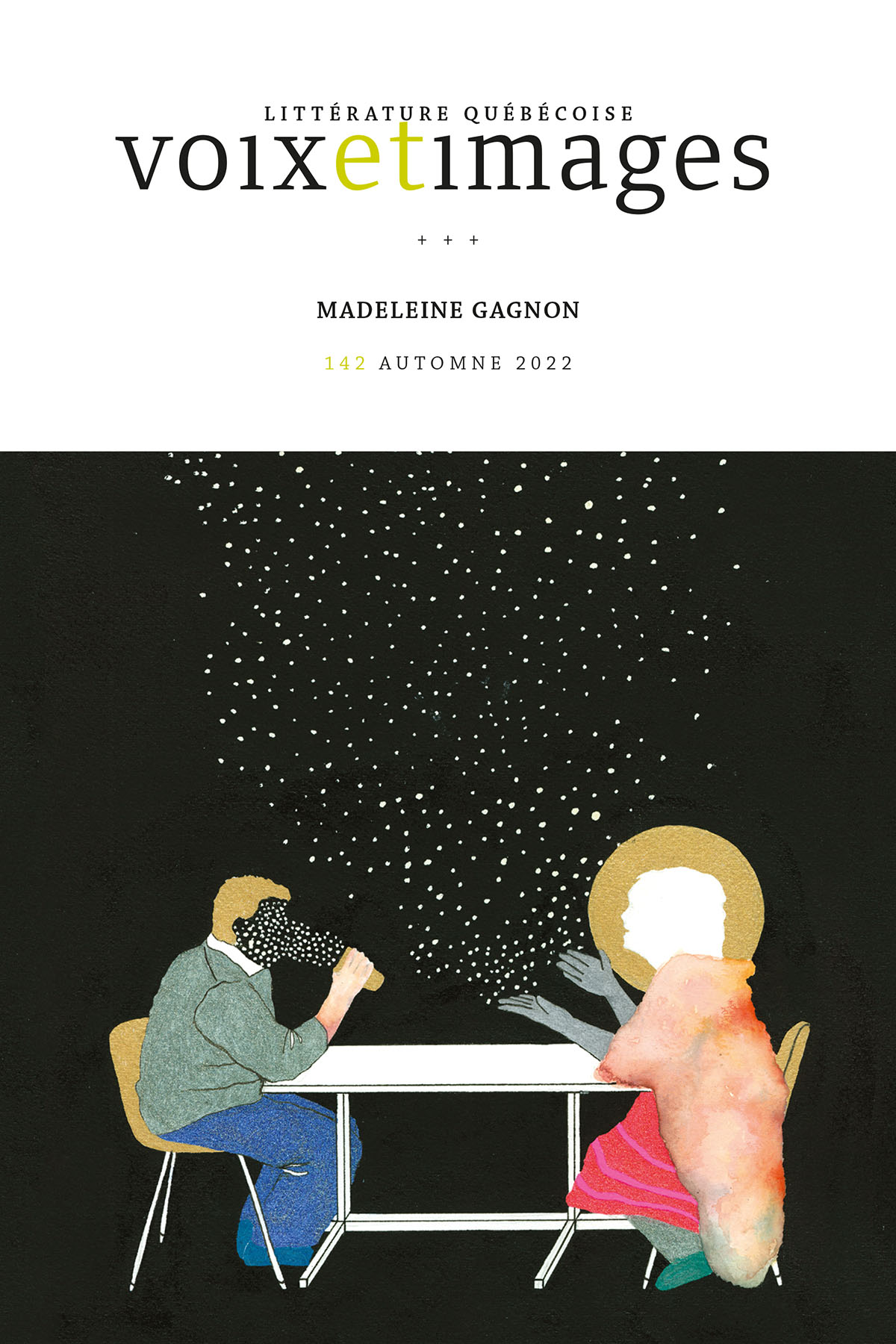Abstracts
Résumé
Cet article porte son attention sur les textes essayistiques de Madeleine Gagnon afin de rendre compte d’un sujet du féminisme confronté à sa propre fin. Retraçant, à travers son oeuvre, les affiliations poétiques et rhétoriques de Gagnon à un féminisme dit de « deuxième vague », l’autrice tend à situer et à circonscrire l’effet, sur son écriture, du changement de paradigme que provoque l’avènement d’un féminisme de « troisième vague ». Elle considère les textes à l’aune d’une histoire des idées mobilisée par le concept de la « fin du féminin », limite conceptuelle qui met Gagnon face aux considérations de finalité et de finitude. Cette limite s’avère déterminante pour son écriture. Paradoxalement, le « féminin » se révèle à la fois vecteur d’absence, de disparition, de mort et principe créatif, en ceci qu’il est la condition même de l’écriture de Gagnon.
Abstract
This article examines essays written by Madeleine Gagnon in order to reflect on the subject of feminism confronted with its own demise. Retracing, through her work, the poetic and rhetorical affiliations of Gagnon with a feminism of the so-called “second wave,” the author attempts to locate and define the effect on Gagnon’s writing of the paradigm shift that provokes the advent of a “third wave.” The texts are considered in terms of the history of ideas mobilized by the notion of the “end of the feminine,” a conceptual boundary that brings Gagnon face-to-face with issues of finality and finiteness. This boundary turns out to be a determining factor in her writing. Paradoxically, the “feminine” reveals itself to be both a vector of absence, disappearance, and death, as well as a creative principle, in that it is the very condition of Gagnon’s writing.
Resumen
Este artículo se centra en los textos ensayísticos de Madeleine Gagnon para abordar un tema del feminismo enfrentado a su propio fin. Tras rastrear, a través de sus obras, las filiaciones poéticas y retóricas de Gagnon con el llamado feminismo de la "segunda ola", la autora trata de situar y circunscribir el efecto que tuvo en su escritura el cambio de paradigma provocado por la llegada del feminismo de la "tercera ola". Considera los textos a la luz de una historia de ideas movilizada por el concepto del "fin de lo femenino", límite conceptual que enfrenta a Gagnon con consideraciones de finalidad y finitud. Este límite aparece como decisivo para su escritura. Paradójicamente, lo "femenino" es a la vez un vector de ausencia, de desaparición, de muerte y principio creativo, ya que es la condición misma de la escritura de Gagnon.
Article body
NOTE 1. ANACROUSE : DEVANCER LA FIN DES TEMPS
Dans le texte éponyme[1] qui ouvre le recueil Donner ma langue au chant, l’écrivaine et essayiste québécoise Madeleine Gagnon raconte un voyage en train. Elle rapporte le bruit des rails et de la locomotive, le paysage qui défile aux fenêtres, ses pensées sur le temps qui passe. Elle décrit aussi la rencontre fortuite avec un jeune homme, lecteur d’Albert Camus, et leur échange passionné fait de considérations existentialistes et nihilistes. Pendant que le jeune homme s’absente momentanément pour aller à sa cabine, soi-disant pour chercher des notes de lecture qu’il désire faire lire à Gagnon, le train s’arrête abruptement : « Mon jeune homme s’était jeté en bas du train. C’est ce qu’on finit par nous dire. Il était mort. L’entretien interrompu fut soudain tout effacé[2]. » Pour Gagnon, le suicide du jeune homme est paradigmatique : « Mon beau jeune homme du train était devenu ce non-futur qu’il m’avait annoncé. » (D, 2010, 17) Ce texte inaugural propose une réflexion sur le temps de l’écriture, sur ce geste qui persiste au moment où « la parole s’absente » et qu’apparaît « le mur infranchissable en mots et intraduisible de la mort ». Il interroge la forme que peut prendre le langage quand le Logos est au seuil de son impossibilité. « Donner ma langue au chant » suit en ce sens l’impératif que se donne la narratrice de considérer la fin : « La fin comme finalité, mais aussi la fin comme finitude. » (D, 2010, 19) Si l’on imagine le train comme allégorie du mouvement sans faille du Logos, la mort de l’homme figure ici la condition temporelle de cette femme menacée par l’arrêt du train comme arrêt de mort de l’écriture. Il est possible de lire cette irruption d’absence en ce qu’elle est ce qui, chez l’autrice, finit par la dire.
L’oeuvre de Gagnon émerge dans le contexte de la révolution sexuelle, contexte où certaines philosophes et théoriciennes féministes réfléchissent à la condition temporelle des sujets féminins dans un monde circonscrit et délimité par l’Homme (à comprendre à la fois comme entité conceptuelle et comme agent social et historique) ; une condition définie par l’exclusion des femmes de l’ordre sociosymbolique et qui détermine la possibilité de leur présence et de leur manifestation dans le réel[3]. Ancrée au coeur des contraintes matérielles qui sont celles de son époque, l’écriture de Gagnon prend son origine et se déploie depuis cette absence structurelle qui a longtemps été dévolue aux femmes. Une hantise de la fin circule ainsi dans son oeuvre comme ce qui signale une préoccupation pour la mort, mais aussi la précarité d’une prise de parole au féminin menaçant toujours de la renvoyer à la non-reconnaissance initiale. Donner ma langue au chant, qui réunit ses textes théoriques les plus importants publiés après 2000, est habité par cette inquiétude et s’ouvre sur le présage d’une fin prochaine : « Alors qu’il me reste peu d’avenir somme toute, on me demande de parler de futur. » (D, 2010, 11)
En lisant les essais de Gagnon à l’aune des discours de la fin[4], et en les faisant se rencontrer comme dans une sorte de pli temporel que je produis ici, il apparaît que les enjeux du sexe et du genre, à la fois produits et déconstruits par le féminisme et les gender studies, déterminent certaines finalités de son écriture. Autrement dit, le féminin et la fiction « Femme » figurent le seuil tragique du Logos. De fait, j’avance que la fin fonctionne rhétoriquement et poétiquement à l’intérieur des textes de Gagnon de manière à manifester les bornes du féminin et que cette condition langagière liminaire donne à penser ce qu’entretient le féminin avec une fin des temps. Si la mort, l’absence et la disparition sont des thèmes qui parsèment son oeuvre ; s’ils ont servi à penser le déploiement de l’écriture elle-même depuis ces réserves négatives ; s’il est possible, enfin, de supposer que tout·e écrivain·e en vient à circonscrire le lieu d’achoppement de la parole au moment où se rapproche le terme d’une carrière ou bien celui d’une vie, force est de constater que chez Gagnon la « fin » excède ces considérations générales en ce qu’elle concerne la question spécifique du féminin. Entre ses premiers textes essayistiques datant des années 1970 et ceux des années 2000, colligés dans deux recueils auxquels je me référerai, Autographie, t. II : Toute écriture est amour (1989) et Donner ma langue au chant (2011), se trace la question du féminin comme ce qui serait aux prises avec l’imminence de sa propre disparition. Le féminin avance vers une fin qui délimite la condition de la parole, la « venue à l’écriture » des femmes et de Gagnon elle-même : « C’est ici, au seuil de cette impossibilité, que point le rêve de l’écriture […]. » (D, 2010, 12) Chez Gagnon, qui conçoit la finalité de son écriture comme ce qui « rempl[it] de mots ce vide, imagin[e] derrière la mince ligne d’horizon muette, oeuvr[e] sur le terrain de l’absence » (D, 2010, 19), le féminin donne à penser les moyens (stratégiques) des sujets pour intégrer le champ de l’existence (historique, sociale, politique, juridique, symbolique, etc.). Il invite à formuler et à admettre l’hypothèse de sa finitude en ce qu’il porte en lui sa propre mort : « Il y eut comme un goût de désastre dans ma bouche de cendres. Il y eut comme un avortement de mots. Dans ce fracas silencieux, je ne pouvais imaginer un avenir de mots et de paroles ni rêver un futur comme cela se fait toujours d’une bouche à l’autre quand la vie se met à l’oeuvre de parler. » (D, 2010, 17) Considérant que la déconstruction du féminin opérée par la philosophie et les études de genre a problématisé la possibilité de son épuisement comme signifiant, une attention aux écarts temporels et aux effets de distance dans les textes de Gagnon rend compte d’un sujet féministe luttant contre sa fin. Cette proposition invite à interroger les différents « temps » de ce sujet à travers une histoire des idées du féminisme qui se trame dans les écrits de Gagnon et qui témoigne de la précarité de l’énonciation de celle qui se risque à l’écriture. Je tenterai ici de faire ressortir les tensions théoriques, esthétiques et politiques qui se présentent momentanément comme autant de limites, mais qui s’avèrent le principe d’un déplacement de ces fins, mouvement qui définit peut-être chez l’écrivaine une condition de la parole féminine.
NOTE 2. LES DISSONANCES DE L’ÉCRITURE FÉMININE
Qui s’intéresse au parcours de Gagnon notera que les mouvements contestataires des années 1970, en particulier le combat féministe, ont autorisé une prise de parole. La nécessité de la libération sexuelle au tournant des années 1970 coïncide avec une libération de la parole[5] et, encore, dans son acception (post) structuraliste, à une « libération du signifiant » : « The liberation of the signifier, the rebellion against idealist repressions, and the unleashing of the forces of difference and desire against the law and order of identity[6]. » Selon Barbara Johnson, qui se réfère aux travaux de Luce Irigaray, d’Hélène Cixous et d’Alice Jardine pour penser ce moment de la théorie française, l’une des lignes de combat déterminantes de l’époque a été celle qui liait les questions d’autorité et de domination discursives aux politiques sexuelles. C’est en accord avec cette conception – laquelle problématise l’exclusion des femmes des institutions littéraires et universitaires comme le fait d’une structure symbolique binaire basée sur la différence sexuelle – qu’émerge le désir et la possibilité même de l’écriture de Gagnon. En effet, l’écriture est pensée comme le champ de bataille féministe pour l’avènement des voix féminines longtemps tenues dans un mutisme culturel. C’est au moment où « [l]e mouvement féministe en est à ses toutes premières armes, où la lutte des femmes est loin de rallier les masses[7] » que Gagnon répond de cette nécessité (qui ne va pas sans la réjouissance du sentiment libérateur) d’inscrire au coeur de la langue la marque du féminin.
La « venue à l’écriture » des femmes (pour reprendre la locution de cette oeuvre collective de 1976 dans laquelle Gagnon écrit aux côtés d’Hélène Cixous et d’Annie Leclerc) se fonde sur le « procès du logocentrisme » (T, 1975, 124) :
[La parole,] prenons-la, nettoyons-la de toutes ses aliénations, reconnaissons ses marques phalliques et ajoutons les nôtres qui la feront déborder de toute part ; ajoutons le double du sexe qui manque ; faisons notre marque […]. [L]’éveil de notre sexe se poursuit : car il fut refoulé par les mâles, il fut par nous, d’une certaine façon, camouflé[8] […].
Cette initiative et cet appel à la révolution féministe et marxiste, figurée comme un éveil de conscience sexuelle, participent d’un désir de ce « féminisme de la différence » d’en finir avec la position féminine traditionnelle. Ce que Gagnon nomme la « femme phallophore » (T, 1977, 80) constitue la forme idéalisée du féminin de l’ordre symbolique dominant qui ne fait que le reléguer, et les femmes avec lui, hors des champs de la Raison et du Logos.
S’en prenant au phallogocentrisme, tantôt sur le terrain de la psychanalyse, tantôt sur celui de la philosophie, Gagnon se rallie à celles qui parlent à l’envers de l’ordre établi et se « situe[nt] du côté des écritures féminines » (T, 1975, 134). À l’instar de ce que proposait déjà Jacques Derrida lorsqu’il opposait l’écriture à la parole et réfléchissait au féminin comme vecteur d’altérité, Gagnon considère la qualité et le potentiel du féminin. En raison de son statut d’exception et d’exclu, celui-ci définit la possibilité même de l’écriture à l’encontre du système symbolique et politique dominant. Si elle s’engage, en déconstructionniste, à « retracer le chemin de toutes les chaînes signifiantes, chaînes de l’esclavage phallocentrique » (T, 1975, 63) et à « ajout[er] des signifiants nombreux au signifiant Phallus » (T, 1975, 134), Gagnon soutient néanmoins que « ce que Derrida n’a pas vu, [c’est] le phallocratisme » (T, 1975, 135), à savoir les effets matériels, sociaux et culturels de la domination masculine. À cet égard, pour rendre manifeste et politique cet oubli de la philosophie, l’écriture féminine à laquelle souscrit Gagnon prend pour matière première le corps : « La libération des femmes, ça veut dire la parole du corps » (C, 86) ; « Comme des millions de femmes, je veux inscrire mon corps en lutte. » (C, 63) Attendu qu’en vertu de l’ordre traditionnel du discours, l’« accès [du féminin] au symbolique coïncide avec son exclusion » (T, 1977, 81), et qu’« une grande partie de l’histoire, pour ne pas avoir été pensée et écrite par [les femmes], s’est figée dans la mémoire du corps femelle » (C, 63), l’écriture féminine va dans le sens de l’inscription de cette non-pensée du sexe féminin. Selon cette logique du supplément et du retour du refoulé (T, 1975, 30), par laquelle on ajoute au discours ce qui a toujours et déjà manqué à sa structure, l’écriture féminine fait place à l’inquiétude et à l’étrangeté de celles qui, dans le tout harmonieux des conventions, dissonent, dérangent, défont :
Elles revendiquent pour tous. Elles atteignent le coeur du double, de la doublure, du logocentrisme. Elles ajoutent des signifiants nombreux au signifiant phallus. Un, deux, trois autres signifiants. Elles ne simplifient pas. Elles multiplient. Elles atteignent l’Autre du phallus en sa Loi même. La Loi du père. La loi de l’ordre. Le nom du père. Elles s’attaquent à l’ordre du langage tellement qu’elles passent pour folles. Elles rient. Elles revendiquent un droit au symbolique. Refoulées de l’histoire, elles ont compris l’ordre des interdits pour y avoir servi dans l’échange comme nombre. Elles ne sont plus dans le refoulé ou n’y veulent plus s’y mourir. Ne sont plus les représentées. Le miroir, le fantasme de l’autre.
C, 106
En l’absence de « modèles historiques » (C, 89), l’altérité féminine se présente alors dans et par l’écriture comme vecteur révolutionnaire, au sens marxiste et tel que le conçoit la théorie sémiotique de Julia Kristeva[9]. Si cette dernière est intéressée par les effets poétiques qui participent à définir une révolution du langage et moins par les intérêts politiques, voire idéologiques, véhiculés par les énoncés, Gagnon et ses alliées de l’heure inventent une écriture comme un véritable programme ; écriture dont la rhétorique communautaire, qu’exemplifie plus que tout autre usage celui du « nous », est mue par le rêve de la création et de la réinvention : « Il nous faut réinventer […] [n]on pas le désir – sans quoi nous ne serions aucun langage – mais ses formes : ses paroles et ses gestes » (C, 68) ; « C’est à nous d’afficher ce qui fut longtemps l’autre côté, le dissemblable, le dedans, l’obscur, la nuit océan. » (C, 103-104)
NOTE 3. LES CONTRETEMPS DU SUJET FÉMINISTE
Dans son texte « Pourquoi, comment, pour qui écrire », Gagnon aborde l’essoufflement dans les années 1970 de la communauté littéraire, qu’elle désire, imagine et rêve militante : « Dans une époque de temps du creux de la vague, il est normal que les diverses luttes menées par différents groupes donnent l’impression d’émiettement, de forces atomisées, rivales et conflictuelles. » (T, 1975, 135) Tentant de faire sens des tensions entre socialisme et féminisme – deux mouvements dans lesquels s’engagent la pensée et l’écriture de Gagnon et qui divisent la communauté militante de l’époque en autant de clivages idéologiques, en ce qui concerne, entre autres, la fin de l’inégalité des sexes –, elle pressent un second creux, celui qui met cette fois en tension deux « vagues » du féminisme.
Lors du colloque « Un genre malgré tout. Pour une réflexion sur la différence sexuelle à l’oeuvre dans l’écriture », organisé en 2004 par Catherine Mavrikakis et Patrick Poirier à l’Université de Montréal, Gagnon présentait un texte s’intitulant « Entre grammaire et désir, quel est mon genre ? », dans lequel elle se prononce sur l’actualité du féminisme. Si elle mentionne d’emblée la notion d’écriture féminine qui a été pour elle, au tournant des années 1970, un vecteur créatif et militant vers « la reconnaissance d’absence, de fulgurantes intuitions figurant, à l’horizon de l’humanité pensante, l’inscription, enfin, du sujet femme dans l’ordre du discours : celui de la loi et du désir » (D, 2006, 97), c’est surtout la rencontre, ou plutôt le conflit, entre un certain féminisme (de deuxième vague) et l’arrivée sur la scène intellectuelle des gender studies qui est l’objet de ses préoccupations[10]. Alors que l’on sent bien dans ce texte le travail de la réflexion, par le parcours qu’elle trace de sa propre histoire en littérature et l’évocation de références (littéraires, psychanalytiques, philosophiques) qui ont été fondamentales pour l’avènement de sa propre écriture, on constate la méfiance que provoque chez elle ce changement de paradigme.
De fait, dans ce texte qui se démarque par sa posture quelque peu réactionnaire, nous retrouvons l’instance contre laquelle se positionne l’autrice – ici les études de genre – et un scepticisme qui met l’écriture en mouvement. Annonçant, avec une ruse rhétorique, qu’elle ne détient pas « les compétences pour [s]’avancer bien à fond sur le territoire des gender studies[,] [n]i les aptitudes, ni à vrai dire, le goût » (D, 2006, 101), et que « [s]a volonté n’est pas de jeter l’anathème sur l’ensemble des gender studies » (D, 2006, 104), elle leur attribue néanmoins un dessein et des répercussions épistémiques pour l’avenir d’une pensée du féminin, se risquant ainsi à la généralisation. Nous ne savons pas qui ni quelles théories évoque Gagnon dans son texte ; nous ignorons si elle se réfère à un corpus particulier ou si elle y va d’une disqualification unilatérale de ce en quoi elle ne parvient pas à se reconnaître (elle associe, en effet, l’apparition des gender studies à une « inquiétante étrangeté » [D, 2006, 101]). Toujours est-il qu’elle en a contre une « injonction récurrente » des gender studies « à démasquer dans les textes l’appartenance ou l’orientation sexuelles, à les classer, les classifier selon les nouvelles catégories fixes et stables qui comprendraient l’hétérosexualité, l’homosexualité, la bisexualité et la transsexualité » (D, 2006, 102). Elle redoute les « récentes barrières inamovibles » (D, 2006, 102 ; je souligne), l’« obsession de l’identification sexuelle », ou encore la « rage d’identification claire et fixe » (D, 2006, 103 ; je souligne) et la « gangue naturaliste et biologiste » (D, 2006, 104) dans laquelle se complairaient ces nouvelles théories. Face aux « insondables corollaires des avancées vertigineuses » (D, 2006, 102) auxquelles elle a participé au courant des décennies passées se présente cet « immense contrecoup sous forme de diverses tentatives de rapatriement et de re-naturalisation d’un continent où le féminin, tant celui des hommes que celui des femmes, venait de trouver sa voix » (D, 2006, 102-103). En effet, elle dénonce le bannissement (D, 2006, 103) du sujet féminin des nouveaux lieux de la théorie, avançant que « [p]our traverser la frontière des gender studies, il faudrait produire le passeport de la sexualité, appartenance et orientation estampillées » (D, 2006, 103). Elle conçoit que l’émergence de ce champ a été, d’une certaine manière, le résultat d’une mise au rencart du féminin, de son « retour au foyer, au tournant de l’an 1990 » (D, 2006, 101), et de celui de ses soeurs d’armes[11]. En cela, le « nous » qu’elle oppose à cette nouvelle communauté, un « nous, artisans de l’écriture, quel que soit son genre, [qui savons] que ni les corps organiques ni les corps ou corpus textuels n’atteindront la transparence et la limpidité du repère enfin débusqué » (D, 2006, 103-104), est soutenu par un idéalisme aux prises avec son propre déplacement.
En effet, entre le premier et ce dernier moment de la pensée de Gagnon se dessinent le rêve et l’idéal d’une écriture du corps qui n’aurait rien à voir avec le positivisme de la biologie, l’anatomie ou l’identitaire. Le corps féminin et son émancipation seraient à comprendre comme un effet des fantasmes et des luttes historiques qui en viendraient à définir les sujets femmes en fonction de rapports négatifs d’exclusion. Elle s’accorde en cela avec Kristeva qui, dans « Le temps des femmes » (1979), suggère que c’est lorsqu’une égalité fait problème qu’elle « apparaît essentielle pour le combat de la nouvelle génération[12] » du féminisme. Autrement dit, la « femme » ne fait sens (comme signifiant) que du moment où l’égalité est en souffrance. Cette formulation donne à penser l’essence féminine ou bien le sujet « femme » comme l’effet ou encore le symptôme du sexisme[13]. Par ailleurs, dans ce texte, qui surgit au moment d’un essoufflement militant et d’une remontée du conservatisme social et politique en Occident, et dans lequel elle pressent (comme un souhait) « l’épuisement du féminisme comme moment de la pensée[14] », Kristeva souligne « [l]a cohérence apparente que revêt le terme de “femme” dans l’idéologie culturelle […] [qui] efface les différences entre les fonctions ou structures qui agissent sous ce mot[15] ». Suivant cette élaboration, la disparition de la « femme » qu’appréhende Gagnon pourrait être liée à un apaisement de tensions autour desquelles se jouent les combats du moment. Ainsi, nous pouvons situer la voix de Gagnon dans « Entre grammaire et désir, quel est mon genre ? » au seuil de cette disparition. Parlant depuis le lieu du féminin épuisé, de sa fin imaginée, de cette absence qui est, en fin de compte, le giron de son écriture, Gagnon lutte avec son propre fantasme autoritaire dont le féminin a pu, à une certaine époque, être le creuset.
NOTE 4. TEMPS MORT DE L’AUTRICE
Au conflit générationnel que catalyse l’émergence des gender studies (et au coeur duquel Gagnon s’inscrit en début de texte) s’ajoute le conflit culturel. Gagnon est partie prenante du mouvement féministe québécois, lequel, il faut le noter, se distingue de ce qui a cours en même temps en France et aux États-Unis par son évolution, son vocabulaire et sa spécificité nationale, en particulier à partir des années 1970[16]. Ce qui constitue le « féminisme radical » du Québec se veut plus englobant, « pens[ant] ensemble ce qui, en France, se vivait de manière clivée, soit le féminisme matérialiste et le féminisme de la différence sexuelle[17] ». Or, du fait peut-être d’une éducation ou d’une affinité intellectuelle, ou bien simplement d’un attachement à une conception de l’écriture qui procède depuis l’enjeu symbolique de la différence sexuelle, Gagnon résiste au geste englobant et montre un attachement pour la tradition française, en particulier pour le travail d’Hélène Cixous[18]. L’arrivée et la popularité des gender studies viennent troubler la manière dont le féminisme, celui de Gagnon en particulier, se pensait jusqu’alors. Le foyer principal de ce nouveau champ d’études se trouve aux États-Unis, cette nouvelle tradition se fondant et se construisant donc d’abord en anglais. Ce qui happe Gagnon paraît être le retour d’une autre impossibilité, laquelle tombe sur une écriture s’étant jusque-là déployée à partir d’une certaine définition française et francophone du féminin. À ce propos, elle souligne la prérogative du sujet anglophone de s’exprimer dans « une langue neutre, contrairement aux langues latines, faites de déclinaisons et d’accords selon le genre grammatical. Mis à part le “She” et le “He”, désignant elle et lui, la neutralité de l’anglais [a] pu favoriser l’accueil du sujet féminin, décentré, clivé et soumis, comme tout sujet », affirmant que « le contraire s’est produit du côté des gender studies » (D, 2006, 103). Gagnon touche ici à ce qui se joue en français entre le genre et le langage, où se confondent les préoccupations éthiques et politiques du parler « en tant que » et les normes grammaticales[19]. Selon elle, le genre féminin de la langue française fonctionne comme un « instrument de domination » et d’exploitation sexuelle qui réitère la différence sexuelle, autant sur le plan des structures sociales que dans la matérialité des corps parlants. L’écrivaine note que, pour cette raison, la langue ne peut être une « amie, que dis-je, maîtresse, puisque l’histoire en fait une rivale, dans ses codes (grammaticaux, syntaxiques, stylistiques) appris/transmis dans un dressage aux références quasi toujours mâles » (T, 1975, 60)[20].
La condition de possibilité de l’énonciation et l’autorité du sujet féminin s’envisagent donc à l’intérieur du problème de la traduction théorique[21]. Dans « Réplique à Sarah Kofman », Judith Butler répond à la critique française de ladite « posture identitaire à l’américaine[22] », critique représentée par Kofman, mais à laquelle nous pouvons associer Gagnon en ce que les deux se positionnent de façon similaire par rapport à cette question (en raison, sans doute, d’un héritage, d’une méthodologie et d’une expérience apparentés). L’un des « reproches » qui ont été adressés aux théoriciennes américaines est d’avoir été de mauvaises lectrices de la French Theory[23], particulièrement de la psychanalyse[24]. Butler se réfère aux écrits de Jacques Lacan pour nommer les éléments du malentendu :
Je me souviens de cette phrase de Lacan […] dans laquelle ceux qui échouent à comprendre le Phallus comme signifiant privilégié sont caractérisés, d’abord, comme « culturalistes », puis comme « féministes » et, donc, comme l’évidente conséquence de la dégradation de la psychanalyse quand elle a atterri sur le sol américain[25].
Le noeud de cette guerre culturelle se forme aussi, à l’envers du Phallus, autour du sens du « féminin » et de son usage dans les théories psychanalytiques (et celles qui s’en inspirent) et féministes, soit en fonction de son acception comme instance symbolique ou comme genre social[26]. Selon qui en parle, on accuse l’idéalisation ou l’abaissement du terme[27]. Butler signale que ceux qui tendent à disqualifier le féminisme américain le font sur la base de l’usage politique du féminin, en tant qu’il sert « une certaine version de la politique de l’identité, celle qui fait que toute analyse est précédée de la déclaration d’une position identitaire, la déclaration “Moi, en tant que femme…”, “Moi, en tant que féministe…”[28] ». La position identitaire obéirait à la même logique qu’une métaphysique de l’identité (essentialisme), « ré-autorisant la fermeture même du concept ainsi que la fixation sémantique du féminin en tant qu’identité que […] l’écriture féminine cherche à déplacer[29] ». Paradoxalement, « en revendiquant de “parler en tant que femmes”, [les féministes américaines] parlent, de fait, comme des hommes, c’est-à-dire métaphysiquement[30] ». C’est une rhétorique que l’on rencontre chez Gagnon, laquelle se fait critique des « femmes phalliques » « revendiqu[a]nt l’égalité avec l’homme, mais avec l’homme qui possède, dirige et contrôle » (T, 1975, 31) et qui sont « mâle[s] à force de [s]e reconnaître et de [s]’affirmer femelle[s] » (C, 67). Dans cette logique, on reproche à qui défend une identité (sexuelle) de reproduire la dynamique d’autorité qu’on associe à la domination. On lit celui ou celle qui parle « en tant que » comme un sujet qui se leurrerait lui-même de la fiction identitaire. Sans faire l’impasse sur le caractère paternaliste d’une telle remarque, je relève la prérogative de ceux qui circonscrivent l’espace sémantique du féminin et la valeur de ses occurrences, et qui ferait que le féminin serait condamné à ne jamais signifier, à ne jamais référer. C’est dans les années 1960 que le féminin est devenu, à travers son articulation dans la théorie de la déconstruction, une instance de l’impossibilité de la référentialité. Il a été conçu comme un signifiant fuyant, déplaçant la prétention métaphysique de lisibilité. La notion d’auteur et d’autorité se retrouve problématisée à l’endroit même du référent : l’autorité, en tant que relation d’identité entre un texte, l’auteur et son intention, est déconstruite. L’écriture féminine à laquelle s’attache Gagnon a ainsi été le terrain d’expérimentations et de résistances symboliques féminines et féministes contre les normes institutionnelles et patriarcales qui ont traditionnellement circonscrit les usages du langage et défini par là même l’autorité[31].
En quoi le « nous/femmes » des textes de Gagnon échappe-t-il à l’écueil référentiel dans lequel tomberaient les gender studies ? Il semble que l’un des rêves du féminisme auquel participe son écriture est la possibilité de parler et d’écrire « comme femme », mais sans autorité. Bien qu’il y ait un pouvoir à camper le lieu de l’aporie, il s’agit peut-être d’un piège que d’y voir une fonction particulière du féminin. Cette posture privilégiée que la déconstruction lui a octroyée, qui provient d’un renversement structurel de l’espace négatif où la métaphysique l’avait confiné, reproduit néanmoins, dans une perspective pragmatique et éthique, une division sexuelle. Ce que Butler nomme une « fixation sémantique du féminin » sur laquelle se fonde le conflit franco-américain réinvoque d’une certaine manière la même binarité qui priverait les sujets minoritaires d’une autorité et, par extension, d’une existence dans les discours. Nonobstant le caractère de l’autorité féminine dans l’écriture de Gagnon, l’énonciation féministe demeure liée à l’impératif d’une prise de parole qui ne peut échapper entièrement à l’intentionnalité. À l’instar de Johnson qui suggère de considérer les différents types d’intentionnalité (comme forme d’autorité discursive) lorsqu’on invoque le « en tant que » pour situer un texte[32], il est possible d’envisager le féminin comme ce qui porte le désir d’autorité du sujet chez Gagnon.
En effet, se situant au confluent des rhétoriques du féminisme, du marxisme et de la psychanalyse, la pierre angulaire de la démarche et des espoirs de Gagnon réside dans la notion de désir, dont elle cherche continuellement à repenser et à renouveler l’usage. Selon elle, tout discours à portée émancipatrice doit avoir en son centre le désir : « Si les femmes – et même les plus “savantes” – utilisent de plus en plus ce que l’on nomme, à défaut de mieux, fiction, c’est que jusqu’ici ce mode d’écriture (et de parole) est le seul qui puisse redonner au discours ce qu’il y a en nous tous de pulsions, fantasmes et désirs. » (C, 83)
NOTE 5. POINT D’ORGUE DU FANTASME FÉMININ
La parution du texte « Entre grammaire et désir, quel est mon genre ? » coïncide avec l’avènement dans le monde littéraire de ce genre que l’on a nommé l’autofiction. Cooccurrente des mutations politiques et culturelles entourant les identités sexuelles, influencée par l’épidémie du sida qui a donné naissance à toute une tradition d’écritures dites confessionnelles, l’autofiction a problématisé l’usage du « Je » et produit une redéfinition du rapport entre l’auteur et le texte. Elle a permis, sur le terrain du féminisme, de repenser l’engagement politique à même l’écriture de l’intime et d’actualiser l’adage « le personnel est politique » selon cette nouvelle focalisation. Suspicieuse d’un « Je » qui se leurrerait de sa propre performance, craignant que le « délire narcissique » ne réduise l’écriture à de l’anecdotique[33], Gagnon interroge la « tentation autobiographique » (T, 1986, 168)[34] qu’elle soupçonne dans cette écriture où s’affirme la diversité sexuelle. L’opposition sujet/identité, qui se répète dans l’opposition fiction/autobiographie, est peut-être une fausse opposition, mais elle marque néanmoins une autre impossibilité chez Gagnon, et certainement un malentendu, puisque cette nouvelle écriture du « Je » qui jaillit au tournant des années 1990 lui paraît menacer un idéal de la parole poétique.
De fait, elle en a contre ces postures d’écriture qui reposent sur l’identité du « Je » de l’écriture et celui de l’écrivain, les accusant d’être du côté du désir phallique et affirmatif de la prise de pouvoir. Pour elle, la révolution (sexuelle, des classes) ne doit pas reconduire le pouvoir et le désir du pouvoir qui sont au fondement de la domination patriarcale. Or, Gagnon fait l’expérience des limites d’un tel principe lorsqu’elle parle en son « Je » et convoque les références biographiques : « Quand on vient d’où je viens, tous les espoirs sont permis. » (D, 2006, 104) Comment penser cette énonciation féministe qui la fait « parler de son métier comme (de) femme » (ibid.) ? La posture de Gagnon, qu’elle conçoit comme une véritable « prise de position » (ibid.), réfléchit un « Je » comme construction fantasmatique. Il est une fiction, une « prétention » et la « revendication d’une interpellation » (ibid.) qui repose sur le désir d’autorité en tant que présupposé de la parole subjective. Forte de son héritage psychanalytique, l’écrivaine adhère à la conception d’un sujet clivé, clivage qu’elle situe au lieu même du sexe : « Je suis double sexe » (C, 67) ; « Nous sommes deux en chacun de nous. […] Je ne peux libérer mon sexe sans le tien en ce que nous sommes inextricablement liés dans une histoire de représentations de nos corps comme objets ; dans une histoire d’idéologies parcellaires où jusqu’ici le phallus fut parcelle principale. » (Ibid.) Ailleurs, cette position est soutenue par l’aphorisme rimbaldien « Je est un autre » (D, 2008, 113), qui nomme la pluralité fondatrice de toute singularité, un langage toujours habité par la langue de l’autre. Méfiante à l’égard de tout discours affirmant un « JE individualisé qui n’a de cesse la tentation de [saisir le monde] en une entité transparente », elle assure « qu’il n’y a aucune adéquation possible entre ce JE et cet AUTRE ». Dans l’écart qui se creuse entre ces deux instances jaillissent les métaphores, « ces embrayeurs déplaçants de la langue » à l’origine de la création (D, 1992, 73). Qui plus est, elle se réfère ponctuellement dans son oeuvre à Michel de Montaigne, qui suppose comme principe d’écriture de ses essais la précarité du « Je », lequel ne peut se penser que dans la mesure où il est mis en scène par l’écriture :
La subjectivité est le motif de l’écriture poétique. L’objectivité celui de la quête sociographique. Quête « d’estude » et d’« artifice » nous dit Montaigne. Quête vaine et « frivole », si c’est « moy » humblement que « je peins » et si, de façon « ordinaire et simple », je deviens moi-même, sujet et objet de mon art, si « je suis moy-mesure la matière de mon livre ».
T, 1984, 116
Affirmant que « toute écriture de fiction (poésie ou prose) et, en grande partie l’écriture de l’essai, est bel et bien autobiographique, avec plus ou moins de nuances et de raffinements dans les stratégies de dévoilement (et de voilement) » (D, 1990, 46-47), Gagnon considère l’écriture du « Je » comme un enjeu subjectif plutôt qu’identitaire. Autrement dit, l’écriture émerge au lieu même du clivage d’un « Je » qui se fantasme lui-même, d’un « Je » différant toujours de cette fiction idéelle, identitaire, qu’il tente de représenter.
Situant cette question, qui s’adresse en elle-même à tout sujet parlant, du côté du féminin et de la sexualité féminine, l’autrice s’avance dans une réflexion qui tient compte de l’écart privant les femmes des conditions de possibilité de leur énonciation en vertu de considérations matérielles. Elle soutient que les fantasmes dépendent et découlent des conditions matérielles des sujets féminins, du lieu que ces derniers occupent dans le réel, ou duquel ils sont exclus. Dans un essai sur le roman érotique Histoire d’O de Pauline Réage, Gagnon souligne l’importance des récits érotiques et des fantasmes en ce qu’ils « disent à leur façon la guerre des sexes » (T, 1976, 43). Il est essentiel, nous dit-elle, d’avoir recours à ce prisme en ce que les fantasmes, qu’ils soient de domination, de soumission, de sadisme ou de masochisme, loin de reproduire l’oppression des femmes, éclairent sur ce qui a cours dans le réel et dans la sphère sociale ; aussi, la violence ainsi sublimée par l’écriture nous informe sur l’inconscient social : « Comment imaginer, si nous avons été dominées sur toutes les autres scènes par la politique du mâle, que notre sexualité seule aurait échappé au partage ? Comment imaginer une sexualité spontanée, isolée, libre de toute contrainte, toute attache ? » (T, 1976, 44) En effet, « [l]es fantasmes ne naissent pas tout seuls ; les conditions matérielles d’existence des individus fournissent les images qui forment le discours inconscient » (T, 1975, 68). Gagnon persiste, convaincue que lorsque les conditions historiques changeront, l’inconscient changera (ibid.).
Prendre ainsi le parti de la fiction comme lieu fondateur de l’énonciation est une posture féminine, féministe. Puisque la fiction « Femme » a permis de définir les femmes comme Autres du langage, elles ont historiquement occupé les marges et les zones infralangagières, celles des « commérages » (T, 1975, 135), du « bavardage », du « placotage », d’histoires romanesques et sentimentales, et de la fiction (T, 2006, 100). Ainsi Gagnon croit que « les paroles de femmes ramèneront à sa juste place la fiction, à savoir que rien de ce qui se dit librement – fantasmes et rêves – n’est fictif » (T, 1975, 29). Autrement dit, leur relation privilégiée et différentielle à la fiction a octroyé aux femmes un savoir préalable qui reconnaît son effet dans le réel. Une telle perspective repose sur une conception du pouvoir politique du fantasme – comme Cixous écrit dans La jeune née que « les fantasmes s’effectuent[35] » –, et sur les « risques théoriques » (T, 1975, 147) que cela implique. Dans cette optique, le féminin est peut-être plus à même de signaler la précarité du « Je » du fait de la suspicion entourant son énonciation et toute revendication se faisant en ce sens. Le procès du sujet auquel s’adonne Gagnon, procès du « en tant que » de la parole des femmes, montre avant tout la redéfinition de la posture féminine selon le temps et le lieu qu’il occupe. Elle montre que le féminin « veut dire » autre chose dans la quête vers la subjectivité. Ce désir et ces fantasmes en amont de la prise de parole définissent de la sorte le mouvement même de l’écriture féminine à laquelle adhère et participe Gagnon. Ce qui anime sa prose dans le texte de 2006 est, plus qu’une simple opposition défensive, l’inquiétude d’un oubli du fantasme féminin comme promesse d’émancipation et d’écriture.
NOTE 6. CADENCES FÉMININES
Le projet identitaire des études de genre redouté par Gagnon, qu’elle oppose à une subjectivité féminine fondée sur l’absence, figure chez l’écrivaine une condition d’impossibilité de l’écriture. S’appuyant sur une rhétorique de la présence et réitérant les limites conceptuelles de la tradition métaphysique, l’identitaire menace non seulement de reproduire l’exclusion des sujets féminins des champs de la pensée et de la parole contre laquelle écrit Gagnon ; il annonce pour elle le point de désuétude, d’épuisement, de finitude du féminin en écriture comme instance émancipatrice[36].
Ce conflit et la fin anticipée du féminin comme signifiant peuvent être envisagés à la lumière du « Temps des femmes » de Kristeva, où elle réfléchit à la formation des sujets « femmes » en exposant de manière schématique une conception du temps. Dans une sorte d’élaboration hégélienne, dialectique, elle repère les « deux phases » qui correspondent à deux générations de femmes. D’une part, le temps linéaire, historique, progressif, téléologique – le « temps des hommes » – dans lequel les femmes des premiers mouvements féministes en Europe désiraient s’inscrire pour atteindre l’égalité et se prévaloir des mêmes privilèges (sociaux, économiques) que les hommes européens, aspirant ainsi, par un rapport d’identité aux hommes, à la neutralité de l’universalisme. D’autre part, Kristeva parle d’un temps monumental, cyclique, mythique, mis en valeur à la suite des événements de Mai 1968. Concernée par des préoccupations symboliques, esthétiques, psychanalytiques, cette seconde phase manifeste l’idée d’une spécificité féminine, d’une singularité en accord avec ce temps mythique, mystique et en opposition au linéaire, lequel repose et se déploie depuis l’exclusion historique des sujets « femmes ». Les féministes se revendiquant de ce paradigme dénoncent leur condition de laissées-pour-compte du langage et du lien social. Kristeva en appelle à une mise à distance par rapport à ces deux temps, proposant – imaginant, tentant de faire apparaître – un troisième terme temporel, comme la relève de ce conflit dans lequel nous tiennent les deux premières phases. Ce troisième temps serait celui d’une indifférence à « l’égard du sexisme » ; le temps de la « désexualisation » où le « sexe » ne serait plus le signifiant des inégalités entre les êtres humains[37]. Pour la linguiste et psychanalyste, le sexe et l’identité sexuelle, les « femmes » ou le « féminin » ont un potentiel politique et révolutionnaire relativement aux rapports de pouvoir et aux dynamiques de violence et d’inégalité qui les font surgir comme « sujets ».
Si Kristeva fantasme, d’une certaine manière, une fin de la sexualité qui signifierait la fin des rapports de domination genrés, Gagnon craint que ce temps utopique, s’il s’incarne dans la langue, ne fasse qu’opérer un nouveau refoulement du sexisme et ne participe qu’à taire la parole des sujets féminins. Pour l’écrivaine, la définition même de l’écriture, cette « geste poétique » (T, 1981, 150), procède de la féminité : « Qu’est-ce qu’une écriture ? Telle est la question brûlante à l’orée de cette autre question : quelle est la féminité ? » (T, 1981, 149) Ainsi, pour conjurer le retour de cette mort féminine déjà advenue et persister comme sujet de langage, Gagnon affronte un temps qui « se soutient de sa butée, la mort[38] ». Ne pas participer de la réinstauration du privilège phallogocentrique la pousse à contester les assises temporelles de la langue, en sa structure et en sa syntaxe même, puisque la syntaxe, « c’est le temps qui est travaillé[39] ». L’un des arts qui ont été traditionnellement opposés à la parole et au langage de la raison est la musique. Comme l’avance la musicologue Susan McClary, la musique est en soi un discours genré :
Throughout its history in the West, music has been an activity fought over bitterly in terms of gender identity. The charge that musicians or devotees of music are “effeminate” goes back as far as recorded documentation about music, and music’s association with the body (in dance or for sensuous pleasure) and with subjectivity has led to its being relegated in many historical periods to what was understood as a “feminine” realm[40].
Associée logiquement à la féminité, la musique s’oppose au registre masculin de la raison, de l’esprit, de l’idéel. S’insérant dans la syntaxe de la langue, elle consiste en un registre féminin susceptible de mettre à l’épreuve les normes de genre qui sous-tendent le langage et l’ordre sociosymbolique. Pour Gagnon, l’écriture, étant une forme de chant, a le pouvoir de « [d]éjouer la langue [et de] transgresser tous les codes » (T, 1975, 125). Plus qu’un lexique, la musique est chez elle un motif de « désaccord » (T, 1975, 125) et de « dérèglement » : « J’écris pour qu’un jour la parole déréglée – ou les jeux sur le code – soit l’affaire de tous. » (T, 1975, 126) En ce sens, la fin des temps des sujets féminins peut être considérée à la lumière de ce que McClary nomme la cadence féminine [feminine ending] : « A cadence or ending is called “masculine” if the final chord of a phrase or section occurs on the strong beat and “feminine” if it is postponed to fall on a weak beat. The masculine ending must be considered the normal one, while the feminine is preferred in more romantic styles[41]. » Dans la tradition de la théorie musicale, les cadences masculines sont associées à des accords majeurs qui invitent la phrase musicale à une résolution, tandis que la cadence féminine, fondée sur des accords mineurs, laisse la phrase irrésolue, inachevée. Autrement dit, elle lui refuse sa fin. Elle refuse le contrôle hégémonique de la double barre[42]. Gagnon est l’écrivaine des fins féminines. D’emblée, l’écriture poétique constitue pour elle « le lieu des mots qui chantent, l’espace où les mots d’une langue sont musique » (D, 2009, 145), « le chemin du juste dit et de la mesure chantée, là où s’ouvrent les frontières et où les pas glissent, les pieds et les syllabes s’avancent sonores vers ce qui ne peut se dire et concevoir autrement » (D, 2009, 146). C’est dire que le principe musical de ses mots « chanté[s], scandé[s], psalmodié[s] » défie la finalité et la finitude du langage et cherche un sens au-delà de la mesure. Dans « Donner ma langue au chant », elle songe ainsi à faire entrer la langue dans un « temps infinitif » (D, 2010, 14), un hors-temps où elle fait « clapoter, chanter, résonner » les mots, n’oubliant pas que
ces mots-là sont d’abord et avant tout le résonnement d’absence d’une langue originelle qui n’est plus. Avec les mots de la patrie, ton écriture parlera de cette origine, comme d’un paradis perdu et retrouvé seulement dans le chant de ta langue quand celle-ci, à travers la mémoire perdue de sa propre chair, invente de toute pièce, comme à partir de rien, une immémoriale présence
T, 1987, 18
Gagnon parvient à lâcher prise sur la présence de la parole, poursuivant la quête d’une voix dans le royaume de l’écriture qu’elle imagine comme le « grand opéra de la pensée humaine » (D, 2006, 103).
Si Gagnon stipule que l’« écriture est à entendre au féminin » (T, 1981, 149 ; je souligne), c’est que la résonance d’absence dont elle parle procède d’une « écoute silencieuse de moi à l’autre, [et de laquelle] surgit une polyphonie heureuse, qui, le temps que cela dure, a le don de taire les écrits stériles des êtres de la norme, normalisés et moralisants, qui fixent, institutionnellement, ses limites et sa fin, qui cadastrent le sol de l’écrit » (T, 1982, 42). Comme si elle parvenait à écrire dans l’ouïe de cet autre, Gagnon pointe la qualité auditive de l’écriture qu’elle conçoit comme « troisième oreille » (D, 1990, 61). Elle octroie à la littérature le pouvoir (psychanalytique) de faire advenir le sujet féminin dans les contretemps de la langue. Dans l’écriture qui se fait ainsi « écoute flottante » (D, 1990, 64), on entend sa « pensée qui prie, qui invoque et implore », incantations « dirigées vers l’absence, adressées nulle part et vers nulle patrie » (D, 1990, 63). Le caractère sacré, mystique, dévolu à l’écriture est garant d’un report de la finitude d’une voix et d’une vie au-delà d’un terme final : « Ainsi, quand on imagine s’en aller en chantant ou en dansant sur la frontière définitive, celle-ci devient multiple, on dirait une portée de notes, qu’elles soient majeures ou mineures, […] on n’en revient pas. » (D, 2010, 12) Enfin, l’écriture est peut-être à entendre comme le lieu de rencontre du féminin avec lui-même, avec sa propre étrangeté, avec son sens déplacé, dissonant, désaccordé ; et avec la fin fantasmée que serait celle de la guerre des sexes lorsqu’elle se termine et dont la poésie de Gagnon se fait « l’ultime cantate qui éteindra pour un temps la pierre noire du néant, qui parsèmera les éclats de vie, bribes, lueurs au-dessus de l’abîme, conjuration des mauvais sorts de l’inéluctable finitude » (D, 2009, 151).
Appendices
Note biographique
LAURENCE PELLETIER est détentrice d’un doctorat en études littéraires avec une concentration en études féministes de l’UQAM. De 2019 à 2021, elle a poursuivi un stage postdoctoral au Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS) de l’Université Paris VIII-Vincennes–Saint-Denis. Elle est actuellement chargée de cours à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM. Elle est aussi critique et publie dans plusieurs revues culturelles, dont Spirale, Lettres québécoises, Nouveau Projet, Moebius, Jeu. En 2023, elle fera paraître Nudités féminines aux Presses de l’Université de Montréal.
Notes
-
[1]
La première vie de ce texte, qui est l’allocution inaugurale de la 38e Rencontre québécoise internationale des écrivains, a été publiée originalement dans la revue Les Écrits, no 129, août 2010.
-
[2]
Madeleine Gagnon, Donner ma langue au chant, Montréal, Éditions du Noroît, coll. « Chemins de traverse », 2011, p. 17 ; je souligne. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle D suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. Dans une volonté de traduire la transition historique des idées que mobilise Gagnon, j’ajouterai dans cette parenthèse l’année de publication d’origine des textes recueillis dans cet ouvrage.
-
[3]
En 1968, Jacques Derrida donnait une conférence intitulée « Les fins de l’homme ». À partir de la polysémie de la notion de « fin » – finalité et finitude –, il réfléchit aux limites et aux visées conceptuelles de l’« homme » tel que celui-ci est abordé en philosophie métaphysique. Dans une préface au SCUM Manifesto de Valerie Solanas, Avital Ronell fait coïncider cet événement de l’histoire intellectuelle avec celui de la tentative de meurtre d’Andy Warhol par Solanas. Cette conjoncture, de même que la figure de cette écrivaine-terroriste, permet à la philosophe de penser la condition temporelle des sujets féminins qui détermine la possibilité de leur effraction dans le réel. Voir Avital Ronell, « Deviant Payback: The Aims of Valerie Solanas », Valerie Solanas, SCUM Manifesto, New York, Verso, 2004, p. 1-33.
-
[4]
Autour des discours de la fin, je me réfère aux textes suivants : Julia Kristeva, « Le temps des femmes », Michel de Manassein (dir.), De l’égalité des sexes, préface d’Élisabeth Roudinesco et Michel de Manassein, Paris, Centre national de documentation pédagogique, coll. « Documents, actes et rapports pour l’éducation », 1995 [1979], p. 23-38 ; Barbara Johnson, The Wake of Deconstruction, Oxford, Blackwell, coll. « Bucknell Lectures in Literary Theory », 1994, 112 p. ; Judith Butler, « The End of Sexual Difference? », Undoing Gender, New York, Routledge, 2004, p. 174-203 ; et Anne Emmanuelle Berger, « Subject of Desire/Subject of Feminism. Some Notes on the Split Subject(s) of #MeToo », Giti Chandra et Irma Erlingsdóttir (dir.), The Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement, New York/Oxon, Routledge, 2021, p. 55-64.
-
[5]
Voir Anne Emmanuelle Berger, « Subject of Desire/Subject of Feminism », p. 56.
-
[6]
« La libération du signifiant, la rébellion contre les répressions idéalistes, le déchaînement des forces de la différence et du désir contre la loi et l’ordre de l’identité. » Barbara Johnson, « Writing », Frank Lentricchia et Thomas McLaughlin (dir.), Critical Terms for Literary Study, Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 41 ; je traduis.
-
[7]
Madeleine Gagnon, Autographie, t. II : Toute écriture est amour, textes réunis et présentés par Jeanne Maranda et Maïr Verthuy, Montréal, VLB éditeur, 1989, p. 51. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle T suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. Dans une volonté de traduire la transition historique des idées que mobilise Gagnon, j’ajouterai dans cette parenthèse l’année de publication d’origine des textes recueillis dans cet ouvrage.
-
[8]
Madeleine Gagnon, « Mon corps dans l’écriture », Hélène Cixous, Madeleine Gagnon et Annie Leclerc, La venue à l’écriture, Paris, Union générale d’éditions, coll. « 10/18. Inédit », série « Féminin futur », 1977, p. 82. Désormais, les références à ce texte seront indiquées par le sigle C suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[9]
Julia Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du xixe siècle : Lautréamont et Mallarmé, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel quel », 1974, 645 p.
-
[10]
La conceptualisation du féminisme en « vagues » distinctes, qui suggère une logique progressive et téléologique, est interrogée et remise en cause dans l’article « Pour éviter de se noyer dans la (troisième) vague : réflexions sur l’histoire et l’actualité du féminisme radical » de Mélissa Blais, Laurence Fortin-Pellerin, Ève-Marie Lampron et Geneviève Pagé (Recherches féministes, vol. XX, no 2, 2007, p. 141-162). Les autrices y critiquent l’idée d’un cloisonnement des luttes féministes par ce découpage historique. L’une des conséquences de cette conceptualisation serait de donner l’impression que le féminisme dit de « deuxième vague », le féminisme radical, est désuet dès que surgit ladite « troisième vague ». Ce texte permet de bien cerner les tensions qui se jouaient sur la scène théorique à l’époque et desquelles le texte de Gagnon est une manifestation.
-
[11]
Gagnon mentionne d’ailleurs dans son autobiographie Depuis toujours avoir assisté au déclin de l’écriture féminine lorsqu’elle a vu les livres Épousailles et Hommes et femmes de son amie Annie Leclerc être sacrifiés sous les feux croisés des « philosophes ayant dépassé depuis longtemps les barrières étanches entre les genres [et des] radicales homosexuelles qui ne lui pardonnèrent pas l’option éthique pour la prééminence amoureuse de l’hétérosexualité ». Gagnon considère que Leclerc, qui s’appuyait sur son « sempiternel modèle Jean-Jacques Rousseau », « ne s’est pas aidée ». Depuis toujours. Récit autobiographique, Montréal, Boréal, 2013, p. 266.
-
[12]
Julia Kristeva, « Le temps des femmes », p. 28 ; je souligne.
-
[13]
C’est également en ce sens qu’Anne Emmanuelle Berger peut parler d’un « retour du sujet de la deuxième vague du féminisme » à l’aube de ce que l’on a nommé la quatrième vague du féminisme (« Subject of Desire/Subject of Feminism », p. 59). Cette logique de répétition soutient moins le retour du même qu’elle ne laisse percevoir les déplacements – dans les discours sociaux et politiques et les idéologies – qui définissent le sujet femme.
-
[14]
Julia Kristeva, « Le temps des femmes », p. 37.
-
[15]
Ibid., p. 26 ; je souligne.
-
[16]
Voir, à ce sujet, Micheline Dumont et Louise Toupin, La pensée féministe au Québec. Anthologie, 1900-1985, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2003, 750 p.
-
[17]
Chloé Savoie-Bernard, Inventaire pendant liquidation. Expériences du temps dans les écritures au féminin au Québec, 1970-1990, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2020, f. 34.
-
[18]
En effet, elle mentionne dans son autobiographie : « Nous nous disions que le problème des féministes n’était pas tout à fait le même en France et au Québec. Chez les premières, c’était la multiplication des groupes et groupuscules politiques qui constituait leur écueil. Chez nous, au Québec, c’était le clivage irréductible, la frontière infranchissable pour l’instant entre les hétéros et les lesbiennes radicales. Une seule osait penser la bisexualité dans le corps même de son écriture, c’était Hélène Cixous. » (Depuis toujours, p. 281.) À cet égard, Savoie-Bernard s’intéresse à la dissolution du groupe de conscience féministe québécois Retailles, fondé par Gagnon et Denise Boucher, et qui est une manifestation de ces clivages et de l’échec d’un certain « nous » communautaire (Inventaire pendant liquidation, f. 262).
-
[19]
Dans Vivre l’orange, par exemple, Hélène Cixous investit les écueils et les malentendus au lieu même de la polysémie de termes marquant l’identité (« femme », « juive »), à travers des effets de traduction entre le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le portugais, etc., pour produire une réflexion sur l’altérité, laquelle ne peut exister que dans la fluidité et l’instabilité sémantique. Autrement dit, ouvrir le sens (des mots, de la langue), c’est s’ouvrir à l’autre.
-
[20]
En cela, le propos de Gagnon résonne avec celui que défend Monique Wittig dans l’ensemble de son oeuvre, où elle s’en prend à la structure hétéronormative de la langue française et à la prétention universaliste du genre grammatical masculin.
-
[21]
Anne Emmanuelle Berger discute des enjeux de traduction théorique aux États-Unis, en particulier de l’instabilité apparente de l’usage de la locution « différence sexuelle », comme ce qui mène à des quiproquos et à des malentendus que la philosophe Gayle Rubin revendique (subvertit) comme un « détournement pervers ». Anne Emmanuelle Berger, « La “différence sexuelle” ou les fins d’un idiome. Réflexion sur la théorie en traduction », REVUE Asylon(s), no 7, 2009-2010, en ligne : http://www.reseau-terra.eu/article942.html (page consultée le 3 avril 2023).
-
[22]
Judith Butler, « Réplique à Sarah Kofman », Ginette Michaud et Isabelle Ullern (dir.), Sarah Kofman : philosopher autrement, Paris, Hermann, coll. « Rue de la Sorbonne », 2021, p. 90.
-
[23]
Voir Avital Ronell, American philo. Entretiens avec Anne Dufourmantelle, Paris, Stock, 2006, 263 p.
-
[24]
Sur ces questions, on pourra consulter Le grand théâtre du genre. Identités, sexualités et féminisme en « Amérique » d’Anne Emmanuelle Berger (Paris, Belin, coll. « Littérature et politique », 2013, 296 p.), qui partage les mêmes ambitions que Le sexe des modernes. Pensée du neutre et théorie du genre d’Éric Marty (Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fictions & Cie », 2021, 502 p). Il est à noter que Marty a d’ailleurs élaboré son ouvrage sans prendre acte de l’immense fortune théorique féministe qui a fait, avant lui, l’histoire de l’opposition sexe/genre dans la French Theory. À cet égard, le travail de Berger, l’une des références actuelles incontournables en la matière, n’est pas mentionné par Marty, bien qu’il utilise le même cadre théorique et méthodologique ; absence signifiante d’un certain privilège institutionnel quant à la question du sexuel.
-
[25]
Judith Butler, « Réplique à Sarah Kofman », p. 90.
-
[26]
Voir à cet égard Catherine Malabou, Changer de différence. Le féminin et la question philosophique, Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2009, 157 p.
-
[27]
Judith Butler, « Réplique à Sarah Kofman », p. 90.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Ibid., p. 91.
-
[30]
Ibid., p. 93. Or, comme le souligne la philosophe : « [M]ême si certains théoriciens du point de vue (standpoint), aux États-Unis, fondent effectivement leur recherche théorique à partir de la spécification de la localisation sociale, supposée soutenir et permettre leur “perspective” ou leur “position épistémologique”, il y a aussi, à travers la ligne de partage des eaux, une série de fortes critiques de la possibilité même d’une épistémologie s’appuyant sur la “position identitaire”. » (Ibid., p. 91) En effet, le déplacement des divisions conceptuelles du terrain disciplinaire (philosophique, littéraire) au terrain national met en lumière une politique de l’interprétation qui repose sur un malentendu, un problème d’interprétation. Pour plus de nuances sur cette question, voir l’ouvrage de Nancy K. Miller, dans lequel la philosophe s’efforce de distinguer le personnel (ou l’identité) et le positionnel : Getting Personal: Feminist Occasions and Other Autobiographical Acts, New York, Routledge, 1991, 184 p.
-
[31]
Voir Ginette Michaud, « Derrida and Sexual Difference », Jean-Michel Rabaté (dir.), After Derrida : Literature, Theory and Criticism in the 21st Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 58-79 ; et Barbara Johnson, « Writing », p. 39-49.
-
[32]
Barbara Johnson, The Wake of Deconstruction, p. 48.
-
[33]
Ou à du témoignage, dont se méfie Christine Angot selon les mêmes considérations ; voir, entre autres, Une partie du coeur.
-
[34]
La formulation interrogative même du titre « Entre grammaire et désir, quel est mon genre ? » pose au genre la question (métaphysique) de l’identité. Une manière de lire ce texte est de le concevoir comme une mise en scène de cette logique même de l’identitaire qui repose sur ce système question-réponse, et d’une croyance en la coïncidence des deux termes.
-
[35]
Hélène Cixous et Catherine Clément, La jeune née, Paris, Union générale d’éditions, coll. « 10/18 », série « Féminin futur », 1975, p. 226.
-
[36]
Cette mésentente se réfléchit à l’intérieur d’un certain discours de (contre) l’essence. Gagnon mentionne à ce propos qu’on ne connaît pas bien la portée de ce concept d’« essence » que les représentant·es des gender studies tiendraient pour épouvantail et d’où s’articule cette injonction qui nous commande de « ne pas essentialiser » (D, 2006, 97). Il s’agit d’un noeud crucial avec lequel se démènent les théoriciennes et philosophes féministes, noeud autour duquel se déploient les travaux récents de la philosophe Catherine Malabou (Changer de différence, Plaisir effacé), mais aussi auquel s’attaquaient des contemporaines de Gagnon, au moment de la production de son texte. Pensons entre autres à Naomi Schor, à Diana Fuss et à Drucilla Cornell, qui invitent à une reconceptualisation de la notion d’essence, visant justement à brouiller les frontières et les oppositions conceptuelles auxquelles se frappe Gagnon. Travail important, par ailleurs, en ce qu’il participe d’un refus de reléguer les pensées d’Irigaray, de Cixous et de Kristeva à une école, à une clôture conceptuelle ou à un « temps » de la pensée féministe, participant de cette logique téléologique de progrès qui produit des pensées comme des événements ou des objets désuets. En fait, ces théoriciennes, qui s’inscrivent dans la tradition des gender studies, étaient déjà en train d’accomplir ce à quoi en appelle Gagnon lorsqu’elle écrit qu’elle « sai[t] bien que, dans certains couloirs, des recherches viendront rencontrer un jour certaines des questions soulevées par les études entourant l’absence ou encore l’inscription du sujet féminin, au cours des décennies 70, 80, 90 du xxe siècle, études se situant d’emblée dans les aires philosophiques et psychanalytiques » ; qu’elle « prédi[t] même l’éventuelle rencontre fructueuse des deux voies » (D, 2006, 104).
-
[37]
En effet, le texte se termine sur des considérations éthiques qui invitent à un dépassement des désirs identitaires (nationaux, féministes) vers le combat pour la libération de l’espèce humaine.
-
[38]
Julia Kristeva, « Le temps des femmes », p. 26.
-
[39]
Gagnon citée dans Jean Royer, « Madeleine Gagnon. Explorer les premières traces du langage », Le Devoir, 26 mai 1979, p. 18.
-
[40]
« Dans son histoire en Occident, la musique a été une activité farouchement débattue en matière d’identité de genre. L’accusation selon laquelle les musiciens ou les dévots de la musique seraient “efféminés” est aussi vieille que les premiers documents sur la musique, et l’association de la musique avec le corps (en danse ou pour les plaisirs sensuels) et avec la subjectivité l’a reléguée à ce que l’on a longtemps conçu comme le royaume du “féminin”. » Susan McClary, Feminine Endings : Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, p. 17 ; je traduis.
-
[41]
« Une cadence ou une fin est qualifiée de “masculine” si l’accord final d’une phrase ou d’une section se produit sur un rythme fort et de “féminine” s’il est décalé pour se terminer sur un rythme faible. La cadence masculine doit être considérée comme normale, classique, tandis que la cadence féminine relève d’un style plutôt romantique. » Ibid., p. 9 ; je traduis.
-
[42]
Ibid., p. 11.