Abstracts
Résumé
Robertine Barry (1863-1910), alias Françoise, est une des pionnières du journalisme féminin au Québec. Au cours de sa carrière prolifique, dans la « Chronique du lundi », qu’elle tient durant les années 1890 à La Patrie, dans le « Coin de Fanchette », qui est à la fois une page féminine et un courrier du coeur publié dans le même journal, dans le magazine Le Journal de Françoise, qu’elle crée et dirige au cours de la décennie 1900 et dans ses écrits fictionnels, comme le recueil de nouvelles Fleurs champêtres (1895), Barry développe une vision très personnelle de l’amour. Largement diffusée, cette vision, aussi romantique que pragmatique, participe au brassage émotionnel qui refaçonne les normes et les attentes à l’égard de l’amour et du mariage, à une époque marquée par les grands bouleversements socioéconomiques que sont l’industrialisation et l’urbanisation. Analysés ici dans une perspective historienne, les discours sur l’amour de Robertine Barry ouvrent une rare fenêtre d’observation sur les relations amoureuses au tournant du 20e siècle québécois.
Mots-clés:
- histoire,
- femmes,
- amour,
- émotion,
- journalisme,
- Robertine Barry,
- célibat,
- genre
Abstract
Robertine Barry (1863−1910), alias Françoise, was one of the pioneers of women’s journalism in Quebec. In the course of her prolific career, Barry developed a highly personal vision of love in her “Chronique du lundi,” published in the 1890s in the daily newspaper La Patrie as part of the paper’s “Coin de Fanchette” section, featuring both a women’s page and a love advice column; in the magazine Le Journal de Françoise, which she founded and directed during the 1900s; and in her fictional writings, such as the collection of short stories Fleurs champêtres (1895). Widely disseminated, her vision, as romantic as it was pragmatic, was part of the emotional turmoil that reshaped the norms and expectations of love and marriage in an era marked by the great socio-economic upheavals of industrialization and urbanization. Analyzed, here, from a historical perspective, Robertine Barry’s discourses on love provide a rare window on romantic relationships at the turn of the 20th century in Quebec.
Keywords:
- history,
- women,
- love,
- emotion,
- journalism,
- Robertine Barry,
- celibacy,
- gender
Article body
En 1895, la journaliste de La Patrie Robertine Barry, alias Françoise, publie un recueil de contes et de nouvelles remarqué sur le monde rural, ses coutumes et superstitions. Sur les quinze textes que compte Fleurs champêtres, onze parlent d’amour. L’amour – dans le sens de sentiment amoureux – est aussi le sujet de dizaines de ses « Chroniques du lundi » parues dans La Patrie entre 1891 et 1900 et est au coeur du courrier échangé entre Robertine Barry et ses lectrices du « Coin de Fanchette[1] », publié dans La Patrie et dans le Journal de Françoise (1902-1909)[2]. Pour cette pionnière du journalisme féminin au Québec, qui est pourtant demeurée célibataire, l’amour n’est pas un sujet de chronique comme un autre. Sa conception de l’amour infuse sa vision du monde et c’est partie en parlant d’amour que Robertine Barry est devenue Françoise, un personnage incontournable de l’élite littéraire canadienne-française et dont l’influence s’étend sur tout le Canada français, jusqu’aux communautés francophones établies aux États-Unis[3].
Cet article analyse, pour la première fois de manière spécifique, les discours sur l’amour émis par Françoise dans l’ensemble de ses écrits journalistiques et littéraires publiés entre 1891 et 1909. Ce faisant, il cherche à saisir l’état d’esprit d’une époque, une part du « régime émotionnel[4] » d’un groupe – les Canadiens français – en proie aux grands changements socio-économiques caractérisant le tournant du 20e siècle au Québec : l’industrialisation et l’urbanisation, qui apportent dans leur sillage un certain nombre de problèmes de santé publique (épidémies, mortalité infantile). Un groupe qui est aussi fortement imprégné par une foi catholique quasi généralisée et marqué par le grand pouvoir détenu par l’Église catholique. C’est en effet dans ce contexte très particulier que s’inscrit Françoise, une des premières journalistes féminines canadiennes-françaises. Femme bien de son temps et de sa culture, tout en étant ouverte sur le monde et éprise de liberté, cette célibataire offre à ses lectrices et lecteurs une vision de l’amour originale, qui emprunte, on le verra, à la fois au romantisme – entendu ici comme l’amour basé sur le désir, la passion et l’idéalisation de l’autre – et à un pragmatisme prosaïque.
Au Canada, peu d’historien.ne.s ont traité de l’amour. Ce sentiment est considéré indirectement dans les travaux de Françoise Noël à travers certaines correspondances de l’élite; de Serge Gagnon, par le biais de la sexualité, du péché et du mariage; de Gérard Bouchard, dans le vécu de couples du Saguenay; et de Marie-Aimée Cliche via des « séparations de corps » (Noël, 2003; Gagnon, 1990 et 1993b; Bouchard, 2000; Cliche, 1995, 1997). Peter Ward, dans Courtship, Love, and Marriage in Nineteenth-Century English Canada (Ward, 1990), s’y penche un peu plus directement, avançant notamment que l’amour est la principale raison des unions au Canada à partir du milieu du 18e siècle. Ward s’inscrit ainsi dans une tradition historiographique qui brosse un portrait linéaire de l’évolution de l’amour en Occident.
En effet, plusieurs historien.ne.s ont mis l’accent sur l’apparition de l’amour romantique comme prérequis au mariage à la fin du 18e siècle en parallèle avec la montée de l’individualisme et du libéralisme (Stone, 1977; Shorter, 1977; Coontz, 2006). Cette nouvelle association entre amour romantique et mariage chrétien aurait contribué à renforcer l’idéologie de la domesticité, qui a séparé de plus en plus les rôles féminins et masculins au 19e siècle (Davidoff et Hall, 1987). De ce fait, l’amour romantique sera vu par plusieurs historien.ne.s comme un piège pour les femmes parce qu’il les enferme dans un rôle prédéterminé. Pour d’autres, il sera vu comme ayant redonné aux femmes du pouvoir au sein de leur couple en les valorisant comme des êtres dotés d’une personnalité unique (Lystra, 1989, p. 9). Pour la sociologue américaine Szuzsa Berend, l’idéal romantique du mariage d’amour au 19e siècle entrainera néanmoins plusieurs femmes de l’élite vers le célibat laïc, un état que plusieurs trouvaient préférable à celui d’épouse lorsque le sentiment idéalisé, voire spiritualisé (perçu comme voulu par Dieu) que devait être l’amour, n’était pas au rendez-vous (Berend, 2000).
L’amour n’est pas un sujet neuf et il a donné lieu à un certain nombre d’études en sciences sociales au cours des dernières années (Illouz, 2012, 2020; Piazzesi, 2017). Concept qui pourrait sembler facile d’accès, il apparaît tout autrement lorsqu’on s’y intéresse en profondeur, ne serait-ce que par la difficulté de donner une définition claire de cette émotion (ou sentiment), qui prend des formes variées en fonction de l’époque et de l’espace. En effet, l’amour, tel que nous l’entendons dans cet article, nous inspirant de la manière de voir de l’historiographie des émotions, n’est pas un sentiment universel ni anhistorique. Il s’agit d’une construction socioculturelle, qui a un impact réel sur l’expérience des hommes et des femmes, notamment sur les croyances relatives au mariage, sur le vécu du mariage et sur les rôles de genre (Reddy, 2012; Harris et Jones, 2015; Karandashev, 2016).
Notre étude, se concentrant sur l’amour « amoureux », exclut les autres formes d’amour (filial, adelphique, parental, amical, amour de Dieu…). Nous ne tenterons pas, dans cet article, d’offrir une définition fixe de ce sentiment. Nous chercherons plutôt à comprendre la vision qu’en a Robertine Barry, celle qu’elle a intériorisée à partir de ses expériences, de ses lectures, de ses observations, et celle qu’elle diffuse grâce à sa position de journaliste. Comment conçoit-elle l’amour? Idéalise-t-elle ce sentiment? S’en méfie-t-elle? L’amour a-t-il, selon elle, les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes? Comment sa vision de l’amour influence-t-elle sa vision du mariage? Comment est-ce que tout cela se traduit dans les conseils qu’elle donne à ses lecteurs et lectrices? À travers les discours de cette femme d’influence, qui provient d’une certaine élite économique et culturelle, mais rejoint des gens de toutes les classes sociales (comme en atteste la provenance des lettres de ses lectrices et lecteurs)[5], nous tenterons d’apercevoir le « régime amoureux[6] » qui régnait au Québec au tournant du 20e siècle. Un régime qui associe amour romantique et mariage, mais pas aux dépens de considérations très pragmatiques comme la situation du conjoint, son aisance financière, sa sobriété, son tempérament. Selon Robertine Barry, les femmes, surtout, doivent prendre en compte ces éléments terre à terre dans le choix d’un mari, car elles n’arrivent pas au mariage aussi bien armées que les hommes. En effet, pour cette pionnière du féminisme au Québec (Collectif CLIO, 1992; Carrier, 2003), les femmes sont plus amoureuses, plus fidèles, plus entières, plus pures et donc plus vulnérables aux blessures d’amour que les hommes. Cette vision essentialisée des rôles des sexes est au coeur des discours de Robertine Barry sur l’amour.
Cet article, qui décortique une trentaine de chroniques, de nouvelles littéraires et de pages de courrier du coeur, choisies en fonction de la présence de l’amour dans leur propos, sera divisé en trois parties. Dans la première, nous offrons une petite biographie de Robertine Barry en la positionnant sur l’échiquier idéologique de son temps. Dans la deuxième partie, nous décortiquons la vision de l’amour qu’elle élabore dans ses chroniques de La Patrie, dans ses articles du Journal de Françoise et dans ses écrits littéraires. Dans la troisième partie, nous analysons plus spécifiquement ses discours prescriptifs à travers le courrier de la rubrique Le Coin de Fanchette, que la journaliste a tenue dans La Patrie et dans le Journal de Françoise. À travers ses nombreux écrits sur l’amour, soutenons-nous, Robertine Barry alimente le zeitgeist de son époque et aide les femmes et les hommes qui la lisent à donner du sens à leur expérience.
Femme et journaliste au tournant du 20e siècle
Robertine Barry naît à l’Île-Verte en 1863 d’une mère canadienne-française originaire de l’Île-Verte, Aglaée Rouleau, et d’un père d’origine irlandaise, John Edmond Barry. Elle est la neuvième de leurs treize enfants (dont trois meurent en bas âge). Établis d’abord aux Escoumins, puis à Trois-Pistoles, les Barry sont bilingues, aisés et influents dans l’est du Québec. En effet, John Edmond Barry est directeur de scierie, maire, juge de paix et marguillier. La famille Barry, amatrice de musique et de littérature, possède une bibliothèque bien garnie dans laquelle Robertine fréquente des écrivains comme Hugo, Musset, Lamartine, La Fontaine, les Soeurs Brontë (Lamontagne, 1984, p. 19), dont plusieurs sont associés au courant littéraire du romantisme, qui valorise la sensibilité, la mélancolie, l’intimité, la passion et le mal de vivre. Ces lectures contribueront certainement à construire la vision qu’elle se fera de l’amour.
Robertine passe une partie de son enfance à jouer au bord du fleuve avec ses soeurs et frères. Elle fréquente l’école élémentaire des Escoumins, puis le Couvent Jésus-Marie, de Trois-Pistoles où elle est demi-pensionnaire. Vers 1879, elle entre comme pensionnaire au Couvent des Ursulines de Québec, où elle fait ses premières armes comme journaliste au journal étudiant l’Écho du cloître (Desjardins, 2010). Si son enfance campagnarde lui a permis d’observer de très près les comportements amoureux, les bienfaits et les méfaits de l’amour chez les hommes et les femmes du Bas Saint-Laurent (fréquentations, mariages heureux et malheureux), son éducation religieuse l’a nourrie de préceptes catholiques qu’elle ne perdra jamais de vue en discourant sur l’amour : l’importance du support mutuel, de la fidélité jusqu’à la mort, du sacrifice de soi (Doucet, 2019, p. 273-276). D’ailleurs, Robertine Barry, malgré toutes les idées avant-gardistes qu’elle défendra et ses critiques à l’égard de l’Église catholique, demeurera toute sa vie une catholique sincère, qui allait prier à Notre-Dame après le travail, mais qui « avait une aversion marquée pour les pharisiens, les sépulcres blanchis » (Des Ormes, 1949, p. 108).
Au sortir du couvent, où elle a approfondi ses connaissances en français, en mathématiques, en sciences naturelles, en couture et en musique, après avoir envisagé pendant un moment de suivre sa soeur Evelyne dans la vie religieuse, Barry envoie quelques textes à des éditeurs de journaux, sans succès. Elle se projette aussi dans un mariage, qui n’aura pas lieu. « Je ne suis pas de celles qui considèrent le mariage comme le but vers lequel doivent tendre les plus nobles efforts de toute une vie », écrit-elle dans son journal personnel aujourd’hui perdu (Des Ormes, 1949, p. 47)[7]. Ce journal, dont Des Ormes cite des entrées sans leur accoler de date, évoquerait à quelques reprises un « prince » qu’elle aurait aimé avant de le voir s’éloigner de sa pensée. « Dans tous les mystères de la vie de Françoise, rien ne demeure plus mystérieux que ses amours », écrit Des Ormes, évoquant aussi une passion tardive que la journaliste aurait vécue avec un homme marié, que Sergine Desjardins suppose être le juge Joseph-Émery Robidoux (Des Ormes, 1949, p. 76-78; Desjardins, 2011, p. 228-234).
En 1891, à 28 ans, Françoise publie son premier article dans le journal à grand tirage La Patrie, dirigé par le libéral Honoré Beaugrand, un papier incisif sur l’éducation des filles. Peu de temps après, naîtra, dans le même journal, la « Chronique du Lundi », qu’elle tiendra pendant près de 10 ans. À la même époque, à la suite du décès de son père, Barry déménage de Trois-Pistoles à Montréal. Elle s’installe dans une maison de la rue Saint-Denis avec sa mère, ses frères et soeurs célibataires et la gouvernante de la famille[8].
Bientôt, Robertine Barry devient une figure incontournable de la scène littéraire et culturelle montréalaise. Ses populaires « Chroniques du lundi » posent un regard souvent caustique sur les institutions, dont l’Église, mais toujours bienveillant sur les gens – les ouvriers et mendiants de la ville, les filles-mères, les paysans... Elle entretient ses lecteurs et lectrices de sujets variés : la ville, le tramway, le travail, la mort, les superstitions, la pauvreté, le traitement des animaux, les arts, la condition des femmes et l’amour, dans une perspective que l’on pourrait qualifier de moderne. En effet, dans le débat qui fait rage entre modernité et tradition, Robertine Barry s’inscrit clairement du côté pro-moderne, valorisant le progrès technique et scientifique, mais aussi le progrès social, n’hésitant pas à revendiquer des changements qui ébranlent les structures traditionnelles, comme le droit de vote, une instruction plus poussée et la possibilité de s’accomplir en fonction de ses talents pour les femmes, comme aussi l’instruction laïque et l’ouverture de bibliothèques publiques. Pour mieux la situer sur l’échiquier idéologique de son temps, il est utile de dire que son principal adversaire idéologique est une figure de proue du traditionalisme, le journaliste Jules-Paul Tardivel, et que ses plus grands alliés, Honoré Beaugrand, Louis Fréchette, Joséphine Marchand, sont des partisans de la modernité libérale. « Françoise, c’est la journaliste libre-penseuse, une des rares féministes des années 1900 à oser critiquer le clergé, une femme qui appartient au nouveau siècle » (Collectif Clio, 1992, p. 245), a-t-on écrit avec justesse. Dans plusieurs débats, Françoise apparaît en effet plus audacieuse, plus « moderne » que ses amies féministes Joséphine Marchand-Dandurand et Marie Gérin-Lajoie, peut-être parce qu’elle n’a pas de mari à qui ses positions idéologiques peuvent nuire. Ceci dit, son adhésion à la modernité n’est pas aussi radicale que celle des « femmes nouvelles » américaines et européennes de son époque, des femmes rebelles, indépendantes et érotisées qui mêlaient luttes ouvrières et féminisme, qui parlaient de droit de vote et même de contraception (Stansell, 1998).
Au cours de la décennie 1890, Françoise collabore, de façon ponctuelle, à plusieurs revues et journaux[9], donne des conférences, et publie son recueil de nouvelles Fleurs champêtres, une oeuvre à saveur ethnologique et littéraire dans laquelle elle recueille « en un faisceau d’historiettes, les traditions, les touchantes coutumes, les naïves superstitions et jusqu’aux pittoresques expressions des habitants de nos campagnes avant que tout cela n’ait complètement disparu » (Françoise, Fleurs Champêtres[10], p. 27)[11] En 1896, Françoise inaugure, dans La Patrie, « Le Coin de Fanchette », une page féminine comprenant un courrier dans lequel elle répond aux questions de ses lectrices et lecteurs, qui tournent beaucoup autour de l’amour. Elle qui n’est pas mariée devient paradoxalement, pour les lectrices et lecteurs très avides de ses conseils, une spécialiste des affaires du coeur. À la fin du 19e siècle, elle est un « catalyseur culturel », « la figure la plus illustre du monde féminin », selon Paul Wyczynski (Wyczynski, 1999, p. 151). Son appartement est à ses heures un salon littéraire, où se réunit une partie de l’élite culturelle québécoise. Amie d’Olivar Asselin, d’Henriette Dessaulles, de Laure Conan, elle est la « marraine littéraire » du jeune et talentueux poète Émile Nelligan[12].
En 1900, Robertine Barry est, avec Joséphine Marchand-Dandurand, représentante des femmes canadiennes à l’exposition universelle de Paris où elle participe aussi au Congrès international des femmes[13]. À Paris, elle fréquente les salons littéraires, se lie d’amitié avec des femmes de lettres européennes, dont Juliette Adam et Gyp, qui deviendront des collaboratrices au sein d’un informel réseau transatlantique de femmes de lettres (Savoie, 2004). En 1904, elle se rendra à l’Exposition universelle de Saint-Louis, au Missouri, où elle créera des liens avec plusieurs femmes journalistes canadiennes (notamment du Canada anglais[14]) et en 1906, à l’Exposition internationale de Milan, voyage qui lui permettra de revoir ses ami.e.s européen.ne.s et d’obtenir une audience privée avec le pape Pie X (« Une audience du Saint-Père », JdeF, 4 mai 1907, p. 42-44).
Pour comprendre les discours de Robertine Barry, il faut les inscrire dans cette perspective transnationale, car non seulement la journaliste voyage, mais elle lit quotidiennement des journaux et oeuvres littéraires provenant de l’étranger. Ainsi, ses idées avancées sur les droits et l’éducation des femmes et sur le célibat féminin sont influencées en partie par les discours français sur la « femme nouvelle », éduquée, indépendante, féministe (Roberts, 2002) et par les discours anglais sur la [traduction] « célibataire endurcie » (Walkowitz, 1992, p. 63). Grande admiratrice de la journaliste française Séverine (1855-1929), et lectrice assidue du magazine féministe La Fronde, fondé par Marguerite Durand en 1897[15], Françoise lance à son tour en 1902 son propre magazine, Le Journal de Françoise (1902-1909). Ce dernier porte le sous-titre de « Gazette canadienne de la famille » et affiche le slogan « Dire vrai et faire bien », qui montre l’importance égale qu’elle accorde à la liberté de dire et au devoir. Elle tiendra ce magazine à bout de bras pendant neuf ans, écrivant de nombreux articles, recrutant les collaborateurs et collaboratrices, révisant les textes tout en s’occupant des abonnements et de la comptabilité, avec l’aide d’une secrétaire de rédaction.
Françoise considère son magazine à la fois comme une « université » pour celles et ceux qui n’ont pas la chance d’y aller, comme un moyen de promouvoir des causes auxquelles elle croit, et comme une vitrine pour les écrivain.e.s d’ici et d’ailleurs. Le Journal de Françoise instruit en effet ses lectrices et lecteurs sur l’histoire du monde (dont l’histoire littéraire), l’actualité internationale, les progrès techniques, scientifiques et médicaux. Il prend position en faveur d’une amélioration des droits civiques des femmes, de leur accès aux études supérieures et ose aborder favorablement la question controversée du droit de vote des femmes (JdeF, 2 janvier 1909 et 16 janvier 1909). Dans un contexte souvent hostile à ces idées, il promeut l’instruction laïque, la protection des personnes vulnérables, dont les « filles-mères », qui portent tout l’opprobre d’une grossesse hors mariage (« À qui la faute », JdeF, 6 mars 1909, p. 358) et l’implantation de bibliothèques publiques (« À propos de bibliothèques », JdeF, octobre 1902, p. 160-170). Il ose critiquer la religion et l’Église catholique dans les aspects que Françoise juge hypocrites (« La religion canadienne », JdeF, 17 mars 1906, p. 378-379). Le Journal de Françoise publie aussi des textes d’auteur.e.s d’ici et d’ailleurs, dont Laure Conan, Joséphine Marchand-Dandurand, Émile Nelligan, Louis Fréchette, Albert Lozeau, Edmond de Nevers, Juliette Adam, Carmen Sylva, Hélène Varasco, Thérèse Bentzon.
En 1905, Françoise présente à Montréal sa pièce de théâtre intitulée Méprise, une comédie légère sur le thème des sentiments amoureux, un thème qui n’a de cesse de l’intéresser. Cette pièce simple raconte un imbroglio sentimental entre un homme et une femme qui finira par une déclaration d’amour mutuelle et, on l’imagine, par un mariage heureux.
Les histoires sentimentales personnelles de Robertine Barry, comme on l’a évoqué plus haut, n’ont pas eu une telle fin avantageuse. Mais le choix du célibat chez elle ne semble pas pour autant être un choix « par dépit ». Il s’explique premièrement par la compréhension aigüe qu’elle a de ce que le mariage enlève aux femmes : une femme mariée redevient mineure aux yeux de la loi, ne peut divorcer si jamais la relation s’avère infernale. Il s’explique aussi par ce que le célibat apporte aux femmes : une plus grande liberté de s’engager dans des projets personnels sans avoir besoin de l’approbation d’un mari. Il s’explique finalement probablement par l’idéalisation, par Françoise, de l’amour romantique : comme les protagonistes étudiées par Zsuzsa Berend (Berend, 2000), elle aurait préféré être célibataire que de s’engager avec quelqu’un envers qui elle ne ressentait pas ces sentiments étranges et mystérieux associés au véritable amour, sentiments qu’elle semble avoir déjà éprouvés, si l’on en croit certaines de ses chroniques[16].
À une époque où les « vieilles filles » sont souvent l’objet de moqueries, Françoise n’hésite pas à parler du célibat en termes très positifs, et souvent avec humour. Elle écrit par exemple : « Ne vaut-il pas mieux faire rire de soi parce qu’on n’est pas mariée, que de ne pouvoir rire parce qu’on l’est? » (LP, réponse à Friponne, 15 janvier 1898, p. 9). Et ailleurs :
Parce qu’enfin la vieille fille a songé à se faire une vie extérieure et active, parce qu’elle a compris qu’elle a sa part des responsabilités, et, que dans l’harmonieux concert universel, elle a pris la place qu’un préjugé sot et barbare l’avait empêchée d’occuper jusqu’ici. Elle a goûté à une vie nouvelle qui l’a transformée, qui en a fait une femme d’action et de mouvement et qui, en éloignant à jamais d’elle le dédain ou le ridicule, lui fait regarder la vie sans bravade comme sans défaillance.
JdF, « Vieilles filles », 7 octobre 1905, p. 198-199
En effet, le célibat laïc, à la fin du 19e siècle, devient une option intéressante pour de nombreuses femmes, notamment grâce aux possibilités nouvelles de travail rémunéré, qui nourrissent un désir d’indépendance présent chez elles (Young, 2019).
En 1909, Barry met fin à l’aventure du Journal de Françoise, évoquant des « devoirs nouveaux » qui ne lui permettraient plus de consacrer autant de temps à son magazine. À la même période, elle se voit offrir par le Premier ministre libéral Lomer Gouin un poste d’inspectrice de manufactures[17], nomination qui reconnait le fait qu’elle a souvent, dans ses articles, dénoncé le triste sort des travailleuses et demandé pour elles des conditions plus décentes (« Les jeunes filles dans les bureaux », JdeF, 21 février 1903). Robertine Barry n’occupe pas longtemps ce poste de fonctionnaire puisqu’elle décède le 7 janvier 1910, à 46 ans, d’une congestion cérébrale. Les dernières années de la journaliste ont été difficiles sur le plan de la santé et marquées par un conflit avec sa grande amie Marie Gérin-Lajoie. Cette dernière avait cédé à la demande de Mgr Bruchési, archevêque de Montréal, de ne pas imprimer dans les actes d’un colloque de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste une conférence de son amie Françoise, jugée trop radicale par l’archevêque (Desjardins, 2011, p. 387). Toutes les féministes du tournant du 20e siècle jouaient un jeu d’équilibriste, pour ne pas s’aliéner l’opinion des puissants et être mises au ban de la société (Cliche, 1989). Mais Robertine Barry, en partie parce qu’elle était célibataire, comme nous l’avons évoqué, n’était pas encline à autant de compromis. Ses dernières années ont été marquées par des périodes dépressives, à la suite de plusieurs deuils et peut-être d’un chagrin d’amour (Desjardins, 2011, p. 234, 398, 401, 409-410).
Plongeons maintenant directement dans les discours sur l’amour de Robertine Barry, d’abord dans ses chroniques dans les journaux et dans ses travaux littéraires, ensuite dans ses pages de courrier du coeur.
L’amour, selon Robertine Barry, dans ses écrits journalistiques et littéraires
L’une des premières choses qui sautent aux yeux lorsque l’on s’intéresse aux écrits de Françoise, c’est la prévalence des discours sur l’amour, présents partout dans l’oeuvre. Dans cette partie, nous analyserons les discours amoureux de Robertine Barry dans ses chroniques de La Patrie et du Journal de Françoise et dans le recueil de nouvelles Fleurs champêtres, et nous observerons leur oscillation entre pessimisme terre à terre et idéalisation romantique. Précisons que la frontière entre l’observation empirique et l’imagination n’est pas toujours facile à tracer dans les écrits de Françoise, qui brouille constamment les pistes. Or, pour les fins de notre analyse, la véracité est secondaire; il nous importe plutôt d’observer ses idées sur l’amour à travers les histoires qu’elle raconte, qu’elles soient vraies ou inventées.
Plusieurs des nouvelles et articles de Françoise dévoilent une vision très sombre de l’amour. La nouvelle « L’amour qu’on aime tant » (JdeF,15 avril 1909, p. 389-390; reprise dans Lamontagne, 1984[18]), en est un exemple probant. Parue dans le tout dernier numéro du Journal de Françoise, elle jouxte le texte « Pour prendre congé » de la directrice, qui explique qu’elle cesse la publication de la revue après sept ans de travail. Rappelons que Robertine Barry décédera neuf mois plus tard, en janvier 1910, ce qui peut donner à cette nouvelle des allures de testament.
Dans « L’amour qu’on aime tant », donc, une jeune femme se meurt en accouchant. Avant de fermer les yeux pour de bon, elle parle à son mari, à qui elle confie l’enfant qui vient de naître. Alors qu’il est anéanti par le chagrin et qu’il lui dit qu’il l’aime, elle répond :
Oui, tu m’aimes… Aujourd’hui surtout, que tu me vois si malade, tout l’amour des premiers jours revient dans ton chagrin… Pourtant, je me suis bien aperçue, va, parfois, que ton amour allait s’affaiblissant… Non, non, ne proteste pas… Tous les hommes sont ainsi, je pense… Ils n’aiment pas comme le savent les femmes… leur amour dure si peu de temps. Il tue souvent.
Pour la narratrice, « l’oubli vient à tous les hommes et, un jour, une autre aussi… » Lorsqu’elle affirme que c’est à cause de l’amour qu’elle meurt, on comprend qu’elle parle davantage des tourments psychologiques que des conséquences physiques de l’amour (l’accouchement), même si les deux se confondent. « Ne pouvais-tu m’aimer sans me faire mourir? », demande la narratrice à son mari, avant que ses lèvres glacées se referment pour toujours.
Cette nouvelle diffuse une vision triste et amère de l’amour, du point de vue d’une narratrice que ce sentiment a rendue malheureuse avant de la tuer. Ce n’est pas si souvent que Françoise établit, dans un texte, un lien de causalité entre l’amour et la mort. Par contre, certaines des idées présentes au coeur de la nouvelle « L’amour qu’on aime tant », soit que les hommes n’aiment pas de manière aussi pure et durable que les femmes et qu’ils se lassent vite d’une femme pour en aimer une autre, représentent un leitmotiv dans les discours de Françoise. Ses écrits laissent souvent entrevoir sa vision imparablement genrée de l’amour. Pour Françoise, l’amour est pour les femmes un sentiment précieux, sérieux, qui dure toute la vie; et pour les hommes, il est souvent un jeu qui les amuse, mais dont ils se lassent rapidement. Les hommes, pour Françoise, sont en effet inconstants[19] dans leurs sentiments, voire infidèles, comme elle le laisse entendre dans sa chronique du 18 février 1895, où elle raconte une discussion entre amies :
Je ne sais comment cela se fit, mais la conversation vint à tomber sur les hommes, et une vieille dame, que je vois d’ici avec sa figure respirant l’intelligence, son air digne et distingué, laissa tomber la phrase suivante : - l’homme fidèle est un mythe. J’avoue que cela me fit un peu froid au coeur; j’aimais à croire que chacun avait tout au moins autant de constance que moi, et je devais modifier ma croyance, parce que l’expérience et les années venaient de me donner, par la bouche de cette personne, une autre leçon.
« CdL », LP, 18 février 1895, p. 1
Les discours de Françoise sur l’amour, comme on l’a dit, ont tendance à mettre en avant des différences « naturelles » entre les femmes et les hommes, à essentialiser leurs manières d’être et de sentir en amour : les femmes sont fidèles, pures, honnêtes, ardentes, dévouées, et les hommes sont changeants, insouciants, fuyants et volages.
Dans les discours de Françoise sur l’amour, il est par ailleurs très souvent question d’amour impossible. L’amour est irréalisable ou encore il est déjà mort, pour différentes raisons : la différence d’âge (« CdL », LP, 28 janvier 1895, p. 1*), d’ethnicité ou de classe sociale entre les amoureux, ou encore la mort d’un des deux protagonistes. Certains des récits sont des épopées déchirantes situées à des époques anciennes, comme « La lampe qui ne s’éteint jamais » (« CdL », LP, 29 mai 1893*), un amour entre un Iroquois et une jeune Française au temps de la Nouvelle-France et « Jeanne Sauriol », une relation impossible entre un officier anglais et une jeune Canadienne française qui sacrifiera l’amour pour la fidélité à sa patrie (un sacrifice hautement méritoire selon Françoise) (FC, p. 118-121). Dans la nouvelle « L’amour passa » (JdeF, 2 mai 1908, p. 34-40*), Françoise raconte l’histoire tragique d’une jeune Canadienne française qui comprend qu’elle était en présence de l’amour juste au moment où l’Anglais qui l’aimait meurt.
Quelle que soit la cause de l’impossibilité de la relation, les protagonistes féminines des textes de Robertine Barry se souviennent de leurs amours avortées avec beaucoup de nostalgie, comme si les blessures amoureuses ne guérissaient jamais complètement au coeur des femmes. Et ce, même si elles ont été les initiatrices de la rupture. Ainsi, la nouvelle « Lamento », parue dans La Patrie et republiée dans Le Journal de Françoise (« CdL », LP, 24 décembre 1898, p. 15; sous le titre « Sabine, JdF, 18 février 1905, p. 642-643*), met en scène des amies, autour d’un piano, qui se racontent leurs anciennes amours, volontairement interrompues à cause du tempérament trop fougueux d’un amoureux ou de la peur de la femme d’être un frein aux ambitions de l’homme. Françoise écrit qu’en écoutant le piano, « les âmes qui avaient souffert, connurent encore le mal de ne pouvoir oublier ».
Dans ces textes sur l’amour impossible, l’écrivaine exalte la nostalgie amoureuse des femmes et souligne l’incurabilité des déceptions amoureuses féminines comme si elles étaient les preuves de leur pureté, de leur supériorité morale sur les hommes. Bien qu’il soit difficile de mesurer les effets sur le « régime amoureux » de tels discours, on peut penser qu’ils ont des répercussions importantes sur les rapports de genre en amour; les femmes se sentant non seulement légitimes, mais particulièrement vertueuses et morales lorsqu’elles ne parviennent à oublier un ancien amour.
D’autres textes du « versant pessimiste » des discours sur l’amour de Robertine Barry mettent en scène des couples profondément malheureux. Parmi eux, les époux campagnards qui ne s’aiment pas, dans « Gracieuse » (FC, p. 103-111) et un couple gangrené par la violence du mari (finalement décédé) dans « Le mari de la Gothe » (FC, p. 35-43). Dans ce texte qui ouvre Fleurs champêtres, Robertine Barry dénonce le « fatalisme […] si profondément enraciné chez nos paysans », qui fait en sorte que certaines femmes acceptent la violence et la misère, croyant à la réalisation de leur « destinée ». Comme en écho à ce texte, deux ans plus tard, Françoise raconte dans La Patrie, avec un humour pince-sans-rire, le récit d’une New Yorkaise malheureuse en mariage qui assassine son mari et fait habilement passer ce meurtre pour un suicide pour pouvoir épouser un autre homme (« CdL », LP, 5 juillet 1897, p. 2.). Ces textes sont des critiques féministes à l’égard du mariage, une institution que Françoise rend responsable de beaucoup de malheur humain, et pas seulement lorsqu’il y a alcoolisme ou violence, mais parfois parce que les époux se sont mal choisis.
Combien y en a-t-il de ces mariages malheureux? Leur nombre est infini, […] leur intérieur est un enfer. Pourquoi? Ah! Le sais-je! Ce n’est peut-être entre eux qu’un malentendu, un grain de sable, un rien, mais il manque, pour supporter leurs défauts communs, pour rétablir la bonne entente, la sympathie et l’amitié qui doivent subsister toujours, quand l’amour est envolé. Il n’y a pas de corde d’harmonie, qui vive dans leurs relations […] Rien ne les unit, ni les idées, ni les sentiments, ni les goûts, et ils s’en vont à la dérive, retenus cependant l’un à l’autre et maudissant leurs liens indissolubles. »
« CdL », LP, 11 février 1895, p. 1
Malgré sa vision souvent triste, voire dramatique et parfois cynique, de l’amour et du mariage, Robertine Barry estime que le sentiment amoureux est aussi le plus beau et le plus grand de tous et que lorsque les conditions sont réunies, il mène directement au bonheur. Ainsi, dans plusieurs de ses articles et nouvelles, elle représente des idylles amoureuses jolies et prometteuses. Par exemple, dans « Souvenir de l’exposition », Françoise met en scène un jeune couple, dans une exposition, sur le point de se faire de grandes promesses. Dans un décor rempli de fleurs et de musique, la protagoniste, en tenant le bras de son prétendant, « [sentit] en son être un bonheur si nouveau et si grand qu’elle voulait en mourir » (« CdL », LP, lundi 30 août 1897, p. 2*).
À quelques endroits, Françoise décrit l’amour comme la réunion de deux âmes soeurs. Ainsi, selon une légende bretonne, raconte-t-elle, à chaque âme masculine correspond une âme féminine. Ces âmes sont projetées à la naissance dans un périmètre déterminé. Quand les parties se rencontrent, le bonheur est parfait. Par malheur, écrit-elle, souvent la rencontre n’a pas lieu. Sur la Côte Nord, ajoute-t-elle, « la croyance générale veut que ceux qui ne se marient pas soient des veufs et des veuves, dont le mari ou la femme qui leur était destiné est mort au berceau ou avant l’hymen. Et les vieux garçons et les vieilles filles, ne trouvant plus sur la terre cette autre moitié d’eux-mêmes, qu’ils cherchent sans cesse, passent leur vie seuls jusqu’au jour des éternelles réunions » (« CdL », LP, 11 février 1895, p. 1). Elle contribue donc à ancrer dans les esprits cette idée romantique d’individus faits l’un pour l’autre.
Bien que Françoise semble souvent sceptique à propos de la durabilité du bonheur amoureux[20], elle donne vie à quelques reprises dans ses écrits à des époux unis dans un bonheur simple. Ainsi, dans la nouvelle « Au pays des montagnes » (FC, p. 122-127), elle montre un couple marié heureux, la femme provenant d’une classe sociale supérieure à celle de l’homme, et ayant accepté de le suivre sur la Côte-Nord où ils ont construit leur bonheur. Des couples heureux apparaissent aussi, comme on le verra plus loin, dans le courrier du « Coin de Fanchette », comme dans cette réponse à « maman heureuse », à qui Françoise écrit :
Mes félicitations, petite maman, encore dans la lune de miel après dix ans de mariage! Ça, c’est encourageant au moins! Et quel est votre secret pour vous conserver un mari si bon, si attentif, donnez-le-moi, je l’enseignerai à mes autres correspondantes dont la vie maritale n’est pas tout à fait filée d’or et de soie.
« CdL », LP, 9 avril 1898, p. 22
Finalement, dans les discours amoureux de Françoise, il arrive que l’on voie le triomphe d’amours ayant paru impossibles. Par exemple, dans « Miracle d’amour » (JdF, 19 décembre 1903, p. 229-230*), Françoise raconte l’histoire d’une abbesse bénédictine de Poitiers, au 10e siècle, qui avant de mourir, reconnait sous les traits d’un moine qui entre dans sa chambre pour la bénir, l’homme qu’elle a aimé durant sa jeunesse et qu’elle avait, dans ses rêves les plus inavouables, tant souhaité revoir. Le « miracle » s’est produit et l’abbesse Berthalde meurt en paix, au « premier jour de l’an 953 ».
Au final, il ressort des discours de Françoise sur l’amour une grande idéalisation romantique dans l’absolu, accompagnée d’un grand pessimisme sur la possibilité de voir se réaliser dans la réalité les désirs d’amour. Le pessimisme de Françoise prend racine dans la situation légale des femmes mariées, qui deviennent dépendantes de leur époux. Il s’appuie aussi sur une vision essentialisée des femmes et des hommes en amour. Les femmes, pour elle, n’oublient jamais un homme qu’elles ont aimé; les hommes passent à autre chose sans regrets. Son pessimisme est donc aussi ancré dans une vision irréconciliable des sexes. Il est difficile de savoir comment sont reçus ces discours de Françoise, mais la rubrique « Le Coin de Fanchette », que nous analyserons dans la prochaine partie, nous permet de mieux cerner la relation qu’entretient Françoise avec ses lectrices et lecteurs, dont certains sont perspicaces, comme le montre cette réponse de Françoise à une lectrice qui, selon elle, n’a pourtant rien compris du tout :
J’ai lu votre lettre avec beaucoup d’intérêt; quelques passages m’ont particulièrement amusée, celui, par exemple, où vous dites que quelque amoureux a dû me faire des infidélités, c’est pour cela que je semble avoir si peu de confiance dans les hommes. Ma foi, vous n’y êtes pas, petite Anonyme, ce serait de la méchanceté d’insinuer que j’ai à me plaindre d’aucun d’eux, et je suis prête à donner à tous ceux qui m’ont fait la cour, et ils ne sont pas nombreux, un certificat de bonne conduite.
« CdF », LP, 9 avril 1898, p. 22
Robertine, l’amour et ses lecteurs et lectrices : une analyse de la page « Le Coin de Fanchette »
Au cours de sa carrière de journaliste, Robertine Barry entretiendra des liens très forts avec ses lectrices et lecteurs. La rubrique la plus emblématique de ces liens est « Le Coin de Fanchette », qu’elle décrit souvent comme une famille. Cette page féminine paraît dans La Patrie de 1896 à 1901 et sera reprise dans Le journal de Françoise de façon sporadique. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la section « Réponses aux correspondants[21] », qui prend place dans La Patrie en 1897 et 1898, où elle répond à des questions variées de ses lecteurs et, majoritairement, de ses lectrices. Il faut noter qu’il y a une évolution entre « Le Coin de Fanchette » de La Patrie et celui du Journal de Françoise. Dans le premier journal, l’amour et les relations amoureuses sont omniprésents, la section des questions s’apparentant souvent à un courrier du coeur. À cette époque, « Le Coin de Fanchette » est une page féminine qui traite de sujets variés comme la mode, la cuisine, l’histoire et qui publie de la poésie. Plus tard, dans Le journal de Françoise, « Le Coin de Fanchette » ne fait que répondre aux questions des lecteurs et lectrices, mais ne traite que très rarement des questions sentimentales, se tournant plutôt vers des questions de culture générale[22]. Ainsi, si nous étudierons les deux journaux, La Patrie prend plus de place dans notre analyse.
Le « Coin de Fanchette » mérite qu’on s’y attarde puisqu’il s’agit d’un magnifique terrain pour étudier la vision de l’amour chez la journaliste par la façon dont elle prend forme dans les recommandations à ses lecteurs. Alors que les courriers du coeur ont été analysés plus abondamment en ce qui concerne le milieu du 20e siècle, comme La clinique du coeur de Marcel-Marie Desmarais et Refuge sentimental de Janette Bertrand (Luneau, 2009; Sénéchal, 2006; voir aussi Gagnon, 1993a), les courriers du coeur du 19e siècle et du début du 20e siècle restent encore à étudier[23].
Cette page permet de distinguer les questions jugées importantes par les lecteurs et lectrices et l’appétit qu’il y avait pour des conseils amoureux, dans une société qui offraient peu de moyens, autres que des publications religieuses, de s’informer sur de telles questions. L’anonymat des lectrices et le fait que Françoise affirme détruire les lettres reçues permet de créer un lien de confiance spécial entre la journaliste et ses lecteurs et lectrices.
Les relations amoureuses ne sont pas simples à comprendre, pense Françoise. Lorsqu’une lectrice la questionne sur l’amour, elle lui répond :
Il est certainement impossible de rien préciser, car l’amour varie à l’infini selon les caractères et les tempéraments. De l’amitié à l’amour il n’y a qu’un pas, dit-on, et cependant on ne peut dire où commence l’amitié et où finit l’amour. La différence entre l’amour et l’amitié se ressent plutôt qu’il (sic) ne s’explique. »
« CdF », LP, 23 octobre 1897, p. 9
Pour Robertine, dans ses conseils aux lectrices, l’amour ne doit pas être passionnel, cela est particulièrement vrai pour les jeunes personnes, qui représentent la majorité des personnes qui lui écrivent. Ainsi, à maintes reprises, la journaliste mentionne les dangers de l’amour précoce. Françoise écrit à un lecteur qu’elle ne pense pas « qu’un jeune homme de dix-neuf ans doive demander à une jeune fille de l’attendre. C’est se mettre de part et d’autre une corde au cou beaucoup trop tôt; à dix-neuf ans, Jean-Louis, on ne sait pas au juste ce que l’on aime » (« CdF », LP, 2 octobre 1897, p. 9). Cette idée revient souvent dans les conseils et les chroniques de la journaliste : si l’amour est un aspect important à considérer dans le mariage, l’amour passionnel de la jeunesse est dangereux, pour les garçons comme pour les filles.
Ainsi, Françoise n’hésite pas à rabrouer vertement plusieurs lectrices qui entretiennent des sentiments trop passionnels à l’égard d’un prétendant, sentiments qui selon elle, lorsqu’exprimés trop naïvement, mettent leur dignité à risque. C’est le cas pour Bella, à qui elle écrit :
Vous m’écrivez de ne pas vous faire de la peine en vous disant d’oublier ce monsieur, lequel, il faut bien vous l’avouer, n’a pas l’air de vous aimer bien fort. Je ne vous le dirais donc pas et vous pourrez continuer à l’aimer, mais pour l’amour de Dieu, ayez assez de décence pour ne pas le lui montrer. Soyez aimable, comportez-vous avec lui, comme avec une vieille connaissance rien de plus et attendez, pour manifester vos sentiments, qu’il vous ait fait part des siens.
« CdF », LP, 22 janvier 1898, p. 9
À une autre femme, elle écrit :
Vous vous abaissez indignement en allant demander pardon pour une faute que vous n’avez pas commise; comment avez-vous pu compromettre ainsi votre dignité? (…) Vous êtes comme un jouet entre ses mains, et viendra un jour, où il n’aura que du mépris pour vous. (…) l’amour, hélas, fait faire bien des folies, mais il faut tâcher de rester maître de soi : vous m’avez l’air d’avoir perdu tout contrôle sur vos actions. Si vous ne vous ressaisissez promptement, je vous plains, ma pauvre enfant. Le voilà mon conseil. Le suivrez-vous? Je ne crois pas.
« CdF », LP, 15 janvier 1898, p. 9
On peut donc voir que la journaliste se méfie de l’amour passionnel, principalement de celui qui pose des risques à l’honneur des femmes. Comme elle l’avait déjà mentionné dans La Revue Nationale, une femme « ne possède qu’une seule chose : son honneur et sa bonne réputation, qui sont synonymes. Si par ses légèretés, elle compromet l’un ou l’autre, tous les biens de la terre ne sauraient compenser le mal qu’elle s’est fait à elle-même » (La Revue Nationale, 1895, p. 539). Ainsi, si pour Barry, l’amour doit être présent au sein du couple, cette émotion doit être témoignée de la bonne façon et encadrée par un ensemble de pratiques qui permettent de l’exprimer et de savoir s’il y a de la réciprocité.
Robertine Barry parle abondamment des actes peu honorables qui sont à proscrire, tant pour les hommes que pour les femmes. Envoyer sa photographie, tenir la main d’un homme, sortir avec un homme sans chaperon font partie des comportements féminins jugés répréhensibles par Barry et qui témoignent d’une légèreté, si ceux-ci sont effectués avant les fiançailles. Les nombreuses questions qu’elle reçoit sur les baisers montrent que cet enjeu est présent pour une bonne partie du siècle, comme en témoignent les questions reçues plus tard par le père Marie-Marcel Desmarais (Luneau, op. cit.). On constate une évolution au milieu du 20e siècle, alors que les baisers, de même que les caresses, deviennent de plus en plus acceptables (Sénéchal, op. cit.), chose impensable à l’époque de Barry. Cet ensemble de prescriptions se retrouve au coeur de ce que les sociétés conçoivent comme étant la masculinité et la féminité, et change en fonction du temps et de l’espace[24]. Barry, pour son époque, participe non seulement à la transmission de ces normes, mais aussi à leur construction à travers le prisme de ses propres conceptions de la moralité et de l’amour.
Le « Coin de Fanchette » est ainsi un espace privilégié pour observer ce que Mark Hunter appelle les actes pratiques de l’amour (Hunter, 2010), soit notamment la manière dont les gens reconnaissent l’amour, ou l’absence de celui-ci, chez un prétendant[25]. Pour Barry les actes amoureux prennent forme dans la quotidienneté. Ces actes sont imprégnés d’une morale catholique et la vision de l’amour de Robertine semble complètement détachée de la sexualité. En cela elle s’inscrit dans la même lignée que les autres chroniqueuses de l’époque et au diapason de la vision du clergé. Barry prône en effet un « amour chaste qui se place au-delà de la matière » (La Revue Nationale, 1895, p. 539).
Pour Françoise, dans « le Coin de Fanchette », les petites attentions sont plus représentatives de l’amour que les grandes déclarations[26]. Faire la cour revient à témoigner son amour. Une correspondance, soignée et sans faute d’orthographe pour ne pas « le dégoûter de vous s’il est instruit » est une des façons à privilégier, puisque l’amour « est une chose si tendre, si délicate, qu’il faut constamment l’entourer de poésie et rien ne défleure le plus beau sentiment, fût-il exprimé d’une façon ravissante, que de grossières fautes contre la grammaire » (« CdF », LP, 2 octobre 1897, p. 9). Les convenances apparaissent dans le respect de l’autorité parentale dans le choix du conjoint. À une prénommée Désobéissante, elle mentionne qu’elle ne souhaite pas « encourager un amour que les parents défendent [elle veut dire : interdisent], d’autre part, je sais qu’il y a des parents qui sont bien peu raisonnables » (« CdF », LP, 10 octobre 1897, p. 9). Si certains parents semblent déraisonnables, leur volonté semble néanmoins primer sur celles des enfants.
L’amour n’est donc pas tout, il faut aborder cette émotion en l’inscrivant dans un ensemble d’attentes conjugales qui date de bien avant la fin du 19e siècle. En juin 1898, Françoise lance la question à ses lecteurs et lectrices : « Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un homme? » (LP, 4 juin 1898, p. 14). Les réponses montrent que pour la majorité des lectrices, l’homme doit d’abord les aimer, comme l’exprime Muguet des bois qui désire un homme qui l’« aime beaucoup et toujours, afin que nous voguions sur un éternel flot d’amour ». Il en est de même pour Hermione, pour qui le prétendant parfait serait « grand et châtain, de manières distinguées, pas trop flirt, mais un peu je n’en dirais rien; au moral qu’il soit bon, généreux, assez intelligent pour comprendre que Dieu lui donne une bonne petite femme; je veux surtout qu’il m’aime beaucoup, de cet amour vrai et sincère, qu’il soit caressant à l’excès, doux et affectueux ».
À une autre question, « Les convenances d’âge et de fortune sont-elles nécessaires au bonheur dans le mariage? » (« CdF », LP, 11 juin 1898, p. 14), plusieurs lectrices répondent qu’être d’une classe similaire est un élément important. Pour Clervera, une célibataire, « le bonheur sans argent n’existe que dans les ménages sans éducation ». Encore à cette époque, plusieurs femmes ont l’impression que leur situation financière précaire est un frein à leurs aspirations romantiques (Valoie, 1901)[27]. Toutefois, plusieurs voient en l’amour une émotion qui traverse toutes les barrières. Pour Reseda, dans « un mariage d’amour le coeur est toujours jeune malgré les années, et la femme qui aime respecte son mari, fût-elle la plus âgée. Qu’est-il besoin d’argent quand l’amour domine tout » (« CdF », LP, 11 juin 1898, p. 14). En dépit de l’opinion de Reseda, pour la plupart des lecteurs et lectrices, l’amour est plus convenable si c’est l’homme qui est le plus âgé.
On constate dans les réponses des lectrices et lecteurs que l’amour côtoie d’autres attentes, comme la sobriété, l’intelligence, le dévouement, l’absence de jalousie et, pour certain.e.s, la profondeur de la bourse. La beauté commence aussi à prendre une place importante dans les critères de sélection d’un mari, la majorité des femmes mentionnant qu’elles souhaitent un physique agréable chez leur futur époux. Ces deux questions posées au lectorat en 1898, qui ont engendré plusieurs dizaines de réponses, sont très riches pour constater que l’amour a pris une place importante, parmi d’autres considérations dans les attentes maritales au 19e siècle.
Barry est d’ailleurs au diapason avec son lectorat en ce qui a trait à l’enchevêtrement des critères romantiques et pragmatiques. Elle mentionne à maintes reprises l’importance de l’amour dans le mariage, comme à cette institutrice à qui elle dit : « N’épousez pas cet autre qui se présente, si vous aimez encore votre étudiant, car vous serez malheureuse toute votre vie » (« CdF », LP, 16 octobre 1897, p. 9). Elle donne le même conseil à une autre lectrice, en peine d’amour, lui disant « qu’il ne faut pas dire que vous épouseriez “l’autre” au risque de ne jamais l’aimer, uniquement parce que c’est un bon parti. Une jeune fille ne doit pas parler de la sorte, ce n’est pas joli. Pour se marier, il faut aimer, aimer beaucoup, et vous n’en aurez pas de reste » (LP, 16 octobre 1897, p. 9).
Même si elle fait de l’amour le socle du mariage, Barry reste toutefois sensible à d’autres facteurs. Elle conseille à une dénommée Martine d’épouser « celui qui demeure à la ville; une citadine s’acclimate difficilement à la campagne » (LP, 16 octobre 1897, p. 9). À Étiennette, elle recommande d’épouser « celui que vous aimez le mieux; à votre place je prendrais le cultivateur, car sa situation est moins précaire » (LP, 16 octobre 1897, p. 9). L’amour n’est donc pas tout, à sa dimension parfois transcendante doit s’ajouter des aspects terrestres, matériels par exemple.
Il y a une raison pour laquelle Barry prône l’amour dans le mariage, c’est pour que celui-ci soit heureux, étant bien au fait des ravages que peut causer une union malheureuse, principalement pour les femmes. En effet, pour Françoise « l’amour peut durer entre l’époux et la femme. Il devrait durer toujours; mais hélas! en bien des cas, le règne de ce petit dieu est très éphémère » (« CdF », LP, 8 janvier 1898, p. 2). On voit plusieurs témoignages de mariages malheureux au sein du « Coin de Fanchette », plusieurs lectrices de Françoise parlant de leurs problèmes de couple et de la disparition et/ou de l’entretien difficile du sentiment amoureux au sein de celui-ci. Cela est particulièrement vrai pour les femmes, à qui Françoise donne deux conseils qui peuvent se résumer en deux mots : dignité et résignation. En effet, si le « Coin de Fanchette » fait oeuvre de catharsis pour certaines femmes en leur permettant de parler des problèmes de leur ménage et de demander conseil pour changer certains éléments problématiques chez leur mari, la journaliste est souvent bien impuissante devant la disparition de leur bonheur conjugal. À Épouse malheureuse, qui se désole à propos de son mari jaloux, elle dit : « Je vous plains de tout mon coeur, chère madame, mais vous ne corrigerez votre mari de ce terrible défaut qu’à force de douceur et de renoncement à votre propre plaisir » (« CdF », LP, 22 janvier 1898, p. 9). Barry conseille donc à ces femmes de persévérer dans ce que la société attend d’elles en tant qu’épouses.
Ces cas de femmes malheureuses ne sont certainement pas sans nourrir le pessimisme amoureux que diffuse Françoise. Pour la journaliste, l’amour est quelque chose qui se fane avec l’âge. Plusieurs lectrices écrivent pour déverser leurs états d’âme sur leur union qui chancelle. Pour Françoise, cela est dû aux différentes conceptions de l’amour chez les hommes et les femmes. À une lectrice, elle écrit :
On dit ordinairement que l’amour est un jeu pour l’homme, et une affaire capitale pour la femme. S’il en est souvent ainsi, c’est sans doute parce que la vie pratique ayant une large part sur les pensées de l’homme, elle lui laisse peu de temps pour la vie sentimentale. La femme, au contraire, n’ayant que des occupations intérieures et personnelles, rien ne l’enlève aux chagrins du coeur, rien ne détourne puissamment son âme des pensées qui l’obsèdent et l’affligent.
JdF, 21 janvier 1905, p. 619
Dans le « Coin de Fanchette », Françoise encourage, d’une certaine manière, la passivité des femmes dans les relations amoureuses et la résignation dans la peine. Comme elle le souligne à Poulette et à Minette, c’est aux hommes de faire les premiers pas (« CdF », LP, 7 août 1897, p. 10). Pour les femmes, les grandes peines d’amour doivent être vécues en silence. À une lectrice qui utilise le pseudonyme de Clarisse, elle écrit :
Vous portez dans le coeur une plaie douloureuse et saignante et, cependant, rien ne trahit à l’extérieur les souffrances que vous ressentez. Ce sont des caractères comme ceux-là que j’admire et c’est à eux que vont mes sympathies. C’est de cette façon que je comprends la douleur, Clarisse.
« CdF », LP, 15 janvier 1898, p. 9
Pour celles qui ne sont pas appelées par l’homme qu’elles aiment, ou délaissées, la façon la plus noble de vivre leur peine est en ne laissant aller des larmes que « quand vous serez bien seule, sans témoin qui les regarde couler » (« CdF », LP, 24 juillet 1897, p. 10).
En somme, le « Coin de Fanchette » permet d’accéder au côté le plus terre à terre de la vision de l’amour de Françoise. En effet, ses conseils à ses lecteurs et surtout ses lectrices sont remplis de pragmatisme, de l’importance des convenances et de la dignité. Ils nous font entrevoir un régime amoureux qui, s’il valorise l’amour romantique, accorde encore beaucoup d’importance à ces considérations pratiques qui peuvent faire la différence entre une vie d’épouse misérable et une vie d’épouse satisfaisante. Cette partie d’article ne saurait à elle seule exploiter tout le potentiel du « Coin de Fanchette », il s’agit d’un premier jalon qui peut aider à comprendre les différentes nuances de la perception de l’amour au Québec au tournant du 20e siècle.
⁂
En conclusion, pour mieux comprendre le « régime émotionnel » et surtout le « régime amoureux » du Canada français au tournant du 20e siècle, une ère de bouleversements qui s’ouvre avec l’industrialisation et se referme avec la Première Guerre mondiale, Robertine Barry apparaît comme une figure incontournable. Observatrice sensible des comportements et des mouvements du coeur, femme cultivée, ouverte sur le monde, en avance sur son temps, mais respectueuse des traditions, écrivaine habile, personnalité reconnue et respectée à la ville comme à la campagne, elle a certainement contribué à l’évolution tranquille du « régime amoureux » de son temps.
Elle l’a fait d’une part à travers ses écrits journalistiques et littéraires. Si ces écrits valorisent l’amour romantique, ils rappellent aussi très régulièrement aux lecteurs et lectrices les aspects pragmatiques à prendre en compte dans le choix d’un partenaire de vie. Robertine Barry est en effet très consciente des implications concrètes et parfois dramatiques de l’amour dans la vie des femmes en particulier. Ces dernières courent selon elle de grands risques en se laissant aller à ce sentiment : perdre leur dignité ou leur honneur, tomber enceintes, se briser le coeur. Françoise souhaite leur éviter ces écueils, à une époque où la contraception était presque inexistante et le mariage indissoluble.
Elle a d’autre part contribué à l’évolution des comportements et des perceptions autour de l’amour en incarnant, dans la vie de tous les jours, Françoise, cette journaliste célibataire et autonome financièrement, libre de discourir sur l’amour et de revendiquer publiquement des changements dans la condition des femmes. Pour ses lecteurs et lectrices avides de modèles, de conseils, de sens à donner à leur existence, elle a ainsi entrouvert le champ des possibles sur le plan amoureux et participé au lent remodelage des modèles de féminité ainsi qu’à celui des attentes à l’égard du mariage, qui allait se poursuivre tout au long du 20e siècle.
Appendices
Notes biographiques
Sophie Doucet est stagiaire postdoctorale à l’Université Concordia. Elle est spécialiste de l’histoire des femmes, de la famille et des émotions. Ses recherches actuelles portent sur l’histoire des frères et soeurs alors que sa thèse de doctorat s’est intéressée au paysage émotionnel de la bourgeoise catholique Marie-Louise Globensky (1849-1919).
Jonathan Fortin est candidat au doctorat au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Sa thèse a pour sujet le célibat féminin et masculin laïc à Montréal entre 1880 et 1930. Ses principaux axes de recherche sont les femmes, la famille et le genre en milieu urbain.
Notes
-
[1]
Ci-après « CdL » pour « Chronique du Lundi » et « CdF » pour « Coin de Fanchette » dans les parenthèses.
-
[2]
Ci-après LP pour La Patrie et JdF pour le Journal de Françoise dans les parenthèses.
-
[3]
Il est difficile d’évaluer avec précision le degré d’influence d’une personnalité publique. Mais on sait, par le tirage important de La Patrie (27 000 exemplaires en 1901), par le bruit médiatique qu’a fait la réception de Fleurs champêtre (commenté dans plusieurs journaux), par la renommée des collaborateurs et collaboratrices du Journal de Françoise durant neuf ans, par la provenance rurale et urbaine des lettres des lecteurs et lectrices du Coin de Fanchette, par le fait, raconté par Renée des Ormes, que Françoise se faisait reconnaître dans la rue jusque dans les communautés francophones des États-Unis (Des Ormes, 1949, p. 120), où La Patrie était distribuée, et peut-être aussi Le Journal de Françoise (« Notre programme », JdF, mars 1902, p. 1.), on sait donc, que le rayon d’influence de Robertine Barry était très vaste. Sans compter que comme rare femme oeuvrant dans les médias, elle était en soi une curiosité attirant l’attention.
-
[4]
Selon William Reddy, les gens vivent dans des « régimes émotionnels », assimilables aux régimes politiques. Ces régimes imposent des normes émotionnelles, ainsi que des pratiques et rituels pour les inculquer, qui soutiennent la stabilité du régime politique (Reddy, 2001).
-
[5]
Au regard du taux d’alphabétisation de l’époque, les écrits journalistiques, surtout ceux qui appartiennent à la presse à grand tirage, parviennent à rejoindre une importante partie de la population. En effet, le taux d’alphabétisation de la population québécoise à la fin 19e siècle est estimé à 75 %, soit légèrement moins que celui des grandes puissances européennes (Verrette, 2002).
-
[6]
Nous entendons ici « régime amoureux » comme l’ensemble des codes qui régissent la compréhension de l’amour et les comportements amoureux à une époque et dans une société donnée. Le « régime amoureux » fait écho au « régime émotionnel » de l’historien des émotions William Reddy (Reddy, 2001).
-
[7]
De son vrai nom, Léonide Ferland (1881-1957), enseignante et femme de lettre, Renée des Ormes a publié en 1949 Robertine Barry, en littérature : Françoise : pionnière du journalisme féminin au Canada français, en se basant notamment sur un journal personnel (un « carnet ») tenu par Robertine Barry. Ce journal semble avoir été perdu ou détruit par la suite (Desjardins, 2010, p. 18). Renée des Ormes a aussi laissé un fonds d’archives qui comprend des notes de travail sur Robertine Barry à la Société d’archives du Saguenay-Lac-Saint-Jean (dossier 1328).
-
[8]
Il faut savoir que la cohabitation entre frères et soeurs célibataires n’est pas du tout exceptionnelle au tournant du 20e siècle, alors que l’addition des salaires des individus permet un meilleur niveau de vie. Voir à ce sujet le mémoire de Catherine Renaud (1994). La journaliste Édouardina Lesage (Colette) cohabitera elle aussi avec ses soeurs célibataires pendant toute sa vie (Savaria, 2020), de même que la journaliste Léonise Valois avec sa soeur Philomène (Warren, 1993).
-
[9]
Notamment Le Coin du feu, le Bulletin, le Franc Parler, la Femme, la Revue populaire, Revue canadienne, le Samedi, l’Album universel, la Kermesse, la Charité, L’Almanach du peuple, la Revue nationale et la Feuille d’érable.
-
[10]
Ci-après : FC. Nous avons consulté la réédition préparée par Gilles Lamontagne (Lamontagne, 1984).
-
[11]
Cet ouvrage, qui paraît aujourd’hui plutôt gentil, créera une polémique médiatique, entre d’un côté, le conservateur Jules-Paul Tardivel, directeur du journal La Vérité, qui accuse Françoise d’avoir évacué la religion de ses descriptions campagnardes, et les alliés de Françoise, Louis Fréchette et Joséphine Marchand-Dandurand, qui soulignent les qualités de l’ouvrage (Tardivel, 1895a; 1895b; Marchand-Dandurand, 1895; Fréchette, 1895).
-
[12]
Certains auteurs ont suggéré qu’il aurait pu y avoir une liaison sentimentale entre Robertine Barry et Émile Nelligan, qui était de seize ans son cadet, mais nous n’avons trouvé aucune preuve en ce sens. Selon Wyczynski, Nelligan aurait souhaité dépasser le stade platonique de leur amitié, souhait qui n’aurait pas été partagé par Robertine Barry (Wyczynski, 1999, p. 158-160). Quoi qu’il en soit, leur relation a été intense et tourmentée, ce qui se reflète dans certains poèmes de Nelligan comme « Beauté cruelle » et « À une femme détestée », et dans les écrits de Françoise sur Nelligan, comme dans un article paru au moment de la publication du recueil de poèmes du poète, alors que celui-ci est interné dans un hôpital psychiatrique (JdF, 2 avril 1904, p. 313).
-
[13]
À cette occasion, elles signent chacune un chapitre du livre Les femmes du Canada, leur vie et leurs oeuvres, distribué à l’Exposition universelle de Paris, 1900. Le chapitre signé par Barry s’intitule « Les femmes canadiennes dans la littérature ».
-
[14]
Où elle participe à jeter les bases du Canadian Women’s Press Club et de sa version francophone, dont elle devient présidente. Préoccupée par la question des revenus des femmes de lettres, elle créera un comité de réflexion sur les droits d’auteur.
-
[15]
Voici ce qu’elle écrit à propos de La Fronde et de Séverine, dans La Patrie : « Avez-vous lu le journal La Fronde? Le journal exclusivement consacré aux intérêts de notre sexe et qui annonce fièrement en haut de ses colonnes qu’il est « dirigé, administré, rédigé et composé par des femmes ». Il est fort bien écrit, je le constate avec orgueil, et sa lecture me cause infiniment de plaisir; moi qui ai toujours été de tous les temps, une admiratrice sincère du beau talent de Séverine, je suis heureuse de lire chaque jour dans La Fronde un article de cette plume si alerte et si originale » (« CdF », LP, 12 février 1898, p. 9) Dans le même entrefilet, elle indique à ses lectrices qu’elles peuvent se procurer La Fronde à Montréal, à la librairie Fauchille. Une petite recherche dans l’Annuaire Lovell nous indique que le commerce Charles Fauchille, Stationery and Fancy Goods est situé au 1712, rue Sainte-Catherine, entre Saint-Denis et Sanguinet.
-
[16]
Par exemple, en racontant sa conversation avec une religieuse qui ne connaissait que l’amour de Dieu et pas le sentiment amoureux « terrestre », elle écrit : « Elle ignorait, d’un autre amour, la douceur et la force, les ivresses et les tourments. Je restai muette, ne voulant pas rider, même d’un souffle, la surface de cette âme si pure et si limpide. » (« Fleur du cloître », JdeF, 17 décembre 1904, p. 579)
-
[17]
Depuis 1885, l’État intervient dans les relations entre le patronat et les ouvriers pour amoindrir les effets néfastes de l’industrialisation, en promulguant certaines lois qui limitent le nombre d’heures travaillées, fixent l’âge à partir duquel un enfant peut travailler en usine, encadrent les accidents de travail. Pour veiller à la mise en application de ces règlements, il nomme des inspecteurs, puis des inspectrices de manufactures (mieux placées que leurs confrères pour intervenir auprès des femmes ouvrières et des adolescent.e.s en usines).
-
[18]
Plusieurs articles de Françoise sont repris dans Gilles Lamontagne, 1984. Un astérisque (*) signalera ceux dont c’est le cas.
-
[19]
Voir aussi : « CDL », LP, 19 novembre 1894 et « Le Coin de Fanchette », LP, 12 février 1898. Dans le premier article, Françoise raconte le mariage d’un couple syrien auquel elle a assisté et elle se demande si l’« homme syrien » est constant, lui, et si la mariée pleurera un jour, comme tant d’autres, son bonheur perdu. Dans l’entrefilet du « Coin de Fanchette » elle écrit : « Un premier amour déçu, ça fait bien mal et il nous reste dans l’esprit de si vilains doutes sur la constance et l’honnêteté des hommes (…) »
-
[20]
Dans une chronique, elle raconte une rencontre amoureuse originale et prometteuse et ajoute en guise de conclusion : « Et je me hâte d’ajouter que leur bonheur est sans mélange, car dans dix ans d’ici, si j’avais à raconter cette histoire, Dieu sait si je pourrais en dire autant. » (« CdL », LP, 4 novembre 1895, p. 2)
-
[21]
Nous n’avons malheureusement pas accès aux questions des lecteurs et lectrices, Barry publiant seulement ses réponses aux questions. Dans bien des cas, il est toutefois possible de les deviner. Françoise, qui s’adresse à la personne en l’appelant par son pseudonyme, affirme répondre à toutes les lettres qu’elle reçoit. Il ne subsiste aucun fonds d’archives où l’on peut retrouver la correspondance reçue par Barry. La journaliste affirme à plusieurs reprises qu’elle détruit les lettres envoyées par ses lectrices (« CdF », LP, 9 avril 1898, p. 22).
-
[22]
Ce changement pourrait s’expliquer par la volonté de donner un aspect plus sérieux au journal, mais aussi parce que celui-ci ne veut pas seulement rejoindre les femmes; il vise aussi les familles. On peut penser qu’il y a une volonté de rejoindre un lectorat moins populaire. Concernant les formes d’écriture dans les chroniques de Françoise et le support médiatique de son oeuvre, voir Rizzuto (2017).
-
[23]
On trouve quelques exceptions, comme le mémoire de Maude Savaria (2020) qui porte sur la journaliste Colette (Edouardina Lesage) et son « Courrier de Colette » paru dans La Presse au cours de la première moitié du 20e siècle.
-
[24]
Concernant la masculinité et le sentiment amoureux, voir le mémoire de Sonya Roy (2006) et les travaux de Louise Bienvenue et Christine Hudon (2004).
-
[25]
Sally Holloway (2018) décrit à merveille comment les rituels, le langage et les pratiques entourant l’amour romantique changent avec le temps et sont contestés ou retravaillés par les gens de l’époque.
-
[26]
À un homme qui demande comment savoir s’il est aimé elle répond : « Il me semble que cela ne doit pas être difficile de trouver quand on est véritablement aimé et quand on ne l’est pas : mille nuances, mille petits riens qu’on ne saurait décrire ou même analyser, nous l’indiquent. Appliquez-vous à cette étude des sentiments chez votre amie. » (LP, 11 juin 1898, p. 14)
-
[27]
La journaliste Léonise Valois le souligne d’ailleurs dans un article du Monde illustré.
Bibliographie
- Barry, Robertine (Françoise), 1900 « Chroniques du lundi. 1891-1895 », 325 p. [http://www.canadiana.ca/view/oocihm.03171/9?r=0&s=1], consulté le 17 décembre 2020.
- Barry, Robertine (Françoise), 1900 « Les femmes canadiennes dans la littérature », dans : Les femmes du Canada : leur vie et leurs oeuvres, Conseil National des Femmes du Canada, pour être distribué à l’Exposition Universelle de Paris, p. 209-215.
- Barry, Robertine (Françoise), 1902-1909 Le journal de Françoise, les chroniques du lundi, La Patrie.
- Barry, Robertine (Françoise), 1891-1901 « Chroniques du Lundi », La Patrie.
- Barry, Robertine (Françoise), 1895 « Modes et Monde », La Revue Nationale. Volume 1, n° 5, p. 536-539.
- Barry, Robertine (Françoise), 1896-1901 « Le Coin de Fanchette », La Patrie.
- Berend, Zsuzsa, 2000 « “The Best or None!” Spinsterhood in Nineteenth-Century New England », Journal of Social History, 33, 4 : 935-957.
- Bienvenue, Louise et Christine Hudon, 2004 « Entre franche camaraderie et amours socratiques. L’espace trouble et ténu des amitiés masculines dans les collèges classiques (1870-1960) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 57, 4 : 481-507.
- Bouchard, Gérard, 2000 « La sexualité comme pratique et rapport social chez les couples paysans du Saguenay (1860-1930) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 54, 2 : 183-217.
- Cliche, Marie Aimée, 1989 « Droits égaux ou influence accrue? Nature et rôle de la femme d’après les féministes chrétiennes et les anti-féministes au Québec 1896-1930 », Recherches féministes, 2, 2 : 101-119.
- Cliche, Marie Aimée, 1997 « Les séparations de corps dans le district judiciaire de Montréal de 1900 à 1930 », Canadian Journal of Law and Society, 12, 1 : 71-100.
- Cliche, Marie Aimée, 1995 « Les procès en séparation de corps dans la région de Montréal, 1795-1879 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 49, 1 : 3-33.
- Collectif Clio, 1992 (1982) L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour.
- Coontz, Stephanie, 2006 Marriage, a History. How Love Conquered Marriage, New York, Penguin Book.
- Davidoff, Leonore et Catherine Hall, 1987 Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850, Chicago, University of Chicago Press.
- Desjardins, Sergine, 2010 Robertine Barry, La femme nouvelle, Tome 1, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles.
- Desjardins, Sergine, 2011 Robertine Barry, On l’appelait Monsieur, Tome 2, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles.
- Des Ormes, Renée, 1949 Robertine Barry : en littérature Françoise. Pionnière du journalisme féminin au Canada, 1863-1910, Québec [s.é.].
- Doucet, Sophie, 2019 Toujours je sens mon âme se balancer entre les joies et les peines : Le paysage émotionnel de Marie-Louise Globensky (1849-1919) observé à travers ses écrits personnels, thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal.
- Fréchette Louis, 1895 « Françoise », la Patrie, 29 juin 1895, p. 1.
- Fréchette Louis, 1895 Françoise, « Chronique du lundi », La Patrie, 17 juin, p. 1.
- Gagnon, Serge, 1990 Plaisir d’amour et crainte de Dieu. Sexualité et confession au Bas-Canada, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval.
- Gagnon, Serge, 1993a « Confession, courrier du coeur et révolution sexuelle », dans : Manon Brunet et Serge Gagnon (dir.), Discours et pratiques de l’intime, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, pp. 71-93.
- Gagnon, Serge, 1993b Mariage et famille au temps de Papineau, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval.
- Harris, Alana et Timothy Jones, 2015 « Introduction : Historicizing “Modern” Love and Romance », dans : Alana Harris et Timothy Jones (dir.), Love and Romance in Britain, 1918-1970, Londres, Palgrave Macmillan, pp. 1-19.
- Holloway, Sally, 2018 The Game of Love in Georgian England: Courtship, Emotions, and Material Culture, Oxford, Oxford University Press.
- Hunter, Mark, 2010 Love in the Time of AIDS: Inequality, Gender, and Rights in South Africa, Bloomington, Indiana University Press.
- Illouz, Eva, 2012 Pourquoi l’amour fait mal : L’expérience amoureuse dans la modernité, Paris, Le Seuil.
- Illouz, Eva, 2020 La Fin de l’amour : Enquête sur un désarroi contemporain, Paris, Le Seuil.
- Karandashev, Victor, 2016 Romantic Love in Cultural Contexts, Basel, Springer.
- Lamontagne, Gilles (dir.), [1895] Fleurs champêtres. Suivi d’autres nouvelles et de récits et Méprise, comédie inédite en un acte, Montréal, Fides.
- Luneau, Marie-Pier, 2009 « L’amour au temps de la Révolution tranquille. Le père Marcel-Marie Desmarais, médecin du coeur », Études d’histoire religieuse, 75 : 69-88.
- Lystra, Karen, 1989 Searching the Heart: Women, Men and Romantic Love in Nineteenth-Century America, New York, Oxford University Press.
- Marchand-Dandurand, Joséphine, 1895 « Censure déloyale », Le Coin du feu, juillet, p. 216-217
- Noël, Françoise, 2003 Family Life and Sociability in Upper and Lower Canada, 1780 to 1870: a View from Diaries and Family Correspondence, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
- Piazzesi, Chiara, 2017 Vers une sociologie de l’intime : Éros et socialisation, Paris, Hermann.
- Reddy, William M., 2001 TheNavigation of Feeeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press.
- Reddy, William M., 2012 The Making of Romantic Love.Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan, 900-1200 CE, Chicago, University of Chicago Press.
- Renaud, Catherine, 1994 Une place à soi? Aspects du célibat féminin laïc à Montréal à la fin du 19e siècle, mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal.
- Rizzuto, Liliana, 2017 « De la “Chronique du lundi” (1891-1900) au Journal de Françoise (1902-1909) : hybridité des formes et des écritures dans l’oeuvre de Françoise ». Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 8, 2. [https://id.erudit.org/iderudit/1039702ar.]
- Roberts, Mary Louise, 2002 Disruptive Acts. The New Woman in Fin-de-Siècle France, Chicago, University of Chicago Press.
- Roy, Sonya, 2006 Les règles du jeu de la séduction dans les manuels de savoir-vivre québécois (1863-1917) : investir le monde du sentiment et de l’intimité masculine, mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal.
- Savaria, Maude, 2020 « Écris donc à Colette » : représentations de femmes et discours de genre dans le « Courrier de Colette », 1903-1956 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal.
- Savoie, Chantal, 2004 « L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des femmes de lettres canadiennes », Études littéraires, 36, 2 : 17-30.
- Sénéchal, Johanne, 2006 Fréquentations et mariage, les représentations de jeunes québécoises à travers l’étude d’un courrier du coeur (1958-1968), mémoire de maîtrise (histoire), Université Laval.
- Shorter, Edward, 1977 Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil.
- Stansell, Christine, 1998 « Féminisme et modernisme au début du XXe siècle », dans : Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon, L’histoire sans les femmes est-elle possible?, Paris : Perrin.
- Stone, Lawrence, 1977 The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, New York, Harper and Row.
- Tardivel, Jules-Paul, 1895a « Fleurs champêtres », la Vérité, 15 juin, p. 3
- Tardivel, Jules-Paul, 1895b « Mlle Françoise », la Vérité, 22 juin, p. 7
- Valois, Léonise, 1901 « Les vieilles filles », Monde illustré, vol. XVIII, n° 918, 30 novembre p. 498.
- Verrette, Michel, 2002 L’alphabétisation au Québec 1660-1900 : en marche vers la modernité culturelle, Québec, Septentrion.
- Walkowitz, Judith, 1992 City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London, Chicago, University of Chicago Press.
- Ward, Peter, 1990 Courtship, Love, and Marriage in Nineteenth-Century English Canada, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press.
- Warren, Louise, 1993 Léonise Valois, femme de lettres (1868-1936). Un portrait, Montréal, L’Hexagone.
- Wyczynski, Paul, 1999 Émile Nelligan. Biographie, Montréal, Bibliothèque québécoise.
- Young, Arlene, 2019 From Spinster to Career Woman: Middle-class Women and Work in Victorian England, Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press.

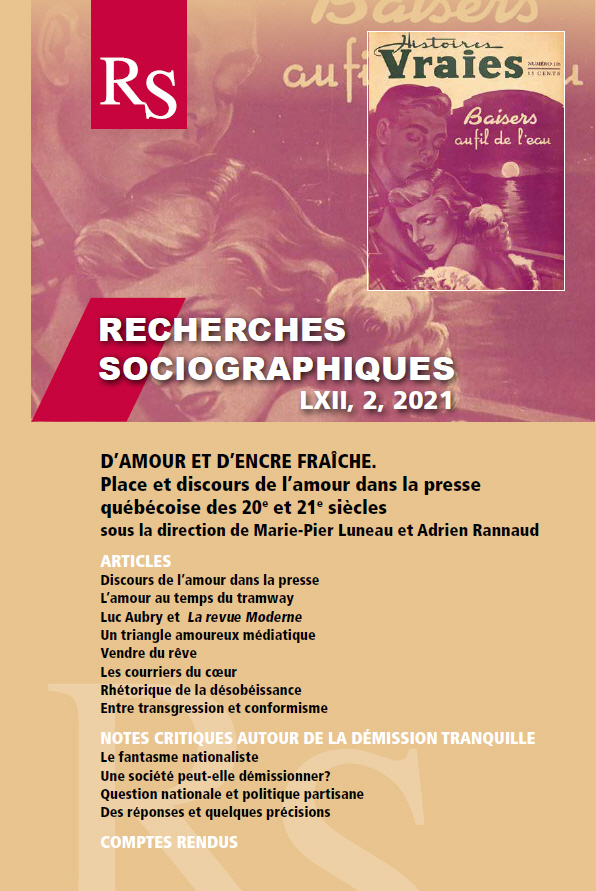
 10.7202/009639ar
10.7202/009639ar