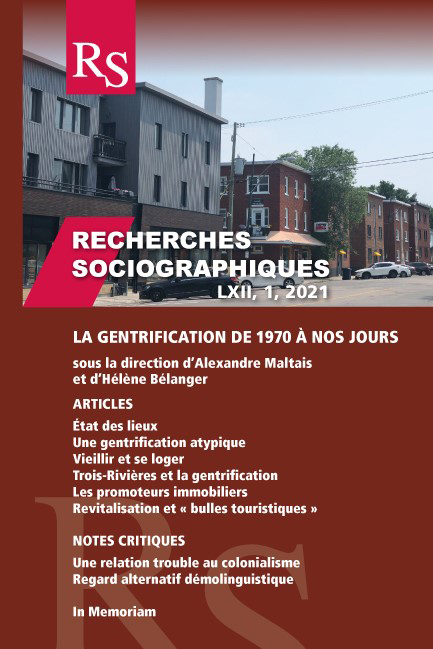Article body
Le gouvernement du Québec revendique, depuis les débuts de la Révolution tranquille, le droit de mener une action internationale autonome, à tout le moins dans les champs de compétence de la province. Selon le mot de Jean Charest, alors Premier ministre : « ce qui est de notre compétence chez nous est de notre compétence partout ». Après avoir, dans les années soixante, espéré pouvoir négocier avec Ottawa un arrangement constitutionnel clarifiant les bases de cet engagement hors frontières, le Québec a dû se résoudre à exploiter les ambiguïtés du cadre juridique de la fédération pour occuper, à coups de précédents et à force de ténacité, tout l’espace diplomatique permis et y camper ses positions. L’État québécois a ainsi institutionnalisé un ensemble de pratiques affirmant sa prétention à l’autonomie en matière de relations internationales. Il met en place un réseau de « délégations » aux allures d’ambassades, il signe avec des États étrangers des « ententes » en cherchant à masquer leur dépendance à l’égard de traités conclus par le gouvernement fédéral, il nomme un représentant à l’UNESCO qui n’est en fait que membre de la délégation canadienne, il soumet symboliquement au parlement l’« approbation » de traités conclus par le Canada mais qu’il juge ressortir en partie à sa compétence constitutionnelle, et ainsi de suite.
Cette activité, explique Jean-François Payette dans son ouvrage, a des effets mystifiants. Elle construirait l’image trompeuse d’un Québec capable, dans le cadre constitutionnel existant, de disposer d’une personnalité internationale distincte et de défendre au-delà de ses frontières son « intérêt national ». Or, pour l’auteur – qui ne cache pas ses convictions indépendantistes –, bien que le Québec ait ainsi développé une action extérieure d’une portée sans équivalent pour un État fédéré, celle-ci demeure nécessairement handicapée par son statut de province, qui le condamne à la sujétion juridique en matière de relations internationales. Le mythe serait, selon Payette, reproduit et accrédité par le monde académique lorsque des auteurs, par simple négligence ou aveuglement, commettraient l’erreur de qualifier de « politique étrangère » l’action internationale du Québec. Une véritable politique étrangère serait plutôt, selon lui, tout à la fois ce à quoi le Québec devrait aspirer en tant qu’État national et ce dont il est privé en tant qu’État non souverain.
Sur le plan de la science politique, la fixation que fait Payette sur le concept de politique étrangère, bien rendue par le titre du livre, est difficile à comprendre. D’abord parce que, contrairement à ce qu’il tente de démontrer, ce concept ne sert pas exclusivement à nommer, dans la littérature académique, la politique extérieure des États souverains et, encore moins, celle d’États nationaux. Ensuite, on s’étonne de cette problématique que construit Payette autour de l’inadéquation du concept de politique étrangère puisque celui-ci est en fait, aujourd’hui, rarement mobilisé pour étudier l’action internationale du Québec. On lui préfère généralement, au sein de la communauté académique, celui de paradiplomatie. Lequel, comme l’auteur l’explique lui-même en annexe de l’ouvrage, a justement été forgé pour désigner l’action internationale d’entités politiques non souveraines. Payette force donc passablement la note en tentant de vêtir d’habits académiques une ambition essentiellement politique; celle de combattre l’idée que le Québec ait pu trouver dans le régime politico-juridique canadien la flexibilité lui permettant de défendre ses intérêts sur la scène internationale.
Ces considérations sémantiques débouchent sur un traitement essentiellement descriptif et historique du sujet. Payette refait le récit de l’histoire des relations internationales du Québec de la Conquête à aujourd’hui. Cette histoire a déjà été racontée, en particulier par des hauts fonctionnaires comme Gaston Cholette, Claude Morin ou André Patry, mais aussi par plusieurs politologues comme Louis Balthazar, Luc Bernier ou Stéphane Paquin. L’ouvrage offre une bonne synthèse et une mise à jour de ce matériau, mais sans rien y ajouter de particulièrement significatif. Le récit est soutenu par une trentaine d’entretiens, mais tous menés avec des acteurs ou intellectuels susceptibles de soutenir la thèse de l’auteur. Il est en effet frappant que d’anciens premiers ministres ou ministres responsables des relations internationales sous des gouvernements péquistes comme Louise Beaudoin, Bernard Landry, Jean-François Lisée, Jacques-Yvan Morin ou Jacques Parizeau aient ensemble fourni plus d’une douzaine d’entretiens alors qu’aucun ancien titulaire de charge sous un gouvernement libéral à Québec – sauf Paul Gérin-Lajoie – ou sous un gouvernement fédéral n’a été entendu. Tout aussi surprenant est le fait que la thèse de doctorat dont est tiré le livre ait été dirigée par Bernard Landry et évaluée par Louise Beaudoin. Qui se retrouvent donc dans les rôles à la fois d’objets, de héros, de sources et d’évaluateurs de cet ouvrage universitaire.