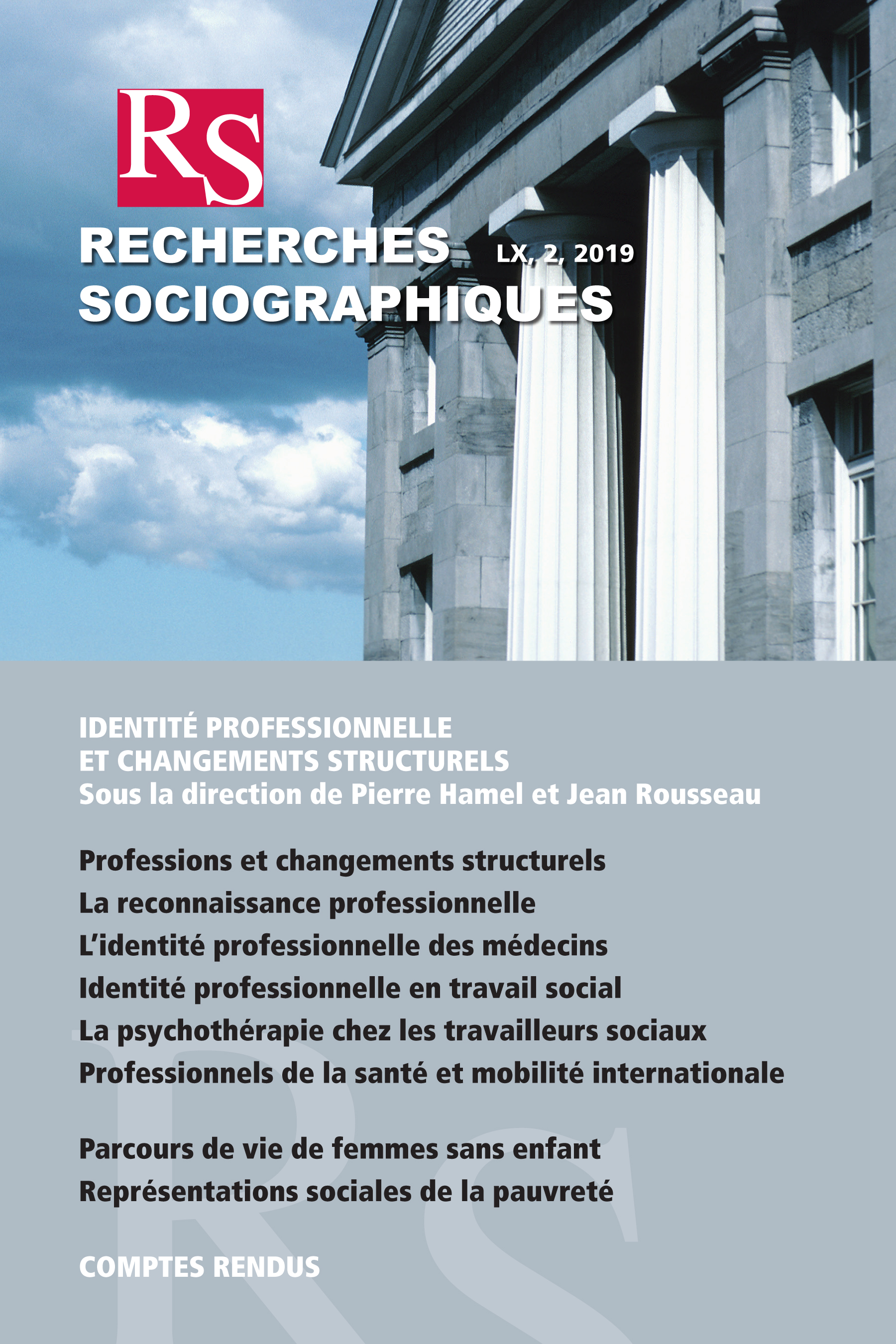Article body
Dans cet ouvrage, André Turmel se propose de saisir l’enfance comme « porte d’entrée de la modernisation » (p. 13) du Québec, c’est-à-dire de voir en quoi les changements entourant l’enfance éclairent les mutations de la société québécoise pour la période 1850-1950. En cela, l’ouvrage est une mise en oeuvre du programme de recherche précédemment développé par l’auteur, notamment dans sa Sociologie historique de l’enfance dont le projet est de comprendre « pourquoi et comment l’enfance est une réalisation historique » (Turmel, 2013, p. 5). Le Québec par ses enfants compte six chapitres, de longueur variable, qui confèrent à l’ouvrage une structure cohérente.
Le premier chapitre propose un survol de la thèse de l’auteur et de son appareillage conceptuel. Insistant sur les insuffisances de la théorie classique de la modernisation – schéma linéaire et dual selon lequel les sociétés passeraient de la « tradition » à la « modernité » selon une logique séquentielle plus ou moins universelle, Turmel suggère de problématiser ce processus historique en s’autorisant à y voir du « métissage » et de « l’hybridation ». Alimentée par le paradigme des Subaltern studies, cette réflexion débouche sur l’hypothèse fondatrice de l’ouvrage, soit celle d’une « modernité alternative hybride » (p. 29). À l’encontre des « discours circulant », répète l’auteur, la société québécoise n’est pas « en retard » par rapport au mode de production capitaliste et industriel, mais témoigne de la « viabilité d’une adaptation innovante » (p. 30).
Toute l’ambition de l’ouvrage consiste à relire ces processus historiques par le prisme particulier du « collectif de l’enfance » que l’auteur définit, d’après la sociologie de Bruno Latour et la théorie de « l’acteur-réseau », comme « un dispositif d’agencement interindividuel et intergroupe qui rassemble enfants et acteurs interagissant ensemble » (p. 16). Le regard analytique est donc moins porté sur l’enfance en tant que telle que sur « le corps communautaire » qui la constitue historiquement, celui-ci étant « composé d’entités hétérogènes – humaines et non humaines – qui fabriquent et recomposent le lien social dans un sens qu’il s’agit de porter au jour » (p. 27). Ce qui intéresse tout spécialement Turmel est l’intégration de nouveaux éléments dans ce « collectif » (lutte à la mortalité infantile et juvénile, discours hygiénistes, pratiques médicales, vaccins, psychologues, institutions, etc.) et la circulation des enfants en son sein.
Les trois chapitres suivants font la démonstration de la thèse de la « modernité alternative hybride », chacun traitant d’un aspect central de la mutation de la condition de l’enfance au Québec. Après avoir passé en revue la littérature démographique et historiographique, Turmel rappelle d’abord les modalités du passage d’un régime démographique de forte fécondité à un régime de faible fécondité. Dans le dernier tiers du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les anglophones connaissent une baisse de fécondité semblable à ce qui est observé pour d’autres provinces et pays occidentaux, tandis que les francophones conservent une natalité plus élevée. À l’appartenance linguistique s’ajoute le facteur religieux : les catholiques, y compris d’origine britannique, ont plus d’enfants que les femmes des autres confessions. Il existe donc plusieurs régimes démographiques dans le Québec de la période à l’étude. Chacun des trois principaux groupes ethnoculturels (anglo-protestants, anglo-catholiques et franco-catholiques) entame sa transition à un moment et un rythme différent – d’où « l’hybridité » du passage à la modernité.
Cette situation présente des similitudes avec celles du travail et de l’éducation des enfants. Longtemps, les Québécois restent les moins scolarisés au pays : en 1891, ils sont deux fois plus nombreux à être analphabètes que les Ontariens ; en 1931, ils occupent le dernier rang des provinces canadiennes avec un taux de scolarisation de 60 % chez les 5 à 19 ans. Ici encore, l’auteur distingue les trois groupes ethnoculturels, faisant apparaître une « scolarisation différentielle » (p. 88) où les franco-catholiques apparaissent nettement moins scolarisés que les deux autres groupes, même s’ils connaissent eux aussi une progression en la matière. C’est le mode de production propre aux groupes sociaux qui éclaire le mieux le parcours scolaire des enfants : le mode de production domestique, qui concerne davantage les familles franco-catholiques dont le père est un travailleur non qualifié, « procède d’une organisation du travail familial qui ne favorise guère l’école : le service familial va le plus souvent à l’encontre de la scolarisation des enfants » (p. 114). À l’encontre de la théorie classique de la modernisation, il n’y a donc pas stricte adéquation entre industrialisation et scolarisation. En outre, les familles devenues ouvrières conservent certaines caractéristiques de l’organisation domestique tout en tirant profit des ressources rendues disponibles par l’économie salariale. Cette expérience juvénile du début du XXe siècle, dit Turmel, est celle de « l’enfant clivé », cette figure hybride symptomatique d’un monde en transition où les configurations traditionnelles de la vie sociale maintiennent leur force d’attraction tout en s’arrimant aux nécessités de la société industrielle.
Turmel s’intéresse ensuite à la mortalité infantile (MI) et aux dispositifs qui sont progressivement développés au XXe siècle pour l’endiguer, en particulier l’hygiène publique et la médecine. Il rappelle les taux de MI qu’il qualifie « d’excessifs » (p. 117) et « d’effarants » (p. 118) : le Québec se distingue en effet du reste du Canada et affiche, jusqu’aux années 1930, les taux de MI les plus importants. Des trois groupes ethnoculturels, les franco-catholiques présentent les taux les plus élevés de MI. Devant cet état de fait, les discours et pratiques hygiénistes s’organisent et prennent de l’ampleur à partir de la Première Guerre mondiale. Turmel montre le détail de ces initiatives en s’intéressant aux cas des programmes « Gouttes de lait » et des cliniques de puériculture. Ces dispositifs sont mis sur pied par des « groupes réformateurs » constitués de médecins, mais aussi d’autres acteurs issus des milieux religieux et associatifs. Dès lors, le champ médical prend une place de plus en plus grande dans le « collectif de l’enfance » en communiquant les avancées scientifiques aux familles afin qu’elles les intègrent à leurs pratiques parentales. Au début du XXe siècle, ce discours médical tourne autour de la distinction fondamentale entre « l’hygiène corporelle » et « l’hygiène de l’âme », toutes deux nécessaires au développement de l’enfant. L’hygiène de « l’âme » glisse lentement vers l’hygiène « morale » puis, dans les années 1930, elle devient hygiène « mentale » (p. 151). Ce glissement sémantique est symptomatique d’un profond bouleversement, celui de l’avènement de la psychologie et de la place prépondérante qu’elle occupera dorénavant au sein du « collectif de l’enfance ». Ce « cadrage hygiénique du collectif » (p. 305) est lui aussi « hybride » en cela que les pratiques parentales traditionnelles perdurent aux côtés d’un discours scientiste qui reste dans une certaine mesure étranger aux moeurs des familles.
Le dernier tiers de l’ouvrage est consacré aux « enfants de la marge », c’est-à-dire ceux qui sont pris en charge par une autre institution que la famille. Turmel présente un portrait, détaillé par de nombreuses données statistiques, des principales institutions chargées de l’encadrement de ces enfants. D’abord les crèches et les orphelinats qui, relevant de l’initiative privée et religieuse, s’occupent respectivement des enfants d’âge préscolaire (06 ans) et d’âge scolaire (6-12 ans). Ces organisations ont une double vocation, charitable et éducative. Ce qui frappe Turmel, c’est qu’une faible proportion des enfants qui y sont admis soient de réels orphelins, au sens strict. En pratique, les orphelinats seraient un « pensionnat pour familles des milieux populaires et ouvriers » (p. 290) qui y placent leurs enfants, pour des séjours de durée variable, le temps de faire face à certaines conjonctures (décès, désunion, maladie, pauvreté, etc.) et de se réorganiser.
Les écoles d’industrie éduquent, par l’apprentissage d’un métier, les enfants âgés de 12 à 18 ans qui sont orphelins, illégitimes ou abandonnés. Enfin, les écoles de réforme encadrent, en principe, les jeunes s’étant rendus coupables de méfaits. Dans les faits, les frontières (physiques, mais aussi administratives) entre ces institutions sont poreuses et les autorités religieuses qui les administrent s’autorisent une grande marge de manoeuvre par rapport au cadre légal. C’est dire que les catégories gestionnaires d’enfance « délinquante » et « en besoin de protection » se confondent dans la pratique. Les enfants de la marge, pluriels et hétérogènes, circulent donc de manière complexe dans ce réseau institutionnel, mais aussi entre institutions et familles. À cet égard, l’analyse statistique de deux organisations de la région de Québec est fort pertinente et instructive, mais Turmel s’enlise ensuite dans des propositions théoriques qu’il ne parvient pas à démontrer.
L’auteur défend longuement l’idée voulant que les « catégories cognitives » de l’orphelin, de l’illégitime, de l’abandonné et de « l’anormal » dominent successivement l’imaginaire québécois et se cristallisent dans une représentation historique misérabiliste de l’enfance. La mémoire collective serait « saturée » par les symboles de la honte et du malheur comme Aurore « l’enfant martyre » ou les orphelins de Duplessis (p. 300). Pour le dire clairement, la figure victimaire de l’enfant serait le reflet de l’image que le Québec se fait de lui-même, « la métaphore et l’axe paradigmatique de la société québécoise elle-même » (p. 309).
Cette thèse, qui est la plus originale de l’ouvrage, est aussi la moins convaincante. Pour se réconcilier avec leur représentation « d’éternelles victimes de leur propre histoire » (p. 309), pense Turmel, les Québécois (francophones…) doivent s’acquitter de leur dette symbolique « par la reconnaissance explicite de cette autre narration » (p. 308), soit celle d’une enfance plurielle, qui ne soit pas strictement malheureuse ou honteuse. C’est à ce projet qu’est consacrée la fin de l’ouvrage, mais les données destinées à faire émerger cet autre récit sont pour le moins discutables. L’auteur convoque l’aumônier de l’Hospice Saint-Joseph de la Délivrance, dont on peut se demander s’il n’avait pas intérêt à présenter son institution sous un jour favorable. Les témoignages d’expériences positives des orphelinats qu’évoque Turmel sont ceux d’une enquête conduite par Arthur St-Pierre en 1948, enquête que Denyse Baillargeon (dans son propre compte rendu de l’ouvrage) juge peu crédible puisque St-Pierre avait le mandat de « défendre ces institutions ».
Turmel ne parvient donc pas à prouver que « la vie à l’orphelinat ne s’apparente pas à l’ordre carcéral, loin de là ! » (p. 270), ni que la discipline ne correspond pas à l’idée reçue d’une « réprimande méthodique » (p. 270), ni que ces institutions sont favorables à « l’éclosion » des enfants (p. 270). En plus de se contredire en concluant que la lecture des règlements de ces institutions « indique que les enfants n’ont nulle marge de manoeuvre » (p. 273), l’auteur laisse dans l’ombre le cas des « orphelins de Duplessis » qu’il qualifie de « cliché » sans en faire l’analyse. Les lecteurs familiers avec l’histoire de l’éducation et de la discipline se demanderont notamment si les représentations tragiques de l’enfance sont véritablement propres au Québec et caractéristiques de son passé de colonisation.
Cette thèse de l’enfance honteuse comme miroir de la conscience collective québécoise accuse un certain sociologisme qui fait de la société une entité dotée d’une « psychologie » ou d’une « âme ». La perspective de Turmel évoque à certains égards l’héritage de Fernand Dumont, pour qui le Québec est aux prises avec « une conscience de soi négative », et partage avec Éric Bédard et Jacques Beauchemin le projet de réconcilier la nation québécoise avec son histoire. Dans l’ouvrage recensé, l’approche en termes de « société globale » conduit l’auteur à prêter trop peu d’importance à la conflictualité inhérente à la vie sociale. C’est là une distance importante avec d’autres perspectives, incarnées notamment par Jean-Marie Fecteau et Denyse Baillargeon, qui accordent un grand intérêt aux rapports de pouvoir. Bien qu’il en reconnaisse ici et là l’existence, Turmel fait l’impasse sur le fait que les appréhensions du monde sont multiples et antagonistes, par conséquent que les groupes en présence (mères, autorités religieuses, infirmières, corps médical, psychologues, politiques, etc.) mènent une lutte quant à l’interprétation de ce qu’est l’enfant « normal » et la bonne manière de le produire. Pour ces raisons, le lecteur est parfois laissé avec l’impression que le « collectif de l’enfance » est un « corps communautaire » qui se meut par lui-même de manière harmonieuse. Une prise en compte sérieuse des apports des traditions matérialistes, féministes et foucaldiennes aurait grandement enrichi l’ouvrage.
Il faut aussi regretter que la bibliographie soit incomplète (des dizaines de titres cités dans le corps du texte n’y figurent pas) et qu’il soit parfois malaisé de déterminer si l’auteur se réfère aux données de première main ou aux utilisations qui en ont été faites. En somme, la première portion de l’ouvrage, qui présente l’état des connaissances historiques et démographiques en l’agrémentant de quelques données originales, est certainement la plus réussie. Bien que les experts de la question y découvriront peu de nouvelles propositions, Le Québec par ses enfants sera utile à un public universitaire intéressé par un tour d’horizon rigoureux de la mutation du Québec et de son enfance.