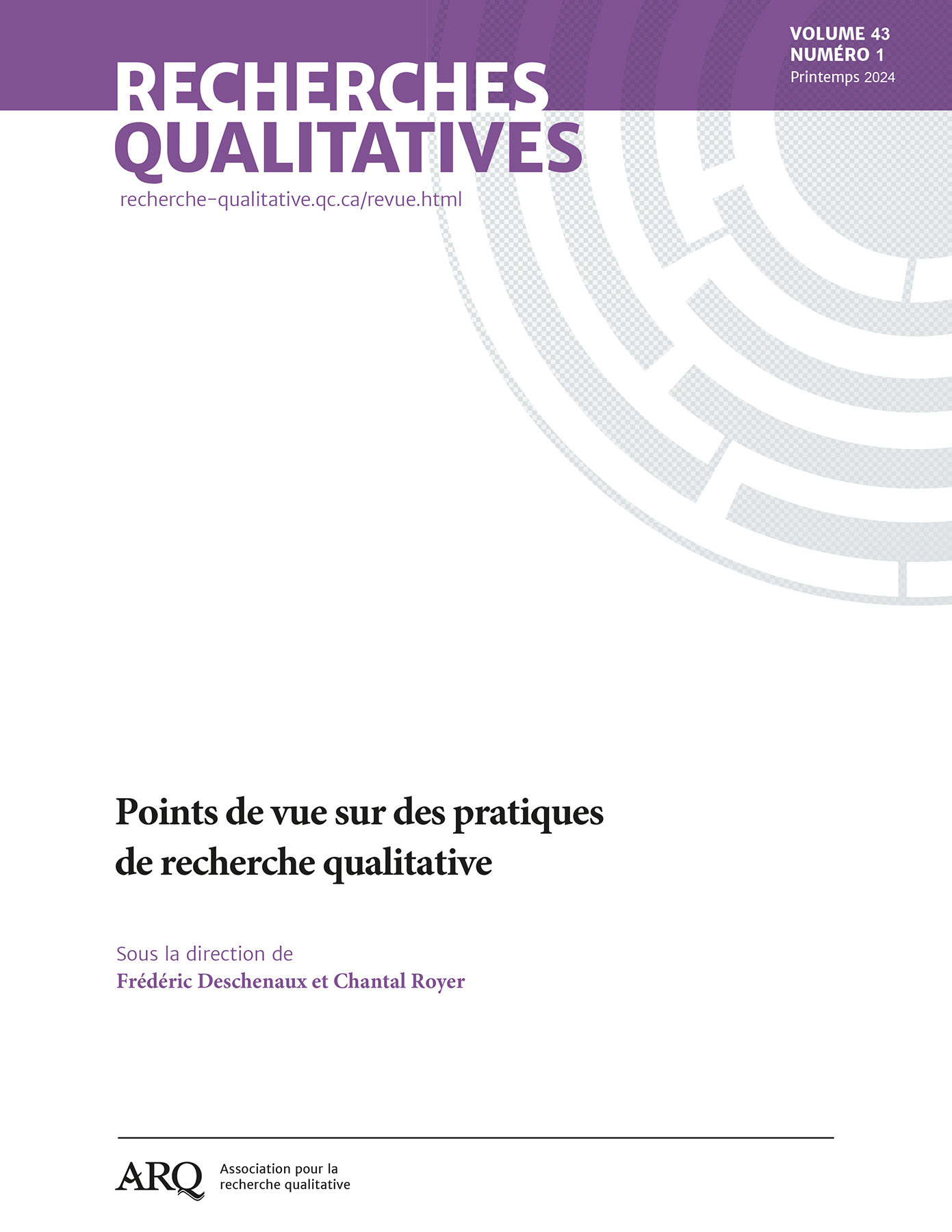Article body
Introduction
Que peuvent avoir en commun un journaliste et un chercheur? Bien plus que ce que je pensais après avoir lu Troubler les eaux, l’essai journalistique de Frédérick Lavoie (2023). Lors de ma lecture, je me suis surpris à pouvoir substituer sans trop d’accrocs le mot chercheur à celui de journaliste, et ainsi à me transposer dans les questionnements et les doutes que l’auteur soulève envers lui-même, sa pratique journalistique [de recherche] et l’état de notre monde. La quatrième de couverture résume bien ce qu’on peut ressentir lors de cette lecture : « Troubler les eaux est un récit qui nous fait éprouver le vertige d’un journalisme [d’une science] renonçant à ses certitudes pour mieux prendre en compte la différence et l’insoluble ». Frédérick Lavoie s’inspire de la pensée de Donna Haraway et d’Anna Tsing pour réaliser une réflexion critique sur sa pratique. Par ricochet, il offre aussi un reflet au monde des recherches qualitatives. Ce que je propose ici c’est de nous confronter, comme chercheurs et chercheuses, au trouble que vit le journaliste. Avec cette note de recherche, je souhaite : 1) revenir sur les éléments critiques que Frédérick Lavoie soulève vis-à-vis sa pratique et suggérer comment ceux-ci peuvent se transposer au monde de la recherche; 2) souligner l’originalité de sa démarche et montrer comment elle peut nourrir une pratique de recherche plus engagée et incarnée; 3) ouvrir les possibles envisageables et partager le trouble qui émane de cet essai.
Lavoie ouvre deux boîtes noires que partagent la recherche et le journalisme : le travail de terrain et celui de l’écriture. Ces deux boîtes noires sont souvent tenues pour acquises (you just do it) et invisibilisées dans les rendus de recherche (Anteby, 2013; Sergi & Hallin, 2011). Or, comme nous le montre le journaliste, le travail de terrain et d’écriture est miné de dilemmes et de difficultés. Nous devons naviguer dans les zones grises, les doutes, l’impossibilité d’avoir accès à toutes les informations ou de capter la réalité. Lors de ma lecture, c’est face à cette question que je me suis retrouvé confronté : quelle place donnons-nous à l’incertitude et à l’invérifiable en recherche?
Mon objectif est de souligner la complexité qui se cache derrière le travail de terrain et d’écriture; d’interroger les idées qu’on tient pour tabous. En rendant visible ce travail, on le réhabilite aussi comme moment constitutif de la recherche, et donc potentiellement génératif de connaissances. Du moins c’est ce à quoi arrive Frédérick Lavoie dans son ouvrage : il rend l’incertitude et l’invérifiable révélateurs.
Rencontres et droit à l’opacité
Vous habitez un village situé à plusieurs heures de route de Dhaka, la capitale du Bangladesh […] quand soudain vous voyez approcher trois silhouettes. À leur démarche, à leur habillement et à leurs visages, vous devinez que ces gens ne sont pas d’ici, pas des environs […] L’étranger est intarissable de questions. Il veut savoir si vous avez récemment été victime d’inondation […] [Ces personnes] sont seulement ici pour récolter des informations […] Vous ne savez pas trop quoi penser de ce qui vient de se passer. Vous ne vous sentez pas nécessairement flouée, quoique peut-être un peu. Vous auriez bien voulu en savoir davantage sur ces personnages demeurés somme toute mystérieux, comprendre à quelles fins vous leur avez consacré de votre temps. Vous vous demandez même peut-être ce qu’iels feront de vos mots et de votre image
Lavoie, 2023, pp. 11-15
C’est en nous plongeant dans la peau d’une Bangladaise (fictive) que Frédérick Lavoie amorce son ouvrage. Cette mise en abyme d’une rencontre journalistique donne le ton. Quelle relation peut-il exister entre le journaliste [le ou la chercheuse] et la personne interrogée? Quelle perception cette personne peut-elle avoir de l’interaction qui semble pourtant banale : la récolte d’informations concernant de récentes inondations? Ce qui amorce le trouble chez Frédérick Lavoie c’est d’abord des rencontres avec des Bangladais et Bangladaises dans le cadre d’une enquête journalistique sur les enjeux de l’eau dans ce pays d’Asie du Sud. Il sent à ce moment qu’il remplit ses obligations journalistiques [de recherche], mais reconnaît qu’il ne peut pas aller « au fond des choses » (2023, p. 236). Mais c’est surtout lorsque vient le temps d’écrire l’essai [la recherche] résumant l’enquête que la vague de trouble frappe.
J’avais à ma disposition les mots de ces hommes et de ces femmes. Je pouvais les mettre entre guillemets pour les faire parler. Rien ni personne ne m’empêchait de le faire. Pas même ces personnes elles-mêmes. Comment l’auraient-elles pu alors que nous n’avions plus aucun contact et qu’elles ne liraient probablement jamais le fruit de mon travail? Mon malaise à les faire parler à travers ma plume à la première ou même troisième personne était la prolongation de ce sentiment qui m’avait habité par intermittence sur le terrain
2023, p. 35
Pour Lavoie, l’écriture fait émerger une tension entre l’aspiration de donner une voix aux personnes rencontrées et le désir de rester authentique. N’y a-t-il pas un risque d’induire en erreur, se demande-t-il? Comme il le souligne, son « processus de cueillette d’information n’avait certainement pas été irréprochable. Il n’avait pas été malhonnête pour autant » (2023, p. 36). Il reconnaît qu’il n’a qu’une vision partielle et partiale des témoignages et des faits :
Mais que valait mon analyse de ces fragments de vie si je n’avais même pas l’impression – ni même plus l’illusion de l’impression – de disposer des outils pour rendre justice à leur complexité et à leur expérience du monde
2023, p. 36
En fin de compte, ce n’est rien de moins que la méthode journalistique traditionnelle qui est remise en question (le fait de simplement rapporter des propos ou une situation objectivement). D’entrée de jeu, il doute de sa capacité à « saisir la réalité du Bangladesh et [de] ses habitant.e.s, et de l’encapsuler dans des articles et dans un livre » (2023, p. 50).
Troublant pour un ou une journaliste dont le métier est justement de faire état des réalités… mais cela l’est aussi pour un chercheur ou une chercheuse de qui on attend la production de connaissances sur un phénomène. Pareillement, notre processus de cueillette d’information en recherches qualitatives n’est pas irréprochable. Tout comme en journalisme, nous tentons de valider l’information de différentes façons, mais il reste qu’une partie de l’expérience demeure toujours difficile (voire impossible) d’accès. De plus, nous donnons un angle à cette expérience (vision partielle et partiale) avec notre analyse en décidant du sujet sur lequel nous souhaitons mettre la lumière.
Lavoie illustre bien ce problème avec le cas de Katherine Boo (2012), une journaliste qui tente de rendre compte de la vie des habitants et habitantes du bidonville d’Annawadi près de l’aéroport de Mumbai. Dans son ouvrage, l’autrice états-unienne tente de donner une voix à cette population : d’abord en s’effaçant du récit, mais aussi en s’assurant que toutes les informations (factuelles et même émotionnelles) soient vérifiées. Avec son travail de recherche et d’écriture, Katherine Boo souhaite « donner accès à la conscience des habitant.e.s du bidonville »… ce dont doute Lavoie! Non seulement sur le réalisme de « vérifier des émotions comme on vérifie des faits », mais surtout parce que derrière une posture omnisciente se cachent « la sensibilité et les intérêts de l’autrice » (Lavoie, 2023, p. 40). Ainsi, l’éclairage que l’on porte – qu’il soit journalistique ou scientifique – oriente la « réalité » que nous tentons de comprendre. Comment faire entendre la voix (authentique) d’une personne, alors que c’est d’abord une question que nous posons qui lance le dialogue, ou encore une situation précise qui attire notre attention?
Bien que la démarche scientifique n’aspire pas (nécessairement) à faire état de l’expérience complète des populations étudiées, le trouble que vit Lavoie jette la lumière, à mon avis, sur les limites de nos méthodes et de nos analyses, mais surtout sur notre responsabilité éthique. D’une part, comment peut-on réellement s’assurer d’avoir un accès authentique à ce que nos participants et participantes partagent avec nous? D’autre part, quelle responsabilité avons-nous si nous savons que notre présence demeure intrusive?
À ce titre, Lavoie mobilise un concept très intéressant pour concevoir les limites du travail de « compréhension » que l’on tente d’accomplir : le droit à l’opacité d’Édouard Glissant (1990). Pour le penseur martiniquais, si l’on souhaite comprendre les êtres et leurs idées, cela exige d’avoir un accès sans entraves et une totale transparence. Pour Glissant, ce souhait ou cette possibilité découle davantage d’une relation d’autorité entre une personne qui exige d’avoir cet accès libre vis-à-vis d’une autre (ou pense l’avoir), ce qui caractérise la relation journalistique [de recherche] impérialiste selon Lavoie. En s’appuyant sur le concept du droit à l’opacité, Lavoie avance qu’une personne peut ou devrait refuser que sa personne soit réduite « à des données servant à nourrir des grilles d’analyse qui ne sont pas les siennes et qui n’ont pas grand-chose à voir avec sa vision de soi et du monde » (2023, p. 48). La pensée critique et décoloniale de Glissant vient alors soulever la limite et la responsabilité de la pratique journalistique [de recherche]. Celles-ci exigent un travail d’enfermement, voire d’appropriation pour comprendre l’autre, demandent une transparence des personnes rencontrées, et ultimement entament une interprétation de leurs réalités par les grilles d’analyse et de discours du ou de la journaliste [chercheur ou chercheuse]. Pour Lavoie, le droit à l’opacité est non seulement peu reconnu dans la pratique journalistique [de recherche], mais encore plus dans les normes de publication : la place au doute ou à l’incertitude n’est pas acceptée. Pourtant, ce droit à l’opacité est accordé au ou à la journaliste [chercheur ou chercheuse] qui peut se mettre en retrait et « maintenir son opacité » dès que les participants et participantes le ou la « questionnent » (p. 50) sur sa vie et ses intentions.
Ces réflexions critiques ont aussi été développées dans le monde de la recherche, particulièrement féministe et décoloniale[1]. Lavoie offre une illustration avec ses récits (prochaine section) sur comment ce droit à l’opacité se traduit dans sa relation entre les participants et participantes. Même si nous invisibilisons ce droit à l’opacité dans le rendu de la recherche [journalistique], nous y sommes inévitablement confrontés lorsque nous interagissons sur le terrain.
Récits hésitants pour habiter le doute
La deuxième partie du livre, « Entrevoir les failles », la plus volumineuse, offre une série de récits de terrain racontés sous la perspective de Frédérick Lavoie. Ceux-ci offrent à la fois une illustration des questionnements et limites abordés dans la première partie, mais constituent aussi le terreau de sa réflexion qui suivra. Deux thèmes marquent ces récits et ont des implications pour la recherche : l’intrusion du ou de la journaliste [chercheur ou chercheuse] et l’effet des normes et attentes.
Un intrus dans la place
Les premiers chapitres résonnent directement avec la conclusion de la première partie. Lavoie offre une fenêtre sur différents moments de son enquête où ce droit à l’opacité se manifeste ou encore est bafoué. L’élément déclencheur dans plusieurs de ces récits est simplement l’arrivée du ou de la journaliste [chercheur ou chercheuse] et de son équipe sur le terrain. Une seule rencontre suffit malheureusement à bousculer la vie ordinaire d’une inconnue (« Les larmes de Basanti »). Ou encore, la seule présence de l’équipe crée des attentes et des espoirs pour les habitants et habitantes d’une communauté (« Les bonnes idées »), et ce, malgré les précautions prises et les avertissements donnés aux personnes par Lavoie et son équipe. « Aurais-je dû anticiper qu’il en serait ainsi » (Lavoie, 2023, p. 114), se demande-t-il ?
Lavoie réaffirme que notre arrivée sur le terrain n’est pas sans effet[2] : chez les personnes que nous rencontrons, mais aussi parce que nous mettons la lumière sur un enjeu particulier. Dans « L’événement (et la vie ordinaire) », il illustre comment l’intérêt médiatique (occidental) sur un événement (déversement pétrolier) – et donc la raison de sa présence – se trouve en décalage avec les enjeux de la population. Pour cette dernière, le déversement est en quelque sorte un non-événement. Dans « Donner une voix », c’est à la tension entre le droit à l’information [droit de savoir] et le risque de faire ressortir des traumatismes que Lavoie se confronte.
La première série de récits nous permet de nous interroger sur notre responsabilité lorsque nous enquêtons sur des événements ou phénomènes. Donner la voix, mais à quel prix? Porter un regard sur un enjeu, mais avec quelle(s) conséquence(s)? Si en recherche il existe un certain encadrement éthique qui permet de mitiger certains risques, il n’en demeure pas moins que nous ne sommes pas à l’abri d’effets subtils, mais tout aussi dommageables (Jackson & Mazzei, 2009). Lavoie offre ici un exercice réflexif, critique et humble qui devrait inspirer notre pratique de recherche. C’est en explorant ses maladresses, ses doutes, ses impressions, mais aussi le rôle qu’ont joué certains collaborateurs (fixeurs[3]) qu’il arrive à faire ressortir une compréhension partielle et partiale de l’enjeu. La sensibilité et l’humilité sont des caractéristiques (et habiletés) importantes « qui valent bien tout l’arsenal des “critères de scientificité”, sous la protection desquels se réfugie, parfois, une analyse manquant de solidité » (Paillé & Mucchielli, 2003, p. 198 ; voir aussi Ndiaye & St-Onge, 2015).
Lavoie met en tension l’obligation journalistique [de recherche] de validité avec une certaine obligation d’authenticité : que devons-nous faire si les témoignages recueillis sont partiels et partiaux ou encore dégagent un droit à l’opacité (résistance/évitement), et donc ne peuvent pas être présentés de façon manifeste? Souvent, la norme journalistique [académique] le poussait à effacer cette authenticité et ses doutes. Parfois, il s’agissait d’une décision responsable (intérêt public et personnel) de ne pas creuser ou diffuser. D’autres fois, n’était-ce pas une simplification, voire une mauvaise représentation d’une situation complexe? Lavoie se retrouve parfois devant la « double impossibilité de dire et de taire » (p. 217). Que faire dans ce cas? « Que peut le journalisme [la recherche] face à l’invérifiable? » (« Présomptions discutables », p. 217).
Cela soulève bien évidemment la place que nous laissons au doute, à l’incertitude, à l’invérifiable, aux impressions et aux informations partielles et partiales en recherche. Si, d’un côté, il est important de s’appuyer sur des informations et des savoirs valides, cette « validité » peut être difficile à atteindre comme nous avons vu. Dans leur article Collecting data or creating meaning?, Julie White et Sarah Drew (2011) critiquent la vision romantique et passée de prendre pour argent comptant (face value) les histoires racontées par les participants et participantes. En s’inspirant de Rolland Barthes (1984), elles avancent que le texte n’est pas quelque chose de produit par l’auteur ou l’autrice, mais bien quelque chose de créé par le lecteur ou la lectrice. Les entretiens, par exemple, sont des performances (Alvesson, 2003). Et même lors de l’écriture, comme nous le démontre Lavoie, il peut être difficile, voire impossible, de simplement « laisser les voix parler d’elles-mêmes » ou de « donner la voix » (2023, p. 40) (voir aussi Jackson, 2003 ; Jackson & Mazzei, 2009). Ce à quoi arrive Frédérick Lavoie dans son livre, c’est justement de problématiser et d’aborder ce doute et ce trouble qui sous-tendent l’incertitude et l’invérifiable, tout en arrivant à en tirer des conclusions (hésitantes et ouvertes).
Normes et attentes
Un deuxième thème, lié au premier, ressort des récits de Lavoie : le rôle des normes et des attentes, car l’intrusion et la tension décrites plus haut s’inscrivent dans des structures plus larges. De façon très concrète, l’auteur démontre comment le monde journalistique [académique] a un effet performatif sur la pratique. Dans « Clé en main », il illustre comment le partenariat avec une ONG oriente la production d’un reportage [article], et ce, même si le journaliste [chercheur] a une liberté critique. Ceci peut sembler évident, mais la réalité est plus complexe. Dans le cas du journalisme international, le partenariat garantit l’accès au terrain, une certaine « histoire » et donc une justification à déployer les ressources pour un média. Bien qu’un ou une journaliste [chercheur ou chercheuse] peut être critique envers une ONG, il se peut aussi qu’une certaine sympathie se développe
à l’égard de ses travailleur.euses qui, contrairement à ellui, améliorent concrètement au jour le jour le sort de leurs frères et soeurs humaines plutôt que de regarder l’étendue de leur misère derrière le plexiglas de l’objectivité journalistique [scientifique]
Lavoie, 2023, p. 146, l’italique est de l’auteur
Le ou la journaliste [chercheur ou chercheuse] adopte une approche par le haut, selon Lavoie, plutôt que de s’intéresser à l’expérience des personnes rencontrées, c’est-à-dire que ce sont des personnes en position d’autorité (ONG, journaliste, rédaction) qui décident les sujets à enquêter. Qu’arrive-t-il si en étudiant un programme d’une ONG, on se rencontre qu’une autre innovation – moins remarquable – ait plus d’importance que celle sur laquelle nous devons enquêter (« Clé en main »)? Qu’arrive-t-il si ce qui est significatif et important dans l’histoire est aussi réducteur (« Qui tue la Buriganga? »)? En ce sens, le format de l’article, les attentes de la rédaction et du lectorat ne nous permet pas toujours d’aborder la complexité et les nuances qui caractérisent la situation. Le journalisme [la recherche] condamne-t-il nos choix, se demande-t-il?
Bien qu’un article journalistique diffère grandement d’un article scientifique – tant sur le fond, la forme et le processus –, on ne peut pas s’empêcher à cette lecture de remettre en question les limites imposées par les normes et les attentes de nos disciplines en sciences sociales. Cet aspect a été discuté par plusieurs (par exemple, Pullen et al., 2020; Richardson, 1990; Weatherall, 2019), mais en lien avec le premier thème, on peut se demander plus précisément : comment les normes et les attentes laissent-elles peu de place à l’incertain et aux doutes, pourtant des dimensions de compréhension et de la complexité? Aussi, Lavoie met le doigt sur la question : comment le cadrage des enjeux influence-t-il notre rapport au monde que nous tentons de comprendre? En somme, le chercheur ou la chercheuse [journaliste] arrive toujours avec une certaine idée de sur quoi portera son regard. Peut-être a-t-il ou a-t-elle une liberté pour s’ajuster et prendre au bond une nouvelle orientation. Peut-être qu’une entente partenariale, une subvention, une direction de recherche, une contrainte temporelle, une pression à publier, un angle mort ou une inaptitude/méconnaissance l’en empêche aussi. Bref, nous voyons bien ici comment le travail de terrain, et ensuite d’écriture, est un constant jeu d’équilibre entre des tiraillements, des tensions et des compromis. Le chercheur ou la chercheuse [journaliste] doit faire des choix, parfois rapidement, et s’ajuster face à des contraintes qui peuvent être à la fois habilitantes ou contraignantes.
La deuxième partie du livre offre une illustration des enjeux qui ressortent « du travail de terrain » du journaliste [du chercheur ou de la chercheuse]. Frédérick Lavoie porte une réflexion critique sur sa pratique et surtout sur certaines illusions que l’on peut avoir, et qu’on peut tenter de masquer ou de faire disparaitre (in)volontairement dans le rendu final : l’article. Si certaines personnes peuvent y voir une attaque à la crédibilité de la profession journalistique [de recherche], j’y vois plutôt une tentative de la rendre plus sensible, humble, authentique et incarnée. En fait, Lavoie aborde les « tabous » qui se cachent derrière le travail de terrain – que l’on tente parfois de masquer –, mais qui sont pourtant riches en connaissances. Dans son article Relaxing the taboo on telling our own stories, le chercheur Michel Anteby (2013) souligne que le travail de recherche demande à la fois une distance et un engagement. Or, dans une vision traditionnelle de la recherche, l’engagement est souvent vu comme en opposition à une « posture professionnelle » (p. 1277). Anteby argumente à partir de son expérience et celle d’autres personnes que les façons dont nous maintenons une distance et nous engageons dans un terrain peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que nous étudions. Plus récemment, Anteby (2024) démontre comment le simple accès (ou même le refus!) à un terrain peut nous en apprendre sur celui-ci. En recherches qualitatives, les incertitudes, l’invérifiable ou le refus peuvent générer des connaissances lorsqu’on explore les effets émotionnels ou subjectifs que ceux-ci génèrent (Kisfalvi, 2006).
C’est ce à quoi arrive Lavoie, contribuant ainsi à rendre le journalisme [la science] plus poreux et flexible :
un journalisme [une science] qui, en somme, saurait approcher le différent, l’inconstant, l’incongru et l’insoluble non pas comme une donnée sauvage à dompter et à mettre en cage pour mieux la transformer en certitude, mais comme la promesse d’une connaissance inédite qui ne peut émerger qu’à travers la négociation des paramètres de sa mise en récit
2023, p. 254
D’un point de vue pratique, cette deuxième partie offre aussi pour les chercheurs et chercheuses un exemple de techniques d’écriture pour aborder l’incertitude et le doute. Ces récits de terrain sont à la fois un partage de témoignages (verbatim), de contextualisation historique et documentaire, de pensées et sentiments. Mais surtout, les récits se concentrent sur l’interaction qui se déroule. Lavoie offre des interprétations des possibles, tout en les gardant ouverts. Ces interprétations incertaines permettent d’aborder la complexité, sans la simplifier ou la réifier. Elles constituent à mon sens une richesse et contribuent à donner une épaisseur à ses récits et son expérience (Sergi & Hallin, 2011). Ce que Lavoie arrive à faire c’est « mettre en doute » son autorité comme narrateur[4], comme il le souligne plus loin : « […] je ne possédais pas les compétences pour absorber ces réalités de manière assez vaste et perspicace de faire autorité à leur sujet » (2023, p. 253, italique de l’auteur). Ici, l’autorité attendue du journaliste [du chercheur ou de la chercheuse] entre en tension avec l’humilité de sa posture.
Transposer le doute à la recherche
À cette étape, la lecture de Troubler les eaux me bousculait sur plusieurs plans. Certaines personnes peuvent se demander à quel point l’expérience de Frédérick Lavoie peut se transposer au monde de la recherche. Après tout, il s’agit d’une enquête faite par un journaliste canadien au Bangladesh auprès de communautés marginalisées. Plusieurs éléments spécifiques marquent ce contexte et créent un terreau fertile aux enjeux qu’il rencontre : il est un homme blanc, son projet de journalisme international s’inscrit dans des rapports Nord-Sud, il existe une distance culturelle et linguistique, il travaille sur l’eau, un enjeu sensible tant au niveau politique qu’aux niveaux économique et sanitaire, et essentiel pour la survie.
Lavoie est réflexif et autocritique à de nombreux moments dans l’ouvrage (voir particulièrement « Fond du malaise », « Je n’est pas l’autre », « Oui, mais… »). Il faut dire que c’est un journaliste avec une bonne expérience en couverture internationale. Il est journaliste indépendant d’autant plus – il tient aussi des collaborations avec des médias québécois (Le Devoir, La Presse, ICI Radio-Canada, Le Quotidien). Il a plusieurs essais à sa fiche (2012, 2015, 2018; Lavoie & Lavoie, 2018) – en plus d’une série télévisée : À table avec l’ennemi (Lavoie & Crête, 2014). Il a couvert une variété de territoires, des contextes de guerre (Ukraine), et connaît particulièrement l’Asie du Sud, vivant lui-même en Inde depuis quelques années, parlant l’hindi (et le russe). Il affirme être animé par des valeurs de justice sociale et démocratique. Bref, on ne peut pas simplement expliquer son trouble par la naïveté ou l’inexpérience – peut-être certains réflexes masculins et occidentaux, il le reconnaît.
En ce sens, on est face à une personne aguerrie avec une expérience critique et indépendante qui s’est lancée dans l’enquête au Bangladesh. Si, en effet, certains facteurs demeurent spécifiques (traduction linguistique et interculturelle, par exemple), il n’en demeure pas moins que son expérience soulève des réflexions très importantes pour la recherche [le journalisme]. Pour le journaliste d’expérience qu’est Lavoie, ouvrir les boîtes noires du travail de terrain et du travail d’écriture a été une expérience troublante… mais très générative.
En fait, moi-même, je me voyais dans les questionnements et les dilemmes que Lavoie vivait. Je suis doctorant en administration, avec une certaine expérience d’enseignement et de recherche qui précède mon doctorat. Je travaille sur les tensions organisationnelles que vivent des groupes communautaires et militants à Montréal, dont certains ne correspondent pas à mon identité sociale (homme blanc qui étudie par exemple un groupe antiraciste). Mon approche méthodologique s’appuie sur la recherche-action participative dans la tradition sud-américaine (Fals-Borda, 1997) et féministe (Maguire, 1987; McIntyre, 2008). Je travaille – et aspire – à une certaine vision de faire de la recherche [du journalisme] autrement, tant sur le fond que sur la forme. Les questionnements et les doutes qui touchent la positionnalité, le fait de donner une voix, les approches par et pour, les rapports de pouvoir… m’habitent au quotidien. C’est peut-être pourquoi Troubler les eaux a résonné avec moi : il offrait un reflet de mes doutes et mes dilemmes vécus sur le terrain malgré nos champs disciplinaires distincts.
Lavoie pose par ricochet des questions importantes au monde de la recherche [du journalisme] : comment certaines normes et attentes académiques [journalistiques] réduisent-elles l’espace laissé à la recherche engagée [au journalisme engagé]? Comment mener une recherche engagée comme personne en position de pouvoir qui travaille dans une institution qui demeure élitiste (comme l’université [un média]) et qui aspire à travailler avec des populations marginalisées? Par exemple, est-ce possible de penser une collaboration entre un chercheur homme blanc et un groupe antiraciste composé principalement de femmes racisées? Si oui, quelles en sont les modalités? Quels en sont les enjeux? J’ai la chance d’expérimenter en ce moment même cette collaboration — principalement grâce à l’accueil et à la volonté du groupe à explorer ces questions. Il est trop tôt pour nous (le groupe et moi) d’avancer des conclusions à ce titre. Mais ce que Lavoie nous apprend, particulièrement à moi comme chercheur, c’est la place que la recherche [le journalisme] doit laisser au doute et au trouble. Comment peuvent-ils être génératifs? Comment les aborder dans l’écriture de la recherche? Comment les écrire dans les cadres qui nous sont imposés? À ce titre, Lavoie offre quelques pistes de réponses.
Habiter le doute et vivre avec le trouble
Frédérick Lavoie tire ses réflexions principalement de deux penseuses qui nous sont familières en sciences sociales : Donna Haraway et Anna Tsing. Pour remettre en question les enjeux entourant la production de connaissances journalistiques [scientifiques], il mobilise la notion de savoirs situés d’Haraway et sa critique de l’objectivité (dominante) (1988).
L’application qu’il en fait lui permet de faire ressortir des éléments contextuels qui le poussent à faire une « bonne » enquête classique et « objective » : une pression temporelle et de ressources qui le pousse à maximiser son temps sur le terrain (efficacité); des relations de collaboration (fixeurs) plutôt transactionnelles (répondre aux besoins du journaliste [du chercheur ou de la chercheuse] plutôt qu’au besoin des communautés); l’importance de la neutralité/impartialité dans le rendu de l’enquête; une conception du doute qui « réfère généralement à ce scepticisme sain que l’on entretient à l’égard de l’exactitude et de la véracité des faits et des témoignages que l’on recueille » (Lavoie, 2023, p. 244). En d’autres mots, le journaliste [le chercheur ou la chercheuse]
sait poser des questions et sait douter des réponses. Ce qu’il sait moins faire toutefois, c’est remettre en question les questions mêmes qu’il a l’habitude de poser et de se poser, et le lieu d’où il les pose et se les pose
p. 244
Ces enjeux se transposent au monde de la recherche, mais pas facilement, car ils remettent en question une vision traditionnelle de la recherche (objective, distante et neutre). À partir de la notion de savoirs situés d’Haraway, Lavoie problématise son rôle et son autorité de journaliste [chercheur ou chercheuse]. Pour Haraway et dans une perspective féministe, l’objectivité n’est pas de l’ordre de la transcendance, mais bien d’une incarnation particulière et spécifique. Tout savoir est construit à partir d’une vision située. Ce qui n’équivaut pas au relativisme. Au contraire, Haraway (1988) reconnaît qu’une vision implique du pouvoir de voir. Afin d’adopter cette objectivité incarnée, nous devons identifier la position d’où l’on parle et reconnaître que ce que l’on étudie n’est pas un objet passif, mais bien un sujet avec une agentivité (pouvant mobiliser son droit à l’opacité, par exemple).
À force d’habiter le doute, de retourner mes questions dans tous les sens, d’explorer mes angles morts et ceux du journalisme, quelque chose s’était tranquillement mis à prendre forme en arrière-plan de ma paralysie; quelque chose, comme le sentiment d’une certaine cohérence; quelque chose comme le début d’une confiance en ma capacité, ma légitimité et même de pratiquer le journalisme autrement
Lavoie, 2023, p. 281
Dans la partie « Rouvrir le mystère », Lavoie mobilise l’ouvrage Friction : délire et faux semblants de la réalité d’Anna Tsing (2005) pour imaginer des méthodes plus informelles et aléatoires qui permettent d’habiter le doute et considérer le trouble (ce qu’il expérimentera dans le chapitre suivant, « Dérives fécondes »).
Dans Friction, Tsing nous invite à mettre l’accent sur les éléments de surprises et de doutes qui caractérisent le processus de recherche. Comme nous avons vu plus haut, l’arrivée du journaliste [du chercheur ou de la chercheuse] a un effet, une friction qui crée une possibilité de reconfiguration par la collision, la rencontre, le frottement : les rencontres hétérogènes et inégales peuvent être à l’origine de nouveaux agencements de culture et de pouvoir (Tsing, 2005). Les frictions sont le point de départ – la porte d’entrée – pour étudier un phénomène, une façon de se coller à la réalité plutôt que des éléments à silencer. Tsing nous pousse à valoriser les doutes, les troubles, les non-dits, le hasard, la surprise, les zones d’ennui, l’incompréhensibilité, l’incertitude.
C’est dans ces rencontres – nécessairement empreintes de rapports de pouvoir – qu’il est possible d’établir un dialogue et d’offrir des pistes de compréhension partielle et partiale, mais authentique. Tsing et Haraway sont bien conscientes que nous ne vivons pas de la même façon les histoires ou les événements que nous rencontrons. Toutefois, reconnaître le doute et le trouble constitue une première étape pour une collaboration selon elles.
La pensée de Tsing et d’Haraway permet de concevoir l’apport que peuvent avoir le doute et le trouble. Toutefois, il demeure difficile de l’appliquer dans une pratique journalistique [de recherche]. Lavoie se prête au jeu dans « Dérives fécondes ». Il tente avec des collaborateurs et collaboratrices au Québec et en Inde trois expériences[5] qui mettent de l’avant les frictions, cultivent le trouble et habitent le doute. Ils arrivent à produire des reportages et à dégager des réflexions intéressantes. Mais Lavoie laisse une impression de nager à contre-courant. Lui-même souligne la subtilité des résultats dans certaines expériences. Fait intéressant, c’est surtout la réticence de certains médias institutionnels d’investir dans le journalisme exploratoire, les cadres et les attentes d’un clip ou d’un article journalistique, et la difficulté d’aplanir certains rapports de pouvoir (genre, économique, travail) à travers une collaboration qui lui empêche d’explorer complètement ces expérimentations. Toutefois, deux éléments porteurs facilitent l’exploration de sa pratique alternative : un espace médiatique plus libre lui permettant de rompre avec le format traditionnel (dans la revue Liberté et Le Quotidien), ainsi que l’occasion d’aller couvrir la guerre actuelle en Ukraine, avec des ressources, une flexibilité et justement son espace médiatique libéré… lui permettant de faire place à des récits non dominants, à ses doutes et à proposer finalement un autre journalisme. Fait à noter, et que Lavoie ne souligne pas, ces espaces lui sont en partie accessibles, à mon avis, grâce à son expérience et à sa réputation comme journaliste indépendant, entre autres. Je doute que le « jeune Frédérick Lavoie » ait pu y avoir accès.
Conclusion
Quels apprentissages pouvons-nous tirer pour le monde de la recherche [du journalisme]? Tout d’abord, cela souligne la difficulté à mettre en oeuvre ses pratiques alternatives. N’empêche que les expérimentations, même à petites échelles, peuvent être riches en apprentissages. À ma lecture, c’est aussi le rôle de l’écosystème de publication : l’importance de s’ouvrir à d’autres formats et de se doter justement d’espaces qui acceptent ces expérimentations; de les cultiver, mais aussi de les valoriser. C’est possiblement un angle qui m’accroche plus, principalement parce que je m’intéresse à la recherche engagée et que j’ai eu la chance dans mon parcours d’avoir justement accès à certains espaces. Ma « jeune » expérience m’apprend tout de même que ce ne sont pas tous et toutes les jeunes doctorants et doctorantes qui en bénéficient… la pression et le cadrage à faire une « bonne recherche » arrivent très tôt dans le parcours et l’expérimentation est laissée ou suggérée à une certaine étape de sa carrière, comme Lavoie peut en bénéficier aujourd’hui (et heureusement pour lui), et ce, même si d’excellents exemples et une littérature nous appuient dans cette direction (voir l’appel fait par Elizabeth St. Pierre, 2021).
En ouvrant les boîtes noires du travail de terrain et d’écriture, nous nous confrontons à l’incertitude et à l’invérifiable en recherche, aux dilemmes et aux tensions auxquels nous sommes confrontés. À mon avis, et comme Lavoie arrive à le démontrer, cela complexifie et rend plus sensible notre pratique. Cette complexification demande certes plus d’efforts et de nuances, mais aussi permet de générer une compréhension plus précise, humble et ouverte. Cela peut être confrontant pour un chercheur ou une chercheuse dont la légitimité sociale repose sur l’acte de générer des connaissances précises. Cependant, loin de limiter notre capacité d’action, l’appel à considérer l’incertitude et l’invérifiable permet au contraire de s’ouvrir aux dimensions du faire et du écrire de la recherche que nous tenons souvent pour acquises ou encore que nous invisibilisons.
Si l’ouvrage Troubler les eaux m’a bel et bien troublé, c’est parce qu’il offre non seulement un reflet à mon identité de chercheur (je me vois bien dans Frédérick), à ma pratique de recherche que je qualifie d’engagée, mais aussi à mon monde de la recherche. Frédérick Lavoie arrive à mettre le doigt sur des doutes et un trouble que je ressens actuellement dans mon travail de recherche. Mais il m’offre aussi des exemples, tant pour la pratique de recherche que pour l’écriture, pour habiter ces doutes et vivre ce trouble. Et je pense surtout qu’il me et nous confronte à des questions importantes que nous devons nous poser et que j’ai tenté d’esquisser dans ce texte. Des questions auxquelles certaines personnes répondent déjà, auxquelles d’autres tentent d’élaborer des réponses, réponses dont certaines doutent peut-être. J’espère que cette note stimulera cette réflexion, causera un peu de trouble chez d’autres, et ouvrira un espace pour en discuter.
Appendices
Note biographique
Marc D. Lachapelle est doctorant en administration à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM). Il s’intéresse particulièrement aux tensions organisationnelles ainsi qu’aux pratiques et outils alternatifs en management. De plus, il travaille sur les questions des pratiques engagées de la recherche et de la pédagogie, tout comme sur l’utilisation des formes alternatives d’écriture académique. Il est chargé de cours en innovation sociale et en gestion alternative des organisations (HEC Montréal, Concordia, UQAM, Saint-Paul). Il a récemment lancé un projet de vulgarisation scientifique qui crée un dialogue entre les mouvements citoyens du Québec et le milieu de l’innovation sociale : Perspectives et dialogue en innovation sociale (FRQ-DIALOGUE).
Notes
-
[1]
Voir à ce titre l’excellent ouvrage d’Alecia Y. Jackson et Lisa A. Mazzei, Voice in Qualitative Inquiry, 2009.
-
[2]
Voir aussi l’ouvrage de Michel Anteby (2024) The interloper : Lessons from resistance in the field.
-
[3]
Un fixeur ou une fixeuse est une personne qui collabore sur le terrain avec le ou la journaliste. Cette personne est parfois une initiée ou une personne ayant des contacts privilégiés facilitant le ou la journaliste dans son travail. Dans certains cas, elle jouera aussi le rôle d’interprète.
-
[4]
Voir aussi Récits inachevés : réflexions sur la recherche qualitative en sciences humaines et sociales de Marie-Claude Thifault et Isabelle Perreault (2016) pour d’autres exemples. Notons aussi ici les proximités étymologique et sémantique entre les termes auteur et autorité.
-
[5]
Je n’aborderai pas en détail ici les expériences, car elles se transposent mal au monde de la recherche.
Références
- Alvesson, M. (2003). Beyond neopositivists, romantics, and localists: A reflexive approach to interviews in organizational research. The Academy of Management Review, 28(1), 13-33.
- Anteby, M. (2013). Relaxing the taboo on telling our own stories: Upholding professional distance and personal involvement. Organization Science, 24(4), 1277-1290. https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0777
- Anteby, M. (2024). The interloper. Lessons from resistance in the field. Princeton University Press.
- Barthes, R. (1984). Le bruissement de la langue. Éditions du Seuil
- Boo, K. (2012). Behind the beautiful forevers: Life, death, and hope in a Mumbai undercity. Random House Publishing Group.
- Fals-Borda, O. (1997). Participatory action research in Columbia: Some personal reflections. Dans R. McTaggart (Éd.), Participatory action research: International contexts and consequences (pp. 107-112). University of New York Press.
- Glissant, É. (1990). Poétique de la relation. Gallimard.
- Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599. https://doi.org/10.2307/3178066
- Jackson, A. Y. (2003). Rhizovocality. International Journal of Qualitative Studies in Education, 16(5), 693-710. https://doi.org/10.1080/0951839032000142968
- Jackson, A. Y., & Mazzei, L. A. (2009). Voice in qualitative inquiry: Challenging conventional, interpretive, and critical conceptions in qualitative research. Routledge/Taylor & Francis Group.
- Kisfalvi, V. (2006). Subjectivity and emotions as sources of insight in an ethnographic case study: A tale of the field. M@n@gement, 9(3), 109-127.
- Lavoie, F. (2012). Allers simples. La peuplade.
- Lavoie, F. (2015). Ukraine à fragmentation. La peuplade.
- Lavoie, F. (2018). Avant l’après : voyages à Cuba avec Georges Orwell. La peuplade.
- Lavoie, F. (2023). Troubler les eaux. La peuplade.
- Lavoie, F. & Crête, C.A. (2014). À table avec l’ennemi [Série télévisée]. TV5.
- Lavoie, F. & Lavoie, J. (2018). Frères amis, frères ennemis. Somme Toute.
- Maguire, P. (1987). Doing participatory research: A feminist approach. University of Massachusetts.
- McIntyre, A. (2008). Participatory action research. Sage Publications.
- Ndiaye, L. D., & St-Onge, M. (2015). Entre sensibilité épistémologique et légitimité méthodologique : réflexions autour d’une théorie de la recherche sensible. Spécificités, 8(2), 34-40. https://doi.org/10.3917/spec.008.0034
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2003). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Armand Colin.
- Pullen, A., Helin, J., & Harding, N. (2020). Writing differently. Emerald Publishing Limited.
- Richardson, L. (1990). Writing strategies: Reaching diverse audiences. Sage Publications.
- Sergi, V., & Hallin, A. (2011). Thick performances, not just thick descriptions: The processual nature of doing qualitative research. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 6(2), 191-208.
- St. Pierre, E. A. (2021). Post qualitative inquiry, the refusal of method, and the risk of the new. Qualitative Inquiry, 27(1), 3-9. https://doi.org/10.1177/1077800419863005
- Thifault, M.-C., & Perreault, I. (2016). Récits inachevés : réflexions sur la recherche qualitative en sciences humaines et sociales. Presses de l’Université d’Ottawa.
- Tsing, A. L. (2005). Friction: An ethnography of global connection. Princeton University Press.
- Weatherall, R. (2019). Writing the doctoral thesis differently. Management Learning, 50(1), 100-113. https://doi.org/10.1177/1350507618799867
- White, J., & Drew, S. (2011). Collecting data or creating meaning? Qualitative Research Journal, 11(1), 3-12. https://doi.org/10.3316/QRJ1101003