Abstracts
Résumé
Le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki a développé un protocole de gestion du patrimoine archéologique. Ce protocole se positionne en réaction aux abus passés et présents dans la gestion du matériel archéologique sur le territoire ancestral de la nation. Nous présentons dans cet article les défis auxquels le Bureau est confronté, illustrés par trois cas de figure : 1) les limites du rapatriement d’objets situés sur la portion états-unienne du territoire ancestral ; 2) l’enjeu des archéologues amateurs et de la constitution de collections privées ; 3) le cas du rapatriement d’une collection provenant d’un site funéraire w8banaki. Ces exemples nous mènent à affirmer que la vie des objets se poursuit bien au-delà de leur abandon dans le sol. Leur muséification constitue parfois leur mort sociale, mais une vie symbolique persiste, car ce matériel devient vecteur de revendications et de reconstruction symbolique. Les objets sont porteurs de savoirs et ils sont centraux à la construction identitaire des groupes et des individus. De plus, dans le contexte précis des nations autochtones, ils occupent un rôle de médiateur et sont sujets à diverses formes de politisation. Comme nous tentons de le démontrer en ancrant cet article dans l’expérience récente de la Nation w8banaki, les objets peuvent être instrumentalisés simultanément à diverses fins. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les démarches récentes et croissantes de rapatriement de matériel archéologique et ethnologique, un concept qu’il importe de considérer avec beaucoup de vigilance.
Mots-clés :
- W8banaki,
- Ndakina,
- rapatriement,
- réconciliation,
- décolonisation
Abstract
The Ndakina Office of the Grand Conseil de la Nation Waban-Aki has developed a protocol for the management of the W8banaki Nation’s archaeological heritage. This protocol is a response to past and present mismanagement of archaeological material on the Nation’s ancestral territory. In this article, we present the challenges faced by the Office, illustrated by three cases studies: 1) the limitations of repatriation of objects located on the American portion of the Nation’s ancestral territory; 2) the issue of amateur archaeologists and private collections; 3) the case of the repatriation of a collection from a W8banaki burial site. These examples lead us to assert that the life of objects continue well beyond their abandonment in the ground. Although their museumification may constitute their social death, a symbolic life persists as these material objects become vectors of restitution, resilience, and symbolic reconstruction. These objects carry knowledge and are central to community and individual identity (re) construction and healing. Moreover, in the specific context of First Nations, they play a crucial mediating role and are subject to various forms of politicization. Through the recent experience of the W8banaki Nation with repatriation, this article attempts to demonstrate that objects can be simultaneously instrumentalized for various purposes. It is in this context that the recent and growing efforts to repatriate archaeological and ethnological materials are taking place, a concept that must be considered with great vigilance.
Keywords:
- W8banaki,
- Ndakina,
- repatriation,
- reconciliation,
- decolonization
Resumen
La Oficina Ndakina del Gran Consejo de la Nación Waban-Aki ha elaborado un protocolo para la gestión del patrimonio arqueológico. Este protocolo es una respuesta a los abusos pasados y presentes en la gestión del material arqueológico en el territorio ancestral de la Nación. En este artículo, presentamos los retos a los que se enfrenta la Oficina, ilustrados por tres casos: 1) los límites de la repatriación de objetos situados en la parte estadounidense del territorio ancestral; 2) la cuestión de los arqueólogos aficionados y la constitución de colecciones privadas; 3) el caso de la repatriación de una colección procedente de un sitio funerario w8banaki. Estos ejemplos nos llevan a afirmar que la vida de los objetos continúa mucho más allá de su abandono. Su museificación constituye a veces su muerte social, pero persiste una vida simbólica, ya que este material se convierte en un vehículo de reivindicación y reconstrucción simbólica. Los objetos son portadores de conocimiento. Son fundamentales en la construcción de la identidad de grupos e individuos. Además, en el contexto específico de las naciones indígenas, desempeñan un papel mediador y están sujetos a diversas formas de politización. Como intentaremos demostrar anclando este artículo en la reciente experiencia de la Nación w8banaki, los objetos pueden ser instrumentalizados simultáneamente con diversos fines. En este contexto se inscribe la reciente y creciente repatriación de material arqueológico y etnológico, un concepto que se debe considerar con mucho cuidado.
Palabras clave:
- W8banaki,
- Ndakina,
- repatriación,
- reconciliación,
- descolonización
Article body
Les objets archéologiques ont une importance pour les Premiers Peuples en ce qu’ils contribuent à un processus de réappropriation de leur culture et du discours qui est produit sur celle-ci. Pour la Nation w8banaki (abénakise), les ancêtres ont transmis au fil du temps des savoirs, des gravures, des récits et des objets[1]. Ils ont aussi nommé des lieux et laissé sur le territoire des traces de leur occupation, traces qui sont aujourd’hui visibles dans les sols et l’imaginaire collectif w8banaki et qui font partie intégrante de leur patrimoine culturel et naturel. Ces traces se rendent jusqu’à leurs descendants par différents canaux, tant par l’oralité et la transmission des savoirs traditionnels et des récits que par des témoins matériels d’occupation du territoire et des anciens modes de vie. Sur le plan scientifique, l’artéfact archéologique ou ethnographique apparaît aussi comme porteur de savoir. Il constitue une composante matérielle fidèle d’un savoir-faire et d’une connaissance des ressources naturelles et représente une technologie ainsi qu’un marqueur culturel qui se transmet, évolue ou disparaît à travers le temps et selon les contextes. L’artéfact apporte des connaissances sur des contextes d’occupation du territoire mais peut aussi être perçu comme un objet fabriqué, utilisé et investi d’affection car il a appartenu à un ancêtre et renvoie directement à son quotidien (Spector 1993).
Les savoirs des objets du passé
Les connaissances acquises par l’étude des artéfacts permettent de préserver des repères sociaux nécessaires à la construction identitaire, mais aussi à des fins éducatives, artistiques et innovatrices. Par l’entremise de cette filiation avec les ancêtres, des connaissances du territoire se transfèrent et servent à la transmission culturelle et identitaire, en assurant un sentiment transcendant de continuité culturelle groupale et intergénérationnelle à laquelle l’individu contribue (Gimenez 2002 ; Chandler et Lalonde 2008). Retracer la filiation aux ancêtres par les traces matérielles laissées sur le territoire contribue également à l’intendance territoriale et à l’affirmation des Premières Nations puisque ces traces permettent de mesurer l’impact de l’anthropisation des territoires ancestraux et une série de changements sociaux associés aux transformations connexes du paysage culturel d’une Première Nation (Treyvaud, O’Bomsawin et Bernard 2018). Le passé est ainsi porteur d’une composante identitaire et de dimensions sociales, politiques et, ultimement, cosmologiques.
Pourtant, la production de connaissances historiques et archéologiques sur les peuples autochtones s’inscrit à l’intérieur d’un contexte colonial qui perdure à ce jour. L’héritage colonial de nos disciplines est à la source de l’expérience des Premières Nations avec l’archéologie et l’ethnologie. Malgré de nombreux appels à la décolonisation, cet héritage doit être pris en considération lorsqu’on s’intéresse aux enjeux liés au patrimoine archéologique des Premières Nations. Les archéologues, les historiens et les anthropologues formés aux traditions universitaires ont été longtemps placés aux avant-postes de la mémoire collective et ont agi comme les seuls gardiens et intendants légitimes de ces savoirs (Atalay 2012). Le choix des sujets de recherche, l’identification des sites, la catégorisation du mobilier archéologique et son interprétation furent longtemps teintés d’eurocentrisme et de colonialisme (Smith et Wobst 2004). Les résultats de recherche répondent souvent peu aux questionnements des Premiers Peuples sur l’occupation et l’utilisation passée du territoire ainsi qu’aux défis actuels de gouvernance des nations autochtones (Echo-Hawk 2000 ; Simpson 2014 ; Treyvaud, O’Bomsawin et Bernard 2018). Ce n’est que récemment que des voix autochtones et d’autres formes de discours sur l’histoire ont commencé à être admises dans la construction des récits historiques et nationaux (Lainey 2008). En effet, il a fallu une série de courants théoriques critiques pour prendre acte de l’empreinte occidentale et souvent coloniale des épistémologies mises de l’avant au sein des universités (Bibaud 2015).
Le Ndakina, territoire ancestral de la Nation w8banaki
Cet article est rédigé par trois employés du Bureau du Ndakina, le bureau territorial de la Nation w8banaki, dont l’expertise s’inscrit dans trois disciplines concernées par le thème du rapatriement, à savoir : l’archéologie, l’histoire et l’anthropologie sociale et culturelle. Il tend à partager des réflexions ancrées dans le point de vue d’acteurs non autochtones de l’intendance territoriale et employés du conseil tribal de cette nation. Cet article n’est donc pas issu d’une étude spécifique. Il présente une série de défis et d’écueils soulevés par la gestion et la circulation du matériel archéologique autochtone. À mi-chemin entre la théorie et l’empirisme, notre réflexion s’inspire de trois expériences récentes relatives au rapatriement de collections archéologiques auxquelles a été confrontée la Nation w8banaki, soit : 1) les limites du rapatriement d’objets situés sur la portion états-unienne du territoire ancestral, avec des exemples inspirés du National American Grave Protection and Repatriation Act (NAGPRA) ; 2) les archéologues amateurs et la constitution de collections privées ; 3) le rapatriement d’une collection provenant d’un site funéraire w8banaki. Ces expériences ont mené le Bureau du Ndakina à développer un protocole pour encadrer la gestion du patrimoine archéologique. Or, maintes considérations tant symboliques que scientifiques doivent figurer dans le processus de rapatriement des collections archéologiques, des restes humains et des objets funéraires et sacrés, considérations qui ont une portée politique, culturelle, patrimoniale et psychique. La complexité des enjeux nécessite, à nos yeux, une réflexion systémique et interdisciplinaire. Celle-ci sera encadrée par des théories critiques issues de trois principaux courants : l’archéologie des Premières Nations (Echo-Hawk 2000 ; Atalay 2012), les théories décoloniales (Smith 2013 ; Coulthard 2014) et la critique épistémique émise par le mouvement des études subalternes (Haraway 1988 ; Mayneri 2014 ; Spivak 2010 ; Adichie 2009).
Contexte à l’étude
La Nation w8banaki est composée des Premières Nations d’Odanak et de W8linak, regroupant un peu plus de 3000 membres. Elle porte une responsabilité d’intendance envers le Ndakina, son territoire ancestral. Le Ndakina couvre une bonne partie des États actuels du Vermont, du New Hampshire et du Maine, bien que les communautés w8banakiak soient établies au Québec.
Le patrimoine archéologique fait partie intégrante du territoire à protéger. La Nation s’appuie sur deux institutions pour assurer une surveillance de son patrimoine et, à l’occasion, rapatrier des objets culturels. Une première institution, le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-aki, est l’organe responsable des questions territoriales. Il a le mandat, entre autres, de représenter les Premières Nations d’Odanak et de W8linak en matière de consultations et de revendications territoriales, de protection du patrimoine archéologique et d’adaptation aux changements climatiques (Bernard 2021 ; Harris 2010 ; Smith 2013). La seconde institution, le Musée des Abénakis situé à Odanak, est un acteur majeur qui conserve les biens archéologiques et ethnographiques de la nation à des fins éducatives, culturelles et sociales. Depuis 1965, il place au coeur de ses responsabilités la transmission des savoirs et des savoir-faire traditionnels d’une génération à l’autre. Le Musée fait la promotion de la culture w8banaki et les résultats qui émanent des projets de la nation y sont souvent diffusés ou intégrés par l’entremise de différents supports (expositions muséales, musée virtuel, blogues, capsules vidéo, sentiers pédestres et de découvertes, sites archéologiques, floristiques et fauniques, etc.).
Les objets archéologiques portent en eux différents sens qui perdurent bien au-delà de leur abandon dans le sol. Dans une perspective psycho-psychanalytique, Guy Gimenez propose l’idée qu’un objet peut comporter au moins quatre dimensions : physique, psychique, relationnelle et groupale : « [il] s’agit d’un champ qui détermine des lieux et des objets qui ont un statut d’entre-deux, ou de plus de deux : entre deux espaces, entre deux psychés, entre deux temps, entre deux générations, etc. » (Gimenez 2002 : 2). Selon l’auteur, les objets peuvent occuper une fonction d’interface entre les champs de l’individuel, du groupal et du culturel (ibid.). Ils ont de multiples vies parallèles et se voient accorder une diversité de sens construits et négociés (Appadurai 1988). Cette perspective trouve une résonance dans l’analyse systémique des relations intergroupes et de la rencontre interculturelle (White, s. d. ; White et Emongo 2014)[2]. En contexte autochtone, cette relationalité des collections archéologiques est importante car elle met en lumière des rapports entre nations dont la dimension coloniale ne peut être occultée. En effet, le sens des objets est souvent construit à la suite de la production d’un discours scientifique, selon des critères externes à ces nations et qui ne tiennent pas toujours compte de leurs traditions, de leur oralité ou d’autres composantes de leur patrimoine immatériel (Atalay 2012 ; Oyen 2014)[3]. On y perçoit parfois une asymétrie dans l’analyse, la classification et l’interprétation des collections archéologiques et ethnologiques entre chercheurs et membres d’une nation autochtone (Giligny 2005). Comme le patrimoine archéologique et ethnographique occupe une grande partie de l’héritage culturel muséal canadien, nombre d’auteurs ont appelé à développer des stratégies pour éviter que les interprétations ne reflètent des représentations coloniales (Hanna 2005 ; Chalifoux et Gates St-Pierre 2017). Sur ce point, Bibaud affirme ceci :
Ce que les auteurs postcoloniaux, comme Edward Saïd, nous ont appris à reconnaître, c’est que la « décolonisation » – ici en ce qui nous concerne de la muséologie – ne reposerait pas tant sur la condamnation pure et simple des normes et des principes occidentaux, mais plutôt sur leur « désoccidentalisation », leurs déplacements et leurs ajustements. Bref, la « décolonisation » est aussi un projet épistémologique.
Bibaud 2015
Le rapatriement des collections est intimement lié à la réconciliation entre les gouvernements et les peuples autochtones (Vernier 2016). La Commission Vérité et Réconciliation du Canada a aussi relevé ce lien significatif par un certain nombre d’appels à l’action qui portent sur cet enjeu. Il apparaît intéressant dans ce contexte d’évaluer les cadres législatifs possibles qui permettraient aux nations autochtones de rapatrier leur patrimoine matériel et immatériel, dont les artéfacts archéologiques constituent une part importante. Au Canada, il n’existe pas d’encadrement légal fédéral[4] relatif au rapatriement, bien que certains protocoles d’ententes aient été négociés au cas par cas entre des Premières Nations et certaines institutions muséales ou universitaires (voir Warrick 2018). De fait, le rapatriement n’est jamais aisé en raison, entre autres, de la complexité de la relation historique et politique entre une multiplicité d’acteurs. Les protocoles existants semblent reposer sur des prémisses fragiles et des mécanismes imparfaits. Les exemples de la loi américaine, la Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGRPA), et deux autres expériences récentes de la nation nous serviront ici à illustrer la dimension – ou la vie – politique du rapatriement des collections archéologiques. Ces cas nous amèneront ensuite à discuter du concept de réconciliation dans une perspective critique afin de soulever certaines tensions et incohérences qui en émergent.
Expériences de rapatriement chez la Nation w8banaki
Les défis du cadre légal : l’exemple du NAGPRA
Le rapatriement et le NAGPRA soulèvent des questions fascinantes, vitales et complexes pour la discipline – questions concernant l’héritage, l’histoire, l’identité, l’épistémologie, l’ontologie, la culture matérielle, la religion, la loi et la société, la liberté académique, les politiques publiques, l’éthique et le politique.
Nash et Colwell‐Chanthaphonh 2010, notre trad.
Le NAGPRA est une loi fédérale états-unienne en vigueur depuis 1990 qui définit un processus légal de transfert des « ressources culturelles » à leurs « descendants linéaires » autochtones. Les agences fédérales et les institutions subventionnées par le gouvernement fédéral, telles que les universités ou les musées, se voient désormais obligées de publier un inventaire des biens autochtones qui sont en leur possession et de restituer le « matériel » à toute nation culturellement affiliée qui en fait la demande officielle – à condition qu’ils n’aient pas été cédés antérieurement par une nation. Sont couverts par la loi : 1) les restes humains ; 2) les objets funéraires ; 3) les objets sacrés ; 4) les objets issus du patrimoine culturel. Elle permet, de ce fait, une certaine reprise de contrôle par les peuples autochtones – reconnus par le gouvernement fédéral et situés aux États-Unis – sur l’usage, le discours et les travaux scientifiques qui porteront sur le matériel. Cette loi permet dès lors aux Premières Nations de jouer un rôle plus actif dans l’interprétation et l’affirmation de leur histoire collective et dans la recherche qui porte sur elles et sur leurs ancêtres. Le contrôle du matériel confère un certain regard sur la production scientifique qui en découlera et restitue un pouvoir aux groupes concernés. À cet effet, la loi s’inscrit dans une perspective de justice historique (Rose, Green et Green 1996). Rose et al. rappellent aussi qu’en favorisant le rapatriement du matériel archéologique et d’ossements aux nations concernées, le NAGPRA ne se présente pas en obstacle à la recherche (ibid.). La loi aurait d’ailleurs contribué à la documentation de nombreuses collections et, du fait même, à la multiplication des travaux scientifiques sur le sujet, que ce soit en muséologie, en archéologie et en ostéologie.
Toutefois, certaines failles ou contrecoups négatifs de l’application du NAGPRA ont été relevés (Rose, Green et Green 1996 ; Fine-Dare 2002 ; Hanna 2005) ; nous proposons d’en relever trois types qui trouvent particulièrement écho dans l’expérience récente de la Nation w8banaki. En premier lieu, la nécessité de prouver l’affiliation culturelle d’une nation (« Indian tribe » selon le texte de la loi)[5] à une collection semble parfois contestable et reflète une compréhension erronée des dynamiques et des territorialités des peuples autochtones. La loi définit l’affiliation culturelle comme suit :
« affiliation culturelle » signifie qu’il existe une relation d’identité de groupe partagée qui peut être raisonnablement retracée historiquement ou préhistoriquement entre une tribu indienne ou une organisation hawaïenne autochtone actuelle et un groupe antérieur identifiable.
43 CFR 10.11, NAGPRA, notre trad.
La démonstration scientifique par liaison biologique, anthropologique, archéologique ou historique de la descendance linéaire et de la filiation entre le groupe (pré)historique et la nation contemporaine est un point central de la loi. Deux scénarios sont possibles : le matériel sera restitué soit aux descendants linéaires du groupe de provenance des artéfacts et ossements, soit au groupe situé géographiquement à proximité du site « de provenance » du matériel. Or, une incertitude inhérente à la recherche scientifique demeure souvent et n’est pas prise en considération lors du processus de rapatriement à cause de la rigidité du cadre juridique scientifique (Fine-Dare 2002 ; Lainey 2008). En effet, cette démonstration de filiation ne peut se faire sans poser de problèmes éthiques et conceptuels, notamment quant aux notions hautement politiques de nation, territoire et territorialité.
On retrouve dans la loi une incompatibilité qui peut être de plusieurs ordres. D’une part, plusieurs nations sont composées de membres aux origines multiples, ou issus d’échanges et d’intermariages entre groupes autochtones qui étaient très mobiles sur le territoire. La Nation w8banaki n’y fait pas exception. Par exemple, Odanak et W8linak ont été des points de chute pour divers groupes w8banakiak, historiographiquement présentés comme les Norridgewocks, les Pigwackets, les Sokokis, etc. Cette compartimentation en diverses nations tend à exclure des considérations les échanges humains et culturels (voir Delamour et al. 2017). En résumé, ce sont les définitions mêmes de « nation » et de « territoire » selon des critères occidentaux qui apparaissent contestables ici. La conception de l’affiliation culturelle portée par le NAGPRA contredit ou ignore donc l’histoire et les territorialités autochtones d’Amérique du Nord, car elle conçoit la délimitation des territoires autochtones selon les frontières nationales actuelles, sans tenir compte des limites antérieures des territoires ancestraux. Cette vision apparaît incompatible avec le caractère fluide de la territorialité des groupes algonquiens, qui a favorisé les échanges et le partage du territoire (Charland 2006 ; Marchand 2012 ; Pawling 2016). Dans cette dernière perspective – et considérant l’existence des zones de chevauchement territorial et d’échanges continus entre une multiplicité de groupes culturellement, linguistiquement et géographiquement très proches –, il peut être très difficile, voire parfois impossible, de déterminer le fait qu’une seule nation puisse être culturellement affiliée à un site ou à une collection. En outre, les institutions muséales détenant actuellement les collections des sites « paléoindiens » refusent de se départir de ces objets en argumentant que l’ancienneté des objets ne permet pas leur affiliation à une nation contemporaine. Elles se considèrent ainsi comme les seuls gardiens légitimes de ce patrimoine ancien, attitude que l’on peut considérer comme coloniale et paternaliste.
En second lieu, la construction de cette preuve de filiation peut devenir « coûteuse et frustrante » (Fine-Dare 2002, notre trad.) pour les nations qui l’entreprennent, ainsi qu’un « énorme fardeau financier et spirituel » (Nash et Colwell-Chanthaphonh 2010, notre trad.). Le temps et les ressources humaines et financières nécessaires pour entreprendre ce genre de démarche et pour mettre en valeur le matériel rapatrié représentent une importante limite au bon fonctionnement du NAGPRA (Vernier 2016).
Alors que les procédures de rapatriement peuvent prendre des années, le processus de justification de l’affiliation culturelle est excessivement rapide. Une notice avisant qu’un groupe a l’intention de rapatrier une collection est publiée en ligne trente jours avant que la démarche soit entreprise. Cela exige donc de la part des nations autochtones de déployer d’importantes ressources et une grande vigilance, ne serait-ce que pour maintenir une veille sur les activités du NAGPRA, et en particulier sur d’autres groupes voisins, voire rivaux. Ensuite, pour répondre à l’une de ces notices et entamer des démarches auprès du NAGPRA, une nation doit mobiliser maints efforts pour : 1) prendre une décision quant au potentiel du matériel en question et à son intérêt pour un tel matériel ; 2) répondre à l’institution fédérale concernée ; 3) monter un dossier et une preuve d’affiliation, c’est-à-dire enclencher une démarche et une réponse – qu’il sera difficile d’émettre dans un aussi court laps de temps.
Le rapatriement : vecteur d’autodétermination ou instrument politique ?
Si les récentes initiatives et les protocoles de rapatriement rappellent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en référence à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ce mouvement s’inscrit aussi dans un contexte où la longue histoire des politiques coloniales a créé des tensions inter- et intra-nations persistantes, auxquelles les démarches de rapatriement contribuent (ONU 2008). Comme soulevé plus haut quant à l’affiliation culturelle, les questions de rapatriement et de patrimoine peuvent alimenter des conflits liés aux territoires des nations autochtones ainsi qu’à leur occupation et à leurs revendications contemporaines. Dans le cadre du NAGPRA, une perspective critique met à jour ces rapports de pouvoir épistémiques et épistémologiques. Celle-ci aborde notamment la prétention persistante à l’universalisme de la recherche universitaire « scientifique ». Elle a été élaborée par le mouvement des études subalternes, il y a de cela plus de vingt ans (Mayneri 2014 ; Morris 2010 ; Spivak 2010), avec d’autres perspectives féministes et décoloniales (Adichie 2009 ; Coulthard 2014 ; Haraway 1988 ; Smith 2013). Ces courants ont démontré les processus d’effacement de l’Autre au profit des perspectives et des épistémologies issues du discours scientifique et occidental. Ils rappellent aussi le caractère historiquement, socialement, culturellement et géographiquement situé de toute connaissance (Haraway 1988).
Rose et al. rappellent qu’en optimisant les prérogatives éthiques des disciplines scientifiques, celles-ci ne s’en trouvent pas moins imbriquées dans un contexte politique de revendications territoriales et de frictions intergroupes (1996). Dans le contexte (post)colonial actuel, le NAGRPA peut encourager une politisation de l’archéologie et de l’histoire par des groupes ayant des intérêts sur certains territoires.
La Nation w8banaki vit actuellement des pressions liées aux enjeux que nous venons de soulever. Rappelons qu’une part importante de la population de cette nation habite aux États-Unis et détient la double citoyenneté canadienne et états-unienne. La portion états-unienne du territoire est encore habitée, utilisée et occupée par les W8banakiak, bien que ceux-ci soient membres des bandes d’Odanak ou de W8linak (GCNWA, comm. pers.). Une part du problème lié au rapatriement du matériel archéologique émane de groupes s’auto-identifiant en tant que W8banakiak au Vermont et au New Hampshire depuis les années 1990 (Roy 2003). Ces groupes s’inscrivent dans un mouvement analogue à celui très contestable de l’émergence de groupes « métis de l’Est » au Canada (Gaudry et Leroux 2017 ; Leroux 2018). Ceux-ci prétendent à une reconnaissance de leur héritage autochtone sans toutefois réussir à rattacher leur généalogie aux descendants contemporains ou historiquement connus par les communautés d’Odanak et de W8linak. Au sein de la Nation w8banaki, la crédibilité de telles prétentions repose justement sur cet élément essentiel. Celle-ci ne reconnaît pas la légitimité de ces groupes dits « Abénakis du Vermont » (Comité w8banaki d’affirmation, comm. pers.)[6]. Actuellement, ces groupes sembleraient rechercher par le rapatriement et la possession d’artéfacts et d’ossements une forme indirecte de reconnaissance de leurs revendications par des gouvernements, induite par un rapatriement et qui légitimerait, au moins symboliquement, leurs prétentions territoriales. Cette stratégie apparaît servir les intentions de reconnaissance de groupes auto-identifiés[7]. Sur ce point, le NAGPRA a justement prévu certaines procédures en cas de « demandes rivales » de rapatriement, c’est-à-dire lorsque plusieurs groupes plus ou moins affiliés revendiquent les mêmes territoires ou les mêmes collections. Un amendement du NAGPRA en 2010 oblige maintenant les institutions à rapatrier les restes humains à la nation dont le territoire est le plus près du lieu de découverte (43 CFR 10.11, Legal Information Institute 2021). C’est le caractère final du processus de rapatriement qui mènerait, dans ce cas-ci, à une certaine course au rapatriement entre différents groupes ou nations visant à prendre possession du matériel, « une fois pour toute » (Rose, Green et Green 1996).
Comme la portée géographique du NAGPRA ne traverse pas les frontières états-uniennes, il est impossible pour la Nation w8banaki d’entreprendre elle-même des démarches de rapatriement. Néanmoins, sur le site officiel du département de l’Intérieur des États-Unis, en charge de l’application du NAGPRA, il est reconnu que :
Le comité de révision du NAGPRA a reconnu qu’il existe des cas où des groupes non reconnus par le gouvernement fédéral peuvent constituer des demandeurs appropriés pour des items culturels.
USBR 2019, notre trad.
Dans le cadre d’une démarche en ce sens, l’organisation gouvernementale a pourtant affirmé au Bureau du Ndakina que :
La NAGPRA ne prévoit pas de transfert à un groupe non reconnu par le gouvernement fédéral, à moins et jusqu’à ce que le groupe se joigne à une demande d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral. Nous vous suggérons de contacter les tribus reconnues au niveau fédéral qui partagent une relation d’identité de groupe (affiliation culturelle selon NAGPRA) avec les restes ancestraux pour discuter de vos préoccupations et leur faire connaître votre position sur la question
GCNWA, comm. pers., notre trad.
Si les W8banakiak peuvent s’associer à une autre Première Nation reconnue par le gouvernement fédéral états-unien dans le but d’accéder à du matériel dont elle considère qu’il lui est culturellement et historiquement affiliée, d’autres groupes peuvent aussi opter pour cette méthode comme stratégie d’affirmation et de reconnaissance. En bref, le NAGPRA contribue à la réappropriation du patrimoine et de la recherche par les Premiers Peuples. Il a fait montre depuis son apparition d’une bonne foi gouvernementale dans une perspective de justice historique. Imparfait, il peut néanmoins faire l’objet d’une instrumentalisation politique qui crée certaines tensions.
Détection, chasses aux trésors et collections privées
Des formes contemporaines de pillages
Les activités d’archéologues amateurs constituent un autre phénomène lié à la protection du patrimoine archéologique autochtone. Il afflige d’ailleurs de manière croissante la Nation W8banaki. Au Québec, la rive sud du Saint-Laurent particulièrement, fait l’objet de pillages et de ventes illégales d’artéfacts, notamment en Montérégie, en Estrie, au Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches (GCNWA, comm. pers.). Depuis cinq ans, le Bureau du Ndakina constate une recrudescence des actes de pillages sur des sites archéologiques connus, dont le Fort Abénakis (CaFe-7), le site Bishop (BiEx-3) et l’île Montesson (CcFc-3 et CcFc-8), de même que sur des lieux d’intérêts culturels w8banakiak comme les carrières de schiste de la région de Windsor, le cimetière d’Odanak, les îles d’Alsig8ntegw (rivière Saint-François), les rives du lac Saint-Paul et de W8linaktegw (rivière Bécancour). Le Bureau du Ndakina et les responsables du Musée des Abénakis interviennent régulièrement sur des lieux de pillages. Malgré cette approche de sensibilisation à l’importance culturelle, scientifique et patrimoniale du matériel archéologique, les interventions se soldent en général par une dénonciation au ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) ou par une demande d’intervention à la Sûreté du Québec ou au corps de police de la Nation w8banaki. De plus, comme la presque totalité du Ndakina est en territoire privé, la surveillance et l’accessibilité des sites sont complexes, ce qui engendre des difficultés supplémentaires quant à la conservation et la protection du patrimoine archéologique provenant des sites culturels w8banakiak.
Les vallées de Kik8ntegw (rivière Chaudière), d’Alsig8ntegw et la région de l’Estrie sont régulièrement visitées par des « chasseurs de trésors » en provenance du Québec ou du nord-est des États-Unis. Ces individus ou petits groupes sont nombreux. Ils utilisent les données archéologiques et étudient les cartes historiques pour trouver des lieux à investiguer. Les propriétaires privés donnent généralement accès à leurs champs, en échange d’une compensation financière et sans même savoir qu’il s’agit d’une pratique illégale au Québec. Le Bureau du Ndakina a été témoin de cette pratique lors de ses sorties sur le terrain. Il arrive même que certains se rendent au Musée des Abénakis ou dans les locaux du Bureau pour se renseigner. La plupart des gens rencontrés affirment ignorer que leur pratique est illégale et qu’ils détruisent les contextes des sites archéologiques. Pourtant, une hache de pierre de 3000 ans et un calumet en alliage cuivreux du xixe siècle perdent beaucoup de leur pertinence scientifique lorsqu’ils sont dissociés de leur contexte archéologique.
La collecte d’artéfacts à l’aide d’un détecteur de métaux contribue à « dépouiller un lieu de ses biens en causant des dommages, mais aussi en s’attribuant indûment des biens, des idées, une oeuvre, etc. » (Compagnon 2010 : 189 ; Lecroere 2019). Le pillage des sites archéologiques ou d’intérêts culturels et patrimoniaux est largement documenté à la grandeur du globe. Plusieurs pays n’ont aucun encadrement législatif des découvertes à teneur archéologique, tandis que d’autres comme le Pérou ou le Mexique disposent de lois rigides (Compagnon 2010 ; Carpentier 2011). Cependant, ces lois ou règlements auraient des impacts mitigés sur le pillage archéologique. Selon l’UNESCO, la valeur marchande de cette pratique se chiffre en milliards de dollars, alors que le matériel est notamment écoulé sur des sites de vente en ligne (UNESCO 1970 ; 2021).
La pratique du pillage archéologique est interdite au Québec par l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette Loi vise à favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel dans l’intérêt public. Plus particulièrement, elle prévoit l’attribution de statuts légaux aux éléments du patrimoine archéologique, visant à assurer leur préservation (Québec 2011). Ainsi, pour réaliser des projets archéologiques en sol québécois, les connaissances, les compétences et la méthode du demandeur – acquises dans le cadre d’une formation académique – doivent être reconnues par le MCCQ, qui délivre ou non un permis autorisant la tenue de travaux archéologiques (surveillance, prospection, inventaire, fouille).
Les collections privées d’artéfacts autochtones
Des éléments du patrimoine archéologique des Premières Nations se retrouvent fréquemment au sein de collections privées, ce qui nuit au développement de connaissances sur l’occupation ancienne du territoire (Compagnon 2010 ; Rovet et al. s.d.). Les collectionneurs provoquent, par les échanges et la vente d’objets autochtones, un malaise grandissant au sein des communautés, des instances de la Nation w8banaki et des musées. Outre les impacts émotionnels et spirituels que peuvent avoir ces pratiques, la décontextualisation du matériel archéologique a de grandes conséquences pour la recherche et pour la Nation w8banaki. Nous évaluerons le cas du site Cliche-Rancourt (BiEr-14) en raison de son importance pour la nation.
La majeure partie des sites archéologiques de l’Estrie, au coeur du Ndakina, ont été découverts par des collectionneurs. Par sa situation géographique, les Appalaches et les bassins hydrographiques reliant la côte Est à Kchitegw (fleuve Saint-Laurent), l’Estrie est d’un grand intérêt culturel et patrimonial pour les W8banakiak. Il y a environ 15 000 ans, le retrait progressif de l’inlandsis sur cette région a favorisé la présence d’une flore et d’une faune propice à l’occupation humaine. La présence de ces premières occupations suscite l’intérêt des collectionneurs, qui procèdent à la récolte de centaines d’artéfacts relatifs aux périodes précédant l’arrivée des Européens. Ces artéfacts trouvés en surface et sur des sites érodés portent en eux des connaissances sur le Ndakina, l’histoire des W8banakiak et de leurs ancêtres. Retirés de leur contexte d’utilisation, ils ont perdu une bonne part de leur intérêt scientifique et culturel.
Le plus vieux site archéologique autochtone du Québec (12 000 ans) est situé sur le Ndakina, en Estrie, et est un des lieux d’origine de ces collections. Ce site a reçu le nom de Cliche-Rancourt (BiEr-14) en hommage aux propriétaires du site pour leurs efforts de « sauvetage » réalisés dans la région et leur implication dans le développement de l’archéologie au Québec (Chapdelaine 2007). Sans vouloir remettre en question le professionnalisme des responsables de ces projets ou les traditions archéologiques de l’époque, une série de constats méritent notre attention. D’une part, on s’interroge sur le fait que l’intervention archéologique au site Cliche-Rancourt ait été décrite comme une opération de sauvetage. Les raisons évoquées à l’époque pour statuer qu’une fouille de sauvetage était nécessaire sont la présence d’objets sur les berges ou en stratigraphies. Ces dernières ne montrent pas, de notre point de vue, que l’emplacement du site se trouvait dans une situation critique pouvant mettre en danger l’intégrité du site Cliche-Rancourt. En outre, le ramassage d’artéfacts réalisé à pied ou en embarcation sur les rives des plans d’eau de la région de Mégantic ne s’apparente pas à une intervention de sauvetage, mais plutôt à du pillage dans le but d’enrichir des collections personnelles. On déplore cette démarche, qui se poursuit encore aujourd’hui sur le Ndakina par l’entremise de chasseurs de trésors. Tout comme il y a 50 ans, la région de Mégantic et Sherbrooke continue d’être l’objet d’activités de pillages organisées. D’autre part, ces sites sont des vecteurs de savoirs traditionnels et de connaissances sur l’occupation et la gestion du territoire autochtone aux périodes pré- et coloniales. Or, malgré l’importance du site, aucune Première Nation concernée n’a été informée à l’époque de ces découvertes et des projets de recherche en cours. Certes, on ne peut contester le défi, voire l’impossibilité de faire un lien culturel entre le matériel du site en question, qui remonte à 12 000 ans, et les nations actuelles. Néanmoins, les membres des Premières Nations ont toujours fréquenté ces secteurs, et ce, jusqu’à aujourd’hui. À l’instar du NAGPRA, si l’on adhère à la vision w8banaki de l’intendance territoriale, la Nation a la responsabilité de veiller sur le contenu des sites. Il convient en terminant de se demander quel nom devrait porter le site archéologique autochtone le plus ancien du Québec et qui devrait en être son gestionnaire.
Une meilleure reconnaissance des territoires autochtones et de la présence dynamique et contemporaine de ces Nations apparaît ici essentielle dans nos pratiques de recherche. Sans promouvoir un rapatriement de la collection Cliche-Rancourt, il semble qu’une collaboration avec la Nation w8banaki aurait pu être mise en oeuvre au moment de la découverte du site ou au cours des dernières années. Des exemples de bonnes pratiques existent au Canada, dont en Nouvelle-Écosse, où depuis 1989 la Nation mi’gmaw s’occupe de la protection des sites Debert et Belmont. En partenariat avec les ministères provinciaux et fédéraux ainsi que les universités, la Nation Mi’gmaw dirige des projets de recherche, de préservation des sites et des collections archéologiques, en plus de faire la mise en valeur des connaissances. Plus précisément, c’est un conseil consultatif des aînés mi’kmawey debert qui a la charge de développer les projets de transfert des connaissances tant aux membres de la Nation qu’au public (voir Mi’kmawey 2021).
Dans le cas des collections privées, le contexte dans lequel ces objets furent acquis ou appropriés apparaît fort discutable. Dans ces circonstances, quelles sont les possibilités pour la Nation W8banaki de se réapproprier ses objets du passé ? À cet égard, un rapatriement par rachat des objets ou des collections qui appartenaient autrefois à la Nation n’est pas envisageable et ne peut être présenté comme un effort vers la réconciliation, et ce, même avec une aide financière des gouvernements. Pour la Nation W8banaki, ces objets ou artéfacts sont culturellement associés à leurs ancêtres et devraient ainsi revenir à la Nation, sans qu’elle ait à entreprendre des démarches de rachat.
Le rapatriement de la collection du site Lachapelle
La troisième étude de cas proposée concerne une offrande funéraire perdue dans les méandres d’une démarche de rapatriement d’une collection de la plus haute importance pour la Nation W8banaki, dont la demande a été faite au ministère de la Culture et des Communications du Québec. À l’automne 2018, le Bureau du Ndakina a ainsi été mandaté pour procéder au rapatriement de la collection du site Lachapelle (CaFf-3), situé à Saint-François-du-Lac. Le projet faisait suite à la demande des Conseils de bande d’Odanak et de W8linak. Les objectifs visés étaient de documenter et réviser de façon exhaustive la collection afin d’acquérir de meilleures connaissances sur les rites funéraires anciens et de mettre en valeur la collection archéologique au Musée des Abénakis. À la suite de ces travaux, encore inachevés, il est prévu de réinhumer les objets provenant des sépultures à Odanak, auprès des ossements humains ayant déjà été remis en terre.
Le site se trouve sur la rive ouest d’Alsig8ntegw, à moins de cinq kilomètres des sites CaFe-4, CaFe-5 et CaFe-7 situés dans la communauté d’Odanak. Deux campagnes de fouilles archéologiques ont été réalisées sur le site à la suite de la découverte fortuite d’ossements humains en 1993 par le propriétaire du terrain. La première intervention s’est faite sous forme de prospection par sondages archéologiques, tandis que la seconde campagne s’est consacrée à la fouille complète de deux sépultures. À la suite des différents travaux, les archéologues ont été en mesure d’estimer la présence d’au moins neuf sépultures additionnelles. Selon l’analyse du mobilier archéologique, le site démontre une continuité d’occupation depuis 5000 ans. Les datations au radiocarbone effectuées sur des ossements ont révélé que les individus reposant dans les sépultures seraient décédés entre 1490 et 1665 (Larocque 2000 ; Larocque et Poulin 1994).
Une bonne portion de la collection Lachapelle a été la cible d’analyses par le passé. Lors de la découverte initiale du site et de la fouille subséquente, les vestiges humains ont été analysés par Robert Laroque (Larocque et Poulin 1994 ; Larocque 2000). Les archéologues Daniel Poulin et Yves Chrétien ont effectué des analyses sommaires des artéfacts céramiques et lithiques (Larocque et Poulin 1994 ; Larocque 2000). Une partie des restes fauniques a aussi été analysée par Michelle Courtemanche et Évelyne Cossette de l’Ostéothèque de Montréal (Larocque 2000). Une étude neutronique de la composition chimique d’une alène en cuivre natif découverte sur le site a été effectuée par Jean-François Moreau (Larocque 2000). Finalement, une étude du cadre culturel, topologique et géomorphologique du site a été réalisée par la firme Ethnoscop en 1995 (Ethnoscop 1995). Une publication basée sur les interprétations initiales, sous forme de chapitre d’un collectif, est aussi disponible à l’intérieur du numéro 31 de la collection Paléo-Québec (Chapdelaine et Corbeil 2004). Une excellente analyse ostéologique des trois sépultures découvertes s’y retrouve (Larocque 2004).
Lors de l’étude des artéfacts et des contextes du site, une alène en cuivre natif mise au jour à côté du crâne d’un des défunts fut envoyée pour des analyses spécialisées de caractérisation chimique. Les outils de cuivre natif sont des objets rares et souvent associés à des sépultures ou des sites sacrés. En raison de leur couleur rouge (apparenté au sang de la Terre-Mère), de leur rareté et de leur provenance géologique, ces artéfacts ont une représentation symbolique importante pour les Premières Nations du Canada (Chapdelaine 2003a ; 2007 ; Treyvaud 2013). Pour répondre à des questions de provenance du matériau utilisé pour façonner cette alène, l’objet fut envoyé à un laboratoire ontarien, consigné dans le rapport technique daté de mai 2000. Dans le cadre du rapatriement de la collection au Bureau du Ndakina, l’équipe d’archéologie a cependant constaté que l’alène n’était plus dans la collection. Des recherches ont alors été entamées afin de retrouver l’objet en reconstituant ses différents passages dans les institutions québécoises responsables de la gestion des collections archéologiques (Université Laval, Université du Québec à Chicoutimi, MCCQ, etc.). Il semble que l’objet n’ait jamais été remis dans la collection déposée au MCCQ et qu’aucun avis de prêt pour analyse spécialisée ne soit parvenu ni à la Nation W8banaki ni au MCCQ. Selon les procédures, le contenu des boîtes déposées à la réserve doit correspondre à l’inventaire. Si l’archéologue désire conserver des pièces de la collection archéologique à des fins d’analyse, il doit en fournir la liste et signaler les raisons, la durée de l’emprunt et le lieu d’entreposage à la Direction de l’archéologie. Une convention de prêt est préparée par la direction.
Bien qu’anecdotique, il est désastreux que ce genre d’évènement puisse survenir. Le non-respect du protocole du MCCQ sur la recherche archéologique illustre dans ce cas les démarches auxquelles sont confrontées les Premières Nations. Le rapatriement d’une collection archéologique comporte des objectifs précis, dont la réappropriation des connaissances, la gestion du patrimoine de la Nation ainsi que la mise en place d’un programme muséal pour la diffusion des connaissances. Le site Lachapelle et sa collection archéologique présentent, par leur rareté et leur préservation, un intérêt indéniable pour la recherche archéologique (Larocque et Poulin 1994 ; Larocque 2000). Il en demeure aujourd’hui que plusieurs résultats, données et artéfacts émanant de ce projet de fouilles archéologiques ont été perdus, endommagés ou ne répondent pas aux intérêts de la Nation qui est pourtant la première concernée.
Cette récente expérience a également exposé des divergences d’interprétation entre les chercheurs universitaires et les chercheurs de la communauté sur les contextes archéologiques. À titre d’exemple, l’alène de cuivre natif découverte à côté du crâne du défunt de la sépulture 1 a été interprétée par les archéologues mandatés par le MCCQ comme un artéfact n’étant pas dans son contexte d’origine. Selon ces derniers, la sépulture daterait de la période du Sylvicole et l’utilisation du cuivre natif est généralement associée au Québec à la période de l’Archaïque. La présence de cet artéfact est accidentelle selon les chercheurs et il aurait été contenu dans les sédiments de remplissage de la fosse (Larocque et Poulin 1994 ; Larocque 2000). Les archéologues du Bureau du Ndakina sont, quant à eux, d’avis que cet objet pourrait constituer une offrande funéraire étant donné l’importance de sa nature, de sa signification et de son lieu de dépôt. On retrouve des objets de cuivre natif tout au long des périodes antérieures au Contact. Une perle oblongue de cuivre natif façonnée par enroulement et quelques rebuts ont d’ailleurs été mis au jour sur le site CaFe-7 à Odanak. Le contexte de découverte est associé à l’année 1571 (+/- 49). Le site archéologique CaFe-7 a révélé des contextes de fabrication d’objets d’alliage cuivreux (perles, cônes clinquants, tiges enroulées, pendentifs) façonnés à partir de morceaux recyclés d’objets européens, démontrant ainsi un savoir-faire traditionnel du travail des métaux (Treyvaud et Plourde 2017 ; Treyvaud 2013). Les recherches effectuées sur des collections archéologiques du côté états-unien du Ndakina (sites Tracy Farm et Old Point Mission) et les analyses spécialisées réalisées sur ce type d’artéfact exposent l’importance du cuivre natif et des alliages cuivreux, permettant d’affirmer qu’il s’agissait d’un objet ayant une grande valeur pour les W8banakiak (Chapdelaine 2003a ; Treyvaud 2013). Dans un tel contexte de divergence d’interprétation, les chercheurs devraient explorer la tradition orale autochtone. Outre ces aspects scientifiques, l’alène de cuivre natif était peut-être un bien familial qui a perduré à travers le temps. Cet aspect des rites funéraires a été discuté avec les membres de la Nation wabanaki. Bien que ce genre de dissensions soit chose commune dans l’interprétation des données dans le milieu de la recherche scientifique, ce cas rappelle l’importance d’accorder un plus grand espace aux perspectives spirituelles et aux interprétations des contextes par les Premières Nations concernées. La mise en place de projets collaboratifs et multivocaux permet d’éviter la publication d’un point de vue unique.
Discussion
Les trois cas de figure présentés ci-haut sont issus d’expériences vécues par la Nation W8banaki. Elles mettent en lumière des facteurs qui peuvent expliquer l’intérêt et les divergences dans la relation aux objets et aux savoirs entre une pluralité d’acteurs qui possèdent plusieurs régimes de valeurs (Appadurai 1986). À ce jour, au Canada, aucune réglementation ou ligne directrice nationale n’encadre explicitement les mécanismes de régulation du rapatriement entre les chercheurs, les institutions muséales et universitaires, l’État et les gouvernements autochtones. La gestion du patrimoine autochtone s’effectue au cas par cas.
Les peuples autochtones ont des rapports complexes avec le domaine scientifique, notamment l’archéologie. Aux xixe et xxe siècles, de nombreuses fouilles et travaux de conservation et de diffusion ont été effectués sans leur participation ni leur consentement. Plusieurs objets sacrés ou culturellement importants ont été dérobés et exposés dans des musées sans respect de leurs fonctions et de leurs significations. De même, plusieurs sépultures autochtones ont été étudiées et aliénées, mettant à mal la préservation de leur patrimoine matériel et immatériel (Echo-Hawk 2000 ; Smith 2013 ; Atalay et al. 2016 ; Bruchac 2018). Maintes lacunes demeurent au niveau de l’implication des Premiers Peuples dans la définition, l’acquisition, la préservation, la documentation, l’interprétation et la mise en valeur du patrimoine autochtone (Bell et Paterson 2009). L’archéologie des Premières Nations est une approche théorique et méthodologique qui repose justement sur le pouvoir décisionnel et organisationnel des peuples autochtones et leur capacité à mettre de l’avant des projets de recherche qui concernent leur patrimoine culturel (Bruchac, Hart et Wobst 2010 ; McGuire 1992 cité dans Nicholas et Andrews 1997). Ce mouvement théorique et méthodologique s’est développé au sein des Premières Nations états-uniennes au début des années 2000 afin de répondre à la problématique des chercheurs occidentaux qui étudient le patrimoine autochtone sans consulter les nations concernées. D’autant plus que les interprétations scientifiques, fortes d’une prétention universaliste, sont souvent teintées de colonialisme et occultent les savoirs traditionnels et la vision autochtone du temps et de l’espace (Smith 2013 ; Watkins 2000). Ce courant se démarque par la détermination des Premières Nations à prendre en charge la direction des projets de recherche et mettre en place des partenariats et des collaborations avec les chercheurs universitaires ou les instances gouvernementales partageant leur vision de la recherche en milieux autochtones (Atalay 2012).
Nous avons relevé quatre fonctions parallèles et complémentaires que les objets peuvent avoir : économique, politique, scientifique et symbolique (psychique, culturel et social). Ces dimensions sont mobilisées de façon simultanée dans tout processus de rapatriement, celui-ci s’inscrivant immanquablement dans un contexte socioculturel et politique complexe. Le rapatriement interpelle ainsi des questions de justice sociale et de justice historique liées à l’idée populaire de réconciliation (Vernier 2016). La gestion autonome du patrimoine archéologique par les Premières Nations a pour objectif que ces objets puissent contribuer à la construction identitaire et groupale de la nation concernée.
Pour ce faire, l’encadrement des processus de rapatriement ne doit pas reposer sur une vision univoque de la science occidentale en rapport aux autres systèmes de connaissance et de valeurs, ainsi qu’au détriment des prérogatives culturelles des Premières Nations (Jérôme 2013 ; Sterlin 2006). Margaret G. Hanna en appelle à une archéologie « négociée » ayant le potentiel de renforcer la discipline tout en la mettant au service des peuples autochtones (Hanna 2005). Ce genre de démarche ne doit pas non plus être conçu comme un obstacle supplémentaire au développement ou au bon déroulement des projets. En revanche, les peuples autochtones se doivent d’être vigilants quant aux dangers d’appropriation ou de réappropriation de la parole des membres et de la nation au profit des chercheurs ou de groupes auto-identifiés. Le cadre théorique des injustices épistémiques permet d’appréhender les enjeux de crédibilité des récits et des savoirs des groupes historiquement marginalisés en tant que reflets de rapports de pouvoir structurels entre groupes sociaux (Godrie et Dos Santos 2017). L’autrice nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie explique bien les dangers de la publication d’une histoire unique sur un peuple. Elle mentionne que « le pouvoir est l’habileté, non seulement de raconter une histoire sur une autre personne, mais d’en faire l’histoire définitive de cette personne » (Adichie 2009, notre trad.). Plusieurs critiques décoloniales ont également souligné que le pouvoir de modeler le passé d’un groupe contribue aux projets colonialistes (Delamour et al. 2017). De même, le caractère inachevé des décolonisations n’est plus à démontrer et les effets du colonialisme persistent dans toutes les sphères sociales, dont l’enseignement et le milieu de la recherche ne sont pas exclus (Haggis 2004 ; Mayneri 2014).
Une dimension profonde du colonialisme passe par ce qui est nommé l’épistémicide par Rebecca Sockebeson, chercheure d’origine penobscot (2020). Elle propose un dialogue intime inspiré de ses expériences personnelles avec le système éducatif occidental pour mettre en lumière une couche profonde d’effacement de sa culture et de son mode d’appréhension du monde, supprimée par la folklorisation (Sockbeson 2020). Cette perspective en appelle à nous méfier d’une hiérarchisation des savoirs ou de la préséance des intérêts scientifiques qui peut s’exprimer dans leur interprétation, notamment lors de la collision des représentations socioculturelles des objets et de leur fonction (Hanna 2005, Mayneri 2014 ; Desmarais et Jérôme 2018 ; Dubuc et Turgeon 2004 ; Jérôme 2013 ; 2014). Il convient donc de garder en tête les interstices relationnels et interculturels que crée le partage de perspectives sur un objet.
De la pertinence d’une gestion autochtone du patrimoine archéologique
Pour les W8banakiak, le territoire est un espace qui inclut l’occupation physique, l’utilisation des ressources et les savoirs et croyances qui y sont associés. Le Bureau du Ndakina a développé au cours des dernières années un protocole de gestion du patrimoine archéologique (GCNWA 2020). Sa création a été motivée par les nombreux obstacles auxquels le Bureau a été confronté depuis sa création en 2013. Il a été conçu à l’aide de l’approche méthodologique de l’archéologie des Premières Nations, qui vise à sensibiliser les membres d’une nation à la valeur de ses connaissances, à leur responsabilité vis-à-vis de leur territoire et de sa gestion et à la transmission des connaissances aux nouvelles générations.
Le protocole de gestion s’inspire d’initiatives semblables impulsées ailleurs au Canada et aux États-Unis (Atalay 2012 ; Atalay et al. 2016 ; Treyvaud, O’Bomsawin et Bernard 2018 ; Chalifoux et Gates St-Pierre 2017 ; Bernard 2021). Celui-ci vise à encadrer l’ensemble des découvertes archéologiques correspondant au territoire du Ndakina et émanant de projets de recherche, de découvertes fortuites, de travaux de développement d’infrastructures routières, énergétiques, touristiques ou de loisirs, ainsi que de l’exploitation des ressources naturelles. Plus précisément, il permet à ces instances d’inclure rapidement des règles concernant quatre situations : 1) les projets de développement d’infrastructures sur le territoire touchant des sites archéologiques existants et des sites sensibles pour la nation, déclarés ou non au MCCQ ; 2) les projets de recherches archéologiques universitaires ou de mise en valeur ; 3) les découvertes fortuites de restes humains ; 4) les demandes de rapatriement d’objets, d’artéfacts, de collections archéologiques, d’ossements humains ou de sépultures et de son mobilier funéraire (GCNWA 2020).
Selon ce protocole, les travaux archéologiques prévus sur le Ndakina doivent maintenant être réalisés avec l’autorisation des conseils de bande, que les sites soient proches ou éloignés des communautés. Les instances gouvernementales de la nation doivent être tenues au courant du déroulement des travaux, et les membres souhaitant participer aux fouilles et aux travaux archéologiques peuvent être formés afin d’intégrer les équipes de terrain. Le Bureau du Ndakina évaluera ensuite l’intérêt ou la nécessité pour la nation d’effectuer de nouvelles recherches archéologiques dans ces secteurs.
Le protocole s’inscrit dans un mouvement de réappropriation du discours historico-anthropologique. Cette démarche est très importante en raison de l’appropriation du matériel par des chercheurs, des individus et des groupes auto-identifiés. Il vise, de surcroît, à favoriser la reprise par la nation des modes de production de la recherche archéologique. Sur ce point, l’intégration d’assistants de terrain et de jeunes w8banakiak dans les recherches et les fouilles archéologiques menées par le Bureau du Ndakina a permis de mieux cerner les éléments des travaux qui retiennent l’intérêt des membres de la nation. Par exemple, les projets « Fort Odanak et W8linaktekw : La rivière abénakise » réalisés par la nation entre 2009 et 2018 comportaient une composante éducative et un volet communautaire qui visait à ce que la communauté s’approprie les travaux, notamment en engageant les jeunes comme apprentis archéologues. Selon Michelle Bélanger, directrice du Musée des Abénakis lors de la réalisation du projet Fort Odanak :
À travers le projet, ils découvrent leur culture, leur histoire, leur patrimoine, et leurs racines. Aussitôt qu’une découverte est faite, on leur explique à quoi servait l’objet et ils s’imaginent comment vivaient leurs ancêtres… Pour la première fois, ce ne sont pas des scientifiques qui viennent étudier le passé de la communauté et repartir avec ces informations-là.
Michelle Bélanger, directrice du Musée des Abénakis à l’époque du projet
Les apprentis archéologues pouvaient développer une relation particulière avec les découvertes de cette campagne de fouilles. L’un d’eux cherchait justement « ce que les ancêtres avaient fait sur le même territoire où je vis. Quelqu’un qui dépeçait un animal pour nourrir sa famille... […] Ce n’est plus juste hypothétique… ». À bien des égards, les découvertes peuvent activer chez ces jeunes de la nation un sentiment de continuité dans lequel ils s’inscrivent personnellement. À cet instant critique, un intérêt est éveillé. L’importance du sentiment de continuité culturelle dans la construction identitaire et en tant que facteur protecteur en santé mentale est maintenant bien connue en psychologie et en anthropologie (De Plaen 2000 ; Chandler et Lalonde 2008). Cet exemple de recherche communautaire collaborative nous mène à postuler que les recherches menées par la nation sur son propre passé nourrissent les processus d’affirmation identitaires auprès des jeunes générations.
Le rapatriement comme espace de réconciliation ?
Depuis la fin du xxe siècle, l’intérêt pour l’archéologie gagne en importance autant auprès des groupes autochtones qu’allochtones. Ce phénomène est partiellement tributaire des politiques gouvernementales coloniales et des prétentions de groupes allochtones sur les territoires ancestraux des Premières Nations. L’idée de rapatriement s’inscrit donc dans un contexte historique, social et politique bien précis. Les initiatives de rapatriement sont généralement sous-tendues par les concepts de réconciliation et de reconnaissance des nations autochtones, de leur entité et de leur autonomie politique. Or, si ces trois notions peuvent sembler faire partie d’une démarche plus vaste de décolonisation, elles peuvent être instrumentalisées, voire réifier une expérience coloniale (Raines et Bush 1992 ; Coulthard 2014). Les expériences présentées et vécues par le Bureau du Ndakina nous permettent d’affirmer que le rapatriement et la réconciliation sont des concepts qui ne sont pas à l’abri d’une réappropriation politique. Il importe de les employer avec prudence alors qu’ils semblent gagner en popularité et, dans certains cas, perdre en substance. En effet, du fait même de leur popularité grandissante, ils semblent être peu à peu dépouillés des implications critiques et décoloniales qu’ils portaient à l’origine.
Le contexte politique des revendications territoriales des Premières Nations ajoute une couche de complexité aux démarches de rapatriement et requiert une compréhension des dynamiques intergroupes et du statut juridico-politique de chacun vis-à-vis des gouvernements. En somme, il faut se garder de considérer une démarche de rapatriement comme étant de facto une mesure de réconciliation. Rappelons que le terme même de « réconciliation » implique qu’il y aurait déjà eu dans le passé une forme de conciliation entre les colonisateurs et les Premiers Peuples. Nombre d’acteurs adhèrent à cette expression sans nécessairement mettre en question ses implications terminologiques. En effet, ce genre de coexistence pacifique n’a jamais existé. Il apparaît donc que la popularisation croissante de ces termes ne sert principalement que les gouvernements allochtones, contribuant à la construction d’un nouveau mythe fondateur national.
Appendices
Notes biographiques
Edgar Blanchet, anthropologue de formation (M. Sc. en anthropologie, Université de Montréal, 2019), est actuellement chargé de projet en anthropologie sociale et culturelle au Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et enseignant en anthropologie au collégial. Il travaille, entre autres, sur des questions relatives aux territorialités, à la santé et aux savoirs autochtones. Sans s’y limiter, Edgar effectue la collecte de données auprès des membres de la Nation selon les protocoles développés par le Bureau et procède au traitement et à l’analyse des données de recherche. Il est l’auteur de nombreux rapports d’enquête sur l’utilisation et l’occupation contemporaine du territoire par les W8banakiak ainsi que de diverses publications.
Geneviève Treyvaud est titulaire d’un diplôme en orfèvrerie (HEAD-Genève), d’un baccalauréat en anthropologie et d’une maîtrise (Université de Montréal) et d’un doctorat en archéologie (Université Laval/INRS ETE). Elle est archéologue au Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et professeure associée au département d’histoire de l’Université Laval et au Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de recherche scientifique (INRS-ETE). Elle travaille particulièrement sur les périodes précoloniales et de contact ainsi que sur l’impact de la colonisation européenne sur les technologies traditionnelles et sur les territoires ancestraux des Premières Nations du Sud-Est du Canada. Au Bureau du Ndakina, son mandat consiste à développer des projets de recherches archéologiques afin de mieux connaître l’occupation ancestrale du territoire. En collaboration avec l’équipe du Bureau, elle voit à la protection du patrimoine archéologique lors des consultations territoriales et documente les modes d’exploitation des ressources naturelles et les techniques de fabrication de l’outillage ancien des W8banakiak.
Jean-Nicolas Plourde, candidat à la maîtrise en histoire (Université Laval), est historien au Bureau du Ndakina au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Il a notamment publié – en coll. avec Edgar Blanchet, Geneviève Treyvaud, Les aînés de la communauté d’Odanak, L’équipe jeunesse Niona du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et David Bernard – « Les strates de mémoire du presbytère d’Odanak » (Histoire Québec 24, n˚ 4 : 26-30, 2019) et « La mobilité w8banaki et la privatisation du Ndakina (xviiie-xxe siècles) » (Histoire Québec 25, n˚ 4 : 8-11, 2020). Il veille au sein du Bureau du Ndakina à intégrer les savoirs et données historiques relatifs à l’utilisation et l’occupation du territoire par la Nation W8banaki. Il assure également un soutien dans le cadre des revendications territoriales particulières de la Nation W8banaki.
Notes
-
[1]
« W8banaki » est le résultat de la contraction des mots w8ban (aurore) et aki (terre) qui, mis ensemble, signifient « Peuple de l’aurore » ou « Peuple de l’Est ». Le « 8 » indique une forme de « ô » ou de « on » nasal, un son qui n’existe pas dans la langue française. Le suffixe -ak est la marque du pluriel. Le gentilé n’a pas d’indicateur du féminin.
-
[2]
Lainey (2008) fait bien la démonstration de ce genre d’utilisation d’objets muséaux dans la construction identitaire d’une idéologie nationale en se servant de l’exemple des commémorations du 400e anniversaire de la Ville de Québec et des hommages rendus à Samuel de Champlain. Il documente les traces et l’évolution des interprétations du fameux wampum réputé pour avoir été donné à Samuel de Champlain lui-même. Or, aucune indication ne corrobore cette affirmation. Cette interprétation erronée n’est cependant plus remise en question. Il constate par cette étude de cas l’autorité des institutions muséales et, du fait même, leur responsabilité face aux savoirs produits quant à la mise en pratique d’une éthique rigoureuse dans les travaux qui sous-tendent leurs expositions.
-
[3]
Il est intéressant de mettre en relation la perspective exprimée par Gimenez (2002) avec celle du Laboratoire de recherche sur les relations interculturelles (LABRRI) de l’Université de Montréal. Ce groupe promeut l’utilisation d’une grille d’analyse systémique-interactionniste en trois niveaux d’analyse : l’individuel, le groupal/culturel (qu’ils réunissent) et l’universel. Les significations et les symboles qu’on attribue à un objet semblent pouvoir s’analyser suivant cette grille (White, s.d. ; White et Emongo 2014).
-
[4]
Cependant il existe certaines lois provinciales, notamment en Alberta et en Colombie-Britannique, qui encadrent la gestion du patrimoine archéologique.
-
[5]
Le NAGPRA utilise le terme tribes – qui englobe les vocables « bande », « nation » et « communauté ». La loi définit ainsi ce terme : « «tribu indienne» : toute tribu, bande, nation ou autre groupe organisé ou communauté d’Indiens, y compris tout village autochtone de l’Alaska (tel que défini ou établi en vertu de la loi sur le règlement des revendications autochtones de l’Alaska [43 U.S.C. 1601 et seq]), qui est reconnu comme pouvant bénéficier des programmes et services spéciaux fournis par les États-Unis aux Indiens en raison de leur statut d’Indien » (notre trad.).
-
[6]
Une résolution du Conseil des Abénakis d’Odanak datant du 29 septembre 2003 visait à dissocier les Abénakis d’Odanak des groupes s’auto-identifiant comme étant « Abénakis » aux États-Unis, à l’exception « de nos frères et soeurs à Wôlinak et Penobscots. Nous reconnaissons aussi, bien sûr, nos camarades des Premières Nations wabanaki – les Passamaquoddy, Malécites et Mi’kmaq » (Conseil des Abénakis d’Odanak 2003, notre trad.). Certains de ces groupes, dits « Abénakis du Vermont », ont néanmoins été reconnus par l’État du Vermont sans l’être par le gouvernement fédéral américain.
-
[7]
Phénomène croissant, de plus en plus d’Américains allochtones s’auto-identifient comme autochtones pour diverses raisons spirituelles, fiscales, ou encore pour fuir un certain malaise identitaire lié à l’identité « blanche » et coloniale (Hamidi, Leroux et Ross-Tremblay 2018).
Bibliographie
- 101st Congress. 1989. National Museum of the American Indian Act. https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/about/NMAIAct.pdf
- Adichie, Chimamanda. 2009. « The danger of a single story ». COMMONLIT. https://www.commonlit.org/en/texts/the-danger-of-a-single-story
- Appadurai, Arjun, dir. 1988. The social life of things: Commodities in cultural perspective. Cambridge : Cambridge University Press.
- Atalay, Sonya. 2012. Community-Based Archaeology: Research With, By, and for Indigenous and Local Communities. Berkeley : University of California Press.
- Atalay, Sonya, Lee Rains Clauss, Randall H. McGuire et John R. Welch, dir. 2016. Transforming Archaeology: Activist Practices and Prospects. New-York : Routledge Press.
- Bell, Catherine E. et Robert K. Paterson, dir. 2009. Protection of First Nations Cultural Heritage: Laws, Policy, and Reform. Law and Society Series. Vancouver : UBC Press.
- Bernard, David. 2021. « La création du comité w8banaki de coordination de la recherche ». Dans Kasalokada ta lagwosada. Réalités et enjeux de la recherche collaborative en milieux autochtones. Sous la direction de Carole Delamour, Jo Anni Joncas, Davis Bernard, Benoit Éthier et Francesca Croce, 123-135. Sherbrooke : Éditions Peisaj.
- Bibaud, Julie. 2015. « Muséologie et Autochtones du Québec et du Canada. De la crise à la « décolonisation tranquille ». Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain 15 https://doi.org/10.4000/mimmoc.2169
- Bruchac, Margaret M. 2018. « Broken Chains of Custody: Possessing, Dispossessing, and Repossessing Lost Wampum Belts ». Proceedings of the American Philosophical Society 162(1) : 56-105.
- Bruchac, Margaret M., Siobhan M. Hart et Martin H. Wobst, dir. 2010. Indigenous Archaeologies: A Reader on Decolonization. New-York : Routledge Press.
- Bureau of Reclamation. 2019. The Native American Graves Protection and Repatriation Act. https://www.usbr.gov/nagpra/index.html
- Carpentier, Vincent. 2011. « Halte au pillage ! ». Revue archéologique de l’Ouest 28 : 290‑291.
- Chalifoux, Éric et Christian Gates St-Pierre. 2017. « Décolonisation de l’archéologie : émergence d’une archéologie collaborative ». Salon : un éclairage sur la société par les revues savantes. https://salons.erudit.org/2017/08/01/decolonisation-de-larcheologie/
- Chandler, Michael J. et Christopher E. Lalonde. 2008. « Cultural Continuity as a Protective Factor against Suicide in First Nations Youth ». Horizons –A Special Issue on Aboriginal Youth, Hope or Heartbreak: Aboriginal Youth and Canada’s Future 10(1) : 68-72.
- Chapdelaine, Claude. 2003a. « Les objets en cuivre natif ». Dans Île aux Allumettes. L’archaïque supérieur dans l’Outaouais. Sous la direction de N. Clermont, C. Chapdelaine et J. Cinq-Mars, 219-252. Coll. Paléo-Québec 30. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
- Chapdelaine, Claude. 2003b. « Le Méganticois : la vingt-cinquième école de fouille, juillet-août 2003 ». Rapport de recherche archéologique. Université de Montréal.
- Chapdelaine, Claude, dir. 2007. Entre lacs et montagnes au Méganticois : 12 000 ans d’histoire amérindienne. Coll. Paléo-Québec 32. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
- Chapdelaine, Claude et Pierre Corbeil, dir. 2004. Un traducteur du passé. Mélanges en hommage à Norman Clermont. Coll. Paléo-Québec 31. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
- Charland, Philippe. 2006. « Aln8baïwi Kdakina Notre Monde à la manière abénakise : La toponymie abénakise au Québec ». Algonquian Papers 37 : 49-73.
- Compagnon, Gregory, dir. 2010. Halte au pillage. Paris : Éditions Errance.
- Conseil des Abénakis d’Odanak. 2003. Résolution de bande d’Odanak – chronologique : GOB-046-03-04. 29 septembre.
- Coulthard, Glen S. 2014. Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- Delamour, Carole, Marie Roué, Élise Dubuc et Louise Siméon. 2017. « Tshiheu : Le battement d’ailes d’un passeur culturel et écologique chez les Pekuakamiulnuatsh ». Recherches amérindiennes au Québec 47(2‑3) : 161-172.
- De Plaen, Sylvaine. 2000. « Histoire d’un métissage thérapeutique… Ou comment articuler les concepts psychodynamiques et culturels dans une pratique psychiatrique hospitalière de consultation obstétricale ». Anthropologie médicale 3 : 69-75.
- Desmarais, Laurence et Laurent Jérôme. 2018. « Voix autochtones au Musée de la civilisation de Québec : Les défis de la muséologie collaborative ». Recherches amérindiennes au Québec 48 (1‑2) : 121‑131.
- Dubuc, Élise et Laurier Turgeon. 2004. « Musées et premières nations : La trace du passé, l’empreinte du futur ». Anthropologie et Sociétés 28(2) : 7-18.
- Duceppe-Lamarre, François. 1999. « L’archéologie du paysage à la conquête des milieux forestiers, ou l’objet paysage vu par l’archéologue de l’environnement ». Hypothèses 1(2) : 85-94.
- Echo-Hawk, Roger C. 2000. « Ancient History in the New World: Integrating Oral Traditions and the Archaeological Record in Deep Time on JSTOR ». American Antiquity 65(2) : 267-290.
- Fine-Dare, Kathleen Sue. 2002. Grave Injustice: The American Indian Repatriation Movement and NAGPRA. Lincoln : University of Nebraska Press.
- Gaudry, Adam et Darryl Leroux. 2017. « White Settler Revisionism and Making Métis Everywhere: The Evocation of Métissage in Québec and Nova Scotia ». Critical Ethnic Studies 3(1) : 116-142.
- Giligny, François. 2005. « De la fouille à l’interprétation : le traitement des données ». Dans Guide des méthodes de l’archéologie. Sous la direction de Jean-Paul Demoule, 129-186. Guides repères. Paris : La Découverte.
- Gimenez, Guy. 2002. « Les objets de relation ». Dans Les processus psychiques de la médiation Sous la direction de Bernard Chouvier, 81-102. Inconscient et Culture. Paris : Dunod
- Godrie, Baptiste et Marie Dos Santos. 2017. « Présentation : inégalités sociales, production des savoirs et de l’ignorance ». Sociologie et Sociétés 49(1) : 7-31.
- Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 2020 (2019). Communications personnelles et données non publiées. Bureau du Ndakina.
- Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 2020. « L’importance de développer un cadre législatif international sur le rapatriement d’objets cérémoniaux et de restes humains. » https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Reportrepatriation/submissions-indigenous-peoples-ngos/Nation-Waban-aki2.pdf
- Haggis, Jane. 2004. « Thoughts on a politics of whiteness in a (never quite post) colonial country: Abolitionism, essentialism and incommensurability ». Dans Whitening Race: Essays in social and cultural criticism. Sous la direction de Aileen Moreton-Robinson, 48-58. Canberra : Aboriginal Studies Press.
- Hamidi, Nawel, Darryl Leroux et Pierrot Ross-Tremblay. 2018. « Premiers Peuples : cartographie d’une libération. » Liberté 32 : 12-13.
- Hanna, Margaret G. 2005. « The changing legal and ethical context of archaeological practice in Canada, with special reference to the repatriation of human remains ». Journal of Museum Ethnography 17 : 141‑151.
- Haraway, Donna. 1988. « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective ». Feminist Studies 14(3) : 575‑99.
- Harris, Heather. 2010. « Indigenous Worldview and Ways of Knowing as Theoretical and Methodological Foundations behind Archeological Theory and Method ». Dans Indigenous Archeologies: A Reader on Decolonization. Sous la direction de Margaret Bruchac, Siobhan Hart et H. Martin Wobst, 63‑68. New York : Routledge Press..
- Ingold, Tim. 2000. The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill. London : Routledge Press.
- Jérôme, Laurent. 2013. « Cosmologies autochtones et musée. Diversité des expériences et des points de vue dans un processus de consultation ». Histoire, monde et cultures religieuses 3(27) : 19-42.
- Jérôme, Laurent. 2014. « Présentation : Vues de l’autre, voix de l’objet dans les musées ». Anthropologie et Sociétés 38(3) : 9-23.
- Lainey, Jonathan C. 2008. « Le prétendu wampum offert à Champlain et l’interprétation des objets muséifiés ». Revue d’Histoire de l’Amérique française 61(3‑4) : 397.
- Larocque, Robert. 2000. Le site Lachapelle à Saint-François-du-Lac, fouilles archéologiques et analyses des restes humains. Conseil de bande d’Odanak/MCCCF, rapport inédit : 47.
- Larocque, Robert. 2004. « Les sépultures iroquoiennes de Saint-François-du-Lac (CaFf-3) ». Dans Un traducteur du passé. Mélanges en hommage à Norman Clermont. Sous la direction de C. Chapdelaine et P. Corbeil, 203-218. Coll. Paléo-Québec 31. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
- Larocque, Robert, et Daniel Poulin. 1994. « Le site Lachapelle à Saint-François-du-Lac : un lieu d’inhumation amérindien (CaFf-3) sur la rivière Saint-François ». Rapport inédit. MCCCF, Québec : 24.
- Lecroere, Thomas. 2019. « L’étude des données “grises” issues de la détection illégale de métaux : sauvegarde du patrimoine ou cercle vicieux du pillage ? » Canadian Journal of Bioethics/Revue canadienne de bioéthique 2(3) : 149‑157.
- Legal Information Institute. 2021. 43 CFR § 10.11 – Disposition of culturally unidentifiable human remains. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/10.11
- Leroux, Darryl. 2018. « ‘We’ve Been Here for 2,000 Years’: White Settlers, Native American DNA and the Phenomenon of Indigenization ». Social Studies of Science 48(1) : 80‑100.
- Marchand, Mario. 2012. « La représentation sociale de l’espace traditionnel des autochtones par rapport à celle du territoire des allochtones : l’exemple de la forêt mauricienne, 1534-1934 ». Cahiers de géographie du Québec 56(159) : 567‑82.
- Mayneri, Andrea C. 2014. « Sorcellerie et violence épistémologique en Centrafrique ». L’Homme. Revue française d’anthropologie 211 : 75‑95.
- Mi’kmawey Debert Cultural Centre. 2021. Sa’qewe’l kmitkinal, Ancestors Live Here. https://www.mikmaweydebert.ca/
- Ministère de la Culture et des Communications. 2017a. Patrimoine – Conseil du patrimoine culturel du Québec. https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5092
- Ministère de la Culture et des Communications. 2017b. Patrimoine – Rôle du ministère. https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5159
- Ministère de la Culture et des Communications. 2018. Plan stratégique 2018-2021. https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/plan_strategique_2018-2021.pdf
- Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 2008. Service de soutien aux institutions muséales. Élaborer une politique de gestion des collections (Guide pratique).https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ssim-gestion-des-collections.pdf
- Nash, Stephen E. et Chip Colwell‐Chanthaphonh. 2010. « Nagpra After Two Decades ». Museum of Anthropology 33(2) : 99‑104.
- Nicholas, George P., et Thomas D. Andrews. 1997. At the Crossroads Archeology and First Peoples in Canada. Burnaby, B.C : Simon Fraser University.
- Pawling, Micah. 2016. « Wabanaki Homeland and Mobility: Concepts of Home in Nineteenth-Century Maine ». Ethnohistory 63(4) : 621‑43.
- Poirier, Sylvie, Laurent Jérôme et la Société d’histoire atikamekw (Nehirowisiw Kitci Atisokan). 2014. « Présentation : Les Atikamekw Nehirowisiwok : territorialités et savoirs ». Recherches amérindiennes au Québec 44(1) : 3-10.
- Québec. 2011. Loi sur le patrimoine culturel, LQ 2011, c 21. https://canlii.ca/t/69ns5 (consulté le 13 décembre 2021).
- Raines, June et Camille Bush. 1992. « One is Missing: Native American Graves Protection and Repatriation Act: An Overview and Analysis ». American Indian Law Review 17 : 639-664.
- Redman, Charles L. 1999. Human Impacts on Ancient Environnements. Tucson : University of Arizona Press.
- Rose, Jerome C., Thomas J. Green et Victoria D. Green. 1996. « NAGPRA IS FOREVER: Osteology and the Repatriation of Skeletons ». Annual Review of Anthropology 25(1) : 81‑103.
- Rovet, Guillaume, Grégory Compagnon, Nicolas Minvielle-Larousse et Sébastien Champeyrol . 2017, « Chasse au trésor et pillage du patrimoine archéologique : Un enjeu de médiation ». Dans Les médiations de l’Archéologie. Sous la direction de Daniel Jacobi et Fabrice Denise, 171-185. Collection OCIM. Dijon : Éditions universitaires de Dijon.
- Roy, Christopher A. 2003. « Un bref survol de la situation abénaquise aux États-Unis ». Recherches amérindiennes au Québec 33(2) : 127‑30.
- Smith, Claire et Hans Martin Wobst. 2004. Indigenous Archaeologies: Decolonising Theory and Practice. New York : Routledge Press.
- Smith, Linda Tuhiwai. 2013. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London : Zed Books Ltd.
- Sockbeson, Rebecca C. 2020. « Cipenuk Red Hope:Weaving Policy Toward Decolonization & Beyond ». Thèse de doctorat, Educational Policy Studies, Université d’Alberta, Edmonton. https://doi.org/10.7939/R30863H0V
- Spector, Janet D. 1993. What This Awl Means: Feminist Archaeology at a Wahpeton Dakota Village. St. Paul : Minnesota Historical Society Press.
- Spivak, Gayatri C. 2010. « “Can the Subaltern Speak?” ». Dans Can the Subaltern Speak: Reflections On The History Of An Idea. Sous la direction de Rosalind C. Morris, 21-78. New York : Columbia University Press.
- Sterlin, Carlo. 2006. « Pour une approche interculturelle du concept de santé ». Ruptures, revue transdisciplinaire en santé 11(1) : 112‑121.
- Treyvaud, Geneviève. 2013. « Reconstruction des technologies de production métallique employées par les artisans européens et amérindiens du xvie au xviiie siècle au Canada ». Thèse de doctorat, département d’histoire, Université Laval, Québec.
- Treyvaud, Geneviève, Suzy O’Bomsawin et David Bernard, 2018. « L’expertise archéologique au sein des processus de gestion et d’affirmation territoriale du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ». Recherches amérindiennes au Québec 48(3) : 81-90.
- Treyvaud, Geneviève et Michel Plourde. 2017. Les Abénakis d’Odanak, un voyage archéologique. Odanak : Musée des Abénakis.
- UNESCO. 1970. « Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970 ». http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 2021. Lutte contre le trafic illicite, retour et restitution des biens culturels : 50e anniversaire de la Convention 1970.https://fr.unesco.org/fighttrafficking
- Van Oyen, Astrid. 2014. « Les acteurs-réseaux en archéologie : état de la question et perspectives futures ». Les nouvelles de l’archéologie 135 : 14‑20.
- Vernier, Melissa. 2016. « Réappropriation du patrimoine autochtone : défis et nouvelles pratiques muséales et archivistiques ». Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research 11(2). https://doi.org/10.21083/partnership.v11i2.3586
- Warrick, Gary. 2018. « Collaboration avec les Hurons-Wendat pour la protection du patrimoine archéologique en Ontario ». Recherches amérindiennes au Québec 48(3) : 45-55.
- Watkins, Joe. 2000. Indigenous Archeology Indian Values and Scientific Practice. Oxford : Alta Mira Press.
- White, Bob W., s.d., dir. Breakdown and Breakthrough: An Anthropological Theory of Intercultural Communication. En parution. (comm. pers., nov. 2017).
- White, Bob W. et Lomomba Emongo. 2014. L’interculturel au Québec : Rencontres historiques et Enjeux politiques. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
List of figures
Le Ndakina, territoire ancestral de la Nation w8banaki

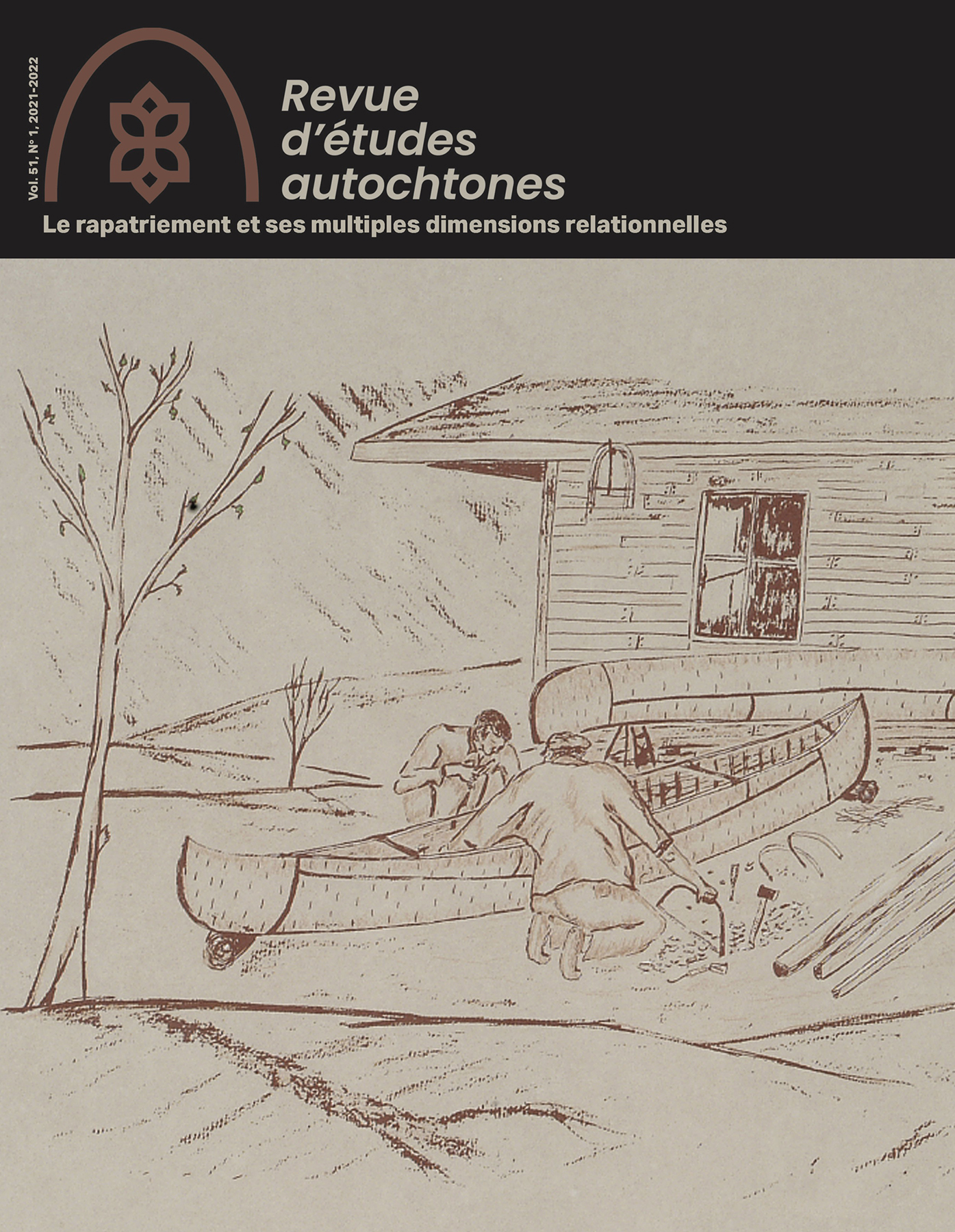


 10.7202/1048603ar
10.7202/1048603ar