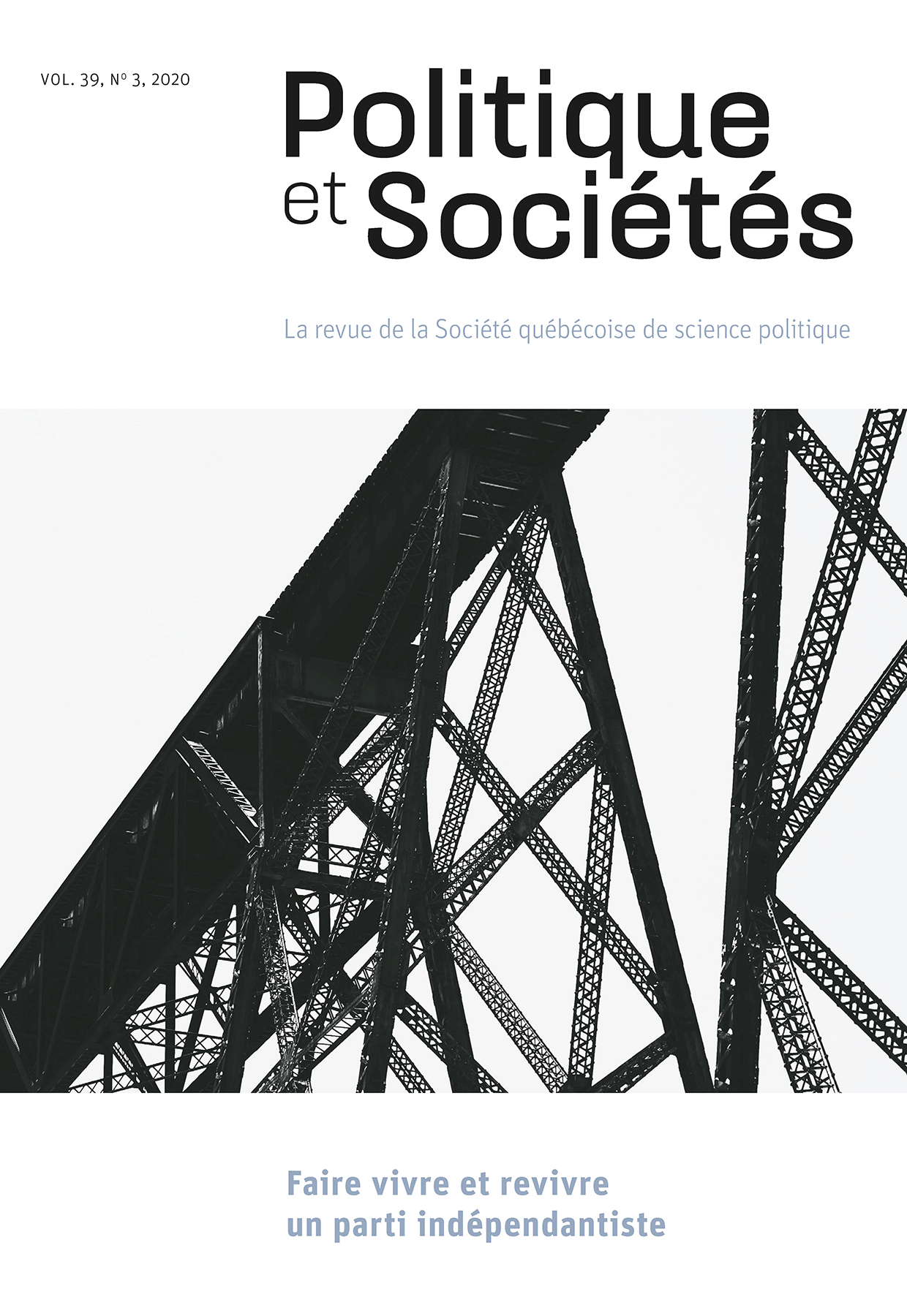Article body
Quels corps peuvent se défendre de la violence ? Qui accède aux armes pour défendre son corps ? Décadrer et désarticuler notre compréhension de la violence et l’autodéfense : tel est le but de l’ouvrage Se défendre. Une philosophie de la violence de la philosophe Elsa Dorlin (Université Paris 8). Entamant le prologue sur « ce que peut un corps », elle y propose une philosophie de l’autodéfense des corps marginalisés, qui prend sa source non pas dans la loi, comme dans la tradition philosophique occidentale, mais plutôt dans le muscle, ce qui déplace toute la logique de compréhension de la violence dans la pensée politique (p. 15).
Dorlin propose une « histoire constellaire de l’autodéfense » (p. 16), c’est-à-dire une généalogie critique tenant compte de l’opposition entre l’héritage juridico-politique sur la légitime défense et les « éthiques martiales de soi » qui sont plutôt le fait des mouvements sociaux. Cette généalogie est celle de l’histoire des corps expulsés, réduits à la violence. Elle interroge le dispositif de pouvoir qui maintient la notion de défense comme étant un privilège de certains : la légitime défense est permise pour certains corps et refusée pour d’autres. Ce sont des corps indéfendables.
L’autrice critique la philosophie politique moderne, où le droit à la violence est autorisé par certains corps, pour la préservation du corps propriétaire. Qui n’est pas propriétaire n’est pas un corps défendable pouvant accéder à la légitime défense. Résolument féministe dans son approche à l’autodéfense, l’autrice prend ses sources intellectuelles dans les courants afro-américains, mais aussi chez Judith Butler et Frantz Fanon. Elle explore la violence comme une praxis absolue où le sujet est transformé par cette violence. C’est dans la violence que se forme le pouvoir d’agir du sujet, le sujet toujours « hors de soi » : à la Butler, la violence est intimement liée à la formation du sujet, alors que pour Fanon, la violence devient une praxis de libération. Ainsi, c’est grâce à l’autodéfense que les corps indéfendables se réapproprient le statut de sujet.
Dès le prologue, le ton politique de l’ouvrage est donné où le lectorat se trouve devant deux scènes : d’un côté, la description de la torture de Millet de la Girardière qui, en se défendant, n’est que davantage torturé en raison du dispositif corporel qui l’empêche de lutter pour sa survie ; de l’autre côté, Rodney King qui, s’étant défendu, est devenu indéfendable par son corps racisé, maîtrisé par les forces policières. Ce sont ces « deux logiques d’assujettissement, convergeant vers une même subjectivation malheureuse, qu’il est question de saisir dans ce livre, face à une technologie de pouvoir qui n’aura jamais autant investi cette logique défensive pour assurer sa propre perpétuation » (p. 14). Le corps est donc au coeur de l’ouvrage : c’est à travers celui-ci que cette recension se tisse.
Le corps désarmé. Ce chapitre aborde l’échafaudage politico-juridique de « contrôle des corps armés », qui rend monopolistique la possibilité d’être armé. La modernité politique eurocentrée a impliqué une redéfinition de ce que signifie « se défendre » (p. 23) et l’imposition d’un système martial qui vise à maintenir les corps désarmés et à étouffer toute forme de résistance. Cela « institue une ligne de partage entre les sujets qui sont propriétaires d’eux-mêmes » et « les esclaves qui ne s’appartiennent pas » (p. 26). Le corps subalterne est désarmé, corporellement, subjectivement : il est mis hors citoyenneté, sans défense, dématérialisé.
Le corps défensif. Ce chapitre expose les enjeux de l’accès aux savoirs martiaux. Dorlin s’interroge sur l’autodéfense féministe qui « instaure un rapport au monde, une autre façon d’être », en « ravivant les muscles, en exerçant un corps qui habite, occupe la rue, se déplace, s’équilibre » (p. 58). Elle oppose cette autodéfense à la norme, patriotique et capitaliste, d’une position de féminité « sans défense » (p. 63).
Le corps combattant. Partant d’un ancrage analytique dans les ghettos nazis, ce chapitre expose que la « défense d’un soi déjà en partie condamné » contre la « thanatoéthique », soit « l’ensemble des pratiques qui investissent la mort comme instance restauratrice des valeurs de vie » (p. 65-68). Le corps en combat devient le seul moyen de survie pour les communautés. L’autrice montre que la technique de combat rapproché du Krav Maga devient la base d’une « politique stratégique militaire d’une plus grande ampleur » (p. 77) qui soutient Israël dans son exportation de la « sécurité » et, donc, dans une « culture de la défensive » (p. 79). Le corps devient l’arme létale : « la chimie de la peur » transforme le corps défensif en corps offensif. C’est dans cette mécanique répressive, utilisant le discours sur la défense de soi, que l’État d’Israël légitime son « droit à la violence et à la colonisation » (p. 81).
Le corps « propre ». Dorlin reprend les conceptions de l’autodéfense moderne telles que théorisées par les philosophes Thomas Hobbes et John Locke et montre comment celles-ci sont associées à la préservation de soi et à la notion de propriété : il y a « ceux qui possèdent leur corps en propre et ceux qui en sont par nature dépossédés » (p. 87). Le corps « propre », ou « le corps à soi », devient ainsi le fondement de toute autre « propriété » et, donc, institue le corps comme sujet ou non du politique. C’est le « schème de la subjectivité moderne dominante » qui établit la conservation et le droit comme des privilèges liés : la « propriété préexiste donc à l’action de se conserver » (p. 90). Les sujets subalternes sont dépossédés d’eux-mêmes, permettant le maintien de l’ordre, du « légitime » et de « l’illégitime », ce qui amène l’autrice à analyser la culture du vigilantisme aux États-Unis.
Le corps « non blanc ». Ce chapitre analyse le rapport du féminisme à l’impérialisme et au racisme – aux corps « non blancs » – soulignant que la « “défense des femmes” demeure un motif récurrent des systèmes et dispositifs racistes » (p. 115). En référence aux guerres menées en Irak et en Afghanistan, Dorlin montre comment le narratif du patriotisme états-unien a utilisé la rhétorique sur la défense : « nos femmes » sont maintenant celles qui nous défendent de « ces hommes » (p. 117). La défense de la nation est incarnée dans les soldates tortionnaires, émasculant l’ennemi à Abu Ghraib : c’est la figure de la justicière, au service d’une norme hégémonique de « virilité chrétienne, blanche et capitaliste » (p. 118).
Le corps racisé. La dichotomie entre l’autodéfense jugée « légitime » et la violence des populations noires, jugée « illégitime », est au centre de ce chapitre. Partant du Black Power et de l’ouvrage Negroes with Guns de Robert F. Williams (1962, Marzani & Munsell), Dorlin montre que cette philosophie défie l’idée individualiste et la tradition de l’autodéfense entendue comme propriété. La violence défensive devient l’ultime rempart insurrectionnel pour la survie du corps racisé : c’est la « philosophie de l’action violente » de Fanon (p. 127) et « l’émergence d’une sémiologie des corps en lutte » (p. 135).
Le corps en lutte. Ce chapitre aborde, d’une part, l’intersection entre le sexe et la race dans les luttes des minorités sexuelles dans les années 1960-1970 où s’instaurent des systèmes de sécurité citoyenne sous une norme de la « masculinité gaie blanche » (p. 143). D’autre part, il mobilise deux exemples sur la défense. Premièrement, le récit du double viol de Jude Jordan comme paradoxe de la défense de soi : violée par un homme blanc, elle mobilise la race comme rage autoprotectrice ; violée par un homme noir, la rage de la race l’a paralysée. C’est le résultat des failles du féminisme et de l’antiracisme. Deuxièmement, le jeu vidéo de Suyin Looui Hey Baby ! où la femme armée se bat contre le sexisme en répondant à la violence par la violence, à force d’impliquer le massacre d’agresseur à répétition, finit par reproduire la logique néolibérale de l’autonomie, du « pouvoir de » (p. 155) et, donc, de la « responsabilité » de la femme elle-même contre ses agresseurs. La défense finit par être assimilée à l’arme.
Le corps résilient. Reprenant le roman d’Helen Zahavi, Dirty Weekend (2000, Phébus), Dorlin expose les conséquences quotidiennes de la violence continue, proposant le concept de « phénoménologie de la proie ». C’est la condition du sujet féminisé d’être « traqué », constamment en proie à la violence. Ironiquement, plus les femmes se défendent, plus elles sont traquées. Dorlin pose donc l’épineuse question du féminisme et de son « propre rapport à la violence » (p. 164). La phénoménologie de la proie dévoile le corps résilient face à une violence qu’on tente de normaliser par une « herméneutique du déni » (p. 165). Il s’agit d’un renversement de la compréhension de la défense, non pas des dominants, mais bien, d’un point de vue féministe, dans une réplique quotidienne, refusant l’assujettissement et la domination.
Elsa Dorlin laisse une certaine ambiguïté quant à la « philosophie de la violence » ; peut-être espérons-nous, in fine, un autre ouvrage tellement la généalogie qu’elle fait de l’autodéfense des opprimé·e·s bouleverse plusieurs cadres de la pensée politique ? Une telle philosophie des minorisé·e·s pose la question même des possibilités de résistances : celles-ci ne sont-elles pas retournées contre les minorisé·e·s lorsqu’il·elle·s réclament leur corps dans le politique ? Ne nous reste-t-il que les éthiques martiales de soi ?