Abstracts
Résumé
Le Parti québécois doit composer, sur le front des relations intergouvernementales, avec un enjeu particulier : celui du dilemme entre poursuivre coûte que coûte son idéal – l’accession du Québec à la souveraineté – et la prise en compte des conséquences de ses actions à court, moyen et long terme sur les intérêts du Québec et sur l’évolution du fédéralisme canadien. Malgré ce dilemme, les stratégies adoptées par le PQ depuis cinquante ans pour défendre les revendications du Québec ne diffèrent pas substantiellement de celles des autres partis politiques qui ont occupé le pouvoir. Avec des taux de succès variables, les approches multilatérales, bilatérales et unilatérales ont fréquemment été employées par le parti au sein des divers forums pancanadiens. À partir d’une réflexion sur les discours et sur les actions posées par le PQ dans la conduite des affaires constitutionnelles et des relations intergouvernementales, la présente étude vise à brosser un portrait des stratégies mises en oeuvre par les gouvernements péquistes pour défendre, au premier chef, l’autonomie du Québec, mais, également, sa participation aux institutions centrales de la fédération canadienne.
Mots-clés :
- Parti québécois,
- fédéralisme canadien,
- relations intergouvernementales,
- autonomie,
- participation
Abstract
The Parti Québécois has had to deal with a particular issue in terms of intergovernmental relations : the dilemma of pursuing its ideal goal at all costs—Quebec’s accession to sovereignty—or taking into consideration the foreseeable consequences of its actions on Quebec’s interests and the evolution of Canadian federalism in the short, middle and long term. Despite this dilemma, the strategies adopted by the PQ do not substantially differ from the other political parties. With varying success rates, multilateral, bilateral, and unilateral approaches have frequently been used by the Party in different Canadian forums. Reflecting on the discourse and actions taken by the PQ in constitutional affairs and intergovernmental relations, this study aims to draw a critical assessment of the strategies implemented by the PQ governments to defend, primarily, the autonomy of Quebec, but also its participation in the central institutions of the Canadian federation.
Keywords:
- Parti québécois,
- Canadian federalism,
- intergovernmental relations,
- autonomy,
- participation
Article body
Conçu autour d’un idéal, le Parti québécois (PQ) se trouve, depuis sa création, tiraillé entre la prise en compte des conséquences prévisibles de ses actions à court, à moyen et à long terme sur les intérêts du Québec et sur l’évolution du fédéralisme canadien ou la poursuite, coûte que coûte, de son objectif – l’accession du Québec à la souveraineté.
D’un côté, la souveraineté-association puis la souveraineté-partenariat se voulaient des solutions aux difficultés constitutionnelles qui caractérisent la relation Québec/Canada. Vues sous cet angle, les affaires constitutionnelles et les relations intergouvernementales canadiennes apparaissaient donc comme des questions de première importance, voire existentielles. De l’autre côté, l’idée de faire du Québec un pays s’est aussi rapidement imposée comme un idéal autonome, valable en soi, dont la réalisation n’était en rien conditionnée par l’état des relations avec le reste du Canada ou par le bilan de la participation du Québec au fédéralisme. Plus désintéressés de la critique du réel, soit du fonctionnement des institutions canadiennes et de leurs tensions, les partisans de cette vision ont eu tendance à considérer les relations intergouvernementales comme secondaires, à l’image d’un mal nécessaire.
Bref, de deux choses l’une : soit les relations intergouvernementales n’avaient d’intérêt qu’en attendant le « grand soir » de l’indépendance, soit elles étaient un instrument à manipuler au profit de la promotion de la souveraineté. Telles deux forces concurrentes à l’intérieur d’un même corps, ces deux tendances, l’une plus pragmatique, l’autre plus idéaliste, ont toujours coexisté au sein du PQ. Or, ces tiraillements rejoignent, à bien des égards, le débat classique théorisé par Max Weber (1959) entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Pendant qu’une fraction du Parti – par conviction souverainiste – s’est désintéressée des relations intergouvernementales et a déconsidéré ces enjeux par rapport à la réalisation de son idéal d’indépendance, une autre fraction s’est plutôt attachée aux conséquences prévisibles d’une amélioration ou d’une détérioration des relations du Québec avec les autres gouvernements de la fédération.
Dans ce contexte, les gouvernements du PQ auraient pu multiplier les actions unilatérales pour affirmer et pour défendre l’autonomie du Québec, poser des gestes de rupture à l’endroit du fédéralisme canadien ou, encore, adopter la politique de la « chaise vide » dans les forums multilatéraux de la fédération. Or, il n’en est rien, ou presque. Non seulement les demandes du PQ à l’endroit du gouvernement fédéral n’ont pas, jusqu’à présent, foncièrement différé de celles des autres formations politiques québécoises au pouvoir, mais le Parti n’a négligé aucune méthode pour les faire valoir sur la scène canadienne. C’est, du moins, l’hypothèse que nous défendons.
La présente étude prend la forme d’une analyse de l’histoire constitutionnelle qui se concentre principalement sur les années pendant lesquelles le PQ formait le gouvernement ou l’opposition officielle, et ce, afin d’explorer les méthodes, les stratégies et les approches privilégiées par le Parti pour défendre les propositions de réforme du droit que sont les revendications traditionnelles du Québec. Pour ce faire, les sources mobilisées sont, au premier chef, les compilations gouvernementales recensant les prises de position des différents acteurs politiques du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental (Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes [SAIC], 1998 ; 2001 ; 2008) de même que des analyses doctrinales produites par des constitutionnalistes et des acteurs des relations intergouvernementales.
Cette contribution est structurée à partir des travaux qui dressent un panorama des différentes voies qu’empruntent les relations intergouvernementales au Canada (verticales/horizontales, législatives/exécutives, multilatérales/unilatérales, etc.) (Adam et al., 2015 ; Gauvin, 2017). Puisque la Constitution de 1867 n’a pas été rédigée en prévision d’une coopération intense et soutenue entre les gouvernements et qu’elle prévoit un système parlementaire modelé sur celui de Westminster, une importante partie de ces relations s’est développée en marge de la Constitution, voire de la loi (Papillon et Simeon, 2004). Les exécutifs se retrouvent donc très fréquemment au centre de cette dynamique (Smiley, 1976 ; Pelletier, 2004 : 182-185). En outre, surtout depuis les échecs des accords du lac Meech et de Charlottetown, ils empruntent de plus en plus la voie des relations bilatérales (Painter, 1991), grâce à la signature d’ententes intergouvernementales principalement (Poirier, 2008). Évidemment, ce constat a des incidences sur la pérennité du fédéralisme canadien, notamment sur les tensions entre les courants d’unité et d’asymétrie constitutionnelle (Ryan, 2000 : 260 ; Gagnon, 2006).
Ces tensions se sont exacerbées ou atténuées au gré de moments tournants des relations intergouvernementales, lesquels se sont, bien souvent, déroulés sous le règne du PQ depuis les cinquante dernières années. À ce titre, cette étude rejoint celles sur les effets structurants des partis politiques appartenant à la famille des partis autonomistes sur la configuration des systèmes politiques (Thorlakson, 2009 ; Montigny, 2017). Plus précisément, elle recoupe les travaux sur la position du Québec lors des négociations précédant le rapatriement (Laforest et Readman, 2013), les ententes du lac Meech (McRoberts, 1999) et de Charlottetown (Lemieux, 1991), l’Union sociale (Gagnon, 2000 ; Fortin et al., 2003) ou, plus généralement, les tentatives d’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser (Adam, 2008 ; Turcotte, 2012). Somme toute, cette contribution vise à comprendre comment le PQ a mobilisé les différentes avenues des relations intergouvernementales depuis les cinquante dernières années pour porter les intérêts du Québec au sein de la fédération, considérant les tensions auxquelles il est lui-même confronté entre inscrire ses actions à l’intérieur d’une éthique de conviction ou de responsabilité.
Par le cumul des stratégies, le PQ a su explorer tout le potentiel ainsi que les limites des différentes méthodes ou approches des relations intergouvernementales, sans nécessairement en privilégier une. Avec des taux de succès fort variables, il s’est engagé dans des rondes de négociations multilatérales, dans des procédures visant à apporter des changements bilatéraux à la Constitution ainsi que dans des mesures caractérisées par une approche unilatérale. Autrement dit, les gouvernements du PQ ne sont jamais limités à une façon de faire précise dans la conduite des relations intergouvernementales.
Un multilatéralisme peu payant
En toute logique, le fédéralisme suppose un minimum de coopération multilatérale entre les membres de la fédération (Wheare, 1953 : 10). Ces discussions entre les représentants des provinces, avec ou sans la présence des autorités fédérales, permettent de coordonner des actions législatives, gouvernementales et administratives. Pour le Québec, elles sont, en outre, l’occasion de forger des fronts communs visant à « amener le gouvernement canadien à respecter davantage les principes fondamentaux du fédéralisme » (Pelletier, 2009 : 19). Le recours à la coopération interprovinciale, en plus de faire contrepoids aux prétentions centralisatrices des autorités fédérales, mène idéalement à la recherche de compromis entre les entités fédérées quant à l’amélioration des institutions fédératives de l’État, conformément aux principes de la coopération et de la participation (Bonenfant, 1976 : 21).
Cela se retrouve par ailleurs chez tous les gouvernements du Québec, qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes. Or, à l’exception notable de la période du « beau risque », jamais le PQ ne s’est lancé – de son propre chef – dans une telle ronde de négociations multilatérales visant à « réconcilier » ou à résoudre durablement la question des rapports Québec-Canada. En effet, devant des changements à long terme proposés par le fédéral, les gouvernements du PQ ont souvent été sur la défensive, saisis ou emportés par l’actualité. Ils ont alors agi au meilleur de leurs capacités, dans le sens que leur dictaient les intérêts du Québec.
Le Parti québécois au pouvoir : de la précarité des fronts communs
Anticipant un désaccord majeur avec le gouvernement en place à Ottawa, les gouvernements du Parti québécois cherchent souvent à convaincre les premiers ministres des autres provinces d’adopter une position commune par une stratégie d’alliances ponctuelles. Des rapprochements inattendus peuvent alors se produire : le tandem Lucien Bouchard/Mike Harris en est un bel exemple (Montpetit, 2007 : 199-203).
Cela dit, c’est certainement dans le cadre des négociations post-référendaires de 1981 que le gouvernement de René Lévesque s’engage le plus intensivement dans cette approche multilatérale. Il s’agit alors de faire contrepoids à la détermination et à l’empressement du gouvernement Trudeau à imposer son people package, c’est-à-dire son projet de rapatriement accompagné d’une charte des droits individuels (Pitfield, 1980 ; Hurley, 1996 : 58-68).
Le Québec s’oppose à ce projet (Assemblée nationale, 1981), notamment parce que l’adoption de la charte des droits limiterait ses compétences, en général, et, surtout, celle de légiférer pour la protection de la langue française en particulier. Du reste, le projet de Pierre Elliott Trudeau ne contient ni décentralisation de pouvoirs ni reconnaissance de la spécificité du Québec (Woehrling, 1992 : 123). Au début de l’année 1981, cinq autres provinces, soit l’Alberta, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique, s’opposent tout aussi énergiquement au projet fédéral de rapatriement. Un peu plus tard, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse se rallient à ce groupe pour former « la bande des huit[1] ».
Jusqu’à la désormais célèbre « nuit des longs couteaux », du 4 au 5 novembre 1981, ce front commun de huit provinces ne ménage aucun effort pour bloquer le rapatriement unilatéral voulu par Trudeau. Parmi ses principales actions, mentionnons : premièrement, la négociation de l’Accord du 16 avril 1981, une contre-proposition ralliant une vaste majorité de provinces pour un rapatriement ; deuxièmement, les intenses relations diplomatiques auprès des responsables politiques du Royaume-Uni afin de les sensibiliser aux exigences du fédéralisme canadien (Godin, 2005 : 92-100 ; Bastien, 2013) ; troisièmement, les renvois du projet de résolution fédérale afin d’en contester les fondements constitutionnels et conventionnels devant les cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve.
Sous l’influence de son ministre des Affaires intergouvernementales, Claude Morin, le gouvernement Lévesque joue subtilement ses cartes et s’assure de maximiser son influence au sein du front commun en asseyant la légitimité fédérative de son action (Morin 1991 : 556-558). Pour ce faire, le gouvernement du Québec, dans un esprit de modération pragmatique visant à susciter compromis et consensus, se contraint à ne défendre que des positions ayant déjà été adoptées par l’une ou par l’autre des provinces membres du front commun (Rémillard, 1983 : 68, 80-82).
En fait, la stratégie consiste à donner le plus d’ampleur possible à un plus petit dénominateur commun en pigeant ou en sélectionnant, dans les différentes positions des sept autres provinces, celles qui se rapprochent le plus possible des positions traditionnelles du Québec (ibid. : 82-83). Les exigences du Québec deviennent donc « modérées », car elles ont déjà été défendues par l’une ou l’autre des sept autres provinces.
Au-delà de la dimension stratégique, les concessions faites par le gouvernement Lévesque pour arriver à une position commune au sein de ce front sont néanmoins importantes. L’Accord d’avril 1981 précise que toutes les provinces sont « égales » et propose un rapatriement minimaliste : une formule d’amendement sans charte des droits, contrairement à ce qu’exigeait le gouvernement fédéral, et sans renouvellement du fédéralisme, à l’inverse de ce que demandait traditionnellement le Québec. En ce sens, on peut critiquer la proposition du groupe des huit pour ce qu’elle ne contient pas, c’est-à-dire une reconnaissance et des pouvoirs accrus pour le Québec.
C’est néanmoins pour les compromis inscrits dans l’Accord que le gouvernement Lévesque a été le plus fortement blâmé. Alors que la formule d’amendement préconisée par le gouvernement Trudeau accordait au Québec – de même qu’à toutes les « régions de provinces » du Canada – un droit de véto sur l’essentiel des modifications constitutionnelles à venir, le gouvernement Lévesque a préféré renoncer à cette position traditionnelle au profit d’un simple droit de retrait avec compensation financière (ou opting out). Dans un accord qui stipulait « l’égalité des provinces », le Québec s’est rallié à la formule dite « 7/50 », laquelle exige le consentement d’au moins les deux tiers des provinces, représentant au moins 50 % de la population.
Pourquoi ce renoncement au droit de véto[2] ? Alors que ce dernier aurait permis au Québec d’accroître son rapport de force et de bloquer, à lui seul, toutes futures réformes de la Constitution contraires à ses intérêts, le droit de retrait ne lui permet que de se soustraire à l’application de changements sans, pour autant, empêcher leur adoption. En ce sens, le compromis signé par le gouvernement Lévesque au sein du front commun apparaît comme un recul. En revanche, le droit de retrait – s’il s’accompagnait d’une véritable compensation financière – était, à certains égards, plus conforme au type de fédéralisme auquel aspire le Québec. Il avait l’avantage de favoriser une plus grande souplesse dans la formule d’amendement. Après tout, à partir du moment où le droit de véto proposé au Québec par Trudeau était aussi offert à toutes les régions de provinces de la fédération canadienne, les chances de succès d’une réforme en profondeur du fédéralisme se voyaient considérablement réduites. La multiplication des vétos devenait la meilleure garantie pour le maintien du statu quo, comme l’ont d’ailleurs montré les échecs des accords du lac Meech et de Charlottetown où, en définitive, toutes les provinces détenaient leur propre droit de véto (Morin et Woehrling, 1992 : 56).
À terme, le droit de retrait offrait au Québec l’occasion de se forger graduellement un statut particulier dont il ne faut pas sous-estimer l’importance. Certains de ses détracteurs voient d’ailleurs dans le droit de retrait une forme de « séparatisme » à la carte (Hogg, 1993 : 96).
Chose certaine, ce changement de position constitutionnelle a été le prix à payer pour renforcer le front commun. En effet, ce genre de coalition et d’action multilatérale implique inévitablement des compromis, et c’est souvent la province la plus différente des autres qui, en étant la plus éloignée de la position médiane, doit davantage s’adapter (Pelletier, 2008 : 119).
La stratégie multilatérale du front commun présente un autre inconvénient majeur : la fragilité de ces coalitions hétéroclites. Le dénouement peut souvent s’écrire à l’avance. Ce qui ne représente, pour certaines provinces, qu’un point de départ dans les négociations (Noël, 2000 : 46-47), symbolise, pour le Québec, un ultime effort devant indiquer le seuil en deçà duquel il ne faut pas s’aventurer (Laforest et Readman, 2013 : 71). Si le sort du front commun de 1981 est un parfait exemple de ce phénomène, il est loin d’être un cas isolé. Qu’il s’agisse des négociations portant sur l’Union sociale canadienne, en 1999, ou de celles sur le financement de la santé, conclues en 2018, graduellement, sous la pression d’Ottawa, les alliances s’effritent.
À terme, il faut bien l’admettre, les fronts communs se forment plus lentement et parfois plus difficilement qu’ils ne se dissolvent, d’autant que le nationalisme québécois, en général, et le souverainisme, en particulier, s’avèrent souvent bien commodes quand vient le temps pour les provinces de se rallier à la position d’Ottawa et d’abandonner, au terme des négociations, le front commun (Ryan, 2000 : 247). En somme, peu importe la sincérité de leur engagement dans la stratégie du front commun, les gouvernements du Parti québécois sont perçus, par leurs homologues du reste du Canada, comme manquant de loyauté à l’égard de la fédération (Labelle, 2008 : 84). On les soupçonne de vouloir instrumentaliser l’échec des négociations pour mousser la popularité de leur option (propos de Benoît Pelletier tenus en 2009, lors d’une entrevue avec Laplante-Lévesque, et cités dans la thèse de ce dernier en 2010).
Plusieurs des acteurs de la « nuit des longs couteaux » ont rétrospectivement justifié leur absence de communication avec René Lévesque dans les moments décisifs de la négociation en arguant qu’aucun compromis n’aurait, de toute manière, pu satisfaire le gouvernement du PQ. Évidemment, c’est faire fi des concessions déjà importantes qui avaient été faites par le Québec pour en venir à l’entente de la bande des huit du 16 avril 1981.
Toujours est-il que si le front commun de 1981 fut d’abord un succès, le renversement des alliances dans la nuit du 4 au 5 novembre a laissé un profond goût amer (Brouillet, 2006 : 375), périodiquement dénoncé depuis par l’ensemble des formations politiques représentées à l’Assemblée nationale.
Or, même après le rapatriement, le gouvernement Lévesque a, contre toute attente, renoué avec l’approche multilatérale à la demande expresse des Autochtones. Il a accepté de se joindre, à titre d’observateur seulement, à la ronde de négociations de 1983. Le 16 mars de la même année, les parties en vinrent à signer la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution qui comprend, entre autres, l’engagement de principe en vertu duquel, avant toute modification de la Constitution touchant aux Autochtones, une conférence des représentants de ces derniers et des premiers ministres devra être organisée (O’Reilly, 1984). La modification, suivant la procédure du 7/50, est, quant à elle, entrée en vigueur trois ans plus tard sans que le Québec y donne toutefois suite à l’Assemblée nationale.
Puis, à la toute fin de son deuxième mandat[3], alors que l’usure du pouvoir se faisait de plus en plus sentir, le gouvernement Lévesque a accepté de s’engager dans le « beau risque » que lui proposait le gouvernement Mulroney (Godin, 2005 : 344-350 et 354-357). Une nouvelle ronde de négociations multilatérales s’en est suivie, finalement complétée par le gouvernement Bourassa, lequel remportera les élections de 1985.
Lors du retour au pouvoir du Parti québécois, Jacques Parizeau a conclu les importantes négociations en vue de l’Accord sur le commerce intérieur, dont l’essentiel avait d’ores et déjà été mené sous la gouverne de Daniel Johnson et supervisé par un président de séance neutre.
Après l’échec référendaire de 1995, le Québec s’est investi dans les négociations multilatérales qui ont mené à l’Entente-cadre sur l’Union sociale (Tremblay, 2000 : 201). D’abord à l’écart des discussions, le gouvernement Bouchard s’est ensuite joint au consensus de Saskatoon, en août 1998, dans l’espoir de faire front commun avec les autres provinces pour atténuer les visées centralisatrices de ce projet. La demande principale du Québec, soit la présence d’un droit de retrait avec pleine compensation, était alors remplie. Encore une fois, ce consensus vola en éclat le 4 février 1999 sous la pression d’Ottawa et dans un contexte d’importantes restrictions budgétaires. Le gouvernement fédéral parviendra à faire accepter par tous les gouvernements – à l’exception de celui du Québec – une entente-cadre (Canada, 1999). Sans mécanisme impartial de résolution des différends, sans assurance de financement stable et sans de meilleures garanties quant au droit de retrait avec pleine compensation, le gouvernement du Québec de même que l’opposition officielle ne pouvaient entériner une telle entente qui venait légitimer les intrusions financières fédérales dans le domaine des politiques sociales (McRoberts, 1999 : 332 ; Noël, 2000 : 19).
De ces quelques exemples, il ressort que l’approche multilatérale a souvent été synonyme de revers pour le PQ. En pratique, peu importe la nature et le contenu du consensus dont il se veut le porteur, un gouvernement péquiste semble toujours susciter une certaine méfiance (Gagnon et Erk, 2002 : 324-326) chez ceux pour qui l’attachement à l’unité canadienne est une vertu cardinale, et ce, malgré les relations interpersonnelles empreintes de professionnalisme et de courtoisie que ses représentants ont pu établir avec ceux du reste du Canada (Morin, 1985 : 80-82). Que de telles arrière-pensées existent ou non chez les leaders du Parti n’a, en définitive, que bien peu d’importance pour ceux qui, instinctivement, s’en méfient.
Le Parti québécois dans l’opposition : de l’éthique de conviction
Il existe aussi un important contraste entre l’attitude du Parti québécois à l’endroit des négociations multilatérales selon qu’il exerce le pouvoir ou qu’il se trouve dans l’opposition. Dans cette dernière position, le Parti s’est souvent montré très sceptique à l’endroit des négociations multilatérales, où, contrairement au principe de dualité canadienne, le Québec n’est qu’une délégation parmi tant d’autres.
Dans l’opposition, le PQ a en effet combattu la Charte de Victoria de 1971 (Lévesque, 1971a ; 1971b), ce qui a indirectement contribué à son rejet par le gouvernement Bourassa[4]. Rétrospectivement, cette charte offrait au Québec un droit de véto sur la modification de ses pouvoirs, là où la Constitution de 1982 ne contient qu’un droit de retrait avec ou sans compensation financière.
L’Accord du lac Meech est un autre exemple. Même si le virage du « beau risque » avait été entrepris sous le gouvernement Lévesque (Lefebvre, 1984), et même si plusieurs souverainistes avaient activement travaillé à l’élection du Parti conservateur de Brian Mulroney lors des élections du 17 septembre 1984, le PQ a choisi, à terme, de s’opposer à l’Accord au moment de son adoption par résolution à l’Assemblée nationale du Québec (Assemblée nationale, 1987). La principale critique formulée par le Parti québécois concernait l’absence de modernisation du partage des compétences. Autrement dit, l’Accord était trop concentré sur la réforme des institutions fédérales (amélioration du principe de participation), et pas assez sur la décentralisation du fédéralisme (approfondissement du principe d’autonomie) (Croisat et al., 1992 : 92). Le processus d’adoption en vint à avorter, faute d’appuis suffisants dans les autres provinces.
Si l’opposition du PQ à l’Entente de Charlottetown relève de la même logique, son refus de soutenir l’adoption du projet de loi 150 a de quoi surprendre davantage. Après le discours de la « main tendue » de Jacques Parizeau (Assemblée nationale, 1990) et les accents très souverainistes du rapport de la commission Bélanger-Campeau, on aurait pu croire que le PQ apporterait son soutien à la Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du Québec (1991). Cette loi venait mettre en oeuvre le consensus issu de la commission Bélanger-Campeau en rendant possible la tenue d’un référendum sur la souveraineté avant le 26 octobre 1992. Conformément à la stratégie du « couteau sur la gorge » du politologue Léon Dion (1978 : 9), ce référendum devait porter sur la souveraineté du Québec, à moins qu’une offre de réforme constitutionnelle ne soit formulée entre-temps. N’ayant plus confiance en la détermination du gouvernement libéral de mener à terme le processus d’accession à la souveraineté proposé par le rapport final de la commission Bélanger-Campeau, les députés du PQ votèrent finalement contre ce projet de loi visant l’organisation du référendum (Riggi, 2016 : 114-115).
Puis, lors du référendum du 26 octobre 1992, le PQ fit, sans surprise, campagne contre l’Entente de Charlottetown, et ce, même si le contenu de ce projet représentait un progrès pour le Québec par rapport au statu quo. Militant dans le même camp que des fédéralistes très centralisateurs et hostiles aux demandes du Québec (arrêt Libman, 1997), les dirigeants du PQ considéraient le rejet de l’Entente de Charlottetown comme un prélude, une première étape vers la tenue d’un nouveau référendum sur la souveraineté du Québec.
L’opposition du PQ prit aussi forme lors de la création, à l’initiative du gouvernement de Jean Charest, du Conseil de la fédération (SAIC, 2004). Alors que ce renforcement de la coopération interprovinciale par la mise en place d’un secrétariat permanent commun à l’ensemble des provinces n’a rien de bien dangereux pour les intérêts du Québec, les porte-parole du PQ, notamment Alexandre Cloutier, sont allés jusqu’à demander le retrait du Québec en 2010 (Cloutier, 2010). Ils estimaient que les résultats obtenus par le Conseil étaient insatisfaisants, notamment quant à la réflexion sur le pouvoir fédéral de dépenser[5].
Ainsi, dans le rôle de l’opposition officielle surtout, et plus rarement au gouvernement, le PQ s’est opposé à plusieurs projets de réforme qui, bien modestement, allaient malgré tout dans le sens des intérêts du Québec. Au pouvoir, comme le montre sa participation aux négociations préalables au rapatriement de la Constitution, le PQ s’est montré nettement plus constructif et porté sur le compromis. Quant au « beau risque », bien que René Lévesque se soit prêté au jeu, ce n’était pas pour autant une proposition de son cru, même s’il en a payé un certain prix politique. À terme, la perte du pouvoir au profit des libéraux de Robert Bourassa en décembre 1985 n’aura jamais permis de voir comment un gouvernement péquiste aurait composé avec une ronde de négociations constitutionnelles ayant des visées décentralisatrices.
Du rapatriement à la négociation sur l’Union sociale canadienne, en passant par les ententes sur le financement de la santé, ce sont des initiatives fédérales visant à marquer une plus grande centralisation de la fédération qui ont forcé le gouvernement du PQ à s’engager dans ces négociations. Sous réserve des rares épisodes où ce gouvernement a pratiqué la politique de la « chaise vide », il s’est toujours activement impliqué – et de bonne foi – dans les négociations multilatérales portant sur les enjeux prioritaires du moment. Le fait de participer à des négociations entreprises à la demande d’Ottawa ou d’autres provinces l’a souvent placé sur la défensive. Devant les velléités centralisatrices du fédéral, il se retrouve sous pression : forcé à réagir, à se compromettre et à user de son « capital politique », il ne peut travailler directement à la réalisation de son idéal.
Un bilatéralisme étonnamment fructueux
Les relations intergouvernementales peuvent aussi prendre la forme de négociations bilatérales entre le fédéral et le Québec, d’une part, puis entre le Québec et une autre province, d’autre part. Ce type de relations comporte plusieurs avantages pour le Québec. Contrairement aux négociations multilatérales, où il ne compte que pour une délégation parmi celles des autres provinces, auxquelles s’ajoutent de plus en plus souvent les représentants des territoires et des peuples autochtones (Papillon, 2011 ; Newman, 2016), les négociations bilatérales favorisent des relations d’égal à égal entre le Québec et le partenaire choisi.
Cette égalité traduit davantage l’idéal de dualité auquel la conception québécoise du fédéralisme canadien est très attachée. Que ce soit à travers la théorie des deux peuples fondateurs, la revendication de la reconnaissance de la spécificité du Québec, la dualité linguistique, le bijuridisme ou ce que la Cour suprême a appelé « les valeurs sociales distinctes du Québec », nombreux sont les auteurs et les responsables politiques québécois à s’être revendiqués de cette conception dualiste du fédéralisme canadien (Chaput-Rolland et Graham, 1963 ; Bonenfant, 1965 ; Allaire, 1991 ; Dion, 1995 ; Ryan, 1995 ; Montpetit, 2007 ; Pelletier, 2010).
Pour les gouvernements du PQ, ce sont les négociations bilatérales, dont il a parfois été l’instigateur, qui ont offert les meilleures avancées dans la promotion des intérêts du Québec.
Sur le plan constitutionnel, le recours à l’approche bilatérale, suivant la procédure des « arrangements spéciaux » de l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, a rendu possible la déconfessionnalisation des commissions scolaires au profit d’un nouveau système fondé sur les clivages linguistiques (Modification constitutionnelle de 1997 [Québec], 1997 ; Proulx, 1998). Ce succès est d’autant plus considérable qu’il s’agit de la seule modification constitutionnelle qui concerne le Québec survenue depuis l’adoption de la nouvelle formule d’amendement en 1982.
C’est néanmoins sur le terrain des ententes dites administratives ou intergouvernementales que les succès ont été les plus nombreux. Ces ententes permettent au fédéral et aux provinces d’encadrer ou de coordonner l’exercice de leurs compétences respectives (Bankes, 1991). En pratique, elles sont souvent une manière de contourner les contraintes du partage des compétences en faveur d’une centralisation ou d’une décentralisation administrative vers le Québec ou vers Ottawa (Taillon, 2016).
Même si elles sont statistiquement nombreuses, ces ententes n’ont pas toutes la même importance. Le plus souvent, elles organisent l’intrusion du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces par une participation du pouvoir central au financement d’activités relevant a priori de compétences provinciales. L’exercice du pouvoir fédéral de dépenser offre, à cet égard, un exemple éloquent (Turcotte, 2012).
Inversement, dans d’autres situations, ces ententes réalisent une forme de décentralisation administrative. Les autorités fédérales délèguent alors au gouvernement du Québec des compétences exécutives (ou administratives) supplémentaires. C’est évidemment ce second type d’ententes qui contribue à renforcer l’autonomie du Québec. Les gouvernements du PQ ont conclu quelques ententes de ce type. L’exemple le plus connu est certainement l’Entente Canada-Québec portant sur la collaboration en matière d’immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire. Signée en 1978 par le ministre québécois de l’Immigration, Jacques Couture, et par son homologue fédéral, Jack Cullen, elle reconnaît au Québec, pour la première fois, le droit de sélectionner les ressortissants étrangers sur son territoire en fonction de ses propres intérêts[6].
En outre, en avril 1997, l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail intervient après trente ans de revendications du Québec. En vertu de cette dernière, le fédéral laisse notamment au Québec toute la responsabilité de la planification, de la conception et de la mise en oeuvre des services publics d’emplois financés à même les fonds provenant du compte d’assurance-emploi – dont Ottawa demeure le seul responsable.
De la formation de la main-d’oeuvre à l’immigration, en passant par la déconfessionnalisation du système scolaire et par le siège du Québec au Sommet de la francophonie[7], l’importance des ententes bilatérales conclues par le PQ compte très certainement parmi les aspects les plus positifs de son bilan gouvernemental. Ces gains arrachés au gouvernement central ont parfois fait dire à certains que le PQ serait mieux placé que les partis fédéralistes pour faire pression sur le fédéral, dans la mesure où la crainte d’un référendum amènerait celui-ci à faire des concessions bilatérales à l’endroit du Québec pour éviter d’attiser le mécontentement au sein de l’électorat de la seule province majoritairement francophone. Un tel raisonnement est évidemment impossible à vérifier.
Dans la même optique, le Parti québécois a parfois enregistré des « gains » sur des mesures qu’il n’avait pas demandées, et ce, tout simplement parce que ces gestes posés par Ottawa s’inscrivaient dans le cadre d’une série d’actions (communément appelée le « Plan A ») visant à reconquérir la confiance des Québécois au lendemain des résultats exceptionnellement serrés du référendum de 1995. La mise en place de vétos régionaux, en 1996, au profit du Québec et de toutes les autres « régions de provinces » du Canada, de même que le vote d’une résolution, le 29 novembre 1995, par la Chambre des communes, reconnaissant le Québec comme société distincte, sont des illustrations emblématiques de ce genre de « gains » non sollicités, sur des questions qui ne figuraient pas dans les revendications prioritaires du gouvernement péquiste au pouvoir. Il ne semble d’ailleurs pas y avoir d’équivalent à ces gestes atypiques sous les libéraux si ce n’est la reconnaissance de la nation québécoise par résolution à la Chambre des communes le 27 novembre 2006, laquelle, à bien des égards, apparaît comme une réponse à un défi lancé par le Bloc québécois.
Au-delà de ces gains non sollicités, il ressort des relations bilatérales entre Québec et Ottawa un contraste sidérant entre, d’un côté, les tensions politiques et idéologiques qui se répercutent dans les discours et, de l’autre, les résultats concrets quant à la conclusion des ententes (Papillon et Simeon, 2004 : 127 ; Laplante-Lévesque, 2010 : 111). Johanne Poirier souligne, à juste titre, que « le nombre d’ententes intergouvernementales conclues par le gouvernement du Québec n’était pas nécessairement inférieur sous l’égide du PQ, mais ce dernier n’étalait pas la pratique de manière aussi manifeste » (Poirier, 2008 : 5). Autrement dit, la rhétorique politique ou la communication gouvernementale diffèrent, mais les pratiques institutionnelles demeurent[8].
Sans surprise, le PQ s’est montré peu enclin à ébruiter l’ampleur de sa contribution à l’amélioration du fédéralisme par le biais des ententes intergouvernementales. Après tout, ces dernières sont utiles, certes, car elles peuvent être le véhicule de gains importants, mais il ne faut jamais sous-estimer leur précarité sur le plan juridique (Poirier, 2008). En effet, le respect de ces ententes repose en grande partie sur la bonne volonté de leurs signataires. Elles sont juridiquement fragiles et peu contraignantes dans la mesure où les législateurs du fédéral et des provinces sont libres de contredire leur contenu. Dans certaines circonstances, leur poids politique et symbolique les protège de toute remise en question, comme c’est probablement le cas des ententes Canada-Québec sur l’immigration. Toutefois, dans bien d’autres cas, surtout lorsqu’elles ont de fortes incidences financières, elles sont sporadiquement désavouées par une loi de l’un ou de l’autre des parlements. Les autorités fédérales conservent ainsi la capacité juridique de revoir unilatéralement l’ampleur de leurs investissements ou de n’importe quel type d’engagement pris dans une entente administrative (Adam, 2008 ; Turcotte, 2012).
Bref, comparativement à l’approche multilatérale, les ententes bilatérales ont l’avantage d’offrir plus de souplesse et de flexibilité quand vient le temps de réunir les appuis préalables nécessaires à un changement, mais elles ont aussi l’inconvénient de fournir peu de garanties juridiques lorsqu’elles prennent la forme d’ententes administratives (Taillon, 2016).
L’unilatéralisme sous plusieurs formes
Parce qu’il suppose pour le Québec une plus grande maîtrise de son destin, l’unilatéralisme est a priori une stratégie qui devrait, à bien des égards, mieux concorder avec l’idéal souverainiste. Le fait de poser des gestes par lui-même, sans l’accord des autres membres de la fédération et, souvent, sans même chercher à obtenir cet assentiment, représente effectivement un acte d’affirmation, un geste de souveraineté qui fait contraste avec le partage du pouvoir et la coopération que sous-tend le fédéralisme. Il y a toutefois lieu de distinguer deux formes d’actions unilatérales. Celle qui exploite la marge d’autonomie conférée par la Constitution (autonomiste) et celle qui s’inscrit davantage dans une logique de rupture ou de conquête de nouveaux pouvoirs (défiance). Dans ce second scénario, l’action unilatérale vise à contourner le cadre constitutionnel, à le réinterpréter ou à forcer le jeu pour s’attribuer de facto certains pouvoirs ou certaines prérogatives qui ne figuraient manifestement pas dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution ni dans celui des tribunaux. L’unilatéralisme comme expression de l’autonomie provinciale est donc une composante essentielle de la logique fédérale, et ce, tant et aussi longtemps qu’il est conforme à la Constitution et n’empiète pas sur les prérogatives des autres membres de la fédération.
Un unilatéralisme autonomiste prudent
Dans le cas particulier du Parti québécois, il est quelque peu étonnant de constater à quel point ses actions unilatérales se sont, somme toute, cantonnées à un unilatéralisme « autonomiste ». Pour un parti dont l’article premier prône la sortie du cadre constitutionnel canadien, il a quand même assez peu joué la carte de la défiance[9]. Même pour réaliser l’indépendance, le PQ a, la plupart du temps, et assurément lors des référendums de 1980 et de 1995, privilégié la négociation des modalités d’accession à la souveraineté par un accord d’association ou de partenariat. En fait, même cette rupture était pensée et conçue à l’intérieur des paramètres du droit et de la légalité.
Outre le débat particulier sur le processus d’accession à la souveraineté, l’unilatéralisme a souvent pris la forme d’une surenchère identitaire sous les gouvernements du PQ. Dans les années qui ont suivi l’offensive des commandites fédérales, les gouvernements de Lucien Bouchard et de Bernard Landry ont été particulièrement actifs dans la modification de la dénomination de certaines institutions. À titre d’exemple, l’Institut de police du Québec est devenu, en 2000, l’École nationale de police, alors qu’en 2002, le Musée du Québec a changé de nom pour Musée national des beaux-arts du Québec et la fête de Dollard a été rebaptisée Journée nationale des Patriotes.
En outre, le rapatriement de la Constitution a amené le gouvernement à poser des gestes importants. Pour bien marquer son opposition, le législateur québécois a adopté en 1982 une loi omnibus modifiant l’ensemble des lois québécoises afin d’y inclure une dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés, conformément aux modalités prévues par l’article 33 de cette dernière. Il a aussi bonifié le contenu de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise), et ce, pour au moins trois raisons. Premièrement, il s’agissait de bien marquer que les griefs du Québec contre la Charte canadienne n’emportaient pas un rejet des droits et libertés. Deuxièmement, il y avait aussi une volonté de faire du texte de la Charte québécoise un texte plus complet, plus exhaustif que son équivalent canadien (Morin, 1994 : 196). Troisièmement, en ajoutant des droits collectifs de même que des droits économiques et sociaux, le législateur québécois marquait une différence philosophique qui contraste avec l’approche strictement individualiste et libérale de la Charte canadienne[10] (Morel, 1993 : 16-18). Ces différents objectifs participaient, de près ou de loin, à une concurrence identitaire qui prenait pour champ de bataille les deux instruments de protection des droits et libertés que sont la Charte québécoise et la Charte canadienne (Laforest, 1992 : 131-135 et 190).
Dans sa gestion des compétences provinciales, le Parti québécois a aussi exploité l’autonomie que lui offrait la Constitution canadienne, mais en composant, autant que possible, avec les contraintes juridiques qu’elle impose. Par exemple, la réforme de la Loi sur l’Assemblée nationale de 1982 a poursuivi le processus de « dé-monarchisation » du vocabulaire et du fonctionnement de la législature (Paquin, 2018 ; Deschênes, 2019a ; 2019b), mais sans oser attaquer de front la charge de lieutenant-gouverneur fermement protégée par la Constitution. De même, l’adoption de la Loi sur la consultation populaire ainsi que les réformes du financement des partis politiques en 1977-1978 ont marqué une évolution des institutions vers une conception plus républicaine, axée sur la souveraineté du peuple. En l’occurrence, cette dernière s’est néanmoins incarnée sous la forme de référendums dits « consultatifs » (Taillon, 2007) afin de composer avec les contraintes de la Constitution.
Même les législations les plus audacieuses, celles dont la constitutionnalité sera contestée, demeurent des lois pour lesquelles il y avait, certes, une volonté d’utiliser l’autonomie dont dispose le Québec pour aller dans une direction opposée à celle du fédéral, mais sans trop s’éloigner des paramètres de la Constitution. L’adoption de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, dite « loi 99 », est un parfait exemple d’unilatéralisme plus autonomiste. Cherchant à redéfinir les règles d’accession à la souveraineté, l’adoption, en 2000, de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (loi sur la clarté) a marqué un net recul par rapport à l’autonomie du Québec (Turp, 2000 ; Rocher et Verrelli, 2003) en institutionnalisant un droit de regard des autorités fédérales sur la « clarté » de la question et des résultats référendaires. Adoptée en réponse à cette loi fédérale sur la clarté, la loi 99 a été habilement rédigée de manière à affirmer les principes constitutifs de l’État québécois comme entité fédérée. En concurrence avec la loi fédérale, sans pour autant porter atteinte à l’avis de la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998), le contenu de cette loi québécoise, conjugué au recours à l’interprétation conforme, a permis de concilier les principes fondamentaux de la démocratie et de l’État québécois contenus dans la loi 99 avec les paramètres du droit constitutionnel canadien. C’est du moins ce qu’a conclu la Cour supérieure du Québec, en 2018, dans le jugement Henderson, lequel se trouve présentement devant la Cour d’appel.
Du reste, l’adoption de la Charte de la langue française a aussi semblé, à certains égards, en rupture avec les politiques canadiennes. C’est, du moins, un virage législatif important (Plourde, 1988). Dans sa version initiale, la Charte comportait des dispositions qui étaient contraires au bilinguisme institutionnel prévu à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, les décideurs de l’époque avaient des motifs raisonnables de croire que le Québec détenait le pouvoir de modifier unilatéralement ces questions (Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 [1]). À terme, la Cour suprême a donné tort au Québec sur ce point, mais les prétentions de ce dernier constituaient néanmoins une hypothèse plausible.
La Charte de la langue française (loi 101) réduisait aussi les droits des citoyens anglophones issus d’autres provinces de fréquenter l’école anglaise au Québec, par ce qu’on a appelé la « clause Québec ». Si cette disposition a finalement été invalidée par les tribunaux dans l’arrêt Quebec Association of Protestant School Boards de 1984, c’est seulement après que le gouvernement Trudeau eut réussi le coup de force du rapatriement et inséré, dans la Charte canadienne, une partie sur les droits linguistiques (Laforest, 1992 : 190). Le sens du détail que l’on retrouve dans les articles 16 à 23 de la Charte canadienne ne doit rien au hasard et n’a pas son équivalent pour les autres droits garantis (Proulx, 1985 : 179). En effet, ils ont été sciemment rédigés de manière à contredire la loi 101 et à faire prévaloir la « clause Canada » aux dépens de la « clause Québec », pour ainsi rétablir le droit des citoyens issus d’autres provinces de fréquenter l’école anglaise au Québec. Il en va de même de plusieurs des autres aspects de la loi 101 qui ont été invalidés par les tribunaux, notamment les dispositions relatives à la langue d’affichage (arrêts Devine, 1988 et Ford, 1988). En définitive, ces contraintes juridiques, qui n’existaient pas en 1977, ont rendu possible, après 1982, le développement d’une jurisprudence défavorable à la législation québécoise.
Pour justifier sa politique linguistique dans le cadre des relations intergouvernementales, le gouvernement de René Lévesque a souvent eu recours à une approche originale, celle de la réciprocité (Lévesque, 1977 : 2 et 4). Dans une logique défensive, le Québec invitait les autres provinces à offrir autant de droits à leur minorité francophone que ce qu’il offre à sa minorité historique anglophone. Il s’agit d’une manière de souligner l’asymétrie des droits qui existent, depuis 1867, entre les minorités anglophones et francophones du Canada. L’argument de la réciprocité a bien évidemment un effet miroir. Il rappelle que ce qui est bon pour les Anglo-Québécois devrait a fortiori l’être pour les fragiles minorités francophones du reste du Canada.
L’unilatéralisme passif : des occasions manquées pour le Québec
Si l’action unilatérale du Parti québécois a davantage épousé les formes de l’autonomisme que celles de la rupture ou de la défiance, cette volonté du Québec de faire les choses seul et à sa manière a parfois pris la forme d’une politique de la « chaise vide », un unilatéralisme passif qui, lui, consiste plus simplement à s’abstenir de participer à certains forums de coopération multilatérale.
À cet égard, la politique de la chaise vide n’est pas le monopole du PQ. Après l’échec de l’Accord du lac Meech, Robert Bourassa, dans une déclaration solennelle, avait clairement exprimé son intention de ne négocier que d’égal à égal avec Ottawa et de s’abstenir de participer à certaines conférences multilatérales, estimant que le processus de révision de la Constitution était « discrédité » (Assemblée nationale, 1990).
Il n’empêche que le PQ a, à plusieurs reprises, employé cette stratégie, notamment en refusant de contribuer à l’élaboration d’un plan d’action national pour la condition féminine (Marois, 1983 : 3-4), aux discussions portant sur la Prestation nationale pour enfant, au processus de négociation entourant la déclaration de Calgary ou à une partie importante des négociations préalables à l’Union sociale de 1999 (Noël, 2008 : 29-30). À la politique de la chaise vide s’est aussi ajoutée celle du refus de signer, en fin de course, l’entente négociée par le fédéral et les autres provinces.
Cette stratégie de la chaise vide s’est aussi transportée devant les tribunaux, en 1998, pour des raisons qui tiennent au mode de désignation des juges et à l’interprétation d’un texte constitutionnel imposé au Québec sans son consentement. Ce fut le cas lorsque le gouvernement de Lucien Bouchard a décidé de s’abstenir de toute intervention dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec. Ce choix a forcé la Cour à nommer un amicus curiae pour représenter les intérêts du Québec. Il faut dire que les avis de 1981 et de 1982 sur le rapatriement et sur le droit de véto du Québec avaient très sérieusement et durablement ébranlé la confiance des nationalistes québécois à l’endroit de la Cour suprême.
Cette méfiance envers des juges nommés unilatéralement par Ottawa peut d’ailleurs expliquer un plus faible recours aux tribunaux pour contester des initiatives fédérales de la part des gouvernements du PQ par rapport aux plus récents mandats des libéraux. Alors que ces derniers ont, durant les années 2000, entrepris plusieurs contestations dans des dossiers comme ceux de la réforme du Sénat, des valeurs mobilières, du registre des armes à feu ou de la procréation assistée, le PQ, quant à lui, s’est montré plus passif. Dans le court mandat de Pauline Marois, c’est seulement sous la pression de recours intentés par des parties civiles que le gouvernement du Québec est intervenu dans le dossier de la nomination du juge Marc Nadon et dans celui de la succession au trône.
Du reste, s’ajoute à cette liste le refus du gouvernement Bouchard, en 1996, de défendre les demandes constitutionnelles du Québec à l’occasion de la révision obligatoire de la formule d’amendement prévue dans la Loi constitutionnelle de 1982. Le 21 juin 1996, le premier ministre canadien, Jean Chrétien, a profité d’une rencontre avec ses homologues provinciaux pour inscrire ce sujet, parmi bien d’autres points, à l’ordre du jour. Pendant cette discussion qui portait précisément sur le bilan de la Constitution de 1982, le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, a choisi de s’absenter quelques minutes des délibérations. À la sortie de la rencontre, Jean Chrétien a déclaré qu’il considérait avoir satisfait aux exigences de l’obligation constitutionnelle de réexamen (Whyte, 1996 : 15-16).
Alors qu’il aurait pu mobiliser l’attention des médias, de la population et de la classe politique, sans parler de la possibilité de saisir les tribunaux afin de les amener à préciser la nature des obligations prévues par l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Taillon et Deschênes, 2012), le gouvernement du Parti québécois a préféré passer son tour. Demeuré passif ce jour-là, il a raté une occasion ou, à tout le moins, une tribune pour rappeler les problèmes créés par le rapatriement, tant en ce qui concerne la manière dont il a été adopté que son contenu.
Cette hésitation à engager sérieusement le débat sur le fonctionnement du fédéralisme et sur la meilleure manière de défendre les intérêts du Québec à l’intérieur du système canadien s’est aussi manifesté dans l’opposition du PQ lors de la publication du document Québécois, notre façon d’être Canadiens (SAIC, 2017). Plutôt que d’encourager ou de prolonger les délibérations sur la nouvelle politique en exigeant la tenue d’une commission parlementaire ou en élaborant des contre-propositions susceptibles de révéler les carences du document, les critiques du PQ ont surtout porté sur le peu d’appétit pour des discussions constitutionnelles du côté des autorités fédérales et des autres provinces.
Hésitant à s’enfoncer dans la réforme à long terme du fédéralisme ou craignant d’être accusés de faire le pari d’un nouveau « beau risque », les gouvernements du PQ ont parfois été passifs dans certains dossiers, là où le Québec aurait pu se forger un rapport de force et créer les conditions favorables à des changements constitutionnels.
Conclusion
Malgré son orientation souverainiste, l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976 n’a pas substantiellement modifié les positions du Québec sur les fronts constitutionnel et intergouvernemental. Au contraire, ses revendications se sont, pour l’essentiel, inscrites dans la continuité du positionnement historique du Québec à l’endroit des autres membres de la fédération. Au premier chef, la promesse d’offrir « un bon gouvernement » (Godin, 2005 : 22) constituait un signal important : l’action du PQ n’allait pas être radicalement différente de celle des gouvernements du Parti libéral et de l’Union nationale, du moins en attendant de pouvoir réaliser la souveraineté. Après tout, un « bon gouvernement » s’engage dans la gestion des affaires courantes et dans la défense des intérêts du Québec, et ce, même si cette action s’inscrit à l’intérieur du système fédéral, nonobstant les conséquences sur une démarche visant à sortir de ce système (Lévesque, 2007 : 398-399 ; Parizeau, 2009 : 36).
À de nombreuses reprises, les approches unilatérales, bilatérales et multilatérales ont donc été employées par le PQ pour porter les intérêts du Québec dans le Canada. Dans différents forums, et de manière variée, il s’est positionné de manière à défendre les deux principes normatifs du fédéralisme : l’autonomie et la coopération/participation (Brouillet, 2006 : 82-83 et 94-95). Alors que le premier permet au fédéral et aux provinces d’être, chacun à leur manière, « souverains » dans leurs champs de compétence, le second passe généralement par l’implication des États membres de la fédération dans l’organisation et dans le fonctionnement des institutions communes.
Entre les gouvernements du Parti québécois et ceux du Parti libéral du Québec, de l’Union nationale et maintenant de la Coalition avenir Québec, il y a une différence de degré plus qu’une différence de nature lorsqu’il est question de relations intergouvernementales. Les critiques à l’endroit du gouvernement fédéral sont semblables et, dans le cadre des affaires courantes, les solutions proposées aussi. C’est seulement sur les contours d’une solution à long terme que les gouvernements souverainistes du Parti québécois et les gouvernements fédéralistes du Parti libéral s’opposent frontalement.
Certes, l’idéal d’indépendance peut parfois freiner la réflexion sur les affaires constitutionnelles et les relations intergouvernementales. Cette réticence apparaît encore plus forte lorsqu’il s’agit de questions touchant à l’amélioration des institutions fédérales ou communes et à la participation des provinces à ces institutions (les exemples de la réforme de la Cour suprême et de la succession royale en témoignent), par opposition à des dossiers mettant davantage en cause l’autonomie des provinces (pouvoir accru en immigration, déconfessionnalisation du système scolaire, etc.). Tout se passe comme si, à choisir entre les deux piliers du fédéralisme que sont le principe d’autonomie et le principe de participation/coopération, le PQ avait implicitement choisi de privilégier le premier au détriment du second.
En outre, lorsqu’il est question de la souveraineté ou lorsqu’il est dans l’opposition, le PQ inscrit davantage son discours et son action dans une éthique de conviction. En revanche, au pouvoir, notamment lorsqu’il est affaibli par ses échecs référendaires, le Parti fait preuve d’un pragmatisme et d’un sens du compromis étonnants qui rapprochent son action de celle des autres formations politiques (Montigny, 2017).
Ce décalage entre la promesse d’une politique différente, plus agressive à l’endroit d’Ottawa, que semblent supposer l’étiquette de parti souverainiste et les actions somme toute très modérées des gouvernements du PQ, est bien illustré par la doctrine de la « gouvernance souverainiste ». Développée par Pauline Marois et son ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, Alexandre Cloutier, le Parti signifiait ainsi son intention d’être plus ferme envers Ottawa, d’être plus qu’un « bon gouvernement » et, s’il le faut, de poser des « gestes de rupture » (Laplante, 2004) avec le fonctionnement habituel de la fédération, une façon de « forcer le jeu », à défaut de pouvoir faire l’indépendance. Au pouvoir, la « gouvernance souverainiste » (Cloutier et Maltais, 2013) s’est avérée être en parfaite continuité avec le cours normal de ce que n’importe quel gouvernement du Québec peut habituellement réaliser dans la défense de ses intérêts.
Appendices
Notes biographiques
Patrick Taillon est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, où il enseigne le droit constitutionnel et le droit administratif. Son plus important ouvrage, Le référendum, expression directe de la souveraineté du peuple ? Essai critique sur la rationalisation de l’expression référendaire en droit comparé, a été publié en 2012, aux éditions Dalloz, et a pour objet les effets juridiques des décisions majoritaires prises lors d’un référendum. Outre la démocratie référendaire, ses intérêts de recherche portent, entre autres, sur les évolutions passées et à venir de la Constitution, sur les modes d’exercice du pouvoir constituant de même que sur le renouvellement du fédéralisme canadien. Il assure la direction, pour le compte de l’Association québécoise de droit constitutionnel (AQDC), d’une revue de presse quotidienne de l’actualité constitutionnelle.
Amélie Binette est doctorante en droit, en cotutelle entre l’Université Laval (Québec) et l’Université d’Orléans (France). Dans le cadre de ses recherches, elle s’intéresse à la désuétude en droit constitutionnel canadien à travers le prisme de la force et de la densification normatives. Ses travaux portent également sur les sources, les pratiques et les dysfonctionnements du fédéralisme canadien. Elle a récemment codirigé, avec les professeurs Patrick Taillon et Guy Laforest, l’ouvrage Jean-Charles Bonenfant et l’esprit des institutions, paru en 2018 dans la collection « Prisme » des Presses de l’Université Laval.
Notes
-
[1]
Notons que quelques provinces demeurent méfiantes à l’endroit de l’appui de la Saskatchewan à la bande des huit en raison de « ses relations plus étroites au niveau des fonctionnaires et des politiciens avec le gouvernement fédéral » (Peckford, 2013 : 39).
-
[2]
Le renoncement n’était ici que partiel et symbolique puisque le Québec ne ratifiera pas la Loi constitutionnelle de 1982 (Assemblée nationale, 1981). À terme, c’est la Cour suprême, dans le Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution (1982), qui niera l’existence du droit de véto tiré des usages – dont le Québec avait toujours bénéficié avant 1982.
-
[3]
Une ronde de négociations constitutionnelles se déroula également entre août 1982 et février 1983 sur des questions autres que celles ayant trait aux Autochtones, soit les tribunaux administratifs, les tribunaux de la famille à juridiction regroupée, les lieutenants-gouverneurs et les droits de propriété. Le Québec y participa, mais toujours à titre d’observateur. Puisque la formule de l’unanimité était alors requise pour modifier la charge des représentants de la Reine, le projet de réforme avorta (Hurley, 1996 : 110-111).
-
[4]
Cela dit, l’opposition du PQ a certainement pesé moins lourd que les divisions internes au sein des libéraux, dont la frange plus nationaliste critiquait le projet (Ryan, 2004).
-
[5]
Lors de son mandat comme première ministre, Pauline Marois a toutefois participé à toutes les rencontres du Conseil de la fédération en 2012 et en 2013 (SQRC, 2019).
-
[6]
En 1991, elle fut remplacée par l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, laquelle s’inscrit dans la même lignée.
-
[7]
Signée par les gouvernements de Pierre-Marc Johnson et de Brian Mulroney le 7 novembre 1985, l’Entente Canada/Québec relativement au Sommet des pays francophones prévoit que le premier ministre du Canada et celui du Québec recevront une invitation au Sommet francophone et seront tous deux présents pendant l’événement.
-
[8]
Selon Pelletier (2008 : 89-90), il en est de même des rencontres fédérales-provinciales-territoriales auxquelles le Québec participe assidûment, même dirigé par un gouvernement du Parti québécois.
-
[9]
Le principal contre-exemple serait la défunte Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement (2013). Certains diront qu’il s’agit d’un exemple d’une législation volontairement hors système, proposée afin de mettre en tension les choix législatifs du Québec avec l’interprétation très individualiste de la liberté de conscience et de religion préconisée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Syndicat Northcrest (2004), Multani (2006), N.S. (2012) ou Mouvement laïque québécois (2015). Néanmoins, puisque ce projet de loi n’a jamais été adopté, on ne pourra connaître les compromis et les amendements qu’il aurait pu contenir ni le sort que lui auraient réservé les tribunaux.
-
[10]
Malheureusement, à notre avis, la Cour suprême s’est efforcée, dans son interprétation des deux chartes, d’atténuer toute forme de différentialisme pour privilégier une interprétation uniformisatrice des droits, aux antipodes de l’autonomie des provinces que suppose une fédération (Bernatchez, 2008 : 13-24).
Bibliographie
- Adam, Marc-Antoine, 2008, « Le fédéralisme, le pouvoir de dépenser et l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 », Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 1, p. 1-22, consulté sur Internet (https://aqdc.quebec/wp-content/uploads/2016/07/adam-federalisme_pouvoir_de_depenser.pdf) le 25 février 2019.
- Adam, Marc-Antoine, Josée Bergeron et Marianne Bonnard, 2015, « Intergovernmental Relations in Canada : Competing Visions and Diverse Dynamics », dans Johanne Poirier, Cheryl Saunders et John Kincaid (sous la dir. de), Intergovernmental Relations in Federal Systems : Comparative Structures and Dynamics, Don Mills, Oxford University Press, p. 135-173.
- Allaire, Jean, 1991, Un Québec libre de ses choix. Rapport du Comité constitutionnel du Parti libéral du Québec, Montréal, Parti libéral du Québec, 28 janvier.
- Assemblée nationale, 1981, Résolution de l’Assemblée nationale du Québec concernant le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne, 2 octobre.
- Assemblée nationale, 1987, Résolution de l’Assemblée nationale du Québec autorisant la modification de la Constitution du Canada en conformité avec l’Accord du lac Meech, 23 juin.
- Assemblée nationale, 1990, Journal des débats, 34e législature, 1re session, vol. 31, n° 6, 22 juin.
- Bankes, Nigel, 1991, « Co-operative Federalism : Third Parties and Intergovernmental Agreements and Arrangements in Canada and Australia », Alberta Law Review, vol. 29, no 4, p. 792-838.
- Bastien, Frédéric, 2013, La bataille de Londres : dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, Montréal, Boréal.
- Bernatchez, Stéphane, 2008, « La Cour suprême du Canada et la Charte québécoise des droits et libertés : des décisions judiciaires non entièrement théorisées en guise de dialogues », Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 1, p. 1-24, consulté sur Internet (https://aqdc.quebec/wp-content/uploads/2016/07/bernatchez-cour_supreme_charte_quebecoise-1.pdf) le 26 février 2019.
- Bonenfant, Jean-Charles, 1965, « Le bilan du passé », dans Raymond Morel (sous la dir. de), La dualité canadienne à l’heure des États-Unis, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 25-30.
- Bonenfant, Jean-Charles, 1976, « La Cour suprême et le partage des compétences », Alberta Law Review, vol. 14, p. 21-33.
- Brouillet, Eugénie, 2006, La négation de la nation : l’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien, Québec, Septentrion.
- Canada, 1999, Un cadre visant à améliorer l’union sociale. Entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, Ottawa, 4 février, consulté sur Internet (https://scics.ca/fr/product-produit/entente-un-cadre-visant-a-ameliorer-lunion-sociale-pour-les-canadiens/) le 25 février 2019.
- Chaput-Rolland, Solange et Gwethalyn Graham, 1963, Chers ennemis, Montréal, Les Éditions du Jour.
- Cloutier, Alexandre, 2010, Point de presse de M. Alexandre Cloutier, Québec, Hôtel du Parlement, 7 avril, consulté sur Internet (http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-4909.html) le 25 février 2019.
- Cloutier, Alexandre et Agnès Maltais, 2013, Présentation des actions concrètes du gouvernement Marois pour défendre les Québécois, Conférence de presse de M. Alexandre Cloutier et de Mme Agnès Maltais, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Québec, édifice Pamphile-Le May, 3 avril, consulté sur Internet (http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-10951.html) le 25 février 2019.
- Croisat, Maurice, Franck Petiteville et Jean Tournon, 1992, Le Canada, d’un référendum à l’autre : les relations politiques entre le Canada et le Québec (1980-1992), Talence, Association française d’études canadiennes.
- Deschênes, Gaston, 2019a, « “…Long Live our Noble Queen…” (air connu) », Blogue Septentrion, 20 janvier, consulté en ligne (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/01/20/long-live-our-noble-queen-air-connu/) le 10 mars 2019.
- Deschênes, Gaston, 2019b, « “… Long Live our Noble Queen…” (suite) », Blogue Septentrion, 14 février, consulté en ligne (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/02/14/long-live-our-noble-queen-suite/) le 10 mars 2019.
- Dion, Léon, 1978, « Le Canada et le Québec : la part du nationalisme », Études canadiennes, no 5, p. 5-15.
- Dion, Léon, 1995, Le duel constitutionnel Québec-Canada, Montréal, Boréal.
- Fortin, Sarah, Alain Noël et France St-Hilaire, 2003, Forging the Canadian Social Union : SUFA and Beyond, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques.
- Gagnon, Alain-G., 2000, « Introduction : l’opposition du Québec à l’union sociale canadienne », dans Alain-G. Gagnon (sous la dir. de), L’union sociale canadienne sans le Québec. Huit études sur l’entente-cadre, Montréal, Saint-Martin, p. 11-18.
- Gagnon, Alain-G., 2006, « Le fédéralisme asymétrique au Canada », dans Alain-G. Gagnon (sous la dir. de), Le fédéralisme canadien contemporain : fondements, traditions, institutions, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 287-304.
- Gagnon, Alain-G. et Yan Erk, 2002, « From Jean Bodin to Consociational Democracy and Back », dans Stephen Brooks (sous la dir. de), The Challenge of Cultural Pluralism, Westport, Praeger Publishers, p. 129-138.
- Gauvin, Jean-Philippe, 2017, Les relations intergouvernementales et la coordination des politiques publiques au Canada : entre relations formelles et informelles, thèse de doctorat, Département de science politique, Université de Montréal.
- Godin, Pierre, 2005, René Lévesque, L’homme brisé, Montréal, Boréal.
- Hogg, Peter W., 1993, « The Difficulty of Amending the Constitution of Canada », Osgoode Hall Law Journal, vol. 31, p. 41-61.
- Hurley, James Russ, 1996, La modification de la Constitution du Canada. Historique, processus, problèmes et perspectives d’avenir, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada.
- Labelle, Caroline, 2008, Claude Morin et la question constitutionnelle (1961-1981), mémoire de maîtrise, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal.
- Laforest, Guy, 1992, « La Charte canadienne des droits et libertés au Québec : nationaliste, injuste et illégitime », dans François Rocher (sous la dir. de), Bilan québécois du fédéralisme canadien, Montréal, VBL, p. 124-151.
- Laforest, Guy et Rosalie Readman, 2013, « Plus de détresse que d’enchantement. Les négociations constitutionnelles de novembre 1981 vues du Québec », dans François Rocher et Benoit Pelletier (sous la dir. de), Le nouvel ordre constitutionnel canadien. Du rapatriement de 1982 à nos jours, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 57-83.
- Laplante, Robert, 2004, « Revoir le cadre stratégique », L’Action nationale, janvier, p. 1-31.
- Laplante-Lévesque, François, 2010, L’impact des mécanismes de fédéralisme exécutif sur le déficit fédératif canadien, mémoire de maîtrise, Département de science politique, Université du Québec à Montréal.
- Lefebvre, Robert, 1984, « Négocier avec le gouvernement Mulroney constitue un “beau risque”, dit Lévesque », Le Devoir, 24 septembre, p. 1.
- Lemieux, Vincent, 1991, « Le positionnement des partis dans les débats sur l’avenir politique du Québec », dans Louis Balthazar, Guy Laforest et Vincent Lemieux (sous la dir. de), Le Québec et la restructuration du Canada, 1980-1992 : enjeux et perspectives, Québec, Septentrion, p. 265-279.
- Lévesque, René, 1971a, « Veni, vidi, Vic-toria ? », Le Journal de Montréal, 11 juin.
- Lévesque, René, 1971b, « Miss Turner-Trudeau », LeJournal de Montréal, 19 mai.
- Lévesque, René, 1977, Déclaration du premier ministre du Québec sur les accords de réciprocité en matière d’enseignement, 18e conférence annuelle des premiers ministres provinciaux, St. Andrews, Nouveau-Brunswick, 18-19 août, Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC), doc 850-8/012.
- Lévesque, René, 2007 [nouv.éd.], Attendez que je me rappelle, Montréal, Québec Amérique.
- Marois, Pauline, 1983, Notes pour une intervention de Pauline Marois, ministre déléguée à la Condition féminine, Conférence fédérale-provinciale territoriale des ministres responsables de la Condition féminine, Ottawa, 31 mai et 1er juin, Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC), doc. 830-129/019, p. 3-4.
- McRoberts, Kenneth, 1999, Un pays à refaire. L’échec des politiques constitutionnelles canadiennes, Montréal, Boréal.
- Montigny, Éric, 2017, « Partis autonomistes et indépendantistes : paradoxes et influence institutionnelle », Civitas Europa, vol. 1, no 38, p. 85-108.
- Montpetit, Éric, 2007, Le fédéralisme d’ouverture. La recherche d’une légitimité canadienne au Québec, Québec, Septentrion.
- Morel, André, 1993, « L’originalité de la Charte québécoise en péril », dans Développements récents en droit administratif, vol. 45, « Formation permanente du Barreau », Cowansville, Yvon Blais, p. 65-89.
- Morin, Claude, 1985, « L’expérience canadienne et québécoise de révision constitutionnelle : leçons et perspectives », Cahiers de droit, vol. 26, no 1, p. 29-55.
- Morin, Claude, 1991, Mes premiers ministres : Jean Lesage, Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, René Lévesque, Montréal, Boréal.
- Morin, Claude, 1994, Les choses comme elles étaient : une autobiographie politique, Montréal, Boréal.
- Morin, Jacques-Yvan et José Woehrling, 1992 [2e éd.], Les constitutions du Canada et du Québec du régime français à nos jours, t. 1, Montréal, Thémis.
- Newman, Dwight, 2016, « Understanding the Section 43 Bilateral Amending Formula », dans Emmett Macfarlane (sous la dir. de), Constitutional Amendment in Canada, Toronto, University of Toronto Press, p. 147-163.
- Noël, Alain, 2000, « Étude générale sur l’entente », dans Alain-G. Gagnon (sous la dir. de), L’union sociale canadienne. Huit études sur l’entente-cadre, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 19-48.
- Noël, Alain, 2008, « Fédéralisme d’ouverture et pouvoir de dépenser au Canada », Revista d’estudis autonòmics i federals, no 7, p. 10-36.
- O’Reilly, James, 1984, « La Loi constitutionnelle de 1982. Droit des autochtones », Cahiers de droit, vol. 25, no 1, p. 125-144.
- Painter, Martin, 1991, « Intergovernmental Relations in Canada : An Institutional Analysis », Canadian Journal of Political Science, vol. 24, no 2, p. 269-288.
- Papillon, Martin, 2011, « Adapting Federalism : Indigenous Multilevel Governance in Canada and the United States », Publius : The Journal of Federalism, vol. 42, no 2, p. 289-312.
- Papillon, Martin et Richard Simeon, 2004, « The Weakest Link ? First Ministers’ Conferences in Canadian Intergovernmental Relations », dans Peter J. Meekison, Hamish Telford et Harvey Lazar (sous la dir. de), Canada. The State of the Federation 2002, vol. 86, Montréal/Ithaca, McGill-Queen’s University Press, p. 113-140.
- Paquin, Magali, 2018, « Jean-Charles Bonenfant, artisan de la modernité parlementaire au Québec », dans Amélie Binette, Patrick Taillon et Guy Laforest (sous la dir. de), Jean-Charles Bonenfant et l’esprit des institutions, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 333-352.
- Parizeau, Jacques, 2009, La souveraineté du Québec. Hier, aujourd’hui et demain, Boisbriand, Michel Brûlé.
- Peckford, Brian, 2013, « Les mythes du rapatriement enfin dévoilés ! », dans François Rocher et Benoit Pelletier (sous la dir. de), Le nouvel ordre constitutionnel canadien. Du rapatriement de 1982 à nos jours, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 27-44.
- Pelletier, Benoît, 2009, « Les relations intergouvernementales au Canada, vues dans une perspective horizontale », dans Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico (dir.), Seminario internacional la federalización en España : Los déficit de la cooperación intergubernamental, p. 1-36.
- Pelletier, Benoît, 2010, Une certaine idée du Québec. Parcours d’un fédéraliste : de la réflexion à l’action, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Prisme ».
- Pelletier, Réjean, 2004, « Les mécanismes de coopération intergouvernementale : facteurs de changements ? », dans Tom McInstosh, Pierre-Gerlier Forest et Gregory P. Marchildon (sous la dir. de), La gouvernance du système canadien, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, vol. 3, Les Études de la commission Romanov, p. 151-194.
- Pelletier, Réjean, 2008, Le Québec et le fédéralisme canadien. Un regard critique, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Pitfield, Michael, 1980, Report to Cabinet on Constitutional Discussionsand the Outlook for the First Ministers’ Conference and Beyond, 30 août, reproduit dans David A. Milne, 1982, The New Canadian Constitution, Toronto, Lorimer, p. 219.
- Plourde, Michel, 1988, La politique linguistique du Québec : 1977-1987, vol. 6, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.
- Poirier, Johanne, 2008, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien : Les ententes intergouvernementales », Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 1, p. 1-31, consulté sur Internet (https://aqdc.quebec/wp-content/uploads/2016/07/poirier-une_source_paradoxale.pdf) le 13 janvier 2019.
- Proulx, Daniel, 1985, « La loi 101, la clause-Québec et la Charte canadienne devant la Cour suprême : un cas d’espèce ? », Revue générale de droit, vol. 16, no 1, p. 167-193.
- Proulx, Daniel, 1998, « La modification constitutionnelle de 1997 relative aux structures scolaires au Québec : une mesure opportune et juridiquement solide », Revue du Barreau, vol. 58, p. 41-94.
- Rémillard, Gil, 1983, « Historique du rapatriement », Cahiers de droit, vol. 25, no 1, p. 15-97.
- Riggi, Jessica, 2016, La question constitutionnelle chez les responsables politiques québécois, 1985-1991 : un long désenchantement, mémoire de maîtrise, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal.
- Rocher, François et Nadia Verrelli, 2003, « Questioning Constitutional Democracy in Canada : From the Canadian Supreme Court Reference on Quebec Secession to the Clarity Act », dans Alain-G. Gagnon, Montserrat Guibernau et François Rocher (sous la dir. de), The Conditions of Diversity in Multinational Democracies, vol. 45, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, p. 207-237.
- Ryan, Claude, 1995, Regards sur le fédéralisme canadien, Montréal, Boréal.
- Ryan, Claude, 2000, « L’entente sur l’union sociale canadienne vue par un fédéraliste québécois », dans Alain-G. Gagnon (sous la dir. de), L’Union sociale canadienne sans le Québec. Huit études sur l’entente-cadre, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 245-262.
- Ryan, Claude, 2004, « Le non d’un gouvernement et d’un peuple (juin 1971) », Le Devoir, 9 février.
- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 1998, Position historique du Québec sur le pouvoir fédéral de dépenser : 1944-1998, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 2001, Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental : de 1936 à mars 2001, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 2004, Le Conseil de la fédération, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 2008, Les positions traditionnelles du Québec sur le partage des pouvoirs : 2002-2008, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 2017, Québécois, notre façon d’être Canadiens. Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Secrétariat québécois aux relations canadiennes (SQRC), 2019, Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental de 2001 à 2018, Québec, Ministère du Conseil exécutif.
- Smiley, Donald, 1976 [2e éd], Canada in Question : Federalism in the Seventies, Toronto, McGraw-Hill, Ryerson.
- Taillon, Patrick, 2007, « Pour une redéfinition du référendum consultatif », Revue internationale de droit comparé, vol. 59, no 1, p. 143-156.
- Taillon, Patrick, 2016, « Une Constitution en désuétude. Les réformes paraconstitutionnelles et la “déhiérarchisation” de la Constitution au Canada », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez (sous la dir. de), avec la collaboration de George Azzaria, La norme juridique « reformatée ». Perspectives québécoises des notions de force normative et de sources revisitées, Sherbrooke, Éditions de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, p. 297-355.
- Taillon, Patrick et Alexis Deschênes, 2012, « Une voie inexplorée de renouvellement du fédéralisme canadien : l’obligation constitutionnelle de négocier des changements constitutionnels », Cahiers de droit, vol. 53, no 3, p. 461-522.
- Thorlakson, Lori, 2009, « Patterns of Party Integration, Influence and Autonomy in Seven Federations », Party Politics, vol. 15, no 2, p. 157-177.
- Tremblay, André, 2000, « Pouvoir fédéral de dépenser », dans Alain-G. Gagnon (sous la dir. de), L’union sociale canadienne sans le Québec. Huit études sur l’entente-cadre, Montréal, Saint-Martin, p. 185-222.
- Turcotte, Marc-André, 2012, Comment faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement : le pouvoir fédéral de dépenser à l’épreuve du fédéralisme canadien, mémoire de maîtrise, Département de science politique, Québec, Université Laval.
- Turp, Daniel, 2000, La nation bâillonnée. Le plan B ou l’offensive d’Ottawa contre le Québec, Montréal, VLB.
- Weber, Max, 1959, Le savant et le politique (introduction par Raymond Aron), Paris, Plon.
- Wheare, Kenneth Clinton, 1953 [3e éd.], Federal Government, Londres, Oxford University Press.
- Whyte, John D., 1996, « A Constitutional Conference… Shall Be Convened… : Living with Constitutional Promises », Constitutional Forum, vol. 8, no 1, p. 15-19.
- Woehrling, José, 1992, « Le principe d’égalité, le système fédéral canadien et le caractère distinct du Québec », dans Pierre Patenaude (sous la dir. de), Québec-Communauté française de Belgique : autonomie et spécificité dans le cadre d’un système fédéral, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 119.
- Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].
- Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11.
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).
- Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.).
- Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, L.C. 2000, c. 26.
- Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1.
- Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, RLRQ, c. E-20.2.
- Loi sur la consultation populaire, RLRQ, c. 64.1.
- Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du Québec, L.R.Q., 1991, c. 34.
- Modification constitutionnelle de 1997 [Québec], TR/97-141 (Gaz. Can. II).
- Proclamation de 1983 modifiant la Constitution, TR/84-102 (Gaz. Can. II).
- Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790.
- Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.
- Henderson c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 1586.
- Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569.
- Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3.
- Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256.
- P.G. (Qué) c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66.
- R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726.
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.
- Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.
- Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551.

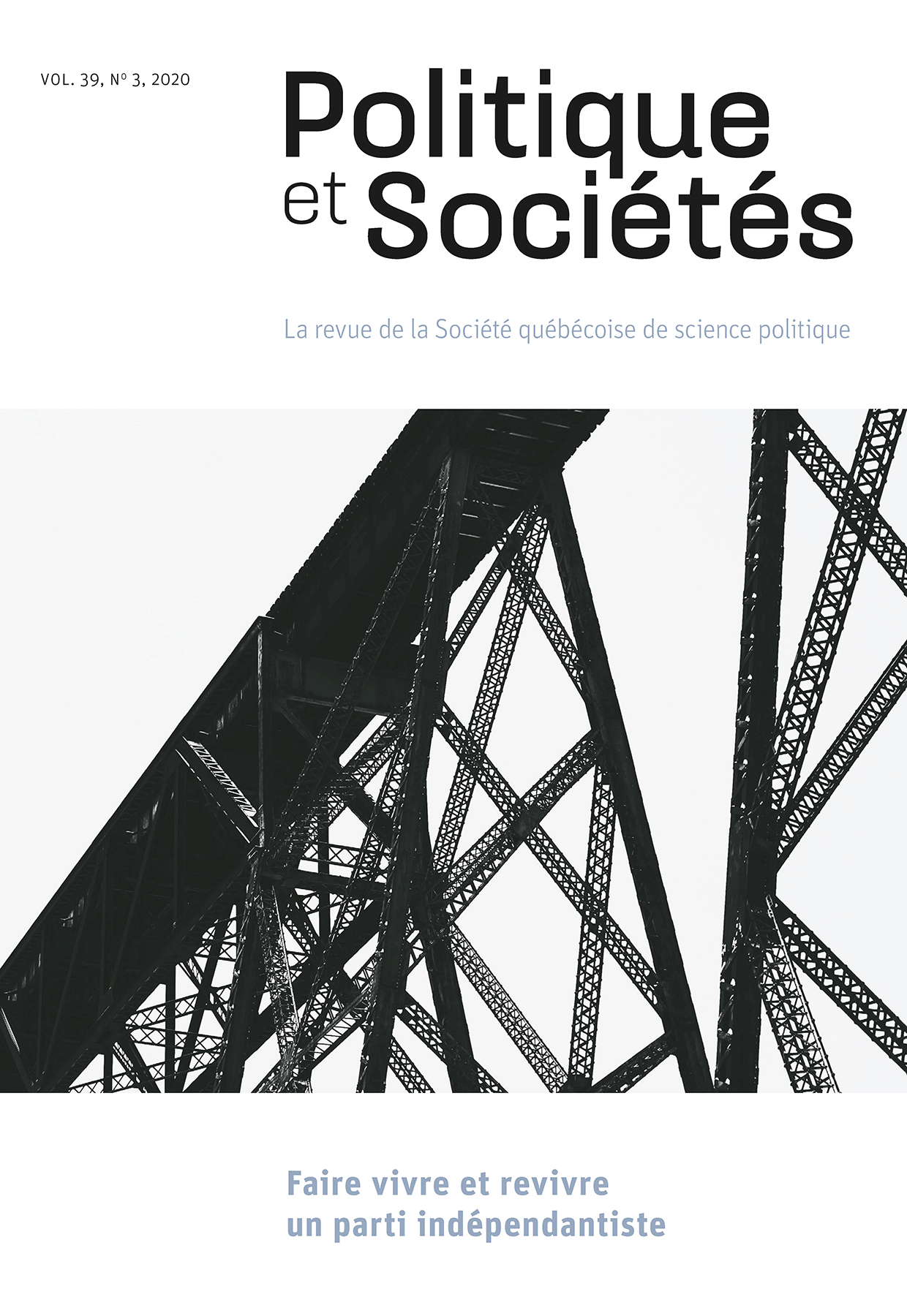
 10.7202/042644ar
10.7202/042644ar