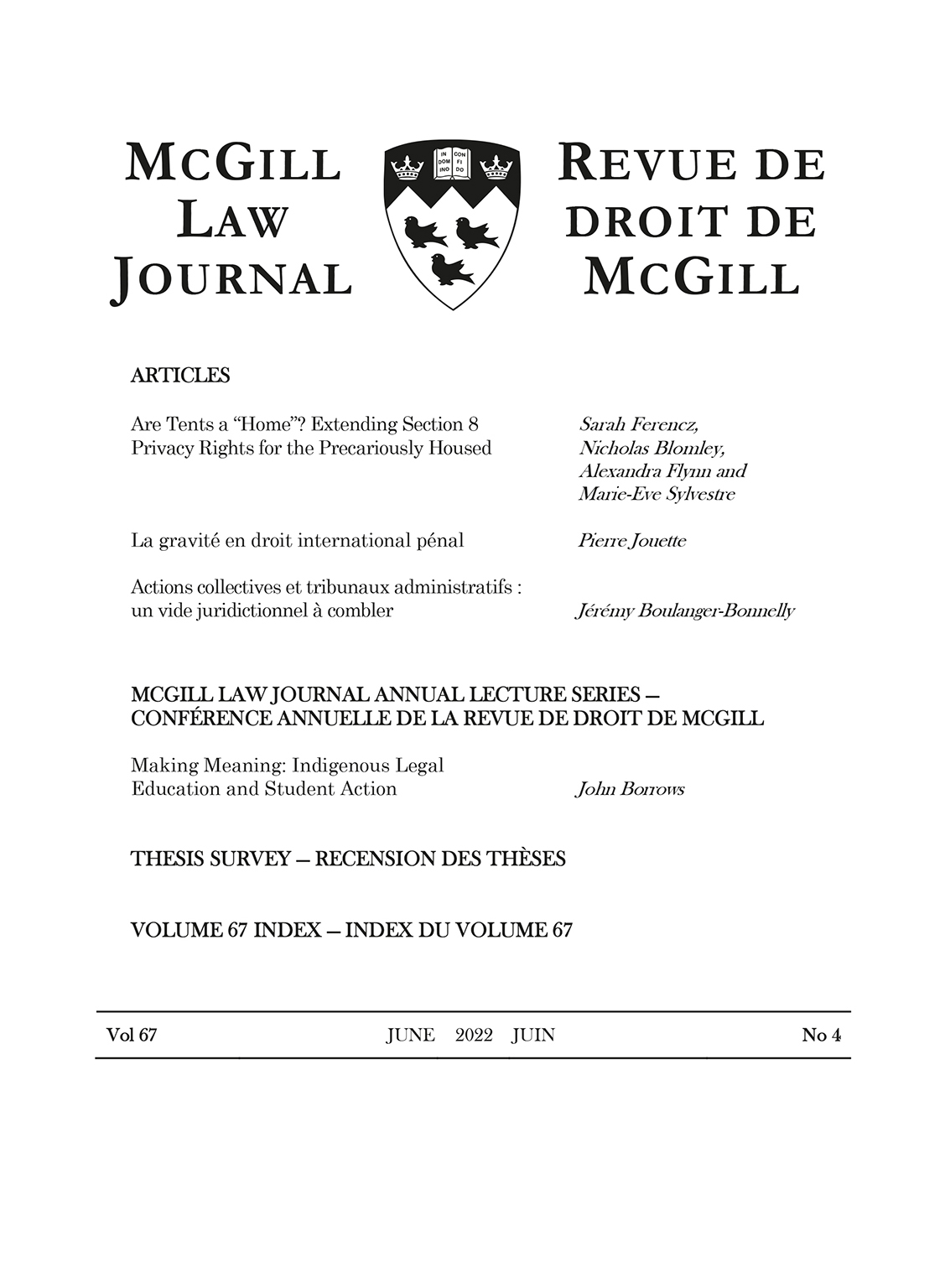Abstracts
Résumé
Les actions collectives sont un outil fondamental d’accès à la justice, d’économie des ressources judiciaires et de dissuasion. Alors qu’elles sont en principe disponibles dans tous les domaines du droit civil, la Cour d’appel du Québec a récemment confirmé qu’elles ne peuvent être intentées lorsque le litige relève exclusivement de la compétence d’un tribunal administratif. En conséquence, des dossiers qui pourraient se prêter à une décision collective, comme ceux qui opposent des dizaines de locataires à des propriétaires immobiliers d’envergure, doivent plutôt procéder par voie individuelle. Or, plusieurs justiciables n’ont tout simplement pas les moyens ni la volonté de se pourvoir en justice pour des montants qui, pris isolément, n’en valent pas la peine. Le présent article explore trois pistes de solution qui permettraient de rectifier la situation en matière de baux de logement, soit le renforcement du mécanisme des causes types devant le Tribunal administratif du logement, la possibilité d’intenter des actions collectives en cette matière devant la Cour supérieure du Québec, et l’octroi au Tribunal administratif du logement du pouvoir d’entendre de telles actions. Eu égard aux objectifs de l’action collective et à l’expérience de certaines autres juridictions, cette dernière solution semble être la plus prometteuse et mériterait donc d’être explorée par le législateur. Enfin, l’article conclut que cette solution est conforme à la Constitution du Canada.
Abstract
Class actions are a fundamental tool for access to justice, for saving judicial resources, and for deterrence. While they are, in principle, available in all areas of civil law, the Quebec Court of Appeal recently confirmed that they cannot be brought when the dispute falls exclusively within the jurisdiction of an administrative tribunal. As a result, cases that could be decided collectively, such as those between dozens of tenants and large property owners, must instead be decided individually. Many litigants simply do not have the means or the will to litigate for amounts that, taken individually, are not worth the effort. This article explores three possible solutions to rectify the situation with respect to residential leases: strengthening the test case mechanism before the Tribunal administratif du logement, making it possible to bring class actions in this area before the Superior Court of Québec, and giving the Tribunal administratif du logement the power to hear such actions. Given the objectives of class actions and the experience of some other jurisdictions, the latter solution appears to be the most promising and should therefore be explored by the legislator. Finally, the article concludes that this solution is consistent with the Constitution of Canada.
Article body
Introduction
L’action collective est un mécanisme procédural incontournable du paysage juridique québécois. Des dizaines d’actions de cette nature sont intentées annuellement dans des domaines aussi variés que le droit de la consommation, le droit des assurances, la responsabilité extracontractuelle ou la responsabilité de l’État[1]. Ces actions permettent à des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois de faire valoir des droits qui, autrement, risqueraient de demeurer lettre morte. Pour ne prendre qu’un exemple, des consommateurs qui ont eu à débourser quelques dollars à peine en frais de conversion de devises imposés illégalement ont pu collectivement réclamer des millions de dollars. Sans le mécanisme de l’action collective, cet argent serait manifestement resté dans les coffres des banques concernées[2].
De la même façon, certains litiges entre propriétaires et locataires se prêtent bien mal à des actions individuelles. Par exemple, des propriétaires qui disposent de centaines de logements résidentiels peuvent profiter de leur position pour imposer des frais illégaux dont le montant est trop faible pour qu’il vaille la peine de les contester individuellement devant les tribunaux. Or, dans une telle situation, il demeure impossible pour les locataires de mener une action collective afin de rétablir leur rapport de force et de faire valoir leurs droits de façon efficace et peu coûteuse. Comme la Cour d’appel du Québec l’a récemment confirmé dans l’arrêt Veer[3], en reprenant des principes développés par la Cour suprême du Canada, leur seul recours demeure une action individuelle devant le Tribunal administratif du logement, qui a succédé en 2020 à la Régie du logement.
Le présent article soutient qu’une réforme serait nécessaire afin de corriger cette situation. Dans un premier temps, il résume l’affaire Veer et les conclusions de la Cour d’appel du Québec, qui servent de point de départ à la réflexion (I). Il explique ensuite les conséquences de cet arrêt et de l’état du droit qu’il consacre, tant pour les justiciables que pour le système de justice et la société dans son ensemble (II). En réponse à cette situation, il met de l’avant trois pistes de solution, soit le renforcement du mécanisme des causes types devant le Tribunal administratif du logement, l’octroi à la Cour supérieure du Québec du pouvoir d’entendre des actions collectives relatives aux baux de logement, ou encore l’octroi d’un tel pouvoir au Tribunal administratif du logement (III). À la lumière de l’expérience d’autres juridictions, l’article conclut que cette dernière solution semble être la plus porteuse. Enfin, la dernière section de l’article suggère qu’une telle réforme respecterait les limites constitutionnelles imposées en vertu de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867[4] (IV).
I. L’affaire Veer
Résumons tout d’abord l’arrêt Veer, qui est à l’origine de notre réflexion. Cette affaire oppose deux locataires à leurs locatrices, des sociétés commerciales d’envergure[5], dont elles contestent certaines pratiques prétendument illégales. Mme Veer soutient que les 200$ qu’elle a dû payer pour céder son bail excédaient les « dépenses raisonnables » dont le recouvrement est permis dans de telles circonstances[6]. Pour sa part, Mme Létourneau allègue que les locatrices ont fait défaut d’inscrire sur son bail « le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant » sa signature[7] et qu’elle aurait dû être compensée pour des travaux majeurs effectués dans son immeuble[8]. Jusque-là, les trois litiges sont similaires à ceux qui surviennent ponctuellement dans le cours des relations entre propriétaires et locataires.
La particularité de l’affaire tient à ce que les demanderesses décident d’utiliser le véhicule de l’action collective pour faire valoir leurs droits[9]. Compte tenu que le parc locatif des défenderesses comprend 6 000 unités au Québec et que leurs pratiques semblent répandues[10], des milliers de personnes sont susceptibles d’en avoir elles aussi fait les frais. Or, puisqu’il est difficile de les identifier et d’obtenir de leur part un mandat pour les représenter en justice[11], l’action collective apparaît comme la voie procédurale tout indiquée.
Les demanderesses déposent donc trois demandes pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective auprès de la Cour supérieure du Québec, laquelle « est seule compétente pour entendre les actions collectives » aux termes de l’article 33 du Code de procédure civile (ci-après C.p.c.). Les défenderesses demandent toutefois le rejet des trois demandes au motif qu’elles relèveraient plutôt de la compétence exclusive de la Régie du logement qui s’étend, selon l’article 28(1) de sa loi constitutive, à « toute demande […] relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec » [nos italiques][12]. Les demanderesses rétorquent que l’article 33 C.p.c. doit avoir préséance sur cette attribution de compétence; qu’à tout événement les demandes sont de nature extracontractuelle et ne sont pas « relative[s] au bail d’un logement »[13]; et qu’elles dépassent collectivement 85 000$ et échappent donc à la compétence de la Régie du logement[14].
La Cour supérieure et la Cour d’appel rejettent ces trois arguments et mettent fin aux actions collectives proposées. Sur l’interaction entre l’article 28(1) de la Loi sur la Régie du logement et l’article 33 C.p.c., les juges concluent que ce dernier ne peut écarter la compétence ratione materiae des tribunaux et autres organismes juridictionnels[15]. Ils se fondent au premier chef sur l’arrêt Bisaillon[16], dans lequel la Cour suprême du Canada a jugé qu’une action relative à l’administration d’un régime de retraite ne pouvait être intentée de façon collective puisqu’un arbitre de grief avait compétence exclusive sur le litige. Pour la Cour, « le recours collectif demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels » [nos italiques][17]. Ainsi, tel qu’établi par la jurisprudence antérieure[18], « la procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d’un autre tribunal »[19].
Dès lors, la question principale qui se pose dans Veer est de savoir si l’arrêt Bisaillon, rendu sous l’empire du C.p.c. (1965), demeure d’actualité en vertu du nouveau C.p.c. La Cour supérieure et la Cour d’appel répondent par l’affirmative. Selon elles, l’article 571 C.p.c. confirme que l’action collective demeure un moyen de procédure, alors que l’article 33 C.p.c. reprend pour l’essentiel l’article 1000 C.p.c. (1965), qui prévoyait que la Cour supérieure avait compétence exclusive en matière de recours collectifs[20]. Seule la Régie du logement peut entendre les demandes de Mmes Veer et Létourneau[21], puisqu’elles sont bel et bien « relatives au bail d’un logement »[22] et ne dépassent pas individuellement le seuil de la compétence monétaire de la Cour du Québec[23].
Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par certains débats parlementaires que la Cour supérieure et la Cour d’appel n’ont toutefois pas mentionnés. En 1978, le ministre responsable du projet de loi sur le recours collectif a en effet tenu à préciser que son initiative se limitait à introduire un « moyen de procédure »[24] et ne contenait pas « une espèce d’article universel qui ouvrirait l’ensemble des tribunaux administratifs au recours collectif »[25]. Ces commentaires, quoique non déterminants, révèlent que le législateur n’a pas voulu permettre aux justiciables d’intenter des actions collectives pour les matières réservées exclusivement aux tribunaux administratifs. La ministre responsable du C.p.c. a confirmé que les articles pertinents se limitent à reprendre le droit antérieur, ce qui laisse entendre que cette intention n’a pas changé avec l’adoption du nouveau code[26].
En définitive, une seule voie s’offre donc à Mmes Létourneau et Veer pour faire valoir leurs droits : elles doivent nécessairement saisir la Régie du logement. Or, cette option fait échec à la dimension collective de leurs demandes. D’une part, aucune procédure de recours collectif n’est disponible devant la Régie. D’autre part, si les règles de procédure de cet organisme prévoient la possibilité de recevoir un mandat d’autrui pour agir en son nom ou de réunir plusieurs demandes[27], ces options s’avèrent irréalistes dans les circonstances, compte tenu du nombre de personnes concernées — potentiellement des milliers — et du fait que leur identité est inconnue[28]. D’ailleurs, une recherche au plumitif du Tribunal administratif du logement confirme que Mmes Létourneau et Veer ont décidé de ne pas poursuivre leurs démarches devant ce tribunal[29].
II. Les conséquences de l’état actuel du droit
De cet état du droit découlent certaines conséquences pour les justiciables et le système de justice dans son ensemble. Celles-ci sont de trois ordres : elles ont trait à l’accès à la justice (a); à l’économie des ressources judiciaires (b); et à la dissuasion de pratiques indésirables (c). Ce sont ces mêmes considérations qui sont généralement invoquées pour justifier l’existence de l’action collective[30]. Ainsi, au terme de l’analyse, il appert que des demandes similaires à celles de l’affaire Veer pourraient tout à fait se prêter à ce type d’action.
A. L’accès à la justice
Tout d’abord, la solution retenue dans l’arrêt Veer n’est pas la plus optimale du point de vue de l’accès à la justice. Il est bien établi que l’action collective, bien qu’elle ne soit qu’un véhicule procédural, a une « portée sociale » importante[31]. Ce moyen de procédure vise notamment « à faciliter l’accès à la justice aux citoyens qui partagent des problèmes communs et qui, en l’absence de ce mécanisme, seraient peu incités à s’adresser individuellement aux tribunaux pour faire valoir leurs droits »[32]. Cette réticence à entamer des actions individuelles peut découler de diverses circonstances, que ce soit « l’ignorance des droits substantiels susceptibles d’être exercés, l’ignorance de l’existence d’un préjudice important, des compétences linguistiques limitées, l’âge avancé des demandeurs, une santé psychologique ou physique fragile, la crainte de représailles de la part du défendeur, [ou] l’aliénation découlant de démêlés avec la justice » [notes omises][33]. L’action collective amenuise ces obstacles en permettant aux membres du groupe de conserver un rôle passif et parfois même absent dans la conduite du litige, en s’en remettant au représentant désigné par le tribunal.
Mis à part ces défis d’ordre psychologique ou social, l’enjeu financier est celui qui fait le plus souvent échec aux actions individuelles. En effet, lorsque les sommes en jeu sont modiques sur le plan personnel, chaque demandeur potentiel peut considérer que le problème n’est pas suffisamment important pour saisir le système de justice. Il peut aussi juger que le problème est assez significatif, mais que le temps ou les coûts associés à un éventuel recours en justice dépassent le bénéfice qu’il pourrait obtenir[34]. En d’autres mots, il s’agit d’intérêts diffus et fragmentés qui, de par leur nature, se prêtent bien mal aux actions individuelles qui sont l’apanage traditionnel du système de justice[35]. L’action collective pallie ce problème d’ordre financier « en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe […] [et ainsi] en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement »[36]. Ce mécanisme est particulièrement important dans les domaines où le préjudice causé est souvent minime sur le plan individuel, mais considérable sur le plan collectif, par exemple en droit de la consommation[37], mais aussi en matière d’investissements financiers[38] ou de dommages environnementaux.
Ces mêmes obstacles existent aussi en droit du logement. L’exemple de l’affaire Veer est révélateur à cet égard. Les réclamations respectives de Mmes Veer et Létourneau, allant d’une centaine de dollars à quelques milliers de dollars tout au plus, étaient suffisamment significatives pour poser problème à chacune d’elles. Cependant, les montants en jeu n’étaient pas nécessairement assez importants pour justifier qu’elles entament des actions individuelles étant donné les frais, le temps et les désagréments que cela implique. Évidemment, la procédure simplifiée adoptée par le Tribunal administratif du logement peut minimiser certaines de ces difficultés[39], mais malgré ces aménagements, le recours individuel demeure irréaliste ou inaccessible pour la plupart des locataires concernés. En effet, une procédure simplifiée demeure insuffisante pour écarter complètement certaines des difficultés mentionnées ci-avant, y compris les défis sociaux et psychologiques liés au fait d’entamer une action en justice.
Ces considérations relatives à l’accès à la justice sont d’autant plus importantes lorsque le rapport de force des parties en présence est inégal. Ainsi, alors que Mmes Veer et Létourneau disposent de ressources limitées et doivent assumer entièrement les frais de leur propre demande, les défenderesses bénéficient de ressources significatives vu leur taille. Elles peuvent également réaliser des économies d’échelle si elles sont impliquées dans plusieurs litiges de même nature. À cet égard, le professeur Galanter distingue la position des plaideurs sporadiques (« one-shotters ») de celle des plaideurs répétitifs (« repeat players »). Ces derniers comparaissent plus souvent devant les tribunaux et obtiennenent ainsi une connaissance, une expertise, des relations et des occasions que les premiers n’ont tout simplement pas[40]. En conséquence, les grandes entités qui se pourvoient fréquemment en justice profitent d’un rapport de force qui leur est favorable comparativement aux parties qui, comme Mmes Veer et Létourneau, ne risquent pas de se retrouver aussi souvent devant les tribunaux.
Ce déséquilibre de pouvoir entre locataires et propriétaires n’est pas anecdotique. Si de nombreux locataires québécois louent leur logement auprès de petits propriétaires qui sont parfois dans une situation économique similaire à la leur, des milliers d’autres font plutôt face, comme Mmes Veer et Létourneau, à des entités corporatives d’envergure qui disposent d’un parc locatif de centaines, voire de milliers d’unités. Il est difficile d’obtenir des données fiables et d’actualité à ce sujet, mais les dernières études disponibles suggèrent qu’à peine 12% des propriétaires résidentiels du Québec contrôlent près de 60% du marché locatif de la province[41]. Cette concentration élevée de logements entre les mains d’un faible pourcentage des propriétaires s’explique entre autres par le fait qu’environ 23% des unités locatives dans la province appartiennent à de grands propriétaires qui possèdent 50 unités ou plus[42]. Or, ces propriétaires sont précisément ceux qui sont susceptibles d’être avantagés en tant que plaideurs répétitifs, aux côtés des institutions paragouvernementales qui fournissent elles aussi du logement à des milliers de personnes[43]. Le déséquilibre qui existe entre ces propriétaires et leurs locataires est exacerbé lorsque le taux d’inoccupation est faible[44], comme c’est actuellement le cas au Québec[45], puisque certains propriétaires peuvent se permettre davantage d’écarts sans s’inquiéter de retrouver d’autres locataires au besoin.
Dans de telles circonstances, l’action collective est un outil efficace, voire nécessaire, pour rééquilibrer le rapport de force entre les parties et améliorer l’accès à la justice des plaideurs sporadiques. La jurisprudence et la doctrine mentionnent d’ailleurs expressément que l’un des objectifs de l’action collective est d’« assure[r] l’équilibre des forces entre les parties »[46] et plus spécifiquement entre les individus et les grandes entités corporatives[47]. Certains sont même d’avis « qu’un recours collectif et impersonnel peut seul équilibrer les rapports des forces en présence » [nos italiques][48] dans ces dossiers, en créant un « pouvoir du nombre qui serait inexistant si les réclamations étaient menées individuellement » [notre traduction][49]. En ce sens, l’action collective prend une importance renouvelée dans les secteurs de la société qui se complexifient et se retrouvent de plus en plus sous le contrôle d’un faible pourcentage de la population[50], comme c’est le cas du marché québécois du logement.
Cependant, il faut préciser que l’action collective elle-même n’est pas au-delà de tout reproche en matière d’accès à la justice. Il s’agit d’un véhicule complexe, notamment en raison de la procédure d’autorisation qui doit être complétée avant que l’action puisse suivre son cours sur le fond. Cette procédure, bien qu’elle ne soit en théorie qu’un mécanisme de filtrage visant à écarter les actions frivoles[51], devient souvent lourde à un point tel qu’elle entrave précisément l’accès à la justice que l’action collective vise à favoriser. En 2016, la juge Bich de la Cour d’appel du Québec notait à cet égard que l’autorisation préalable « entrave cet accès » ou, à tout le moins, représente « une formalité dont les coûts exorbitants ébranlent la raison d’être ou encore une sorte de mondanité procédurale ne permettant pas un filtrage efficace »[52]. En réponse à ces critiques, la Cour supérieure a créé en 2018 une « Équipe restreinte en matière d’action collective au stade de l’autorisation » composée de dix juges qui entendent toutes les demandes d’autorisation d’actions collectives dans les districts de la division d’appel de Montréal[53]. Cette réforme semble avoir amélioré l’efficacité et la rapidité du processus[54], quoiqu’il soit encore trop tôt pour en évaluer tous les effets.
Malgré ces efforts, la lourdeur procédurale de l’action collective a des conséquences bien réelles sur l’accès à la justice. Premièrement, elle entraîne des délais considérables à toutes les étapes du processus. À la suite d’une analyse de 1 306 actions collectives au Québec, la professeure Piché note en effet que « l’action collective est une procédure complexe qui entraîne généralement des délais plus importants que pour d’autres procédures »[55]. Elle relève qu’il s’écoule en moyenne plus de deux ans et demi avant que le jugement d’autorisation soit rendu, et un peu plus de cinq ans entre la demande d’autorisation et l’obtention d’un jugement sur le fond[56]. Deuxièmement, l’action collective engendre des coûts qui, bien que répartis entre un grand nombre de justiciables, représentent en moyenne plus de 40% de la valeur du jugement ou du règlement, ce qui limite l’indemnisation des membres du groupe[57]. Ces coûts s’expliquent notamment par le fait que la complexité de l’action collective requiert que les parties soient représentées par avocat, contrairement à certains litiges individuels où elles peuvent plus aisément se représenter seules[58].
Ces quelques données montrent bien que l’action collective n’est pas une panacée et qu’elle vient avec son lot de défis, tout comme l’action individuelle. Il n’en demeure pas moins qu’en permettant le regroupement de demandes individuelles qui ne seraient tout simplement jamais introduites autrement en raison des réticences détaillées ci-avant, elle fournit une voie additionnelle d’accès à la justice qui, quoique imparfaite, conserve une utilité certaine.
C’est en ce sens relatif et pragmatique que l’impossibilité pour les locataires d’intenter des actions collectives pour tout litige concernant leur bail de logement et valant individuellement moins que la limite supérieure de la compétence de la Cour du Québec constitue un obstacle potentiel à leur accès à la justice. Permettre de telles actions pourrait minimiser l’impact des barrières sociales, psychologiques et financières auxquelles font face les locataires, surtout lorsqu’ils s’opposent à des propriétaires d’envergure avec lesquels il existe un déséquilibre de force.
B. L’économie des ressources judiciaires
Au-delà de ses conséquences potentielles sur l’accès à la justice des locataires, la situation consacrée par l’arrêt Veer pose aussi problème sur le plan de l’utilisation des ressources judiciaires.
Supposons un instant que l’ensemble des 6 000 locataires des défenderesses dans l’affaire Veer se soit effectivement décidé à intenter des recours auprès de la Régie du logement fondés sur la même série de faits et les mêmes arguments juridiques, une possibilité que mentionne la Cour d’appel du Québec dans son arrêt[59]. Ces demandes auraient représenté près de 9% du nombre total de demandes introduites l’année dernière devant ce tribunal[60], ce qui aurait causé d’importants délais et de nombreux problèmes logistiques. Évidemment, les obstacles mentionnés ci-avant font en sorte que de telles situations ne surviennent que rarement, voire jamais. Ironiquement, le décrochage judiciaire permet au système de justice de faire des économies, bien qu’il ne soit pas souhaitable pour autant. Le véritable défi consiste à déterminer de quelle façon un éventuel ensemble de demandes soulevant des questions connexes devrait être traité afin d’utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles.
L’action collective vise précisément à répondre à ce défi. Comme la Cour suprême du Canada l’indique, le regroupement d’actions qu’elle opère « permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit »[61]. Le résultat bénéficie à tous, qu’il s’agisse des parties ou du public, puisque « [l]es gains en efficacité ainsi réalisés libèrent des ressources judiciaires qui peuvent être affectées à la résolution d’autres conflits, et peuvent également réduire le coût du litige à la fois pour les demandeurs (qui peuvent partager les frais) et pour les défendeurs (qui contestent les poursuites une seule fois) »[62]. En ce sens, l’action collective s’avère souvent plus efficace que l’action individuelle lorsque le litige présente des aspects collectifs importants.
Il est vrai que les actions collectives mobilisent elles aussi une grande quantité de ressources et prennent un certain temps avant d’être résolues, parfois même davantage qu’une simple action individuelle[63]. Ces délais entraînent des coûts additionnels non seulement pour les justiciables impliqués, mais aussi pour le système de justice dans son ensemble, qui doit consacrer des ressources financières et du temps judiciaire à ces actions d’envergure. Ainsi, les actions collectives exigent leur propre investissement de temps et d’argent qui limite les économies qu’elles peuvent générer sur le plan des ressources judiciaires.
Par contre, il faut comparer ces délais avec l’alternative que représenterait l’introduction d’une multitude de demandes individuelles identiques. En regroupant les demandes qui s’y prêtent, bien que les actions collectives mobilisent des ressources considérables, elles ont l’avantage de les utiliser de façon à donner accès à la justice au plus grand nombre. Elles permettent ainsi d’utiliser judicieusement ces ressources. Ce souci d’efficacité est d’autant plus important considérant qu’un afflux d’actions individuelles similaires risquerait d’ajouter aux délais qui affligent déjà le Tribunal administratif du logement. Bien que la situation se soit améliorée en 2019-2020, il n’en demeure pas moins que les causes civiles générales — soit celles qui seraient les plus susceptibles de faire l’objet d’actions collectives étant donné que les causes urgentes et prioritaires risquent plutôt de procéder par d’autres voies — prennent en moyenne 10,6 mois pour faire l’objet d’une première audience[64]. Ces délais pourraient potentiellement être mieux contrôlés par le traitement de quelques actions collectives que par la résolution de dizaines d’actions individuelles similaires.
Bref, la possibilité de mener des actions collectives devant les tribunaux administratifs mobiliserait probablement davantage de ressources que la situation actuelle, caractérisée par un décrochage judiciaire important. Néanmoins, si l’objectif est de permettre au plus grand nombre de faire valoir leurs droits, l’analyse qui précède suggère que, d’un point de vue systémique, il peut être plus efficace de traiter les actions similaires collectivement, plutôt que de manière individuelle.
C. La dissuasion de pratiques indésirables
Enfin, au-delà de ses conséquences sur l’accès à la justice et sur les ressources judiciaires, l’état du droit consacré par l’arrêt Veer peut nuire à la dissuasion de comportements indésirables.
Comme l’affirmait le ministre responsable du projet de loi sur le recours collectif adopté en 1978, cette voie procédurale a pour troisième objectif de faire « réfléchir ceux qui auraient […] la tentation de frauder, de commencer à frauder ou de continuer à le faire »[65]. Par le fait même, elle contribue « à mettre un frein à des pratiques commerciales absolument inqualifiables »[66]. Ces paroles, bien que datant de plusieurs décennies déjà, demeurent d’actualité. Ainsi, la Cour suprême du Canada identifie « l’exercice des recours collectifs comme [un] moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes » [nos italiques][67]. En l’absence de ce mécanisme procédural, « des personnes qui causent des préjudices individuels mineurs mais répandus pourraient négliger le coût total de leur conduite, sachant que, pour un demandeur, les frais d’une poursuite dépasseraient largement la réparation probable »[68]. Cette réalité leur permet de « présumer que de petits méfaits ne donneraient pas lieu à un litige »[69]. En conséquence, les principes que le législateur enchâsse dans ses lois impératives « risquent de demeurer du papier ou du placotage »[70]. L’action collective permet de renverser cette tendance en rendant bien réelle la possibilité d’une action en justice, ce qui augmente l’effet de dissuasion[71].
Cette dissuasion sert avant tout à rendre plus efficaces les dispositions impératives adoptées par le législateur, la possibilité d’une action collective incitant les défendeurs potentiels à modifier leur conduite avant même qu’une demande d’autorisation ne soit déposée, ou à la suite d’un jugement défavorable. Ainsi, l’action collective « sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence »[72]. La dissuasion joue aussi un rôle plus large dans l’économie de marché, puisqu’un commerçant qui adopte des pratiques illégales peut en tirer un avantage indu par rapport à ses compétiteurs. En ce sens, des actions collectives efficaces « promeuvent la compétition et l’efficacité du marché […] au bénéfice des individus, des compagnies et de la société dans son ensemble » [notre traduction][73]. Enfin, la dissuasion est essentielle pour maintenir la confiance du public envers le système de justice. Des réclamations d’une faible valeur peuvent tout de même générer du ressentiment chez les justiciables qui, voyant que de potentiels défendeurs peuvent réaliser des profits illégaux en toute impunité, peuvent se mettre à douter de l’efficacité des lois et des institutions[74].
Ces considérations valent tout autant en droit du logement. Certains propriétaires de grande envergure peuvent imposer illégalement quelques dollars à chacun de leurs locataires pour profiter du fait que la plupart de ces derniers ne voudront pas, ou ne pourront pas, faire appel au Tribunal administratif du logement pour rectifier la situation. Leurs pratiques, même lorsqu’elles sont illégales et qu’elles touchent des dizaines, voire des centaines de locataires, peuvent se poursuivre sans qu’aucune conséquence juridique n’en découle. Dans ces circonstances, ces propriétaires qui posent des gestes illégaux n’ont aucun incitatif véritable à respecter les prescriptions de la loi, tant que leurs contraventions demeurent sous le seuil de tolérance de leurs locataires. Ce faisant, les dispositions que le législateur adopte pour protéger ces derniers, malgré leur caractère progressiste, risquent de rester lettre morte.
III. Solutions potentielles
Il ressort de ce qui précède que certaines actions qui sont actuellement menées devant le Tribunal administratif du logement pourraient se prêter à l’action collective. Or, la rigidité des règles relatives à la compétence ratione materiae ferme cette voie et force les justiciables à se limiter à leurs demandes individuelles ou — plus probablement — à abandonner leurs droits. Les tribunaux sont obligés d’appliquer ces règles et ne peuvent se demander « s’il serait opportun qu’une action collective puisse être intentée » [nos italiques][75], mais cette question demeure fondamentale pour d’éventuelles réformes législatives.
Dans cet ordre d’idées, la présente section explore trois solutions possibles au problème soulevé précédemment. Tout d’abord, une option pragmatique (mais aussi moins efficace) serait de prévoir un mécanisme par lequel une décision rendue par le Tribunal administratif du logement pourrait être désignée comme cause type afin de simplifier le traitement d’actions similaires déposées subséquemment par d’autres demandeurs (a). Une autre possibilité serait de permettre à la Cour supérieure d’entendre des actions collectives relatives aux baux de logement, malgré la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement en cette matière (b). Enfin, un troisième moyen de répondre à ce problème consisterait à permettre à ce dernier tribunal d’entendre de telles actions lorsque le litige relève de sa compétence ratione materiae (c).
A. Une solution pragmatique : renforcer les causes types
Une première solution qui ne demanderait pas nécessairement de changement législatif important et qui serait donc plus pragmatique dans l’environnement actuel consisterait à renforcer le mécanisme des causes types (aussi connues sous leur appellation anglaise de « test cases ») devant le Tribunal administratif du logement.
Une cause type est une action individuelle menée par l’un des justiciables affectés par une situation dont les conséquences sont collectives. Cette action se déroule comme à l’habitude et se solde par une décision qui ne s’applique officiellement qu’au justiciable en question. Or, considérant notamment la doctrine du stare decisis, les parties et les tiers qui prennent connaissance de cette décision peuvent s’attendre à ce que des dossiers identiques ou même similaires connaissent la même issue[76]. Le défendeur qui a perdu l’action, par exemple, risque d’être plus enclin à compenser hors cour d’autres demandeurs se trouvant dans la même situation, afin d’éviter des échecs judiciaires semblables. Il est aussi probable qu’il modifie son comportement futur afin de se conformer aux enseignements du tribunal, de peur d’être de nouveau poursuivi en justice.
Le mécanisme des causes types perd toutefois en efficacité devant le Tribunal administratif du logement qui, comme les autres tribunaux administratifs québécois, n’est pas strictement lié par ses propres décisions, contrairement aux cours civiles[77]. En conséquence, les décisions du tribunal n’ont qu’une force persuasive mais non contraignante dans les affaires subséquentes, même lorsque celles-ci sont similaires ou identiques. Il n’existe donc aucune garantie qu’une cause type menée devant ce tribunal aurait l’impact escompté sur les parties et sur les tiers, ce qui limite l’effet de dissuasion normalement associé à ce mécanisme.
Les causes types pourraient toutefois être renforcées par des ajustements qui permettraient aux décisions non seulement d’avoir un effet persuasif sur les parties et sur les tiers, mais aussi de lier d’autres parties qui décideraient d’en bénéficier. En Angleterre, par exemple, le Group Litigation Order (ci-après GLO) permet au tribunal, dans le contexte d’une action civile, d’établir un registre afin que d’autres parties se joignent à une action déjà intentée et bénéficient de la décision éventuellement rendue. Dans certaines circonstances, le tribunal peut en outre autoriser d’autres parties à s’inscrire au registre après que la décision a été rendue[78], ce qui donne une force renouvelée au principe de la cause type. On pourrait éventuellement penser à implanter un tel mécanisme auprès du Tribunal administratif du logement, ce qui ne demanderait pas de modification législative et pourrait se faire à même les règlements de procédure appropriés. Concrètement, cela aurait par exemple permis à Mmes Veer et Létourneau de mener leurs réclamations à terme, puis de demander au tribunal de permettre à d’autres locataires de s’inscrire afin de bénéficier eux-aussi de la décision, sans pour autant devoir passer à travers le même processus.
Un mécanisme calqué sur le GLO anglais aurait toutefois ses limites. Comme toute autre action individuelle, il placerait le fardeau du recours judiciaire sur les épaules de l’individu qui déciderait de mener le dossier. Ce fardeau serait d’autant plus grand qu’en cas d’échec, cet individu demeurerait souvent responsable des frais de justice[79]. Qui plus est, on peut s’attendre à ce que peu de personnes s’inscrivent véritablement au registre pour réclamer leur dû. En Angleterre, par exemple, le taux de réclamation de plusieurs GLO est demeuré très faible, s’établissant parfois à moins de 1% des personnes concernées[80]. Les critiques ont d’ailleurs dit du GLO anglais qu’il ne minimisait pas, mais au contraire qu’il institutionnalisait, l’incapacité des justiciables à faire valoir leurs réclamations de faible valeur en justice[81].
Cette situation s’apparente à celle observée au Québec lorsqu’une action collective se solde par un processus de réclamations individuelles. Rappelons que le tribunal qui fait droit à une action collective doit ordonner le recouvrement collectif — c’est-à-dire le paiement par les défendeurs d’une somme globale — lorsque le montant total des réclamations est établi de façon suffisamment précise[82]. Cependant, la distribution des sommes aux membres du groupe peut se faire soit à partir d’une somme globale versée par la partie défenderesse, qui est ensuite distribuée automatiquement à ceux-ci, soit par des réclamations individuelles. Or, le taux d’indemnisation est environ deux fois plus faible dans ce dernier cas[83]. Cela s’explique non seulement par la « passivité rationnelle » ou la « mollesse procédurale » de certains réclamants[84], mais aussi par la difficulté de les rejoindre afin de les informer de leurs droits et du processus de réclamation. Bref, l’exigence de déposer une réclamation, quoique beaucoup plus simple qu’une action devant les tribunaux, demeure un obstacle à l’accès à la justice pour de nombreuses personnes.
Ces limites font d’un mécanisme similaire au GLO anglais une option bien peu attrayante pour pallier les conséquences néfastes de l’état actuel du droit sur l’accès à la justice, l’utilisation des ressources judiciaires et la dissuasion des comportements indésirables. La phase du recouvrement par les membres est à bien des égards « la plus fondamentale »[85], et c’est pourtant à cette étape que le GLO semble perdre toute son efficacité. La contribution du GLO à l’accès à la justice demeure ainsi minime, tout comme sa participation à l’économie des ressources judiciaires. Enfin, le faible taux de réclamation qui découle d’un mécanisme de cette nature limite l’effet de dissuasion qui pourrait pousser les défendeurs éventuels à modifier leurs comportements pour se conformer à la loi. L’action collective a elle aussi ses limites, particulièrement lorsque le recouvrement ou la distribution comporte une composante individuelle, mais contrairement au GLO, elle ouvre à tout le moins la porte à un recouvrement collectif assorti du paiement d’une somme globale lorsque les circonstances s’y prêtent. Dans plusieurs situations, l’action collective demeure donc plus attrayante qu’une solution semblable au GLO.
B. Une deuxième solution : redonner compétence à la Cour supérieure du Québec
Une autre solution qui pourrait être envisagée serait de permettre à la Cour supérieure du Québec d’entendre toute action collective relative à un bail de logement, en lui redonnant cette partie de sa compétence générale qui lui a été retirée au profit du Tribunal administratif du logement. Concrètement, une telle solution aurait permis à Mmes Veer et Létourneau de présenter leurs demandes d’autorisation à la Cour supérieure, comme elles souhaitaient d’ailleurs le faire, et ce malgré la compétence exclusive du tribunal.
Cette solution aurait l’avantage de puiser dans l’expertise que la Cour supérieure a développée en matière d’actions collectives au fil du temps, plus spécifiquement quant à la procédure d’autorisation. Grâce aux ajustements organisationnels récents — dont l’équipe restreinte de dix juges mentionnée précédemment[86] —, son expertise est d’autant plus grande, à tout le moins dans les districts faisant partie de la division d’appel de Montréal, là où la plupart des actions collectives sont intentées. Le fait de confier toutes les actions collectives à la Cour supérieure pourrait aussi donner l’impression à certaines parties prenantes que le processus est plus légitime et traité avec davantage de sérieux[87]. Des arguments similaires ont été avancés en lien avec l’action de groupe française, laquelle est « réservée au tribunal de grande instance », ce que certains auteurs qualifient de « net avantage qui garantit le sérieux de traitement et permettra une spécialisation judiciaire »[88]. Enfin, si la Cour supérieure était en charge de l’ensemble des actions collectives, les débats relatifs à la compétence qui, comme dans l’affaire Veer, ne manqueraient pas de survenir, s’en trouveraient simplifiés. Il serait clair que toute action collective, peu importe le domaine et la nature des questions en jeu, devrait procéder devant cette cour.
Cette solution serait en quelque sorte similaire à celle qui prévaut dans d’autres juridictions où les affaires relatives aux baux de logement sont traitées par les tribunaux de droit commun et où, en conséquence, elles peuvent prendre la forme d’actions collectives. En Californie, par exemple, les actions en justice relatives aux baux de logement sont menées devant les cours de l’État, ce qui permet aux demandeurs de se prévaloir de l’article 382 du Code of Civil Procedure qui prévoit la possibilité d’intenter une action collective[89]. Dans certains cas, de telles actions peuvent aussi être menées devant les cours de district fédérales en vertu des Federal Rules of Civil Procedure, notamment lorsque le montant total en cause dépasse cinq millions de dollars, que le groupe comporte plus de cent membres et que l’un d’entre eux est citoyen d’un autre État[90]. Ainsi, par exemple, des demandeurs ont pu intenter une action collective contre un propriétaire au nom de milliers de locataires afin de contester l’imposition de frais de retard exorbitants[91]. À la lumière de cette expérience, il ne serait pas incongru, à première vue, de permettre aux actions collectives en matière de baux de logement de procéder devant la Cour supérieure.
Cette option aurait toutefois ses propres conséquences négatives. Si l’expertise de la Cour supérieure peut être utile au stade de l’autorisation, les parties ne pourraient néanmoins pas bénéficier sur le fond de celle développée par le Tribunal administratif du logement en matière de demandes relatives aux baux de logement. Qui plus est, cette solution pourrait donner lieu à une course aux tribunaux (« forum shopping »). En effet, des parties pourraient tenter de trouver des questions communes afin de transformer leur recours en action collective, pour pouvoir saisir la Cour supérieure du Québec plutôt que le Tribunal administratif du logement[92]. Enfin, quoique cela ne demeure qu’une hypothèse, on peut prévoir que redonner cette compétence à la Cour supérieure mènerait possiblement au dépôt de plusieurs nouvelles actions collectives chaque année, ce qui pourrait engorger une institution qui est déjà aux prises avec des délais importants. Il est à prévoir que de nouveaux juges devraient être ajoutés à l’équipe restreinte en matière d’autorisation des actions collectives et qu’à moins d’un réinvestissement gouvernemental ou d’une réorganisation du travail, ce transfert de ressources risquerait d’avoir un impact négatif sur les autres affaires que la Cour supérieure doit entendre.
C. Une solution à privilégier : élargir la compétence du Tribunal administratif du logement
Enfin, une troisième solution consisterait à donner au Tribunal administratif du logement le pouvoir d’entendre des actions collectives dans les matières relevant de sa compétence exclusive. De cette façon, Mmes Veer et Létourneau auraient pu mener une action collective comme elles le souhaitaient, mais devant ce tribunal plutôt que devant la Cour supérieure.
Cette solution pourrait surprendre les observateurs québécois, habitués à ce que toutes les actions collectives soient entendues par la Cour supérieure. Pourtant, l’idée de permettre aux tribunaux administratifs d’entendre des recours collectifs a été envisagée dès la préparation du projet de loi 39 en 1978, lequel a introduit cette voie procédurale dans la province. Le ministre responsable s’exprimait alors de façon si limpide qu’il vaut la peine de citer ses propos au long :
Pourquoi, par le projet de loi 39, n’ouvrez-vous pas tout de suite le recours collectif devant tous et chacun des tribunaux administratifs du Québec comme, par exemple, la Commission des affaires sociales, la Régie des loyers, le Tribunal d’expropriation et le reste? J’ai expliqué en commission parlementaire, que cela avait été dans un premier temps notre intention. Après en avoir longuement discuté avec les présidents des principaux tribunaux administratifs du Québec, nous avions convenu avec eux d’y aller par morceaux, au fur et à mesure que l’ensemble de la procédure aurait pu être rodé. Compte tenu des ajustements qui sont par ailleurs nécessités dans le fonctionnement de certains de ces tribunaux administratifs par d’autres mesures et d’autres lois qui ont été adoptées par cette Assemblée – c’est le cas notamment de la Commission des accidents du travail – nous avons convenu avec eux, dès que ce sera possible, d’ouvrir par étapes et d’introduire le recours collectif devant chacun des tribunaux administratifs. Ce que nous ne faisons pas par le projet de loi 39 qui ne contient pas, en d’autres termes, une espèce d’article universel qui ouvrirait l’ensemble des tribunaux administratifs au recours collectif [nos italiques][93].
En ce qui concerne plus spécifiquement les litiges opposant locateurs et locataires, comme ceux en cause dans l’affaire Veer, le ministre affirmait, de façon similaire :
Je voudrais par ailleurs, sur cette question très précise, rappeler que mon collègue, le ministre des Affaires municipales, a déjà déposé un livre blanc concernant les relations entre locataires et propriétaires dans lequel on a clairement indiqué, comme gouvernement, notre volonté en insérant, lorsque le moment viendra, dans un projet de loi qui, celui-là, nous l’espérons tous, deviendra une loi permanente des relations entre locataires et propriétaires, comme première étape d’ouverture sur un des tribunaux administratifs, le recours colle[c]tif [nos italiques][94].
Il faut comprendre qu’en 1978, plusieurs des principaux tribunaux administratifs du Québec venaient tout juste d’être créés ou de se faire attribuer de vastes compétences dans le cadre des multiples programmes sociaux instaurés dans le sillage de la Révolution tranquille[95]. Il est donc tout à fait logique que le gouvernement ait voulu procéder par étapes, en consolidant dans un premier temps la procédure individuelle devant ces tribunaux pour ensuite y permettre l’exercice d’actions collectives, qui s’avèrent souvent plus complexes. Malheureusement, il semble toutefois que les ambitions initiales du gouvernement se soient évaporées avec le temps et que cette seconde étape ait tout simplement été oubliée, puisqu’elle n’a pas été remise de l’avant ni même discutée sérieusement au cours des dernières décennies. Plus de quarante ans plus tard, ce qui devait arriver « dès que […] possible »[96] demeure toujours un mirage.
L’octroi au Tribunal administratif du logement du pouvoir d’entendre des actions collectives qui relèvent de sa compétence reconnaîtrait le fait que, loin de constituer un moyen d’exception[97] qui doit être limité à des secteurs précis du droit et à des institutions spécifiques, l’action collective est aujourd’hui « un remède ordinaire »[98] d’application générale. D’ailleurs, divers observateurs affirment déjà que l’action collective québécoise est offerte « en toutes matières »[99], et qu’il s’agit d’« un véhicule universel ouvert à tous les secteurs d’activités »[100]. Bien que ces affirmations soient inexactes, au regard notamment du cadre consacré dans l’arrêt Veer, elles révèlent tout de même qu’il ne serait pas illogique d’étendre cette voie procédurale à d’autres domaines du droit civil, comme les baux de logement.
Donner cette compétence au Tribunal administratif du logement plutôt qu’à la Cour supérieure aurait ses avantages et ses inconvénients, tel que le suggère la section précédente. Au chapitre des avantages, cette solution permettrait aux parties de bénéficier de l’expertise de ce tribunal sur le fond et les empêcherait de s’adonner à une course aux tribunaux. Elle serait aussi potentiellement plus efficace sur le plan des ressources judiciaires. Il est à prévoir que des ressources additionnelles devraient être consenties au Tribunal administratif du logement afin de traiter ces nouvelles actions. Toutefois, ces ressources seraient fort probablement moins coûteuses que celles de la Cour supérieure, ne serait-ce que sur le plan des salaires des juges ainsi mobilisés[101].
De l’autre côté, il serait initialement hasardeux de demander à des juges administratifs n’ayant jamais appliqué les critères d’autorisation des actions collectives de se charger de cette étape fondamentale de façon aussi efficace que la Cour supérieure. Néanmoins, certains ajustements pourraient être envisagés afin de développer une expertise en ce sens. Par exemple, il serait possible de former une équipe restreinte de juges administratifs chargés de l’autorisation des actions collectives — à l’instar de l’équipe similaire créée par la Cour supérieure[102] — et de développer des programmes de formation continue afin de les épauler dans leur travail.
Permettre au Tribunal administratif du logement d’entendre des actions collectives pourrait aussi s’avérer contre-productif si les règles de procédure ne sont pas adaptées en conséquence. Certains auteurs relèvent que la procédure devant ce tribunal, loin d’assurer l’accès à la justice pour tous, tend plutôt à perpétuer les inégalités sociales entre locataires et propriétaires. Outre les délais qui placent souvent les parties les plus précaires dans des situations délicates[103], des aspects administratifs, comme l’ordre de priorité dans la mise au rôle des dossiers, peuvent aussi avoir pour effet de favoriser les classes sociales plus privilégiées au détriment des plus vulnérables[104]. Ces quelques constats mettent en relief le fait qu’une réforme qui permettrait au Tribunal administratif du logement de se saisir d’actions collectives devrait du même souffle se pencher sérieusement sur la procédure qui y est appliquée. Effectivement, il ne faudrait pas exacerber les problèmes à l’encontre desquels des critiques légitimes ont déjà été formulées. Par exemple, il serait opportun de reconsidérer le processus de mise au rôle, non seulement pour y intégrer les actions collectives, mais aussi afin de le repenser de façon plus fondamentale.
Malgré ces quelques nuances, l’exemple de certaines juridictions étrangères suggère qu’il est tout à fait possible, voire souhaitable, de permettre aux tribunaux administratifs comme le Tribunal administratif du logement d’entendre des actions collectives, dans la mesure où les règles de procédure applicables sont adaptées en conséquence. En Angleterre, par exemple, le Civil Justice Council a formellement recommandé au Lord Chancellor en 2008 de créer une nouvelle procédure de recours collectifs[105]. Sa première recommandation était d’introduire une action collective générique similaire à celle que nous connaissons au Québec, en plus de considérer le développement « [d’]actions collectives individuelles et distinctes […] dans le contexte civil plus large, c.-à-d. devant le CAT [Competition Appeal Tribunal] ou le Employment Tribunal, en tant que complément à l’action collective générique » [notre traduction][106].
Cette recommandation était justifiée par le souhait que les actions relevant de la compétence exclusive de ces organismes continuent d’être entendues par ceux-ci vu leur expertise particulière, mais aussi par des considérations relatives aux ressources judiciaires. En effet, comme le notait le Civil Justice Council, permettre aux organismes juridictionnels d’entendre des actions collectives « faciliterait l’administration adéquate et efficace de la justice dans les cours civiles, compte tenu que des réclamations n’auraient pas à être portées devant ces cours, générant ainsi des économies de ressources tout en permettant à ces réclamations d’être conduites de façon efficace devant le tribunal spécialisé approprié » [notre traduction][107].
Cette recommandation a mené, en 2015, à l’adoption du Consumer Rights Act et de règles de procédure correspondantes, lesquels ont permis au CAT d’entendre des actions collectives[108]. Depuis lors, des justiciables peuvent se porter représentants d’un groupe et demander l’autorisation d’intenter une action collective en matière de droit de la compétition, laquelle est autorisée suivant des critères généralement similaires à ceux qui s’appliquent au Québec, quoique plus restrictifs à certains égards[109]. Le tribunal peut toutefois décider si l’action doit procéder par inclusion (« opt-in ») ou par exclusion (« opt-out ») des membres[110], alors que l’action collective québécoise suit exclusivement le second modèle[111]. Comme ce pourrait être éventuellement le cas devant le Tribunal administratif du logement, les actions collectives menées devant le CAT doivent nécessairement relever de sa compétence matérielle, laquelle se limite aux comportements anti-compétitifs interdits par le Competition Act 1998[112]. Par ailleurs, si ce nouveau mécanisme a connu un départ incertain vu l’approche restrictive du CAT à l’étape de l’autorisation[113], un récent arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni entérine au contraire une approche souple qui laisse présager un futur plus prometteur pour ce véhicule procédural[114].
Aux États-Unis, quoique la tendance initiale des agences et tribunaux administratifs fédéraux ait été de se limiter à la résolution individuelle de chaque dossier, certains d’entre eux ont récemment développé des outils de gestion collective des litiges[115]. Il semble même que les Bankruptcy Courts, la Court of Federal Claims et la Equal Employment Opportunity Commission (ci-après EEOC) entendent fréquemment des actions collectives relevant de leur propre champ de compétence[116]. Pour ne prendre que ce dernier exemple, l’EEOC a adopté des règles lui permettant d’entendre des « class complaints » dans le cadre de litiges relatifs à l’équité en emploi dans la fonction publique fédérale[117]. L’EEOC entend plusieurs dizaines d’actions collectives de cette nature chaque année[118]. Les critères d’autorisation utilisés par cette commission sont généralement similaires à ceux employés par les cours fédérales en vertu des Federal Rules of Civil Procedure[119].
Il est intéressant de noter que l’EEOC, tout comme les autres agences américaines mentionnées, a elle-même mis sur pied le mécanisme des actions collectives en utilisant son pouvoir de gérer sa propre procédure, sans avoir recours à des modifications législatives[120]. Une telle voie, plus simple que l’adoption d’un projet de loi, pourrait éventuellement être suivie par les tribunaux administratifs québécois, comme le Tribunal administratif du logement, qui ont eux aussi le pouvoir de régir leur procédure[121]. Cela est d’autant plus vrai que l’action collective, considérée comme un simple moyen procédural, s’inscrirait logiquement dans les règles existantes. Il faudrait toutefois que l’article 33 C.p.c. soit préalablement modifié pour retirer à la Cour supérieure sa compétence exclusive sur les actions collectives. Autrement, cette disposition risquerait de faire échec aux règles de procédure ainsi adoptées[122].
Par ailleurs, les exemples internationaux précités mettent en relief quelques ajustements aux règles de procédure qui sont de mise afin que les actions collectives menées devant des tribunaux administratifs demeurent efficaces. Dans le cas du CAT, les règles de procédure du tribunal ont été complètement actualisées de façon concomitante avec l’adoption du nouveau régime de « collective proceedings »[123]. Une section entière spécifiquement dédiée à ces nouvelles actions est apparue, afin de prévoir des règles particulières régissant leur déroulement, de la demande jusqu’au jugement, en passant par la réponse du défendeur, la procédure d’autorisation (« certification »), les avis aux membres, la procédure de recouvrement et les éventuelles transactions[124]. Cette façon de régir les actions collectives s’apparente à celle adoptée dans notre propre C.p.c., qui contient lui aussi une section dédiée à ces actions[125].
De façon fort similaire, l’EEOC a édicté des règles de procédure distinctes — quoique moins détaillées que celles du CAT — afin de régir les « class complaints ». Comme c’est le cas au Royaume-Uni et au Québec, ces règles déterminent notamment le contenu de la demande d’autorisation, la procédure à suivre pour déposer une telle demande — qui inclut, fait intéressant, une obligation de rencontrer au préalable un conseiller de la commission pour discuter du recours[126] — ainsi que les exigences relatives au processus d’autorisation, aux avis aux membres, au processus de recouvrement individuel, et aux éventuelles transactions entre les parties[127]. Un objectif transversal qui ressort de toutes ces règles de procédure est la protection des intérêts des membres du groupe, lesquels ne sont évidemment pas considérés dans les règles propres aux actions individuelles.
Si le Tribunal administratif du logement était habilité à se saisir d’actions collectives, ses règles de procédure devraient être ajustées d’une manière similaire à celles du CAT et de l’EEOC. À charge de redite, la gestion de ces actions se distingue à bien des égards de celle des actions individuelles auxquelles les juges administratifs du Québec sont habitués. Ainsi, l’introduction de telles actions transformerait leur rôle, ce qui demanderait certainement une formation additionnelle. Le présent article n’a pas pour but de dresser une liste exhaustive des changements procéduraux qui seraient nécessaires, mais il est utile d’en identifier quelques-uns.
Au premier chef, il faudrait évidemment que soient prévues l’étape de l’autorisation, laquelle demeure essentielle à la gestion des actions collectives[128], ainsi que l’étape connexe de l’avis aux membres et la possibilité pour ces derniers de s’exclure du groupe[129]. Par ailleurs, le contenu de la demande devrait aussi être adapté : si les demandes individuelles déposées au Tribunal administratif du logement ne doivent actuellement contenir qu’« un exposé sommaire des motifs à [leur] appui »[130], les demandes d’autorisation d’actions collectives devront être plus étoffées vu leur complexité et leurs conséquences plus importantes.
Pour ces mêmes motifs, il serait sage d’envisager de placer chaque action collective proposée sous la gestion particulière d’un juge administratif désigné, comme c’est le cas en Cour supérieure[131]. Vu la portée géographique potentiellement plus large des actions collectives — par exemple si une action met en cause des logements situés aux quatre coins du Québec — il faudrait également donner compétence à tout bureau du Tribunal administratif du logement d’entendre une demande mettant en cause un ou des logements situés hors du territoire qu’il dessert, ce qui n’est pas le cas actuellement[132].
Enfin, certains ajustements devraient porter sur l’issue des actions collectives menées devant le Tribunal administratif du logement. D’une part, il faudrait prévoir les modalités de recouvrement et de liquidation, en se fondant possiblement sur les dispositions idoines du C.p.c.[133] D’autre part, alors que le législateur a limité les possibilités d’appel d’une décision de ce tribunal[134], il pourrait vouloir reconsidérer ce choix en matière d’actions collectives. En effet, il souhaiterait peut-être permettre aux justiciables de porter ces décisions plus facilement en appel, dans le but de préserver les droits des membres du groupe[135]. Il pourrait aussi décider, vu l’importance des actions collectives, de réserver à la Cour d’appel le pouvoir d’entendre de tels appels, au lieu de la Cour du Québec, qui est normalement celle qui entend les appels des décisions du Tribunal administratif du logement en premier lieu[136].
IV. Actions collectives devant le Tribunal administratif du logement : une solution constitutionnelle?
Une question demeure : serait-il constitutionnel de permettre au Tribunal administratif du logement de se saisir d’actions collectives relatives aux baux de logement? Aux termes de l’article 96 de la LC 1867[137], les provinces sont limitées dans leur pouvoir d’attribuer une compétence à une cour inférieure ou à un tribunal administratif. Il n’est pas évident à première vue que la compétence élargie du tribunal proposée ci-avant respecterait ces limites. Cette question mérite ainsi une étude plus approfondie.
Le test applicable en la matière est bien établi et se décline en deux temps. D’une part, selon le « test historique », les provinces ne peuvent octroyer à un tribunal inférieur des pouvoirs de nature judiciaire, qui correspondent généralement à ceux exercés exclusivement par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération, qu’ils soient exclusifs ou concurrents. Ce type de pouvoir peut cependant être attribué à un tribunal inférieur s’il n’est que complémentaire ou accessoire à une fonction principalement administrative[138]. D’autre part, d’après le « test de la compétence fondamentale », une compétence attribuée à un tribunal inférieur est invalide si elle « a pour effet de retirer aux cours supérieures l’un des attributs de leur compétence fondamentale »[139]. Il convient d’aborder ces deux aspects tour à tour.
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que le pouvoir de connaître des actions collectives en matière de baux de logement est de nature judiciaire. Cependant, il n’est pas certain qu’il corresponde généralement aux pouvoirs exercés par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Le véhicule procédural de l’action collective n’existait évidemment pas à l’époque[140], mais de toute façon, la Cour suprême du Canada nous enseigne que l’analyse doit s’attarder au « type de différend concerné » et non à d’autres aspects accessoires comme le « type de réparations demandées »[141] ou le « mécanisme décisionnel » utilisé[142]. Ainsi, il faut essentiellement se demander si la résolution des différends en matière de baux de logement incombait à l’époque aux cours supérieures, de district ou de comté.
Cette question a déjà été résolue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Grondin[143], qui mettait précisément en cause la compétence de la Régie du logement sur diverses questions reliées aux baux de logement. Dans cette affaire, la cour a établi que certaines cours inférieures, dont les cours de commissaires et la Cour du recorder de Montréal, avaient compétence sur ces matières à l’époque de la Confédération et, en conséquence, qu’elles pouvaient tout à fait être entendues par un tribunal administratif provincial[144]. La même conclusion s’applique aux pouvoirs du Tribunal administratif du logement, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’actions individuelles ou collectives. Bref, il est fort probable que le test historique établi en vertu de l’article 96 de la LC 1867 n’empêcherait pas une réforme qui permettrait au Tribunal administratif du logement d’entendre des actions collectives relevant autrement de sa compétence matérielle.
Il reste à appliquer le test de la compétence fondamentale. Celui-ci, détaillé dans l’arrêt MacMillan Bloedel, prévoit que la province ne peut retirer aux cours supérieures leur compétence « fondamentale » ou « inhérente »[145]. Ce concept est difficile à définir avec précision, mais la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il inclut « les pouvoirs qui ont une importance cruciale et qui sont essentiels à l’existence d’une cour supérieure dotée de pouvoirs inhérents et au maintien de son rôle vital au sein de notre système juridique »[146]. Par exemple, « le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des lois, la mise à exécution de [ses] ordonnances, le contrôle de [sa] propre procédure et la compétence résiduelle à titre de tribunal de droit commun » entrent dans cette catégorie[147]. La compétence fondamentale des cours supérieures comprend aussi leur capacité « d’exercer des fonctions judiciaires et de dire le droit dans des litiges privés »[148], ce qui empêche les provinces de réserver aux tribunaux provinciaux un nombre trop important de dossiers de droit privé.
Les actions collectives, en raison de leur ampleur, permettent souvent d’aborder des questions de droit privé complexes. Permettre à un tribunal administratif d’entendre de telles actions limiterait donc, dans une certaine mesure, la possibilité pour la Cour supérieure du Québec de se pencher sur ces questions. En ce sens, il n’est pas impossible qu’une contestation constitutionnelle soit intentée. Il faut toutefois noter que les litiges relatifs aux baux de logement ne dépassant pas la compétence pécuniaire de la Cour du Québec sont déjà réservés exclusivement au Tribunal administratif du logement et que la constitutionnalité de cet octroi de compétence a été confirmée dans l’arrêt Grondin[149]. Ainsi, le regroupement de ces dossiers par voie d’action collective ne porterait pas davantage atteinte à la compétence fondamentale de la Cour supérieure que la situation actuelle. La réforme proposée serait donc peu susceptible d’être jugée inconstitutionnelle sur ce fondement.
Une dernière question se pose toutefois quant à la compétence pécuniaire du Tribunal administratif du logement. La Cour suprême du Canada a récemment conclu que de façon générale, les litiges civils excédant environ 66 000$ doivent être entendus en Cour supérieure pour ne pas empiéter trop sévèrement sur la compétence fondamentale de cette cour[150]. Or, on peut aisément supposer que plusieurs actions collectives qui seraient menées devant le Tribunal administratif du logement dépasseraient ce seuil. Il faut toutefois se rappeler, comme la Cour d’appel l’a confirmé à bon droit dans Veer, que cette limite monétaire doit s’apprécier au regard de la valeur de chaque action individuelle et non de celle de l’ensemble de l’action collective proposée[151]. Cette conclusion a aussi été confirmée en ce qui concerne la compétence de la Cour du Québec, qui peut tout à fait joindre et entendre ensemble plusieurs litiges dont la valeur collective dépasse son seuil pécuniaire, tant que chacun d’entre eux ne dépasse pas cette limite[152]. Bref, rien ne porte à croire qu’il serait inconstitutionnel de permettre au Tribunal administratif du logement d’entendre des actions collectives, tant et aussi longtemps que le recours individuel de chaque membre n’excède pas sa compétence, que ce soit en raison de sa nature ou de sa valeur monétaire.
Conclusion
À bien des égards, le Québec a été un précurseur dans le développement des actions collectives au Canada. Il y a plusieurs décennies déjà, il reconnaissait que ce véhicule procédural est nécessaire afin de permettre aux justiciables d’avoir accès à la justice, de gérer de façon efficace une multitude de recours similaires ou identiques et de convaincre les défendeurs de se conformer aux dispositions impératives de la loi, lesquelles visent la plupart du temps à protéger les justiciables les plus vulnérables. Ces mêmes enjeux se présentent aussi dans divers domaines de droit qui sont pourtant réservés exclusivement aux tribunaux administratifs, devant lesquels aucune action collective ne peut actuellement être intentée. C’est notamment le cas en matière de baux de logement.
Cette situation mérite d’être réévaluée au bénéfice des justiciables, du système de justice, mais aussi du public dans son ensemble. Une telle proposition est loin d’être radicale étant donné que le législateur considérait lui-même permettre, dès 1978, l’utilisation du mécanisme des actions collectives en toutes matières civiles, incluant celles traitées par des tribunaux administratifs. Bien qu’il ait finalement décidé d’en limiter la portée aux seules affaires civiles normalement entendues par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, cette décision pragmatique s’accompagnait d’une volonté d’étendre l’action collective à tous les tribunaux, « dès que […] possible »[153]. Quarante ans plus tard, la complexification de notre société et la concentration du pouvoir économique entre les mains d’un petit nombre — comme les propriétaires de Mmes Veer et Létourneau — rendent cette étape d’autant plus nécessaire.
Cet article a examiné trois solutions possibles pour remédier aux problèmes qui découlent de l’état actuel du droit. Il conclut que la plus prometteuse consisterait à élargir la compétence du Tribunal administratif du logement afin de lui permettre d’entendre des actions collectives dans les matières qui relèvent de sa compétence exclusive. Cette solution paraît être celle qui favorise le plus l’accès à la justice, en minimisant les efforts requis pour que les justiciables puissent profiter du recours intenté par une personne placée dans la même situation qu’eux. Par ailleurs, dans l’objectif d’économiser les ressources judiciaires, il apparaît plus efficace de donner à ce tribunal la responsabilité d’entendre de telles actions, plutôt que d’engorger encore davantage la Cour supérieure du Québec et d’utiliser ses mécanismes qui, à certains égards, sont plus coûteux. Enfin, l’action collective semble être un moyen efficace pour dissuader les quelques propriétaires qui pourraient autrement être tentés de faire fi des dispositions impératives de la loi.
Le présent article a mis l’accent sur le droit du logement, mais la même solution pourrait éventuellement être étendue à des matières qui sont exclusivement réservées à d’autres tribunaux administratifs ou spécialisés. Les conclusions de l’arrêt Veer s’appliquent dans des domaines aussi variés que les régimes de retraite[154], les impôts[155], le recouvrement de taxes[156] et les demandes relatives aux programmes sociaux[157]. Elles s’appliquent aussi dans d’autres provinces dont le cadre législatif est similaire[158]. Dans ce vaste éventail de circonstances, les mêmes enjeux d’accès à la justice, d’économie des ressources judiciaires et de dissuasion se posent avec autant d’acuité et les mêmes solutions pourraient être explorées, quoiqu’il faille évidemment tenir compte des aspects particuliers de chaque domaine de droit et de chaque province.
Il faut toutefois réitérer une dernière fois que malgré ses avantages potentiels, l’action collective n’est pas une panacée et comporte son lot d’inconvénients. Au premier chef, il s’agit d’une voie procédurale qui mobilise une quantité considérable de ressources et dont les délais peuvent facilement dépasser ceux d’une action individuelle correspondante. Cette lourdeur procédurale a pour effet qu’il est impensable d’intenter une action collective sans l’aide d’avocats chevronnés, alors qu’il est relativement plus facile et fréquent d’entreprendre une action individuelle devant un tribunal administratif sans être représenté par avocat[159]. En conséquence, des investissements significatifs sont requis pour mener à bien une action collective, ce qui peut avoir un effet disproportionné sur les groupes les plus marginalisés lorsque les avocats ne décident pas eux-mêmes de financer les recours qu’ils chapeautent[160]. Il faut garder ces écueils à l’esprit pour éviter qu’une réforme éventuelle ne soit, en définitive, qu’un coup d’épée dans l’eau. De même, il faut s’assurer que toute réforme soit assortie d’ajustements aux règles de procédure du Tribunal administratif du logement afin, notamment, d’éviter de perpétuer les inégalités sociales entre locataires et propriétaires.
En terminant, si le présent article a mis l’accent sur la voie juridique, celle-ci n’est pas la seule à permettre aux locataires de faire collectivement valoir leurs droits. Historiquement, d’autres moyens politiques et économiques, comme les grèves des loyers, les négociations collectives et la création d’associations de défense des droits des locataires, ont permis de protéger les intérêts de ces derniers, parfois même de façon plus efficace que les recours judiciaires[161]. De cette perspective plus large, l’action collective ne représente qu’une corde de plus à l’arc des locataires. En outre, même sur le plan juridique, l’action collective n’est pas l’unique solution permettant de renforcer la défense des droits des locataires. D’autres approches pourraient aussi être considérées en parallèle, comme l’institution d’actions pénales permettant de sanctionner les contraventions aux règles impératives. C’est déjà le cas en matière de droit de la consommation[162] et la Cour suprême du Canada a expressément reconnu, en matière de valeurs mobilières et de litiges environnementaux, que de tels recours peuvent « atteindre l’objectif de modification des comportements »[163]. Dans le même ordre d’idées, le législateur pourrait envisager de mettre en oeuvre une action pénale qui renforcerait les dispositions qui protègent les locataires, quoique les tenants et aboutissants de cette solution éventuelle devraient être soigneusement étudiés. Cette solution, comme la mise sur pied d’actions collectives devant les tribunaux administratifs, demanderait donc des études plus approfondies. Elle mériterait toutefois que le législateur québécois se mette à y réfléchir plus sérieusement.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir Catherine Piché, L’action collective : ses succès et ses défis, Montréal, Thémis, 2019 aux pp 32, 36–39 [Piché, L’action collective]. Quatre-vingt-dix-neuf actions collectives ont été intentées en 2020 (voir « Registre des actions collectives », en ligne : Cour supérieure du Québec <registredesactionscollectives.quebec> [perma.cc/RL3J-NRNH]).
-
[2]
Voir Banque de Montréal c Marcotte, 2014 CSC 55. L’un des demandeurs avait payé des frais illégaux totalisant un maigre montant de 4,06$, pour lequel il n’aurait certainement pas valu la peine d’intenter une action individuelle (voir Marcotte c Banque de Montréal (20 juin 2003), Montréal, CS QC 500-06-000197-034 (requête ré-amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant) aux para 2.7A, 2.7E, en ligne (pdf) : Trudel Johnston & Lespérance <tjl.quebec> [perma.cc/4LMS-C4LB]).
-
[3]
Voir Veer c Boardwalk Real Estate Investment Trust, 2019 QCCA 740 [Veer CA].
-
[4]
(R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 96, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5 [LC 1867].
-
[5]
Voir Létourneau c Boardwalk Real Estate Investment Trust, 2018 QCCS 206 aux para 2–3 [Veer CS] (dans deux des trois recours, certains dirigeants des sociétés de gestion sont aussi nommés comme codéfendeurs).
-
[6]
Voir art 1872 CcQ; Veer c Boardwalk Real Estate Investment Trust (21 juin 2017), Montréal, CS QC 500-06-000850-178 (demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante modifiée) aux para 34, 47 [Veer demande d’autorisation], en ligne (pdf) : Registre des actions collectives <registredesactionscollectives.quebec> [perma.cc/2JEB-8RGG]; Veer CS, supra note 5 au para 5; Veer CA, supra note 3 au para 46.
-
[7]
Art 1896 CcQ. Voir aussi Veer CS, supra note 5 au para 9; Veer CA, supra note 3 au para 3.
-
[8]
Voir Veer CS, supra note 5 au para 13; Veer CA, supra note 3 au para 4.
-
[9]
Le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur du C.p.c., le terme « recours collectif » a été remplacé au Québec par l’expression « action collective ». Pour refléter fidèlement le fait que les recours entamés avant cette date utilisaient les termes de l’ancien C.p.c. (1965), la notion de « recours collectif » sera utilisée en lien avec ces dossiers, alors que celle d’« action collective » sera utilisée en toutes autres circonstances.
-
[10]
Voir Veer demande d’autorisation, supra note 6 aux para 9, 16.
-
[11]
Voir art 59, al 2 Cpc (1965), désormais remplacé par art 91 Cpc.
-
[12]
Loi sur la Régie du logement, RLRQ c R-8.1, art 28(1) [LRl]. En date du 31 août 2020, la LRl a été remplacée par la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ c T-15.01 [LTal]), qui contient la même disposition à l’article 28(1). Voir aussi Veer CS, supra note 5 aux para 17–18.
-
[13]
LRl, supra note 12, art 28(1).
-
[14]
Voir Veer CS, supra note 5 au para 19; Veer CA, supra note 3 au para 6.
-
[15]
Voir Veer CS, supra note 5 au para 26; Veer CA, supra note 3 aux para 24–25.
-
[16]
Voir Bisaillon c Université Concordia, 2006 CSC 19 [Bisaillon].
-
[17]
Ibid au para 17. La Cour est unanime sur ce point, les juges dissidents notant que la voie du recours collectif « ne saurait avoir d’incidence sur les droits substantiels des intéressés » (ibid au para 66), mais concluant que le litige en cause n’a pas son origine dans la convention collective et ne relève donc pas de la compétence de l’arbitre de griefs (voir ibid aux para 67−68).
-
[18]
Voir Carrier c Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2000 CanLII 10636, EYB 2000-20114 (Référence) (CA Qc) (la contestation d’une entente entre le ministre de la Santé et la Fédération des médecins spécialistes du Québec devait être entendue par un conseil d’arbitrage); Hamer c R, 1998 CanLII 12752, EYB 1998-06130 (Référence) (CA Qc) (la contestation d’avis de cotisation transmis par les autorités fiscales devait se faire devant la Cour du Québec ou la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas).
-
[19]
Bisaillon, supra note 16 au para 22.
-
[20]
Voir Veer CS, supra note 5 aux para 23−27; Veer CA, supra note 3 aux para 25–36.
-
[21]
Il faut toutefois noter que la Cour d’appel refuse de se prononcer formellement sur cette question dans le cadre du recours de Mme Veer, puisque cette dernière s’est désistée avant l’audition de son pourvoi (voir Veer CA, supra note 3 aux para 47, 63–64).
-
[22]
Veer CS, supra note 5 aux para 38, 45−46, 50−53, 56. Voir aussi Veer CA, supra note 3 aux para 40–44.
-
[23]
Voir Veer CS, supra note 5 (concluant, en référant à l’article 35(3) C.p.c., que « ce n’est pas le montant total des réclamations envisagées qui est pertinent, mais bien la réclamation de chacun des membres, considérée individuellement » au para 41). Notons au passage que la Cour suprême du Canada s’est récemment dite d’avis que la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec, actuellement fixée à 85 000$, est trop élevée pour satisfaire aux conditions de la LC 1867 (supra note 4, art 96) (voir Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art 35, 2021 CSC 27 au para 160 [Renvoi sur la Cour du Québec]). Nous y reviendrons.
-
[24]
Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 31-3, vol 20, no 34 (16 mai 1978) à la p 1475 (Pierre Marois) [Débats 1978].
-
[25]
Ibid.
-
[26]
Voir Québec, Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile – Chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ et Wilson & Lafleur, 2015 aux pp 51, 416 (au sujet des articles 35 et 571 C.p.c.).
-
[27]
Voir LRl, supra note 12, art 57; Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ c R-8.1, r 5, art 10 (remplacé le 31 août 2020 par le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, r 5). Comparer arts 91, 210 Cpc.
-
[28]
Le mécanisme de la réunion d’instances devant le Tribunal administratif du logement n’est d’ailleurs pas automatique. La jurisprudence révèle notamment que ce tribunal a refusé de réunir, d’une part, des demandes impliquant un locataire qui a cessé de payer son loyer en raison d’un prétendu défaut d’exécution de son locateur et, d’autre part, des demandes impliquant le même locateur qui réclame le loyer impayé au locataire (voir par ex Placements Sergakis inc c Derochie, 2021 QCTAL 2804 aux para 11–13).
-
[29]
Une recherche avec les adresses respectives des demanderesses ne retourne aucun dossier les impliquant, bien que plusieurs autres recours impliquant les mêmes adresses aient été intentés par les propriétaires contre d’autres locataires.
-
[30]
Voir généralement L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c JJ, 2019 CSC 35 au para 6 [Oratoire]; Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 au para 15 [Hollick]; Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 aux para 27–29 [Dutton]; Vivendi Canada Inc c Dell’Aniello, 2014 CSC 1 au para 1; Nicole L’Heureux, « Effective Consumer Access to Justice: Class Actions » (1992) 15:4 J Consumer Policy 445 à la p 447; Mathew Good, « Access to Justice, Judicial Economy, and Behaviour Modification: Exploring the Goals of Canadian Class Actions » (2009) 47:1 Alta L Rev 185. En Angleterre, voir R-U, Civil Justice Council, “Improving Access to Justice through Collective Actions”: Developing a More Efficient and Effective Procedure for Collective Actions (Final Report), par John Sorabji et al, 2008 à la p 51, en ligne (pdf) : Courts and Tribunals Judiciary <www.judiciary.uk> [perma.cc/PER5-GPDC] [Civil Justice Council]. La professeure Piché note d’ailleurs que ces mêmes objectifs sont ceux poursuivis par la plupart des régimes de redressement collectif à travers le monde (voir Catherine Piché, « L’emprise des cinq doigts de Frankenstein : réflexion en cinq temps sur l’action collective » (2016) 68:2 RIDC 291 à la p 314 [Piché, « Frankenstein »]).
-
[31]
Bisaillon, supra note 16 au para 16.
-
[32]
Ibid. Voir aussi Desjardins Cabinet de services financiers inc c Asselin, 2020 CSC 30 [Asselin] (décrivant le recours collectif comme un « mécanisme procédural de justice sociale » au para 127).
-
[33]
AIC Limitée c Fischer, 2013 CSC 69 au para 27 [Fischer].
-
[34]
Voir Asselin, supra note 32 au para 116; Fischer, supra note 33 (« [l]’obstacle le plus fréquent est d’ordre financier. Il surgit lorsque les frais élevés d’une action en justice et les sommes modestes en jeu empêchent de s’adresser aux tribunaux » au para 27). Sur le temps et les coûts, voir Stefan Wrbka, Steven Van Uytsel et Mathias M Siems, « Access to justice and collective actions: ‘Florence’ and beyond » dans Stefan Wrbka, Steven Van Uytsel et Mathias Siems, dir, Collective Actions: Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interests?, Cambridge (R-U), Cambridge University Press, 2012, 1 à la p 6.
-
[35]
Voir Mauro Cappelletti et Bryant Garth, « Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective – A General Report » dans Mauro Cappelletti et Bryant Garth, dir, Access to Justice, vol 1 : A World Survey, Alphenaandenrijn et Milan : Sijthoff and Noordhoff et Dott A Giuffrè Editore, 1978, 3 à la p 18.
-
[36]
Hollick, supra note 30 au para 15.
-
[37]
Selon la professeure Piché, plus de 20% des actions collectives intentées au Québec ces dernières années seraient dans ce domaine (voir Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 41).
-
[38]
Voir Asselin, supra note 32 au para 116.
-
[39]
Voir notamment Stéphane Bernatchez et al, « La justice de proximité : des transformations en matière d’accès à la justice vues sous l’angle de la gouvernance » (2021) 62:2 C de D 339 à la p 377, n 184.
-
[40]
Voir Marc Galanter, « Why the “Haves” Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change » (1974) 9:1 Law & Soc’y Rev 95 aux pp 97–103.
-
[41]
Voir Francine Dansereau et Marc Choko avec la collaboration de Gérard Divay, Les logements privés au Québec : la composition du parc de logements, les propriétaires bailleurs et les résidants, Société d’habitation du Québec, 2002 à la p 10 (à partir des informations du tableau « Dénombrement des propriétaires bailleurs et répartition du parc possédé selon le nombre de logements possédés », nous avons pu additionner le nombre de propriétaires pour les catégories de propriétaires possédant six à 200 logements et plus, obtenant ainsi 34 100 propriétaires, ce qui représente 12,31% du nombre total de 277 100 propriétaires. L’addition des proportions du parc possédé pour les mêmes catégories de propriétaires permet de conclure que ce 12,31% des propriétaires possède 57,1% du parc locatif au Québec).
-
[42]
Voir ibid.
-
[43]
Voir G Richard Brown, « Tenants in Court: The Class Action » (1971) 3 UC Davis L Rev 101 à la p 102. Notons aussi qu’aux États-Unis, un groupe composé d’au minimum 40 demandeurs est présumé suffisamment large pour justifier une action collective (voir Consolidated Rail Corp v Town of Hyde Park, 47 F (3d) 473 (2e Cir 1995) (« numerosity is presumed at a level of 40 members » à la p 483)).
-
[44]
Voir Brown, supra note 43 à la p 101.
-
[45]
Le taux d’inoccupation global s’établissait à 2,4% pour les centres urbains du Québec en 2020 (voir « Enquête sur les logements locatifs, centres urbains : taux d’inoccupation » (29 septembre 2021), en ligne : Société canadienne d’habitation et de logement <cmhc-schl.gc.ca> [perma.cc/M48T-D343]).
-
[46]
Pharmascience inc c Option Consommateurs, 2005 QCCA 437 au para 20 [Pharmascience]. Voir aussi Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2012 à la p 144 [Lafond, L’accès à la justice].
-
[47]
Voir Piché, « Frankenstein », supra note 30 à la p 296. Voir aussi Dutton, supra note 30 au para 26.
-
[48]
Barreau du Québec, Rapport sur le recours collectif, Montréal, 1977 à la p 1, tel que cité dans Pierre-Claude Lafond, « Le recours collectif : entre la commodité procédurale et la justice sociale » (1998-1999) 29:1/2 RDUS 3 à la p 21 [Lafond, « Le recours collectif »].
-
[49]
Bernard Murphy et Camille Cameron, « Access to Justice and the Evolution of Class Action Litigation in Australia » (2006) 30:2 Melbourne UL Rev 399 (« power in numbers that would be non-existent if claims were pursued individually » à la p 403).
-
[50]
Voir Dutton, supra note 30 au para 26. Pour un aperçu historique de cette tendance, voir Lafond, « Le recours collectif », supra note 48 à la p 10. Voir aussi Mauro Cappelletti, « La protection d’intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (Métamorphoses de la procédure civile) » (1975) 27:3 RIDC 571 (« la complexité de la société moderne et l’enchevêtrement des relations économiques engendrent des situations où des actes particuliers peuvent porter atteinte aux intérêts d’un grand nombre de personnes et présentent, de ce fait, des problèmes qui n’ont pas été envisagés dans les litiges individuels » à la p 572).
-
[51]
Voir notamment Asselin, supra note 32 aux para 16, 27.
-
[52]
Charles c Boiron Canada inc, 2016 QCCA 1716 au para 73. Voir aussi Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c Université Laval, 2017 QCCA 199 au para 136.
-
[53]
« Directives de la Cour supérieure pour le district de Montréal » (dernière modification le 1er septembre 2019) au para 226, en ligne (pdf) : Cour supérieure du Québec <coursuperieureduquebec.ca> [perma.cc/R4ZW-3XDU] [« Directives de la Cour supérieure »]. Voir aussi Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 111.
-
[54]
Voir Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 111.
-
[55]
Ibid à la p 56.
-
[56]
Voir ibid.
-
[57]
Voir ibid à la p 225.
-
[58]
Voir ibid aux pp 225, 229. Voir aussi Jasminka Kalajdzic, Class Actions in Canada: The Promise and Reality of Access to Justice, Vancouver, UBC Press, 2018 à la p 6.
-
[59]
Voir Veer CA, supra note 3 aux para 35–36.
-
[60]
Voir Québec, Régie du logement, Rapport annuel de gestion, 2019-2020, Gouvernement du Québec, 2020 à la p 1, en ligne (pdf) : Tribunal administratif du logement <tal.gouv.qc.ca> [perma.cc/U5LR-G67N] [Régie du logement].
-
[61]
Hollick, supra note 30 au para 15. Voir aussi Dutton, supra note 30 au para 27.
-
[62]
Dutton, supra note 30 au para 27.
-
[63]
Voir Piché, L’action collective, supra note 1 aux pp 56, 225 et texte correspondant aux notes 55−57.
-
[64]
Voir Régie du logement, supra note 60 à la p 6.
-
[65]
Débats 1978, supra note 24 à la p 1474.
-
[66]
Ibid aux pp 1474–75.
-
[67]
Infineon Technologies AG c Option consommateurs, 2013 CSC 59 au para 60. Cet extrait a été repris plus récemment dans Asselin (supra note 32 au para 16). Notons que l’objectif d’indemnisation, quant à lui, est souvent assimilé à la question de l’accès à la justice dont nous avons traité précédemment (voir Piché, « Frankenstein », supra note 30 à la p 302; Fischer, supra note 33 au para 24).
-
[68]
Dutton, supra note 30 au para 29.
-
[69]
Ibid.
-
[70]
Débats 1978, supra note 24 à la p 1474.
-
[71]
La professeure Piché note toutefois, à juste titre, que cet effet de dissuasion est bien « difficile – sinon impossible – à prouver » (Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 118).
-
[72]
Hollick, supra note 30 au para 15.
-
[73]
Civil Justice Council, supra note 30 (« [e]ffective collective actions promote competition and market efficiency, consistent with the Government’s economic principles and objectives, benefiting individual citizens, businesses and society as a whole » à la p 18).
-
[74]
Voir L’Heureux, supra note 30 à la p 446, citant Jean Calais-Auloy, « Les modes d’intervention de la puissance publique pour la défense des consommateurs » dans L’interventionnisme économique de la puissance publique : Études en l’honneur du Doyen Georges Péquignot, t 1, Montpellier, Centre d’Études et de Recherches Administratives de Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université de Montpellier I, 1984, 71 à la p 74.
-
[75]
Veer CS, supra note 5 au para 55. Voir aussi Asselin, supra note 32 au para 27.
-
[76]
Voir Civil Justice Council, supra note 30 aux pp 25–26.
-
[77]
Voir par ex Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c Association des producteurs de théâtre privé du Québec (APTP), 2012 QCCA 1524 au para 106. Voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 129–31.
-
[78]
Voir Civil Procedure Rules 1998 (R-U), SI 1998/3132, art 19.12(1)(b) (telles qu’amendées par les Civil Procedure (Amendment) Rules 2000 (R-U), SI 2000/221, art 9 et annexe 2).
-
[79]
Pour une analyse du même problème dans le cadre du GLO anglais, voir Shinthean Ng, « Class Action (Not US-style): Enhancing Access to Justice » (2017) 6 Manchester Rev L Crime & Ethics 49 à la p 56.
-
[80]
Voir Civil Justice Council, supra note 30 aux pp 100–01. Voir aussi Ng, supra note 79 à la p 52.
-
[81]
Voir Civil Justice Council, supra note 30 aux pp 86–87.
-
[82]
Voir art 595 Cpc.
-
[83]
Voir Piché, L’action collective, supra note 1 aux pp 185–86 (notant un taux de distribution de 82,66% par distribution automatique et de 42,21% par réclamations individuelles). La même situation prévaut lorsque le recouvrement collectif s’avère impossible et que le tribunal le remplace par un recouvrement individuel (voir ibid aux pp 183–84).
-
[84]
Voir Soraya Amrani Mekki, « L’action collective québécoise : Regard (envieux) d’un processualiste français » (2016) 68:2 RIDC 341 à la p 342.
-
[85]
Piché, « Frankenstein », supra note 30 à la p 304.
-
[86]
Voir Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 111 et texte correspondant à la note 53.
-
[87]
Voir Lafond, L’accès à la justice, supra note 46 à la p 148.
-
[88]
Pierre-Claude Lafond, « L’action de groupe française ou l’art de rater une belle occasion » (2016) 68:2 RIDC 319 à la p 334 [Lafond, « L’action de groupe »].
-
[89]
Voir Cal CCP § 382 (1971).
-
[90]
Voir 28 USCA §§ 1332(d)(1)–(2), 1332(d)(5) (West 2022); Federal Rules of Civil Procedure, 28 USCA § 23 (West 2022).
-
[91]
Voir Munguia-Brown v Equity Residential, 2017 WL 4838822 (ND Cal Dist Ct).
-
[92]
Par exemple, un locataire qui voudrait intenter un recours en fixation de loyer fondé sur des circonstances purement individuelles pourrait être tenté, pour bénéficier du rapport de force que fournit l’action collective, de se plaindre aussi de la non-divulgation du loyer précédent dans le bail, bien que cette pratique ne soit pas à la source de son préjudice. On peut aussi imaginer d’autres situations où les demandeurs pourraient se mettre à la recherche d’au moins une question commune ou connexe leur permettant de bâtir une action collective.
-
[93]
Débats 1978, supra note 24 à la p 1475.
-
[94]
Ibid. Ces remarques faisaient écho, notamment, aux commentaires de la Commission des services juridiques qui, dans le mémoire qu’elle a déposé en commission parlementaire, recommandait que les tribunaux administratifs soient requis d’« adopter dans un délai de deux ans des règles de pratique prévoyant la possibilité d’exercer devant [eux] un recours collectif » (Québec, Assemblée nationale, Commission permanente de la justice, « Mémoire présenté par la Commission des services juridiques à la commission parlementaire chargée d’étudier le projet de loi sur le recours collectif », Journal des débats de la Commission permanente de la justice, 31-3, n° 8 (8 mars 1978) à la p B-364).
-
[95]
Voir généralement « De 1971 à 1995 – un vent de réforme », en ligne : Conférence des juges administratifs du Québec <cjaq.qc.ca> [perma.cc/2Q9Z-YM9Z].
-
[96]
Débats 1978, supra note 24 à la p 1475.
-
[97]
Voir Oratoire, supra note 30 au para 8, citant Tremaine c AH Robins Canada Inc, [1990] RDJ 500, 1990 CanLII 2808 (CA Qc). Voir aussi Pharmascience, supra note 46 au para 20.
-
[98]
Oratoire, supra note 30 au para 8, citant Harmegnies c Toyota Canada inc, 2008 QCCA 380 au para 29. Voir aussi Dutton, supra note 30 (« l’importance du recours collectif comme instrument de procédure dans les litiges modernes est devenue évidente » au para 46).
-
[99]
Amrani Mekki, supra note 84 à la p 341.
-
[100]
Lafond, « L’action de groupe », supra note 88 à la p 320. Voir aussi Lafond, L’accès à la justice, supra note 46 à la p 148; Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 270.
-
[101]
Concernant les salaires des juges du Tribunal administratif du logement, voir Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, r 5.1, annexe I, art 3; Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, D 450-2007, (2007) GOQ II, 2723, annexe II, modifié par D 952-2022, (2022) GOQ II, 3537 (entre 130 732$ et 169 950$). Pour les salaires des juges de la Cour supérieure du Québec, voir Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1, art 13(d) (338 800$).
-
[102]
Voir « Directives de la Cour supérieure », supra note 53 au para 226.
-
[103]
En matière d’insalubrité, voir par ex Martin Gallié et Julie Verrette, « Le parcours judiciaire des victimes d’insalubrité (le cas de la moisissure) » (2020) 13:2 RD & santé McGill 181 aux pp 230−32, 242.
-
[104]
Voir Martin Gallié et Louis-Simon Besner, « De la lutte contre les délais judiciaires à l’organisation d’une justice à deux vitesses : la gestion du rôle à la Régie du logement du Québec » (2017) 58:4 C de D 711 (la mise au rôle « contribue à privilégier des intérêts bien particuliers, d’une minorité, c’est-à-dire ceux des propriétaires de logements locatifs », de sorte que « les délais varient grandement selon la catégorie sociale des justiciables et les enjeux sociaux et sanitaires des litiges » aux pp 746−47).
-
[105]
Voir Civil Justice Council, supra note 30 à la p 11.
-
[106]
Ibid (« [a] generic collective action should be introduced. Individual and discrete collective actions could also properly be introduced in the wider civil context i.e., before the CAT or the Employment Tribunal to complement the generic civil collective action » aux pp 21, 137).
-
[107]
Ibid (« [t]his would also facilitate the proper and effective administration of justice both in the civil courts, as claims would not have to be brought before those courts thus giving rise to resource savings, whilst enabling them to be prosecuted efficiently within the appropriate specialist tribunal » à la p 138).
-
[108]
Voir Consumer Rights Act 2015 (R-U), annexe 8, arts 4–11; Competition Appeal Tribunal Rules 2015 (R-U), SI 2015/1648, arts 73–98 [CAT Rules].
-
[109]
Voir Competition Act 1998 (R-U), art 47B [Competition Act]; CAT Rules, supra note 108, arts 73, 75, 78, 79; art 575 Cpc. Voir aussi Rachael Mulheron, « The United Kingdom’s New Opt-Out Class Action » (2017) 37:4 Oxford J Leg Stud 814 aux pp 822−23.
-
[110]
Voir Competition Act, supra note 109, arts 47B(7)(c), 47B(10)–(11).
-
[111]
Voir arts 576, 579–80 Cpc.
-
[112]
Voir Competition Act, supra note 109, art 47A(2).
-
[113]
Voir par ex Gibson v Pride Mobility Products Limited, [2017] CAT 9 aux para 102–20.
-
[114]
Voir Mastercard Incorporated v Merricks, [2020] UKSC 51. Il est intéressant de noter que la cour attribue à ce nouveau véhicule procédural des objectifs similaires à ceux de l’action collective québécoise, soit l’indemnisation des membres, l’accès à la justice et la dissuasion de pratiques indésirables (voir ibid au para 2) et qu’elle se fonde largement sur la jurisprudence canadienne afin d’interpréter les exigences législatives propres au régime britannique (voir ibid aux para 19, 37–42).
-
[115]
Voir Michael Sant’Ambrogio et Adam S Zimmerman, « Inside the Agency Class Action » (2017) 126:6 Yale LJ 1634 aux pp 1640–42. Les auteurs notent toutefois qu’en date de 2017, « very few agencies use formal class action or other complex litigation procedures » (ibid à la p 1658).
-
[116]
Voir ibid à la p 1659.
-
[117]
Voir 29 CFR § 1614.204 (2012).
-
[118]
Voir Sant’Ambrogio et Zimmerman, supra note 115 à la p 1666.
-
[119]
Voir ibid.
-
[120]
Le bureau du conseiller juridique (Office of Legal Counsel) du département de la Justice américain a rejeté une contestation du service postal qui remettait en question la validité des règles adoptées par l’EEOC pour entendre des recours collectifs (voir É-U, Office of Legal Counsel, Legality of EEOC’s Class Action Regulations: Memorandum Opinion for the Vice President and General Counsel United States Postal Service, 2004 aux pp 254−55, 261, en ligne (pdf) : The United States Department of Justice <justice.gov> [perma.cc/NZU4-8HGC]).
-
[121]
Voir LTal, supra note 12, art 85 (« les membres peuvent, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires […] Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée »).
-
[122]
Voir notamment Yves Lauzon, « Le recours collectif quebecois : description et bilan » (1984) 9:3 Can Bus LJ 324 à la p 326.
-
[123]
Voir CAT Rules, supra note 109.
-
[124]
Voir ibid, arts 73–98.
-
[125]
Voir arts 571–604 Cpc.
-
[126]
Voir 29 CFR §§ 1614.105 (2010), 1614.204(b) (2012) (il est à noter que cette obligation s’impose aussi dans le cadre de plaintes individuelles).
-
[127]
Voir 29 CFR § 1614.204 (2012). Voir aussi É-U, US Equal Employment Opportunity Commission, Equal Employment Opportunity Management Directive for 29 CFR Part 1614 (EEO-MD-110), 2015 au chapitre 8, en ligne (pdf) : US Equal Employment Opportunity Commission <eeoc.gov> [perma.cc/QG7N-NR59].
-
[128]
Voir arts 574–77 Cpc. La professeure Piché, par exemple, conclut de façon empirique que « l’autorisation a su jouer un rôle important dans le filtrage des dossiers d’action collective et dans la protection des membres du groupe au fil des 25 dernières années » (Piché, L’action collective, supra note 1 à la p 110). Elle plaide pour un maintien de l’autorisation conjugué au développement d’une approche plus rigoureuse par les tribunaux (voir ibid à la p 111).
-
[129]
Voir arts 579–81 Cpc.
-
[130]
Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, r 5, art 3, al 2(3) [Règlement du Tal].
-
[131]
Voir art 572 Cpc.
-
[132]
Voir Règlement du Tal, supra note 130, art 5.
-
[133]
Voir notamment arts 592, 595–601 Cpc. Les modalités d’une transaction intervenue entre les parties devraient aussi être prévues, alors que le Règlement du Tal énonce simplement que « [l]orsque les parties concluent une entente, le Tribunal ferme le dossier » (supra note 130, art 14). Comparer avec l’article 590 C.p.c., qui prévoit que « [l]a transaction […] ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal » après avoir avisé les membres.
-
[134]
Voir LTal, supra note 12, art 91 (assujettissant tout appel à l’octroi d’une permission par un juge de la Cour du Québec et interdisant tout appel pour « la fixation de loyer, la modification d’une […] condition du bail ou la révision de loyer », le recouvrement d’une petite créance, le démembrement d’un ensemble immobilier, la conversion en copropriété divise, la démolition et l’autorisation de déposer le loyer).
-
[135]
Par exemple, l’article 578 C.p.c. prévoit un droit d’appel asymétrique au stade de l’autorisation en édictant que « [l]e jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel », alors que « [c]elui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée » [nos italiques]. Sur le fond, l’article 602 C.p.c. prévoit que « [l]e jugement qui dispose de l’action collective est sujet à appel de plein droit ». Un régime similaire pourrait être mis en place au Tribunal administratif du logement.
-
[136]
Voir LTal, supra note 12, art 91. Notons aussi que tant le Tribunal administratif du logement que la Cour du Québec sont assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure du Québec, qui peut s’exercer dans des circonstances bien définies (voir arts 34, 529 Cpc).
-
[137]
Supra note 4, art 96.
-
[138]
Voir Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 au para 59. Ce test a d’abord été développé dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 RCS 714 aux pp 734–36, 123 DLR (3e) 554.
-
[139]
Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 aux para 65–66. Voir aussi MacMillan Bloedel Ltd c Simpson, [1995] 4 RCS 725 aux para 18, 27, 130 DLR (4e) 385 [MacMillan Bloedel].
-
[140]
Ce qui tend à montrer que l’attribution de ce pouvoir à un tribunal inférieur est constitutionnelle, étant donné que « [s]i une compétence est nouvelle, il ne peut alors y avoir de conflit avec l’art. 96, puisque cette compétence n’a pu relever d’une cour supérieure au moment de la Confédération » (Renvoi relatif à certaines modifications à la Residential Tenancies Act (N-É), [1996] 1 RCS 186 au para 94, 131 DLR (4e) 609 [Renvoi sur la Residential Tenancies Act (N-É)]).
-
[141]
Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 au para 74, référant au Renvoi sur la Residential Tenancies Act (N-É), supra note 140 au para 76.
-
[142]
Renvoi sur la Residential Tenancies Act (N-É), supra note 140 au para 76, citant Dupont c Inglis, [1958] RCS 535 à la p 543, 14 DLR (2e) 417. Voir aussi Sobeys Stores Ltd c Yeomans et Labour Standards Tribunal (N-É), [1989] 1 RCS 238 à la p 255, 57 DLR (4e) 1. Notons toutefois que certaines décisions ont qualifié le pouvoir en cause par référence à la fois au type de différend et aux réparations octroyées (voir par ex MacMillan Bloedel, supra note 139 au para 25).
-
[143]
Voir Québec (PG) c Grondin, [1983] 2 RCS 364, 4 DLR (4e) 605 [Grondin].
-
[144]
Voir ibid à la p 383. Voir aussi Renvoi sur la Residential Tenancies Act (N-É), supra note 140 aux para 81–92.
-
[145]
Supra note 139 au para 28. Dans cette décision, la Cour suprême applique ce test à l’exemple du pouvoir en matière d’outrage (voir ibid aux para 40–42).
-
[146]
Renvoi sur la Residential Tenancies Act (N-É), supra note 140 au para 56, juge en chef Lamer, concordant.
-
[147]
Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 au para 68, référant à MacMillan Bloedel, supra note 139.
-
[148]
Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 au para 82.
-
[149]
Supra note 143.
-
[150]
Voir Renvoi sur la Cour du Québec, supra note 23 aux para 118, 142. L’analyse est toutefois nuancée en indiquant notamment qu’une compétence portant sur un domaine plus restreint du droit privé pourrait militer en faveur de l’acceptation d’un plafond pécuniaire plus élevé (voir ibid aux para 131−33).
-
[151]
Voir Veer CA, supra note 3 aux para 38–39. Voir aussi Veer CS, supra note 5 aux para 34, 40–41, 48, 54. Voir la même conclusion en Colombie-Britannique dans Gates v Sahota, 2018 BCCA 375 aux para 68–77 [Gates], autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 38438 (2 mai 2019).
-
[152]
Voir art 35, al 3 Cpc. Voir aussi Groupe Cantrex inc c Tapis Cowansville inc, 2009 QCCA 1576.
-
[153]
Débats 1978, supra note 24 à la p 1475.
-
[154]
Une décision récente confirme d’ailleurs cette conclusion en matière de régimes de retraite, citant avec approbation l’arrêt Veer (voir Regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal c Ville de Montréal, 2020 QCCA 399 au para 20, citant Veer CA, supra note 3 au para 36).
-
[155]
Voir MS c R, 2020 CF 982 au para 55.
-
[156]
Voir Gagnon c Amazon.com inc, 2019 QCCA 1166 aux para 24−25.
-
[157]
Pour un exemple antérieur à Veer, voir Laprise c Boisclair, ès qualités “Ministre de la Solidarité sociale”, REJB 2001-24941 aux para 16–21 (Référence), 2001 CanLII 25031 (CS Qc), conf par Laprise c Boisclair, 2002 CanLII 63416, EYB 2002-35673 (Référence) (CA Qc).
-
[158]
Voir par ex Gates, supra note 151 aux para 76–77, 88(e).
-
[159]
Selon le Président de la Régie du logement, en 2019, près de 85% des demandeurs se présentant devant ce tribunal administratif le faisaient sans avocat (voir « La Fondation met à jour son guide Seul devant un tribunal administratif » (mai 2019), en ligne : Fondation du Barreau du Québec <fondationdubarreau.qc.ca> [perma.cc/3U5H-T5GJ]). Un auteur note pour sa part que « moins de 6% des locataires sont représentés au Québec » (voir Martin Gallié, « L’accès à la justice : une idéologie? À propos des réformes en droit du logement » (2020) 54:1/2/3 RJTUM 233 à la p 255). Évidemment, l’autoreprésentation comporte elle aussi des inconvénients non négligeables.
-
[160]
Pour un survol des coûts reliés aux actions collectives, voir Piché, L’action collective, supra note 1 aux pp 30, 225–68. La littérature américaine, notamment, suggère que les actions collectives ne sont pas toujours efficaces pour défendre les droits des segments les plus marginalisés de la population en raison de critères procéduraux stricts, mais aussi des investissements qu’elles requièrent (voir par ex Maureen Carroll, « Civil Procedure and Economic Inequality » (2020) 69:2 DePaul L Rev 269 à la p 294; Suzette M Malveaux, « The Modern Class Action Rule: Its Civil Rights Roots and Relevance Today » (2017) 66:2 U Kan L Rev 325 aux pp 367 et s).
-
[161]
Voir par ex Geneviève Breault, « Militantisme au sein des groupes de défense des droits des personnes locataires : pratiques démocratiques et limites organisationnelles » (2017) 23:2 Reflets 181 aux pp 183–85; Pierson Nettling, « Tenant Activism and the Demise of Urban Renewal: Tenants, Governance, and the Struggle for Recognition at Habitations Jeanne-Mance in Montreal » (2022) 48:3 J Urban History 523.
-
[162]
Voir par ex Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art 277.
-
[163]
Fischer, supra note 33 au para 16. Voir aussi Hollick, supra note 30 au para 35.