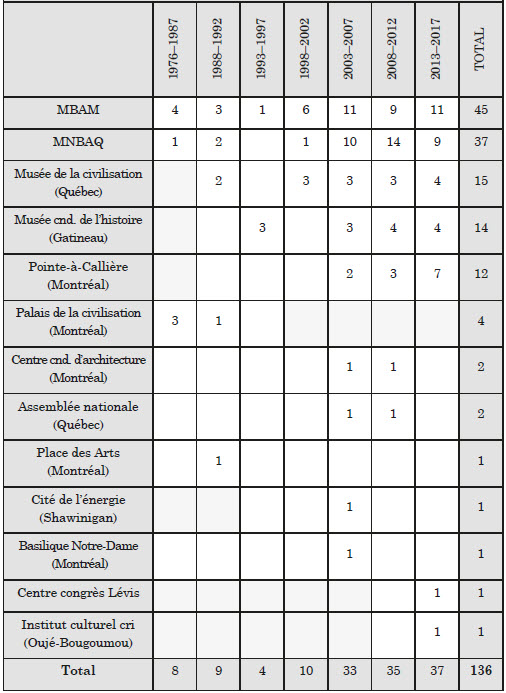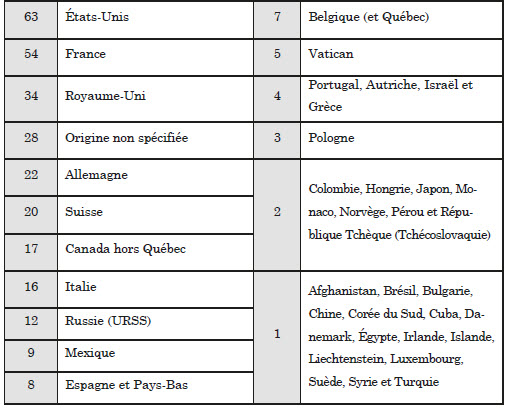Abstracts
Résumé
Afin d’encourager la présentation d’expositions au Québec, l’article 697 du Code de procédure civile permet de protéger contre les saisies les oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques prêtés de l’étranger. Cette disposition (alors l’article 553.1 de l’ancien Code de procédure civile) fut introduite en 1976 afin de permettre la tenue, à Montréal, d’une importante exposition en provenance de l’URSS.
Depuis, de nombreux États se sont dotés de mesures de protection comparables et l’article 697 est fréquemment employé pour protéger les oeuvres d’art et objets culturels lors de leur passage au Québec. Cependant, la jurisprudence étrangère révèle que ces mécanismes ne sont pas exempts de failles. Plus de quarante ans après l’adoption au Québec de cette disposition d’insaisissabilité, et à la lumière des développements internationaux, la présente étude se propose de dresser un bilan de l’emploi de cette disposition, d’évaluer ses défauts ainsi que de formuler des propositions afin de renforcer son efficacité et de permettre son emploi dans d’autres contextes que ceux jusqu’ici envisagés par le législateur.
Abstract
In order to encourage the presentation of exhibitions in Québec, article 697 of the Code of Civil Procedure allows for the protection of works of art and other cultural or historical property on loan from abroad from seizure. This provision (then article 553.1 of the former Code of Civil Procedure) was introduced in 1976 to allow a major exhibition from the USSR to be held in Montréal.
Since then, many states have adopted similar measures of protection, and article 697 is frequently used to protect works of art and cultural objects during their stay in Québec. However, foreign case law reveals that these mechanisms are not without important flaws. More than forty years after Québec adopted this unseizability provision, and in light of international developments, the present study proposes to review the use of this provision, assess its flaws, and formulate proposals to strengthen its effectiveness and allow its use in contexts other than those hitherto contemplated by the legislator.
Article body
Introduction : un danger bien réel
Imaginons l’effet que pourrait avoir une descente de police au Musée des beaux-arts de Montréal durant une exposition d’expressionnistes allemands, après qu’un descendant d’un propriétaire spolié durant la Seconde Guerre mondiale eut revendiqué un tableau. Imaginons les réactions provoquées par une demande d’injonction pour empêcher le Musée Pointe-à-Callière de renvoyer un objet ancien à un prêteur en raison d’un soupçon de pillage archéologique. Imaginons qu’une grande compagnie tente de faire exécuter une sentence arbitrale contre un État en visant une oeuvre appartenant à cet État alors que cette oeuvre se trouve au Musée national des beaux-arts du Québec. Imaginons surtout l’embarras d’un conservateur de l’une de ces institutions lorsqu’il tentera ensuite d’organiser une exposition et de convaincre un prêteur étranger — qui prend déjà le risque de faire voyager un objet souvent fragile — que le Québec offre des garanties juridiques suffisantes pour assurer la bonne tenue de l’exposition et le retour des objets. Nos musées sont-ils véritablement à l’abri de pareils scénarios[1]?
Le paysage international s’est considérablement complexifié depuis que le Québec fut l’une des premières juridictions à se doter, en 1976, d’une loi d’immunité de saisie des biens culturels. Les nombreuses tentatives de saisie qui secouent le monde de l’art depuis une vingtaine d’années — dont la plus célèbre est celle du Portrait de Wally à New York en 1998 — rendent les prêteurs plus hésitants et plus exigeants. Bien plus qu’une question de procédure civile, l’immunité de saisie influe sur la capacité des institutions muséales à obtenir et à exposer au public des oeuvres de qualité. Il s’agit donc, à notre avis, d’un élément constitutif de la politique culturelle québécoise.
L’évolution internationale du droit régissant l’immunité de saisie pendant ces dernières décennies n’a jusqu’ici entraîné aucune réaction du légis- lateur québécois, et ce, malgré le fait que, des cinq provinces canadiennes à avoir adopté un mécanisme comparable, le Québec possède la loi qui est vraisemblablement la plus vulnérable aux réclamations en justice. À notre connaissance, on ne trouve ni étude universitaire ni essai de politique publique qui analyse l’efficacité de la loi québécoise[2]. Si l’objectif du législateur était bien d’éviter la possibilité de toute poursuite judiciaire lors d’une exposition temporaire ayant lieu sur son territoire, force est de constater que la loi actuelle n’atteint que partiellement cet objectif.
Le présent essai souhaite d’abord (I) expliquer l’origine et le développement du régime québécois présentement en vigueur[3]; puis (II) identifier dans la jurisprudence étrangère les raisons pour lesquelles le régime actuel pourrait s’avérer insuffisant; ensuite (III) cerner pourquoi une large immunité doit être accordée aux objets culturels; et finalement (IV) proposer des pistes de réforme. Notre objectif est d’identifier les outils juridiques dont les institutions muséales québécoises ont besoin pour assurer la pérennité des échanges culturels internationaux afin que les musées jouent pleinement leur rôle et que le public continue québécois continue d’avoir accès à des expositions de grande qualité.
I. Les origines de la loi québécoise
A. Une demande du Kremlin
En 1975, pour célébrer le trentième anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, l’URSS organisa une grande exposition de toiles de l’Ermitage et du Musée russe dans cinq villes américaines : Washington, Los Angeles, Houston, Détroit et New York[4]. Le Canada demanda, avec succès, que l’exposition s’y arrêtât également. Sur six villes candidates, deux furent retenues pour l’accueillir : Winnipeg et Toronto.
Or, l’histoire des collections publiques soviétiques est mouvementée. Nombre de collectionneurs privés furent expropriés au lendemain de la révolution russe, et, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Armée rouge pilla des centaines de milliers d’objets culturels[5]. L’URSS demanda donc au Manitoba et à l’Ontario qu’une loi fût votée pour protéger les objets faisant partie de l’exposition contre toute réclamation. Avant 1976, seules deux juridictions s’étaient dotées de pareille législation : les États-Unis, en 1965, afin de préparer la venue d’une exposition soviétique à l’Université de Richmond[6] et l’État de New York, en 1968, après une saisie d’oeuvres chez un galeriste[7].
Au Manitoba, l’adoption de la loi ne se fit pas sans réticence. En pleine guerre froide — et dans une province où vit une importante population d’ascendance ukrainienne —, certains députés conservateurs se demandèrent pourquoi il aurait fallu empêcher les Manitobains d’ester en justice pour satisfaire aux exigences du Kremlin[8]. Malgré tout, la loi fut votée à une majorité de trente-cinq voix contre quatorze lors d’un vote libre[9]. L’exposition connut un franc succès. Les choses furent cependant plus compliquées en Ontario où le gouvernement minoritaire conservateur semblait hostile à une quelconque limite des droits de propriété, et refusa de proposer une loi analogue[10].
Le Musée des beaux-arts de Montréal sauta sur l’occasion. Le ministre des Affaires culturelles d’alors, Jean-Paul L’Allier, proposa d’amender le Code de procédure civile pour répondre aux exigences russes. L’opinion publique était alors surtout préoccupée par l’ouverture prochaine des Jeux olympiques de Montréal. Les trois partis politiques représentés à l’Assemblée nationale tombèrent facilement d’accord et les trois lectures du projet de loi eurent lieu en une même journée, le 30 juin 1976[11] :
Cette mesure est nécessaire suivant les exigences de certains pays qui proposent des expositions itinérantes d’importance. Notamment le Musée des beaux-arts se voit offrir, à l’occasion, de telles expositions et ne peut les accueillir, précisément parce qu’il n’est pas en mesure de fournir de telles garanties d’insaisissabilité.
Compte tenu de l’importance de ces expositions, compte tenu de la valeur des biens qui sont exposés, il nous apparaissait nécessaire de proposer ici cette modification au Code de procédure civile afin de permettre aux autorités des musées, quels qu’ils soient, musées publics ou musées privés, de négocier, le cas échéant, de telles expositions et de fournir, sur décision du gouvernement, donc du lieutenant-gouverneur en conseil, une garantie d’insaisissabilité.[12]
La lecture des brefs débats tenus à l’Assemblée nationale révèle que la modification du Code de procédure civile fut adoptée non pas après une étude minutieuse des différents cas de figure auxquels les institutions muséales pourraient être confrontées, mais bien dans le but précis d’assurer la tenue à Montréal d’une exposition d’oeuvres provenant de l’URSS. Même si le ministre ne fut pas explicite sur ce point, l’intervention du député Bellemare de l’Union nationale, également favorable au projet de loi, ne laisse aucun doute sur les motifs qui poussèrent l’Assemblée à agir aussi rapidement :
M. le Président, je suis très heureux de concourir à [c]e projet de loi parce que je crois personnellement que les Russes, même si c’est un pays à dénomination totalitaire, ont des choses merveilleuses à nous montrer. Le principe de la loi qui est devant nous concorde parfaitement bien avec le projet de loi no 56 qui a été présenté au mois de juin dernier par le ministre des Affaires culturelles de la province de Manitoba. […]
Je comprends qu’il y a certaines personnes qui ont été chassées de ces pays totalitaires qui sont ici en demeure permanente et qui pourraient peut-être manifester le désir de recouvrer, par des procédures, les biens et les effets qu’elles ont perdus lors de leur mutation, lors de leur immigration au Canada. Je crois que c’est une saine prudence qui est dictée par la largeur de vue du ministre, mais aussi à la demande formelle du gouvernement russe qui l’a demandé avant de pouvoir établir chez nous cette exposition.[13]
L’ancien Code de procédure civile fut ainsi modifié par l’ajout de l’article 553.1 :
553.1. Sont aussi insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu’il détermine, les oeuvres d’art ou biens historiques provenant de l’extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l’être. Ces oeuvres ou biens ne doivent pas avoir été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec.
Le décret adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’insaisissabilité décrétée par le présent article n’empêche pas l’exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de service relatifs au transport, à l’entreposage et à l’exposition des oeuvres et biens visés au premier alinéa.[14]
Le décret 2596-76 publié quelques semaines plus tard dans la Gazette officielle permit à Montréal de recevoir l’exposition[15]. L’annexe du décret, comprenant la liste des oeuvres exposées, comportait certains des plus grands artistes de l’art occidental : Titien, Caravage, Rembrandt, Vélasquez, Poussin, Fragonard, Cézanne ou Gauguin.
À la suite de cet épisode, l’Ontario réagit. Le premier ministre Bill Davis, le même qui avait refusé d’aller de l’avant en 1976, fit adopter, en 1978, une loi pour assurer la venue d’une exposition sur les trésors de Toutânkhamon[16]. Deux autres provinces canadiennes votèrent des dispositions analogues : la Colombie-Britannique en 1980[17] et l’Alberta en 1985[18], mais sans que des expositions importantes n’y fussent prévues. En conséquence, dès 1985, cinq provinces canadiennes s’étaient dotées de lois d’immunité de saisie, et ce, bien avant des pays qui présentent des expositions internationales d’envergure bien plus fréquemment comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Cependant — et c’est un point important sur lequel nous reviendrons — le Parlement fédéral n’adopta jamais de loi comparable concernant ses champs de compétence.
B. Quarante ans après
Depuis, le système des décrets s’est largement implanté dans le paysage muséal québécois. Entre 1976 et 2017, on recense que des oeuvres faisant partie de 136 expositions furent protégées par un décret d’insaisissabilité. Le Tableau 1, ci-dessous, donne un aperçu des institutions qui ont employé le système. Deux tendances se dégagent. D’abord, et après une première période calme où l’on ne relève souvent qu’un seul décret annuellement (1976–2002), le nombre de décrets augmente de manière significative à partir de 2003. Depuis une décennie, la moyenne annuelle se situe environ à sept décrets. Alors qu’au début c’est le prêteur qui faisait une demande spéciale pour un décret, certains musées ont désormais pour politique de demander systématiquement un décret lorsqu’une exposition provient de l’étranger[19]. Ensuite, la grande majorité des décrets est obtenue par cinq musées : le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), le Musée de la civilisation, le Musée canadien de l’histoire et Pointe-à-Callière.
Tableau 1
Institutions d’accueil au Québec (1976–2017)[20]
L’analyse de ces décrets permet également d’établir la nationalité des prêteurs et, partant, de dresser le portrait des relations muséales québécoises et d’identifier ses principaux partenaires. Le Tableau 2 recense l’origine des prêts[21] et confirme que, si de nombreux pays prêtent au fil des ans, certains partenaires tiennent une place privilégiée dans les relations culturelles québécoises, en particulier les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. De plus, et si l’on exclut les prêts d’origine inconnue et les prêts d’origine québécoise — alors que ces derniers ne devraient pas donner lieu à un décret[22] —, 95% des prêts proviennent d’Amérique du Nord (incluant le Mexique) ou d’Europe (incluant la Russie)[23].
Tableau 2
Origine des prêteurs – Québec (1976–2017)
Il est par ailleurs intéressant de comparer ces données avec celles de l’Ontario, l’autre province qui organise annuellement un nombre important d’expositions internationales (Tableau 3). Depuis 2003, un nombre comparable de décrets est demandé au Québec et en Ontario.
Tableau 3
Institutions d’accueil en Ontario (2003–2017)[24]
L’article 553.1 du Code de procédure civile fut depuis repris sans grand changement dans le nouveau Code de procédure civile à l’article 697. Le commentaire (laconique) de la ministre explique que l’on reprend l’essentiel du droit antérieur[25]. Le texte actuel se lit comme suit :
697. Les oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques provenant de l’extérieur du Québec qui sont exposés publiquement au Québec ou destinés à y être exposés sont insaisissables s’ils sont déclarés tels par décret du gouvernement, pour la période qui y est indiquée. Ce décret entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’insaisissabilité de ces biens n’empêche pas l’exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec ou encore pour donner effet à un contrat de service relatif à leur transport, leur entreposage et leur exposition.[26]
Nous remarquons que la terminologie a été légèrement modifiée. Alors que l’on protégeait dans l’ancien code des « oeuvres d’art ou biens historiques », le libellé fut étendu aux « oeuvres d’art [et] autres biens culturels ou historiques ». L’ajout de l’expression « bien culturel » peut paraître anodin, mais il apporte une précision importante quant à la portée de la disposition. En effet, alors que « bien historique » n’a pas d’acceptation juridique particulière, l’expression « bien culturel » est désormais l’expression consacrée en droit international pour désigner les objets qui ont une valeur culturelle. Elle est employée dans les trois grandes conventions internationales sur le sujet : la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye 1954)[27], la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970 (UNESCO 1970)[28] et la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés[29]. L’expression est également employée dans la loi fédérale d’application des conventions La Haye 1954 et UNESCO 1970[30], ainsi que dans les lois d’immunité de saisie des autres législateurs francophones : Manitoba[31], France[32], Belgique[33] et Suisse[34]. Étant donné que le Code de procédure civile ne définit pas quels objets peuvent faire l’objet d’une protection, ce changement terminologique permet de considérer que tous les biens culturels protégés par la Convention UNESCO 1970 — qui contient à son article premier l’énumération la plus complète des objets inclus sous le vocable de « bien culturel » — peuvent faire l’objet d’une protection au Québec. Cela inclut donc non seulement les objets archéologiques et artistiques, mais aussi, et notamment, les spécimens de zoologie, de botanique, de minéralogie ou les manuscrits rares[35]. Il serait donc tout à fait normal qu’une exposition de fossiles de dinosaures ou de pierres précieuses puisse recevoir la protection d’un décret.
Bien que le système d’immunité se soit durablement implanté dans le paysage muséal québécois, un tour d’horizon international démontre que cette protection n’est pas exempte de failles.
II. La jurisprudence étrangère
Alors qu’il n’y avait des lois sur l’immunité de saisie qu’aux États-Unis en 1976[36], nombre de juridictions se sont depuis dotées de mécanismes de protection : la France (1994)[37], l’Allemagne (1998)[38], l’Autriche (2003)[39], la Belgique (2004)[40], la Suisse (2005)[41], le Royaume-Uni (2007)[42], Israël (2007)[43], le Liechtenstein (2008)[44], la Finlande (2011)[45], la République tchèque (2011)[46], le Japon (2011)[47] et l’Australie (2013)[48]. Cette démultiplication des lois traduit l’augmentation des revendications portant sur des objets d’art. Il ne faut pas s’en étonner. Les progrès dans la recherche sur les spoliations passées, la démultiplication des litiges et des arbitrages internationaux, l’augmentation du nombre d’expositions et de la valeur des objets d’art rendent plus probables les saisies. On distingue trois cas de figure qui peuvent donner lieu à des revendications sur des objets culturels prêtés dans le cadre d’expositions temporaires.
A. Les types de saisies
1. Le différend sur la propriété d’un objet culturel
Les poursuites les plus médiatisées et les plus spectaculaires proviennent de familles de propriétaires ou de communautés spoliées qui ne disposent d’aucun recours dans la juridiction où se trouve habituellement l’oeuvre. Par exemple, un héritier d’une famille spoliée lors des grandes nationalisations de la révolution russe tenta, en 2003, de saisir vingt-cinq oeuvres prêtées par la Russie à un musée de Los Angeles, dont des oeuvres de Van Gogh, Degas et Picasso[49]. La famille princière du Liechtenstein, pourtant neutre lors de la Seconde Guerre mondiale, tenta de récupérer, en 1991, des oeuvres exposées en Allemagne qui avaient fait l’objet d’une nationalisation en 1946 par les autorités tchécoslovaques[50]. Ou encore, en 2005, une communauté aborigène australienne tenta de saisir des dessins sur des écorces d’arbres datant du milieu du XIXe siècle qui étaient prêtés par le British Museum au Museum Victoria de Melbourne[51].
La tentative de saisie peut également découler d’un différend international. Certains États craignent en effet que la propriété ou la possession de certains objets puisse être remise en cause, comme c’est le cas des collections impériales chinoises qui sont à Taïwan depuis la guerre civile ou des Manuscrits de la mer Morte saisis par Israël après la guerre des Six Jours[52]. Plus exceptionnellement, les autorités de l’État hôte décident d’intervenir et d’effectuer une enquête criminelle sur le passé d’une oeuvre, comme dans le cas de la saga Wally que nous allons détailler plus loin.
2. L’exécution d’un jugement ou d’une sentence
Une oeuvre d’art ou un bien culturel ou historique peut également être à risque de saisie même s’il n’existe aucun contentieux quant à sa propriété. En effet, certaines décisions judiciaires et sentences arbitrales peuvent s’avérer difficilement exécutables dans le pays du débiteur. Le créancier peut donc tenter de saisir les avoirs du débiteur, incluant des oeuvres d’art, lorsqu’elles se trouvent dans une juridiction où les recours sont plus aisément disponibles. Voici quelques exemples. En 2000, une famille russe, qui avait vu ses usines expropriées en 1918, obtint un jugement de 234 millions de dollars devant les cours américaines. Pour exécuter ce jugement, elle tenta de saisir des oeuvres se trouvant dans une exposition sur les trésors de la famille Romanov présentée aux États-Unis[53]. En 2002, les victimes d’une attaque terroriste commanditée par la Libye en 1986 tentèrent de mettre la main sur des objets appartenant à ce pays lors d’une exposition qui se tenait à Berlin[54]. En 2003, des créanciers ayant des obligations de l’Empire russe demandèrent la saisie de 240 tableaux à Paris[55]. En 2005, la compagnie Noga tenta de saisir en Suisse cinquante-cinq tableaux impressionnistes pour exécuter une sentence arbitrale contre la Russie qui avait refusé d’honorer un contrat[56]. En 2010, des ayants droit espérèrent satisfaire un jugement contre la Syrie qui avait commandité une attaque terroriste à Berlin en 1983 en tentant de saisir des pièces prêtées au Landesmuseum Württemberg à Stuttgart[57]. Et quant à l’entreprise Diag Human, elle voulut en 2011 mettre la main, en Autriche, sur des tableaux prêtés au Belvédère pour exécuter une sentence contre la République tchèque[58]. On le constate, ces tentatives d’exécution de jugement ou de sentence qui ne découlent pas d’un différend relatif au bien culturel revendiqué sont extrêmement imprévisibles.
3. Le droit d’auteur
Finalement, il existe une troisième situation qui peut donner lieu à une saisie, qui, à notre connaissance, n’a pas été étudiée en doctrine. En vertu des effets combinés de l’article 38(1) de la Loi sur le droit d’auteur et de l’article 517 du Code de procédure civile qui régit les saisies avant jugement, le détenteur d’un droit d’auteur peut saisir toute oeuvre qui est en contrefaçon de ses droits[59]. Évidemment, il s’agit d’un risque qui vise particulièrement l’art contemporain, car il faut qu’un droit d’auteur subsiste dans une oeuvre pour que ce recours existe. Au Canada, le droit d’auteur est valable pour la durée de la vie de l’artiste plus cinquante ans[60].
Après cet état des lieux, il est nécessaire de s’attarder aux deux dossiers les plus riches d’enseignement : Wally et Malewicz.
B. U.S. v. Wally : contourner l’immunité
Une première brèche aux lois d’immunité de saisie fut ouverte alors que le Musée Leopold organisa une tournée internationale de ses toiles qui s’arrêta sur les cimaises du Museum of Modern Arts (MoMA) en 1997[61].
1. Le Portrait de Wally d’Egon Schiele
Egon Schiele, enfant terrible de l’avant-garde viennoise, réalisa en 1912 l’une de ses plus extraordinaires toiles, le Portrait de Wally, représentant Walburga (Wally) Neuzil, qui fut à la fois modèle et compagne du peintre entre 1911 et 1915. Le portrait fut acheté par la galeriste juive autrichienne Lea Bondi Jaray en 1925. Après l’Anschluß, les biens de Bondi furent aryanisés et vendus à Friedrich Welz, un marchand d’art autrichien plus tard accusé de crimes de guerre. Bondi dut fuir avec son mari au Royaume-Uni peu de temps après.
Après la guerre, le Portrait de Wally fut toutefois confondu par le Bundesdenkmalamt, service chargé des restitutions, avec Bildnis seiner Frau (un portrait d’Edith Harms, qui épousa Egon Schiele en 1915) qui avait fait partie de la collection de Heinreich Rieger, un autre collectionneur viennois dont les biens avaient été aryanisés durant la guerre. Wally fut donc restitué par erreur aux héritiers de Rieger avec d’autres oeuvres ayant appartenu à ce dernier. Les héritiers de Rieger finirent par vendre plusieurs oeuvres, incluant Wally, au Belvédère.
Lea Bondi réussit donc à obtenir la restitution de l’entièreté de sa collection, sauf Wally[62]. Pour l’aider à récupérer ce tableau, Bondi demanda l’aide de Rudolf Leopold, qui amassait durant les années 1950 et 1960 une importante collection de peintures de Schiele. Leopold prit effectivement contact avec le Belvédère, mais s’arrangea toutefois pour obtenir Wally pour sa collection personnelle en échange d’un autre Schiele (Rainerbub) qui fait encore aujourd’hui partie de la collection du Belvédère. Bondi apprit l’existence de cet échange en 1957, mais ses efforts pour récupérer la toile restèrent vains. Elle décéda à Londres en 1969.
En 1994, Leopold céda sa vaste collection — plus de cinq mille objets — afin que soit créé le Musée Leopold, aujourd’hui à la fois l’un des principaux musées de Vienne et la plus importante collection de toiles de Schiele. Wally faisait partie du lot. Avec son pendant, un autoportrait de Schiele réalisé à la même époque, Wally devint rapidement une icône viennoise.
C’est donc cette toile au passé mouvementé qui fut envoyée, avec environ 150 autres oeuvres, dans une tournée internationale en 1997. Lors de l’arrêt de l’exposition au MoMA, les héritiers de Lea Bondi contactèrent sans succès le musée pour récupérer la toile. La famille se tourna vers les autorités new-yorkaises qui déposèrent un recours pénal afin de saisir le tableau en vertu du droit de l’État de New York. Le 7 janvier 1998, trois jours avant la fin de l’exposition et alors que les tableaux devaient être expédiés en Catalogne, le MoMA reçut un subpoena duces tecum qui lui demandait de comparaître avec Wally. Trois décennies après son adoption, il s’agit de la première affaire dans laquelle les tribunaux durent juger de la portée de la New York Arts and Cultural Affairs Law (NYCAL) régissant les immunités de saisie, la loi qui est l’équivalent de l’article 697 du Code de procédure civile.
L’envoi de ce subpoena marqua le début de douze ans de procédures judiciaires, période pendant laquelle la toile demeura enfermée dans un entrepôt. Il est intéressant de se pencher sur cette saga, car les différents jugements rendus permettent de décortiquer les situations où l’immunité de saisie de l’État de New York permit, ou ne permit pas, de protéger le tableau. La première série de jugements porte sur une procédure en vertu des lois criminelles de l’État de New York, la seconde, sur une procédure en vertu du droit fédéral.
2. La procédure criminelle new-yorkaise
En réaction à l’envoi du subpoena, le MoMA déposa immédiatement une requête pour le faire invalider, prenant appui sur les dispositions de la NYCAL, ainsi rédigées :
12.03 No process of attachment, execution, sequestration, replevin, distress or any kind of seizure shall be served or levied upon any work of fine art while the same is enroute to or from, or while on exhibition or deposited by a nonresident exhibitor at any exhibition held under the auspices or supervision of any museum, college, university or other nonprofit art gallery, institution or organization within any city or county of this state for any cultural, educational, charitable or other purpose not conducted for profit to the exhibitor, nor shall such work of fine art be subject to attachment, seizure, levy or sale, for any cause whatever in the hands of the authorities of such exhibition or otherwise [nos soulignements].[63]
Le 13 mai 1998, la Cour suprême de New York invalida le subpeona, jugeant que celui-ci constituait un type de saisie prohibée par la NYCAL, qui empêchait « any kind of seizure », incluant les saisies criminelles[64]. Après avoir analysé la portée de la loi, la juge conclut que les héritiers ne pouvaient profiter d’une exposition temporaire pour faire valoir leurs droits, fussent-ils légitimes, l’État de New York ayant, en effet, déterminé que l’intérêt public devait l’emporter sur une réclamation privée :
The Legislature determined, in balancing policy considerations, that it was in the state’s interest to protect cultural institutions and their ability to encourage the exchange of art for the benefit of the entire populace over the needs of a few individuals to recover their art, even if the art was stolen.[65]
La division d’appel de la Cour suprême de l’État infirma cette décision le 16 mars 1999[66], jugeant que la NYCAL n’avait pas de portée en droit criminel. Cependant, la Cour d’appel de l’État de New York intervint et, à six voix contre une, accueillit finalement la cassation du subpoena. La majorité écrivit :
We fully appreciate the profound and opposing interests presented by this case. The District Attorney has a constitutional responsibility to identify and prosecute criminal activity, while the Museum seeks to make works of art from all over the world available to New Yorkers. These two significant interests have come into conflict as a result of Nazi atrocities. The Legislature of this State made a significant policy decision 30 years ago when it enacted the predecessor to section 12.03. As a court of law, we cannot alter that policy under the guise of legislative interpretation. The language of the statute is clear, the intent of the Legislature manifest.[67]
Les tribunaux new-yorkais jugèrent donc que la loi prévenait à la fois les saisies civiles, mais également les saisies criminelles. Cependant, les autorités n’en restèrent pas là.
3. La procédure en vertu de la loi fédérale
Le lendemain de ce jugement, alors que la toile se trouvait toujours aux États-Unis, ce fut au tour du Procureur général des États-Unis et des services douaniers américains de saisir le tableau. Cette fois-ci, ce ne fut pas le droit criminel de l’État de New York, mais une loi fédérale, la National Stolen Property Act[68], qui fut invoquée. L’immunité de l’État de New York ne pouvait s’appliquer à une loi fédérale.
Après coup, on pourrait se demander pourquoi le MoMA se contenta de la protection de la loi de New York et ne demanda pas la protection de la loi fédérale. Il semble que c’était la pratique à l’époque, étant donné que la NYCAL protégeait automatiquement les oeuvres, et alors qu’une demande était nécessaire auprès des autorités fédérales pour qu’un décret soit publié[69]. Une double immunité de saisie à la fois en vertu de la loi de New York et du droit fédéral aurait vraisemblablement empêché toute saisie[70].
Quoi qu’il en soit, une requête en rejet fut déposée par le Musée Leopold contre cette seconde action. Cette requête fut accordée le 19 juillet 2000 par la Cour du district[71]. En réponse, les autorités demandèrent avec succès de déposer une nouvelle procédure dans le dossier[72]. Après ce dépôt, une nouvelle demande en rejet du Musée Leopold fut cette fois rejetée[73]. Puis, en 2009, dans un jugement très favorable au poursuivant, la Cour ordonna la tenue d’un procès sur la seule question de savoir si, au moment de l’importation de la toile aux États-Unis, le docteur Leopold savait que la peinture avait été mal acquise[74].
Mais le procès n’eut jamais lieu. Le docteur Leopold décéda le 29 juin 2010, moins d’un mois avant le début des audiences. Le Musée Leopold accepta de verser 19 millions de dollars aux héritiers de Lea Bondi, de poser dorénavant une fiche près du tableau pour expliquer sa provenance et d’exposer d’abord le tableau au Museum of Jewish Heritage avant qu’il ne retournât en Autriche[75].
Deux grandes leçons peuvent être tirées du dossier Wally. Primo, dans un système fédéral, il est essentiel que des garanties soient accordées par chacun des paliers de gouvernement. Dans le dossier Wally, c’est par négligence que le décret fédéral n’avait pas été demandé. Or, au Canada, il n’existe tout simplement pas de mécanisme fédéral dont les musées pourraient se prévaloir. Ensuite, les dispositions de protection des oeuvres sont des exceptions au principe général qui veut que les justiciables aient accès aux tribunaux. Et, devant une situation d’injustice historique, les tribunaux peuvent être tentés d’interpréter ces dispositions de manière restrictive, comme ce fut le cas de la division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York[76]. En conséquence, une loi d’insaisissabilité efficace devrait avoir une portée large et non ambiguë.
C. Malewicz v. Amsterdam : poursuivre le prêteur
Une seconde brèche — moins médiatisée, bien que plus considérable quant à ses conséquences juridiques — fut ouverte par une autre poursuite, celle de la succession du peintre Kasimir Malevitch (1879–1935) contre la Ville d’Amsterdam. En 2003 et 2004, quatorze oeuvres de Malevitch furent prêtées par le Stedelijk, principal musée d’art moderne d’Amsterdam, au Guggenheim de New York et à la Menil Collection de Houston pour une exposition temporaire[77].
Ces tableaux avaient une histoire aussi mouvementée que celle du Portrait de Wally. Malevitch, artiste d’avant-garde russe et père du suprématisme, exposa une centaine d’oeuvres à Berlin en 1927. Il dut rentrer rapidement en Union soviétique, mais il ne put rapatrier ses oeuvres avec lui, étant donné qu’on y condamnait l’art abstrait. Après la prise de pouvoir par les nazis, ses oeuvres furent également interdites en Allemagne. Elles passèrent donc entre les mains d’amis de l’artiste, d’abord celles d’Alexander Doner, directeur du Landesmuseum d’Hanovre, puis celles d’Hugo Haring, qui cacha les tableaux durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, ne se considérant pas comme leur propriétaire légitime, Haring refusa de vendre les tableaux.
Malade, Haring accepta finalement en février 1956 de prêter les tableaux au Stedelijk, mais pas de les vendre. Dans leurs communications subséquentes, les représentants de Haring — et non Haring lui-même — suggérèrent que ce dernier était désormais propriétaire des oeuvres par propriété acquisitive. Le musée conclut donc un second prêt avec une option d’achat avec les représentants de Haring en novembre 1956. Celui-ci mourut en 1958 et le musée exerça son option d’achat. Étant donné qu’il ne s’était jamais considéré propriétaire des oeuvres, il semble que ses proches aient profité de ses ennuis de santé pour obtenir le produit de la vente des tableaux.
En 1996, les héritiers de l’artiste demandèrent une première fois la restitution des oeuvres. La Ville d’Amsterdam refusa en 2001. Les quatorze oeuvres prêtées à New York et à Houston en 2003 par le Stedelijk faisaient partie des quatre-vingt-quatre peintures acquises en 1958. Elles étaient protégées par un décret d’immunité de saisie en vertu de la loi fédérale[78]. Ce mécanisme fédéral est assez proche de celui en vigueur au Québec. Il nécessite la publication d’un avis de la part du gouvernement fédéral, ce qui empêche ensuite toute saisie lorsque les oeuvres sont sur le territoire américain.
La particularité de cette poursuite est que les héritiers du peintre ne réclamèrent pas la saisie des oeuvres; ils poursuivirent plutôt la Ville d’Amsterdam pour des dommages pécuniaires équivalents à la valeur des tableaux[79]. La poursuite fut déposée deux jours avant la fin de l’exposition à Houston. Le dossier chemina donc alors que les oeuvres étaient de retour à Amsterdam.
La Ville d’Amsterdam déposa deux requêtes en rejet dans ce dossier, qui furent rejetées respectivement en 2005 et en 2007. Amsterdam fut à chaque occasion appuyée par le Procureur général des États-Unis. Étant donné que les peintures étaient à la fois propriétés publiques néerlandaises et protégées par la loi fédérale d’immunité de saisie, la Ville d’Amsterdam invoqua ces deux arguments pour faire rejeter la demande. Même si l’essentiel de ces décisions traite de l’immunité souveraine, nous laisserons de côté cet aspect — malgré le caractère extrêmement discutable du raisonnement — pour nous attarder aux propos concernant l’immunité de saisie.
La Cour de district des États-Unis pour le District de Columbia rejeta la première requête en rejet en mars 2005 étant donné l’absence au dossier de plusieurs éléments factuels qui auraient été nécessaires pour déterminer si l’une des exceptions à la loi sur l’immunité souveraine américaine pouvait s’appliquer[80]. Cependant, les principales affirmations du raisonnement concernant l’immunité de saisie méritent d’être citées au long. Loin de constituer un simple entrebâillement, elles laissent la porte grande ouverte à une poursuite contre un prêteur qui jouit par ailleurs de l’immunité de saisie en bonne et due forme :
Clearly, as the United States and the City argue, § 2459 protects loaned artworks and cultural items from seizure or judicial process “for the purpose or having the effect of depriving such [U.S. cultural] institution … of custody or control of such object.” 22 U.S.C. § 2459. A litigant with a claim against a foreign sovereign may not seize that sovereign’s property that is in this country on a cultural exchange and the litigant may not serve the receiving museum with judicial process to interfere in any way with the physical custody or control of the artworks. The Malewicz Heirs have tried to do neither. They have sued the City of Amsterdam, not the Guggenheim or the Menil Collection. Had this lawsuit begun and concluded before the Malewicz Collection left this country, no order of this Court would have, or could have, affected the custody or control that the museums (and carriers) exercised over the artworks. The Immunity from Seizure Act deprives all U.S. courts from taking any action to obtain physical custody of the Malewicz Collection or other cultural icons granted immunity while in this country.
[…]
Because the Malewicz Heirs are not seeking judicial seizure of the artworks, the City’s and the United States’ reliance on § 2459 is misplaced. Immunity from seizure is not immunity from suit for a declaration of rights or for damages arising from an alleged conversion […] [italiques dans l’original, nos soulignements].[81]
L’immunité de saisie n’empêche donc pas le dépôt d’une poursuite en déclaration de titre ou en dommages. Les conséquences de ce jugement sont qu’après un procès sur le fond dans l’État où l’oeuvre fut exposée, le requérant pourrait tenter de faire exécuter ce jugement partout où est exposé le tableau, incluant le lieu usuel d’exposition.
La Ville d’Amsterdam déposa des éléments de preuve supplémentaires au dossier, menant au dépôt d’une seconde requête en rejet de la ville qui fut également rejetée en 2007[82]. Le jugement porte, encore une fois, essentiellement sur l’immunité souveraine. Cependant, un passage du mémoire d’amicus curiae soumis par le Procureur général des États-Unis indique assez clairement la position du gouvernement américain quant à la très large protection dont les prêteurs devraient jouir :
Congress thus sought to assure foreign lenders that exhibiting their artwork would not provide a basis of jurisdiction in the United States. As the Senate Report accompanying the legislation observed, the statute was intended “to encourage the exhibition in the United States of objects of cultural significance which, in the absence of assurances such as are contained in the legislation, would not be made available.”
[…]
As Representative Rogers explained, the bill was designed to assure the foreign lender that it could lend artwork to the United States without incurring the risk that the artwork would be seized or the lender would become subject to suit:
If a foreign country or an agency should send exhibits to this country in the exchange and cultural program and someone should decide that is necessary for them to institute a lawsuit against that particular country or those who may own the cultural objects, the bill would assure the country that if they send the objects to us, they would not be subjected to a suit and an attachment in this country.
[…]
The enactment of § 2459 addressed this uncertainty by providing foreign lenders with the assurance that the temporary loan of artwork under the terms of the statute would not subject them to litigation [soulignements dans l’original, notes omises].[83]
Après ces deux jugements, on arriva finalement, le 23 avril 2008, à un accord de règlement à l’amiable avant que la cause ne cheminât. Sur les quatre-vingt-quatre toiles que le musée possédait, cinq furent rendues aux héritiers.
Comme dans le cas du Portrait de Wally, il n’est évidemment pas possible de savoir quel aurait été le jugement si la cause s’était rendue au fond. Mais l’intérêt d’une loi d’immunité de saisie est qu’elle devrait justement constituer une fin de non-recevoir à toute poursuite afin d’éviter la tenue de procédures coûteuses. La décision de 2005 dans l’affaire Malewicz constitue un précédent dangereux qui indique qu’il est possible de poursuivre un prêteur étranger en dommages, et ce, malgré l’impossibilité de saisir les biens culturels en tant que tels. Il semble que, de part et d’autre de l’Atlantique, cette décision, et surtout l’idée que l’immunité de saisie n’empêche pas pour autant une poursuite civile en déclaration de titre ou en dommages, n’ait pas été véritablement comprise :
Also, during the training courses I provide for museum directors and registrars, it generally turns out, that one does not realise that while receiving immunity from seizure, it may well be possible that a foreign court has jurisdiction to adjudicate a case. Museums and State entities generally do not have in mind that something like the Malewicz case may actually happen to them.[84]
Moins connue que le dossier du Portrait d’Adèle Bloch-Bauer sur l’immunité souveraine ou celui du Portrait de Wally, cette décision devrait pourtant mériter toute notre attention. Les prêteurs canadiens devraient y songer avant d’envoyer une oeuvre d’art ou un objet culturel ou historique temporairement aux États-Unis, surtout en raison du fait que la Cour suprême canadienne adopte une politique extrêmement libérale de reconnaissance des jugements qui émanent des États-Unis[85]. Quant aux institutions québécoises, elles trouvent ici des raisons de douter de la protection accordée par le Code de procédure civile alors que l’article 697 est situé dans la section traitant de l’exécution des jugements, et non dans celle du dépôt d’une action en justice.
Avant d’aborder les modifications nécessaires au régime québécois d’immunité de saisie, nous traiterons des raisons qui justifient d’accorder une large immunité aux prêteurs.
III. Noli me tangere : arguments à l’encontre de la saisie d’un bien culturel exposé hors de sa juridiction habituelle
Est-il nécessaire que les États accordent une large immunité, véritable sauf-conduit pour biens culturels, afin d’assurer la bonne tenue d’expositions temporaires? Les opposants à l’immunité de saisie font généralement valoir que lorsqu’il n’est pas possible pour une personne de revendiquer ses droits dans une juridiction, ce serait ajouter à l’injustice que de l’empêcher d’intenter un recours lorsqu’un objet se trouve finalement dans une autre juridiction où le système de justice lui est plus favorable[86]. Ils s’appuient sur le fait que le libre accès aux tribunaux est une liberté fondamentale, déterminante pour le respect de la primauté du droit[87]. D’autres arguent que le fait d’accorder l’immunité constitue une validation implicite de crimes passés[88]. Il s’agit d’arguments sérieux.
Les victimes de spoliation inspirent effectivement la plus grande des sympathies, d’autant plus que les vols d’oeuvres d’art ont souvent accompagné les pires campagnes de persécution. Nous ne saurions insister suffisamment sur la nécessité d’instaurer des mécanismes de restitution équitables dans la juridiction où réside habituellement une oeuvre d’art ou un objet culturel ou historique. De larges progrès ont déjà été réalisés. Une prise de conscience des autorités et de l’opinion publique depuis les années 1990 a déjà permis de débloquer la situation dans de nombreuses juridictions[89].
L’objectif de cette section est de détailler les raisons pour lesquelles saisir un bien culturel lors d’une exposition temporaire dans une autre juridiction que celle où l’objet est habituellement entreposé est une fausse bonne idée. Nous détaillerons deux argumentaires. Le premier, plus théorique, repose sur la place particulière de l’objet d’art dans la collectivité. Le second, pragmatique, repose sur les effets pratiques néfastes des tentatives de saisie.
A. Le public et le privé
Le titre du présent article, « Noli me tangere », fait évidemment référence à l’une des scènes les plus représentées du Nouveau Testament. Le Christ, ressuscité, ordonne à Marie-Madeleine : « Ne me touche pas ». L’incarnation humaine, de chair, fait place à la réincarnation, à la vie éternelle. Pour les chrétiens, le Christ est désormais et pour toujours d’une substance différente. Ainsi, toute justification du régime d’exception pour les objets culturels doit partir du constat qu’un lamassu assyrien, qu’un kouros grec, que des mosaïques byzantines, qu’un Raphaël ou qu’un Chardin ne devrait recevoir le même traitement qu’un objet du quotidien. La qualification de bien mobilier n’est tout simplement pas suffisante pour rendre compte de l’importance qu’ont ces oeuvres dans les sociétés humaines. Ou pour le dire avec autrement plus d’élégance :
Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial.[90]
Ces oeuvres, témoins du génie passé et liens entre les générations, occupent une place si particulière dans la vie de la communauté que des arrangements juridiques sont nécessaires pour assurer leur préservation, leur étude et leur diffusion. Dans ces circonstances, un différend privé concernant la propriété d’un bien culturel revêt forcément une dimension publique.
De nombreux législateurs reconnaissent la spécificité de l’art étant donné qu’ils protègent les prêts d’oeuvres destinées à des expositions. Par exemple, le rapport du gouverneur Nelson Rockefeller, présenté en appui à la promulgation de la NYCAL, souligne bien que la loi a pour objectif de favoriser la tenue de grandes expositions dans les institutions culturelles de l’État :
Many of the most important events of the artistic year through the State consist of special shows devoted to a special theme … These exhibitions … rely … on loans of works of art for their success. The promotion and continuation of these events is necessary to maintain New York’s status as the art center of the Nation and is beneficial to the general cultural atmosphere of the State … .
The bill, by exempting such works of art from legal process where their presence in the State of New York is solely by the generosity of the exhibitor and not for any commercial purpose, will go far to allay the fears of potential exhibitors and enable the State of New York to maintain its pre-eminent position in the arts.[91]
L’intervention d’un député de la majorité néo-démocrate au Manitoba, en 1976, saisit les raisons pour lesquelles il est préférable d’adopter des mesures d’immunité et de favoriser l’accès à la culture pour un large public, même si cela risque de priver un particulier d’une revendication légitime :
A very fine Conservative historian was Jakob Burckhardt, a Swiss historian, who had a great great respect for art, for the artistic tradition of Western Europe. This may be something that is not very congenial to the members opposite but I have a great deal of respect for his opinion in this area. I’d like to just read one little excerpt. Burckhardt never closed his mind to new possibilities, unlike members opposite. But he insisted—and this was the driving force of his study and teaching of history—to preserve European culture one must first be aware of it.
[…]
You who vote against this bill will be denying some people in this province a chance to be aware of the great tradition of art in Western Europe. […] I want to see who is going to vote against this bill, who is going to vote against it, who is going to deny a far far more fundamental right than you say we are violating in this bill. That is the right of the people of Manitoba to see this great collection of art.[92]
Autrement dit, il ne s’agit donc pas d’attaquer la légitimité des revendications individuelles sur un objet culturel, mais d’opérer une hiérarchie entre le bien public et le bien privé dans le contexte très particulier des échanges culturels.
Même si le débat fut bref au Québec et en France en raison de l’absence d’opposition et de l’urgence de légiférer, l’intervention du député Charron, qui appuya à l’Assemblée nationale le projet de loi de 1976 au nom du Parti québécois, rejoint aussi cette idée. L’importance des échanges culturels et l’intérêt qu’a le public d’admirer les grandes oeuvres doivent primer sur des revendications individuelles :
II va de soi que des pays qui nous font l’honneur, à l’occasion de permettre à des Québécois d’admirer des oeuvres à caractère universel par leur conception comme dans leur réalisation ne soient aucunement soumis à des tracasseries juridiques qui pourraient émaner de conflits absolument étrangers à la volonté des deux [É]tats qui collaborent à l’organisation de l’exposition. Je veu[x] dire, par exemple, que si des particuliers québécois, pour une raison ou une autre, se sentaient légitimés d’exiger des poursuites judiciaires pouvant conduire jusqu’à la saisie de certaines oeuvres d’art prêtées dans tout autre contexte et toute autre occasion, que ces particuliers se voient privés de ce droit, surtout lorsque les [É]tats consentants à l’organisation de l’exposition n’en ont été aucunement prévenus. C’est dans ce sens qu’est l’intention du projet de loi tel que me l’avait annoncé et présenté le ministre des Affaires culturelles, et c’est exactement pour cette raison que nous y souscrivons.[93]
Quant à Jean-Pierre Camoin, sénateur RPR (Rassemblement pour la République) qui défendit l’immunité en 1994 en France, il le fit également au nom de l’intérêt public :
[Après la tentative de saisie des héritiers Chtchoukine au centre Georges-Pompidou, la] Réunion des musées nationaux a rencontré de très grandes difficultés dans le cadre des discussions préparatoires à l’organisation de l’exposition Impressionnisme : les origines et de l’exposition Les Cathédrales de Monet.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que soient également compromises des demandes de prêts formulées auprès de musées russes pour les prochaines grandes expositions, dont une rétrospective de l’oeuvre de Cézanne.
Tous les tableaux concernés sont des chefs-d’oeuvre, dont la présence à l’exposition est essentielle pour la compréhension de l’oeuvre de l’artiste. Il serait extrêmement préjudiciable que le public en soit privé.
Enfin, pour l’organisation de l’exposition Derain par le Musée d’art moderne de la ville de Paris, le prêt de trois tableaux provenant du musée Pouchkine et de neuf tableaux du musée de l’Ermitage est actuellement suspendu [nos soulignements].[94]
Les musées sont parmi les principaux dépositaires des objets qui permettent aux citoyens de mieux comprendre la richesse de leur histoire et de leur culture. Les grandes expositions temporaires permettent de faire découvrir à des milliers de visiteurs des pièces qu’ils auraient difficilement pu admirer autrement. Il s’agit également de moments privilégiés durant lesquels des objets culturels ou historiques normalement éloignés peuvent être confrontés et étudiés, permettant de faire avancer les connaissances sur un artiste, une période ou une région. Qui plus est, le contact avec les arts constitue une voie privilégiée de formation pour les artistes.
Les lois d’immunité de saisie sont par ailleurs en adéquation avec le droit international qui reconnaît l’importance des échanges culturels et de l’accès à la culture, notamment dans la Charte des Nations-Unies[95], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[96] ou la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles[97].
Le préambule de l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel est fort éloquent :
la diffusion la plus large des diverses formes d’expression des civilisations [est une condition impérieuse] tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contrib[ue] ainsi au maintien de la paix dans le monde.[98]
L’article III de ce même accord favorise non seulement la mobilité des collections, mais prévoit également que les pays hôtes peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux oeuvres de quitter le territoire à la fin de l’exposition.
Quant à la Recommandation concernant l’échange international de biens culturels, elle fait de l’échange des biens culturels un élément fondamental de la compréhension entre les peuples :
Considérant que l’élargissement et le renforcement des échanges culturels, en permettant une meilleure connaissance des réalisations respectives dans les divers domaines de la culture, contribueront à un enrichissement des différentes cultures fondé sur le respect de l’originalité de chacune d’entre elles et sur celui de la valeur des cultures des autres peuples, qui constituent le patrimoine culturel de l’humanité tout entière,
Considérant que la circulation des biens culturels, dès lors qu’elle est assurée dans des conditions juridiques, scientifiques et techniques propres à empêcher les trafics illicites et la détérioration de ces biens, est un moyen puissant de compréhension et d’appréciation entre les nations […] [soulignements dans l’original].[99]
Et devant l’augmentation spectaculaire des demandes de saisies, l’International Law Association adopta, en 2014, un projet de convention internationale pour assurer la protection des objets culturels lors de prêts temporaires[100]. Loin d’être un accident historique, l’article 697 du Code de procédure civile s’insère dans un corpus de plus en plus important de droit international et de droit interne qui encourage et protège les échanges culturels.
Il faut finalement ajouter que l’octroi de l’immunité ne constitue pas une validation implicite de quelque crime que ce soit, mais une réalisation des limites d’un système juridique éloigné de la réalité des événements qu’il serait appelé à juger. Un juge de la Cour supérieure du Québec est mal placé pour décider du droit de propriété d’une oeuvre spoliée par l’Armée rouge en Allemagne en 1945 ou prise par le Kuomintang en Chine continentale en 1949. La rapidité et la recherche du résultat immédiat ne sont pas toujours saines lorsque nous avons affaire à des processus historiques aussi complexes[101]. Finalement, nos préférences sur ces questions importent assez peu. Malgré l’ampleur des injustices passées, nos tribunaux ont difficilement la légitimité nécessaire pour profiter d’une exposition temporaire afin de s’immiscer dans ces débats. Seul un processus de réconciliation dans les pays concernés ou entre les pays concernés, lorsque le temps sera venu, pourra véritablement guérir les plaies de l’histoire[102].
B. Considérations pratiques
Non seulement permettre les recours freinerait les échanges culturels et irait à l’encontre de l’intérêt du public, mais la démultiplication des poursuites aurait des effets pratiques néfastes. D’abord, l’expérience démontre que ce genre de poursuite produit rarement une restitution. Au mieux, les ayants droit obtiennent un règlement à l’amiable qui leur donne quelques toiles comme dans l’affaire Malewicz, ou une somme d’argent, comme dans l’affaire Wally. L’une des rares saisies à l’étranger qui eut lieu sans heurts pour les ayants droit est celle d’une peinture de Girolamo Romanino saisie par les nazis à Paris en 1941 et entrée subséquemment dans les collections publiques italiennes. Lors d’une exposition en Floride, en 2011, la peinture fut saisie et restituée alors que l’Italie n’émit aucune contestation[103]. Ce cas peut cependant difficilement constituer un précédent concluant étant donné qu’aucun décret d’insaisissabilité n’avait été demandé.
Les effets négatifs de ces poursuites sont, eux, bien réels. Les garanties légales ont un impact important sur le comportement du prêteur. Faut-il rappeler que l’exposition soviétique de 1976 aboutit à Montréal, et non à Toronto, parce que le législateur québécois fut en mesure d’accorder des garanties que l’Ontario ne put consentir? Toute tentative de saisie, qu’elle soit fructueuse ou non, augmente la méfiance chez les prêteurs. Même s’il est très difficile d’établir combien de prêts furent annulés pour cause d’absence de garantie légale, et que nous pouvons raisonnablement supposer que seule une minorité des refus est publicisée, nous recensons néanmoins de nombreux exemples. En 1994, la Russie refusa de prêter des Monet pour une exposition à Rouen alors que la France ne s’était pas encore dotée de loi sur l’immunité des oeuvres d’art[104]. En 1998, des prêteurs privés refusèrent d’envoyer des Bonnard au MoMA après la saisie surprise du Portrait de Wally[105]. Entre 1998 et 2006, en l’absence de protection, de nombreux prêts furent refusés au Royaume-Uni par la France, la Russie, la Roumanie et Taïwan, ce qui entraîna même l’annulation pure et simple d’une exposition sur l’art chinois au British Museum[106]. En 2000, l’exposition de La Danse de Matisse à Milan fut annulée en raison d’une menace de saisie[107]. En 2003, une galerie américaine refusa un prêt à l’Autriche[108]. La même année, lors d’une exposition temporaire à New York, le Mont Sinaï du Greco fit l’objet d’une demande de saisie rapidement rejetée par les tribunaux new-yorkais. Cela mena le prêteur, un musée crétois, à retirer le tableau de l’exposition itinérante qui devait s’arrêter à Londres plutôt que de devoir affronter une nouvelle contestation[109]. Avant l’adoption de la loi israélienne en 2007, des conservateurs eurent de la difficulté à attirer des expositions[110]. En 2011, la République tchèque rapatria des dizaines de tableaux conservés à l’étranger — dont un Manet au Musée d’Orsay — pour éviter l’exécution d’une sentence arbitrale[111]. La même année, des tableaux ne purent être envoyés en Australie, qui n’offrait alors aucune protection, pour une exposition sur l’art moderne allemand[112]. Finalement, les demandes d’une communauté aborigène australienne pour saisir des écorces d’arbre décorées, qui sont au Royaume-Uni depuis le XIXe siècle, menèrent à une diminution des prêts vers l’Australie[113].
Les procédures empêchent les tableaux d’être vus pendant une très longue période : sept ans dans le cadre d’une toile revendiquée en Allemagne par le Prince du Liechtenstein (1991–1998)[114] ou douze ans pour le Portrait de Wally (1998–2010)[115]. Qui plus est, et comme l’a tristement démontré l’affaire Noga, les locaux de police employés pour entreposer les biens saisis ne sont pas toujours appropriés pour la conservation des oeuvres d’art[116].
Le prêteur, même s’il souhaite qu’une oeuvre soit admirée par un large public, accepte déjà de nombreux risques, dont ceux liés au transport. Ce prêteur ne devrait ni avoir à analyser les risques juridiques du prêt ni avoir à défrayer les coûts d’une contestation judiciaire.
Il est, en dernière analyse, difficile d’affirmer que l’immunité de saisie cause un préjudice à un ayant droit. Ce dernier n’est pas en meilleure position pour réclamer un tableau exposé temporairement et protégé par une disposition anti-saisie que si ce tableau n’avait pas quitté son lieu habituel d’exposition. Le prêt d’une oeuvre couvert par l’immunité place probablement l’ayant droit dans une situation plus favorable. L’exposition publique peut permettre de localiser la provenance d’un tableau litigieux et de publiciser les revendications d’éventuels ayants droit beaucoup plus efficacement que si l’oeuvre ou l’objet n’avait pas voyagé. Ce fut le cas en 1998 lorsqu’un Monet spolié fut identifié comme tel lors d’une exposition temporaire à Boston[117].
Par ailleurs, on ne saurait prétendre que l’immunité de saisie laisserait la porte ouverte à tous les excès. D’abord, et malgré l’augmentation des litiges, les cas de contestation de titre de propriété restent exceptionnels lorsque l’on considère l’ensemble des prêts muséaux effectués dans le monde. Ensuite, ces demandes de saisies peuvent être effectuées, comme nous l’avons vu, pour exécuter un jugement qui n’a aucun lien avec l’oeuvre ou l’objet revendiqué — mise à part l’identité du débiteur — ou sur la base d’éléments de preuve inconnus de l’institution au moment d’accepter le prêt. Mais surtout, les musées adhèrent à des codes d’éthique tel le Code de déontologie pour les musées de l’International Council of Museums (ICOM), et sont bien au fait des problématiques liées à la provenance des objets qu’ils exposent[118]. L’immunité de saisie n’a pas pour objet de permettre à des conservateurs d’effectuer des opérations à l’éthique douteuse, mais d’éviter le risque de judiciarisation en dépit des efforts déployés pour assurer la bonne tenue d’une exposition.
IV. Pistes de réformes
Après avoir esquissé le portrait de la situation actuelle, cette dernière section se propose d’aborder certains thèmes plus ciblés sous forme de recommandations susceptibles de perfectionner la loi québécoise. Certaines mises en garde contre une protection trop large seront formulées.
A. L’immunité contre toute poursuite
Le principal talon d’Achille du régime actuel est qu’il prévient la saisie, mais non le dépôt d’une demande en jugement déclaratoire sur la propriété de l’objet ou une réclamation monétaire de style Malewicz. L’emplacement de l’article 697 du Code de procédure civile ne laisse aucun doute quant à la portée limitée du régime québécois. Situé dans le Livre VIII sur l’exécution des jugements, il fait partie d’une série d’articles (694 à 701) qui listent les biens qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie. Le Code de procédure civile ne contient aucun mécanisme pour empêcher le dépôt d’une demande en dommages-intérêts ni en jugement déclaratoire de droits de propriété. Bien après le départ d’une oeuvre ou d’un objet culturel du territoire, le prêteur et l’institution pourraient donc être englués dans une poursuite.
Aucune des cinq lois provinciales canadiennes n’empêche le dépôt d’une action en dommages. Cependant, le Manitoba, l’Ontario et l’Alberta préviennent le dépôt de toute action qui pourrait mener à la revendication d’un bien culturel, ce qui assure une protection plus importante que celle du Québec qui porte uniquement sur les saisies[119].
Nous doutons fortement qu’il s’agisse d’un choix conscient du législateur. À vrai dire, personne ne semble avoir pensé à cette possibilité de poursuite pécuniaire avant Malewicz. La lecture du débat parlementaire de 1976 indique que le législateur voulait éviter au prêteur « des tracasseries juridiques » et empêcher des « poursuites judiciaires pouvant conduire jusqu’à la saisie de certaines oeuvres d’art prêtées »[120]. La même situation se produisit aux États-Unis lors du débat du projet de loi en 1965. Le bref rapport de la Chambre des représentants reprit des lettres envoyées par le département d’État et de la Justice en faveur de l’adoption de la loi[121] et la transcription du débat devant la Chambre tient dans une page et porte uniquement sur l’effet utile du projet de loi. Pour en défendre l’adoption, le représentant Byron Rogers expliqua qu’il fallait s’assurer que les prêteurs « will not subject themselves to lawsuits in this country » [nos soulignements][122], alors que dans les faits, et comme l’a démontré Malewicz, c’est bien une immunité de saisie qui se retrouve dans la loi.
Ainsi, au Québec comme aux États-Unis, malgré l’intention annoncée d’accorder une large protection au prêteur, le législateur n’a pas véritablement envisagé la possibilité d’une poursuite pécuniaire. Des lois accordant une immunité imparfaite furent adoptées. Le Code de procédure civile devrait être amendé afin de déclarer irrecevable le dépôt de toute procédure tant contre le prêteur que contre l’institution hôte en lien avec la présence d’un bien culturel sur le territoire, ce qui empêcherait tant les saisies que les jugements déclaratoires et les réclamations pécuniaires, tout en préservant les recours actuels pour exécuter des contrats de transport, d’entreposage ou d’exposition[123].
B. Les musées ne font pas qu’exposer
Il serait souhaitable d’étendre les raisons pour lesquelles l’immunité peut être accordée afin d’inclure les situations de recherche, de restauration, de protection ainsi que le transit sur le territoire québécois.
Bien que le seul cas de figure qui donne à l’heure actuelle ouverture à la protection de l’article 697 du Code de procédure civile soit l’exposition d’oeuvres d’art, ces oeuvres peuvent parvenir au Québec pour d’autres raisons. Les musées, les bibliothèques, les centres de conservation et les centres universitaires peuvent entreposer des oeuvres en vue d’une acquisition, d’étude ou de restauration[124]. Prenons l’exemple de la découverte de ce qui semblait être la Cage de la Corriveau dans un musée au Massachusetts. Le Musée de la civilisation voulut effectuer des expertises sur l’objet. On l’emprunta pour l’exposer du 3 au 6 octobre 2013 à Lévis, puis du 16 au 23 novembre 2013 à Québec. Pour ces 12 jours d’exposition, le musée obtint une immunité pour une durée de près de deux ans[125]!
Il n’est d’ailleurs pas exceptionnel qu’une pièce demeure après une exposition et qu’elle fasse l’objet de restauration. On peut même imaginer que le Centre de conservation du Québec ait besoin de protection pour un projet spécial. Il s’agit de situations pour lesquelles la loi actuelle est inadaptée. Une situation analogue eut lieu aux États-Unis où des manuscrits retrouvés à Bagdad durant la Guerre d’Irak durent être envoyés d’urgence aux États-Unis pour restauration. Pour contrer les risques de saisie, le gouvernement obtint l’immunité pour les archives en promettant d’organiser, éventuellement, mais sans plus de détails, une exposition[126]. Bien que la recherche et la restauration soient des activités légitimes qui devrait être protégées, il s’agit d’utilisations du système d’immunité qui sont aux marges de la légalité en raison du libellé actuel de l’article 697 du Code de procédure civile, ce qui pourrait donner lieu à une contestation judiciaire.
Ensuite, les guerres civiles qui ont secoué le Moyen-Orient ces dernières années nous rappellent la fragilité du patrimoine pendant les conflits armés. Pour tenter d’aider lors de ces situations difficiles, la Suisse instaura, en 2014, un mécanisme qui permet à un État étranger d’employer un refuge suisse en période de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. Cette mise à disposition est assortie d’une protection contre toute revendication de tiers[127]. La France et le Royaume-Uni se sont pourvus de mécanismes analogues, respectivement en 2016[128] et en 2017[129]. Le Québec devrait donner des garanties analogues.
Finalement, l’article 697 du Code de procédure civile vise uniquement les oeuvres qui sont exposées publiquement au Québec. Ainsi, un musée situé à Ottawa ne pourrait protéger des oeuvres qui arrivent à Montréal et qui transitent sur le territoire québécois. La loi ontarienne n’est pas beaucoup plus utile aux institutions québécoises qui souhaiteraient employer l’aéroport d’Ottawa ou celui de Toronto. En matière de bon voisinage, il apparaît nécessaire que les différentes provinces prévoient des protections réciproques pour les objets culturels qui transitent sur leur territoire[130].
C. Les oeuvres d’origine québécoise
L’immunité devrait-elle être valable pour toutes les oeuvres, ou devrait-on faire des exceptions? Le Québec est en effet l’une des rares juridictions où une exception importante est prévue, à savoir pour les oeuvres qui « ont été, à l’origine, conçu[e]s, produit[e]s ou réalisé[e]s au Québec »[131].
Selon les différentes réalités historiques, certains pays incluent des exceptions circonstancielles dans leur loi. En Allemagne, le gouvernement annonça qu’aucune protection ne pourrait être octroyée aux oeuvres ayant fait partie des spoliations de l’Holocauste ou aux Beutekunst, objets pillés par l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale[132]. En Israël, les objets spoliés lors de l’Holocauste ne sont pas formellement exclus, car on voulait permettre la tenue d’une exposition de biens spoliés qui sont toujours sous la garde de la France, les MNR (Musées nationaux récupération)[133]. Cependant, pour obtenir une protection en Israël, il faut que le régime juridique du pays prêteur soit équitable afin qu’un ayant droit puisse y soumettre une réclamation, et il est possible pour un tiers de s’objecter à la présence d’une oeuvre avant le début d’une exposition[134]. L’Australie, quant à elle, exclut du système un petit nombre d’objets qui ont un lien important avec l’histoire du pays[135]. Alors que ces considérations sont liées à des événements marquants ou à des blessures mémorielles, on voit mal comment le Québec peut justifier l’exclusion de toute oeuvre d’origine québécoise.
De plus, cet aspect de l’article 697 du Code de procédure civile est d’interprétation ardue. Le critère de conception est particulièrement vague. Un peintre qui effectue un voyage au Québec et qui peint en Allemagne selon ses souvenirs ou un croquis a-t-il « conçu » son oeuvre ici ou là-bas? De surcroît, étant donné que le droit est basé sur le lieu de création, si l’on organisait une rétrospective consacrée à Riopelle ou à Borduas, un musée pourrait en théorie octroyer des garanties pour les toiles de la période parisienne de ces artistes, mais pas pour celles réalisées au pays. Finalement, si l’on reprend l’exemple de la Cage de la Corriveau[136], l’objectif principal de son séjour à Québec était précisément de confirmer s’il s’agissait du fameux gibet ou plutôt d’un objet analogue créé en Nouvelle-Angleterre. Est-ce à dire que l’immunité eût dû tomber à partir du moment où les experts conclurent qu’elle fut forgée par un forgeron qui oeuvrait sur le territoire actuel du Québec?
Une analyse des décrets démontre que, outre cet exosquelette, d’autres objets très vraisemblablement conçus ou produits au Québec furent erronément protégés au fil des ans : des toiles de Joseph Légaré et d’Antoine Plamondon pour l’exposition Rubens à Québec[137]; des oeuvres de Krieghoff, Morrice et Notman pour l’exposition Grandeur nature au MBAM[138]; de Morrice pour l’exposition Morrice et Lyman au MNBAQ[139]; un portrait de D’Arcy McGee pour l’exposition permanente du Musée de l’histoire canadienne[140]; ou des objets ethnologiques pour l’Institut culturel cri[141]. L’impact juridique de l’inclusion de ces objets aux décrets n’est d’ailleurs pas entièrement clair. La formulation retenue, « [l]’insaisissabilité de ces biens n’empêche pas l’exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec », semble indiquer que l’inscription d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel ou historique crée une présomption simple d’insaisissabilité. Ce serait ainsi à la partie qui tente de saisir qu’il appartiendrait de démontrer que l’oeuvre ou l’objet en question provient bien du Québec afin d’annihiler la protection dont il bénéficie.
Nous nous retrouvons ainsi dans la situation curieuse où les musées peuvent offrir de moins bonnes garanties aux prêteurs étrangers pour les oeuvres d’origine québécoise que pour celles qui n’ont aucun lien avec le Québec. Mais, à choisir, la politique culturelle québécoise ne devrait-elle pas encourager en priorité la venue au Québec du patrimoine québécois? Nous ne retrouvons aucune indication dans les débats à l’Assemblée nationale qui explique ce choix. Nous pouvons supposer que le législateur ne souhaitait pas décourager les poursuites visant la restitution d’objets d’origine québécoise afin que les cours québécoises puissent intervenir. En dernier ressort, il nous semble cependant préférable qu’une oeuvre mal acquise soit exposée. Pour les raisons déjà mentionnées, l’exposition est non seulement bénéfique pour le public, mais elle encourage également les recherches de provenance. Il serait donc souhaitable que l’exception de l’article 697 du Code de procédure civile pour les objets « à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec » soit abrogée.
D. La protection automatique
La protection devrait-elle être automatique comme en Colombie-Britannique, à New York ou au Texas? Ou l’institution hôte devrait-elle continuer de demander un décret pour chaque exposition comme c’est actuellement le cas au Québec et dans la plupart des juridictions? Le fait de recevoir une immunité automatique a certes des avantages. Il est évident que les institutions préféreraient probablement une protection automatique. En effet, un sondage effectué au Royaume-Uni avant l’adoption de sa loi sur l’immunité de saisie des oeuvres d’art semble confirmer cette préférence, quoiqu’une protection automatique ne fut finalement pas retenue[142].
Une protection automatique réduirait le fardeau administratif des institutions et permettrait surtout à un musée d’ajouter à quelques jours d’une exposition une nouvelle oeuvre sans craindre qu’elle ne soit pas comprise dans un décret octroyé sur la base d’une liste dressée des mois auparavant.
Cependant, le fait d’accorder l’immunité automatiquement pourrait provoquer des détournements du système. En effet, nous rappelons qu’à l’heure actuelle, toute personne organisant une exposition peut se prévaloir d’un décret, et qu’un marchand d’art pourrait donc en théorie demander un décret. L’autorisation automatique rendrait ainsi beaucoup plus réel le risque qu’une oeuvre soit envoyée au Québec pour se soustraire à une poursuite. L’octroi de l’immunité de saisie, qui a pour objectif de favoriser le bon déroulement des expositions publiques, ne saurait s’exercer en catimini. Un mécanisme de filtrage est donc nécessaire pour éviter les abus. Au demeurant, l’obligation pour un musée de demander un décret devrait provoquer un autocontrôle, puisque la publicité du décret pourrait mettre une institution dans l’embarras si un problème évident quant au titre de propriété n’avait pas été détecté.
Nous estimons en conséquence que l’obligation contenue dans la loi québécoise de déclarer au gouvernement et de publier dans la Gazette officielle l’identité des oeuvres et des objets culturels ou historiques est une contrepartie raisonnable à la protection importante accordée aux prêteurs et aux institutions québécoises hôtes.
Le système demeure plus simple qu’au Royaume-Uni ou qu’en Australie où les institutions doivent recevoir une approbation préalable en démontrant que les procédures internes pour établir la provenance des oeuvres sont adéquates. Ces institutions jouissent ensuite automatiquement de l’immunité pour leurs expositions, mais doivent néanmoins publier sur leur site internet la liste des oeuvres et objets culturels qui vont être exposés[143]. Quant aux États-Unis, les institutions hôtes doivent attester, depuis Wally, que des recherches de provenance ont été effectuées[144]. Pareilles procédures sont défavorables aux petites institutions et impliquent un contrôle plus important des pouvoirs publics sur l’organisation interne des musées. Somme toute, le maintien du système actuel des décrets administratifs au Québec semble atteindre un juste équilibre : peu contraignant pour les institutions culturelles, il assure un degré satisfaisant de publicité et de contrôle tout en centralisant les informations dans la Gazette officielle, plutôt qu’elles soient disséminées sur les sites internet de différentes institutions[145].
E. Deux limites : durée et activités commerciales
L’objectif de l’immunité est d’assurer la tenue d’expositions temporaires, et non d’octroyer une immunité artificielle de longue durée. Or, le système actuel ne prévoit aucune limite temporelle. Même si la grande majorité des décrets sont valides pour la durée normale d’une exposition, soit quelques mois, on retrouve certaines protections beaucoup plus longues : près de deux ans pour l’étude de la Cage de la Corriveau[146], près de trois ans pour des vêtements du peuple Nlaka’Pamux[147], plus de cinq ans pour le portrait de D’Arcy McGee dans l’exposition permanente du Musée canadien de l’histoire[148], ou (pire) une protection sans date de fin pour quelques expositions[149]. Une immunité aussi longue pose problème, car l’objectif n’est évidemment pas de créer un quasi-port franc qui mettrait les objets à l’abri pour un temps indéterminé. Quelle serait la durée maximale optimale? Le Royaume-Uni opta pour un an, tout comme l’Autriche[150]. L’Australie choisit vingt-quatre mois[151], comme l’Allemagne, où cette période peut, et dans des circonstances exceptionnelles, être doublée pour atteindre quarante-huit mois[152]. Il semble qu’une durée allant de douze à vingt-quatre mois, renouvelable, constituerait une limite raisonnable, tout en obligeant une reconsidération ministérielle au bout d’une certaine période si une difficulté survenait.
La loi actuelle est par ailleurs porteuse d’une ambiguïté. Il n’est en effet pas interdit à un marchand d’art de demander un décret pour protéger des oeuvres destinées à être vendues. L’article 697 du Code de procédure civile mentionne en effet simplement que les objets doivent être exposés publiquement au Québec. Il serait donc préférable d’empêcher explicitement que les oeuvres destinées à la vente puissent être immunisées contre les saisies, comme c’est notamment le cas aux États-Unis[153], en Belgique[154], au Royaume-Uni[155] ou en Finlande[156]. C’est également la position de l’International Law Association dans le projet de convention internationale[157]. Le marchand d’art, bien qu’il expose l’oeuvre, doit être en mesure de transférer à l’acheteur un titre valide, et ce serait ajouter de l’incertitude dans le marché et desservir les acheteurs éventuels que d’octroyer des décrets pour des objets dont le titre devrait être sans tache.
F. Une loi fédérale
Finalement, et même si cela déborde la portée du présent article, il est nécessaire d’aborder la question du droit fédéral[158]. À Ottawa, on semble se satisfaire du système actuel. En effet, en 2010, la Jordanie revendiqua certains fragments des manuscrits de la mer Morte, découverts dans l’actuelle Cisjordanie, enlevés par Israël après la guerre des Six Jours et qui faisaient l’objet d’une exposition au Musée royal de l’Ontario. Israël avait spécifiquement demandé l’immunité pour les manuscrits. Le gouvernement canadien choisit de ne pas prendre position concernant la propriété des manuscrits et jugea que la loi ontarienne était suffisante pour assurer la protection de l’exposition[159].
Comme le démontra le dossier Wally, il est tout à fait possible de contourner la loi d’un ordre de gouvernement en effectuant une saisie en vertu de la loi de l’autre palier. N’oublions pas que les premières personnes qui entrent en contact avec les oeuvres au moment de leur arrivée sont les agents douaniers. Et, en plus des pouvoirs fédéraux en matière de douane et de droit criminel[160], le Canada est signataire de la Convention UNESCO 1970 qui oblige chaque État partie à admettre une action en revendication des biens culturels par le propriétaire légitime[161]. Les articles 36.1 et 37 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels [LEIBC] permettent d’instaurer devant une cour supérieure ou la Cour fédérale une action en restitution d’un bien culturel illégalement exporté de son pays d’origine, et qui se retrouve au Canada[162]. Si l’on devait saisir une oeuvre d’art destinée à une exposition dans un musée en application d’une loi de douane ou du Code criminel, on voit mal en quoi un article du Code de procédure civile serait d’une quelconque utilité au prêteur ou à l’institution hôte.
Il semble donc nécessaire que le législateur fédéral accorde des garanties et exclue clairement les prêts pour des expositions temporaires de l’application des lois qui sont de son ressort. La mise en application ne nécessiterait pas d’instaurer un second registre fédéral et de dédoubler le poids administratif pour les institutions. On pourrait par exemple prévoir que, lorsqu’une oeuvre est protégée en vertu d’une loi provinciale, et qu’un décret en bonne et due forme est publié, la protection s’étende automatiquement au droit fédéral.
Conclusion
Le droit régissant le prêt des oeuvres d’art et des biens culturels ou historiques s’est considérablement complexifié depuis cette journée de la fin juin 1976 où les députés de l’Assemblée nationale adoptèrent de manière expéditive un projet de loi pour permettre la venue d’une exposition soviétique à Montréal. Plus d’une centaine d’expositions internationales furent depuis organisées au Québec, et nombre de décisions étrangères ont démontré les limites du système existant. Les risques sont désormais plus importants et plus diffus, créant un décalage croissant entre la volonté du législateur d’éviter au prêteur toute « tracasserie juridique » et le système tel qu’il existe actuellement. Nos institutions muséales — qui sont au centre de la vie culturelle — doivent non seulement disposer des ressources financières, mais également d’un cadre juridique qui leur permette de remplir leur mission. Cet essai a tenté d’apporter quelques éléments de réflexion afin que les expositions muséales demeurent l’apanage des conservateurs, et non du système judiciaire.
Appendices
Notes
-
[1]
À ceux qui estimeraient que les dossiers spectaculaires de restitutions n’arrivent qu’ailleurs, nous rappellerons qu’assez récemment un bas-relief perse, après avoir été volé dans une institution québécoise qui l’avait exposé pendant des décennies, fut retrouvé par la police en Alberta, vendu à un marchand britannique, puis saisi à New York par les autorités en raison de soupçons de pillage archéologique. Le musée québécois avait pourtant respecté les normes déontologiques en vigueur au moment de son acquisition. Ce bas-relief fut finalement restitué à l’Iran (voir Axa Art Insurance et Montreal Museum of Fine Arts, 2017 QCCS 5370; « Turnover Order », In the Matter of an Application for a Warrant to Search the Premises Located at the Park Avenue Armory, 643 Park Avenue, New York New York 100065, (NY Sup Ct 2018); Alexander Herman et Holly Woodhouse, « New York Seizure of a “Recovered” Persian Artefact » (28 novembre 2017), en ligne : Institute of Art and Law <ial.uk.com> [perma.cc/A7ZL-DGJS]).
-
[2]
Pour les commentaires succincts des auteurs en procédure civile, voir Luc Chamberland, dir, Le Grand collectif – Code de procédure civile, commentaires et annotations, 2e éd, Montréal, Yvon Blais, 2017, art 697; Denis Ferland et Benoît Émery, dir, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, Montréal, Yvon Blais, 2015, art 697.
-
[3]
Précisons d’emblée que cet article ne traite pas de l’immunité souveraine comme dans la célèbre décision de la Cour suprême américaine qui portait sur plusieurs tableaux de Klimt dont le Portrait d’Adèle Bloch-Bauer I (voir Republic of Austria v Altmann, 541 US 677 (2004)). Même s’il s’agit de sujets connexes, l’immunité souveraine est l’un des plus anciens principes de droit international et s’applique à toute propriété étatique à l’étranger, moyennant certaines exceptions. L’immunité de saisie est spécifique aux oeuvres d’art et s’applique, au Québec, à tout prêteur, public ou privé.
-
[4]
Pour le contexte historique de cette exposition, voir Daniel Getz, « The History of Canadian Immunity from Seizure Legislation » (2011) 18:2 Intl J Cult Prop 201 à la p 211.
-
[5]
Pour le numéro spécial consacré à ce sujet, voir « Spoils of War v. Cultural Heritage: The Russian Cultural Property Law in Historical Context » (2010) 17:2 Intl J Cult Prop 135.
-
[6]
Voir Nout van Woudenberg, State Immunity and Cultural Objects on Loan, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012 à la p 152. Cette loi est toujours en vigueur (voir 22 USCS § 2459 (2020)).
-
[7]
Voir van Woudenberg, supra note 6 aux pp 161–62. Cette loi est toujours en vigueur (voir New York Art and Cultural Affairs Law, NY CLS § 12.03 [NYCAL]).
-
[8]
Voir l’intervention du député Enns, de l’opposition conservatrice, qui contesta le projet : Manitoba, Assemblée législative, « Bill No 56, The Foreign Cultural Objects Immunity from Seizure Act », Debates and Proceedings, 30-3, vol 126 (27 mai 1976) aux pp 4279–85 (M Harry J Enns) [Débats projet 56 (Manitoba, 1976)]).
-
[9]
Voir Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers, LM 2015, c 27, CPLM c F140 [Loi d’insaisissabilité (Manitoba)].
-
[10]
Voir Ontario, « Foreign Cultural Objects Immunity from Seizure Act », 2e lecture, House Hansard, 31-2 (28 novembre 1978) (M Grande et M Baetz, revenant sur les motifs qui avaient poussé la province à ne pas adopter de loi en 1976).
-
[11]
Ce n’est malheureusement pas une situation exceptionnelle. Pris de court, plusieurs législateurs durent réagir dans l’urgence. Ce fut le cas plus tard en France où, après une tentative de saisie, on inclut une disposition d’immunité dans une loi portant sur les finances (voir Loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, JO, 10 août 1994, 11668, art 61 [Loi no 94-679 (France)]), en Belgique, où un projet de loi fut soumis dans l’urgence, car « des expositions d’oeuvres d’art en provenance d’États étrangers ayant fait part de leurs préoccupations relativement aux possibles saisies de celles-ci sont prévues pour le mois de juin 2004, il y a lieu de déposer très rapidement le projet au Parlement » (Belgique, CE, 27 avril 2004, Avis du Conseil d’État no 36.890/4, publié dans le Projet de loi modifiant le Code judiciaire en vue d’instituer une immunité d’exécution à l’égard des biens culturels exposés publiquement en Belgique, 1051/(2003/2004), 2e session, 51e législature (sanctionné et promulgué le 14 juin 2006) [Projet de loi (Belgique, 2004)] à la p 8), urgence qui aurait été causée par un important échange culturel avec la Russie (voir van Woudenberg, supra note 6 à la p 306), et au Royaume-Uni où, après la tentative de l’entreprise Noga, on inclut des dispositions dans le Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (R-U) [TCE Act (R-U)], véhicule d’une réforme importante des tribunaux britanniques, ce qui fit dire à un Lord : « [w]hat on Earth that is doing in the Bill I cannot imagine. It has nothing to do with anything else that the Bill deals with » (R-U, HL Deb (29 novembre 2006), vol 687, col 772 (Lord Falconer of Thoroton)).
-
[12]
Québec, Assemblée nationale, « Projet de loi 59, Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers », 2e lecture, Journal des Débats, 30-4, vol 17, no 57 (30 juin 1976) à la p 1921 (M Jean-Paul L’Allier) [Débats projet 59 (Québec, 1976)].
-
[13]
Ibid aux pp 1921–22 (M Maurice Bellemare). Cette dernière intervention est d’autant plus surprenante que l’Union nationale, sous Maurice Duplessis, ne s’était pas gênée pour instrumentaliser la présence des trésors polonais à Québec en refusant de les redonner à la fin de la Seconde Guerre mondiale au nouveau gouvernement polonais, parce que désormais communiste. De 1945 à 1960, une partie des trésors de Wawel restèrent donc au Québec (voir John R Porter, « De Cracovie à Québec ou la révélation d’un trésor national inestimable », préface de Le retour des trésors polonais, Québec, Musée du Québec, 2001 aux pp 11–15).
-
[14]
Art 553.1 Cpc (1965).
-
[15]
Voir D 2596-76, (1976) GOQ II, 4887.
-
[16]
Voir Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers, LRO 1990, c F23 [Loi d’insaisissabilité (Ontario)].
-
[17]
Voir Court Order Enforcement Act, LRCB 1979, c 75, art 65.1, modifiée par LRCB 1996, c 78, art 72 [Loi d’insaisissabilité (Colombie-Britannique)].
-
[18]
Voir Foreign Cultural Property Immunity, LA 1985 (1re sess), c F-12.5, modifiée par LRA 2000, c F-17 [Loi d’insaisissabilité (Alberta)].
-
[19]
C’est le cas du Musée national des beaux-arts du Québec. Le Musée de l’histoire canadienne effectue, quant à lui, une évaluation au cas par cas, notamment en prenant en compte les souhaits des prêteurs.
-
[20]
Dans quelques cas, un seul décret est employé pour protéger des oeuvres allant dans plusieurs institutions. Nous avons alors compté ce décret dans la colonne de chacun des musées concernés.
-
[21]
Une juridiction est comptée dès qu’elle prête au moins une oeuvre pour une exposition. Il est ainsi normal que le nombre de pays recensés dans ce tableau soit largement plus important que le nombre de décrets, une exposition pouvant accueillir des oeuvres de plusieurs juridictions.
-
[22]
Voir art 697 Cpc. Le Code de procédure civile précise que l’immunité peut être octroyée aux biens provenant de l’extérieur du Québec. Non seulement la loi ne permet pas de déclarer l’immunité pour des oeuvres qui sont habituellement au Québec, mais cela est contraire à l’esprit du système. L’objectif du mécanisme d’immunité est d’éviter au prêteur étranger le risque d’un débat judiciaire au Québec, et non de permettre à un propriétaire québécois d’éluder ses responsabilités en obtenant une immunité dans la juridiction où le débat devrait avoir lieu. Il y a même des exemples de décrets pour une exposition à une institution d’oeuvres provenant de cette même institution (voir par exemple les décrets 182-2003, 111-2004 et 317-2006)! L’octroi de l’immunité pour un objet habituellement au Québec est donc à proscrire. Le fait que l’immunité ait été octroyée à plusieurs reprises pour des objets habituellement présents au Québec démontre par ailleurs que le travail de filtrage et de révision ministériel qui devrait normalement être effectué avant la publication des décrets peut être défaillant.
-
[23]
Cette recension a une limite inhérente, car elle ne prend pas en compte le nombre d’oeuvres prêtées à chaque occasion ou leur importance. Ainsi, un échange culturel majeur comme l’exposition soviétique de 1976 ou l’exposition sur la Syrie de 1999 sera compté comme un seul prêt dans ce tableau, de la même manière que le prêt d’une seule oeuvre secondaire. Ainsi, même si le nombre de prêts provenant de certains pays non occidentaux peut paraître faible, ils peuvent correspondre à des expositions majeures, comme ce fut le cas pour l’Égypte, la Chine, la Turquie, la Syrie ou l’Afghanistan.
-
[24]
Dans certains cas, un seul décret est employé pour protéger des oeuvres allant dans plusieurs institutions. Nous avons alors compté ce décret dans la colonne de chacun des musées concernés.
-
[25]
Voir Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice, Code de procédure civile – Chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art 697.
-
[26]
Art 697 Cpc.
-
[27]
14 mai 1954, 249 RTNU 216 (entrée en vigueur : 7 août 1956) [La Haye 1954].
-
[28]
14 novembre 1970, 823 RTNU 231 (entrée en vigueur : 24 avril 1972) [UNESCO 1970].
-
[29]
24 juin 1995, 2421 RTNU 457 (entrée en vigueur : 1er juillet 1998) [UNIDROIT 1995].
-
[30]
Voir Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, LRC 1985, c C-51.
-
[31]
Voir Loi d’insaisissabilité (Manitoba), supra note 9.
-
[32]
Voir Loi n° 94-679 (France), supra note 11, art 61.
-
[33]
Voir art 1412ter Code judiciaire (Belgique). Le commentaire de la ministre de la Justice du Québec sur l’art 697 Cpc cite cet article comme source. Cette référence est aussi surprenante qu’inexpliquée.
-
[34]
Voir Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC), no 444.1, arts 10–13 (Suisse) [LTBC (Suisse)].
-
[35]
On pourrait reprendre le même raisonnement pour la version anglaise de l’art 697 Cpc qui emploie le vocable « cultural property », équivalent français en droit international de « biens culturels », également présent dans le titre anglais de La Haye 1954, supra note 27 et d’UNESCO 1970, supra note 28 (mais pas, de manière surprenante, dans UNIDROIT 1995, supra note 29 qui se réfère aux « cultural objects »). Cela renforce la conclusion selon laquelle tous les biens qui sont compris dans la définition de l’article 1 de la Convention UNESCO 1970 peuvent recevoir l’immunité au Québec.
-
[36]
En plus du gouvernement fédéral, plusieurs États se sont également dotés de mécanismes pour prévenir les saisies : New York en 1968 (voir NYCAL, supra note 7, art 12.03 (la protection date de 1965)); le Texas en 1999 (voir Tex Civil Practice & Remedies Code, art 61.081 [Tex CPRC]); le Rhode Island en 2000 (voir R I General Law § 5‑62‑8); le Tennessee en 2000 (voir Tenn Code § 28-3-115) et, de manière plus limitée, la Pennsylvanie en 1976 (voir 42 Pa Cons Stat § 8125).
-
[37]
Voir Loi n° 94-679 (France), supra note 11, art 61.
-
[38]
Voir Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung [Loi de mise en oeuvre des directives des Communautés européennes sur le retour des biens culturels illégalement retirés du territoire d’un État membre et de modification de la loi sur la protection des biens culturels allemands contre l’émigration] (Allemagne), 15 octobre 1998, Bundesgesetzblatt, 1998, partie I, n°70, à la p 3162, art 2, al 3. À la suite de modifications législatives et d’une refonte des textes sur les biens culturels, ces dispositions ont été précisées et sont maintenant contenues dans la Gesetz zum Schutz von Kulturgut [Loi sur la protection des biens culturels] (Allemagne), 31 juillet 2016, Bundesgesetzblatt, 2016, partie I, n°39, à la p 1914, arts 73–76 [KGSG (Allemagne)].
-
[39]
Voir Bundesgesetz über die vorübergehende sachliche Immunität von Kulturgut-Leihgaben zum Zweck der öffentlichen Ausstellung [Loi fédérale portant sur l’immunité temporaire des prêts de biens culturels à des fins d’exposition publique] (Autriche), Bundesgesetzblatt, 2003, partie I, n°133, modifiée par le même nom, Bundesgesetzblatt, 2006, partie I, n°65 [BKLZA modifiée (Autriche)].
-
[40]
Voir art 1412ter Code judiciaire (Belgique), introduit à la suite de l’adoption du Projet de loi (Belgique, 2004), supra note 11.
-
[41]
Voir LTBC (Suisse), supra note 34, arts 10–13. Cette loi de 2003, de même que l’Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (13 avril 2005), 444.11 [Ordonnance (Suisse, 2005)], sont entrés en vigueur le 1er juin 2005.
-
[42]
Voir TCE Act (R-U), supra note 11, arts 134–38.
-
[43]
Voir
 [Loi sur le prêt de biens
culturels] (Israël), 5767-2007, 2007 [Loi sur le
prêt de biens culturels (Israël)].
[Loi sur le prêt de biens
culturels] (Israël), 5767-2007, 2007 [Loi sur le
prêt de biens culturels (Israël)]. -
[44]
Voir Gesetz über die vorübergehende sachliche Immunität von Kulturgut (Kulturgut-Immunität-Gesetz) [Loi portant sur l’immunité temporaire des biens culturels] (Liechtenstein), 15 janvier 2008, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, 2008, n° 9, à la p 462.
-
[45]
Voir Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä [Loi interdisant la saisie de certains objets importés en Finlande aux fins d’exposition] (Finlande), 2011, loi no 697 [LESTNTK (Finlande)].
-
[46]
Voir Zákon o státní památkové péči [Loi sur l’entretien des monuments d’État] (République Tchèque), loi no 20/87, modifiée par l’amendement n° 124/2011, art 20, al 3.
-
[47]
Voir 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 [Loi pour encourager la diffusion d’oeuvres d’art étrangères auprès du public japonais] (Japon), 1er avril 2011, loi no 15, art 3.
-
[48]
Voir Protection of Cultural Objects on Loan Act 2013 (Cth), 2013/12 [Cultural Objects on Loan Act (Australie)]. On trouve également des mécanismes qui jouent un rôle équivalent et protègent en tout ou en partie les prêts. Ainsi, aux Pays-Bas, les articles 436 et 703 du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [Code de procédure civile] (Pays-Bas) empêchent la saisie de biens qui ont un objectif de service public, ce qui permet de protéger les oeuvres d’art prêtées (voir van Woudenberg, supra note 6 à la p 257), alors qu’en Irlande, le National Monuments (Amendment) Act, no 17, 1994, qui oblige la restitution des biens archéologiques volés, ne s’applique pas aux prêts qui sont aux fins d’exposition, de recherche ou de restauration (voir ibid, art 5(12)).
-
[49]
Voir Delocque-Fourcaud v Los Angeles County Museum of Art, No CV 03-5027-R (CTx) (Dist Ct Cal 2003).
-
[50]
Pour les faits pertinents, voir Affaire relative à certains biens (Liechtenstein c Allemagne), exceptions préliminaires, [2005] CIJ Rec 6 aux paras 13–17.
-
[51]
Voir Craig Forrest, « Immunity from Seizure and Suit in Australia: The Protection of Cultural Objects on Loan Act 2013 » (2014) 21:2 Intl J Cult Prop 143 aux pp 146–47.
-
[52]
Au sujet des trésors de la collection impériale chinoise, voir Matthias Weller, « The Safeguarding of Foreign Cultural Objects on Loan in Germany » (2009) 4 Kunstrechtsspiegel 182 à la p 182 [Weller, « Safeguarding »]. Au sujet des Manuscrits de la mer Morte, voir Bernard Duhaime et Camille Labadie, « Les voyages des manuscrits de la mer Morte » (2016) 24:2 Théologiques 183 à la p 189.
-
[53]
Voir Magness v Russian Federation, 84 F Supp (2d) 1357 (Dist Ct Ala 2000).
-
[54]
Voir Matthias Weller, « Immunity for Works of Art and Cultural Property Loaned by Foreign States under Customary International Law: Recent German Case Law » (2011) 1:11 Kunstrechtsspiegel 21 à la p 22 [Weller, « Immunity »]; van Woudenberg, supra note 6 à la p 299.
-
[55]
Voir van Woudenberg, supra note 6 aux pp 288–89.
-
[56]
Voir « Tableaux russes saisis… puis libérés » (16 novembre 2005), en ligne : Swissinfo.ch <www.swissinfo.ch> [perma.cc/DZB7-MKP4].
-
[57]
Voir Weller, « Immunity », supra note 54 à la p 21; van Woudenberg, supra note 6 à la p 297.
-
[58]
Voir van Woudenberg, supra note 6 aux pp 302–03.
-
[59]
Voir LRC 1985, c C-42; Tri-Tex Co c Ghaly, [1999] RJQ 2324 (CA), 1999 CanLII 13314; Théberge c Galerie d’Art du Petit Champlain inc, 2002 CSC 34 aux para 101–11 (le juge Gonthier, dissident, n’affiche pas de désaccord avec la majorité concernant les principes applicables à la saisie d’objets en contrefaçon). Cette décision était fondée sur l’article 734 Cpc (1965) qui fut remplacé par l’art 517 Cpc (2016) lors de la refonte du Code de procédure civile.
-
[60]
Voir Loi sur le droit d’auteur, supra note 59, art 6. On remarque dans le Tableau 1, ci-dessus, que le Musée d’art contemporain de Montréal n’a jamais demandé de décret d’insaisissabilité, malgré le fait qu’il organise régulièrement des expositions internationales. L’institution nous explique que, puisqu’elle traite directement avec l’artiste ou son représentant, les risques d’une contestation portant sur la propriété de l’oeuvre sont faibles, ce qui ne justifie pas de demande de décret. Bien qu’il soit tout à fait exact que les expositions d’art contemporain soient bien moins vulnérables aux différends quant aux titres de propriété des oeuvres, un litige basé sur le droit d’auteur est plus probable et pourrait entraîner une saisie via l’article 517 Cpc.
-
[61]
L’essentiel des éléments factuels de la présente section sur le Portrait de Wally proviennent de van Woudenberg, supra note 6 aux pp 184–95.
-
[62]
Voir United States v Portrait of Wally, a Painting by Egon Schiele, 2002 WL 553532 (NY Dist Ct) à la p 3 [Wally, (NSPA, NY Dist Ct, 2002)].
-
[63]
NYCAL, supra note 7, art 12.03.
-
[64]
Voir In the Matter of the Application to Quash Grand Jury Subpoena Duces Tecum Served on the Museum of Modern Art, 677 NYS (2d) 872 (Sup Ct 1998) [Wally (Subpeona Quash, Sup Ct, 1998)].
-
[65]
Ibid à la p 879.
-
[66]
Voir In re Application to Quash Grand Jury Subpoena Duces Tecum, 253 AD (2d) 211 (Sup Ct Ap Div 1999) [Wally (Subpeona Quash, Sup Ct Ap Div, 1999)].
-
[67]
In the Matter of the Grand Jury Subpoena Duces Tecum Served on the Museum of Modern Art, 719 NE (2d) 897 (NY Ct App 1999) à la p 904.
-
[68]
18 USC § 2311–23.
-
[69]
Voir Wally (Subpeona Quash, Sup Ct, 1998), supra note 64 à la p 876.
-
[70]
Voir van Woudenberg, supra note 6 aux pp 194–95.
-
[71]
Voir United States v Portrait of Wally, 105 F Supp (2d) 288 (US D 2000).
-
[72]
Voir United States v Portrait of Wally, 2000 WL 1890403 (NY Dist Ct).
-
[73]
Voir Wally, (NSPA, NY Dist Ct, 2002), supra note 62.
-
[74]
Voir United States v Portrait of Wally, a Painting by Egon Schiele, 663 F Supp (2d) 232 (NY Dist Ct 2009).
-
[75]
Voir « Stipulation and Order of Settlement and Discontinuance », United States of America v Portrait of Wally, 99 Civ 9940 (NY Dist Ct), 20 juillet 2010. Lors d’une visite au Musée Leopold à l’été 2015, nous avons constaté que le musée tente de mettre cette indication le plus loin possible de la toile.
-
[76]
Voir Wally (Subpeona Quash, Sup Ct Ap Div, 1999), supra note 66.
-
[77]
Pour les éléments factuels pertinents à la présente section, voir Malewicz v Amsterdam 362 F Supp (2d) 298 (DC Dist Ct 2005) [Malewicz (2005)] aux pp 301–03 et van Woudenberg, supra note 6 aux pp 172–82.
-
[78]
Les oeuvres étaient sous la protection de la Public notice 4355, 8 Fed Reg 17852 (2003) émise par le Département d’État américain.
-
[79]
Voir Malewicz (2005), supra note 77 à la p 300 (« the suit arises in replevin, rescission and conversion and seeks the return of the artwork as well as damages »).
-
[80]
Voir ibid à la p 315.
-
[81]
Ibid aux pp 311–12.
-
[82]
Voir Malewicz v Amsterdam, 517 F Supp (2d) 322 (DC Dist Ct 2007) à la p 322.
-
[83]
Brief for the United States as amicus curiae in support of appellant, No 07-5247, dans le cadre de Malewicz v City of Amsterdam, WL 2223219 (DC Dist Ct 2008) aux pp 11–15, en ligne (pdf) : US Department of State <2009-2017.state.gov> [perma.cc/QJ35-JKSH].
-
[84]
Van Woudenberg, supra note 6 à la p 172, n 311. Puisque la décision porte pour l’essentiel sur l’immunité souveraine et qu’elle ne s’est pas soldée par une saisie spectaculaire comme dans le cas de Wally, il est possible que les passages sur l’immunité de saisie n’aient pas retenu l’attention.
-
[85]
Voir Beals c Saldanha, 2003 CSC 72.
-
[86]
Cet argument a été formulé par le député néo-démocrate albertain Jim Gurnett au sujet des biens autochtones au moment du passage de la loi albertaine (voir Assemblée législative, « Bill 14, Foreign Cultural Property Immunity Act », Alberta Hansard, 20-3 (3 juin 1985) aux pp 1308–09).
-
[87]
Pour l’extrait de la lettre de Lord Janner au Times lors du débat au Royaume-Uni, voir R-U, House of Commons Library, The Tribunals, Courts and Enforcement Bill [HL] (Research Paper no 07/22) par Alexander Horne, Philip Ward et Vincent Keter, Londres (R-U), House of Commons Library, 1 mars 2007 à la p 52.
-
[88]
Voir Alessandro Chechi, « State Immunity, Property Rights, and Cultural Objects on Loan » (2015) 22:2/3 Intl J Cult Prop 279 à la p 289.
-
[89]
On peut citer l’adoption de la Convention UNIDROIT 1995, supra note 29, l’adoption des Principes de la Conférence de Washington applicables aux oeuvres d’art confisquées par les nazis (3 décembre 1998) qui permit la mise en place de mécanismes de règlement des différends dans plusieurs pays ou les efforts de restitution de la part d’anciennes puissances coloniales (pour la France, voir par ex Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, « Restituer le Patrimoine africain : vers une nouvelle éthique relationnelle », rapport remis au Président de la République, Emmanuel Macron, le 23 novembre 2018, lequel rapport a été suivi d’une série de restitutions). Plus généralement, ces questions sont l’objet d’une attention croissante des chercheurs, des médias et de l’opinion publique en plus de former la trame de fond de longs métrages à succès. Nous ne pouvons passer sous silence que le Canada demeure en retrait de ces développements internationaux, n’ayant ni adhéré à la Convention UNIDROIT 1995, ni mis en place de mécanismes de résolution des différends « justes et équitables » comme le voulait les Principes de Washington, ni mis en place de mécanisme permettant de s’attaquer à la question des objets culturels autochtones.
-
[90]
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu : le temps retrouvé, Paris, Gallimard, 1927 à la p 49.
-
[91]
Governor’s Memorandum in support of the New York Art and Cultural Affairs Law (1968), McKinney’ Session Laws of New York aux pp 2396–97, tel que cité dans Wally (Subpeona Quash, Sup Ct, 1998), supra note 64 à la p 878.
-
[92]
Débats projet 56 (Manitoba, 1976), supra note 8 à la p 4302 (M Johannson).
-
[93]
Débats projet 59 (Québec, 1976), supra note 12 à la p 1921 (M Claude Charron).
-
[94]
France, JO, Sénat, Débats parlementaires, Compte rendu intégral, 44e séance du 29 juin 1994 à la p 3203 (M Jean-Pierre Camoin).
-
[95]
26 juin 1945, RT Can 1945 no 7, art 1, al 1(3), art 13(1), et art 55, al 1(b).
-
[96]
16 décembre 1966, 993 RTNU 12, art 15 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976).
-
[97]
20 octobre 2005, 2440 RTNU 311, arts 1, 7, 12 (entrée en vigueur : 18 mars 2007).
-
[98]
22 novembre 1950, 131 RTNU 25, préambule (entrée en vigueur : 21 mai 1952). Cet accord n’a jamais été signé par le Canada.
-
[99]
Doc off UNESCO, 19e sess, supp no 1, (1976) 17.
-
[100]
Voir Nout van Woudenberg et James AR Nafziger, « The Draft Convention on Immunity from Suit and Seizure for Cultural Objects Temporarily Abroad for Cultural, Educational or Scientific Purpose » (2014) 21:4 Intl J Cult Prop 481 aux pp 484, 490–91. Le projet de convention est reproduit en annexe de l’article. On peut également se référer à l’article 21 de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, 2 décembre 2004, (entrée en vigueur : en attente), en ligne (pdf) : Nations Unies <treaties.un.org> [perma.cc/3R8M-V5KM]) qui accorde l’immunité aux biens culturels lorsqu’ils sont la propriété d’un État.
-
[101]
Pour ne prendre qu’un exemple, le Traité du Trianon, signé à la suite de la Première Guerre mondiale, permettait à la Hongrie nouvellement indépendante de récupérer son « patrimoine intellectuel » détenu par les Habsbourg, et il ne fallut pas moins de douze ans de négociations entre l’Autriche et la Hongrie pour s’entendre sur les biens qu’il fallait restituer (voir Hans Tietze, « L’Accord austro-hongrois sur la répartition des collections de la Maison des Habsbourg » (1933) 23/24 Mouseion 92 à la p 93).
-
[102]
Pour l’exposé le plus convaincant qui va à l’encontre de la position défendue dans cet article et qui argue pour une intervention des tribunaux occidentaux dans les différends culturels d’autres États, voir Joseph P Fishman, « Locating the International Interest in Intranational Cultural Property Disputes » 35 Yale J Intl L 347.
-
[103]
Voir Chechi, supra note 88 aux pp 279–80.
-
[104]
Voir van Woudenberg, supra note 6 à la p 285.
-
[105]
Voir Judith H Dobrzynski, « Lenders Pull Two Bonnards From a Show at the Modern », The New York Times (29 avril 1998), en ligne : <nytimes.com> [perma.cc/6K84-L243].
-
[106]
Voir R-U, Department for Culture, Media and Sport, Consultation Paper on Anti-Seizure Legislation, 2006 à la p 2 [Consultation Paper (R-U, 2006)]; Horne, Ward et Keter, supra note 87 à la p 50; van Woudenberg, supra note 6 aux pp 228–29.
-
[107]
Voir van Woudenberg, supra note 6 à la p 327.
-
[108]
Voir ibid à la p 300, n 89.
-
[109]
Voir Peter Watson, « Who Owns This Masterpiece? » (27 janvier 2004), en ligne : The Times <thetimes.co.uk> [perma.cc/HQJ3-7ZYU].
-
[110]
Voir Shoshana Berman, « Protection of Cultural Objects on Loan: The Israeli Perspective » (2007) 12:2 Art Ant & L 113 à la p 119.
-
[111]
Voir Associated Press, « Czech Reclaiming Artworks for Fear of Seizure » (10 juin 2011), en ligne : Taiwan News <taiwannews.com.tw> [perma.cc/E6PE-C4NH].
-
[112]
Voir Forrest, supra note 51 à la p 145.
-
[113]
Voir Lyndel V Prott, « The Dja Dja Wurrung Bark Etchings Case » (2006) 13:2 Intl J Cult Prop 214 à la p 244.
-
[114]
Voir Consultation Paper (R-U, 2006), supra note 106 à la p 4.
-
[115]
Voir Josh Rosenblath, « A Tug of War Between Art and Morality » (7 septembre 2012), en ligne : The Austin Chronicle <austinchronicle.com> [perma.cc/2Y6Y-BVN8].
-
[116]
Voir Consultation Paper (R-U, 2006), supra note 106 à la p 6. On note que la loi texane prévoit que les tribunaux peuvent émettre des ordonnances concernant des oeuvres d’art seulement si les principes reconnus dans la profession en matière de transport, de conservation et d’assurance sont respectés (voir Tex CPRC, supra note 36, art 61.082).
-
[117]
Voir Laura Popp, « Arresting Art Loan Seizures » (2000–2001) 24:2 Colum JL & Arts 213 à la p 228.
-
[118]
Voir Conseil international des musées, Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, Paris, ICOM, 2006, art 2.3.
-
[119]
Voir Loi d’insaisissabilité (Manitoba), supra note 9, art 1 (« aucune instance ni action ne peut être intentée ou autorisée »); Loi d’insaisissabilité (Ontario), supra note 16, art 1 (« aucune poursuite ne peut être engagée devant un tribunal »); Loi d’insaisissabilité (Alberta), supra note 18, art 2(1) (« no proceedings shall be taken in any court »). Par contre, la loi de la Colombie-Britannique est plus proche de celle du Québec : « [w]orks of art […] are exempt from seizure or sale » (Loi d’insaisissabilité (Colombie-Britannique), supra note 17, art 72).
-
[120]
Débats projet 59 (Québec, 1976), supra note 12 à la p 1921 (M Claude Charron).
-
[121]
Voir É-U, Senate Committee on the Judiciary, 89e Cong, Cultural Objects—Importation for Temporary Display (1070), Washington, DC, US Government Printing Office, 1965.
-
[122]
É-U, Cong Rec, t 111, 19 à la p 25929.
-
[123]
C’est également la position retenue par l’ILA par le biais de l’article 4 du projet de convention (voir van Woudenberg et Nafziger, supra note 100 aux pp 484–85, 490–91).
-
[124]
La loi albertaine permet de décréter l’immunité lorsqu’un objet est prêté à des fins de recherche (voir Loi d’insaisissabilité (Alberta), supra note 18, art 2(1)). La loi britannique prévoit que l’immunité peut s’appliquer dans des cas de conservation ou de restauration (voir TCE Act (R-U), supra note 11, art 134(7)(a)), alors que la loi allemande permet d’octroyer l’immunité à la fois en cas de restauration et de recherche (voir KGSG (Allemagne), supra note 38, art 73).
-
[125]
Voir D 870-2013, (2013) GOQ II, 3629.
-
[126]
Voir Bruce P Montgomery, « Rescue or Return: The Fate of the Iraqi Jewish Archive » (2013) 20:2 Intl J Cult Prop 175 aux pp 180–81. Pour un cas de figure de tentative de saisie à l’encontre d’une collection qui se trouve dans une juridiction pour des fins d’études, voir Rubin v Islamic Republic of Iran, 138 S Ct 816 (2018).
-
[127]
Voir Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (Suisse), no 520.3, art 12. L’Association of Art Museum Directors a publié un protocole relatif à la protection des oeuvres provenant de pays en crise (voir « Protocols for Safe Havens for Works of Cultural Significance from Countries in Crisis » (2015), en ligne (pdf) : Association of Art Museum Directors <aamd.org> [perma.cc/ZQB8-GQYT]). Au sujet du mécanisme de refuge suisse, voir généralement Nikolaus Thaddäus Paumgartner et Raphael Zingg, « The Rise of Safe Havens for Threatened Cultural Heritage » (2018) 25:3 Intl J Cult Prop 323.
-
[128]
Voir Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, JO, 8 juillet 2016, no 1, art 56.
-
[129]
Voir Cultural Property (Armed Conflicts) Act 2017 (R-U), c 6, art 28.
-
[130]
En cas de saisie en territoire québécois d’une oeuvre qui doit être exposée dans une autre province et qui est protégée par un décret de cette province, l’article 3097, al 2 CcQ pourrait vraisemblablement trouver application et protéger les biens culturels.
-
[131]
Art 697 Cpc.
-
[132]
Voir Weller, « Safeguarding », supra note 52 aux pp 184–85, 190; van Woudenberg, supra note 6 à la p 295.
-
[133]
Voir Berman, supra note 110, à la p 120 et van Woudenberg, supra note 6 à la p 342–43.
-
[134]
Voir Loi sur le prêt de biens culturels (Israël), supra note 43, arts 4–5.
-
[135]
Voir Cultural Objects on Loan Act (Australie), supra note 48, art 8(1)(f), citant Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986 (No 11); Protection of Movable Cultural Heritage Regulations 1987 (No 149) (Cth), 1987/149, r 1.3, 7.3, 9.2A.
-
[136]
Le décret mentionne d’ailleurs explicitement que le Musée de la Civilisation souhaite procéder à une étude (voir D 870-2013, supra note 125).
-
[137]
Voir D 881-2004, (2004) GOQ II, 4364 (les oeuvres : Légaré, Le Martyre de Françoise Brunon-Gonannhatenha (1827–1828); Plamondon, La Descente de croix (1840); Hamel, L’Éducation de la Vierge (1845–1846)).
-
[138]
Voir D 554-2009, (2009) GOQ II, 2428 (les oeuvres incluent : Krieghoff, La Poste royale traversant le Saint-Laurent (vers 1860); Leduc, Les foins (1901); Morrice, La terrasse, Québec (1910–1911)).
-
[139]
Voir D 348-2014, (2014) GOQ II, 1514 (plusieurs oeuvres dont : Morrice, Le Bac, Québec (1907)).
-
[140]
Voir D 738-2016, (2016) GOQ II, 5020 (l’oeuvre : Marlett Bell-Smith, Portrait of D’Arcy McGee (1868)).
-
[141]
Voir D 1122-2017, (2017) GOQ II, 5712 (les objets : un capuchon et deux manteaux).
-
[142]
Voir Horne, Ward et Keter, supra note 87 aux pp 49–50.
-
[143]
Pour le Royaume-Uni, voir TCE Act (R-U), supra note 11, art 136(2); The Protection of Cultural Objects on Loan (Publication and Provision of Information) Regulations 2008 (2008 no 1159), arts 4–5 [Règlement (Royaume-Uni, 2008)]. Pour l’Australie, la certification gouvernementale est d’une durée limitée et doit être renouvelée tous les cinq ans (voir Cultural Objects on Loan Act (Australie), supra note 48, arts 15–17, 21; Protection of Cultural Objects on Loan Regulation 2014 (Cth), 2014/142, arts 8, 11–15) [Règlement (Australie, 2014)].
-
[144]
Voir Popp, supra note 117 aux pp 229–30.
-
[145]
En date du 1er juillet 2020, trente-sept institutions culturelles britanniques et douze institutions australiennes avaient obtenu l’approbation nécessaire pour garantir l’immunité lors d’expositions temporaires. Cela veut donc dire que l’information est répartie entre les sites internet d’autant d’institutions, qui n’ont au demeurant aucune obligation de conserver l’information à l’avenir (voir « Immunity from Seizure / Approved Museum and Galleries », en ligne : Arts Council England <artscouncil.org.uk> [perma.cc/HE65-EKCF] Australian Government <www.arts.gov.au> [perma.cc/BPB3-ZSGU]. Cela étant, nous pourrions nous inspirer du fait que, comme en Suisse, les règlementations britannique et australienne exigent la publication d’un grand nombre d’informations sur les biens culturels, incluant une photographie dans la plupart des cas, ce qui est largement préférable pour favoriser les recherches de provenance (voir Ordonnance (Suisse, 2005), supra note 41, art 7; Règlement (Royaume-Uni, 2008), supra note 143, art 11; Règlement (Australie, 2014), supra note 143, art 11). Les décrets québécois actuels contiennent, en comparaison, assez peu d’informations.
-
[146]
Voir D 870-2013, supra note 125.
-
[147]
Voir D 889-94, (1994) GOQ II, 3305, modifiant D 243-94, (1994) GOQ II, 1408 (relativement à l’exposition au Musée canadien des civilisations).
-
[148]
Voir D 738-2016, supra note 140.
-
[149]
Voir notamment D 1467-88, (1988) GOQ II, 5127 (relativement à l’exposition « Chefs-d’oeuvre de la Galerie nationale de Prague : grands maîtres de la peinture moderne » au Musée national des beaux-arts du Québec); D 1498-92, (1992) GOQ II, 6589 (relativement à l’exposition « Toulouse-Lautrec : La collection Baldwin » au Musée national des beaux-arts du Québec); D 940-2014, (2014) GOQ II, 4051 (relativement à l’exposition « Les Grecs – d’Agamemnon à Alexandre le Grand » au Musée Pointe-à-Callière); D 1122-2017, supra note 141 (relativement à l’exposition « Aa Chiiwaaschaaniwich—Reclaiming the Ways of our Ancestors » à l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw).
-
[150]
Voir TCE Act (R-U), supra note 11, art 134(4)(b); BKLZA modifiée (Autriche), supra note 39, art 2.
-
[151]
Voir Cultural Objects on Loan Act (Australie), supra note 48, art 8(2)(a)(i).
-
[152]
Voir KGSG (Allemagne), supra note 38, arts 73, 75.
-
[153]
Voir Immunity from Judicial Seizure Statute, 22 USC § 2459(a).
-
[154]
Voir art 1412ter § 2 Code judiciaire (Belgique).
-
[155]
Voir TCE Act (R-U), supra note 11, art 137(3).
-
[156]
Voir LESTNTK (Finlande), supra note 45 art 2.
-
[157]
Voir Woudenberg et Nafziger, supra note 100 à la p 484.
-
[158]
On note que l’article 7 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (supra note 30) prévoit la délivrance automatique d’une licence d’exportation pour les oeuvres prêtées à un établissement canadien par un non-résident, afin d’éviter l’application du système des licences qui vise à contrôler l’exportation des biens culturels d’importance hors Canada. Cette disposition n’assure cependant pas l’immunité pendant que le bien culturel est présent au Canada.
-
[159]
Voir Duhaime et Labadie, supra note 52 à la p 184; van Woudenberg, supra note 6 aux pp 208–09. Aucune demande n’a été déposée devant les tribunaux.
-
[160]
Il faut ici rectifier une erreur qui s’est malencontreusement propagée dans la doctrine. Un article datant de 2005 indique que les cinq lois provinciales canadiennes empêcheraient des saisies criminelles appliquant probablement le raisonnement du volet étatique du dossier Wally sans toutefois tenir compte de l’ordre constitutionnel canadien (voir Matthias Weller, « Immunity for Artworks on Loan? A Review of International Customary Law and Municipal Anti-seizure Statutes in Light of the Liechtenstein Litigation » (2005) 38:4 Vand J Transnat’l L 997 aux pp 1018–19). Ailleurs dans l’article, l’auteur cite les dates d’entrée en vigueur des cinq lois canadiennes, et ces dates sont toutes erronées (voir ibid à la p 1011). Par la suite, et de manière plus surprenante, un article de 2011 qui porte spécifiquement sur les lois canadiennes d’immunités de saisie a explicitement repris cette analyse (voir Getz, supra note 4 à la p 211, nn 50–51), tout comme un article de 2014 portant sur la loi australienne (voir Forrest, supra note 51 à la p 157). Ainsi, trois articles affirment que les lois provinciales d’immunité de saisie empêchent toute saisie criminelle. Il est cependant évident qu’une disposition comme l’article 697 du Code de procédure civile peut seulement s’appliquer dans un contexte de procès civil au Québec, et qu’il ne saurait être d’aucune utilité pour s’opposer à une saisie en vertu du droit criminel canadien, ou même d’une loi pénale québécoise. Un débat pourrait éventuellement avoir lieu à savoir si les lois des quatre autres provinces pourraient empêcher une saisie pénale en vertu d’une loi provinciale. Mais une chose est certaine, une immunité contre les poursuites ou les saisies criminelles pourrait seulement provenir d’une loi votée par le Parlement fédéral. Les lois d’immunité décrétées par les cinq assemblées provinciales ne sauraient s’étendre aux champs de compétence fédéraux en matière de droit criminel, de douane ou de contrôle du commerce international.
-
[161]
Voir UNESCO 1970, supra note 28, art 13.
-
[162]
Voir Jennifer Mueller et Kathryn Zedde, « The Cultural Property Export and Import Act and Canada’s International Legal Obligations » (2012) 17:1 RCDP 31 aux pp 38–39. Ceci étant, le paragraphe 56(4) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7, pourrait vraisemblablement empêcher la saisie d’un bien culturel protégé par un décret provincial après un jugement rendu par une Cour fédérale en application d’une de ces dispositions de la LEIBC.
List of tables
Tableau 1
Institutions d’accueil au Québec (1976–2017)[20]
Tableau 2
Origine des prêteurs – Québec (1976–2017)
Tableau 3
Institutions d’accueil en Ontario (2003–2017)[24]