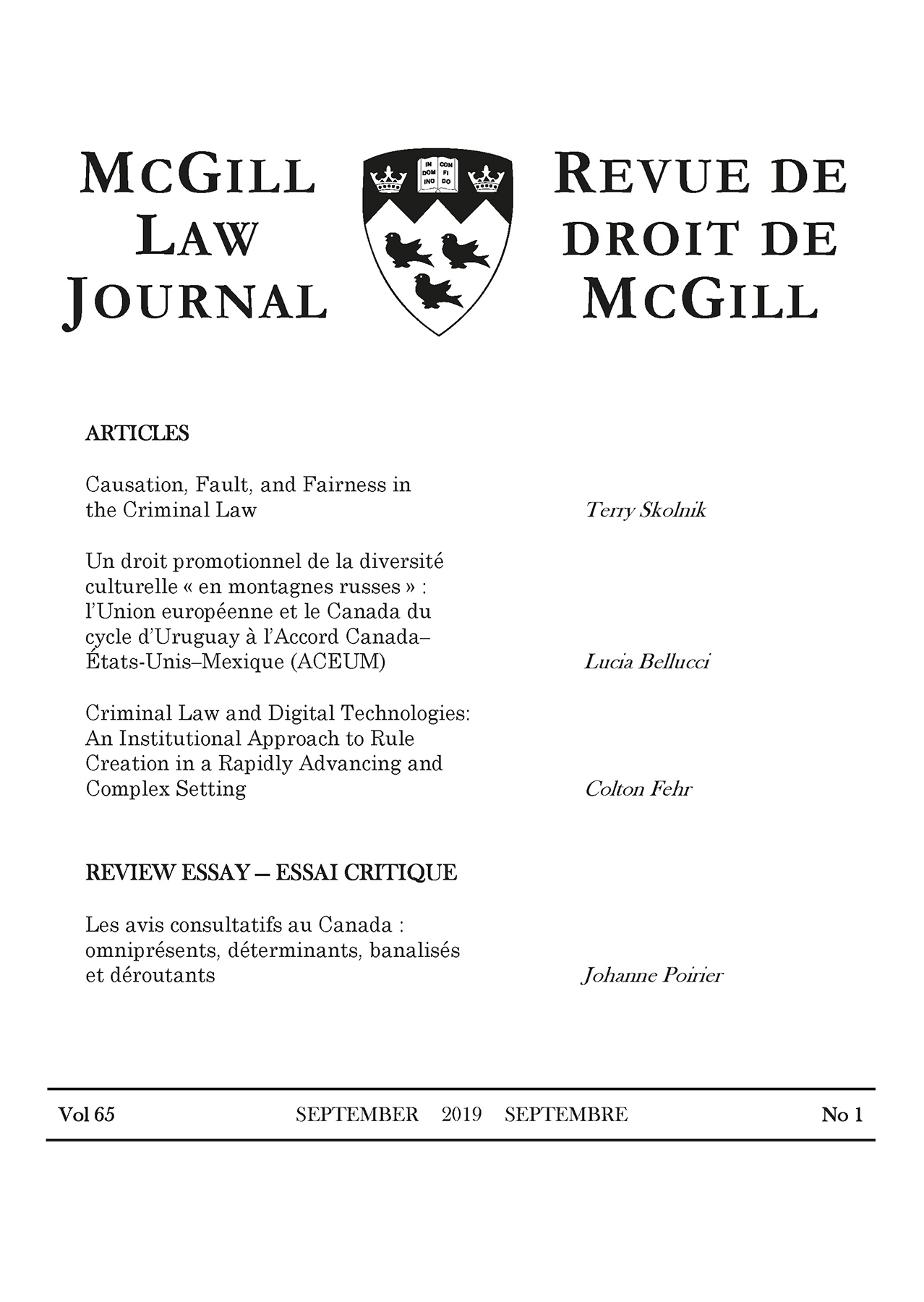Abstracts
Résumé
Les avis consultatifs font partie intégrante de la jurisprudence constitutionnelle canadienne. L’exécutif fédéral a le privilège exclusif de pouvoir soumettre pratiquement toute question de droit, abstraite ou non, à la Cour suprême du Canada, alors que les exécutifs provinciaux peuvent en faire autant auprès de leur Cour d’appel respective. Ces tribunaux ont, en principe, l’obligation de répondre. Au fil des ans, les « renvois » ont traité d’une multitude de sujets, y compris de la répartition fédérale des compétences, du rapatriement de la Constitution, du mariage entre personnes de même sexe, de la réforme du Sénat et de la possible sécession d’une province. Si l’analyse du contenu des renvois constitue un pilier de la plupart des cours de droit constitutionnel, l’institution même a étonnamment largement échappé à une analyse approfondie.
Deux ouvrages majeurs, publiés à quelques mois d’intervalle, comblent avec brio cette lacune. Dans Courts Without Cases: The Law and Politics of Advisory Opinions et Seeking the Court’s Advice: The Politics of the Canadian Reference Power, la constitutionnaliste Carissima Mathen et la politologue Kate Puddister décodent habilement la théorie et la pratique des avis consultatifs sous des angles disciplinaires distincts, mais complémentaires. Deux aspects problématiques ressortent particulièrement de cette analyse croisée.
Il s’agit, en premier lieu, du risque d’instrumentalisation des tribunaux par la branche exécutive. De fait, l’apparent affront à la séparation des pouvoirs a conduit plusieurs pays de common law (mais pas tous) à rejeter la pratique des avis consultatifs. Pourquoi n’est-ce pas le cas du Canada? En second lieu, malgré leur caractère officiellement non contraignant, les renvois sont lus, enseignés, cités, critiqués, plaidés et largement rédigés comme s’il s’agissait d’arrêts rendus en appel, arrêts qui eux sont évidemment contraignants. Comment expliquer la force normative déroutante d’« avis » qui n’ont plus de « consultatifs » que le nom?
Cet essai critique place les deux ouvrages en conversation l’un avec l’autre. L’auteure y ajoute ses propres interrogations et réflexions, notamment sur le rôle et le statut des renvois dans une perspective comparative. L’essai examine les origines, l’évolution et le cadre normatif des « avis consultatifs », ainsi que les motivations « stratégiques » qui fondent la décision de l’exécutif de demander — ou non — un avis consultatif. En conclusion, l’auteure avance une hypothèse sur cette singulière institution qui ne fonctionne pas en théorie, mais plutôt bien en pratique. Les « renvois » représenteraient-ils un autre élément de la culture constitutionnelle du Canada, qui voit s’entrecroiser et s’influencer de manière si fluide les sources formelles et informelles, écrites et non écrites, officielles et effectives du droit?
Abstract
Advisory opinions form an integral part of Canadian constitutional jurisprudence. The federal executive has the exclusive privilege of requesting that the Supreme Court of Canada provide answers on basically any question of law, abstract or not. The provincial executives can request the same of their respective Courts of Appeal. By law, Courts have to respond. Over the years, “references” have dealt with a flurry of topics, including the federal division of powers, patriation of the Constitution, same-sex marriage, Senate reform, and the eventual secession of a province. While canvassing the content of references is a mainstay of most constitutional law courses, the actual institution of “advisory opinions” is surprisingly understudied.
Two significant books, published just months apart, valiantly address this lacuna. In Courts Without Cases: The Law and Politics of Advisory Opinions and Seeking the Court’s Advice: The Politics of the Canadian Reference Power, constitutionalist Carissima Mathen and political scientist Kate Puddister skillfully decode the theory and practice of advisory opinions from distinct, but complementary disciplinary lenses. Two issues particularly stand out in this overlapping and interrelated analysis.
First is the risk of the executive’s instrumentalization of courts. In fact, the apparent affront to the separation of powers has led several (but not all) common law jurisdictions to reject the practice of advisory opinions. Why is this not the case in Canada? Second, despite their officially non-binding nature, references are read, taught, cited, critiqued, argued and largely drafted just as regular appeal decisions. How can the puzzling normative force of advisory opinions—which have, over time, become “advisory” in name only—be explained?
This review essay puts the two books in conversation with one another. The author adds her own interrogations and insights, notably on the role and legal status of references in comparative perspective. The essay surveys the origins, evolution and normative framework of “advisory opinions,” as well as the “strategic” motivations behind the executive’s decision to request—or not—an advisory opinion. In conclusion, the author offers a hypothesis on this odd institution that does not work in theory, but actually works in practice: could “references” be another element in Canada’s singular constitutional culture, in which formal and informal, written and unwritten, official and effective sources of law so fluidly dance together?
Article body
Introduction
Dès sa création, en 1875, la Cour suprême du Canada s’est vue conférer un rôle de conseillère du pouvoir exécutif fédéral. Cette juridiction « spéciale » s’exerce en parallèle de sa fonction judiciaire principale, celle de trancher des appels en dernière instance[1]. Rapidement, les exécutifs provinciaux se sont également dotés d’un accès tout aussi privilégié aux conseils juridiques de leur Cour d’appel respective[2]. Si cette fonction consultative du pouvoir judiciaire au bénéfice du pouvoir exécutif semble exceptionnelle — particulièrement au regard du principe de la séparation des pouvoirs —, sa pratique, elle, ne fait aucunement figure d’exception. Environ un quart des « décisions » rendues par la Cour suprême du Canada en matière constitutionnelle prennent la forme d’avis consultatifs, également connus sous le terme « renvois »[3]. Entre 1875 et 2017, le plus haut tribunal du pays et les différentes cours d’appel provinciales ont rendu plus de deux cents de ces « avis ».
L’histoire constitutionnelle canadienne est en effet jalonnée de ces « conseils juridiques » formulés par les juges, à la demande du pouvoir exécutif des membres de la fédération. Si certains ont traité de questions relativement techniques[4], la vaste majorité a eu pour effet de façonner le paysage constitutionnel canadien : avis fondateurs du Comité judiciaire du Conseil privé en matière de fédéralisme, rapatriement de la Constitution, émergence et évolution de l’État-providence, règles entourant l’éventuelle sécession d’une province, capacité d’Ottawa de légiférer pour la « paix, l’ordre et le bon gouvernement » en période d’urgence, répartition des compétences relatives au mariage entre personnes du même sexe, « auto-constitutionnalisation » de la Cour suprême et règles de nomination à cette Cour, protection de droits linguistiques et de l’indépendance judiciaire, constitutionnalité de mécanismes coopératifs dérogeant à la structure dualiste du fédéralisme canadien et assimilation de la constitution canadienne à un « arbre vivant » méritant une interprétation évolutive.
Bref, les « renvois » font tout simplement partie intégrante du droit public et de la jurisprudence constitutionnelle. L’enseignement du droit constitutionnel serait drôlement appauvri si l’on devait en retirer l’analyse des avis consultatifs[5]. La plupart du temps on les lit, on les enseigne, on les cite, on les analyse, on les invoque par analogie, on les conteste, on les remet en cause de la même manière que les arrêts. Et, de nos jours, l’on s’interroge rarement sur le caractère unique, paradoxal et problématique de cette étrange institution. Si plusieurs aspects des avis — leurs origines, leur statut, leur utilité — ont été explorés au fil du temps, ils n’avaient étonnamment pas fait l’objet d’un examen approfondi et transversal sous forme de monographie[6].
Or, dans une étonnante et heureuse coïncidence, deux ouvrages marquants, fruits de nombreuses années de recherche, sont parus presque simultanément en 2019. Courts Without Cases: The Law and Politics of Advisory Opinions de Carissima Mathen[7] et Seeking the Court’s Advice: The Politics of the Canadian Reference Power de Kate Puddister[8] s’attaquent avec brio aux nombreuses facettes de l’une des institutions centrales du droit constitutionnel au Canada.
Les deux auteures accomplissent ces exercices de décodage descriptifs et analytiques dans une langue accessible et rythmée, en suivant des structures et des schémas narratifs cohérents. Ainsi, au fil de dix chapitres (pour Mathen) et six chapitres (pour Puddister), on voyage à travers l’histoire et la genèse des avis consultatifs, on découvre les dessous de cette riche pratique, on lit avec intérêt des synthèses contextualisées de nombreux renvois marquants, on s’interroge sur la tension entre ce « phénomène » et le principe de la séparation des pouvoirs et l’on est forcé de revoir la définition même du droit.
Deux facteurs confèrent une originalité interpellante à l’institution des « renvois » dans le contexte canadien. D’une part, l’exclusivité du privilège de requérir un tel avis juridique est réservée au pouvoir exécutif, qui en choisit le moment et en formule les questions. D’autre part, bien que ces « avis » ne soient pas formellement contraignants en droit, ils sont immanquablement respectés par tous les acteurs, y compris par les juges eux-mêmes. Ils sont, en réalité, dotés d’une portée normative indissociable de celle des jugements. Les deux monographies abordent ces deux volets fondamentaux de manière rigoureuse, selon des angles d’approche, des méthodologies et des intensités distinctes. Bien que visant le même objet, et analysant en partie le même matériau, ces textes sont largement complémentaires[9].
Ainsi, Carissima Mathen s’intéresse particulièrement aux origines britanniques de l’avis consultatif (les juges étant, à l’origine, des conseillers du Roi) et à son évolution dans le contexte canadien. D’une plume agile, la constitutionnaliste de l’Université d’Ottawa synthétise presque 150 ans de jurisprudence « consultative ». Et surtout, la juriste tente de replacer cette pratique dans la tradition juridique de common law et s’attaque au mystère de la valeur normative paradoxale de ces avis, notamment par une incursion en théorie du droit.
Pour sa part, politologue à l’Université Guelph, Kate Puddister décortique adroitement les nombreuses facettes de la pratique des avis consultatifs. Ce décodage empirique sert de fer de lance à l’objectif principal de sa recherche, celui d’identifier les motivations — juridiques, mais essentiellement politiques — des branches exécutives des membres de la fédération canadienne qui initient — ou non — des renvois. Alors que plusieurs études ont porté sur les « litiges stratégiques » dans le domaine des droits et libertés ou des droits des minorités, cette étude met en lumière le rôle des « renvois stratégiques » élaborés par le pouvoir exécutif.
Mathen s’intéresse également à ces motivations de l’exécutif, mais de manière plus succincte. Puddister évoque l’étonnante force normative des avis consultatifs, mais sans vraiment en interroger les causes. Chacune approfondit avec une grande dextérité intellectuelle l’une de ces questions, ce qui justifie amplement la lecture combinée des deux ouvrages. Par ailleurs, tant la juriste que la politologue s’interrogent sur l’accroc que pose la pratique des avis consultatifs en droit canadien aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire.
En effet, n’est-il pas insolite que les juges agissent en tant que « conseillers juridiques » exclusifs de la branche exécutive? Que seul le gouvernement fédéral puisse directement saisir la Cour suprême pour obtenir un avis juridique relatif à la répartition des compétences, par celle-ci[10]? Que les législateurs ne puissent, eux, requérir un tel avis? Ce privilège de l’exécutif n’est-il pas encore plus déroutant lorsque l’on constate qu’avec le temps, les « avis » consultatifs ont acquis une telle force normative qu’ils sont traités comme des sources de droit par tous les acteurs de l’ordre constitutionnel canadien?
Un peu à l’image d’un diagramme de Venn, certains sujets sont traités dans les deux ouvrages (avec des distinctions qui justifient des lectures parallèles), alors que certains aspects ne sont réellement approfondis que par une seule des auteures, chacune à travers sa lorgnette disciplinaire et méthodologique propre. Sans réellement dialoguer l’un avec l’autre[11], les deux ouvrages se font échos et représentent les exposés les plus complets sur le phénomène des avis consultatifs.
Sans prétendre faire honneur à la richesse des contributions majeures que représentent Courts Without Cases et Seeking the Court’s Advice, le présent essai critique rappelle l’origine des avis consultatifs (partie I), relève des points saillants de la pratique « consultative » (partie II), survole les fondements « stratégiques » expliquant la décision d’un exécutif d’initier — ou non — un renvoi (partie III), explore l’étrange normativité des « avis consultatifs » (partie IV) et la tension entre ces derniers et les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire (partie V) pour questionner ce qui semble être une forme d’exceptionnalisme canadien en la matière (partie VI). La conclusion appelle à investir les nombreux chantiers de recherche, notamment en droit comparé, auxquels ces deux monographies d’exception serviront assurément de tremplin.
I. L’origine, l’évolution et le cadre normatif des avis consultatifs
Dans la fascinante partie historique de son ouvrage, Mathen nous rappelle qu’au fil du long processus de dilution de la monarchie absolue, les rois anglais s’appuyaient sur les avis de la curia regis[12], conseils qui ne liaient aucunement les monarques, évidemment. La procédure d’avis s’est maintenue au Royaume-Uni, faisant même l’objet d’une disposition législative lors de la consolidation du Comité judiciaire du Conseil privé (CJCP) en 1833[13].
La procédure consultative au Canada serait donc l’un des nombreux vestiges de l’héritage constitutionnel britannique sur lequel est érigé le droit public[14]. Fait notoire, la procédure consultative a largement été abandonnée au Royaume-Uni, alors qu’elle a été mobilisée avec vigueur tout au long de l’histoire constitutionnelle du Canada, s’immisçant dans un contexte fédéral qui confiait au pouvoir judiciaire une incontournable mission d’arbitrage[15].
D’ailleurs, lors de son adoption en 1875, la possibilité offerte au gouvernement fédéral de solliciter un avis de la Cour suprême, dont il nommait tous les juges, était perçue comme un autre outil dans l’arsenal de la suprématie d’Ottawa au sein de la fédération. Le premier ministre MacDonald y voyait un moyen de contester les initiatives des provinces, en complément du pouvoir de désaveu des lois provinciales[16]. Dans les années 1890, certains parlementaires soutenaient d’ailleurs que les avis devraient être requis préalablement à l’exercice de ce pouvoir[17]. Or, si des avis ont pu précéder certains désaveux, ils ont parfois été imbriqués avec ceux-ci dans un même contexte houleux de tensions fédérales-provinciales[18].
Appréciant l’intérêt que représente la procédure d’avis consultatif, les provinces ont assez rapidement légiféré afin de conférer un pouvoir similaire à leur branches exécutives et judiciaires[19]. Depuis 1922, ces avis peuvent faire l’objet d’un « appel » devant la Cour suprême[20]. Ironie du sort, alors que le pouvoir de désaveu tombait doucement en désuétude, les provinces ont elles-mêmes commencé à habilement recourir aux avis pour défendre leurs compétences et remettre en cause des initiatives fédérales, voire certaines lois émanant d’autres provinces[21]. L’outil privilégié du pouvoir centralisateur à Ottawa s’est donc rapidement transformé en un outil pouvant être manié par les deux ordres de gouvernement.
Aujourd’hui, en vertu de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, le gouverneur en conseil (c’est-à-dire l’exécutif fédéral) « peut soumettre au jugement de la Cour » [nos italiques] toute question importante de droit ou de fait en matière constitutionnelle, voire toute autre question de droit ou de fait dans d’autres domaines[22]. Si le gouvernement a le loisir de demander un avis, la Cour, elle, doit « d’office » considérer ces questions « importantes » et doit donc les traiter avec célérité, voire priorité[23]. Comme nous le verrons plus loin, alors que la loi impose à la Cour de répondre à toutes les questions qui lui sont adressées[24], celle-ci a interprété l’injonction législative de manière manifestement souple et créative.
De manière un peu incongrue, la Loi sur la Cour suprême permet donc au gouvernement de « soumettre au jugement de la Cour » [nos italiques] toute question de fait ou de droit, expression qui correspond, dans sa version anglaise, à « may refer to the Court for hearing and consideration ». Dans la mesure où un avis n’est justement pas un jugement, le terme est quelque peu déconcertant[25]. Cela étant, le sous-titre qui précède le paragraphe de la loi mentionne bien « Questions déférées pour avis/Referring certain questions for opinion ». Personne ne conteste donc la nature officiellement « consultative » des réponses données par la Cour aux questions ainsi soulevées par le gouvernement[26].
II. L’histoire constitutionnelle canadienne via la pratique des avis consultatifs
Revoir la « jurisprudence » consultative donne l’impression de lire une « biographie constitutionnelle » du Canada qui relate les évènements bien connus et lève le voile sur des aspects oubliés, mais néanmoins souvent déterminants dans l’évolution des rapports entre institutions et communautés au sein de la fédération.
Mettant à profit son oeil de juriste, au fil de quatre chapitres « thématiques », Mathen analyse — de façon souvent détaillée — un nombre significatif d’avis consultatifs ayant jalonné l’histoire constitutionnelle canadienne[27]. À telle enseigne que l’on pourra utiliser des extraits de l’ouvrage pour accéder à la « jurisprudence » comme telle, dans de nombreux domaines, sans trop d’égard aux questions techniques et théoriques entourant la source « contentieuse » ou « consultative » du texte rédigé par les juges. Si la plupart de ces avis ont été commentés, à la pièce, par le passé, les regrouper en un seul volume a la vertu de souligner l’importance collective de ces avis dans l’évolution du droit constitutionnel canadien.
Ce qui est frappant, c’est qu’outre la mise en contexte, ces synthèses auraient pu décrire le raisonnement et les conclusions de jugements rendus à l’issue d’un litige. Le simple fait que l’on puisse analyser la question en cause dans un renvoi, tout comme si elle avait été soulevée en appel, offre une parfaite illustration du phénomène saisi par l’auteure : les renvois remplissent essentiellement la même fonction et ont en pratique la même force normative que les arrêts en appel.
Pour sa part, Puddister mentionne et contextualise la plupart des mêmes avis, mais elle s’intéresse peu à leur contenu ou à leurs conclusions. Elle dissèque méthodiquement la pratique des renvois qu’elle synthétise de manière éclairante par le biais de tableaux et graphiques[28]. Ayant épluché 209 avis rendus par les cours d’appel et la Cour suprême entre 1875 et 2017, la politologue les scrute sous différents angles. Elle examine les fluctuations dans la fréquence des renvois, identifie les « instigateurs » principaux selon les périodes[29] et pointe les domaines du droit les plus à même de faire l’objet de renvois (le fédéralisme étant bon premier!). Elle note que les gouvernements majoritaires sont plus enclins à instituer une procédure de renvoi que leurs homologues minoritaires.
Puddister souligne que des intervenants apportent un éclairage à la Cour dans 93% des renvois (contre 55 % des appels en Cour suprême)[30]. Elle constate que les conclusions unanimes sont moins fréquentes dans le contexte des avis, ce qui s’explique sûrement par l’importance aujourd’hui quasi-systématique des questions juridiques abordées alors que les appels peuvent porter sur des questions beaucoup plus pointues, et techniques[31]. Par ailleurs, les juges confirment la validité entière ou partielle d’une loi contestée dans approximativement les deux tiers des cas, soit la même proportion que dans le cas de contestations soulevées dans le contexte d’un appel[32].
Il est communément admis que la jurisprudence « consultative » du CJCP a contribué à consolider les compétences provinciales et à contrer une tendance centralisatrice à la fois souhaitée et assumée à Ottawa. Les deux auteures démontrent que les questions relatives aux institutions et au fédéralisme occupent — encore aujourd’hui — la part du lion de la jurisprudence « consultative ». Même depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, environ 50 % des avis rendus par la Cour suprême portent toujours sur des questions mettant en jeu l’équilibre fédéral[33], bien que l’essentiel de la jurisprudence constitutionnelle soit dorénavant ancrée dans le domaine des droits fondamentaux, des droits linguistiques et des droits relatifs aux peuples autochtones.
Fait interpellant, justement, seul semble avoir échappé à la procédure consultative le domaine des droits ancestraux ou issus de traités. En matière de droits fondamentaux, mais surtout dans les domaines affectant le droit des peuples autochtones, les gouvernements ont apparemment adopté une attitude plus passive, attendant que les « intéressés » montent un dossier (parfois financé par l’État) à travers tous les échelons de la hiérarchie judiciaire. Malheureusement, ni Mathen, ni Puddister — qui a pourtant mené des entretiens semi-dirigés — ne nous éclairent vraiment sur ce choix stratégique[34].
Les recherches de Puddister démontrent que la cadence des recours aux avis a augmenté au cours de deux périodes particulièrement tourmentées[35]. La première a suivi la Grande Dépression et les tentatives tant fédérales que provinciales d’instituer des programmes sociaux (les années 1930). Ottawa était largement aux commandes lors de ce premier « sommet consultatif », période pendant laquelle l’exécutif fédéral maniait tant le renvoi que le désaveu[36].
La seconde intervient cinquante ans plus tard. En effet, la décennie des années 1980 a, à nouveau, donné lieu à un nombre impressionnant d’avis consultatifs de la Cour suprême et des cours d’appel provinciales (29 en 10 ans)[37]. Dans cette ère de « métapolitique constitutionnelle », les exécutifs ont mobilisé les juges pour tenter de clarifier les règles du jeu ou pour gagner un avantage stratégique, voire les deux, dans des contextes politiques particulièrement tendus. C’est assurément le cas du renvoi sur la réforme du Sénat de 1980[38], de celui sur le rapatriement de la Constitution de 1981[39] et de celui sur le véto du Québec de 1982[40].
Ce second « sommet consultatif » est également marqué par un nombre important de renvois portant sur la répartition des compétences en matière de ressources naturelles, un autre domaine riche en tensions intergouvernementales[41]. Durant cette période, au contraire du précédent « sommet » des années 30, une forte majorité des renvois est initiée par les provinces, qui disposent de plus de ressources qu’au sortir de la crise financière de 1929, et qui cherchent à défendre leurs compétences et à remettre en cause diverses initiatives fédérales.
III. Les renvois : un avantage stratégique réservé à l’exécutif, un risque pour le pouvoir judiciaire
Pourquoi les exécutifs ont-ils recours à la procédure de renvoi? La question peut sembler saugrenue : à l’instar du Roi qui pouvait demander conseil à sa curia regis, le pouvoir exécutif de chaque ordre de gouvernement dispose du privilège de saisir les juges siégeant au sommet de la hiérarchie judiciaire pour l’aider à clarifier une question juridique complexe. La gestion des affaires publiques, surtout dans une démocratie fédérale, nécessite, au quotidien, la clarification de questions juridiques complexes. Consultons donc les experts eux-mêmes!
Mais tout n’est pas si simple. D’une part, les juristes de l’État — et au premier chef, les ministres de la Justice — sont les premiers conseillers juridiques tant des gouvernements fédéral que provinciaux. En matière constitutionnelle, le Ministère fédéral de la Justice doit même émettre un certificat de conformité avec la Charte canadienne pour tout projet de loi déposé au Parlement[42]. D’autre part, la demande d’avis consultatif n’est aucunement systématique, contrairement, par exemple, au contrôle de constitutionnalité a priori exercé par le Conseil d’État belge ou le Conseil constitutionnel français[43]. Ainsi, pour quelles raisons, les gouvernements entament-ils — parfois — une procédure d’avis? Et, au contraire, dans quelles circonstances renoncent-ils à le faire?
Puddister et Mathen offrent chacune un catalogue de raisons justifiant le recours à des avis consultatifs[44]. Les motifs identifiés par les deux auteures se recoupent largement. Examinées de façon conjointe, les « raisons » qui motivent les exécutifs à requérir un avis incluent évidemment la clarification d’une controverse juridique, parfois pour obtenir des directives avant d’introduire une nouvelle politique publique. Dans le cas d’Ottawa, il peut s’agir d’un souhait d’obtenir un avis ayant pour effet d’harmoniser les solutions à travers le pays. L’avis peut également résulter de la décision d’un gouvernement de refiler une « patate chaude » aux juges pour éviter de devoir adopter une position tranchée face à une question controversée. Mieux vaut qu’une branche n’ayant aucune imputabilité électorale rende une « décision » impopulaire ou divisant l’opinion publique (et parfois même le caucus du parti au pouvoir)[45]. Par contre, si l’avis confirme une position appréciée par l’électorat, le gouvernement peut être salué d’avoir demandé un avis pour confirmer la légitimité de ses actions. Par ailleurs, l’exécutif peut vouloir gagner du temps — et ralentir un processus politique — en saisissant les tribunaux. Il peut aussi, au contraire, souhaiter obtenir de façon relativement expéditive l’élucidation d’une incertitude juridique, qui pourrait prendre des années à parvenir à la Cour suprême par la voie contentieuse régulière.
Puddister analyse nombre de situations où le pouvoir exécutif semble instrumentaliser les juges en décidant — ou non — de demander un avis, en choisissant le moment de le faire, et en formulant les questions, parfois de façon particulièrement rusée, pour justifier un renvoi[46]. Les avis consultatifs constitueraient ainsi des stratégies politiques, au même titre que les négociations inter-gouvernementales, par exemple. Mobilisant la théorie de la délégation (agent-principal), la politologue dépeint les renvois comme un moyen, pour le pouvoir exécutif, de temporairement transférer aux tribunaux des controverses politiques[47].
De cette perspective, la Cour parait être une alliée du pouvoir exécutif qui la saisit, et ce même si elle est en désaccord avec ce dernier sur les questions juridiques en jeu. Pour tester ces hypothèses, Puddister a mené un certain nombre (relativement modeste[48]) d’entretiens semi-dirigés avec des acteurs significatifs (anciens Procureurs généraux, au moins un ancien premier ministre provincial, des constitutionnalistes ayant plaidé des renvois et conseillé les exécutifs dans leur prise de décision sur l’opportunité d’instituer une procédure de renvoi)[49]. Cette recherche conduit la politologue à conclure que dans bien des cas, le « résultat » de la procédure de renvoi (la réponse juridique obtenue) importe moins que l’institution de la procédure[50].
Par ailleurs, ayant épluché certains documents déclassifiés du cabinet fédéral, Puddister examine en détail la décision de ne pas recourir à une procédure de renvoi dans deux dossiers controversés, celui relatif à la « Loi du cadenas » et celui concernant l’interdiction du « blasphème religieux », tous deux liés à la période duplessiste[51]. Le choix de ne pas confronter le gouvernement du Québec, surtout dans un contexte où la question constitutionnelle n’était pas sans équivoque, est relaté avec finesse (et fera réfléchir sur le choix actuel de ne pas initier un renvoi dans le contexte de la loi québécoise sur la laïcité de l’État)[52]. Ce choix historique est aussi habilement contrasté avec la décision de saisir la Cour suprême d’avis consultatifs sur la constitutionnalité de lois albertaines affectant le système bancaire, à la même époque, dans un contexte où la reconnaissance du caractère ultra vires des initiatives de la province était plus prévisible[53].
Les renvois analysés dans ce contexte datent sérieusement, la chercheuse n’ayant pu consulter que les documents du cabinet (qui prend, in fine, la décision d’initier un renvoi) antérieurs à 1976. L’exercice reste néanmoins tout à fait fascinant. Espérons qu’il pourra être repris pour analyser les motifs ayant mené à la salve de renvois rendus depuis. Sans avoir pu bénéficier des documents confidentiels, Mathen discute de la controverse plus récente entourant le refus par le gouvernement fédéral d’instituer un nouveau renvoi relatif à l’aide médicale à mourir, forçant des individus à introduire de (longs) recours plus conventionnels pour contester la conformité de certaines limites au droit d’accès à cette aide avec la Charte canadienne[54].
Les deux auteures partagent l’avis que la principale raison pour un gouvernement de saisir un tribunal dans une procédure d’avis est de profiter de l’autorité et de la légitimité dont jouissent les plus hauts tribunaux du pays, ce que Mathen décrit comme son « imprimatur ». Or, cette légitimité ne pourrait survivre si la Cour était vue comme le pantin de l’exécutif. Il faut donc recourir au renvoi de façon pondérée et la Cour doit elle-même répondre avec une certaine prudence.
IV. La déroutante force normative des avis consultatifs
Dans une étude de droit comparé réalisée pour le compte du Parlement européen au sujet de la Cour suprême du Canada, je soulignais en termes laconiques que si les « Renvois » ne sont pas formellement contraignants, ils sont invariablement respectés, au point de « faire jurisprudence »[55]. Le directeur du projet (un constitutionnaliste de tradition civiliste continentale!) a exprimé sa perplexité en m’adressant le commentaire suivant : « Cette apparente contradiction mérite d’être creusée : non contraignant[s] mais respecté[s]? Cela ne crée pas de l’insécurité juridique? ». Les Canadiens répondront simplement : il n’y a pas d’insécurité juridique dans la mesure où les avis sont, justement, respectés comme des jugements et que l’on peut distinguer la force contraignante formelle (non-contraignants) et la portée normative de l’instrument (toujours respectés)[56]. Cela dit, la perplexité d’un observateur « étranger » est toujours une source féconde de réflexion[57]. Comment expliquer non seulement l’existence et la vigueur de la procédure, mais le respect aujourd’hui incontesté, voire rarement questionné, des avis consultatifs[58]?
En fait, en 1912, le CJCP avait exposé son inconfort face à la pratique consultative, soulignant qu’en rendant de tels avis, les tribunaux n’agissaient pas de manière judiciaire. Le Conseil privé a néanmoins statué que cette fonction pouvait être conférée à la Cour, dans la mesure où le gouverneur-en-conseil restait libre de suivre — ou non — l’avis donné, qui reste consultatif (« advisory »)[59]. C’est donc le caractère non contraignant qui sauvegarde l’institution.
Or, pratiquement depuis le début, ces avis ont été respectés par tous les acteurs — judiciaires et non judiciaires — de sorte qu’ils ont en réalité une portée normative indissociable de celle des jugements. Ainsi, les branches politiques n’ont jamais rejeté un avis en affirmant qu’il ne s’agissait que d’une « opinion » non contraignante : elles accordent leur comportement au dispositif de l’avis[60].
À titre d’exemple, lorsque la Cour a conclu à l’existence d’une convention constitutionnelle (elle-même non juridiquement contraignante) selon laquelle toute demande de modification des lois constitutionnelles du Canada adressée à Westminster nécessitait l’appui d’un nombre substantiel de provinces, Ottawa est retourné à la table des négociations[61]. De même, lorsque la Cour suprême a déclaré — par voie d’avis — que certains projets de réforme du Sénat nécessitaient des amendements constitutionnels, les acteurs ont modifié leurs comportements. Ils ont soit relancé les négociations, soit abandonné leurs projets. De manière similaire, lorsque la Cour suprême a conclu — par voie d’avis — que la nomination du juge Nadon à la Cour par l’exécutif fédéral non seulement contrevenait à la loi, mais également qu’une partie de cette loi avait acquis une nature constitutionnelle[62], le gouvernement Harper a noté son désaccord. Il n’a toutefois pas insisté et a nommé un autre juge[63].
Fait plus marquant encore, la condition de constitutionnalité a — en catimini — largement été mise au rancart par les juges, alors même que la pratique s’intensifiait. Ainsi, dans le Renvoi sur la sécession, l’amicus curiae remettait en cause la constitutionnalité de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême — pour la première fois depuis 1912 — et donc de la fonction « consultative » de la Cour telle qu’elle avait évolué et qu’elle était utilisée en l’espèce. La Cour a esquivé la question, en citant l’avis du CJCP à l’appui de son affirmation que la procédure d’avis est constitutionnelle, sans toutefois mentionner la condition de validité épinglée par le CJCP en 1912, soit que l’avis ne peut avoir qu’une valeur consultative[64]. Pourtant, le juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer, s’exprimant dans la presse quelque temps après le Renvoi, affirmait que ce dernier « n’est qu’une opinion [et que ni] le Québec ni le restant du Canada n’est obligé de suivre notre opinion »[65].
Tout au long de son ouvrage, mais surtout dans les deux derniers chapitres, Mathen interroge avec perspicacité cette mystérieuse normativité. Elle le fait en deux temps. D’une part, tout en notant ce qui distingue officiellement les avis des jugements, elle épingle leurs nombreux parallèles. D’autre part, elle se tourne vers la théorie du droit afin de tenter de décoder la force normative d’avis qui ne sont, a priori et en principe, pas contraignants en droit.
A. Les similitudes procédurales entre les jugements en appel et les avis
Mathen expose à quel point les avis revêtent pratiquement les mêmes atours que les litiges donnant lieu à des jugements, et soutient que ces similitudes expliquent en partie la portée normative des renvois[66]. Au tout début, la Cour suprême n’était pas tenue de communiquer ses motifs lorsqu’elle rendait un avis à l’exécutif fédéral. Suite à des protestations de la part des provinces, la loi a été amendée en 1891 sommant la Cour de publier les motifs des avis au même titre que les jugements. L’écart entre avis et appels se rétrécissait. Aujourd’hui — et depuis longtemps — outre certains éléments accessoires, tel l’intitulé, l’exposé des questions et (le cas échéant) le résumé d’un avis antérieur rendu par une cour d’appel provinciale, le texte d’un avis consultatif est donc pratiquement impossible à différencier d’un arrêt en appel.
Dans les deux cas, les procédures tant écrites qu’orales prennent la forme contradictoire (adversarial) typique de la common law. Des « parties » défendent différentes positions, quitte à faire appel à des amicus curiae lorsqu’une « partie » prenante refuse de participer[67] ou lorsque la Cour souhaite un éclairage supplémentaire[68]. Les intervenants sont présents en nombre en fait plus important que lors des appels. Ceci découle logiquement du grand intérêt que suscitent la plupart des renvois, tant d’un point de vue juridique que, souvent, d’une perspective sociale. Les modes de raisonnement et d’interprétation employés dans les motifs des juges sont identiques, qu’il s’agisse d’arrêts ou d’avis consultatifs. Les juges rédigent les deux de la même façon, y compris par la voie d’opinions concordantes et dissidentes.
Les modes de preuve diffèrent évidemment : quoiqu’agissant en « première instance » dans le contexte d’un renvoi, la Cour suprême et les cours d’appel des provinces ne s’appuient que sur une preuve documentaire, et n’entendent pour ainsi dire jamais de témoins assermentés, sujets à contre-interrogatoires, etc. Cela étant, Mathen soutient que le recours à la preuve extrinsèque et à la preuve de sciences sociales — admise en premier lieu dans le contexte de renvois[69] — est maintenant largement admise dans les litiges traditionnels, ce qui crée, encore une fois, un rapprochement, du moins partiel.
S’il y a un aspect qui devrait distinguer ces deux types d’instruments, ce devrait être celui des « réparations ». Or, le ton est souvent similaire et péremptoire : il n’emprunte généralement pas la forme conditionnelle d’un « conseil » ne devant qu’éclairer son destinataire et non pas réellement guider son comportement, et a fortiori s’imposer à tout l’ordre juridique[70]. À titre d’exemple, parmi tant d’autres, dans le Renvoi sur le Sénat de 2014, la Cour écrit que la majorité des changements envisagés « ne [peut] être apporté[e] qu’au moyen de modifications de la Constitution » (« can only »)[71]. Aucune forme conditionnelle, aucune suggestion que la Cour ne fait qu’informer le gouvernement que ses initiatives sembleraient nécessiter des amendements constitutionnels, question qui ne pourrait être tranchée de manière définitive que dans le cadre d’une procédure judiciaire traditionnelle. Autre exemple frappant, dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, la Cour a suspendu la « déclaration » d’invalidité des lois manitobaines pour éviter un chaos normatif qui aurait été contraire à la primauté du droit[72]. Si un avis n’était que « consultatif », la Cour aurait pu laisser au soin des branches politiques l’élaboration d’une solution. Conscients de l’impact de l’avis qu’ils rendaient, les juges en ont suspendu l’effet! Comme le note si finement Mathen, la Cour ne tente même pas de couvrir ses conclusions d’une feuille de vigne qui en protégerait formellement le caractère « consultatif »[73].
Enfin, la meilleure illustration du statut qu’accordent les juges à leurs propres avis « consultatifs » provient sans doute de la façon dont ils les considèrent comme des précédents judiciaires. Le CJCP a lui-même commencé à traiter des avis comme précédents peu de temps après avoir posé leur condition de validité, qui est, justement, qu’ils ne soient pas contraignants! Depuis, la Cour suprême elle-même les cite tels des précédents et les liste dans la catégorie « arrêts/cases » dans les Recueils officiels. De surcroît, les juges appliquent aux avis consultatifs la méthodologie de common law permettant de nuancer ou d’écarter le stare decisis de jugements antérieurs. Ainsi, dans Bedford, la Cour suprême devait déterminer, dans le cadre d’un arrêt en appel, si les tribunaux inférieurs — et elle-même — étaient liés par un Renvoi qu’elle avait rendu un peu plus de vingt ans auparavant[74]. La Cour aurait pu simplement signaler qu’elle n’était pas contrainte de suivre un de ses avis non contraignants. Elle a plutôt traité le Renvoi comme un précédent « régulier » et s’est engagée à déterminer si la juge de première instance avait eu raison, dans les circonstances, de s’éloigner du précédent « consultatif »[75].
Par ses descriptions minutieuses, Mathen nous convainc qu’il n’y a pratiquement pas de différence entre jugements et avis. Mais comment expliquer cette correspondance? Pourquoi la distinction entre jugements et avis s’est-elle estompée à ce point? Toujours dans l’optique de sonder ce que l’on pourrait décrire comme l’« étrange normativité » des avis consultatifs[76], Mathen se tourne vers certaines théories du droit.
B. La théorie du droit à la rescousse de cet étrange phénomène
Cette incursion de Mathen en théorie du droit est opportune, quoiqu’assez schématique. Rejetant la conception austienne du droit comme un « ordre » assorti d’une « sanction », Mathen évoque HLA Hart, pour qui le droit est un « système de règles »[77]. La pensée de Hart, notamment en ce qui a trait aux règles de reconnaissance, n’est malheureusement pas vraiment mobilisée par l’auteure[78]. La juriste s’appuie plutôt sur Joseph Raz, pour qui la caractéristique principale du droit est son « autorité »[79]. Une autorité qui entraine le respect parce qu’elle est légitime. Pourquoi un « avis » et un jugement feraient-ils également autorité? Parce que, selon Mathen, tant l’émetteur des avis consultatifs (la Cour) que le contenu de ceux-ci exercent une égale autorité dans le contexte canadien, notamment en raison des similitudes « procédurales » que je viens d’évoquer. Si je comprends bien, ce serait cette autorité qui aurait pour effet d’estomper la frontière entre le statut juridique formel et informel des jugements en appel et des avis consultatifs.
Dans la mesure où les avis juridiques comportent des affirmations juridiques (statements of law) que la Cour elle-même traite comme du droit, les autres acteurs de l’ordre juridique vont les considérer comme du droit devant guider leurs actions. Ils le feront, selon Mathen, afin d’éviter de remettre en cause la primauté du droit[80]. Autrement dit — et je paraphrase — un instrument officiellement non contraignant en droit doit être traité comme du droit formel, sous peine de violation de la rule of law. Joli paradoxe.
Mathen nous rappelle la distinction qu’établit Raz entre l’acte de « conseiller » et l’acte « d’ordonner », une distinction qui, si j’ai bien saisi, perdrait sa pertinence dans le contexte des avis consultatifs[81]. En effet, le destinataire de l’avis n’évalue pas la pertinence de la substance de celui-ci dans sa prise de décision finale; il se sent tout simplement lié par cet avis[82]. Pour emprunter à la pensée de Patrick Glenn (ce que Mathen ne fait pas), un avis est doté d’une autorité bien plus que « persuasive »[83]. Mais pourquoi? Deux explications sont avancées.
Premièrement, Mathen expose comment la branche exécutive, avec tout son équipage de juristes compétents, n’est aucunement dans la position de subordination du destinataire d’un ordre d’agir[84]. Elle se trouve plutôt dans un rapport d’égalité et d’interdépendance avec le pouvoir judiciaire. Il semblerait donc — Mathen ne l’écrivant pas explicitement — que ce soit ce rapport qui diluerait la distinction entre « droit » et « conseil » dans le contexte des renvois. Cela ne nous dit toutefois pas pourquoi, s’il n’est pas dans un rapport de subordination, mais d’égalité, le pouvoir politique suivrait systématiquement les « conseils » reçus. Pourquoi les considèrerait-il, une fois reçus, indissociables du « droit tout court »? Pourquoi un « égal » se sentirait-il toujours lié par son « égal », l’inverse n’étant pas vrai?
Deuxièmement, et de manière plus convaincante, me semble-t-il, ce serait la compétence et l’indépendance des juges qui auraient pour effet de renforcer leur légitimité et de conférer la même autorité à leurs énoncés, que ce soit dans un contexte de renvois ou d’appels d’une affaire litigieuse[85]. D’autant plus que les juges calquent/accolent le cadre procédural des avis à celui des affaires contentieuses. Résultat : les premiers sont en quelque sorte couronnés de la force normative des secondes. Ou, comme l’écrivent si bien Huffman et Saathoff : « At the heart of debate about the reference system is not the government’s need for and right to legal advice, but its need for and right to judicial advice » [italiques dans l’original][86].
Mais si l’autorité de la Cour et de ses déclarations exercent une telle autorité auprès du monde non judiciaire, comment expliquer que les juges eux-mêmes traitent les avis consultatifs « comme du droit »? Pourquoi, demande Mathen, les juges accorderaient-ils une force normative plus importante à un « avis consultatif » qu’au rapport fouillé d’une commission d’enquête, qui aura colligé des montagnes d’informations, entendu des dizaines de témoins, réalisé des études et commandé des expertises? Et qui est, si souvent, présidée par un (ancien) juge[87]? Dans le même ordre d’idées, pourquoi traiter différemment l’avis rendu par une cour « en fonction » et celui rendu par un ancien juge de cette même cour[88]? Le mystère reste entier.
A cet escient, il serait potentiellement porteur d’examiner ce phénomène à la lumière de la pensée de Lon Fuller, pour qui le droit inclut non seulement le droit que l’on pourrait décrire comme « positif », mais également les attentes réciproques et stabilisées (« stabilised interactional expectancies »)[89]. Au fil du temps, acteurs judiciaires et non judiciaires ont aligné leurs actions et interprétations de telles sortes que les avis exercent la même traction que les arrêts en appel sur tout l’ordre politique et juridique canadien. L’explication relèverait alors de la sociologie du droit.
V. Les renvois : un affront à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance judiciaire?
Dès leur première année d’études de droit ou de science politique, les étudiant.e.s apprennent à quel point la démocratie contemporaine est tributaire de la séparation des pouvoirs. La monarchie absolue fait graduellement place à l’État démocratique — en divisant le pouvoir entre différentes « branches »[90]. Pour éviter les risques de tyrannie, chacune occupe une fonction particulière et agit comme « contre-pouvoir » face aux autres branches. De manière schématique, l’on enseigne que le législateur, jouissant de la légitimité démocratique, adopte les lois suite à un processus de délibération. La branche exécutive met ces lois en oeuvre et « administre » l’État. Les juges appliquent le droit, l’interprètent lorsque nécessaire et tranchent les litiges. Dans plusieurs démocraties constitutionnelles, les juges peuvent également annuler des normes contrevenant à la Constitution (ou du moins, déclarer qu’elles contreviennent à celle-ci). Autrement dit, « chacun son rôle, chacun sa fonction ». La primauté du droit, la démocratie, la protection des minorités dépendent de cet équilibre entre les pouvoirs.
Après avoir posé ces jalons et cité Montesquieu et Locke, on passe ensuite des mois à déconstruire cette théorie de la séparation des pouvoirs. Ou du moins à souligner sa nature bien relative[91], particulièrement dans une fédération doublée d’un régime parlementaire suivant le modèle de Westminster qui ne connait pas de séparation étanche entre le pouvoir législatif et exécutif[92]. Par contre, si l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres branches n’est pas entière, elle est fondamentale et jalousement gardée par les juges eux-mêmes[93].
Or, lorsque le pouvoir exécutif dispose du privilège exclusif de mobiliser les juges pour obtenir un avis juridique qui fera — dans les faits — jurisprudence, l’indépendance de ceux-ci est-elle menacée? N’y a-t-il pas un risque de collusion, notamment au détriment du pouvoir législatif? Par ailleurs, lorsque le gouvernement central peut, seul, saisir directement la Cour suprême, ne menace-t-il pas la neutralité de l’arbitre du pacte fédéral? En somme, la procédure d’avis consultatif n’induit-elle pas un jeu déséquilibré tant de la perspective du fédéralisme que de la séparation des pouvoirs?
Dans certains pays de common law, les tribunaux ont jugé que les renvois étaient contraires au principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire[94]. Au Canada, les tribunaux ont pourtant, à deux reprises, et à plus de cent ans d’intervalle, rejeté l’argument selon lequel des avis rendus par les juges au pouvoir exécutif contrevenaient à la séparation des pouvoirs[95].
Dans le Renvoi sur la sécession, la Cour suprême confirme la constitutionnalité et la légitimité de cette fonction « extrajudiciaire » qui est contestée par l’amicus curiae nommé par la Cour. Soulignant que la séparation des pouvoirs n’est pas étanche au Canada, elle note en passant — et sans réelle analyse comparative — que d’autres cours à l’étranger et plusieurs tribunaux internationaux remplissent une telle fonction[96]. De plus, on l’a vu, la Cour ne reprend pas l’analyse du CJCP qui, en 1912, avait statué que la validité de la procédure d’avis tenait au fait que l’exécutif a toujours le loisir de ne pas suivre les conseils proférés par la Cour dans un avis consultatif.
Par contre, la Cour affirme qu’elle peut — et que dans certaines circonstances, elle doit — refuser de répondre à certaines questions[97]. Elle précise qu’elle « ne doit pas, même dans le contexte d’un renvoi, examiner des questions auxquelles il serait inapproprié de répondre » [nos italiques][98]. Ce serait le cas si, ce faisant, elle était amenée à outrepasser ce qu’elle estime elle-même être le rôle constitutionnel qui lui revient ou si la réponse ne relève pas de son champ d’expertise, c’est-à-dire, la clarification d’une question suffisamment juridique[99]. Puddister nous apprend qu’entre 1949 (date où les recours au CJCP ont été abolis) et 2017, la Cour a décliné de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées dans 17.5 % des avis qu’elle a émis. Cela semble substantiel. Toutefois, la Cour n’aurait refusé de répondre à des questions jugées « inappropriées » parce que trop politiques ou partisanes que dans deux renvois sur 97[100].
Bref, la Cour délimite les contours de son propre rôle constitutionnel, quitte à agir en contravention d’un texte de loi clair (une injonction du législateur, donc) afin d’éviter d’être instrumentalisée par le pouvoir exécutif. La Cour suprême place indéniablement haut la barre de sa propre exclusion. Elle n’a jamais entièrement refusé de rendre un avis, et s’est engagée dans des procédures incontestablement imbriquées dans un registre politique[101], y compris dans le Renvoi sur la sécession où elle énonce ces réserves (avant de donner son avis!).
Pourtant, en vertu du paragraphe 4 de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, la Cour « est tenue » de répondre à « chaque question » qui lui est adressée[102]. Dans le Renvoi sur la sécession, la Cour, appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 53, passe tout simplement sous silence le paragraphe 4. Autrement dit, implicitement, la Cour semble avoir « invalidé » le paragraphe 4, ou l’avoir interprété de telle sorte que les termes péremptoires en perdent toute signification.
Ayant scruté les risques d’instrumentalisation politique des tribunaux saisis de demandes d’avis consultatifs de la part de l’exécutif, Puddister soutient que cette faculté de refuser de répondre — que s’est reconnue la Cour — est la seule façon d’éviter que la procédure consultative ne contrevienne à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance judiciaire[103]. Et ce, même si la faculté de refus est utilisée avec parcimonie.
Selon Puddister, via les renvois, le pouvoir exécutif « délègue » une part de son pouvoir aux juges, pour des motifs essentiellement stratégiques[104]. A priori, l’instrumentalisation du pouvoir judiciaire par l’exécutif pose un sérieux défi à l’État de droit. Ce qui équilibre ce rapport potentiellement malsain entre gouvernement et juges, c’est la possibilité que ces derniers puissent refuser de répondre. Ils protègent ainsi leur indépendance et replacent une certaine cloison entre les pouvoirs judiciaire et exécutif. Quant à Mathen, on a vu que son analyse des rapports d’égalité et d’interdépendance des deux branches semble — implicitement — remettre en cause cette conception de la délégation. Les deux auteures s’entendent, toutefois, pour conclure que c’est surtout le pouvoir législatif qui fait les frais de cette délégation ou de cette interdépendance[105].
VI. Avis consultatifs et culture juridique : un exceptionnalisme canadien?
La fonction consultative est — de toute évidence — particulièrement utile, surtout pour le pouvoir exécutif. L’on pourrait donc imaginer que cette institution trouve écho dans d’autres régimes constitutionnels, particulièrement ceux issus de la même tradition juridique que celle dans laquelle est ancré le droit public canadien. Or, on l’a vu, la pratique a été abandonnée au Royaume-Uni. Par ailleurs, la Haute Cour d’Australie et la Cour suprême des États-Unis ne peuvent rendre des avis consultatifs, en raison de leurs règles constitutionnelles particulières — et d’une interprétation moins « souple » de la séparation des pouvoirs que celle qui règne au Canada[106]. Plus récemment, c’est à la lumière de l’expérience canadienne que la Nouvelle-Zélande aurait également rejeté cette possibilité[107]. L’appétit canadien pour les renvois ferait ainsi figure d’exception.
Par contre, l’on sait également que plusieurs états américains ont confié une fonction d’avis à certains tribunaux[108] : pourrait-on tirer des enseignements de cette pratique pour mieux saisir l’expérience canadienne? Similairement, en vertu de l’article 143 de la Constitution indienne, le Président peut demander un avis à la Cour suprême. Or, il appert que depuis l’adoption de la Constitution indienne en 1950, cette procédure n’a été utilisée que quatorze fois[109]. Autrement dit, la fonction consultative se distille de façon quasi homéopathique en Inde, alors qu’elle est centrale au Canada[110]. Sans explorer le parallèle (ce n’était pas l’objectif de son projet), Mathen mentionne que la procédure consultative existe également en Israël et en Afrique du Sud[111], auxquels on pourrait (notamment) ajouter l’Irlande[112]. En somme, l’expérience canadienne gagnerait à être comparée de manière plus approfondie à l’expérience d’autres États issus de la tradition de common law, notamment afin de comprendre comment ceux-ci ont résolu — ou non — l’épineuse tension entre la pratique consultative et les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire. Cela permettrait d’établir si l’exceptionnalisme canadien en est bien un.
Ni Mathen ni Puddister ne prétendent examiner de manière approfondie le phénomène « des avis juridiques » par la lorgnette du droit public comparé[113]. Néanmoins, toutes deux tracent certains parallèles entre les renvois et le contrôle de constitutionnalité « abstrait » — a priori ou a posteriori — que rendent certaines cours constitutionnelles spécialisées, notamment en Espagne, en Italie, en Allemagne et, jusqu’à un certain point, en France[114]. Puddister émet l’hypothèse que la fonction consultative canadienne dément la fausse dichotomie entre les systèmes anglo-américains et continentaux de contrôle de constitutionnalité. La pratique représenterait ainsi une sorte de modèle intermédiaire[115]. L’idée mérite réflexion et appelle à des analyses contextualisées et approfondies de droit comparé.
Les comparaisons avec les systèmes de cours constitutionnelles suivant le modèle kelsenien sont évoquées tant par la juriste que par la politologue — de manière utile, mais sommaire — à trois égards. Premièrement, il s’agit de démontrer que le rôle des juges ne se limite pas à résoudre des litiges. Ils sont également appelés à répondre à des questions juridiques ou d’interprétation du droit dans un contexte non contentieux. Environ deux tiers des renvois au Canada émergent dans des contextes « abstraits », soit parce qu’ils portent sur un projet de loi qui n’a pas (encore) été adopté, ou parce qu’il porte sur un scénario hypothétique[116]. D’où un certain parallèle. Autrement dit, les « Courts Without Cases » ne sont pas une aberration.
Deuxièmement, en tentant d’éviter une entorse à la séparation des pouvoirs, la tradition civiliste/continentale place les juridictions constitutionnelles à l’écart du pouvoir judiciaire « régulier », lequel « applique le droit » selon une lecture plus classique de la fonction judiciaire. Or, la singularité de la procédure d’avis au Canada (et peut-être de certains autres États, ce qui reste à approfondir) réside dans le fait qu’elle confère aux mêmes juges une fonction « judiciaire/contentieuse » et une fonction « consultative », qui est celle de dire, de clarifier et de faire évoluer le droit. Cette double-fonction laisse donc entier le défi que pose la pratique des avis consultatifs aux principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire.
Dans cette optique, un cas qui mériterait une analyse comparative ultérieure est celui de la Belgique, où les contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori sont exercés par des institutions distinctes, soit la section de législation du Conseil d’État et la Cour constitutionnelle. Le premier émet des avis sur la constitutionnalité de tous les projets de loi avant leur adoption (que ces projets émanent de l’ordre fédéral ou des entités fédérées)[117]. Si l’avis doit obligatoirement être demandé, l’avis lui-même n’est pas contraignant. Il peut être — et est fréquemment — ignoré par les exécutifs/législateurs. Il s’agit donc d’un contrôle de constitutionnalité a priori, qui éclaire les décideurs politiques, mais ne les lie pas. Pas plus qu’il ne lie la Cour Constitutionnelle qui pourrait se prononcer, a posteriori, sur la constitutionnalité d’une loi et en venir à une conclusion contraire à celle du Conseil d’État[118]. Autrement dit, le « conseiller » et le juge constitutionnel ne sont pas les mêmes et ils exercent des fonctions distinctes de manière autonome. Les avis du Conseil d’État belge dès lors sont davantage « consultatifs » que les avis officiellement consultatifs au Canada. Cet arrangement semble davantage conforme à la séparation des pouvoirs.
Il serait également utile de contraster les renvois avec les « questions préjudicielles » qui permettent à un tribunal d’interrompre le processus judiciaire dans un cas concret (voire, oblige celui-ci à le faire), le temps de saisir la cour spécialisée des questions de constitutionnalité[119]. Le magistrat ayant requis une clarification sur une question de nature constitutionnelle poursuivra l’audition du litige une fois reçue la réponse de la cour spécialisée. La réponse donnée par cette dernière liera — formellement — la juridiction ayant requis la clarification (il ne s’agit donc pas d’un « avis »). Officiellement, il existe donc une distinction importante avec les renvois, bien qu’en pratique, les statuts de la « réponse » préjudicielle et de l’avis consultatif canadien soient fort similaires. Ce qui diffère, c’est principalement la nature de l’autorité qui pose la question : un juge tranchant un litige, et non pas le pouvoir exécutif[120].
Troisièmement, l’incursion en droit comparé permet justement de souligner à quel point l’exclusivité réservée au pouvoir exécutif d’interroger le pouvoir judiciaire fait également figure d’exception. En effet, au-delà du statut distinct des textes émanant des cours constitutionnelles dans le contexte de contrôle abstrait (que ce contrôle soit a priori ou a posteriori) se pose la question des détenteurs du droit de saisir les tribunaux dans ce contexte. Question de juge à juge dans le cadre de « questions préjudicielles ». Questions pouvant être soulevées par la Présidence ou par des groupes de parlementaires en France, en Espagne et en Allemagne[121], mais également en Inde, en Irlande, en Belgique ou en Russie.
La procédure de renvoi étant, au Canada, l’apanage de la branche exécutive, elle prive les citoyens, les groupes d’intérêts, les parlementaires (surtout des partis d’opposition) de cette voie « rapide » en matière d’interprétation constitutionnelle[122]. Cette particularité est soulignée par Mathen et Puddister qui suggèrent — la seconde plus fermement — que la saisine des renvois puisse être élargie à d’autres acteurs, dans un souci d’équilibre et de démocratie[123]. En effet, l’exclusivité reconnue au gouvernement contribue à la tendance bien établie et décriée de la centralisation du pouvoir entre les mains de l’exécutif et à la marginalisation du législateur.
À cet égard, Mathen établit de façon fort judicieuse un certain parallèle entre les procédures de renvois, d’une part, et la pratique des jugements « déclaratoires » combinée à l’assouplissement des règles relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public, d’autre part[124]. Cette combinaison permet à des parties n’étant pas directement impliquées dans une affaire contentieuse, mais ayant un intérêt à ce qu’une question de droit soit clarifiée, de saisir un tribunal. Autrement dit, les tribunaux ont graduellement accru les possibilités de contrôle judiciaire — et surtout de constitutionnalité — par voie déclaratoire plutôt que par la voie plus conventionnelle du recours via l’exception d’inconstitutionnalité[125].
Sans l’exprimer en ces termes, Mathen considère donc le renvoi comme un équivalent fonctionnel partiel des procédures de contestation « abstraites » et élargies que l’on retrouve dans certains pays européens. L’analogie pousse, encore une fois, à la réflexion. Il convient de souligner deux avantages des jugements déclaratoires par rapport aux avis consultatifs. D’une part, ils procèdent généralement devant la Cour supérieure d’une province et bénéficient ainsi des procédures et des règles de preuve complexes — notamment testimoniale — qui manquent aux procédures consultatives instituées directement en cour d’appel ou en Cour suprême. D’autre part, les jugements déclaratoires sont formellement contraignants. Par contre, le jugement déclaratoire — s’il doit conduire à un appel final en Cour suprême — peut être extrêmement coûteux. Et il ne s’agit pas d’une procédure idoine pour les parlementaires, dont la contribution à l’examen d’une loi peut être court-circuitée par l’instigation d’une procédure de renvoi[126].
Mais de toutes les comparaisons avec les pratiques étrangères, celle qui apparait comme la plus évidente est celle des avis consultatifs rendus par la Cour internationale de justice (CIJ)[127]. En effet, outre sa fonction juridictionnelle, cet organe des Nations Unies est régulièrement appelé à rendre des avis consultatifs, à la demande non pas des États, mais de l’Assemblée générale, du Conseil de Sécurité ou des divers organes de l’ONU[128]. À quelques exceptions (fort techniques) près, ces avis ne sont pas « obligatoires » — dans le sens de juridiquement contraignants — ni pour les États, ni même pour les organes les ayant sollicités[129]. Formellement, les avis ne visent pas à régler des différends, mais à interpréter le droit et à guider les institutions « politiques » de l’ONU dans l’exercice de leurs fonctions, y compris dans la résolution de conflits hors de l’enceinte juridictionnelle. En pratique, toutefois, la doctrine et — implicitement — la Cour elle-même s’entendent pour reconnaître que les principes établis par ces avis et ceux énoncés dans le cadre d’une procédure contentieuse sont équivalents[130].
À l’instar de la situation canadienne, outre les procédures de saisine, l’essentiel du droit procédural entourant les avis consultatifs rendus par la CIJ sont calqués sur ceux des arrêts. La CIJ elle-même, tout comme la Cour suprême du Canada, traite ses avis comme des précédents. Ils sont largement rédigés comme les arrêts, et sont enseignés et cités de façon interchangeable. De plus, un jugement émanant de la CIJ est « obligatoire » mais pas directement exécutoire : il peut servir de base des actions de la part du Conseil de sécurité par exemple[131]. Il en va de même des avis. En d’autres mots, outre les questions de saisine, la distinction entre avis et arrêts en droit international public est ténue, même si l’on continue de distinguer formellement les deux fonctions de la CIJ. Quelles leçons pourrait-on tirer de ce parallèle avec la pratique des avis dans l’ordre juridique canadien et l’étonnante normativité dont ils sont dotés?
À cet égard — et dans l’optique d’une réflexion sur l’impact des traditions juridiques non seulement sur la qualification d’une institution mais sur la notion même de ce qui constitue « du droit » — il est intéressant de noter que les internationalistes d’origine civiliste soulignent la différence formelle entre la force normative des avis consultatifs rendus par la Cour internationale de justice et celles des arrêts, pour ensuite relativiser cette distinction en pratique[132]. Je n’ai pu procéder à une comparaison systématique dans le cadre du présent essai, mais il est révélateur que l’ouvrage de référence Brownlie’s Principles of Public International Law, mis à jour par James Crawford, aujourd’hui juge à la CIJ, ne traite même pas des valeurs normatives formellement distinctes des avis et des arrêts[133]. Leur égale force jurisprudentielle semble simplement tenue pour acquise.
Les diverses comparaisons proposées par Mathen et Puddister, ou soulevées dans le présent texte, constituent autant d’invitations à réfléchir au rôle du juge dans une démocratie libérale. Malgré certaines similitudes avec des institutions étrangères (ou internationales), la situation canadienne apparait largement inédite. Une originalité bien décrite dans les deux ouvrages, mais dont les raisons d’être ne sont pas vraiment explorées.
Quels aspects de la culture juridique canadienne peuvent expliquer cet exceptionnalisme canadien[134]? Pourquoi le recours à une institution qui semble entrer en collision frontale avec les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire est-il toléré au Canada, voire pratiqué sans grande hésitation? Comment expliquer qu’une institution qui ne fonctionne pas en théorie fonctionne si bien en pratique?
Mathen émet la thèse qu’en fait, en common law, le pouvoir judiciaire est appelé à clarifier le droit, à le « déclarer », à « répondre à des questions ». En ce sens, la fonction consultative n’est pas vraiment en tension avec la fonction judiciaire traditionnelle. Au contraire : elle serait en cohérence avec la fonction de juger dans la tradition de common law[135]. Ainsi, les juges fabriquent du droit en donnant des « conseils » au pouvoir exécutif. Cette assertion percutante méritera d’être prolongée et approfondie tant elle semble confronter la conception fondamentale du principe de la séparation des pouvoirs.
La thèse de Mathen est que dans les deux cas, les juges remplissent essentiellement la même fonction, celle de « donner des réponses ». Implicitement, elle suggère que la fonction judiciaire principale des juridictions d’appel — en tout cas de la Cour suprême — n’est pas de trancher des litiges, mais de dire ou de clarifier le droit. En somme, la procédure d’avis se rapproche des affaires contentieuses, et, vice versa. Les « parties » compteraient moins que les questions juridiques auxquelles la Cour est appelée à répondre[136]. Mais alors comment expliquer que plusieurs pays issus de la même tradition juridique rejettent cette institution?
Inscrire l’analyse des avis consultatifs dans une réflexion sur la culture juridique/constitutionnelle canadienne permettrait sans doute de classer ce phénomène parmi les très nombreux paradoxes et antilogies qui ponctuent le droit constitutionnel canadien. Une constitution si fragmentée que l’on ne connait pas l’entièreté du corpus constitutionnel, composée de plus de trente textes, de principes non écrits, de conventions constitutionnelles dont les tribunaux ne peuvent tracer les contours sans en assurer l’exécution, mais qui sont respectées par tous les acteurs politiques. Un texte fondateur de 1867 toujours en vigueur enchâssant un impérialisme du pouvoir central qui s’est dilué au fil du temps (notamment par le truchement d’avis consultatifs!). Un texte fondateur d’une fédération largement bilingue, mais dont seule la version anglaise est officielle[137]. Un texte colonial qui traite toujours les peuples autochtones comme des objets de législation et non pas des sujets de droit, des titulaires de souveraineté. Un principe de souveraineté parlementaire maintes fois confirmé qui laisse néanmoins les parlementaires en position subordonnée par rapport au pouvoir exécutif.
L’on pourrait prolonger l’énumération de ces paradoxes qui rendent si fascinante et si complexe l’étude du droit constitutionnel canadien. L’hypothèse que je souhaite avancer est que cette réceptivité aux dissonances entre constitution formelle et matérielle, entre droit officiel et droit « vivant », entre règles et mise en oeuvre, fait peut-être partie de la culture constitutionnelle canadienne. L’« étrange normativité » des avis consultatifs n’est peut-être qu’un élément paradoxal parmi tant d’autres.
Conclusion
Avec Courts without Cases et Seeking the Court’s Advice, Carissima Mathen et Kate Puddister retracent l’histoire, la théorie et la pratique des avis consultatifs, puis interrogent leur étonnante normativité et la légitimité dont ceux-ci jouissent en dépit de toute théorie démocratique. Les deux ouvrages comportent des chevauchements inévitables, et chacun met également en lumière des aspects particuliers (contexte, comparaison, lien avec l’actualité politique, contraste avec d’autres questions juridiques) sous un angle particulier, qui complète le travail de l’autre.
Si l’on devait formuler une critique mineure, ce serait qu’à l’occasion, les appareils référentiels généralement complets renvoient à des sources secondaires, là où les sources primaires eurent été éclairantes[138]. De plus, si les deux ouvrages incluent des index fort utiles, l’on aurait souhaité que l’ouvrage de Mathen comporte une bibliographie.
Enfin, et ici nos regrets sont plus substantiels : peu de sources en français sont mobilisées par Mathen, et aucune par Puddister[139]. Or, les discussions relatives à certains renvois clés, tels ceux relatifs au rapatriement de la Constitution, au véto du Québec ou à la sécession, de même que l’analyse du refus d’Ottawa d’instituer des renvois à l’encontre de lois québécoises de l’époque duplessiste, auraient sans doute été enrichies par une doctrine s’exprimant — et pensant — dans l’autre langue officielle.
Heureusement, tant pour la science politique que pour le droit, ces deux ouvrages complémentaires et fouillés n’épuisent pas leur sujet. Ils constituent à la fois des aboutissements remarquables et des tremplins vers de nombreux chantiers de réflexion. Malgré leur indéniable envergure, on referme forcément les deux manuscrits avec un fourmillement de questions. Les deux récits révèlent de nombreux paradoxes, susceptibles de rendre perplexes les constitutionnalistes étrangers, de troubler les positivistes, d’interpeler les comparatistes et de ravir les spécialistes de la sociologie du droit et des cultures juridiques.
Chose certaine, on ne lira, enseignera, voire même rédigera jamais plus un avis consultatif avec ce qui est presque devenu une sorte de confiante désinvolture.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir Supreme Court Act, SC 1875, c 11, art 52; Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c S-26, art 53 (version actuelle).
-
[2]
La Colombie-Britannique et le Manitoba ont également officialisé la compétence consultative de leur cour supérieure (première instance). J’écris « officialisé », puisqu’il est plausible que cette compétence puisse être inhérente à la juridiction plénière des cours supérieures visées par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3 [LC 1867]. Pour un renvoi récent rendu en première instance, voir par ex Reference re: Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588.
-
[3]
Aucune des auteures n’explique l’origine du terme « renvoi/reference », mais l’on comprend que si la Cour rend un « avis consultatif/advisory opinion », l’exécutif, pour sa part, « renvoie » une question à la Cour. Autrement dit, le terme dépend de l’acteur que l’on considère. Il m’a semblé interpellant que dans le langage « courant », même les constitutionnalistes les plus aguerris utilisent le terme « renvoi/reference » plutôt qu’avis consultatif, ce qui a pour effet de partiellement « gommer » la dimension officiellement non-contraignante du texte analysé.
-
[4]
Voir par ex Reference re Refund of Dues Paid under s. 47 (f) of Timber Regulations, [1933] RCS 616, [1934] 1 DLR 43 (concernant des droits de redevances sur le bois d’oeuvre).
-
[5]
À titre anecdotique, environ la moitié des « décisions » portant sur les institutions ou le fédéralisme que mes étudiant.e.s sont appellé.e.s à lire dans leur cours de droit constitutionnel sont des renvois.
-
[6]
Voir notamment François Chevrette et Grégoire Charles N Webber, « L’utilisation de la procédure de l’avis consultatif devant la Cour suprême du Canada : essai de typologie » (2003) 82:3 R du B can 757; James L Huffman et MardiLyn Saathoff, « Advisory Opinions and Canadian Constitutional Development: The Supreme Court’s Reference Jurisdiction » (1990) 74:6 Minn L Rev 1251; Gerald Rubin, « The Nature, Use and Effect of Reference Cases in Canadian Constitutional Law » (1959–60) 6:3 RD McGill 168; Kate Glover Berger, « The Impact of Constitutional References on Institutional Reform » dans Emmett Macfarlane, dir, Policy Change, Courts, and the Canadian Constitution, Toronto, University of Toronto Press, 2018, 125; JF Davison, « The Constitutionality and Utility of Advisory Opinions » (1937–38) 2:2 UTLJ 254; Mark Mina Mikhaiel, « The Dangers of the Reference Question: SCC v. SCOTUS » (2016) 40:1 Can-USLJ 71; Andrea Lawlor, The Supreme Court’s Use of Narratives in Issuing Advisory Opinions, thèse de maîtrise en droit, University of Western Ontario, 2018 [non publiée].
-
[7]
Oxford, Hart, 2019.
-
[8]
Vancouver, UBC Press, 2019 [Puddister, Court’s Advice] (ce manuscrit est largement fondé sur sa thèse doctorale : voir Kate Puddister, Inviting Judicial Review: A Comprehensive Analysis of Canadian Appellate Court Reference Cases, Montréal, McGill University Libraries, 2016).
-
[9]
Puddister a retracé — et classé selon divers critères — 209 avis rendus par la Cour suprême et les dix cours d’appel provinciales entre 1875 et 2017 (Court’s Advice, supra note 8 à la p 14). Mathen, pour sa part, évoque 204 avis émanant des mêmes tribunaux entre 1875 et 2014 (supra note 7 aux pp xiii–xxi).
-
[10]
À ce titre, on notera avec perplexité le fait que dans de rares cas ce ne sont pas les Procureurs généraux (au nom de l’exécutif) qui saisissent la Cour suprême d’un « appel » d’un renvoi rendu par une Cour d’appel, mais bien un « intervenant ». Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, la Cour suprême affirme simplement, sans aucune explication, source ou précédent que l’intervenant se pourvoit d’un droit d’appel de plein droit (2020 CSC 17 au para 16 [Renvoi sur la non-discrimination génétique 2020]). Pourtant dans cette affaire, le Procureur général du Canada partageait l’avis de celui du Québec que c’était de bon droit que la Cour d’appel du Québec avait statué que la loi fédérale était inconstitutionnelle, car son objet véritable relevait de la réglementation de la propriété et des droits civils et non du droit criminel. À ce titre, aucun des exécutifs n’a saisi la Cour suprême. Ils ont plutôt agi à titre d’intervenants (voir Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, ch S-26, art 36).
-
[11]
L’ouvrage de Mathen est paru en avril 2019, celui de Puddister, a été publié en format électronique en mai 2019, et en format papier six mois plus tard. Mathen cite la thèse de doctorat de Puddister, mais évidemment pas son ouvrage, paru tout juste après le sien. Pour sa part, dans cette thèse, Puddister citait des articles de Mathen analysant des renvois précis, mais elle ne la cite plus dans son ouvrage.
-
[12]
Supra note 7 aux pp 31–37, 208.
-
[13]
Voir Judicial Committee Act 1833 (R-U), 3 & 4 Will IV, c 41, art 4. Cette disposition est toujours en vigueur, mais ne semble plus guère utilisée. Cette compétence du CJCP trouve un parallèle avec — mais se distingue de — la procédure selon laquelle le CJCP rendait des « appels » en dernière instance au Canada, jusqu’en 1949. Ces « appels » étaient, techniquement, offerts sous la forme d’un « avis » à sa Majesté (puisqu’il s’agissait bien du comité judiciaire du Conseil privé). Pour la formulation particulière de l’avis à sa Majesté, voir par ex R v British Coal Corporation, [1935] 3 DLR 401 à la p 414, 64 CCC 145 (PC); Edwards v Canada (AG) (1929), [1930] AC 124, [1930] 1 DLR 98 à la p 113 (PC) [Person’s Case].
-
[14]
Mathen précise qu’elle n’a pu examiner l’éventuel lien entre les cours d’équité et les procédures consultatives (supra note 7 à la p 31, n 3). Or, la fonction de conseiller du Chancelier était évidemment centrale à la tradition juridique britannique.
-
[15]
Sur le rôle des tribunaux en contexte fédéral, voir Franceso Palermo et Karl Kössler, Comparative Federalism : Constitutional Arrangements and Case Law, Portland (Or), Hart, 2017 aux pp 261–72; Nicholas Aroney et John Kincaid, Courts in Federal Countries, Toronto, University of Toronto Press, 2017; Frédéric Bouhon, dir, Les juridictions constitutionnelles suprêmes dans les États fédéraux : créatures et créateurs de fédéralisme, (2017) 17 Fédéralisme et Régionalisme, en ligne : <popups.uliege.be> [perma.cc/92D8-9XZS]; Jean-François Gaudreault-DesBiens, « The Role of Apex Courts in Federal Systems : Beyond the Law/Politics Dichotomy » (2017) 17 :1 Jus Politicum 171.
-
[16]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 22–23, 47; Rubin, supra note 6 aux pp 171–73.
-
[17]
Voir Mathen, supra note 7 aux pp 83–84.
-
[18]
C’est le cas notamment des tensions entre Ottawa et le parti créditiste (Social Credit) de l’Alberta dans les années 30, qui ont donné lieu à six renvois et trois désaveux fédéraux de lois provinciales (voir Mathen, supra note 7 aux pp 84–87; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 52 et s).
-
[19]
Pour une liste complète, voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8, Annexe A; Mathen, supra note 7 à la p 31, n 1.
-
[20]
Voir Loi sur la Cour suprême, supra note 1, art 36.
-
[21]
Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2017 QCCA 756, inf par 2018 CSC 48 (concernant, entre autres, un projet de loi provinciale uniforme référé par le Québec à sa cour d’appel).
-
[22]
Loi sur la Cour suprême, supra note 1, art 53(1)–(2).
-
[23]
Ibid, art 53(3); Johanne Poirier, « The Role of Constitutional Courts, A Comparative Law Perspective: Canada: The Supreme Court », European Parliament Research Services, Bruxelles (2019) aux pp 9–10, en ligne (pdf) : Parlement européen <www.europarl.europa.eu> [perma.cc/Z6L4-FLTA] [Poirier, « Role of Constitutional Courts »].
-
[24]
Voir Loi sur la Cour suprême, supra note 1, art 53(4).
-
[25]
Ni Mathen ni Puddister, qui écrivent en anglais, n’ont noté cette étrange désignation. La politologue utilise parfois, en fait, le terme « jugement » pour désigner un avis. Pour sa part, la juriste tente de conserver une plus grande orthodoxie sémantique : voir le paragraphe final de l’introduction de Mathen (supra note 7 à la p 10).
-
[26]
Le terme advisory aurait été ajouté à la Loi sur la Cour suprême lors d’une révision de 1891, pour être ensuite retranché en 1956, ce que note Mathen (supra note 7 à la p 59), mais sans analyser les raisons de cette modification. Pour sa part, Rubin (supra note 6 à la p 175, n 24) évoque les travaux parlementaires sur la modification simplement pour mentionner que le terme advisory n’était que déclaratoire, adopté par prudence, et que son absence n’enlevait rien au caractère consultatif des renvois.
-
[27]
Les quatre chapitres (5 à 8) sont : « Arbitrating Federalism », « Rebirth and Rupture » traitant entre autres du rapatriement de la Constitution, « Interpretation and Rights » et « Institutions » (Mathen, supra note 7 aux pp ix–xi).
-
[28]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8, ch 2.
-
[29]
L’autorité fédérale a instigué le plus de renvois. Parmi les provinces, l’Ontario vient en tête, suivi de la Colombie-Britannique. Certains seront étonnés que le Québec se classe en 6e place, avec environ trois fois moins de recours aux renvois que l’Ontario (voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 45). Cette statistique ne tient toutefois pas compte de la distribution des renvois au cours de la période étudiée.
-
[30]
Voir ibid aux pp 110–12. Cette disparité s’explique en partie parce que les arrêts incluent des appels de plein droit en matière criminelle qui ne soulèvent pas toujours de nouvelles questions de droit.
-
[31]
Les tendances vers davantage — ou moins — d’unanimité gagneraient à être explorées de manière chronologique. Ainsi, en 2013, Jean-François Gaudreault-DesBiens émettait l’hypothèse que les « grands renvois » des vingt dernières années ont souvent été rendus de manière unanime au nom de « la Cour » dans un style discursive « oraculaire » faisant appel à des principes constitutionnels (Jean-François Gaudreault-DesBiens « Le juge comme agent de migration de canevas de raisonnement entre le droit civil et la common law : quelques observations à partir d’évolutions récentes du droit constitutionnel canadien » dans Ghislain Otis, dir, Le juge et le dialogue des cultures juridiques, Paris, Karthala, 2013, 41 aux pp 63–64). Le Renvoi sur la non-discrimination génétique 2020 ferait, si l’on admet cette hypothèse, figure d’exception (supra note 10).
-
[32]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 83.
-
[33]
Voir Kate Puddister, « The Canadian Reference Power: Delegation to the Courts and the Navigation of Federalism » (2018) 49:4 Publius J Federalism 561 à la p 568 [Puddister, « Canadian Reference »]. Voir aussi Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].
-
[34]
Mathen notant simplement que ce choix est « intriguing » (supra note 7 à la p 157).
-
[35]
Court’s Advice, supra note 8 aux pp 52–72; Puddister, « Canadian Reference », supra note 33 à la p 571.
-
[36]
Notamment pour contrer les initiatives albertaines en matière économique, particulièrement lorsque les initiatives du « crédit social » étaient interprétées comme menaçant la suprématie du pouvoir bancaire, ancré dans l’est du pays, et relevant de la compétence fédérale (voir Mathen, supra note 7 aux pp 84–87; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 52 et s).
-
[37]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 46.
-
[38]
Voir Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 RCS 54, 102 DLR (3e) 1.
-
[39]
Voir Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753, 125 DLR (3e) 1 [Renvoi sur le rapatriement].
-
[40]
Voir Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 RCS 793, 140 DLR (3e) 385.
-
[41]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 72 et s; Mathen, supra note 7 aux pp 91–92. Cette période a connu six renvois sur la répartition des ressources, surtout côtières.
-
[42]
Voir Règlement d’examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés, DORS/85-781, arts 3, 5.
-
[43]
Le cas français est évoqué par les deux auteures (voir Mathen, supra note 7 à la p 35, n 25 et à la p 77; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 201–05). Pour la Belgique, voir Lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, MB, 21 mars 1973, 3461, arts 2–6bis.
-
[44]
Voir Mathen, supra note 7 aux pp 181–92; Puddister, Court’s Advice, supra note 8, ch 4, 6.
-
[45]
Épisode truculent : le gouvernement fédéral de MacKenzie King a soumis à l’examen de la Cour suprême la constitutionnalité de lois fédérales adoptées par son prédécesseur, plutôt que de les abroger — et d’être accusé d’actions anti-syndicales. Mieux valait miser sur la probabilité que les juges considèrent les mesures fédérales ultra vires des compétences… fédérales (voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 55–56).
-
[46]
Autre exemple fascinant est celui du renvoi Re Order in Council 1083/70 re Provincial Control of Agricultural Products ((1971), 18 DLR (3e) 326, [1971] 3 WWR 204 (CA Man) conf par [1971] RCS 689, 19 DLR (3e) 169), où le Manitoba a « manufacturé » une loi en espérant qu’elle serait « invalidée » par voie consultative, ce qui s’est produit. La loi était calquée sur une loi québécoise relative à la mise en marché des oeufs, similaire à celle de l’Ontario relative à la mise en marché du poulet. Le Manitoba s’objectait aux mesures protectionnistes des autres provinces. L’invalidation de cette loi « factice » par la Cour d’appel a donné lieu à des négociations intergouvernementales et conduit à l’élaboration de régimes pancanadiens de mise en marché des produits agricoles (voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 3–5).
-
[47]
Voir ibid, ch 6.
-
[48]
Huit entretiens en tout, ce qui s’explique entre autres par la difficulté générée par le secret professionnel auquel les juristes de l’État sont astreints.
-
[49]
Pour sa part, Mathen relate un seul entretien relatif à un avis juridique. L’entretien portait sur l’avis rendu par l’ancien juge de la Cour suprême, Ian Binnie, au sujet de l’éligibilité du juge Nadon pour siéger à la Cour suprême dans la saga qui a conduit le gouvernement Harper à instituer une procédure de renvoi (supra note 7 à la p 184, n 11).
-
[50]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 207.
-
[51]
Voir ibid, ch 5.
-
[52]
Voir Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c L-0.3. En effet, l’exécutif fédéral pourrait formuler une question hypothétique qui ferait fi de la clause dérogatoire, par exemple. Il incomberait alors à la Cour de décider s’il est opportun d’y répondre. Sur ce pouvoir de la Cour, voir partie V, ci-dessous.
-
[53]
Voir Reference Re Alberta Statutes — The Bank Taxation Act; The Credit of Alberta Regulation Act; and The Accurate News and Information Act, [1938] RCS 100, [1938] 2 DLR 81, conf par [1947] AC 503, [1947] 4 DLR 1 (PC). Les compétences fédérales en la matière sont explicitement prévues aux para 91(14), (15), (16) et (19) de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC 1867, supra note 2). A contrario, il était moins évident que les compétences fédérales permettaient de régler les questions jugées d’ordre public, telles que celles soulevées dans les cas québécois.
-
[54]
Le gouvernement fédéral a préféré attendre qu’une décision de la Cour supérieure du Québec, initiée par des personnes directement affectées, soit rendue : voir Truchon c PG Canada, 2019 QCCS 3792. Le Procureur général du Canada a ensuite décidé de ne pas porter la décision en appel ce qui, du moins théoriquement, crée de l’incertitude juridique ailleurs au Canada (puisqu’une telle décision n’a pas d’effet de précédent « horizontal » dans les autres provinces : voir R v Vu, 2004 BCCA 230 aux para 24–27). La décision visait à contester certains des critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir adoptés par le Parlement en réponse à la décision Carter c. Canada (2015 CSC 5).
-
[55]
Voir Poirier, « Role of Constitutional Courts », supra note 23 à la p 10 (citant Canada (PG) c Bedford, 2013 CSC 72 au para 40 [Bedford], la Cour elle-même s’appuyant sur Rubin, supra note 6 à la p 175).
-
[56]
Voir Catherine Thibierge, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie » dans Libres propos sur les sources du droit. Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz, Paris, Dalloz, 2006, 519 à la p 544 (l’auteure distingue trois facettes du concept de « force normative » : sa valeur (officielle), sa portée (son effet concret) et sa garantie (le traitement qu’elle reçoit par les acteurs juridiques et judiciaires)). Pour une synthèse de cette approche, voir Kevin Munungu Lungungu et Johanne Poirier, « Les accords de coopération entre partenaires fédéraux : entre “sources du droit” et soft law » dans Isabelle Hachez et al, dir, Les sources du droit revisitées, Anthémis, Bruxelles, 2013, 889 aux pp 924–27.
-
[57]
Suite à ce commentaire, j’ai ajouté ce qui suit au rapport :
In what may seem like an oddity for jurists unfamiliar with the British constitutional law tradition, this is another way in which Canadian constitutional law is infused with conventions and practices that are not formalised, do not have the status of “positive law”, and yet are invariably respected by relevant actors. In fact, a vast body of seminal constitutional “decisions” are not judgement in Canada, but “references” and, as such, are truly part of the Court’s jurisprudence [notes omises]
Poirier, « Role of Constitutional Courts », supra note 23 à la p 10 -
[58]
Cette acceptation contraste avec les affirmations de plusieurs juges au sujet de la valeur non-contraignante des avis, dans les premières années de la pratique (voir les citations édifiantes reprises par Mathen, supra note 7 aux pp 58–60).
-
[59]
Provinces (AG) v Canada (AG), [1912] AC 571, [1912] 3 DLR 509 à la p 517 (PC) [Provinces (AG)]. Voir aussi Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 15, 161 DLR (4e) 385 [Renvoi sur la sécession] (la Cour suprême note qu’il revient « habituellement » aux juristes de l’État d’aviser l’exécutif, pour conclure que cela n’empêche pas un tribunal de pouvoir agir à titre consultatif également).
-
[60]
Au point où l’on pourrait se demander si — de la perspective des acteurs non-judiciaires — le respect des renvois n’aurait pas atteint le statut de convention constitutionnelle.
-
[61]
Voir Renvoi sur le rapatriement, supra note 39 aux pp 904–10; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 194; Benoit Pelletier, « Amending the Constitution of Canada » dans Peter Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Desrosiers, dir, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2017, 253 à la p 258.
-
[62]
Voir Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21 [Renvoi relatif à la Cour suprême].
-
[63]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 194.
-
[64]
Dans le Renvoi sur la sécession (supra note 59 au para 25), la Cour note que, dans un renvoi, elle « ne statue pas sur des droits », ce qui suggère qu’elle ne tranche pas vraiment en faveur de justiciables. La Cour note que le caractère consultatif des renvois découle ainsi de l’absence de « questions qui pourraient autrement ne pas être considérées comme assez “mûres” pour faire l’objet d’un recours judiciaire ». Cela étant, il est évident que par le recours aux renvois, la Cour statue de façon très déterminante sur de nombreuses questions de droit, qui ont un impact sur tout l’ordre juridique canadien : la constitutionalité du rapatriement de la constitution, la répartition des compétences législatives, les procédures de nomination à la Cour suprême, la réforme du Sénat, etc. Bref, cette timide « nuance » apportée dans le Renvoi sur la Sécession n’est pas très convaincante, surtout à la lumière du principe de stare decisis (voir le présent texte aux notes 55, 74–75).
-
[65]
Alain-Robert Nadeau, « Québec et Ottawa ne sont pas tenus de suivre l’avis de la Cour suprême sur la sécession », Le Devoir (11 janvier 2000) A1.
-
[66]
Supra note 7 aux pp 4, 201, 207 (elle le soulève à de nombreuses reprises, y compris à ces pages).
-
[67]
Voir par ex Renvoi sur la sécession, supra note 59. Ce cas est évidemment emblématique. Un avocat avait été mandaté par la Cour pour présenter les arguments « du Québec » qui refusait de participer à la procédure, soutenant que la question de la sécession et de l’indépendance ne relevait aucunement de la compétence des tribunaux, mais de l’expression démocratique du peuple.
-
[68]
Voir par ex Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 34 [Renvoi sur le Sénat de 2014]. Dans le Renvoi sur la non-discrimination génétique 2018, la Cour d’appel du Québec avait nommé un amicus curiae pour « défendre » la constitutionnalité de la loi fédérale, car le Procureur général du Canada partageait l’avis de celui du Québec que cette loi était ultra vires des pouvoirs du Parlement (Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, 2018 QCCA 2193, inf par 2020 CSC 17 [Renvoi relatif à la non-discrimination génétique 2018]). Le même amicus a rempli le même rôle devant la Cour suprême du Canada (voir supra note 10 au para 19).
-
[69]
Voir par ex Renvoi : Loi anti-inflation, [1976] 2 RCS 373, 68 DLR (3e) 452.
-
[70]
Les auteures n’ont pas procédé à une revue systématique des conclusions, mais ce constat se vérifie dans de nombreux cas (voir par ex le présent texte aux notes 71–72). Cela étant, une forme de prudence déférentielle peut également être décelée. A titre d’exemple, dans son renvoi de mars 2019 sur la constitutionnalité de la loi fédérale sur la « taxe carbone », la Cour d’appel de la Saskatchewan a utilisé un vocabulaire plus approprié à un avis (Reference Re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, 2019 SKCA 40). Ainsi, les juges majoritaires écrivent : « The advisory opinion offered in response to the question posed by the Lieutenant Governor in Council is as follows […] » (ibid au para 210). Pour leur part, les juges minoritaires écrivent : « We advise the Lieutenant Governor in Council that, for the foregoing reasons, in our opinion […] » (ibid au para 477). Dans son opinion majoritaire, leur collègue de la Cour d’appel de l’Ontario affirme simplement : « I would answer the question referred by the Lieutenant Governor in Council as follows […] » (Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, 2019 ONCA 544 au para 164, juge en chef Strathy, avec l’appui des juges MacPherson et Sharpe).
-
[71]
Renvoi sur le Sénat de 2014, supra note 68 au para 111.
-
[72]
Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, 19 DLR (4e) 1.
-
[73]
Supra note 7 à la p 231. Il est intéressant de noter que les analystes du « dialogue » entre juges et parlementaires –– dans le contexte de la suspension de déclarations d’invalidité –– ne font pas de distinctions entre l’impact des arrêts en appel et des avis. Pour une synthèse de cette doctrine, voir Robert Leckey, « Assisted Dying, Suspended Declarations and Dialogue’s Time » (2019) 69 UTLJ (Supplement 1) 64 aux pp 65–67, 76–79.
-
[74]
Voir Bedford, supra note 55, infirmant Renvoi relatif à l’art 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man), [1990] 1 RCS 1123, 56 CCC (3e) 65 (concernant la prostitution).
-
[75]
En l’occurrence, la Cour a donné raison à la juge de première instance, concluant, entre autres, que l’évolution tant de l’interprétation de l’article 7 de la Charte que celle des faits sociaux (démontrés par une preuve monumentale) justifiait de revoir les conclusions rendues dans son précédent Renvoi.
-
[76]
Je fais ici une analogie avec James Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 à la p 253.
-
[77]
Voir John Austin, The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence, Londres, Weidenfield & Nicolson, 1954; HLA Hart, The Concept of Law, 2e éd, Oxford, Oxford University Press, 1994 aux pp 79 et s.
-
[78]
Réfléchir aux « règles de la reconnaissance » (voir Hart, supra note 77, ch 6) dans le contexte des avis pourrait, à titre d’exemple, être porteur de leçons. Sur l’analyse de ces règles de reconnaissance dans le contexte de la distinction entre droit formel et informel (soft law), voir Munungu Lungungu et Poirier, supra note 56 aux pp 896–98.
-
[79]
Voir Mathen, supra note 7 aux pp 193–200; Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford, Clarendon Press, 1979 aux pp 28–29.
-
[80]
Supra note 7 à la p 201.
-
[81]
Ibid aux pp 193–94.
-
[82]
Voir ibid à la p 232.
-
[83]
H. Patrick Glenn définit l’autorité persuasive comme celle « qui attire l’adhésion, plutôt que de la rendre obligatoire » [notre traduction] (« Persuasive Authority » (1987) 32:2 RD McGill 262 à la p 263). Glenn mentionne « giving opinions » dans la liste des actes que les acteurs juridiques posent, mais il n’explore pas le cas des avis consultatifs rendus par des juges (ibid à la p 293).
-
[84]
Supra note 7 aux pp 194–95.
-
[85]
Voir ibid aux pp 200–01.
-
[86]
Supra note 6 à la p 1317.
-
[87]
Voir Mathen, supra note 7 à la p 197.
-
[88]
Mathen évoque à cet égard le sort réservé aux prononcés des anciens juges Binnie, Charron et Bastarache — dans différents contextes — sur l’admissibilité du juge Nadon (ibid à la p 206). Leurs positions n’ont pas été retenues par la Cour suprême qui, par voie d’avis consultatif, a statué que celui-ci ne rencontrait pas les critères pour être nommé au plus haut tribunal du pays (voir Renvoi relatif à la Cour suprême, supra note 62).
-
[89]
Lon L Fuller, « Human Interaction and the Law » (1969) 14:1 Am J Juris 1 à la p 10.
-
[90]
Voir Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, 37e éd, Paris, LGDJ, 2016 aux pp 102–09.
-
[91]
Voir Mark Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, 2e éd, Cheltenham (R-U), Edward Elgar, 2018 aux pp 107–13.
-
[92]
Voir François Chevrette et Herbert Marx, Droit constitutionnel : Principes fondamentaux, 2e éd par Han-Ru Zhou, Montréal, Thémis, 2016 à la p 414; Patrick J Monahan, Byron Shaw et Padraic Ryan, Constitutional Law, 5e éd, Toronto, Irwin Law, 2017 aux pp 16–17.
-
[93]
Voir Monahan, Shaw et Ryan, supra note 92 à la p 17. D’ailleurs, parmi les principes constitutionnels non écrits, le principe de l’indépendance judiciaire s’est vu couronné d’une force normative tout à fait particulière. Voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 RCS 3, 150 DLR (4e) 577. Pour une critique acérée, voir Jean Leclair, « Canada’s Unfathomable Unwritten Constitutional Principles » (2002) 27:2 Queen’s LJ 389 à la p 413, 418 et s. Voir aussi Mackin c Nouveau-Brunswick (Ministre des finances); Rice c Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13.
-
[94]
Voir la partie VI, ci-dessous.
-
[95]
Voir Provinces (AG), supra note 59; Renvoi sur la sécession, supra note 59 au para 15.
-
[96]
Voir Renvoi sur la sécession, supra note 59 aux para 14–15.
-
[97]
Voir ibid au para 26, citant Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C-B), [1991] 2 RCS 525 à la p 545, 83 DLR (4e) 297 [Renvoi sur le Régime d’assistance publique] (un renvoi, donc!). Le refus peut également être fondé sur un manque d’information, ou sur le fait que la réponse à une question rend superflue la réponse à une autre : Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 88 ; Mathen, supra note 7 aux pp 67–68.
-
[98]
Renvoi sur la sécession, supra note 59 au para 26.
-
[99]
Voir ibid au para 26, citant Renvoi sur le Régime d’assistance publique, supra note 97 à la p 545; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 89.
-
[100]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 91, 93–94. Voir par ex Renvoi relatif au mariage entre personnes de même sexe, 2004 CSC 79 au para 71. La Cour a statué qu’étant donné l’engagement du gouvernement fédéral de légiférer de manière à redéfinir l’institution du mariage de manière plus inclusive, il n’était pas nécessaire de trancher sur le caractère discriminatoire (ou non) de la définition traditionnelle de common law comme une union hétérosexuelle. En examinant cette question, la Cour aurait risqué de remettre en cause — par voie d’avis — des jugements en appel dont elle n’était pas saisie! Cette crainte illustre de façon éloquente l’intense force normative des renvois.
-
[101]
Sur le « jeu » entre registres juridique et politique, voir Johanne Poirier, « Le fédéralisme coopératif au Canada : quand les registres juridique et politique jouent au chat et à la souris » (2018) 18 Fédéralisme et Régionalisme, en ligne : <popups.uliege.be> [perma.cc/ K5EF-F472].
-
[102]
Supra note 1, art 53(4) (en anglais : « it is the duty of the Court to hear and consider it and to answer each question so referred » [nos soulignements]).
-
[103]
Court’s Advice, supra note 8 aux pp 196–98.
-
[104]
Ibid, ch 6.
-
[105]
Voir ibid à la p 218; Mathen, supra note 7 aux pp 70–74.
-
[106]
La Cour suprême des États-Unis ne peut se prononcer que sur les « Cases » et « Controversies », voir US Const art III, § 2, cl 1. En Australie, c’est la Haute Cour elle-même qui a rejeté cette possibilité, voir Re Judiciary and Navigation Acts (1921), 29 CLR 257 à la p 265. Voir aussi Renvoi sur la sécession, supra note 59 (la Cour suprême n’évoque pas la jurisprudence australienne dans le contexte de son survol du droit étranger en la matière aux para 12–14).
-
[107]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 10.
-
[108]
Voir Mel A Topf, A Doubtful and Perilous Experiment: Advisory Opinions, State Constitutions, and Judicial Supremacy, Oxford, Oxford University Press, 2011; Renvoi sur la sécession, supra note 59 au para 13.
-
[109]
Voir Raeesa Vakil, « Jurisdiction » dans Sujit Choudhry, Madhav Khosla et Pratap Bhanu Mehta, dir, The Oxford Handbook of the Indian Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2016, 367 aux pp 374–75; Pooja Jha, « The Supreme Court’s Advisory Jurisdiction Under Article 143 » (2000) 42:2/4 J Indian L Inst 458 à la p 460. Il appert que ni le Président ni la Cour elle-même ne soient liés par l’avis rendu (ce qui explique peut-être la différence avec l’intérêt de la procédure au Canada (ibid aux pp 464–66)).
-
[110]
Dans un ouvrage sur le pouvoir judiciaire dans les États fédéraux, la fonction consultative indienne ne fait l’objet que d’une phrase assez laconique, alors qu’elle est traitée avec doigté, mais en un seul paragraphe, dans le chapitre sur le Canada (voir Manish Tewari et Rekha Saxena, « The Supreme Court of India: The Rise of Judicial Power and the Protection of Federalism » dans Aroney et Kincaid, supra note 15, 223 à la p 239; Eugénie Brouillet, « The Supreme Court of Canada: The Concept of Cooperative Federalism and its Effect on the Balance of Power » dans Aroney et Kincaid, supra note 15, 135 aux pp 148–62).
-
[111]
Supra note 7 à la p 3, n 13.
-
[112]
Voir Constitution of Ireland, art 26, en ligne (pdf) : <www.irishstatutebook.ie> [perma.cc/ 8RW3-GXTA]. Dans une autre tradition juridique, voir Конституция Российской Федерации (Constitution de la Fédération de Russie), art 125(5), en ligne (pdf) : <constitution.kremlin.ru> [perma.cc/2R7W-Y8X8].
-
[113]
Mathen souligne toutefois que son ouvrage offre des perspectives dépassant le cas canadien (« larger insights ») (supra note 7 à la p 10).
-
[114]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8, ch 6. Les analyses, par moments laconiques, semblent parfois confondre le contrôle abstrait et le contrôle a priori (i.e., précédent l’adoption d’une loi, ou à sa mise en vigueur). Mathen évoque certaines institutions étrangères à différents endroits du manuscrit, par exemple en discutant de la saisine à la Cour constitutionnelle allemande (supra note 7 à la p 35) ou devant le Conseil constitutionnel français (ibid à la p 78).
-
[115]
« Canadian Reference », supra note 33 à la p 562.
-
[116]
Voir Puddister, Court’s Advice, supra note 8 à la p 97.
-
[117]
Voir Lois sur le Conseil d’État, supra note 43, arts 2–6bis.
-
[118]
Voir Jacques Salmon, Jacques Jaumotte et Eric Thibault, Le Conseil d’État de Belgique, vol 1, Bruxelles, Bruylant, 2012 aux pp 286–93.
-
[119]
Et, dans certains cas, de « conventionalité », c’est-à-dire de la conformité du droit interne — ou de certaines actions au coeur du litige — avec le droit de l’Union européenne ou la Convention européenne des droits de l’homme. Pour la Belgique, voir Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, MB 7 janvier 1989, 315, arts 26–30.
-
[120]
En France, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite en 2008 permet aux particuliers de soulever une question de la non-conformité d’une loi avec les droits fondamentaux dans le cadre d’une affaire contentieuse. Le Conseil d’État (en matière administrative) ou la Cour de cassation (autres domaines) servent alors de « filtres » pour déterminer si la question doit être transmise au Conseil constitutionnel : on se situe donc entre les procédures de saisine directe et la question préjudicielle. Voir « Qu’est-ce que la QPC? » (dernière consultation le 20 janvier 2019), en ligne : Conseil constitutionnel <www.conseil-constitutionnel.fr> [perma.cc/9Y9N-JAMN].
-
[121]
Ce sont les cas examinés par Puddister et Mathen. Elles considèrent également l’Italie, mais pas directement dans ce contexte.
-
[122]
On notera l’exception, notée plus haut, où la Cour suprême accepte de rendre un avis en « appel » d’un renvoi émanant d’une Cour d’appel à la demande d’un intervenant et non d’un Procureur général.
-
[123]
Mathen, supra note 7 à la p 77; Puddister, Court’s Advice, supra note 8 aux pp 200–06. Par l’effet combiné du para 42(1)(d) de la Loi constitutionnelle de 1982 (constituant l’annexe B de la LC 1867, supra note 2) et du Renvoi relatif à la Cour suprême (supra note 62), il est probable qu’une telle modification du mandat de la Cour nécessiterait une modification constitutionnelle.
-
[124]
Supra note 7 aux pp 221–26.
-
[125]
Sur la différence entre les recours en inconstitutionnalité par voie d’exception et ceux par voie déclaratoire, voir Poirier, « Role of Constitutional Courts », supra note 23 aux pp 20 et s.
-
[126]
L’article 54 de la Loi sur la Cour suprême (supra note 1) prévoit que la Cour « composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre ». Il convient de noter que « projet de loi d’intérêt privé » ne signifie pas les projets introduits par les parlementaires ne faisant pas partie du gouvernement, mais vise réellement les lois cherchant à reconnaître des droits spécifiques à des individus, plutôt que des lois d’intérêt général (Mathen, supra note 7 à la p 71).
-
[127]
Les avis consultatifs de certaines juridictions internationales sont mentionnées in passim, sans analyse ou réelle comparaison toutefois, par les deux auteures, et par la Cour suprême dans le Renvoi sur la sécession, supra note 59 au para 14. Outre la CIJ, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de Justice de l’Union européenne peuvent également émettre des avis consultatifs. Au sujet de la CIADH, voir Eleanor Benz, « The Inter-American Court’s Advisory Function Continues to Boom – A few comments on the requests currently pending » (25 novembre 2019), en ligne (blogue) : EJIL-Talk <www.ejiltalk.org> [perma.cc/ZH74-6C2G].
-
[128]
Voir Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 no 7 (entrée en vigueur : 24 octobre 1945), art 96; Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, RT Can 1945 no 7 (entrée en vigueur : 24 octobre 1945), ch IV.
-
[129]
Voir Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 14e éd, Paris, Dalloz, 2018 aux pp 664–66; Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, Droit international public, 8e éd, Paris, LGDJ, 2009 aux pp 1006–10.
-
[130]
Voir Dupuy et Kerbrat, supra note 129 à la p 666.
-
[131]
Voir ibid à la p 682. Voir par ex Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, [1971] CIJ 16; La situation en Namibie, Rés CS 301, Doc off CS NU, 1598e séance, Doc NU S/RES/301 (1971) 7.
-
[132]
Voir Dupuy et Kerbrat, supra note 129, aux pp 641–42; Daillier, Forteau et Pellet, supra note 129 aux pp 1009–10. Ces derniers parlent de l’« autorité morale » des avis, qui est telle qu’ils font partie intégrante de la jurisprudence de la Cour.
-
[133]
Voir James R Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8e éd, Oxford, Oxford University Press, 2012 aux pp 730–32.
-
[134]
Sur la notion de culture juridique, voir David Nelken, dir, Comparing Legal Cultures, Aldershot (R-U), Dartmouth, 1997; Marie-Claire Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) Comparé(s), Paris, Economica, 2010 aux pp 118–28; René Provost, « Centaur Jurisprudence: Culture before the Law » dans René Provost, dir, Culture in the Domains of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 1 aux pp 1–19.
-
[135]
Voir Mathen, supra note 7 à la p 233.
-
[136]
Voir ibid à la p 221.
-
[137]
Voir Loi constitutionnelle de 1982, art 55, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
-
[138]
À titre d’exemple, les références aux écrits de Montesquieu sont incomplètes et renvoient largement à des écrits en anglais, datant des années 1960. Les références au droit comparé — et les allusions aux juridictions internationales — sont également essentiellement ancrées dans la littérature secondaire (voir par ex Mathen, supra note 7 aux pp 40 et s).
-
[139]
Mathen cite l’article de 2003 de Chevrette et Webber (supra note 6) sans vraiment analyser leurs propos (Mathen, supra note 7 à la p 6, n 29). Il n’est pas repris dans la riche bibliographie de Puddister qui ne cite aucun texte en français (Court’s Advice, supra note 8 aux pp 253–67), bien que son manuscrit découle d’une thèse doctorale réalisée à l’Université McGill.